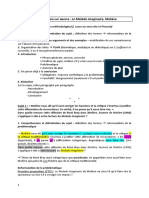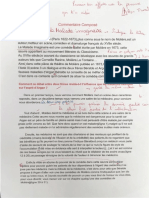Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Acte 3 Scene 3 Analyse Lineaire
Acte 3 Scene 3 Analyse Lineaire
Transféré par
pw2pbbzw4b0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
139 vues4 pagesTitre original
ACTE 3 SCENE 3 ANALYSE LINEAIRE
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
139 vues4 pagesActe 3 Scene 3 Analyse Lineaire
Acte 3 Scene 3 Analyse Lineaire
Transféré par
pw2pbbzw4bDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
BER: Béralde
ARG: Argan
Acte III scène 3
Intro:
Célèbre dramaturge et écrivain français, Jean-Baptiste Poquelin, plus connu sous le nom de Molière,
fut aussi comédien, chef de troupe et metteur en scène. Sous le règne de Louis XIV, il écrivit et mit
en scène des œuvres demeurées célèbre dans l’histoire du théâtre, comme Don Juan ou Le Bourgeois
gentilhomme. Dernière pièce de Molière, Le Malade Imaginaire, écrite en 1673, est une comédie-
ballet mettant en scène un bourgeois hypocondriaque, Argan, qui veut à tout prix que sa fille,
Angélique épouse un médecin. Mais celle-ci est amoureuse d’un certain Cléante. Plusieurs
personnages tentent d’aider la jeune fille en essayant de raisonner son père. Après TOIN, c’est au
tour de BER, dans l’acte III scène 3 d’essayer de convaincre son frère de renoncer à son projet. La
conversation les conduits à parler de la médecine, sujet sur lequel tous les deux ont des opinions
opposées.
LECTURE
Annonce du Plan :
-1er mouvement : leçon de tolérance de BER (L.1 à 5)
-2nd mouvement : une discussion aimée entre les frères (L.6 à 15)
-3ème mouvement : folie d’ARG (L.16 à 20)
Projet de lecture
Nous verrons en quoi cet extrait, au-delà d’une simple dispute entre deux frères, constitue une mise
en abyme qui nous parle du théâtre.
1er mouvement : leçon de tolérance de BER (L.1 à 5)
1) Un personnage mesuré
-BER est un personnage mesuré et raisonnable qui sait aussi s’affirmer
-> Tournure emphatique « Moi…je »
- « Mon frère » rappel les liens du sang ARG/BER
-> volonté de conciliation
-négation totale « ne…point »
-> refuser l’intolérance
- « combattre » objet de la négation relève du champ lexical de la guerre
->BER ne souhaite pas faire la guerre à la médecine mais montrer que certains médecins
manipulent les malades
-BER est ouvert d’esprit car il respect les croyances de tout le monde « tout ce qui lui plaît », il ne
veut pas faire de discours polémique
-pronom indéfini « chacun » + présent de vérité générale
-> renforcer la sagesse de son propos
-> A travers BER c’est Molière qui s’exprime qui veut lutter à tout prix contre la pensée unique
2) Une critique de l’extrémisme
-BER critique les médecins d’imposer leurs croyances en utilisant la violence
-Cette critique peut aussi être pour les dévots, grands ennemis de Molière
->Ils ont le même mode de fonctionnement : imposer une penser unique que refuse Molière.
-c’est alors un débat sur la croyance : « croire »
- « ne … que » BER ne cherche pas à imposer sa croyance
->Son objectif est de raisonner son frère en lui faisant prendre conscience de sa folie
-BER ne veut pas convertir son frère par la force : « un peu », conditionnel passé (« j’aurais
souhaité »)
->BER est qlq de modeste
-il est conscient que raisonner son frère est inutile -> conditionnel passé
-il ne condamne pas son frère -> « erreur » au lieu de « faute »
3) BER un avocat de Molière
-BER devient l’avocat de Molière
-les personnages discutent des pièces de Molière -> c’est une mise en abyme
-Cette mise en abyme fait rire, et permet au dramaturge de se justifier
-BER dit que les pièces de Molière permettent de prendre conscience de ses erreurs par le rire
(« tirer de l’erreur » // « divertir »)
-> « castigas mores ridendo » corriger les mœurs par le rire
Les comédies sont donc, pour Molière un remède moral, une médecine de l’âme.
-le nom du dramaturge est cité -> créer un effet de surprise qui va faire rire les spectateurs
-> mise en abyme qui rompt l’illusion théâtrale
2nd mouvement : Une discussion animée entre frère (L.6 à 15)
1) Condamnation de Molière par ARG
-ARG n’écoute pas son frère + il condamne Molière et ses comédies -> déterminant possessif
« votre », il se désolidarise de son frère et de Molière
- « c’est un … que … » tournure emphatique afin de souligner son accusation
-Oxymore « bon impertinent » x2 -> ironie sarcastique d’ARG à l’encontre de Molière.
-Oxymore est développé par l’antiphrase « bien plaisant, renforcée par l’adverbe « bien »
-L’expression « honnêtes gens » est comique car elle désigne les médecins alors que tout le monde
sait que les médecins sont des imposteurs dans les comédies de Molière sauf ARG qui est crédule
-> ARG défend les imposteurs qui se moquent de lui et accuse son créateur : accentue le rire
(comique de mots)
2) leçon d’humilité
-BER répond, tournure emphatique + négation -> Molière n’attaque pas des personnes (les
médecins) mais, ceux qui jouent à être médecins et ceux qui les crois
-Pour Molière la médecine =/= science mais = croyance car elle prétend savoir ce qui reste un
mystère dans le corps humain.
3) Gradation
- sagesse de BER ne calme pas son frère mais elle le met en colère, la scène se construit sur une
gradation
-tournure emphatique « c’est … », « voilà… » + oxymores antiphrastiques (« bon nigaud », « bon
impertinent ») + énumération (« se moquer », « s’attaquer », « s’aller ») -> augmentation de la
colère d’ARG
-Colère d’ARG est comique
-> elle prend la défense des gens que les spectateurs savent imposteurs ARG les appelles «
des personnes vénérables » ou encore « ces Messieurs-là » (M !)
->il fait des médecins des personnes sacrées -> la crédulité d’ARG fait sourire
- « se moquer des consultations, des ordonnances » -> fait penser aux scènes que l’on vient de voir
(acte 1 scène 1 pour les ordonnances ou acte 2 scène 6 pour les consultations) où les médecins sont
vus comme des charlatans et les apothicaires comme des voleurs
- la réponse de BER est sensée : si on peut mettre en scène des rois et des princes pourquoi pas des
médecins ?
- question rhétorique qu’ARG ne peut répondre puisqu’elle est fondée sur du bon sens
3ème mouvement : la folie d’ARG
1) La colère
-Face au dernier argument ARG redouble de colère, sa critique commence par un juron tronqué ce
qui montre sa hargne et fait sourire.
-le spectateur perçoit d’emblée ARG comme un personnage dominé par l’Hybris (la démesure)
-répétition de « crève » + exclamation montrent la folie et la cruauté d’ARG qui s’oublie en parlant
un langage très familier.
->ARG est animé par la vengeance et il se dresse comme un dieu vengeur pour châtier
« l’impertinence » des gens qui ne croient pas à la médecine
2) Mise en abyme
la scène atteint son acmé (point culminant) dans une mise en abyme vertigineuse
-ARG multiplier les rôles
-> il passe de malade imaginaire à médecin (« si j’étais que des médecins »), juge
(« ordonnerai »), bourreau (« crève !»).
-> Comique car la fonction de bourreau et de médecin se mélangent
-ARG devient aussi metteur en scène en imaginant une scène où Molière irait mourir sous le pouvoir
d’ARG + il s’adresse directement à lui « cela t’apprendra… »
-folie d’ARG apparait aussi grâce à l’utilisation du conditionnel (« je me vengerai », « aurais »,
« ordonnerais », « dirais ») qui lui permet d’imaginer une scène dans laquelle il se venge contre
Molière. -> ARG veut les pires châtiments pour son créateur, comique de situation
3) une scène comique
-Disproportion entre le châtiment promis par ARG et le résultat qui n’a rien d’effrayant -> puni des
saignées et des lavements -> comique car Molière se moque justement de ces méthodes. + le
spectateur s’amuse de ce qu’ARG imagine dans sa folie : Molière qui supplierait pour un lavement
(« il aurai beau faire et beau dire ! »)
-Molière jouait le rôle d’ARG : le voir s‘invectiver lui-même devait beaucoup faire rire son public
-Le personnage d’ARG apparaît donc comme aveuglé par sa folie et sa foi ridicule en la médecine
->Moyen très malin et imparable de se moquer ainsi de ses détracteurs : en le maudissant, ils
deviennent ainsi aussi ridicules qu’ARG
Conclusion :
Nous avons montré que ce dialogue entre l’hypocondriaque Argan et le raisonneur Béralde permet à
Molière de mettre en scène un débat sur la médecine. La sacralisation de la médecine par Argan est
ridicule, mais le raisonneur Béralde reste un personnage peu nuancé. Le lecteur/spectateur ne
pouvant considérer aucune de ces deux opinions comme véritablement crédibles, il lui reste à définir
la sienne. On observe ici comme la comédie de mœurs amuse tout en ouvrant le débat, cherche à
plaire et à instruire conformément à l’idéal classique du XVIIème siècle.
Vous aimerez peut-être aussi
- Parcours Spectacle Et ComédieDocument4 pagesParcours Spectacle Et ComédieYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Histoire Des Premiers Temps de L'islam 1 (La Vie Du Prophete (P) )Document173 pagesHistoire Des Premiers Temps de L'islam 1 (La Vie Du Prophete (P) )dazed100% (2)
- Le Malade ImaginaireDocument13 pagesLe Malade ImaginaireAly BossinPas encore d'évaluation
- Octave Mirbeau, À Un ProlétaireDocument4 pagesOctave Mirbeau, À Un ProlétaireAnonymous 5r2Qv8aonf100% (1)
- Fiche Technique Contrats ItalieDocument14 pagesFiche Technique Contrats ItalieIulia GeorgianaPas encore d'évaluation
- Isaac Assimov - Chante-ClocheDocument12 pagesIsaac Assimov - Chante-ClocheYounes BarakaPas encore d'évaluation
- BLL MOLIERE 2 Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 3 Extrait 2Document8 pagesBLL MOLIERE 2 Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 3 Extrait 2enza.guicheteauPas encore d'évaluation
- Le Roman de La MédecineDocument3 pagesLe Roman de La Médecinenb996nsczsPas encore d'évaluation
- 2 - Analyse Lineaire 2 - Moliere - Acte Iii Scene 3 - Le Malade ImaginaireDocument5 pages2 - Analyse Lineaire 2 - Moliere - Acte Iii Scene 3 - Le Malade ImaginairegaellecheronPas encore d'évaluation
- Analyse - Le Malade Imaginaire (3), MolièreDocument4 pagesAnalyse - Le Malade Imaginaire (3), MolièreFlavio SeromenhoPas encore d'évaluation
- Scène 3 Acte 3Document4 pagesScène 3 Acte 3stefetcat.neauleauPas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire-2Document4 pagesLe Malade Imaginaire-2riezjrif fsdjkfipsdjPas encore d'évaluation
- Plan Malade ImaginaireDocument9 pagesPlan Malade Imaginairelucas.denuellePas encore d'évaluation
- Molière Etude de Texte 9Document5 pagesMolière Etude de Texte 9spiti 64Pas encore d'évaluation
- El 3Document3 pagesEl 3InockyPas encore d'évaluation
- Analyse LinéaireDocument3 pagesAnalyse Linéaireoctave.noelPas encore d'évaluation
- Dissertation Correction Citation BeraldeDocument3 pagesDissertation Correction Citation BeraldelynamamryaPas encore d'évaluation
- MI Dissertation TP Rire Corrige HommeDocument5 pagesMI Dissertation TP Rire Corrige HommeLynna El ghannaouiPas encore d'évaluation
- Dissertation Le Malade ImaginaireDocument3 pagesDissertation Le Malade ImaginaireLéonie Séjourné100% (2)
- Malade ImaginaireDocument2 pagesMalade ImaginaireYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Texte 1 - Moliere DiafoirusDocument2 pagesTexte 1 - Moliere DiafoirusRyan CacoubPas encore d'évaluation
- 1S2TMD. EL 6 Malade Imaginaire - I.1 Portrait de l' Hypocondriaque Argan Avril 2024Document4 pages1S2TMD. EL 6 Malade Imaginaire - I.1 Portrait de l' Hypocondriaque Argan Avril 2024Valentin JacquemondPas encore d'évaluation
- BBE - 2021 - Dissert Moliere Beralde - Corr24 02 21Document3 pagesBBE - 2021 - Dissert Moliere Beralde - Corr24 02 21Mathis FournierPas encore d'évaluation
- Le Malade Imaginaire BacDocument2 pagesLe Malade Imaginaire Bacyanis schellPas encore d'évaluation
- Acte II Scène 5Document4 pagesActe II Scène 5charles.dclrqPas encore d'évaluation
- Lecture Linéaires MayaDocument13 pagesLecture Linéaires MayabeudetcameronPas encore d'évaluation
- Analyse - Le Malade Imaginaire (2), MolièreDocument3 pagesAnalyse - Le Malade Imaginaire (2), MolièreFlavio SeromenhoPas encore d'évaluation
- Lecture AnalytiquemolièreDocument2 pagesLecture AnalytiquemolièreEl MorjanePas encore d'évaluation
- Texte 8 MaladeDocument2 pagesTexte 8 MaladeLouise PanienPas encore d'évaluation
- Ex Dissertation Rédigée LMI Art CompletDocument3 pagesEx Dissertation Rédigée LMI Art CompletDcrx0% (1)
- Copie Du Bac Blanc Elisa Noraz 1G4Document3 pagesCopie Du Bac Blanc Elisa Noraz 1G4gabclercinPas encore d'évaluation
- Oral Bac 1 2Document4 pagesOral Bac 1 2marina.dumontPas encore d'évaluation
- Dissertation MolièreDocument12 pagesDissertation MolièreYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- 2 Piste de Correction (Sujet: Centre Étranger) Le Malade ImaginaireDocument4 pages2 Piste de Correction (Sujet: Centre Étranger) Le Malade Imaginairedroniouarthur100% (1)
- Thémes Et Motifs Clés Dans Le MIDocument4 pagesThémes Et Motifs Clés Dans Le MIjjm.laboriePas encore d'évaluation
- Extrait 13 Le Malade Imaginaire Acte III Scène 14Document4 pagesExtrait 13 Le Malade Imaginaire Acte III Scène 14Belachheb Bouchra100% (1)
- 1A Dissert MaladeDocument2 pages1A Dissert MaladeEmilie FotzePas encore d'évaluation
- Analyse - Le Malade Imaginaire (1), MolièreDocument3 pagesAnalyse - Le Malade Imaginaire (1), MolièreFlavio SeromenhoPas encore d'évaluation
- Img 3220Document1 pageImg 3220melvyn amedienPas encore d'évaluation
- Acte 1 Scène 2 M.I Analyse LinéaireDocument2 pagesActe 1 Scène 2 M.I Analyse LinéaireMathis ThyreaultPas encore d'évaluation
- Lee Malade Imaginaire ComiqueDocument3 pagesLee Malade Imaginaire Comiquerim nouriPas encore d'évaluation
- 1re Francais Moliere Le Malade Imaginaire Spectacle Et ComedieDocument3 pages1re Francais Moliere Le Malade Imaginaire Spectacle Et ComedieredahmamouchiiPas encore d'évaluation
- Texte 6 - Le Malade Imaginaire, Molière I, Scène 5)Document1 pageTexte 6 - Le Malade Imaginaire, Molière I, Scène 5)evasegura2007Pas encore d'évaluation
- Lecture Linéaire M.I. Acte III, 10Document2 pagesLecture Linéaire M.I. Acte III, 10spidermanflash8Pas encore d'évaluation
- MI Essentiel Pour La DissertDocument8 pagesMI Essentiel Pour La Dissertdd7kqtmx7gPas encore d'évaluation
- Analyse Linéaire 8Document2 pagesAnalyse Linéaire 8Tjrjff VkgkfkfkfPas encore d'évaluation
- Quentin OffDocument3 pagesQuentin Offquentin.cheze03Pas encore d'évaluation
- Texte 5 - Le Malade Imaginaire, Molière I Scène 1Document1 pageTexte 5 - Le Malade Imaginaire, Molière I Scène 1evasegura2007Pas encore d'évaluation
- Malade Imaginaire PrésentationDocument2 pagesMalade Imaginaire PrésentationInfinityPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document3 pagesChapitre 3667 X lzPas encore d'évaluation
- 1G6 Molière LA N°5 SC d' Expo DétailDocument4 pages1G6 Molière LA N°5 SC d' Expo Détailmaissamessah07Pas encore d'évaluation
- Texte 8 COMMENTAIRE Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 14Document3 pagesTexte 8 COMMENTAIRE Le Malade Imaginaire Acte 3 Scène 14mazouna 3Pas encore d'évaluation
- Malade-Imaginaire Blog-GallicaDocument8 pagesMalade-Imaginaire Blog-GallicaConanPas encore d'évaluation
- DISSERTATIONS Molière Ou COMMENTAIRE Feydeau 8 PointsDocument4 pagesDISSERTATIONS Molière Ou COMMENTAIRE Feydeau 8 Pointszorlu.ayse2005Pas encore d'évaluation
- Correction Dissertation Moliere 2Document3 pagesCorrection Dissertation Moliere 2mariawaked9Pas encore d'évaluation
- Texte MolièreDocument4 pagesTexte MolièrecolitohgPas encore d'évaluation
- FR 1Document6 pagesFR 1lacailleromain17Pas encore d'évaluation
- LL6 - Acte I Scène 5-Toinette S'oppose Au MariageDocument4 pagesLL6 - Acte I Scène 5-Toinette S'oppose Au MariageRébéca NsukaPas encore d'évaluation
- LDP CompletDocument438 pagesLDP CompletDiego Matos GondimPas encore d'évaluation
- Pistes Correction MolièreDocument6 pagesPistes Correction MolièrevPas encore d'évaluation
- Reviser Pour La Dissertation Sur Le Malade ImaginaireDocument52 pagesReviser Pour La Dissertation Sur Le Malade Imaginairezorlu.ayse2005Pas encore d'évaluation
- Toinette en MédecinDocument3 pagesToinette en Médecinnb996nsczsPas encore d'évaluation
- EL 17 - CC PlanDocument1 pageEL 17 - CC Planmartinez.sarl22Pas encore d'évaluation
- Examen Du Bac Blanc Du 3e Trimestre 3AS.3ASGE 1er Sujet FrançaisDocument2 pagesExamen Du Bac Blanc Du 3e Trimestre 3AS.3ASGE 1er Sujet FrançaisMohammed Belmili100% (4)
- Dice Throne Journey1.1Document5 pagesDice Throne Journey1.1Michonne FrancescaPas encore d'évaluation
- Zouhari Mohamed 3Document2 pagesZouhari Mohamed 3mohamed zouhariPas encore d'évaluation
- Bilan Des Realisations 2016-FrDocument338 pagesBilan Des Realisations 2016-FrimaPas encore d'évaluation
- 15 Le Petit Armé de GédéonDocument17 pages15 Le Petit Armé de GédéonBENIT MVUEZOLOPas encore d'évaluation
- FAGFWGDASAVDDDocument77 pagesFAGFWGDASAVDDHào PhạmPas encore d'évaluation
- Fichier de 0 A 40Document12 pagesFichier de 0 A 40Mohammed ZOUITANEPas encore d'évaluation
- Premier Bet DR Congo - Premier Bet N°1 Des Paris SportifsDocument1 pagePremier Bet DR Congo - Premier Bet N°1 Des Paris SportifsGwen LufumaPas encore d'évaluation
- Devoir DC4-2 Du 4 Juin - EmmaDocument3 pagesDevoir DC4-2 Du 4 Juin - Emmagasilove777Pas encore d'évaluation
- La Lune Et Le CaudilloDocument22 pagesLa Lune Et Le CaudilloRafael Bastos0% (1)
- Bepc Blanc 2024 SVT Local Gagnoa (Nouveau)Document3 pagesBepc Blanc 2024 SVT Local Gagnoa (Nouveau)arsene BATAWUILAPas encore d'évaluation
- Le Mois de RadjabDocument6 pagesLe Mois de RadjabSerigne M. M. SallPas encore d'évaluation
- (FrenchFrench (Z-Library)Document241 pages(FrenchFrench (Z-Library)Endjy LaguerrePas encore d'évaluation
- Cuadro de Amortización Mes Cuota Amortización Interés SaldoDocument2 pagesCuadro de Amortización Mes Cuota Amortización Interés SaldoMarvin Duberly Romero BardalesPas encore d'évaluation
- Calcul Mental Fiche 23Document8 pagesCalcul Mental Fiche 23hannePas encore d'évaluation
- Assemblage Support Statique 1 2Document17 pagesAssemblage Support Statique 1 2CR7 BijoPas encore d'évaluation
- La Légion, RAIDS N°26,1988.júliDocument31 pagesLa Légion, RAIDS N°26,1988.júliLaszlo Kantor100% (2)
- La Dislocation Du Djolof Et L'émergence de Nouveaux RoyaumesDocument3 pagesLa Dislocation Du Djolof Et L'émergence de Nouveaux Royaumesly2022aminataPas encore d'évaluation
- 4 - Pathologisation Du Sexe Dans La SocieteDocument3 pages4 - Pathologisation Du Sexe Dans La SocietemelodyPas encore d'évaluation
- Regles de Rotzball-V4Document3 pagesRegles de Rotzball-V4paul moud ubid100% (2)
- Engels - Lettre À Joseph BlochDocument2 pagesEngels - Lettre À Joseph BlochSherlock DestinyPas encore d'évaluation
- L'invocation Dite QûnutDocument6 pagesL'invocation Dite QûnutmouniraladinaPas encore d'évaluation
- Lettre de Messadi À MalrauxDocument11 pagesLettre de Messadi À MalrauxnachazPas encore d'évaluation
- Livret Rituels Calcul Mental Ce1Document7 pagesLivret Rituels Calcul Mental Ce1berthenancyPas encore d'évaluation
- Hefele. Histoire Des Conciles D'après Les Documents Originaux. 1869. Vol. 10Document610 pagesHefele. Histoire Des Conciles D'après Les Documents Originaux. 1869. Vol. 10Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- FR5152-A Propos Dominus IesusDocument9 pagesFR5152-A Propos Dominus IesusMaria CrucisPas encore d'évaluation