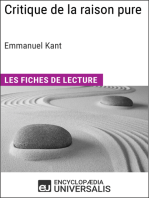Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Lacharite Lisons Kant PDF
Lacharite Lisons Kant PDF
Transféré par
qsdfqsdfqsfTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Lacharite Lisons Kant PDF
Lacharite Lisons Kant PDF
Transféré par
qsdfqsdfqsfDroits d'auteur :
Formats disponibles
U n i v e r s i t d u Q u b e c M o n t r a l
_____________________________________________________________________________________________
L i s o n s K a n t
K
A n a l y s e s , co m m e n t a i r e s , pa r a p h r a s e s , r s u m s et t a b l e a u x
p o u r ai d e r l i r e
l a C r i t i q u e d e l a r a i s o n p u r e
e t l a C r i t i q u e d e l a f a c u l t d e j u g e r
p a r N o r m a n d L a c h a r i t
p r o f e s s e u r a u d p a r t e m e n t d e p h i l o s o p h i e
_____________________________________________________________________________________________
M o n t r a l , m a i 1 9 9 7
Pierre Poirier,
philosophe,
porteur de lesprit de la Critique
et dautres Lumires
1997 Normand Lacharit
Dpt lgal: 2
e
trimestre 1997.
Ouvrage reproduit et reli par les Services de reprographie de lUniversit du Qubec Montral.
5
A v a n t - p r o p o s
trois reprises, jai donn le cours Phi-4013 Kant cest un cours rgulier de 45 h, donn en une session
des tudiants du baccalaurat en philosophie de lUniversit du Qubec Montral. Le prsent ouvrage reproduit
les notes progressivement labores au cours de cet enseignement, ainsi que des dveloppements nouveaux
introduits dans le thme #11. Le criticisme: une reconstruction daprs la Critique de la facult de juger et rdigs
au printemps de 1997.
Jai chaque fois conu cet enseignement comme loccasion de confronter les tudiants au texte mme de
Kant, en traduction franaise. Aussi ai-je voulu limiter mon intervention une prsentation des thses qui ne soit
gure plus quun prsentation des textes. Mon effort a t centr sur ltude de texte et jai tent de varier les
techniques qui permettent lidentification et la prsentation des contenus textuels. Le caractre particulier de ces
objectifs explique, dune part, que mon lecteur ne trouvera presque rien ici de mes rflexions personnelles (mme
propos de Kant) et trouvera au contraire une profusion (peut-tre mme excessive) de citations et de rfrences. Ces
deux caractres seraient inadmissibles dans un ouvrage philosophique du genre essai ou dans un ouvrage dhistoire
de la philosophie. Cependant je ne crois pas devoir ici offrir des excuses mon lecteur, pour ces dfauts quentrane
assez naturellement la particularit de mes objectifs, compte tenu du contexte institutionnel.
Par ailleurs, les notes prsentes ici ne traitent pas de la mme faon les deux Critiques: a) de la Critique de la
facult de juger je ne mattache pas systmatiquement au texte; je fais plutt une reconstruction rationnelle des
rapports que Kant y tablit entre les facults; ce faisant, je tiens compte de lensemble de louvrage mais je ne
procde pas par prsentation systmatique de ses parties. Le contexte de ma reconstruction rationnelle est le
problme gnral de la cohsion du dcoupage des facults dans le criticisme. b) de la Critique de la raison pure je
prsente lessentiel de lEsthtique et de lAnalytique; mais je laisse de ct de larges parties de la suite et me dois
den prvenir ici respectueusement le lecteur: je couvre les Paralogismes de la raison pure (en suivant le texte de la
deuxime dition), mais de lAntinomie de la raison pure je ne prsente que les sections 7, 8 et 9 aprs avoir
rsum larticulation des neuf sections; mon travail sur la Dialectique sarrte l, de sorte que le lecteur ne trouvera
rien sur lIdal de la raison pure troisime chapitre de la Dialectique. Je nai pas de notes non plus sur le long
Appendice la Dialectique, ni sur la Mthodologie transcendantale sauf pour son chapitre III sur
lArchitectonique de la raison pure, utilis ds le dbut des notes.
La prsentation matrielle du texte naura sans doute pas atteint le degr de fini que jaurais souhait et que
jaurais pu atteindre moyennant un peu plus de temps. Cest seulement au printemps de 1997 que jai convenu dun
certain nombre de rgles applicables aux divers problmes de graphie et de typographie quun ouvrage savant doit
professionnellement rsoudre. On trouvera lnonc de ces conventions dans lAppendice 7, la fin du volume.
Lapplication de ces rgles aux dizaines de pages antrieurement rdiges aura t faite de faon plus expditive que
systmatique. Pour les imperfections qui subsistent, je prsente volontiers mes excuses mon lecteur et sollicite sa
bienveillance.
Normand Lacharit, professeur.
Eastman, dcembre 1997
7
K <> T h m e # 1 <> K
1 . L e s c o n t e x t e s d e
l a C r i t i q u e d e l a r a i s o n p u r e
1. Les contextes de la Critique de la raison pure ............................................................................................7
1.1 Les trois contextes: vue densemble..................................................................................................... 7
1.2 La Critique de la raison pure parmi les disciplines mtaphysiques......................................................9
1.2.1. Position gnrale du problme.....................................................................................................9
1.2.2. La manire dont Kant sexprime dans lArchitectonique de la raison pure ..........................10
1.2.3. Le problme du rapport entre la Critique de la raison pure et le systme (des
connaissances) de la raison pure................................................................................................13
1.2.3.1 Lanalyse des textes kantiens faite par Roger Verneaux..................................................13
1.2.3.2 La solution propose par Normand Lacharit au problme de la distinction entre
critique et systme de la raison pure................................................................................. 15
1.3 La Critique de la raison pure parmi les trois Critiques La typologie des facults de lesprit........18
1.3.1 Raison pure et raison pratique....................................................................................................18
1.3.2 Les pouvoirs de lesprit: la connaissance, le dsir, le plaisir..................................................... 19
1.4 La Critique de la raison pure parmi les doctrines philosophiques de la connaissance et de
lexistence humaine Lidalisme transcendantal entre le rationalisme et lempirisme.................21
1.4.1 Autonomie de la connaissance humaine eu gard labsolu..................................................... 21
1.4.2 Autonomie de la morale eu gard au savoir (la science)...........................................................23
1.4.3 Autonomie de la Critique eu gard lexprience (et lhistoire?) ..........................................23
1.1 Les trois contextes: vue densemble
I. La place de la Critique de la raison pure dans le systme des connaissances de la raison pure; ou: la place de
la Critique dans lensemble de la MTAPHYSIQUE.
la raison pure que Kant se propose de soumettre la critique nest autre que la mtaphysique de
lcole wolffienne. (Caygill, H., KD 291.3.1-2) Dans cette cole, la mtaphysique est divise en quatre
parties:
lontologie, ou mtaphysique gnrale, qui avait pour objet, dans les termes de Wolff, les premiers
principes de notre connaissance et des choses en gnral;
la psychologie, qui avait pour objet lme;
la cosmologie, qui avait pour objet le monde;
la thologie, qui avait pour objet Dieu.
Les trois dernires parties formaient la mtaphysique spciale. Il est remarquable que cet
ordonnancement se retrouve dans la Critique de la raison pure: lAnalytique transcendantale traite sa
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
8
faon de lontologie; et les trois sections de la Dialectique transcendantale considrent les thmes des
trois parties traditionnelles de la mtaphysique spciale: lme, le monde et Dieu.
Cependant, la Critique nest pas prsente par Kant comme une nouvelle mtaphysique, apte se
substituer celle de lcole dominante, mais comme une propdeutique toute mtaphysique
future. Ce qui pose deux types de problmes:
le problme des rapports entre le criticisme et la (ou les) mtaphysique existante: quest-ce qui en est
dmoli, quest-ce qui en est maintenu?
La Critique a-t-elle sonn le glas de la mtaphysique?
le problme de la distinction, dans loeuvre de Kant lui-mme, entre ce qui appartient la propdeu-
tique et ce qui en est lapplication, au cours de llaboration des doctrines mtaphysiques qui doivent
offrir les principes et autres connaissances quil est possible de driver des seuls pouvoirs de la
raison pure (donc connaissances synthtiques a priori) concernant les objets traditionnels de la
mtaphysique. Voir lARCHITECTONIQUE DE LA RAISON PURE.
II. La place de la Critique de la raison pure parmi les trois critiques: quels sont les rapports entre raison pure,
raison pratique et facult de juger? Ou: la place de la raison pure parmi les autres FACULTS.
Quand on distingue les Critiques au moyen dun ordinal, on fait rfrence leur date de premire
parution :
la premire Critique est la Critique de la raison pure, publie en 1781;
la deuxime est la Critique de la raison pratique, publie en 1788;
la troisime est la Critique de la facult de juger, publie en 1790.
Le rapport entre raison pure et raison pratique. Dans larchitectonique de la raison pure, on voit une
trace du rapport entre raison pure et raison pratique, du fait qu un certain niveau darticulation
apparaisse une relation entre la mtaphysique des moeurs et la mtaphysique de la nature. Mais linter-
prtation de cette relation montre immdiatement que raison pure ne soppose pas du tout raison
pratique, comme on pourrait tre tent de le supposer en voyant les titres des deux premires Critiques.
Le rapport entre raison et facult de juger.
en juger superficiellement par les titres des trois Critiques, on pourrait penser que les deux
premires traitent de la raison et la troisime de la facult de juger, et imaginer une sorte
dopposition entre raison et facult de juger; ce rapport varierait selon que lon associerait
lentendement la facult de juger ou la raison. Ces suggestions sont trompeuses; il faut leur
rsister.
Mais si la Critique de la raison pure prsente une thorie des pouvoirs dvolus lentendement et
dvolus la raison, pourquoi Kant a-t-il rdig la troisime critique: quel est le rapport entre
lentendement dont la thorie est faite dans la premire Critique (peut-tre aussi dans la deuxime)
et la facult de juger dont la thorie est prsente dans la troisime?
La rponse cette question a deux volets:
1. la distinction entre usage dterminant et usage rflchissant de lentendement et de la raison.
2. la typologie des facults qui prcise la nature et la fonction de la reprsentation prsente en
lesprit. Cette typologie distingue la facult de connatre, celle de dsirer et celle dprouver du
plaisir ou de la peine. Cette typologie fait ressortir les fonctions des pouvoirs de lesprit dans
chaque cas et les fonctions correspondantes des reprsentations; et on dcouvre une ordonnance
que ne laisse pas voir larbre de larchitectonique, savoir:
que la raison nest pas seulement une facult de connatre, mais aussi une facult de dsirer, en
ce sens quelle possde un usage qui la fait intervenir sur la volont. Ce dont rend compte la
Critique de la raison pratique.
que lentendement nest pas seulement une facult de connatre, mais aussi une facult qui
permet dprouver du plaisir ou de la peine et qui, en cette fonction spcifique, contribue la
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
9
production de jugements dune sorte tout fait spciale dont la thorie est faite dans la Critique
de la facult de juger et non pas dans la Critique de la raison pure.
que la facult de juger, enfin, est parfois une facult de connatre et parfois non Ce qui
demandera certes des claircissements.
III. La place de la Critique de la raison pure parmi les DOCTRINES philosophiques de la connaissance et de
lexistence humaine. ENJEUX ET IMPACTS. La fonction de lentreprise critique en tant que science des
limites de la raison humaine.
Je tenterai de dcrire la spcificit de cette place au moyen des concepts dautonomie et de limite; la force de
la revendication dautonomie est conditionne par la reconnaissance dune limite corrlative.
Autonomie de la connaissance humaine eu gard labsolu, dans les limites de lexprience possible et
de la dimension temporelle de lactivit de recherche. (Il sagit de la temporalit de lagir du chercheur et
non de celle du phnomne.)
Le rapport la tradition antrieure: La fin du primat de labsolu; Kant pense dabord la finitude,
ensuite lAbsolu ou la divinit.
Le rapport la tradition postrieure.
Autonomie de la morale eu gard au savoir (la science), dans les limites de la temporalit et de lusage
pratique de la raison.
Autonomie de la Critique eu gard lexprience (et lhistoire?), dans les limites du transcendantal
(considr comme point de vue, comme mthode et, en particulier, comme mthode dargumentation).
Le rapport la tradition antrieure. Naissance de la philosophie transcendantale.
La question de savoir quelles oeuvres de Kant appartiennent cette philosophie.
Le rapport la tradition postrieure.
Comment se comparent la conception que K. se faisait de la philosophie transcendantale et celle
qui a cours aujourdhui sous ce nom.
1.2 La Critique de la raison pure parmi les disciplines mtaphysiques
1.2.1. Position gnrale du problme
Est-ce une pistmologie, au sens o ce terme circule au XX
e
sicle?
est-ce une philosophie transcendantale?
est-ce une mtaphysique? une propdeutique une mtaphysique?
Le problme est pos dans lintroduction de Rousset (dition Garnier-Flammarion de 1976). En expliquant
que la CRPu a des lacunes (qui la rendent dautant plus difficile comprendre), Rousset prcise
que [la CRPu] nest que la propdeutique grce laquelle la connaissance possible est rapporte
aux facults de lesprit humain, mais quelle na de sens que dans la mesure o elle saccomplit dans
une mtaphysique qui russit construire la dtermination scientifique de lobjet connaissable, et
o elle fait partie dune philosophie transcendantale, qui doit tre le systme achev de toutes les
ides et de tous les principes requis pour la pense unifie de ltre dans la connaissance et dans
laction.
(Prsentation, CRPu, Bar 20.1)
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
10
1.2.2. La manire dont Kant sexprime dans lArchitectonique de la raison pure
La notion darchitectonique CRPu, Bar 621.
Jentends par architectonique lart des systmes. (621.1.1)
lunit systmatique fait passer dun agrgat un systme [proposition tenant lieu de dfinition pour
le concept de systme; la proposition sera plus explicite ci-aprs]
la science est une connaissance qui a acquis un caractre dunit systmatique
(Conclusion 1) larchitectonique est donc la thorie de ce quil y a de scientifique dans notre
connaissance en gnral 621.1
(Conclusion 2) Larchitectonique appartient la mthodologie.
Le concept rationnel scientifique contient donc la fin et la forme du tout qui concorde avec lui. (621.2)
jentends par systme lunit des diverses connaissances sous une ide. Dfinition.
Cette ide est le concept rationnel de la forme dun tout, en tant que la sphre des lments et la
positon respective des parties y sont dtermines a priori.. 621.2)
[le schme] qui rsulte dune ide (o la raison fournit a priori les fins et ne les attend pas empirique-
ment), celui-l fonde une unit architectonique. (622.1)
Lide, pour tre ralise, a besoin dun schme
schme = diversit et ordonnance des parties
le schme qui nest pas form daprs une ide, cest--dire daprs une fin capitale de la raison, mais
empiriquement, suivant des vues accidentelles (dont on ne peut savoir davance la quantit <Menge>)
ne donne quune unit technique.
Les divers sens du mot mtaphysique selon les contextes demploi.
Si je fais abstraction de toute matire de la connaissance, considre objectivement, toute connaissance est
alors, subjectivement, ou historique ou rationnelle. (CRPu, Bar 623.2.1-3) Attention: les qualificatifs historique
et rationnel peuvent galement sentendre objectivement. Aussi peut-il y avoir une connaissance objectivement
philosophique et subjectivement historique (exemple: la connaissance philosophique de la plupart des tudiants)
Connaissance historique cognitio ex datis; donne quelquun du dehors (exprience immdiate, rcit,
instruction); nest pas rsulte de la raison.
Connaissance rationnelle cognitio ex principiis. puises aux sources gnrales de la raison (624.1)
celle qui a lieu par construction de concepts: la mathmatique
celle qui a lieu par concepts: la philosophie. La philosophie, en tant que systme de toute connaissance
philosophique, est la simple ide dune science possible, qui nest donne nulle part in concreto, mais dont
on cherche se rapprocher (CRPu, Bar 624.3)
concept scolastique de la philosophie: un systme de la connaissance, qui nest cherch que comme
science, sans que lon ait pour but quelque chose de plus que lunit systmatique de ce savoir, par
consquent la perfection logique de la connaissance.. Le philosophe est un artiste de la raison,
comme le mathmaticien, le physicien, le logicien.
concept cosmique <Weltbegriff> de la philosophie: science du rapport de toute connaissance aux fins
essentielles de la raison humaine (teleologia rationis humanae) (CRPu, Bar 625.2.m7-5), concept
reprsent dans le type idal du philosophe, considr comme lgislateur de la raison humaine. Nous
dterminerons avec plus de prcision ce que la philosophie prescrit, daprs ce concept cosmique, du
point de vue des, pour une unit systmatique. CRPu, Bar 625.3.4f)
la philosophie morale, ou la morale, qui soccupe de la fin ultime de la raison, de la destination
totale <die ganze Bestimmung des Menschen> de lhomme, qui a pour objet la libert; la loi
morale.
la philosophie de la nature.
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
11
Toute philosophie est ou une connaissance par raison pure, ou une connaissance rationnelle par principes
empiriques. La premire sappelle philosophie pure, et la seconde philosophie empirique. (CRPu, Bar 626.3)
philosophie empirique; appele aussi philosophie applique CRPu, Bar 630.3.m5). Elle contiendrait une
vaste anthropologie (formant le pendant de la physique empirique) (631.1.2f) o lon retrouvera la
psychologie empirique.
philosophie de la raison pure. Elle se divise en:
propdeutique (un exercice prliminaire) qui tudie le pouvoir de la raison par rapport toute
connaissance pure a priori, et elle sappelle alors critique.
mtaphysique: systme de la raison pure (la science), toute la connaissance philosophique (vraie ou
apparente) venant de la raison pure dans un ensemble systmatique (CRPu, Bar 626.4.4-7)
mtaphysique de lusage spculatif de la raison pure, ou mtaphysique de la nature. Aussi:
mtaphysique, au sens troit qui est le sens habituel.
mtaphysique de lusage pratique de la raison pure, ou mtaphysique des moeurs.
Cette dichotomie connecte avec la dichotomie terminale de larborescence prcdente.
(M1) la mtaphysique, au sens large: ensemble des connaissances de la raison pure.
critique de la raison pure: connaissance de la raison pure par elle-mme; = propdeutique M2; = esquisse
de la philosophie transcendantale.
(M2) la mtaphysique, au sens troit: en tant que systme de la raison pure et philosophie comme doctrine.
mtaphysique des moeurs: mtaphysique de lusage pratique de la raison pure
(M3) mtaphysique de la nature, ou partie spculative de la mtaphysique au sens troit (M2):
mtaphysique de lusage spculatif, ou thorique, de la raison pure
la philosophie transcendantale: ne considre que lentendement et la raison mme dans un systme
de tous les concepts et de tous les principes qui se rapportent des objets en gnral, sans admettre
des objets qui seraient donns (ontologia) (CRPu, Bar 629.1.4-7)
la physiologie (mais purement rationnelle); elle considre la nature, cest--dire lensemble des
objets donns (quils soient donns aux sens, ou, si lon veut, une autre espce dintuition) CRPu,
Bar 629.1.7-10)
la physiologie immanente: lusage de la raison y est physique, ou immanent; la physiologie
immanente considre la nature comme lensemble des objets des sens, par consquent telle
quelle nous est donne, mais seulement suivant les conditions a priori sous lesquelles elle peut
nous tre donne en gnral. (CRPu, Bar 629.2.2-5)
Voil une mtaphysique de la nature en un sens compatible avec la critique
(Florence Khodoss, Les grands textes, 217.2)
la physique rationnelle (ou mtaphysique de la nature corporelle): considre les objets des
sens extrieurs, en tant quils constituent la nature corporelle.
la psychologie rationnelle (ou mtaphysique de la nature pensante): considre lobjet du
sens intime, lme, et, suivant les concepts fondamentaux de lme en gnral, la nature
pensante. (CRPu, Bar 629.2.7-9)
la physiologie transcendante: lusage de la raison y est hyperphysique, ou transcendant, cest--
dire quil soccupe de cette liaison des objets de lexprience qui dpasse toute exprience
(CRPu, Bar 629.1.m8-7).
mtaphysique au sens ordinaire du mot, aussi bien traditionnel que moderne
(F. Khodoss, Les grands textes, 217.3)
la cosmologie transcendantale, ou cosmologie rationnelle,ou la physiologie de toute la
nature (CRPu, Bar 629.1.m4-3): la liaison dont elle soccupe est interne;
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
12
la thologie transcendantale, ou thologie rationnelle, ou la physiologie de lunion de
toute la nature avec un tre lev au-dessus de la nature (CRPu, Bar 629.1.2f). La liaison
dont elle soccupe est externe.
Mtaphysique M1
CRPu
(prop M2)
(esquisse de philo tscdtle)
M2
(mphys., sens moyen)
syst. de la RPu
M3.1
(mphys. des moeurs)
Conn-ces de RPu
re: usage pratique de la RPu
M3.2
(mphys. de la nature)
Conn-ces de RPu
re: usage spculatif de la RPu
Phil. trscdtle
syst. de tous les concepts qui
se rapportent des objets en
gnral [] ONTOLOGIE
Physiologie de la RPu
immanente
Physica rationalis
Psychologia
rationalis
transcendante
cosmologie
trscdtle
thologie trscdtle
Extrait de Albert Rivaud, commentant la dfinition de la philosophie transcendantale donne dans lOpus
posthumum :
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
13
Lobjet [de la philosophie transcendantale] est de dgager les principes mtaphysiques de toutes les
autres sciences mtaphysiques et notamment des deux plus importantes, mtaphysique de la Nature
et mtaphysique des moeurs. On appelle mtaphysique, une science portant sur la forme de la
connaissance, dans le mesure o cette forme autorise, entre certaines limite, une connaissance
rationnelle ou a priori, sans aucun recours lexprience. Une telle science comporte un
enchanement rigoureux de principes.
(p. 255.2 de: RIVAUD, Albert, Histoire de la philosophie, tome V,
Premire partie De lAufklrung Schelling, Paris, P.U.F., 1968.)
Rivaud mentionne galement que Kant se tient pour linventeur de ladite dfinition de la philosophie trans-
cendantale.
1.2.3. Le problme du rapport entre la Critique de la raison pure et le systme (des
connaissances) de la raison pure
LA RAISON PURE COMME FACULT VERSUS LA RAISON COMME ENSEMBLE DE CONNAISSANCES
PRODUITES PAR LEXERCICE DE LA RAISON PURE
Les termes de lopposition peuvent tre caractriss ainsi:
en tant que facult, la raison (pure) est objective
comme objet tudier, ayant son fonctionnement
comme auteur et agent de la Critique considre comme une dmarche intellectuelle.
en tant quoeuvre ou systme, la raison est objective comme ensemble des connaissances thoriques
quil est possible de produire en se servant de la raison. Cet ensemble comprend toutes les sciences de la
raison, les livres et [les] systmes de la raison pure (CRPu, Bar 74.1.3-4)
LES CONNAISSANCES PURES RELATIVES LA RAISON ELLE-MME (ET AUX AUTRES POUVOIRS DE
LESPRIT) VERSUS LES CONNAISSANCES PURES RELATIVES LA NATURE* (DONT LA RAISON PURE FAIT
ELLE-MME PARTIE)
*Nature sentend ici comme un objet dtude gnral, avant la distinction entre ontologie et
physiologie, cest--dire avant la distinction entre objets possibles et objets donns.
On prend le deuxime terme de lopposition prcdente (facult vs oeuvre), et on le divise son tour.
Cette opposition est celle du rapport entre la critique et la mtaphysique, considres toutes deux comme
ensemble de thories et de thses. Le premier discours thorique prend pour objet la raison en gnral, entendue
comme lenglobant de tous les pouvoirs de lesprit; le second prend pour objets la nature et la libert.
La critique tablit les pouvoirs et les moyens de la raison pure; cest une activit et son produit. La critique
peut sentendre la fois comme un travail (dmarche intellectuelle) et comme une oeuvre. La mtaphysique est
lactivit qui met en exercice ces pouvoirs et moyens ainsi que le produit de cette activit. (Mtaphysique comme
travail vs mtaphysique comme oeuvre.)
1.2.3.1 Lanalyse des textes kantiens faite par Roger Verneaux
Le traitement que donne Verneaux I, dans son chapitre II Propdeutique et systme, p. 37-51 est
instructif, du fait quil rassemble les diverses dclarations de Kant se rattachant ce problme, mais son interpr-
tation des textes kantiens nutilise aucun moment la distinction entre travail et oeuvre. Je conjecture que labsence
de cette distinction contribue considrablement dramatiser et, tout compte fait, rendre insoluble le problme de la
nature des relations entre la critique et la mtaphysique.
Le problme des relations entre critique et philosophie transcendantale nest quune variante du prcdent,
entrane par le flottement smantique dont le terme mtaphysique est affect; la question de savoir si la
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
14
philosophie transcendantale est dj ralise, ou seulement esquisse, par la critique demande la clarification du
rapport entre critique (de la raison pure) et systme (de la raison pure), le mme rapport que pour la question
impliquant la mtaphysique.
Le plan de Verneaux est intressant:
0. Position du problme: Kant dclare 25 fois en CRPu que la critique est une propdeutique la
mtaphysique et affirme pourtant, dans la Dclaration concernant la doctrine de la science de Fichte, le
28 aot 1799:
Je trouve inconcevable loutrecuidante affirmation que jaie voulu seulement crire une
propdeutique la philosophie transcendantale, non le systme mme de cette philosophie.
Jamais une intention pareille na pu me venir lesprit, puisque jai moi-mme fait remarquer
que lachvement total de la philosophie pure, dans la Critique de la raison pure, tait le
meilleur indice de la vrit de cette dernire (Ak. XII, 396-97).
(Cit par Verneaux, Ver, VK-I 37-38)
1. Le plan du systme (38).
2. Critique et mtaphysique (44)
3. Critique et philosophie transcendantale (47)
4. Conclusion (50)
En 1, Verneaux rappelle le plan donn par Kant dans lArchitectonique de la raison pure et fait quelques
observations:
Kant appelle ontologia la philosophie transcendantale. Il avait, dans CRPu, fait une remarque sur
lutilisation de ce mot comme titre (dune doctrine):
Le titre pompeux dune ontologie qui prtend donner, des choses en gnral, une connaissance
synthtique a priori dans une doctrine systmatique (p. ex. le principe de causalit) doit faire place
au titre modeste dune simple analytique de lentendement pur (T.P. 258) (Ver, VK-I 39.4)
il reste tonnant que la philosophie transcendantale ne soccupe pas des ides de la raison. (Ver, VK-
I 40.1)
Trois difficults concernant linterprtation du plan du systme:
D1 pourquoi la mtaphysique de la nature comporte deux parties, la cosmologie et la thologie
transcendantales, dont la critique a dmontr quelles ne peuvent fournir aucune connaissance (Ver,
VK-I 40.3.1-4)?
D2 pourquoi la psychologie transcendantale ne figure-t-elle pas dans la physiologie transcendante,
ct de la cosmologie et de la thologie transcendantale? (Ver, VK-I 40.4) Pourquoi pas une
psychologie transcendantale et une psychologie rationnelle, redoublement et distinction qui
imiteraient ceux du couple cosmologie transcendantale et physique rationnelle?
Je reviendrai sur cette question lors de mes considrations sur le rapport entre le criticisme et les
sciences cognitives contemporaines. Il faudra commenter laffirmation kantienne selon laquelle il
nexiste pas de science de la nature pensante vu que
1 dans toute thorie particulire de la nature, il ny a de science proprement dite quautant quil sy
trouve de mathmatique [ et]
2les mathmatiques ne peuvent sappliquer aux phnomnes du sens interne (Premiers
principes mtaphysiques de la science de la nature, 1786, Prface, trad. Gibelin, 11-12).
Je voudrai tenir compte aussi du fait que Kant bannit la psychologie empirique de la
mtaphysique et la renvoie avec la physique proprement dite (la physique empirique) [] du ct
de la philosophie applique, dont la philosophie pure contient les principes a priori, et avec laquelle
par consquent elle doit tre unie, mais non pas confondue. (CRPu, Bar 630.3)
D3 comment peut-on obtenir une connaissance mtaphysique, cest--dire a priori, dobjets donns
aux sens, cest--dire a posteriori? La rponse est quon nemprunte lexprience rien de plus que
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
15
ce qui est ncessaire pour se donner un objet, savoir le concept de matire et celui de pense.
(Ver, VK-I 43-44) Verneaux rend compte ici de CRPu, Bar 630.2.
En 2, Verneaux essaie de mettre en face du schma de lArchitectonique les indications parses dans la
Critique et les Prolgomnes [] en ce qui concerne la mtaphysique (Ver, VK-I 44.3-4). Verneaux fait
ressortir deux ides de tous les textes quil cite:
la critique nest pas encore le systme
la mtaphysique dont parle Kant se cantonne la philosophie transcendantale comme ontologie puisque:
[] la physiologie rationnelle exige, pour avoir un objet, les concepts de matire et de pense
qui sont empiriques. Or la mtaphysique dont il est question ici se dveloppe par simple analyse
des concepts purs qui auront t mis jour par la critique.
(Ver, VK-I 47.2)
Cest aussi comme ide complte de la philosophie transcendantale que Kant prsente CRPu dans VII
de son Introduction (CRPu, Bar 75.1-2).
proportion que linterprtation des textes kantiens est difficile, linterprtation faite par Verneaux est sujette
caution. L o Kant dit que la critique, et elle seule, fournit tout le plan de la mtaphysique, il nest pas dit
quon doive comprendre seulement le plan (cest pourtant ce que comprend Verneaux en 46.1); lorsque
Kant affirme que la critique fournit dj tous les principes qui servent de base au systme, on pourrait
comprendre quil sagit des thses principales de la mtaphysique et donc minemment de ses contenus, et
quon nest plus en train de parler dune propdeutique en un sens minimaliste. Si dans ces citations on
interprte la critique systmatiquement au sens de travail et la mtaphysique au sens doeuvre, on comprend
que le systme complet des concepts qui se trouve expos dans la critique comme travail soit identiquement
la mtaphysique comme oeuvre.
Lorsque que Kant affirme que la critique est aussi un trait de la mthode (CRPu, Bar 45.1.5), on peut
comprendre que le fait dapercevoir et dlaborer la mthode se distingue fort bien du systme de la science,
si la distinction reste logique, mais se distingue mal de la mise en oeuvre de la mthode (de son actualisation)
si lon considre la critique comme le travail de dcouverte dune rgle et la mtaphysique comme lactua-
lisation de cette rgle.
Linterprtation du rapport entre critique et mtaphysique se joue presque exclusivement sur les deux verbes
driver (des concepts partir des catgories) et analyser ces concepts drivs. Que veut dire Kant par: il
en rsultera une partie purement analytique de la mtaphysique (Prol., 39, trad. Gibelin 103n)? Voir CRPu,
Bar 72-76, Introduction, VII.
En 3, Verneaux collige les textes en vue de prciser quoi rfre philosophie transcendantale. Celle-ci
exclut les principes suprmes de la moralit et, donc, le systme de la morale. (Voir, plus en dtail, ci-
dessous, dans mes explications du tableau deux axes pour la philosophie pratique.)
exclut toujours la physiologie rationnelle.
ci encore, la diffrence entre la critique et la philosophie transcendantale est que celle-ci serait une
extension compltant celle-l.
En 4, les conclusions de Verneaux sont:
le terme de mtaphysique a trois extensions: large, moyenne et stricte. Il en va de mme pour le systme
de la raison pure: il peut englober la critique ou lexclure, englober la morale ou lexclure, et lon doit
mme ajouter un quatrime sens; il est parfois restreint la philosophie transcendantale comme
ontologie.
Quant la philosophie transcendantale [] elle peut sidentifier la critique en excluant toute la
mtaphysique, y compris la philosophie transcendantale comme ontologie. Et elle peut tre une partie de
la mtaphysique, savoir lontologie, en excluant alors la critique. (Ver, VK-I 505-6)
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
16
1.2.3.2 La solution propose par Normand Lacharit au problme de la distinction
entre critique et systme de la raison pure
A. UN MODLE DYNAMIQUE DEUX AXES
Il ne faut pas chercher une diffrence qui, la fois, en soit une de principe et tablisse une dmarcation nette
au niveau de loeuvre entre propdeutique et systme, entre critique et systme, dmarcation qui varierait, de
surcrot, selon les diverses acceptions du terme systme: mtaphysique (aux sens large, moyen, troit),
philosophie transcendantale (seulement comme ontologie, ou pas seulement), mtaphysique de la nature (limite
la physiologie, ou non).
Je pense quil faut concevoir lopposition entre critique et systme en termes dynamiques, cest--dire par
rfrence une dmarche. La mtaphore du germe prform, que Kant lui-mme utilise, est plus dynamique que
celle de propdeutique:
[la mtaphysique comme science] nexistait pas encore, [] elle ne peut non plus se composer de
pices et de morceaux, mais [] son germe doit dabord tre prform entirement dans la critique.
(Prolgomnes, Vrin 1957, 161.1.10-11)
Et il faut penser cette dmarche selon deux axes:
la dmarche dexplicitation-drivation; cette dmarche peut se reprsenter selon un axe qui va du
travail loeuvre. Les rapports entre le point dorigine et le point darrive sont illustrs par des
relations telles que les suivantes:
lorigine larrive
le projet la ralisation du projet
la plan dun systme de la raison
pure
la ralisation (plus ou moins
acheve) du plan
lidentification des fondements et
des bases, pour ce qui est des
concepts et principes a priori
la dfinition et la drivation de
concepts et principes plus
dtaills, partir des fondements
lidentification de la mthode de
la raison pure
lapplication de la mthode de la
raison pure
la dmarche dextension; cette dmarche peut se reprsenter selon un axe qui va de la partie la plus
pure de la thorie la partie la plus empirique, en supposant que la thorie intgre progressivement (et
parcimonieusement) les concepts des objets qui sont donns nos sens, cest--dire a posteriori et
quelle ne prend de lexprience que tout juste ce qui est ncessaire pour nous donner un objet, soit du
sens extrieur, soit du sens intime, le premier au moyen du simple concept de matire (tendue impn-
trable et sans vie), le second au moyen du concept dun tre pensant (dans la reprsentation intrieure
empirique: je pense). (CRPu, Bar 630.2) Sur cet axe se trouve quelque part une frontire et je ne sais
pas si Kant est capable de la situer au moyen de critres qui soient la fois principiels et opration-
nellement prcis entre la philosophie pure et la philosophie applique. Pour rester dans le champ
de la mtaphysique, il faut videmment ne pas franchir cette frontire.
Au moyen de ces deux axes, on peut tracer un schma clairant des rapports entre la critique et le systme de
la raison pure (mtaphysique de la nature) supposer quon reste dans la modlisation de lusage spculatif
de la raison pure. (Voir le graphique de la page suivante.)
Un graphique semblable peut tre trac pour le passage de la Critique de la raison pratique la
mtaphysique des moeurs conue comme la morale pure, o lon ne prend pour fondement aucune anthropologie
(aucune condition empirique) [et qui] appartient aussi la branche de la connaissance humaine, mais philosophique,
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
17
qui vient de la raison pure (CRPu, Bar 627.1). Le problme dans le cas de la mtaphysique des moeurs est de
savoir si lon sort de la philosophie pure pour entrer dans la philosophie empirique (626.3) lorsquon passe de la
morale pure la thorie de la vertu et la thorie du droit problme de lextension (le terme est de moi) du
systme de la morale pure au systme de la mtaphysique des moeurs.
Dmarche d'explicitation-drivation
D
m
a
r
c
h
e
d'
e
x
t
e
n
s
i
o
n
Partie
a priori
pure
Partie
a priori
intgrant
quelques
concepts
empiriques
Travail
Oeuvre
CRPu
Philosophie
transcen-
dantale
(ontologie)
Physiologie
(immanente,
transcendante)
B. LHYPOTHSE DUN MODLE TROIS AXES
Un dveloppement assez naturel de la conceptualit que je viens dintroduire en termes daxes pour dcrire la
dmarche kantienne serait de concevoir un troisime axe, dans le but justement de faire ressortir le principe capable
dunifier les dmarches respectives des trois Critiques. Ce troisime axe serait laxe des usages de la raison pure. Et
il serait utile pour traiter certains problmes soulevs par Verneaux relatifs la manire dintgrer dans
lArchitectonique aussi bien la Critique de la raison pratique que la Critique de la facult de juger, ainsi que leurs
dveloppements mtaphysiques respectifs. Le premier de ces problmes est pos par Verneaux en Ver, VK-I 48.3-
49.1; il sagit de concilier les trois propositions suivantes:
La philosophie transcendantale est le systme de tous les principes de la raison pure, ce qui, par une
argumentation sur la puret de la morale pure, semble inclure au moins une partie dun systme de la
moralit (mtaphysique des moeurs), celle qui noncerait les principes suprmes
La philosophie transcendantale ne doit laisser entrer aucun concept qui contienne rien dempirique, ce
qui semble exclure la morale considre comme un systme, parce quelle contient soit des lments
empiriques, soit des lments trangers la connaissance il sagit des sentiments dans les deux cas.
(Verneaux reproduit ici largumentation donne par Kant dans la dernire section (VII) de son
Introduction CRPu pour exclure la morale pure de la philosophie transcendantale.) La thse de Kant,
en 1781 comme en 1787 est que les principes suprmes de la moralit et ses concepts fondamentaux
[] nappartiennent [] pas la philosophie transcendantale; [] La philosophie transcendantale nest
donc quune philosophie de la raison pure spculative. (CRPu, Bar 75.2)
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
18
Les textes pertinents se trouvent dans le Canon de la raison pure, 1Du but final de lusage pur
de notre raison. Pour la distinction entre lois pures pratiques et lois pragmatiques
(empiriques), voir le paragraphe 600.2; il se termine par: Des lois pures pratiques [] dont le
but serait donn tout fait a priori par la raison et qui ne commanderaient pas dune manire
empiriquement conditionnelle, mais absolue, seraient des produits de la raison pure. Or telles sont
les lois morales, et par consquent seules elles appartiennent lusage pratique de la raison pure
et comportent un canon.
Pour la distinction entre philosophie pratique et philosophie transcendantale, voir le
dbut du paragraphe CRPu, Bar 600.4 et la note affrente:
Mais, comme nous avons en vue un objet tranger la philosophie transcendantale
1
, il faut
beaucoup de circonspection soit pour ne pas sgarer dans des pisodes et rompre lUnit du
systme, soit aussi pour ne rien ter la clart ou la conviction, en disant trop peu sur cette
nouvelle matire. Jespre viter ces deux cueils en me mettant aussi / prs que possible du
transcendantal et en laissant tout fait de ct ce quil pourrait y avoir de psychologique, cest-
-dire dempirique. (CRPu, Bar 600.4-601.1)
La note affrente dit: Tous les concepts pratiques se rapportent des objets de satisfaction
ou daversion, cest--dire de plaisir ou de peine, et, par consquent, au moins indirectement,
des objets de sentiment. Mais comme le sentiment nest pas une facult reprsentative des
choses, mais quil rside en dehors de toute facult de connatre, les lments de nos
jugements, en tant quils se rapportent au plaisir ou la peine, appartiennent la philosophie
pratique, et non pas lensemble de la philosophie transcendantale, qui ne soccupe que des
connaissances pures a priori.
la critique, comme propdeutique, et la philosophie transcendantale, comme systme, ont le mme plan,
les mmes fondements.
Outre le problme de lintgration de la morale pure la philosophie transcendantale, se pose aussi, de toute
faon, le problme du passage de lusage de la raison dans la production des jugements thoriques celui de son
usage dans la production des jugements esthtique et tlologique. (Jen parlerai abondamment dans lexpos sur le
Thme #11. Le criticisme :une reconstitution daprs la Critique de la facult de juger.)
De fait, Kant publiera sa morale mais naura pas le temps de terminer sa mtaphysique de la nature:
1785 : Fondements de la mtaphysique des moeurs
1797 : Mtaphysique des moeurs
Le petit trait intitul Premiers principes mtaphysiques de la science de la nature, publi en 1786, est trs loin de
raliser lide [de la mtaphysique de la nature]. (Ver, VK-I 186.3). En 1804, anne de sa mort, Kant travaillait
Passage des premiers principes mtaphysiques de la science de la nature la physique. Il y rvisait, parat-il, toute
sa philosophie thorique (Ver, VK-I 184.4).
C. LHYPOTHSE DUNE CRITIQUE INTGRE AUX PARTIES DE LA MTAPHYSIQUE APRS LA
DIFFRENCIATION DE CES PARTIES
Selon cette hypothse, on rpartit la critique sur les diverses parties de la mtaphysique. Si on se reprsente
des ouvrages, on na qu les imaginer comportant une premire partie (une introduction, un premier chapitre)
qui procde la critique de lusage de la raison pure qui sera fait dans la suite de louvrage. (Voir le diagramme de
la page suivante.)
1.3 La Critique de la raison pure parmi les trois Critiques La typologie des facults
de lesprit
1.3.1 Raison pure et raison pratique
La Critique de la raison pure contient dj tous les principes qui permettent de faire la distinction
entre les objets de la mtaphysique des moeurs et ceux de la mtaphysique de la nature.
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
19
entre le caractre objectif de la connaissance et le caractre rationnel de la croyance.
Le principe de ces distinctions est lopposition entre lusage spculatif de la raison et son usage pratique. Aussi est-
ce dans la limite de lusage pratique de la raison que se trouvent justifis rationnellement les principes de la
mtaphysique des moeurs; ceux-ci dterminent la nature et les critres de la moralit de mme que les hypothses
(croyances) que lhomme se voit rationnellement contraint de postuler pour donner un sens sa conduite et sa
situation dtre historique. Ce genre de limitation implique un dimension temporelle associe la perfectibilit des
institutions humaines et au caractre processuel de lide mme de ralisation de fins (buts) dans lordre naturel. La
temporalit de laction humaine est la temporalit de lhistoire.
M2
M3.1
(mphys. des moeurs)
Conn-ces de RPu
re: usage pratique de la RPu
Critique de
la raison
pratique
M3.2
(mphys. de la nature)
Conn-ces de RPu
re: usage spculatif de la RPu
Phil. trscdtle
syst. de tous les
concepts qui se
rapportent des objets
en gnral []
Physiologie de la RPu
immanente
Physica
rationalis
Psychologi
e rationalis
transcendante
cosmologie
trscdtle
thologie
trscdtle
Doctrine du
droit
Doctrine de
la vertu
Logique
transcendantale
(CRPu,
esthtique et
analytique
trsdcdtle)
ONTOLOGIE (en
tant que partie
de la
mtaphysique)
Dialectique
trscdtle
La Critique de la raison pure peut tre considre comme fournissant la thorie de ce quest lusage pratique
de la raison. La Critique de la raison pratique adoptera cette dfinition comme un postulat et consistera formuler
les jugements synthtiques a priori que la raison peut produire, en son usage pratique.
1.3.2 Les pouvoirs de lesprit: la connaissance, le dsir, le plaisir
Kant numre, au dbut de la Critique de la facult de juger, les trois principaux pouvoirs de lme:
toutes les facults ou tous les pouvoirs de lme peuvent se ramener ces trois, quon ne peut plus
dduire dun principe commun: la facult de connatre, le sentiment de plaisir et de peine, et la
facult de dsirer (CFJ, Pko 26.3)
C: facult(s) de connatre <Erkenntnisvermgen>; lesprit est en rapport avec des objets et sintresse
la conformit de ses reprsentations avec les objets: rapport de conformit. Eu gard aux facults de
connatre, lintrt de la raison est spculatif.
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
20
D: facult de dsirer <Begehrungsvermgen>; celle-ci est la facult dtre par ses reprsentations cause
de la ralit des objets de ces reprsentations (CFJ, Pko 26n, Intro, III); or, les seuls objets que lesprit
peut causer par les reprsentations quil sen fait sont ses propres actions (libres). Dans ce contexte,
lesprit sintresse au rapport entre la volont (pouvoir de dterminer laction) et les tats de choses
susceptibles de raliser des fins morales; cest le rapport de causalit que peut tablir un agent libre
avec les objets ou situation du monde sur lesquels il peut agir.
P: sentiment de plaisir et de peine <Gefhl der Lust und Unlust>; lesprit est en rapport avec lui-mme
loccasion. La reprsentation est en rapport avec le sujet, pour autant quelle a sur lui un effet, pour
autant quelle laffecte en intensifiant ou en entravant sa force vitale. (Del, PCK 8.2) Rapport de
raction motive.
Cette typologie des facults fournit la cl dune comprhension gnrale et relativement immdiate du rapport
entre les trois Critiques:
la premire la Critique de la raison pure (1781; 1787) fait la thorie des pouvoirs de connatre;
la seconde la Critique de la raison pratique (1788) fait la thorie de la facult de dsirer, pour
autant que cest elle qui est implique dans la dtermination de la moralit des actions libres;
la troisime la Critique de la facult de juger (1790) fait la thorie de la capacit dprouver du
plaisir et de la peine, pour autant que cest elle qui est implique dans la production des jugements
esthtiques et tlologiques.
son tour, le fait que le sentiment de plaisir et de peine fait surgir un problme nouveau pour la philosophie
critique ne se comprend que si lon aperoit la distinction entre lusage dterminant des pouvoirs de connaissance
et leur usage rflchissant.
USAGE DTERMINANT / RFLCHISSANT. En faisant la synthse du divers sous un concept, la facult de juger
dtermine lobjet, donne la reprsentation le statut dun objet pour la pense. Cest ainsi quelle en rend possible
la connaissance. En revanche, lorsquelle prend acte du plaisir plus ou moins grand que lui procure la prsence de la
reprsentation, la facult de juger ne fait que rflchir ltat dans lequel la prsence de lobjet a mis les facults
reprsentatives. Sagit-il dmotion? Sagit-il de ce qui rend possible la signification connote? de la surdtermi-
nation symbolique?
Rtrospectivement, on constate que le tableau de lArchitectonique de la raison pure ne laisse pas
voir larticulation entre lusage dterminant et lusage rflchissant des facults de connaissance,
notamment de la facult de juger; et que, de toute faon, la mtaphysique de la nature (qui en
occupe la plus grande partie) est tout entire place sous lgide de lusage spculatif de la raison:
certes, cest en tant que dterminant que cet usage fait dabord problme pour les deux premires
critiques, mais peut-il tre rflchissant galement?.
Le dnombrement des aspects du fonctionnement de lhomme, de lexistence humaine selon
C-D-P
la typologie C-D-P des facults correspondent trs directement des aspects de lexistence humaine quon
peut considrer comme autant dobjets de la thorisation kantienne selon la mthode critique:
la connaissance; lactivit intellectuelle; la pense conceptuelle.
laction et le dsir; lactivit morale.
le sentiment (plaisir , dplaisir) en tant que perspective sur la compatibilit de lhomme et de la nature, et
perspective, aussi, sur la compatibilit des sujets humains entre eux. Voir Phi, OK II 46, p. 191-198;
47, p. 198 sqq.
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
21
La troisime forme de la communication est celle par laquelle lhomme rencontre directement
lhomme sans concept par et dans le jugement de got ou plus gnralement le sentiment qui a
suscit un jugement esthtique. Cest donc le problme de lintersubjectivit humaine qui est
pos.
(Phi, OK II 191-192)
On peut sans doute faire correspondre ces aspects de lexistence des types dactivits, mais il est davantage
pertinent de les considrer comme les trois aspects sous lesquels on peut considrer un acte donn. Un mme acte
cognitif, mobilisant les facults de reprsentation du sujet, est analys dans le systme kantien de la raison pure
selon trois aspects:
laspect intellectuel, selon lequel la manire dont des concepts a priori se rapportent aux objets en
gnral rend possible la connaissance de ces objets.
laspect moral, selon lequel la manire dont limpratif catgorique et ses maximes se rapportent aux
actions sur les objets rend possible la moralit, le droit, la vertu
laspect vcu, selon lequel la manire dont lexigence rationnelle, mais subjective, dune unit finale
attribue aux produits de la nature est rapporte des objets indtermins (des objets en gnral) rend
possible un sentiment de plaisir, la communicabilit de ce sentiment et lunification de la science.
Pour montrer la pertinence de la critique, en tant que propdeutique une philosophie de
lexistence humaine, il serait intressant de montrer les traits gnraux de cette existence qui
constituent une manifestation de ce quaffirment certaines thses kantiennes, ou qui peuvent tre
expliques par les thses kantiennes. Il est bon, pdagogiquement, de montrer que les principes
purs rvls par la critique sont des conditions de la possibilit de comportements attribus ltre
humain en gnral. Je considre que lAnthropologie du point de vue pragmatique adopte peu
prs ce point de vue pour montrer les traits gnraux de lexistence humaine.
Quil y ait un plaisir pouvoir communiquer son tat desprit, ne serait-ce quen ce qui concerne
les facults de connatre, cest ce quon pourrait facilement montrer par linclination naturelle de
lhomme pour les rapports sociaux (empiriquement et psychologiquement). (CFJ, Pko 61.5.1-5)
Ces aspects gnraux de lexistence humaine ont t tudis par Kant approximativement dans cet ordre, si
lon veut bien interprter ainsi la chronologie de la publication des trois Critiques. Et il est intressant de
reconstituer lensemble de la dmarche kantienne, en tant que construction progressive dun systme, comme une
suite dtapes postrieures la dcouverte du point de vue critique et charges chacune de reconstruire les parties
principales de la philosophie sur la nouvelle base. Quand on a remplac le primat de la chose sur la facult de
connatre par le primat de la facult de connatre sur la chose, il faut en effet trouver dautres explications que les
explications pr-coperniciennes, pr-critiques,
de lorganisation du monde, en tant quensemble accessible mes facults de connatre, et de
lorganisation de la science, en tant quensemble conditionn par mes facults de connatre;
de la possibilit de la morale, en tant que comprhension thorique de mes propres facults de dsirer et
dagir, et en tant quinstrument de la dtermination de mon action comme tre engag lgard de fins
qui orientent toute mon existence;
de la possibilit de la communication avec autrui, en tant que condition de mon existence dans une
socit et une histoire, dans un tat et une culture. Cest cette ide que retient Philonenko dans son
commentaire introductif la Critique de la facult de juger.
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
22
1.4 La Critique de la raison pure parmi les DOCTRINES philosophiques de la
connaissance et de lexistence humaine Lidalisme transcendantal entre le
rationalisme et lempirisme
1.4.1 Autonomie de la connaissance humaine eu gard labsolu
Lautonomie de la connaissance humaine lgard de lAbsolu est affirme dans les limites de lexprience
possible. Deux ides: non seulement la connaissance humaine na pas besoin de garant, mais ce qui peut tre dit
delle et de ses limites est plus sr que ce qui peut tre dit du garant qui serait une figure de lAbsolu. Le double fait
de cette limite et de cette sret est donc mthodologiquement premier dans la mise en oeuvre de la dmarche
philosophique (mtaphysique).
La relativisation de lAbsolu et de la connaissance divine par rapport la connaissance humaine peut
sentendre en un sens plutt sociologique et voquer la mentalit des Lumires (Aufklrung), dont Kant se faisait un
propagandiste volontiers militant. Notre sicle est le vrai sicle de la critique: rien ne doit y chapper. En vain la
religion cause de sa saintet, et la lgislation cause de sa majest, prtendent-elles sy soustraire. (Kant, Prface
la premire dition, CRPu, Bar 31, note 1.) Mais cette ide sentend en un sens plus radical quand on la lit au
niveau mme des thses de la doctrine, cest--dire au niveau mtaphysique.
RAPPORTS LA TRADITION ANTRIEURE
Voir La philosophie de Kant par rapport Leibniz, Fiche no 1 de: Boulad-Ayoub, J., Fiches pour
ltude de Kant, p. 13-15.
Avant Kant, la tradition majoritaire de son temps, laquelle appartiennent Leibniz et Descartes, par exemple,
les limitations qui affectent la connaissance humaine sont penses par rapport une rfrence absolue: lide
dune omniscience dont la divinit est cense tre le dpositaire; cest par rapport cette omniscience
suppose de Dieu que le savoir humain est dit limit. (Ferry, Luc, Prsentation, p. I)
Dans la dmarche cartsienne des Mditations, Dieu sert mme de garant pour les vrits claires et distinctes.
Le moment kantien effectue un spectaculaire retournement: Kant pense dabord la finitude, ensuite
lAbsolu ou la divinit. En dautres termes: la finitude, le simple fait que notre conscience soit toujours dj
limits par un monde extrieur elle, par un monde quelle na pas produit elle-mme, est le fait premier,
celui dont il faut partir pour aborder toute les autres questions de la philosophie. [] Cest partir de cette
finitude quil convient de penser Dieu ou lAbsolu, et non linverse.
Consquence ultime de ce renversement:
cest la prtention connatre lAbsolu, dmontrer par exemple lexistence de Dieu, qui se trouve
relativise par rapport laffirmation initiale de la condition limite de lhomme. []
la figure divine de lAbsolu est [] relativise, rabaisse au rang dune simple Ide dont la ralit
objective est jamais indmontrable par les voies dune quelconque thorie philosophique ou
scientifique. (Ferry, Ibid. , 11.2)
Note intercalaire sur largumentation de Ferry.
Luc Ferry, dans la prface de ldition G-F de 1987 (ci-aprs note Fy, Prf dans les rfrences), regroupe
sous deux titres les caractristiques les plus remarquables de la doctrine de CRPu:
a) la conception de la nature des limites de la connaissance humaine (Fy, Prf I.2) ou thorie de la
finitude (Fy, Prf XIV.2.1);
b) la thorie de lobjectivit de la connaissance.
Ferry divise sa prface en deux parties, chacune dveloppant un de ces titres. Au moyen de la premire
caractristique se trouve explique la division densemble de la CRPu, dcrite alors comme une entreprise
dinvalidation des preuves mtaphysiques de lexistence de Dieu. Le fondement de la dmarche argumentative
kantienne est une thorie des rapports entre intuition, concept et Ide. Cette thorie rpond au problme de laccs
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
23
lexistence des objets que je veux ou prtends connatre: Comment puis-je saisir le particulier, lexistence relle, si
ce nest par le concept? // La rponse de Kant tient en un mot: lintuition. (Fy, Prf III.2.m3-3.1)
le concept ne donne pas accs lexistence; cest lintuition qui donne accs lexistence.
la preuve ontologique (de lexistence de Dieu) est une tentative (avorte) daccder lexistence de lobjet
individuel Dieu par une Ide; lide serait (il faut employer le conditionnel puisquune telle opration
intellectuelle est pure illusion) la connaissance du particulier par concept et non par intuition. [] lide
serait le concept, si le concept pouvait pour ainsi dire dduire son extension de sa comprhension, si la
dfinition dune proprit tait telle quelle nous permettrait de saisir concrtement lexistence relle. (Fy,
Prf IV.f-V.1)
[Fin de la note intercalaire.]
Dans la tradition antrieure, il ny a pas que la mtaphysique. Kant prend modle sur la physique
newtonienne pour concevoir la science de la nature et considre quelle est parvenue noncer des
propositions ncessaires et universelles qui appartiennent la classe des jugements synthtiques a priori . La
doctrine kantienne veut rendre compte du succs de la science physique (contribuant par l en promouvoir
lautorit) et prtend assurer une mtaphysique convenablement limite la mme autorit.
RAPPORTS LA TRADITION POSTRIEURE
Voir Concept et Ide chez Kant et Hegel, Fiche no 11 de: Boulad-Ayoub, J., Fiches pour ltude
de Kant, p. 95-113.
On peut considrer la doctrine kantienne de la connaissance comme le dbut de la tradition qui mnera
Husserl et quon appelle volontiers aujourdhui philosophie transcendantale; cependant les avatars
smantiques de cette appellation doivent tre examins plus fond. Il est douteux que les acceptions
kantienne et husserlienne de cette appellation soient identiques.
Plusieurs des jugements que Kant a ports sur les disciplines scientifiques nont pas reu laval de lhistoire.
1.4.2 Autonomie de la morale eu gard au savoir (la science)
Lautonomie de la morale lgard du savoir dans les limites de lusage pratique de la raison a la mme force
et la mme ncessit que la distinction entre usage spculatif (thorique) et usage pratique de la raison. Dans le
kantisme, la certitude des principes a priori qui fondent la vie morale (laffirmation de la libert, par exemple) nest
pas moins grande que celle des principes qui servent de fondements aux sciences de la nature; et ce, en dpit du fait
que les principes de la moralit ne soient aucunement des connaissances valeur objective.
On trouvera dans la Fiche 9. Positions pratiques de Ayoub, 1990 un rsum des principales thses
kantiennes qui constituent sa doctrine morale; ce rsum montre bien comment la Critique de la raison pure pose
dj les principes qui seront appliqus dans les ouvrages subsquents: Fondements de la mtaphysique des moeurs et
Critique de la raison pratique.
Lautonomie de la morale, selon le point de vue kantien, soulve un problme dexgse assez considrable,
celui de savoir dans quelle mesure (puis, ventuellement, en quel sens) la mtaphysique des moeurs fait partie du
systme des connaissances de la raison pure, ou de la philosophie transcendantale. Le problme est dbattu par
Verneaux, comme je lai mentionn ci-dessus en 1.2.3.1, dans le contexte de la discussion sur les rapports entre la
critique et la philosophie transcendantale. Une formulation secondaire, drive du problme original, pourrait tre:
en quel sens une thse principale de la Critique de la raison pratique est-elle une connaissance de la raison pure
sil est vrai quelle nait pas de valeur objective? En un sens, du fait quelle est identifie, elle constitue une
dcouverte attribuable la raison pure et, en ce sens, une connaissance produite par le mtaphysicien; nanmoins,
elle nest pas une connaissance des choses dont elle peut contenir lIde (des choses telles que le sujet humain libre,
ltre des tres Dieu , le monde)
T H M E # 1 . L A C R I T I Q U E D E L A R A I S O N P U R E E T S E S C O N T E X T E S
_____________________________________________________________________________________________
24
1.4.3 Autonomie de la Critique eu gard lexprience (et lhistoire?)
Le caractre le plus audacieux de la Critique de la raison pure rside dans la mthode philosophique quelle
propose, plus exactement dans le type dargumentation quelle invente, mthode et mode dinfrence quon qualifie
de transcendantaux, en lune des acceptions canoniques de ce terme. Cest laffirmation de lautonomie du
tribunal de la raison, dans les limites de la mthode transcendantale.
La raison doit se passer de lexprience pour dcrter sans appel que ses capacits de connatre (les pouvoirs
dont elle est dote en son usage thorique, ou spculatif) sont limites lexprience possible.
Exemple de problme pistmologique aisment soulev de nos jours, propos dune thorie forte comme
celle de Kant: le problme du lien entre les connaissances de la raison pure et la temporalit. Les jugements
synthtiques a priori que produit lgitimement une mtaphysique de la nature sont-ils rvisables, modifiables? La
thorie de la science contenue dans la Critique de la raison pure est-elle compatible avec une physique qui connat
des rvolutions, qui a connu notamment une rvision de la mcanique newtonienne par la thorie de la relativit, par
la mcanique quantique, etc.?
26
K <> T h m e # 2 <> K
2 . L a C r i t i q u e d e l a r a i s o n p u r e
V u e d e n s e m b l e
2. La Critique de la raison pure Vue densemble......................................................................................25
2.1 La problmatique................................................................................................................................25
2.1.1. La problmatique de la CRPu prsente gntiquement............................................................26
2.1.2. La problmatique de la CRPu prsente systmatiquement......................................................28
2.1.2.1. Le problme principal et les objectifs tels qunoncs dans les prfaces......................... 28
2.1.2.2. Synthse............................................................................................................................33
2.2 La division gnrale de la CRPu ........................................................................................................34
2.2.1. La CRPu en tant que thmatique................................................................................................34
2.2.1.1. Thorie des lments / thorie de la mthode...................................................................34
2.2.1.2. Esthtique et logique transcendantales............................................................................. 35
2.2.1.3. Analytique et Dialectique.................................................................................................37
2.2.2. Les principales oppositions conceptuelles.................................................................................40
2.2.2.1. Connaissance de la raison pure // connaissance de la raison empirique........................... 40
2.2.2.2. Usage thorique de la raison pure // usage pratique de la raison pure..............................42
2.1 La problmatique
Le problme critique cest le problme de la reprsentation, ou encore: le problme de lobjectivit de
la connaissance. Luc Ferry lexpose de faon saisissante dans la deuxime partie de sa Prface, celle consacre
la thorie kantienne de lobjectivit et la question des jugements synthtiques priori (Fy, Prf XIV-XIX). La
formulation du problme est la suivante, dans les termes quutilisait Kant en 1772: sur quel fondement repose le
rapport de ce quon nomme en nous reprsentation lobjet (Lettre Marcus Herz du 21 fvrier 1772. Voir:
KANT, Oeuvres philosophiques, Bibliothque de la Pliade.)
Il existe plusieurs formulations, selon les contextes, du problme central de la CRPu et on devrait pouvoir
saisir les liens entre elles au sortir de la prsente section. En voici quelques-unes:
comment les jugements synthtiques a priori sont-ils possibles? Et, plus spcifiquement:
comment les sciences mathmatiques et physiques sont-elles possibles?
comment la mtaphysique est-elle possible?
Ce sont les formulations que Kant utilise dans la prface la deuxime dition de la CRPu.
Comment sauvegarder les droits de lexprience scientifique et morale en soumettant lesprit lexamen
le plus svre qui soit? (BAy, FK 24.1)
tel est le problme critique: comment lentendement peut-il dpasser ses concepts vers le sensible? en
dautres termes comment des jugements synthtiques a priori (ncessaires) sont-ils possibles? La
dduction transcendantale et le schmatisme transcendantal constitueront les rponses apportes ce
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
27
problme, qui une fois rsolu permettra la thorie des principes, synthses des intuitions et des concepts,
des formes de la sensibilit et des formes de lentendement. (Phi, OK I 98.1.10f)
2.1.1. La problmatique de la CRPu prsente gntiquement
La formulation du problme initial, dans la dissertation de 1770, et sa transformation
Louvrage publi en franais sous le titre La Dissertation de 1770 a t compos par Kant en latin et publi
dabord sous le titre De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis. Il a t traduit en allemand et publi
sous le titre Von der Form der Sinnen- und Verstandeswelt und ihren Grnden..
Voir La dissertation de 1770, Fiche no 2 de: Boulad-Ayoub, J., Fiches pour ltude de Kant ,
p. 19-20.
Le problme initial est de trouver les principes qui rendent compte de la diffrence entre la connaissance
sensible et la connaissance intellectuelle. Lopposition entre sensitive knowledge / intellectual knowledge, selon
la terminologie de Diss. 1770, est rendue par Copleston de la manire suivante :
The distinction must be understood [] in terms of objects, the objects of sensitive knowledge
being sensible things, sensibilia, capable of affecting the sensibility (sensualitas) of the subject,
which is the latters receptivity or capacity for being affected by the presence of an object so as
to produce a representation of it.
(Copleston, F., History of Phil., vol. 6, part I, 1964, p. 226-7)
Que veut dire Kant par connaissance intellectuelle et par monde intelligible ?
[] intellectual or rational knowledge is knowledge of objects which do not affect the senses : that
is to say, it is knowledge, not of sensibilia, but of intelligibilia. And the latter together form the
intelligible world. Sensitive knowledge is knowledge of objects as they appear, that is, as subjected
to what Kant calls the laws of sensibility, namely the a priori conditions of space and time,
whereas intellectual knowledge is knowledge of things as they are (sicuti sunt ). [Rf.: Diss. 1770, 2,
4; d. de lAkademie: II, p. 292.] The empirical sciences come under the heading of sensitive
knowledge, while metaphysics is the prime example of intellectual knowledge.
(Ibid., p. 229)
On voit se profiler ici la notion dessence des choses, coutumire la mtaphysique traditionnelle. Il fallait bien que
les choses fussent penses en intension, cest--dire en un concept, pour quon saisisse leur essence.
Question subsidiaire
La question de savoir si Kant a dcouvert le jugement esthtique tardivement, aprs avoir conu la thorie du
jugement thorique (scientifique) et pratique. Copleston pense quil ne sagit pas dune dcouverte tardive et que
Kant concevait dj, lpoque de la lettre Herz de juin 1771, larticulation des trois grands thmes qui donneront
lieu aux trois Critiques, bien quil penst, cette poque, pouvoir les traiter en un seul ouvrage dont le titre anticip
serait Les limites de la sensibilit et de la raison [Die Grenzen der Sinnlichkeit und der Vernunft].
He now proposes to undertake an investigation into the fundamental concepts and laws which
originate in the nature of the subject and which are applied to the experiential data of aesthetics,
metaphysics and morals. In other words, he proposes to cover in one volume the subjects which
proved in the end to need three, namely the three Critiques. [] And the range of inquiry is to cover
not only theoretical knowledge but also moral and aesthetic experience. (Copleston, F., History of
Phil., vol. 6, part I, 1964, p. 234.2)
Cest dans le paragraphe subsquent que Copleston explicite le plan anticip par Kant (dans la lettre de juin 1771 ou
ailleurs?) et appel, dans ce passage, the original plan:
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
28
According to his original plan the book would have consisted of two parts, one theoretical, the other
practical. The first part would have been subdivided into two sections, treating respectively of
general phenomenology and of metaphysics considered according to its nature and method. The
second part would also have consisted of two sections, dealing respectively with the general
principles ot the feeling of taste and with the ultimate grounds of morality.
(Copleston, F., History of Phil., vol. 6, part I, 1964, p. 235.1)
PLAN ANNONC (1771?)
1. Partie thorique
1.1 Phnomnologie gnrale
Cette expression est dj utilise dans une lettre Lambert, en sept. 1770, pour dsigner une
science qui constituerait une propdeutique la mtaphysique et qui mettrait au clair le
domaine de validit des principes de la connaissance sensible, prvenant ainsi lapplication indue
de ces principes en mtaphysique. (Traduit de Copleston, F., History of Phil., vol. 6, part I, 1964,
233-234) Lexpression semble donc dsigner lensemble qui comprend lEsthtique de CRPu et
lAnalytique de CRPu.
1.2 La mtaphysique considre selon sa nature et sa mthode
donc, apparemment, ce qui deviendra la Dialectique et la Thorie de la mthode.
2. Partie pratique
2.1 Les principes gnraux du sentiment de got [the feeling of taste]
2.2 Les fondements de la moralit.
__________________________
Ce schma est rduit, dans la description donne par Kant en sa lettre Herz de fvrier 1772, car il ny est
plus fait mention du sentiment de got (item 2.1); et Kant songe publier sparment (et dans environ trois mois)
la premire des deux parties de louvrage envisag, savoir celle consacre aux principes de la connaissance
thorique.
Labandon de la thse selon laquelle les reprsentations intellectuelles nous donnent les choses telles quelles
sont en elles-mmes.
Cet abandon dune thse encore soutenue dans la Dissertation (1770) est prsent par Copleston comme une
importante phase de llaboration de la solution critique. Le texte suivant, traduit par moi de Copleston, part de la
remarque faite par Kant dans la lettre Herz de fvrier 1772 et prsente clairement les enjeux. Les passages en
caractres gras sont de moi.
Mais durant quil laborait la premire partie [de louvrage projet] Kant remarqua confie-t-il
Herz quil manquait quelque chose dessentiel, savoir un traitement en profondeur de la relation
que les reprsentations (Vorstellungen) intellectuelles entretiennent avec les objets. Il convient de
commenter les remarques que faisaient Kant ce sujet; car elles nous le montrent aux prises avec le
problme critique qui se posait lui.
Nos reprsentations sensibles ne soulvent pas de problme, pourvu toutefois quon
reconnaisse quelles rsultent du fait que le sujet est affect par lobjet. Certes, les objets sensibles
nous apparaissent dune certaine manire plutt quune autre parce que nous sommes ce que nous
sommes, cest--dire en vertu des intuitions a priori de lespace et du temps. Mais dans la
connaissance sensible la forme est applique une matire qui est reue passivement; notre
sensibilit est affecte par des choses extrieures nous. La rfrence objective de nos
reprsentations sensibles ne pose donc pas de srieux problme. Mais la situation est fort diffrente
en ce qui concerne les reprsentations intellectuelles. Pour le dire en langage abstrait, la conformit
objective du concept avec lobjet serait assure si lintellect produisait ses objets par le moyen de
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
29
ses concepts; si, en dautres termes, il crait les objets en les concevant ou les pensant. Mais seul
lintellect divin est un intellect archtypal en ce sens. Nous ne pouvons supposer que lintellect
humain cre ses objets du fait quil les pense. Kant na jamais admis lidalisme pur, pris en ce sens.
Cependant les concepts purs de lentendement ne sont pas, daprs Kant, tirs de lexprience
sensible. Les concepts purs de lentendement doivent avoir leur origine dans la nature de lme, et
lont pourtant de manire telle que ni ils ne sont causs par lobjet, ni ils ne font exister lobjet
(Akademie, X, p. 130) Mais dans ce cas la question surgit immdiatement de savoir comment ces
concepts rfrent aux objets et comment les objets se conforment aux concepts. Kant observe que
dans sa dissertation inaugurale il stait content dun traitement ngatif de cette question. Cest--
dire quil stait content de dire que les reprsentations intellectuelles [] ntaient pas des
modifications de lme dues lobjet (Ibid.), passant sous silence la question de savoir comment
ces reprsentations intellectuelles ou concepts purs de lentendement rfrent des objets ds lors
quils ne sont pas affects par ces derniers.
tant donn que Kant prend pour acquis que les concepts purs de lentendement et les
axiomes de la raison pure ne sont pas drivs de lexprience, cette question est videmment
pertinente. Et la seule manire dy rpondre, au bout du compte, si on doit maintenir ce qui est pris
pour acquis, sera dabandonner laffirmation faite dans la dissertation disant que les reprsentations
sensibles nous donnent les objets tels quil apparaissent tandis que les reprsentations intellectuelles
nous les donnent tels quils sont; et daffirmer plutt que les concepts purs de lentendement ont
pour fonction cognitive de poursuivre la synthse des donnes de lintuition sensible. En
somme, Kant va devoir soutenir que les concepts purs de lentendement sont, en quelque sorte, des
formes subjectives au moyen desquelles nous concevons ncessairement (parce que lesprit est ce
quil est) les donnes de lintuition sensible. Les objets vont alors se conformer nos concepts, et
nos concepts rfrer aux objets, parce que ces concepts sont des conditions a priori de la possibilit
des objets de la connaissance, remplissant ainsi une fonction analogue celle des intuitions pures de
lespace et du temps, bien que ce soit un niveau suprieur, savoir intellectuel. Autrement dit,
Kant sera en mesure de maintenir sa distinction nette entre le sens et lentendement; mais il devra
renoncer lide que, la diffrence des reprsentations sensibles qui nous donnent les choses telles
quelles apparaissent, les reprsentations intellectuelles nous donnent les choses telles quelles sont
en elles-mmes. En remplacement, on aura un processus ascendant de synthse ayant pour effet
de constituer la ralit empirique. Les formes sensibles et intellectuelles du sujet humain restant
constantes, et les choses ntant connaissables que dans la mesure o elles sont soumises ces
formes, il y aura toujours conformit entre les objets et nos concepts.
(Copleston, F., History of Phil., vol. 6, part I, 1964, 235.1.10-236.2.f;
accentuation en gras due NL)
2.1.2. La problmatique de la CRPu prsente systmatiquement
2.1.2.1. Le problme principal et les objectifs tels qunoncs dans les prfaces
EN TERMES DE RSUM GUID PAR LA DMARCHE
(RSUM STRUCTURE-CALQUE, RSUM LINAIRE)
La problmatique dans la prface (1re d.)
la raison a une tendance naturelle poser certaines questions ce qui a donn lieu la mtaphysique;
cette discipline a connu divers avatars
lindiffrence dont la mtaphysique est lobjet est une mise en demeure adresse la raison de
reprendre nouveau la plus difficile de toutes ses tches, celle de la connaissance de soi-mme, et
dinstituer un tribunal qui (CRPu, Bar 31.1.69)
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
30
la matire de la recherche entreprise (CRPu), en termes de fins: critiquer le pouvoir de la raison en
gnral, [considre] par rapport toutes les connaissances auxquelles elle peut slever indpendam-
ment de toute exprience; par consquent la solution de la question de la possibilit ou de
limpossibilit dune mtaphysique en gnral, et la dtermination de ses sources, de son tendue et
de ses limites, tout cela suivant des principes. (CRPu, Bar 31.2)
la forme de la recherche entreprise (CRPu):
la certitude (33.2). (K. y rappelle les deux parties [zwei Seiten] de la dduction des concepts
purs de lentendement; et le procd qui domine chacune (33.3) et la plus grande importance de
la premire eu gard la question capitale qui est de savoir ce que lentendement et la raison,
indpendamment de toute exprience, peuvent connatre, et non pas comment la facult mme de
penser [das V e r m g e n z u d e n k e n ] est possible. (CRPu, Bar 33.3.4f) K. admet ici que
la dduction subjective nest pas certaine, mais que ce fait ne doit pas nous faire douter de la
certitude de la dduction objective la premire.
la clart (34.2). Contient la prcaution oratoire concernant le petit nombre dexemples et
dclaircissements
la nouvelle conception de la mtaphysique (35.2); dfinie comme linventaire, systmatiquement
ordonn, de toutes les connaissances que nous devons la raison pure (CRPu, Bar 35.2.13-15), elle est
conue comme survenant aprs la critique; il sagira de driver les concepts spcifiques, do linsistance
sur le mot inventaire que Kant met en italique. Dclaration dintention concernant la Mtaphysique de
la nature.
Prface, 2
e
dition.
le travail auquel on se livre sur les connaissances qui sont [proprement loeuvre] de la raison (CRPu,
Bar 37.1.1-2) nest pas encore entr sur la voie sre de la science.
Voir le schma 1.
contrairement ce qui est arriv la logique (37.2-38.2)
(cas des sciences qui produisent une connaissance thorique) la mathmatique a suivi la route sre de
la science
la physique arriva plus lentement trouver la grande route de la science
la mtaphysique (40.2-41.1)
(transition: les questions)
(Jai t amen imiter les sciences qui ont russi:) Que lon cherche donc une fois si nous ne serions
pas plus heureux dans les problmes de mtaphysique (CRPu, Bar 41.2.m5-42.1.3]
Voir le schma 2.
projet de solution pour la premire partie de la mtaphysique, [] celle o lon na affaire qu des
concepts a priori, dont les objets correspondants peuvent tre donns dans une exprience conforme
ces concepts. (CRPu, Bar 43.1.2-5)
[Transition.] Mais cette dduction de notre capacit de connatre a priori conduit, dans la premire
partie de la mtaphysique un rsultat trange, et, en apparence, tout fait contraire au but que
poursuit la seconde partie: cest que
la mme solution vaut pour la deuxime partie de la mtaphysique, car elle nous permet dexpri-
menter une argumentation propos de linconditionn, argumentation qui fournit une contre-preuve
du rsultat dj obtenu.
Note de traduction. Dun autre ct, lexprimentation nous fournit ici mme une contre-preuve
de la vrit du rsultat Le mot de liaison Dun autre ct est trs peu appropri. Le texte
allemand dit: Aber hierin liegt eben das Experiment einer Gegenprobe der Wahrheit des Resultats
jener ersten Wrdigung unserer Vernunfterkenntnis a priori, da sie nmlich nur auf Erscheinungen
gehe, die Sache an sich selbst dagegen zwar als fr sich wirklich, aber von uns unerkannt, liegen
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
31
lasse. Je traduis : Mais cela nous fournit lexprimentation dune contre-preuve de la vrit du
rsultat quatteint cette premire apprciation de notre facult de connatre a priori, et cette
exprience repose justement sur le fait que ladite facult natteint que des phnomnes. Autre
formulation: Mais cest justement en cela que rside lexprimentation dune contre-preuve,
savoir dans le fait mme que ladite facult natteint que des phnomnes
Ainsi le prcdent projet de solution ouvre la porte au voeu de la mtaphysique, qui est de pousser
notre connaissance a priori au-del de toute exprience possible, mais seulement au point de vue
pratique. (44.1.m8-6)
Cette critique est un trait de mthode, et non un systme de la science elle-mme (45) ni un systme
de mtaphysique (45.1.14)
Son utilit: la limitation de lusage spculatif de la raison a une utilit non seulement ngative (eu gard
la raison spculative) mais galement positive car elle lve lobstacle qui menaait de ramener lusage
pratique (pur) de la raison lintrieur de la sensibilit et, partant, de lanantir. La critique assure la
raison pratique que la raison spculative nest pas en contradiction avec elle. (46)
cela se montre en particulier par le fait que la critique donne le moyen daffirmer sans contradiction
que lme humaine est libre et pourtant soumise la ncessit physique, cest--dire non-libre. Cest
la distinction entre lme comme objet dexprience possible et lme comme chose en soi qui permet
de le faire. (47)
Plus gnralement, on peut concilier la morale et la physique en montrant comment la libert se laisse
penser. (48.1.12-m10). De mme pour les concepts de Dieu et de notre me. Jai donc d supprimer
le savoir pour lui substituer la croyance. (CRPu, Bar 49.1.4-5)
Voir le schma 3.
Reprise de lide dutilit: pour les intrts humains, contre le monopole des coles.
La critique soppose au dogmatisme, aussi bien quau scepticisme.
SCHMA 1
connaissance thorique fournie par la raison: cette connaissance. se rapporte son objet en le dterminant, lui
et son concept (lequel doit tre donn par ailleurs)
partie pure de la connaissance. (o la raison dtermine son objet a priori)
la mathmatique doit dterminer a priori son objet.
la physique dtermine son objet en partie a priori.
partie empirique. [Ce terme ne figure cependant pas dans la construction du 38.3]
connaissance pratique fournie par la raison: il sagit de raliser <wirklich zu machen> lobjet.
partie pure
partie empirique
SCHMA 2
a) niveau de lintuition
il sagit de savoir qqch a priori concernant lintuition
je peux le concevoir si les objets se rglent sur la nature de notre facult intuitive
b) niveau des connaissances
(prmisse) il faut que je rapporte les intuitions en tant que reprsentations, quelque chose qui en soit lobjet
et que je dtermine par leur moyen (CRPu, Bar 42.1.18-20)
jopre cette dtermination au moyen de concepts
si les objets ou, ce qui revient au mme, l exprience dans laquelle seule ils sont connus (comme objets
donns) se rgle sur ces concepts (42.2.25-27) je peux obtenir une connaissance a priori.
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
32
SCHMA 3
Facult de lme (non
spcifique)
Facult responsable
(oprante)
Ce dont la critique
rend compte
Connaissances pures que la
critique produit
Facult de connatre Entendement Le savoir; les sciences Thorie du jugement thorique
Facult de dsirer Volont La croyance, la foi. Thorie du jugement pratique
Sentiment de plaisir Facult de juger
(= entendement en son
usage rflchissant)
Le sentiment du beau Thorie du jugement esthtique
& du jugement tlologique.
EN TERMES DUNE ANALYSE PROBLMATOLOGIQUE SELON LES CATGORIES
OBJET INTERROG, OBJET DEMAND
Toute formulation dun problme comporte minimalement des indications qui spcifient ce qui est interrog
(ce propos de quoi le problme est pos) et ce qui est cherch. Appliquant ces deux catgories au texte de
lintroduction de la prface la seconde dition de la Critique de la raison pure, je dgagerai ce que Kant interroge
et ce quil en veut savoir.
A. Rponse la plus directe mais aussi la plus gnrale
Rponse 1. Kant INTERROGE les connaissances qui sont [proprement loeuvre] de la raison (37.1), la
connaissance de la raison [ou connaissance rationnelle] (38.2), et CHERCHE leurs conditions de
possibilit. Plus concrtement ces connaissances, en prenant le mot au sens large (non seulement
thorique) sont: les propositions des sciences (logique, mathmatiques, physique newtonienne) qui
ont un statut de principe ou de loi et les propositions qui affirment la ralit du devoir, comme
fondement de la vie morale (BAy, FK 23.1). Ce sont pour Kant, les certitudes premires (ibid.)
qui sont donnes avec la position du problme. Mais les propositions de la logique ont un statut a
part: elles sont analytiques, et ne sont donc pas incluses dans lobjet interrog, lorsque le problme
est formul en termes de jugements synthtiques a priori.
Les connaissances en question, nous explique Kant (dans les sections I, II et III de lIntroduction),
sont a priori.
Ds ce niveau de gnralit, sont introduites par Kant des distinctions quon pourrait dvelopper ici
pour offrir une rponse plus labore:
connaissance thorique vs connaissance pratique (38.3); connaissance pratique (44.1);
connaissance thorique (48.1.36);
connaissance analytique a priori vs connaissance synthtique a priori (73.1.14-15).
B. Rponses plus spcifiques
B.1 Les connaissances de la raison pure sont considres en soi, comme produit intellectuel dune
certaine sorte.
B.1.1 La sorte est dtermine daprs des proprits logiques ou pistmologiques
Rponse 2. Kant INTERROGE les jugements synthtiques a priori et DEMANDE leurs conditions
de possibilit. La QUESTION kantienne qui runit les deux termes est:
Comment des jugements synthtiques a priori sont-ils possibles? VARIANTES: Comment
des jugements peuvent-ils tre la fois synthtiques et a priori ? Comment quelque chose
peut-il tre un jugement synthtique a priori ? Comment les propositions exprimes par des
noncs thoriques tels que Tout vnement a une cause peuvent-elles tre la fois
indpendantes de lexprience et porteuses dune connaissance sur les objets dexprience?
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
33
Note: Lide quil faille quil y ait telle chose que des jugements synthtiques a priori
semble tre donne dans le problme de dpart. Mais si on considre que lide de jugement
synthtique a priori fait partie de la solution au problme, on peut viter de mentionner ce
concept dans la formulation de la question et dire plutt:
comment expliquer la ncessit (et luniversalit) de principes qui ne sont ni
vidents ni tautologiques, mais qui sont nanmoins au fondement des
sciences ?
le problme de la Critique de la raison pure est un sous-problme du problme de Hume.
(Fin de la note.)
B.1.2 La sorte est dtermine comme classe de contenus disciplinaires, savoir:
a) la classe des connaissances pures appartenant la mathmatique et la physique, depuis
que ces disciplines se sont engages sur la voie sre de la science;
b) la classe des connaissances pures appartenant la mtaphysique dogmatique (produite
jusquici) et une mtaphysique scientifique venir (que Kant se propose de fournir, aprs
avoir complt son travail strictement critique).
Rponse 3.1. Kant INTERROGE la mathmatique et la physique dans leur partie pure (cest--dire
les jugements synthtiques a priori contenus dans ces sciences) et DEMANDE leurs
conditions de possibilit.
Rponse 3.2. Kant INTERROGE la mtaphysique dogmatique et DEMANDE ses conditions de
possibilit.
La question des conditions de possibilit de la mtaphysique dogmatique se formule au
pass puisquil sagit dexpliquer un fait dj arriv, savoir le caractre erron (ou
trompeur) de la mtaphysique existante: Comment la mtaphysique dogmatique a-t-elle
t possible? VARIANTES: quelle est sa lgitimit? quel a t son fonctionnement et
pourquoi a-t-elle fonctionn ainsi?
Note: Cest cette question que va rpondre la dialectique transcendantale considre
comme thorie de lapparence transcendantale.
Rponse 3.3. Kant INTERROGE la mtaphysique en tant que produit post-critique et DEMANDE si
elle est possible, et quelles sont ses conditions de possibilit.
La question correspondante est: Comment la mtaphysique est-elle possible titre de
science? (Introduction la Critique de la raison pure, section VI, 71.2)
B.2 Les connaissances de la raison pure sont rapportes la raison pure comme leur agent, au lieu
dtre considres en elles-mmes. En dautres mots, les connaissances de la raison pure sont
conues ici comme proprits du sujet ou comme proprits de lactivit du sujet au lieu dtre
conues comme produits du sujet.
Rponse 4. Kant INTERROGE la raison pure, au sens gnral de ensemble du pouvoir de
produire des connaissances pures et DEMANDE quelles sont ses conditions dexercice, ses
limites (Noter que conditions dexercice nest pas synonyme de condition de
possibilit.) VARIANTE de la formulation de lobjet demand: canon de la raison pure.
C. Articulation des diverses questions
La question qui dmontre la fois que lobjet interrog est un certain produit du sujet et le sujet lui-mme
pourrait tre formule de la manire suivante:
QI Comment faut-il que soient les pouvoirs de la connaissance pour que les jugements synthtiques a priori
et les parties pures de la mathmatique et de la physique respectivement soient possibles?
Cette formulation QI montre galement larticulation entre les deux questions:
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
34
(Q1) quelles sont les conditions de possibilit des jugements synthtiques a priori? laquelle a pour
rponse:
cest une certaine constitution du sujet (en tant que capable de connatre et penser).
(Q2) quelle est ladite constitution? laquelle a pour rponse:
cest lorganisation sensibilit-entendement-raison avec tous les concepts et principes purs
que dcrit la Critique de la raison pure.
Comme on doit trouver la rponse Q2 pour complter le traitement de Q1 et comprendre sa rponse il
sensuit que, dans une hirarchie logique des problmes, Q2 est un problme driv de Q1.
RELATIONS ENTRE LES OBJETS INTERROGS ET LES OBJETS DEMANDS
a) Quand lobjet interrog est la connaissance pure, en tant que produit, lobjet cherch est le sujet, en
tant que condition de la possibilit du produit.
Rel
c-p
(connaissance, sujet)
o le symbole Rel
c-p
indique la relation de condition de possibilit.
b) Quand lobjet interrog est le sujet, en tant que pouvoir de connaissance pure, lobjet cherch est sa
constitution, en tant que rgle et limite du sujet:
Const (Sujet)
o le symbole Const indique le prdicat (la proprit) avoir la constitution C. La relation entre
lobjet interrog et lobjet demand est ici une relation de prdication. On pourrait peut-tre aussi
reprsenter la forme du problme par une relation de dfinition
Sujet =
df
Constitution S-E-R.
Note concernant les objets de la problmatique kantienne qui sont poss dans la dimension historique.
Dans la Rponse 3, lobjet INTERROG est pos sous la catgorie de produit; cest cette catgorie quon se
rfre pour faire observer le ct par lequel loeuvre de Kant est marque historiquement (physique de
Newton, gomtrie euclidienne, conception de la scientificit de la logique, etc.).
Mais lobjet DEMAND est pos sous la catgorie dagent, cest--dire : constitution du sujet de la
connaissance. Cette constitution est conue comme fixe, par opposition : voluant avec le temps historique,
et comme connaissable a priori (postulat du rationalisme, peut-tre aussi de toutes les traditions
philosophiques europennes quon peut recenser en 1780).
2.1.2.2. Synthse
La diffrence entre reprsentation sensible et reprsentation intellectuelle est dj perceptible au
niveau de lentre en discursivit: par exemple la diffrence entre lexprience de la table
individuelle par loeil et le toucher, dune part, et les formulations verbales de jugements propos
de la table: il y a deux grandeurs de tables dans cette pice, ou: cette table est poussireuse.
La question de lobjectivit ou de la vrit des jugements se pose pour tous les jugements mais se
pose dune faon plus problmatique lorsque le concept utilis rfre un objet qui nexiste peut-
tre pas (p. ex. Dieu, lme, lunivers en tant quobjet unique considr comme totalit, le photon,
etc.) ou que ltat de choses auquel le jugement rfre nexiste peut-tre pas (p. ex. le fait que Jojo
soit coupable, le fait que Lili comprenne, etc.) Et le problme devient plus urgent lorsque ltat de
fait auquel rfre le jugement nest pas singulier mais lui-mme trs conceptualis, gnralis
sur un grand nombre de cas particuliers (p. ex. La force exerce par un corps en mouvement est
gale la masse de ce corps multiplie par sa vitesse.)
Comme le concept au moyen duquel on pense nest ni ncessairement li lexistence de lobjet et
quil nest pas, non plus, directement li lexistence lobjet quand il lest, la question de savoir
quand il lest et ne lest pas est importante, et la question de savoir sil lest encore dans les cas les
plus problmatiques ceux des noncs encore plus gnraux que les gnraliss, savoir les
noncs a priori, a des enjeux encore plus grands.
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
35
2.2 La division gnrale de la CRPu
Voir La Critique de la raison pure Plan, Fiche no 4 de: Boulad-Ayoub, J., Fiches pour ltude
de Kant, p. 35-36. Cette fiche dgage les principales parties de la Critique de la raison pure
(jusquau cinquime niveau darticulation pour la partie centrale) et explicite en deux ou trois lignes
leur contenu.
2.2.1. La CRPu en tant que thmatique
2.2.1.1. Thorie des lments / thorie de la mthode
Le terme lments sentend ici de deux faons:
en contexte mtadiscursif, il dsigne les principes dune discipline ou dune thorie, voire, parfois, les
principes premiers (non drivs). Cest en ce sens quon parle des lments de la gomtrie; et que la
tradition nous parle des lments dEuclide. Cest en ce sens que Kant dsigne les lments de la
Critique mtaphoriquement comme les matriaux de cette discipline par opposition sa mthode et
son plan:
nous avons valu les matriaux / prsent il sagit moins des matriaux que du plan
(CRPu, Bar 541.1)
dans le contexte du discours thorique lui-mme, le terme lments dsigne les lments fondamen-
taux du jugement thorique et du jugement pratique. Dans le premier cas, ce sont les formes de
lintuition, les concepts purs de lentendement ainsi que les principes de lentendement; dans le deuxime
cas, cest la loi morale.
Les sections 2.2.1.2 et 2.2.1.3, ci-dessous dtaillent amplement quels sont ces lments, en ce qui concerne la
Critique de la raison pure. Cest plutt la mthode quil convient ici de dtailler pour voir comment elle se distingue
des lments.
Jentends donc par mthodologie transcendantale (CRPu, Bar 541.2.1-3)
Il y aura 4 parties: discipline, canon, architectonique, histoire. Rappelons les deux premires seulement.
A. La discipline de la raison pure.
dfinition: 545.3
1 Discipline de la RPu dans lusage dogmatique.
Dans cette section, il sagit de prvenir la raison de ne pas confondre son usage par concepts (en
philosophie) et son usage par construction de concepts (en mathmatique) CRPu, Bar 554.1
et de lui apprendre distinguer entre ltablissement de principes directement par concepts et
indirectement par le rapport de ces concepts quelque chose de tout fait contingent, cest--dire
lexprience possible.
Conclusion: 562.2
2 Discipline de la RPu par rapport son usage polmique
dfinition de usage polmique 563.4
Il sagit de prvenir la raison contre les erreurs sceptiques
3 Discipline de la RPu par rapport aux hypothses
Exemple dinjonction: 580.2
4 Discipline de la RPu par rapport ses dmonstrations
Exemple dinjonction: 587.1.1-9
il sagit de demander la raison de respecter les principes de la dduction transcendantale.
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
36
B. Le canon de la RPu dans son usage pratique
dfinition: 598.1
Expose comment les suppositions concernant lexistence de Dieu et dun monde futur sont les
conditions de la possibilit de lexprience morale.
Il sagit de rpondre la question: si je fais ce que je dois, puis-je esprer participer au bonheur?
(CRPu, Bar 605.2-3)
La troisime section du Canon, intitule De lopinion, du savoir et de la foi, prcise le statut
des convictions auxquelles conduit le raisonnement fait par la RPu. Le rsum peut tre donn
dans le texte : [] la foi purement doctrinale [] que je ne crains de me voir jamais dpouill de ce
sentiment. (CRPu, Bar 615.3-616.2)
2.2.1.2. Esthtique et logique transcendantales
Grosso modo, il sagit de la thorie transcendantale de la sensibilit et de la thorie transcendantale de
lentendement; mais Kant nemploie quune fois la premire expression, et jamais la seconde. Le passage introductif
de lEsthtique transcendantale nonce clairement le rapport entre esthtique et logique:
Jappelle esthtique transcendantale la science de tous les principes a priori de la sensibilit.
Cest donc cette science qui doit former la premire partie de la thorie transcendantale des
lments, par opposition celle qui contient les principes de la pense pure et qui se nommera
logique transcendantale.
(CRPu, Bar 82.3)
On retrouve dans cette articulation lopposition entre le rapport lobjet par lintuition et le rapport lobjet
par la pense. Le tout dbut de la Logique transcendantale contient un nonc tout aussi clair de la mme
articulation:
Lentendement ne peut avoir lintuition de rien, ni les sens rien penser. La connaissance ne peut
rsulter que de leur union. Il ne faut pas cependant confondre leurs rles, et lon a au contraire
grandement raison de les sparer et de les distinguer avec soin. Aussi distinguons-nous la science
des rgles de la sensibilit en gnral, ou lEsthtique, de la science des rgles de lentendement en
gnral, ou de la Logique.
(CRPu, Bar 110.1.9f; section I. De la logique en gnral
de lIntroduction. Ide dune logique transcendantale )
A. Esthtique.
La racine du mot esthtique est le mot grec , qui signifie sensation. La tournure
suivante rappelle ltymologie grecque: toute intuition possible pour nous est sensible
(esthtique). (CRPu, Bar 163.1.4-5)
Kant reconnat que Baumgarten utilise ce mot avec le sens de critique du Beau, et que cest donc
un sens diffrent du sien. Mais il estime que cela ne fait rien car
les Allemands sont les seuls qui se soient servis jusquici du mot esthtique pour dsigner ce
que les autres appellent la critique du got
et cette dnomination se fonde sur une fausse esprance: soumettre le jugement critique du
beau des principes rationnels, et [] en lever les rgles la hauteur dune science (CRPu,
Bar 82n}
Dans la premire dition Kant suggre dabandonner lusage du terme au sens de Baumgarten et de
le rserver la thorie qui est une vritable science, en quoi on se rapprocherait alors du langage
des Anciens
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
37
Dans la 2
e
dition, in introduit une alternative: Um deswillen ist es ratsam, [] entweder [] oder
sich in die Benennung mit des spekulativen Philosophie zu teilen und die sthetik teils im
transzendentalen Sinne, teils in psychologischer Bedeutung zu nehmen (Wei III, 70n)
ce qui veut dire: de partager avec la philosophie spculative la dnomination [quon utilise dj au
sens de critique du got]. Les sujets de eingehen lassen et de sich zu teilen sont dans les deux
cas Baumgarten et ses mules allemands. (Note: Je ne suis pas daccord avec Verneaux qui affirme
Kant emprunte donc le terme Baumgarten, mais il en change le sens. Kant, je dirais, emprunte le
terme aux Anciens, malgr lusage dviant quen fait Baumgarten son poque.)
Cependant lOccident adoptera le sens de Baumgarten; Kant lui-mme a fini par le faire dans la CFJ
(1790).
B. Logique
Par opposition lesthtique laquelle soccupe des principes a priori de la connaissance sensible
en tant que science des rgles de la sensibilit en gnral (CRPu, Bar 110.1.17-18)
la logique soccupe de la pense. Au dpart, la logique, en gnral, est dfinie comme science des
rgles de lentendement en gnral (CRPu, Bar 110.1.19). Mais des prcisions sont apportes pour
dfinir la logique transcendantale, laquelle
considre la pense dans son rapport des objets, en tant que ce rapport est a priori
se distingue de la logique gnrale ou formelle qui tudie la forme de la pense abstraction faite
de tout contenu et qui ne soccupe que de la cohrence.
Remarque sur lexpression thorie transcendantale de lentendement:
Kant ne lemploie pas; probablement une raison pour cela est que cette partie de la CRPu doit
tre aussi celle qui explique la diffrence entre la raison et lentendement et galement celle qui,
compte tenu de cette diffrence, doit faire la thorie transcendantale de lusage illgitime de la
raison pure.
Kant utilise par contre lexpression une science de lentendement pur et de la connaissance
rationnelle par laquelle nous pensons des objets tout fait a priori. (CRPu, Bar 113.2)
SCHMA
Logique
comme logique de lusage particulier de lentendement = organon de telle ou telle science; cette logique
contient les rgles qui servent penser exactement sur une certaine espce dobjets. (CRPu, Bar 111.2.9-
10)
comme logique de lusage de lentendement en gnral: logique lmentaire, logique gnrale; elle
contient les rgles absolument ncessaires de la pense, sans lesquelles il ny a aucun usage possible de
lentendement, et par consquent elle envisage cette facult indpendamment de la diversit des objets
auxquels elle peut sappliquer. (CRPu, Bar 110.2.4-8) Elle fait abstraction [] de tout contenu de la
connaissance, cest--dire de tout rapport de la connaissance lobjet, et elle nenvisage que la forme logique
des connaissances dans leurs rapports entre elles, cest--dire la forme de la pense en gnral. (CRPu, Bar
112.2.1-5; dbut de II. De la logique transcendantale)
pure: Une logique gnrale mais pure ne soccupe [] que des principes a priori: elle est un canon de
lentendement et de la raison, mais seulement par rapport ce quil y a de formel dans leur usage, quel
quen soit dailleurs le contenu (quil soit empirique ou transcendantal). (CRPu, Bar 111.1.9-14)
applique: elle a pour objet les rgles de lusage de lentendement sous les conditions subjectives et
empiriques que nous enseigne la psychologie. Elle a donc [aussi] des principes empiriques, bien quelle
soit gnrale ce titre quelle considre lusage de lentendement sans distinction dobjet. Aussi nest-
elle ni un canon de lentendement en gnral, ni un organon de sciences particulires, mais seulement un
catharticon de lentendement humain. (CRPu, Bar 111.1.9f)
logique transcendantale, en laquelle on ne fait pas abstraction de tout contenu (puisque lon soccupe de
lorigine des contenus et pas seulement de leur forme); cette logique est pure (donc non applique), soccupe
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
38
des contenus (donc non gnrale), et seulement des contenus de pense a priori . Cest une logique pure de
lentendement pur.
(Fin du schma.)
2.2.1.3. Analytique et Dialectique
A. Analytique
dabord par rapport la logique gnrale, cest--dire comme partie de la logique gnrale
[] la logique gnrale dcompose toute loeuvre formelle de lentendement et de la raison dans
ses lments et elle les prsente comme les principes de toute apprciation logique de notre
connaissance. Cette partie de la logique peut donc tre nomme analytique [] (CRPu, Bar
115.2.1-5).
ensuite, spcifiquement comme partie de la logique transcendantale
[partie] qui expose les lments de la connaissance pure de lentendement et les principes sans
lesquels aucun objet en gnral ne peut tre pens. (CRPu, Bar 116.3)
B. Dialectique
sens de dialectique en logique gnrale
la logique gnrale, prise aussi pour organon [et non seulement pour canon de lentendement],
prend le nom de dialectique. (CRPu, Bar 115.2.fin). Pour les Anciens, ctait un art sophistique,
une logique de lapparence.
sens de dialectique en logique transcendantale
Premier sens. Il y a donc une dialectique de la raison pure naturelle et invitable (CRPu, Bar
305.3.2f), cest--dire
- il y a lapparence transcendantale
- il y a notre tendance raisonner faussement
- il y a dans notre raison (considre subjectivement comme un pouvoir de connaissance de
lhomme) des rgles et des maximes fondamentales de son application, qui ont tout fait
lapparence de principes objectifs et font que la ncessit subjective dune certaine liaison de
concepts en nous, exige par lentendement, passe pour une ncessit objective de la
dtermination des choses en soi. (CRPu, Bar 305.2.10-17)
- il y a en nous une logique de lapparence, pour ainsi dire, un peu comme on parle dune logique
du pire, dune logique paranode, dune logique du double bind, etc.
Deuxime sens. Dialectique = tude de lapparence transcendantale.
- La dialectique transcendantale se contentera donc de dcouvrir lapparence des jugements
transcendants et en mme temps dempcher quelle ne nous trompe. (CRPu, Bar 305.3.1-3)
- si lon a appliqu le nom de dialectique la logique, cest en ce sens quelle est une critique de
lapparence dialectique, et cest en ce sens aussi que nous le voudrions voir pris ici. (CRPu,
Bar 116.2)
C. Concernant la distinction entre organon et canon.
Canon dans CRPu (Mthodologie, Ch. II; CRPu, Bar 598.1)
- soppose discipline: Il ny a [] pas de canon de lusage spculatif de la raison (car cet usage
est entirement dialectique), mais toute logique transcendantale nest cet gard que discipline.
(CRPu, Bar 598.1.m8-5) Cependant, le terme discipline est du mme ct que canon lorsquon
loppose organon; voir lopposition canon-organon ci-dessous.
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
39
- Jentends par canon lensemble des principes a priori du lgitime usage de certaines facults de
connatre en gnral. (CRPu, Bar 598.1)
- les exemples donns par Kant sont: 1 la logique gnrale dans sa partie analytique est un canon
pour lentendement et la raison en gnral, mais seulement quant la forme, car elle fait abstraction
de tout contenu. [2 Ainsi] lanalytique transcendantale tait le canon de lentendement pur; car il est
seul capable de vritables connaissances synthtiques a priori. Mais l o il ne peut y avoir dusage
lgitime dune facult de connatre il ny a point de canon. (CRPu, Bar 598.1)
Canon dans Logik (Introd., 1)
- soppose organon; on voit Kant utiliser cette opposition dans le passage suivant du dbut du
chapitre sur le Canon de la raison pure (Chap. II de la Mthodologie de la raison pure): La
plus grande et peut-tre la seule utilit de toute philosophie de la raison pure est donc purement
ngative; car elle nest pas un organe qui serve tendre nos connaissances, mais une discipline qui
en dtermine les limites, et, au lieu de dcouvrir la vrit, elle a le modeste mrite de prvenir
lerreur. (CRPu, Bar 597.1.6f)
- la logique nest pas un Organon des sciences, comme le sont par exemple les mathmatiques, parce
quelle ne fournit pas dindication <Anweisung> sur la manire datteindre certaines connaissances
et dlargir le domaine des vrits scientifiques; elle en est seulement un canon, en tant quelle
formule les lois ncessaires que la pense doit respecter, et vrifie si lentendement, dans ses
applications, est rest daccord avec lui-mme. Elle est, dit-il eine allgemeine Vernunftkunst
(canonica Epicuri). (Logik, d. Kirchman, p. 14) (LALANDE, Andr, Vocabulaire de la
philosophie, 1960, p. 119, bas de page.)
D. Implications conceptuelles de la division en Analytique et Dialectique.
D1. LINDIFFRENCIATION INITIALE ENTRE ENTENDEMENT ET RAISON
Voici un certain nombre doccurrences de rfrences la raison dans lIntroduction la logique
transcendantale
1) [la logique, comme organon de telle ou telle science] est ordinairement prsente dans les
coles comme la propdeutique des sciences; mais, dans le dveloppement de la raison humaine,
on ny arrive quen dernier lieu [] (CRPu, Bar 110.2)
2) Une logique gnrale mais pure [] est un canon de lentendement et de la raison, mais
seulement par rapport ce quil y a de formel dans leur usage, quel quen soit dailleurs le
contenu (quil soit empirique ou transcendantal). (CRPu, Bar 111.1)
[partie de la logique gnrale qui doit former la] thorie pure de la raison (CRPu, Bar
111.2.2)
3) nous nous faisons davance lide dune science de lentendement pur et de la connaissance
rationnelle par laquelle nous pensons des objets tout fait a priori. (CRPu, Bar 113.2)
en mme temps quelle naurait affaire quaux lois de lentendement et de la raison, elle ne se
rapporterait qu des objets a priori, et non, comme la logique gnrale, aux connaissances
empiriques ou pures sans distinction. (CRPu, Bar 113.2.5f)
4) le critre simplement logique de la vrit, savoir laccord dune connaissance avec les lois
universelles et formelles de lentendement et de la raison (CRPu, Bar 115.1.1-3)
5) loeuvre formelle de lentendement et de la raison (CRPu, Bar 115.2.1-2). NOTE: cest dans
ce passage quest introduite la distinction entre analytique et dialectique.
6) Kant introduit lide de lusage abusif (logique utilise comme organon) en parlant dusage de
lentendement (CRPu, Bar 117.1) : [] cest alors que lusage de lentendement pur serait
dialectique.
la dialectique est entendue comme critique de lentendement et de la raison dans leur usage
hyperphysique [] . (CRPu, Bar 117.1.21-22)
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
40
La conclusion de ce relev doccurrences: dans lintroduction la logique transcendantale
le terme raison pure nest pas utilis.
le terme raison a son sens large et non son sens troit partiellement (ou potentiellement)
pjoratif.
entendement et raison sont indiffrencis et dcrits comme ayant ensemble un usage
lgitime et un usage abusif.
laccent est mis exclusivement sur lentendement lorsquil sagit de prciser le thme de
lanalytique transcendantale. Voir CRPu, Bar 116.3.1-5 et 116.3.10-14.
Dans lusage indiffrenci, lemploi de raison se justifie par rfrence lexpression les
connaissances rationnelles (spcialement dans la tradition du rationalisme classique) connotant
connaissances a priori;
et lemploi de entendement se justifie par rfrence la facult de produire des concepts
(spcialement lintellectus dans la scolastique et le rationalisme classique) et connote la synthse.
D2. LA RAISON, AU SENS RESTREINT, APRS LA DIFFRENCIATION ENTRE ENTENDEMENT ET
RAISON
Kant entend aussi par Vernunft, en un sens [] qui lui est spcial, la facult de penser suprieure
laquelle nous devons les Ides de lme, du Monde et de Dieu. (CRPu, Dialectique transcendantale,
Introd., II et aussi Livre I, section I.) La Raison, dans ce cas, ne soppose plus lexprience mais
lentendement (Verstand). Ainsi entendue, elle a aussi son usage pratique spcial: cest delle que
relvent les ides de libert, dimmortalit et de Dieu, en tant que postulats moraux. (Article
Raison dans: LALANDE, Andr, Vocabulaire, 8
e
dition, 1960, p. 886a et b)
Relire le beau texte, trs clairant, de J. Lachelier, sur lunit et la diffrenciation des deux concepts
entendement et raison: Le concept [] est, chez Kant, lacte par lequel nous posons, derrire le
voile du temps et de lespace, ltre propre, lide de chaque chose. Il serait lacte propre de la
Raison, sil tait, en mme temps, intuition de cet tre [] Mais il ne saisit rien et il est vide: alors il
se remplit comme il peut [ schme, image]. Il devient ainsi concept dans le sens vulgaire du
mot, simple unit extrieure et accidentelle du divers de lintuition sensible, et la raison devient
entendement. (Article Raison dans: LALANDE, Andr, Vocabulaire, 8
e
dition, 1960, p. 881,
bas de page). Au dpart de ce scnario, la Vernunft serait le de Platon et lintellectus de saint
Thomas
D3. SPCIFICIT DE LOPPOSITION KANTIENNE ENTRE ANALYTIQUE ET DIALECTIQUE
Pour Aristote
les Analytiques exposaient la logique du raisonnement dmonstratif (scientifique)
les Topiques contenaient entre autres, la logique du raisonnement probable. cette logique tait
donn le nom dialectique.
Donc lopposition est ici entre dmonstratif et probable.
Pour Kant,
lAnalytique expose les concepts et les principes sans lesquels aucun objet ne peut tre pens, de
mme que les conditions de lusage de ces concepts et principes.
la Dialectique expose
le fait que les conditions sont parfois enfreintes; diagnostic
les raisons de ce fait (lapparence transcendantale)
les consquences que cette infraction engendre: le conflit de la Raison pure.
Donc lopposition est ici entre pense avec contenu et pense sans contenu.
Mise en garde: Dialectique nest pas prendre dans le sens platonicien; ni dans le sens hglien
(repris par Marx).
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
41
Et comment arrive-t-on incriminer plus spcifiquement la raison?
Cest bien de lusage de lentendement quil sagit: usage illgitime parce que le jugement (= lacte
de lentendement) dpasse lexprience possible. Mais Kant a un excellent motif dincriminer plus
spcifiquement la raison dans lexplication quil fournit de cette extravagance; car cest au cours
du processus du raisonnement que seffectue la remonte vers linconditionn (non pas dans le
jugement isol, mais dans la suite des jugements) et cest bien la raison que lon attribue le
raisonnement, dans toute la tradition philosophique et par une sorte de dfinition nominale.
2.2.2. Les principales oppositions conceptuelles
2.2.2.1. Connaissance de la raison pure // connaissance de la raison empirique
Lopposition entre philosophie pure et philosophie empirique.
Toute philosophie est ou une connaissance par raison pure, ou une connaissance rationnelle par principes
empiriques. La premire sappelle philosophie pure, et la seconde philosophie empirique. (CRPu, Bar 626.3)
Pour la suite de la rflexion.
Avons-nous des exemples de ce quest la philosophie empirique? Quand les principes dont
procde la connaissance sont empiriques, pourquoi et en quel sens cette connaissance est-elle
qualifie tout de mme de rationnelle?
Pour donner un exemple de connaissance par raison pure, il est sans doute lgitime de fournir
des jugements synthtiques a priori; mais est-ce que toutes les connaissances pures sexpriment
de fait dans des jugements synthtiques a priori?
est-ce que toute connaissance a la forme dun jugement?
le prdicat tre synthtique est-il un prdicat simplement logique (apparte-
nant au vocabulaire de la logique gnrale), ou a-t-il aussi une signification
transcendantale?
Les deux couples a posteriori et a priori , empirique et pur (Ver, VK-I 83-89, chap. IV, II Empirique et a
priori)
RAPPORTS ENTRE LES CONCEPTS PUR ET A PRIORI (INTRODUCTION, I, II; P.57-60)
Parmi les connaissances a priori, celles-l sappellent pures, auxquelles rien dempirique nest ml.
(CRPu, Bar 58.2.m6-5)
Si lon sen tient cette premire dfinition, le concept le plus gnrique est celui da priori: il signifie:
indpendant de toute exprience, ou absolument indpendant de lexprience; et le concept plus spcifique est pur,
signifiant: quoi rien dempirique nest ml. Dans ce cas:
on devrait donc normalement dire connaissance a priori pure et non pas connaissance pure a priori.
Kant envisage la possibilit quon ait une connaissance a priori non pure, et donne lexemple: tout
changement a une cause. (CRPu, Bar 58.2.m4-3) Le concept de changement est dit ne pouvoir venir que
de lexprience.
Cependant, Kant accepte galement une dfinition lgrement moins restrictive du concept pur et lemploie
dans ce sens en CRPu, Bar 59.9.8. Dans ce passage, il offre la mme proposition (tout changement a une cause)
comme exemple de jugement pur a priori, De cet exemple, il dit quil est tir de lusage le plus ordinaire de
lentendement et dit cela pour dmontrer la ralit de principes purs a priori dans notre connaissance (59.2.m6-
5), dmontrer le fait quil y ait dans la connaissance humaine des jugements ncessaires et rigoureusement
universels, cest--dire des jugements purs a priori (CRPu, Bar 59.2.1-3).
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
42
(Solution) Kant reconnat lquivoque. Pur signifie la premire fois: une connaissance quoi rien
dempirique nest ml, et la deuxime fois: une connaissance qui ne dpend de rien dempirique.
Double sens du mot pur, desquels dans toute loeuvre je nemploie que le dernier. Et il ajoute que
lexemple de jugement pur au sens strict devrait tre: tout contingent a une cause, car le concept de
contingent ne contient rien dempirique. (Sur lusage de principes tlologiques en philosophie, 1788;
Ak. VIII, 183-84). (Ver, VK-I 85-86). Le passage se trouve dans KUk, Wei 169.2.10-170.1.1.
En pratique, pur et a priori sont le plus souvent synonymes, de sorte que lexpression concept pur a
priori est un plonasme. (Ver, VK-I 85.5) Et on peut toujours supposer, en premire approximation, que pur
signifie qui ne dpend de rien dempirique comme laffirme Kant dans la citation donne ci-dessus.
RAPPORTS ENTRE LES CONCEPTS EMPIRIQUE ET A POSTERIORI
Au dpart, cest--dire dans lnonc des dfinitions nominales, ces concepts sont synonymes. Verneaux cite
lintroduction CRPu, 1. Par la suite, certains emplois du terme empirique semblent dvier de la dfinition
nominale; Verneaux mentionne, en 84.4-6, trois occurrences:
La connaissance empirique nest pas seulement celle qui est tire de lexprience, elle est parfois
lexprience mme: La connaissance empirique est lexprience [trouver la rfrence] (Ver, VK-I 84)
Kant dit de lespace et du temps quils ont une ralit empirique dans le sens quils ont une valeur
objective pour tout ce qui peut tre donn par lexprience. La ralit empirique, en ce sens, est
corrlative de lidalit transcendantale. (Ver, VK-I 84.m1) Un des textes auxquels Verneaux rfre est
celui qui concerne la ralit empirique de lespace:
Notre examen de lespace nous en montre donc la ralit (cest--dire la valeur objective) au point
de vue de la perception des choses comme objets extrieurs; mais il nous en montre aussi lidalit au
point de vue de la raison / considrant les choses en elles-mmes, cest--dire abstraction faite de la
constitution de notre sensibilit. Nous affirmons donc la ralit empirique de lespace (relativement
toute exprience extrieure possible); mais nous en affirmons aussi lidalit transcendantale, cest--
dire sa non-existence, ds que nous laissons de ct les conditions de la possibilit de toute
exprience, et que nous lacception comme quelque chose qui sert de fondement aux choses en soi.
(CRPu, Bar 87.2.m4-88.1.f)
Lusage empirique des catgories signifie usage immanent, cest--dire dans les limites de
lexprience possible. Il soppose lusage transcendantal qui dpasse toute exprience.
Je ne suis pas sr que ce que Verneaux appelle ici drivations et dviations en soit Je ne vois en tout
cas pas denjeux ou de problmes lis ces variations smantiques du terme empirique, du moins si lon tient
compte de lopposition conceptuelle qui suit et du fait quelle ne comporte pas dincompatibilit.
Lopposition entre tre indpendant de lexprience et tre dans les limites de lexprience possible
Le prdicat (I) tre indpendant de lexprience se dit quant la source de la connaissance (source des
concepts, source des principes).
Le prdicat (R) tre relatif , ou dans les limites de, lexprience possible se dit de lusage de la
connaissance (de lusage des concepts, de lusage des principes)
Lorigine
I
pur
non I
empirique
T H M E # 2 . L E P R O B L M E G N R A L D E L A R A I S O N P U R E . LE S D I V I S I O N S .
_____________________________________________________________________________________________
43
Lusage
R
dont lusage est
immanent
par exemple le concept
de cause et le principe
de causalit
par ex. le concept de
changement selon
CRPu, Bar 58.2.2f
la loi de la gravitation
(ou loi du carr
inverse)
non R
dont lusage est
transcendant
Lide de Dieu
Le jugement selon
lequel le monde a eu
un commencement
2.2.2.2. Usage thorique de la raison pure // usage pratique de la raison pure
La question gnrale ici est de savoir si la bipartition usage thorique // usage pratique vaut pour lensemble
de la philosophie critique et suffit pour rendre compte de la structure de lensemble.
Les textes comprennent ceux de la 1 du Canon de la raison pure, CRPu, Bar 600-601
Pour la distinction entre philosophie pratique et philosophie transcendantale, voir le dbut
du paragraphe 600.4 et la note affrente: Mais, comme nous avons en vue un objet tranger la
philosophie transcendantale
1
, il faut beaucoup de circonspection soit pour ne pas sgarer dans
des pisodes et rompre lUnit du systme, soit aussi pour ne rien ter la clart ou la
conviction, en disant trop peu sur cette nouvelle matire. Jespre viter ces deux cueils en me
mettant aussi / prs que possible du transcendantal et en laissant tout fait de ct ce quil
pourrait y avoir de psychologique, cest--dire dempirique. (CRPu, Bar 600.4-601.1; dans la
Premire section: Du but final de lusage pur de notre raison, du Chapitre II: Canon de la raison
pure, de la Mthodologie transcendantale.)
La note affrente dit: Tous les concepts pratiques se rapportent des objets de satisfaction ou
daversion, cest--dire de plaisir ou de peine, et, par consquent, au moins indirectement, des
objets de sentiment. Mais comme le sentiment nest pas une facult reprsentative des choses,
mais quil rside en dehors de toute facult de connatre, les lments de nos jugements, en tant
quils se rapportent au plaisir ou la peine, appartiennent la philosophie pratique, et non pas
lensemble de la philosophie transcendantale, qui ne soccupe que des connaissances pures a
priori.
44
K <> T h m e # 3 <> K
3 . L e s t h t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
3. Lesthtique transcendantale......................................................................................................................43
3.1. Le concept dintuition et son environnement conceptuel...................................................................43
3.2. Illustration des relations entre les divers concepts utiliss par Kant pour modliser le
fonctionnement de la facult des intuitions ........................................................................................47
3.3 Reconstruction des expositions des concepts despace et de temps............................................... 48
3.4 Rsum de lesthtique transcendantale .............................................................................................52
3.1. Le concept dintuition et son environnement conceptuel
Pour comprendre ce quest lintuition, au sens de Kant, il est trs utile de se reporter un passage du dbut de
la Dialectique transcendantale dans lequel Kant rappelle les divers types de reprsentations quil distingue; cet
endroit, son objectif est de nous faire comprendre le sens quil faut donner au mot ide puisque les
reprsentations dont il sera surtout question dans la Dialectique sont les ides mais le tableau quil dresse nous
montre aussi bien la place de lintuition parmi les autres types de reprsentation. (Voir sur la figure de la page
suivante larbre logique des concepts mentionns par Kant.)
a) le concept de reprsentation <Vorstellung>
Le terme gnrique est la reprsentation en gnral (repraesentatio). Aprs elle vient la
reprsentation avec conscience (perceptio). Une perception rapporte uniquement au sujet, comme
une modification de son tat, est une sensation (sensatio); une perception objective est une
connaissance ( cognitio). La connaissance son tour est ou une intuition ou un concept ( intuitus vel
conceptus). La premire se rapporte immdiatement lobjet et est singulire, le second ne sy
rapporte que mdiatement, au moyen dun signe qui peut tre commun plusieurs choses.
(CRPu, Bar 320.2.m7-321.1.4; passage extrait de la Premire section. Des ides en gnral, du
Livre premier: Des concepts de la raison pure, de la Dialectique transcendantale.)
Lintuition est donc une reprsentation dune certaine sorte et soppose au concept qui est la principale autre
sorte de reprsentation. Voir ci-dessous la figure qui montre, au moyen dune arborescence, la subdivision du
concept gnrique de reprsentation.
b) lintuition comme mode de rapport et comme produit; et par mtonymie: lintuition comme facult
De quelque manire et par quelque moyen quune connaissance puisse se rapporter des objets, le
mode par lequel elle se rapporte immdiatement eux et que toute pense prend comme moyen
[pour les atteindre] est lintuition.
(CRPu, Bar 81.1.1-5; cest la toute premire phrase de lEsthtique transcendantale.)
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
45
Reprsentation en
gnral
avec conscience
> PERCEPTION
rapporte
uniquement au
sujet >
SENSATION
objective >
CONNAISSANCE
(cognitio)
qui se rapporte
immdiatement l'objet
et qui est singulire >
INTUITION (intuitus)
qui ne se rapporte que
mdiatement l'objet,
au moyen d'un signe
> CONCEPT
(conceptus)
empirique pure
pur, ayant sa
source
uniquement dans
l'entendement
>NOTION (notio)
empirique
form de notions et qui
dpasse la possibilit de
l'exprience >IDE (ou
concept rationnel
Vernunftbegriff)
qui ne dpase pas la
possibilit de l'exprience
> CATGORIE (ou concept
de l'entendement
Verstandesbegriff)
Selon cette manire de sexprimer, lintuition est explicitement considre comme un mode de rapport.
Lorsque lon considre lintuition comme mode de rapport aux objets, on la dsigne par le terme intuition, lequel
reste alors toujours au singulier puisquil nomme quelque chose dabstrait: une relation.
Mais Kant parle galement dintuition en un sens plus concret, et le terme intuition peut semployer alors
facilement au pluriel pour dsigner ce qui est produit , titre de reprsentations, par la facult qui actualise le mode
de rapport mentionn linstant:
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
46
La capacit de recevoir (la rceptivit) des reprsentations des objets grce la manire dont ils
nous affectent, sappelle sensibilit. Cest donc au moyen de la sensibilit que des objets nous sont
donns, et seule elle nous fournit des intuitions; mais cest par lentendement quils sont penss, et
cest de lui que sortent les concepts. Toute pense doit, en dernire analyse, soit tout droit (directe),
soit par des dtours (indirecte, au moyen de certains caractres), se rapporter des intuitions, et par
consquent, chez nous, la sensibilit, puisquaucun objet ne peut nous tre donn autrement.
(CRPu, Bar 81.1.8-f)
Lorsque Kant considre que le mode de rapport de la sensibilit lobjet donne lobjet, ou apprhende
lobjet, le mode de rapport devient lui-mme trait comme une capacit, comme une facult:
Il ny a pas (pour lhomme) dintuition des intelligibles, mais seulement une connaissance
symbolique, et lintellection ne nous est permise que par concepts universels dans labstrait, non par
le singulier dans le concret. Car toute intuition, en nous, est astreinte un certain principe dune
forme sous laquelle seule quelque chose peut tre vu par lesprit immdiatement, cest--dire comme
singulier et non pas seulement conu discursivement par concepts gnraux.
(Kant, La Dissertation de 1770, 39.1.1-10; les deux premires phrases du 10.)
Cest la facult dintuition, ici, qui est astreinte un certain principe de forme, et son acte (ou son rle) est de voir
ce par quoi elle est affecte.
Remarque. propos des objets, Kant construit ici lopposition entre tre penss et tre donns au moyen de la
sensibilit [par des intuitions]. Cette opposition serait plus facile saisir et retenir sil existait un verbe quon
puisse directement opposer au verbe penser [x] et qui puisse exprimer laction propre la sensibilit aussi
simplement que le mot penser exprime laction propre lentendement. Mais il y a deux difficults. Premire-
ment, la sensibilit tant une facult passive, il est (presque) paradoxal et lgrement misleading de lui attribuer une
action, au sens fort du terme. Deuximement, le verbe quon est tent de proposer pour cet office est le verbe
intuitionner mais il nexiste pas en franais correct. Malgr tout, la mtaphore de la vision sert exprimer
comment lintuition est produite. Dans le passage de la Dissertation cit ci-dessus, tre vu est donn par le verbe
allemand geschaut werden et par le verbe latin cerni. Il faudrait voir si et comment Kant utilise, dans CRPu, les
verbes qui appartiennent la mme famille que Anschauung: schauen et anschauen. Par exemple, au dbut
du chapitre I de lAnalytique des principes:
Ainsi le concept empirique dune assiette a quelque chose dhomogne avec le concept purement
gomtrique dun cercle, puisque la forme ronde qui est pense dans le premier se laisse percevoir
par intuition dans le second.
(CRPu, Bar 187.1.5f)
So hat der empirische Begriff eines Tellers mit dem reinen geometrischen eines Zirkels
Gleichartigkeit, indem die Rundung, die in dem ersteren gedacht wird, sich im letzteren anschauen
lt.
(KpV, Wei 187.1.4f)
La plus grande partie du problme que pose lidentification de laction propre la sensibilit se trouve cependant
rsolue en le renvoyant aux actions de limagination. Cette facult possde une activit, et plusieurs niveaux; sa
toute premire activit est lapprhension; le terme est hrit ici directement du latin. Limagination est qualifie
galement de productrice, de reproductrice et des actions sont ainsi dsignes, qui sont des tapes de la synthse des
intuitions. [Fin de la Remarque.]
La difficult quil y a construire une opposition conceptuelle homogne et claire tient non seulement au
vocabulaire mais galement lambigut de la tradition philosophique aristotlicienne concernant la connaissance
par intuition et lacte dintuition. Cette ambigut est admirablement dcrite par Caygill, larticle intuition (Cay,
KD 262-266). Il conclut ainsi la description quil fait de la manire dont Kant se situe par rapport la tradition:
On doit situer la doctrine kantienne de lintuition lintrieur des paramtres tablis par
Aristote. Kant est demeur en accord avec la tradition aristotlicienne en ce qui concerne le
caractre direct, non mdiatis de lintuition, mais il en a tabli une variante de son propre cru qui
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
47
refusait lopposition entre les rationalistes, qui plaaient la connaissance directe dans les noeta, et les
empiristes qui la plaaient dans les aistheta. Bien que Kant situe lintuition au niveau de la
sensibilit ou de laisthesis dans lEsthtique transcendantale de la CRPu (cest--dire au-dessous
de lentendement et de la raison), il lui accorde nanmoins un caractre formel a priori, russissant
ainsi souligner llment immdiat, sensible de la connaissance sans tre locken, et llment a
priori, formel sans tre cartsien. Il tait essentiel dtablir cet quilibre pour satisfaire lune des
principales conditions quexigeait la solution du problme gnral de la philosophie
transcendantale: comment les jugements synthtiques a priori sont-ils possibles? (CRPu, ) De
tels jugements oprent une synthse de concepts avec des intuitions sensibles qui, tout en tant
htrognes aux premiers, possdent nanmoins un caractre a priori , intelligible.
(Cay, KD 264.2)
c) Les corrlats de lintuition du ct des objets: sensation et phnomne
Limpression dun objet sur cette capacit de reprsentations, en tant que nous sommes
affects par lui, est la sensation. On nomme empirique toute intuition qui se rapporte lobjet par le
moyen de la sensation. Lobjet indtermin dune intuition empirique, sappelle phnomne.
(CRPu, Bar 81.2)
La premire citation donne ci-dessus en 3.1a (320.2) prsentait la sensation comme modification de
[l]tat [du sujet], survenant loccasion dune perception; la mme ide est reprise ici au moyen des deux
concepts corrlatifs impression et tre affect.
d) Forme du phnomne et forme de lintuition
Kant applique au phnomne lopposition conceptuelle forme // matire. La matire du phnomne est ce qui,
en lui, correspond la sensation (CRPu, Bar 81.3.1-2). Par symtrie, Kant va dfinir la forme du phnomne, mais
la symtrie est un peu force puisque, proprement parler, ce qui fait que le divers quil y a en lui [le phnomne]
est ordonn suivant certains rapports (CRPu, Bar 81.3.2-4) nest pas dans le phnomne, mais bien dans lesprit,
notamment, et pour commencer, dans lintuition.
[] Comme ce en quoi seul les sensations peuvent sordonner, ou ce qui seul permet de les ramener
une certaine forme, ne saurait / tre lui-mme sensation, il suit que, si la matire de tout
phnomne ne nous est donne qua posteriori, la forme en doit tre a priori dans lesprit, toute
prte sappliquer tous, et que, par consquent, on doit pouvoir la considrer indpendamment de
toute sensation.
(CRPu, Bar 81.3.4-82.1.f)
Cest ainsi que de lide de forme du phnomne laquelle me semble bien passagre on passe trs tt
lide de la forme des intuitions sensibles, et de la forme de lintuition, au singulier.
Et quelle que soit la varit des formes que peuvent revtir les intuitions sensibles ou lintuition sensible, cest
la classe des formes pures qui va intresser lesthtique transcendantale, et Kant va introduire une troisime
acception du terme intuition:
Jappelle pures (dans le sens transcendantal) toutes reprsentations o lon ne trouve rien qui
se rapporte la sensation. La forme pure des intuitions sensibles en gnral dans laquelle tout le
divers des phnomnes est peru par intuition sous certains rapports, est donc a priori dans lesprit.
Cette forme pure de la sensibilit peut encore tre dsigne sous le nom dintuition pure.
(CRPu, Bar 82.2.1-7)
Il y aura, en fait, deux intuitions pures: lespace et le temps.
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
48
e) Lintuition sensible versus lintuition intellectuelle
Le principe gnral selon lequel la connaissance se rapporte toujours ses objets par lintuition possde de la
gnralit, entre autres, du fait quil couvre, en thorie du moins, deux possibilits de ralisation (ou dapplication):
ou lintuition est fournie par la sensibilit, du fait que le sujet est affect par le phnomne duquel il
reoit des impressions; dans ce cas, lintuition est sensible. Le sujet est passif et le rapport de la
connaissance lobjet est mdiat. La connaissance natteint lobjet que tel quil apparat.
ou lintuition est fournie directement lentendement du fait de la capacit quaurait un entendement de
se donner lui-mme lobjet quil pense dans lacte mme de le penser; dans ce cas, lintuition est
intellectuelle, au sens o cest celle de lentendement (et non celle de la sensibilit). Le sujet est actif et le
rapport de la connaissance lobjet est immdiat. Un tel entendement atteint son objet tel quil est en lui-
mme (en soi)
Dans la tradition philosophique du rationalisme classique, et celle aussi, je suppose, de la scolastique, lentendement
de Dieu est rput capable dintuition intellectuelle. Et Kant voque quelques reprises lhypothse dun tre dot
dun entendement capable dintuition intellectuelle celui de Dieu ou dun autre tre, peu importe , mais
toujours pour souligner que lentendement humain ne possde pas cette capacit. Cest cette restriction quexpriment
les passages intercalaires du genre (du moins nous autres hommes} (CRPu, Bar 81.1.7) et chez nous (CRPu,
Bar 81.1.m2).
Il faut donc comprendre intuition sensible en opposition intuition intellectuelle et non pas en
opposition intuition pure.
3.2. Illustration des relations entre les divers concepts utiliss par Kant pour
modliser le fonctionnement de la facult des intuitions
Comparons le fonctionnement dun appareil de radio avec celui de la sensibilit.
Radio Sensibilit
Appareil possdant une Lesprit, considr en tant que possdant
capacit dtre affect
par les ondes hertziennes par les objets (pour linstant indtermins,
mais capables daffecter le sujet)
capacit qui a son substrat fonctionnellement identifiable
dans un capteur dnergie
lectromagntique (lantenne)
dans les sens
(cinq sens externes, un sens interne)
Le substrat reoit des impressions et
modifie son tat; ces modifications sont
les oscillations lectromagntiques de
lantenne
les sensations
Le substrat prsente en sortie (output)
des missions radiophoniques
(informations, musique, etc.)
des intuitions pures ou empiriques
(en tant que reprsentations obtenues par
intuition)
Liste des oppositions conceptuelles utilises dans lesthtique transcendantale:
tre donns // tre penss, en parlant des objets (81.1;
tre donns par la sensibilit // tre penss par lentendement
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
49
matire du phnomne // forme du phnomne (81.3); matire donne a posteriori, forme donne a
priori;
intuition empirique // intuition pure
esthtique (transcendantale) // logique (transcendantale) (82.3)
exposition mtaphysique // exposition transcendantale
La relation de reprsentation : le phnomne est lobjet de lintuition empirique.
Les 23 premires lignes du premier paragraphe de la 2. Exposition mtaphysique du concept de lespace
valent, comme introduction, pour les expositions concernant lespace et le temps, donc pour les 2-6 incl.:
au sens extrieur correspond la reprsentation des objets dans lespace
au sens intime correspond la reprsentation des objets dans le temps.
3.3 Reconstruction des expositions des concepts despace et de temps
A.1 Les quatre propositions qui constituent lexposition mtaphysique du concept de lespace; les quatre traits
correspondants
E1. Il faut que jaie une reprsentation de lespace et quelle soit loeuvre pour que je puisse faire
lexprience du caractre extrieur des phnomnes, cest--dire
rapporter certaines sensations quelque chose dextrieur moi [je souligne]; sans la
reprsentation pralable, je ne ferais pas de diffrence entre moi et lextrieur de moi et je
rapporterais ma sensation qu moi-mme.
me reprsenter les choses comme en dehors et ct les unes des autres; sans la reprsentation
pralable, je me les reprsenterais seulement comme diffrentes.
La dernire phrase du paragraphe est: Demnach kann die Vorstellung des Raumes nicht aus den
Verhltnissen der uern Erscheinung durch Erfahrung erborgt sein, sondern diese uere
Erfahrung ist selbst nur durch gedachte Vorstellung allererst mglich. (Wei III, 72.2.5f)
E2. On peut se reprsenter quil ny ait pas dobjets dans lespace mais on ne peut se reprsenter quil ny
ait pas despace; cela confre la reprsentation de lespace une ncessit. En dautres mots, la
reprsentation des objets ne peut pas tre la condition qui dtermine la reprsentation de lespace; cest
linverse: cest la reprsentation de lespace qui fonde les intuitions externes, les phnomnes [en tant
qu]extrieurs. Donc la reprsentation de lespace est a priori.
E3. On ne peut se reprsenter quun seul espace, et cette unit nest pas celle dun concept discursif ou
concept universel <allgemein>, car:
quand on parle de plusieurs espaces, ce ne sont jamais que les parties dun seul et mme espace;
le divers que nous y reconnaissons et par consquent le concept universel <allgemeine> despaces
en gnral ne reposent finalement que sur des limitations
lesdites parties ne sauraient prexister cet espace unique (et le constituer par leur assemblage);
elles ne sont au contraire penses quen lui.
Donc, une intuition de lespace sert de fondement tous les concepts que nous en formons (par exemple,
les concepts gomtriques de ligne, de triangle).
E4. Lespace est reprsent comme une grandeur infinie qui contient en soi une multitude infinie de
reprsentations savoir les reprsentations de ses parties (lesquelles coexistent linfini). Ce rapport
dune grandeur infinie linfinit de ses parties est diffrent du rapport (de subsomption) quentretient un
concept avec les reprsentations dont il exprime le caractre commun.
Rsum: il est antrieur lexprience de lespace
sa ncessit: on ne peut concevoir quil ny ait pas despace
son unit nest pas celle dun concept discursif mais celle dune intuition
son infinit nest pas celle dun concept par rapport aux reprsentations quil subsume.
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
50
A.2 Exposition transcendantale du concept de lespace
Par dfinition, une exposition transcendantale doit satisfaire les deux conditions mentionnes en 85.3.
Re: condition 1. [Cette proposition sert de majeure au raisonnement.] La gomtrie contient des
jugements synthtiques a priori concernant les proprits de lespace. Exemples:
lespace na que trois dimensions (86.1)
deux lignes droites ne peuvent enfermer aucun espace (100.1)
avec trois lignes droites on peut former une figure (100.1)
Re: condition 2. [Premire mineure du raisonnement.] Cette science nest possible que sous la
supposition dun mode dexplication donn [et tir] du [concept de lespace]:
il faut que lespace soit originairement une intuition (et non un concept)
car il est impossible de tirer dun simple concept des propositions qui le dpassent.
il faut que cette intuition soit a priori, cest--dire antrieurement toute perception dun objet, et,
par consquent, tre pure et non empirique
[Deuxime mineure du raisonnement.] Ces deux conditions ne sont ralisables, leur tour, que si cette
intuition a son sige dans le sujet, comme la capacit formelle quil a dtre affect par des objets [],
donc, que si elle est la forme mme du sens externe de ce sujet. (CRPu, Bar 86.2)
B.1 Exposition mtaphysique du concept du temps
Les quatre ides qui constituent lexposition mtaphysique du concept du temps, plus une cinquime
(numrote 3 dans le texte) qui appartient lexposition mtaphysique et lexposition transcendantale.
Les quatre premires ides appliquent au concept du temps les proprits dj dgages pour le concept
despace:
son antriorit (1). La perception mme de la simultanit ou de la succession ne serait pas possible
sans la reprsentation du temps qui sert de fondement cette perception.
sa ncessit (2). On ne peut penser la suppression du temps bien quon puisse penser la suppression des
phnomnes.
son unit (4). Son unit nest pas celle dun concept gnral [<allgemein>; dans lexposition
mtaphysique du concept despace, Barni traduisait allgemein par universel, sans doute pour viter la
double occurrence du mot gnral; mais il sagit toujours de allgemein] qui subsumerait des temps
diffrents; la raison en est que Les temps diffrents ne sont que des parties dun mme temps. En
dautres mots, le temps est un seul objet <Gegenstand>. Or, une reprsentation qui ne peut tre donne
que par un seul objet est une intuition.
puisquun concept est ncessairement donn par plusieurs objets, savoir les objets quil subsume.
Die Vorstellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber
Anschauung. (KrV, Wei 79.2.4-5)
De plus [il sagit donc dun second argument], la proposition que des temps diffrents ne peuvent exister
simultanment, ne saurait driver dun concept gnral, puisquelle est synthtique. Il faut donc quelle
soit immdiatement contenue dans lintuition et dans la reprsentation du temps.
son infinit (5). Toute grandeur dtermine du temps nest possible que par des dlimitations dun temps
unique qui lui sert de fondement.
alle bestimmte Gre der Zeit nur durch Einschrnkungen einer einigen zum Grunde liegenden
Zeit mglich sei.
Kant dit-il que pour quune reprsentation soit donne comme illimite il faut quelle soit donne
dans lintuition?
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
51
LARGUMENTATION DE LA 5
E
PARTIE DE LEXPOSITION MTAPHYSIQUE DU TEMPS
Objection hypothtique:
a) [on pourrait penser que] linfinit du temps (le nombre infini de ses grandeurs dtermines) est un
indice du fait que le temps est un concept gnral (allgemein), cest--dire que la reprsentation du
temps est donnes par un concept gnral.
M
Rfutation:
b) [mais il nen est rien:] la reprsentation du temps ne peut tre donne par les concepts;
au contraire, il y a ncessairement une intuition immdiate qui sert de fondement ses concepts, et cest
par elle que la reprsentation du temps est donne.
~M
&Q
c) en effet, linfinit du temps dont il sagit ici est simplement le fait que la reprsentation originaire du
temps est ncessairement donne comme illimite
N
d) car toute grandeur dtermine du temps nest possible que circonscrite par un temps unique qui lui sert
de fondement; en dautres mots: les parties mmes et toutes les grandeurs du temps ne peuvent tre
reprsentes quau moyen dune limitation (applique au temps unique et illimit)
P
e) or, quand il en est ainsi
cest--dire quand les parties mmes et toutes les grandeurs du temps ne peuvent tre reprsentes quau
moyen dune limitation
P
la reprsentation entire de cette chose ne peut tre donne par les concepts ~M
f) car ceux-ci ne contiennent que des reprsentations partielles
elle doit tre donne par une intuition immdiate Q
g) lintuition immdiate dont il sagit est celle qui sert de fondement aux concepts en question
h) et il y a ncessairement une telle intuition
La structure logique de ce raisonnement peut donc tre reprsente par le schma suivant:
M ~M & Q
N & P
P > (~M & Q)
La cinquime ide (numrote 3 dans lnumration kantienne) nonce, propos du concept du temps
a) son caractre de condition de possibilit de connaissances pures: le concept du temps rend possibles,
fonde la possibilit de, certains principes apodictiques concernant les rapports du temps, principes
tels que:
le temps na quune dimension
des temps diffrents ne sont pas simultans mais successifs
leur tour ces principes ont la valeur de rgles qui rendent lexprience possible en gnral.
Laffirmation du caractre de condition de possibilit fait partie de lexposition transcendantale.
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
52
b) le caractre a priori du concept du temps. Lnonc est fait sous la forme ngative (ne peuvent pas tre
tirs de lexprience) et indirecte (le caractre a priori est attribu aux principes apodictiques et par l
au concept de temps qui y est contenu). Laffirmation du caractre a priori fait partie de lexposition
mtaphysique.
B.2 Exposition transcendantale du concept du temps
Kant rfre lide numro 3 de lexposition prcdente, mais ajoute encore un exemple de connaissances
synthtiques a priori rendues possibles par notre concept du temps qui reprsente une intuition originaire: celles que
contient la thorie gnrale du mouvement. Kant pense ici sans doute aux lois du mouvement de Newton.
C. Le 7 Explication de lesthtique
Concernant le dbat sur la ralit du temps. Thse:
Partie affirmative Partie ngative
le temps a une ralit empirique (93.3) na pas de ralit absolue,
transcendantale
le temps est quelque chose de rel; cest
en effet la forme relle de lintuition
interne; il a une ralit subjective par
rapport lexprience intrieure (94.1.8-
11)
il faut admettre lidalit
transcendantale du temps en ce sens que,
si lon fait abstraction des conditions
subjectives de lintuition sensible, il
nest plus rien (93.2)
Cette ralit que jattribue lespace et
au temps laisse intacte la certitude de la
connaissance exprimentale
[Erfahrungserkenntnis]
Thse finale de la 7. Lesthtique transcendantale ne peut rien contenir de plus que ces deux lments,
savoir lespace et le temps
puisque tous les autres concepts appartenant la sensibilit supposent quelque chose dempirique.
D. Le 8.
I. Rappel des positions acquises ayant valeur de rsum ou dexplicitation par des exemples.
II. Thse: tout ce qui dans notre connaissance appartient lintuition [] ne contient que de simples rapports,
rapports de lieux dans une intuition (tendue), rapports de changement de lieu (mouvement), et des lois qui
dterminent ce changement (forces motrices). (101.2)
Lorsquon applique cette thse au sens interne, elle a pour consquence que le sujet, par le sens intime, ne se
reprsente lui-mme que comme phnomne, et non comme il se jugerait lui-mme si son intuition tait purement
spontane, cest--dire intellectuelle. (102.25-27) Autre formulation: [Lesprit] se peroit intuitivement, non
comme il se reprsenterait lui-mme immdiatement et en vertu de sa spontanit, mais suivant la manire dont il es
intuitivement affect, et par consquent tel quil sapparat lui-mme, non tel quil est. (102-103)
III. Lidalit des intuitions sensibles ne signifie pas que les objets soient une simple apparence. Je ne dis
pas que les corps semblent simplement exister hors de moi, ou que mon me semble simplement tre donne dans la
conscience que jai de moi-mme, lorsque jaffirme que la qualit de lespace et du temps, daprs laquelle je me les
reprsente et o je place ainsi la condition de leur existence ne rside que dans mon mode dintuition et non dans ces
objets en soi. (103.2)
T H M E # 3 . L E S T H T I Q U E T R A N S C E N D A N T A L E
_____________________________________________________________________________________________
53
3.4 Rsum de lesthtique transcendantale
Les premires lignes du 22 de lAnalytique transcendantale (dans le chapitre II-De la dduction des concepts
purs de lentendement de lAnalytique des concepts) peuvent servir de rsum de lEsthtique transcendantale.
22. La catgorie na dautre usage dans la connaissance des choses que de sappliquer des
objets dexprience.
Penser un objet et connatre un objet, ce nest donc pas une seule et mme chose. La
connaissance suppose en effet deux lments: dabord le concept, par lequel, en gnral, un objet est
pens (la catgorie), et ensuite lintuition, par laquelle il est donn. Sil ne pouvait y avoir dintuition
donne qui correspondt au concept, ce concept serait bien une pense quant la forme, mais sans
aucun objet, et / nulle connaissance dune chose quelconque ne serait possible par lui. En effet, dans
cette supposition, il ny aurait et ne pourrait y avoir, que je sache, rien quoi pt sappliquer une
pense. Or, toute intuition possible pour nous est sensible (esthtique); par consquent la pense
dun objet en gnral ne peut devenir en nous une connaissance, par le moyen dun concept pur de
lentendement, quautant que ce concept se rapporte des objets des sens. Lintuition sensible est ou
intuition pure (lespace et le temps), ou intuition empirique de ce qui est immdiatement reprsent
comme rel par la sensation dans lespace et le temps. Nous pouvons acqurir par la dtermination
de la premire des connaissances a priori de certains objets (comme dans les mathmatiques), mais
ces connaissances ne concernent que la forme de ces objets, considrs comme phnomnes; sil
peut y avoir des choses qui doivent tre saisies par lintuition dans cette forme, cest ce qui reste
dcider. Par consquent les concepts mathmatiques ne sont pas des connaissances par eux-mmes;
il ne le deviennent que si lon suppose quil y a des choses qui ne peuvent tre reprsentes que
suivant la forme de cette intuition sensible pure. Or les choses ne sont donnes dans l espace et dans
le temps que comme perceptions (reprsentations accompagnes de sensation), cest--dire au
moyen dune reprsentation empirique.
(CRPu, Bar 162.3.1-163.1.25)
54
K <> T h m e # 4 <> K
4 . L A n a l y t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I F o n c t i o n s l o g i q u e s et ca t g o r i e s
4. LAnalytique transcendantale ....................................................................................................................53
4.1 (Introduction) Gnralits concernant lanalytique................................................................................53
4.2 Lanalytique des concepts...................................................................................................................56
4.2.1 Les fonctions logiques du jugement et la table des catgories ..................................................56
4.1 (Introduction) Gnralits concernant lanalytique
A. Le passage de lesthtique la logique
Les thses de lesthtique concernant la ralit empirique et lidalit transcendantale de lespace et du temps
constituent une premire partie de la rponse aux questions de la possibilit des connaissances a priori:
comment la mathmatique est-elle possible?
comment la physique pure est-elle possible?
comment la mtaphysique est-elle possible en tant que disposition naturelle?
Selon la formulation de Kant, lespace et le temps, en tant quintuitions pures a priori, constituent une des donnes
requises pour la solution (CRPu, Bar 105.2.1-2; premire phrase de la Conclusion de lesthtique transcen-
dantale) de ces problmes.
La toute premire articulation conceptuelle que Kant nous donne pour penser le passage de lesthtique la
logique est celle quil fait entre la rceptivit des impressions et la spontanit des concepts; on trouve cette
articulation appelons-la Arti 1 ds la premire phrase de lintroduction la Logique transcendantale. Cette
articulation premire, exprime dans les termes des proprits dynamiques des deux facults qui sont les sources
principales de notre connaissance, saccompagne des oppositions correspondantes habituelles
SENSIBILIT
Capacit de recevoir les
reprsentations
ENTENDEMENT Facult de
connatre un objet au moyen de
ces reprsentations
Arti 2. en termes daction, ou
fonction, des facults
Un objet nous est donn Un objet est pens dans son
rapport cette reprsentation
Arti 3. en termes des proprits
de lobjet de connaissance
Sensible Intelligible
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
55
Arti 4. en termes de produit des
facults, ou lments de notre
connaissance
Intuition.
Intuition empirique: lorsquune
sensation est contenue dans la
reprsentation
Concept.
Concept empirique: lorsquune
sensation est contenue dans la
reprsentation
Intuition pure: lorsque aucune
sensation ne se mle la
reprsentation
Concept pur: lorsque aucune
sensation ne se mle la
reprsentation
Arti 5. en termes des sciences qui
tudient les rgles des facults
Esthtique Logique
Retenons que cest dans le deuxime paragraphe de lintroduction lAnalytique transcendantale que se
trouvent les deux clbres mtaphores qui noncent lide de la ncessaire coopration entre sensibilit et
entendement, entre intuition et concept, dans le processus de la connaissance:
[] Sans la sensibilit, nul objet ne nous serait donn; sans lentendement, nul ne serait pens. Des
penses sans matire sont vides; des intuitions sans concepts sont aveugles. Aussi est-il tout
aussi ncessaire de rendre sensibles les concepts (cest--dire dy joindre lobjet [donn] dans
lintuition), que de rendre intelligibles les intuitions (cest--dire de les soumettre des concepts).
Ces deus facults ou capacits ne sauraient non plus changer leurs fonctions. Lentendement ne
peut avoir lintuition de rien, ni les sens rien penser. La connaissance ne peut rsulter que de leur
union.
(CRPu, Bar 110.1.5-14; accentuation en gras due NL)
Il existe donc une opposition conceptuelle entre phnomne et connaissance.
Cest cette opposition qui tait exprime dans la prface par la mtaphore de lobjet [qui] (comme objet de
connaissance) se rgle sur la nature de notre facult intuitive (CRPu, Bar 42.1.13-14), imitant en cela le soleil dont
le mouvement apparent dpend du fait que nous, Terriens, nous dplacions; la nature de notre facult intuitive est la
condition a priori de laquelle dpend la manire dont lobjet nous apparat.
B. La spcificit de la logique transcendantale
Voir le schma donn dans la section 2.2.1.2 ci-dessus du thme 2, l o jexplique larticulation entre
lEsthtique et la Logique transcendantale. Cest le rapport entre la logique gnrale et la logique transcendantale
quil convient dexpliquer plus avant ici.
La logique gnrale pure, et qui est galement formelle en ce quelle ne soccupe que de la forme de la
pense, abstraction faite de ses contenus, regroupe la logique aristotlicienne (y compris la thorie des syllogismes)
de mme que la logique de tradition cartsienne, exemplifie par la logique de Port-Royal. (Caygill, dans larticle
logic, general/transcendental esquisse une description des traces des deux traditions, telles quon les observe dans
la Critique de la raison pure; voir Cay, KD 280-281.) Il sagit maintenant pour Kant de refondre la logique
gnrale de la tradition et den faire une logique transcendantale moderne (Cay, KD 281.2.6-7), entendons post-
cartsienne.
La logique transcendantale va diffrer de la logique gnrale pure sur deux points:
elle ne se limitera pas tre formelle, comme lest la logique gnrale pure. Au lieu de faire abstraction
de tout contenu de la connaissance, la logique transcendantale rechercherait [] lorigine de nos
connaissances des objets, en tant quelle ne peut tre attribue ces objets mmes (CRPu, Bar
112.2.m12-10).
elle fera une diffrence entre certains contenus de connaissances et certains autres, alors que la logique
gnrale pure dicte ses principes purs a priori sans gard cette diffrence possible entre contenus:
quel quen soit dailleurs le contenu (quil soit empirique ou transcendantal) (CRPu, Bar 111.1.12-
14);
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
56
elle se borne examiner les reprsentations, quelles soient en nous originairement a priori, ou
quelles nous soient seulement donnes empiriquement (CRPu, Bar 112.2.m8-5);
[la logique transcendantale] ne se rapporterait qu des objets a priori , et non, comme la logique
gnrale, aux connaissances empiriques ou pures sans distinction. (CRPu, Bar 113.2.3f)
La dfinition programmatique de la logique transcendantale est donne dans le premier et le dernier
paragraphe de II. De la logique transcendantale, CRPu, Bar 112.113.
Le passage de la logique gnrale pure traditionnelle la logique transcendantale est trs clairement expliqu
par Caygill:
Avec le dveloppement dune logique moderne, transcendantale, Kant nentend pas rejeter les
acquis de la tradition logique. Bien plutt, il prend les analyses du jugement tires de la tradition et
les utilise comme indicateurs pour dcouvrir les oprations de lentendement en logique
transcendantale. Les concepts quil utilise pouf effectuer la transition de la logique traditionnelle la
logique moderne sont ceux dunit et de synthse. Les jugements de la logique gnrale,
abstraction faite de tout contenu, sont des fonctions de lunit (premire section du chap. I Du fil
conducteur servant dcouvrir tous les concepts purs de lentendement de lAnalytique des
concepts); une fois traduits dans les termes de la logique transcendantale ils signifient les synthses
dun sujet spontan, aperceptif, confront un divers de la sensibilit a priori. Les synthses
transcendantales drives des fonctions logiques de la logique gnrale forment la table des
catgories ou la / liste de tous les concepts purs originaux de la synthse que lentendement
contient en lui a priori () Avec ces synthses Kant allait donner satisfaction la fois la logique
traditionnelle base sur les formes du jugement et de linfrence et la logique moderne enracine
dans le Cogito cartsien et base sur la conscience de soi et laperception.
(Cay, KD 281.f-282.1)
C. Concernant le sens de ladjectif transcendantal.
Concernant la dfinition de transcendantal, loccasion de lexplication de ce quest la logique
transcendantale. Imgleichen wrde der Gebrauch des Raumes von Gegenstnden berhaupt
auch transzendental sein: aber ist er lediglich auf Gegenstnden der Sinne eingeschrnkt, heit er
empirisch. (CRPu, Bar 113.2; avant-dernier paragraphe de la division II de lIntroduction de la
Logique transcendantale) Sagit-il de lusage de lespace dobjets en gnral, ou de lusage de
lespace par des objets en gnral, ou de lemploi quon fait de lespace propos dobjets en
gnral Trmesaygues & Pacaud disent: De mme, lemploi quon ferait de lespace pour des
objets en gnral serait aussi transcendantal; mais il est empirique, quand on le limite uniquement
des objets des sens. (CRPu, T. & P. 1950, 80.1) Mon hypothse: lemploi de lespace [pour
parler] dobjets en gnral
Voir, pour un traitement plus systmatique, le plan dun essai sur ce thme, que jai joint comme
Appendice 1 du prsent ouvrage.
D. De la division de la logique (aussi bien gnrale que transcendantale) en analytique et dialectique.
Section III de lintroduction la Logique transcendantale [CRPu, Bar 113.3-116.2]: La logique gnrale se divise en
Analytique et Dialectique.
Admettons la dfinition nominale: la vrit est laccord de la connaissance avec son objet. [CRPu, Bar 113.f-
114.1]
Il est absurde de chercher un critrium la fois suffisant et universel de la vrit [CRPu, Bar 114.2-3]
Le critre simplement logique (formel) de la vrit nest quune condition sine qua non de la vrit. [CRPu, Bar
114.4-115.1]
Il existe deux usages de la logique gnrale:
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
57
si on sen sert comme dun canon pour la pense, sans prtendre en tirer des jugements sur la vrit
matrielle (objective) de la connaissance, elle donne lieu lAnalytique, qui permet de juger de la forme
de toute connaissance. [CRPu, Bar 115.2.1-m11]
si on sen sert comme dun organon, la logique gnrale prend le nom de dialectique, et cet usage est
contraire la dignit de la philosophie (CRPu, Bar 116.2.1-2). [CRPu, Bar 115.2.m11-116.2.f]
Section IV de lintroduction la Logique transcendantale [CRPu, Bar 116.3-117.1]: La logique transcendantale se
divise galement en Analytique et Dialectique.
4.2 Lanalytique des concepts
La dtermination ontologique premire de lobjet en gnral, du point de vue transcendantal nest
ni lextriorit, ni la position devant (contenue dans ltymologie du mot objet), ni laltrit (tout au
contraire! puisque cest laction du sujet qui fait advenir lobjet); cest lunit. (Del, PCK 25.2)
4.2.1 Les fonctions logiques du jugement et la table des catgories
Kant expose rondement, dans la section 9, la table des fonctions logiques et lassortit de 4 remarques
concernant des dtails relativement techniques:
les remarques 1 et 2 justifient chacune une diffrence que la table kantienne fait entre deux fonctions,
diffrence que les logiciens, en logique gnrale, peuvent se permettre de ne pas faire; Kant allgue ainsi
quen prvision de linterprtation transcendantale donner aux fonctions logiques, il lui faut distinguer
entre jugement universel et jugement singulier
entre jugement affirmatif et jugement indfini.
la remarque 3 donne des explications sur les items du groupe des relations. Lexplication concernant la
relation de consquence (deuxime item) comporte une mise en garde: on pense ici le rapport de principe
consquence et seulement ce rapport, sans gard la question de savoir si les deux propositions
impliques sont vraies. Concernant la troisime relation (la disjonction), Kant interprte dj lopposition
logique qui sy trouve dans les termes qui seront pertinents, eu gard la logique transcendantale: les
propositions runies dans une disjonction dterminent une sphre de la connaissance possible (133.1.1)
relativement quelque objet, ainsi que des rapports entre les parties de cette sphre.
la quatrime remarque est galement explicative; Kant y prcise seulement que la modalit concerne non
pas le contenu des jugements mais la valeur de la copule.
TERMINOLOGIE COMPARE DE LA LOGIQUE GNRALE PURE
ET DE LA LOGIQUE TRANSCENDANTALE
I. LACTE DE LENTENDEMENT
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
58
Logique gnrale pure Logique transcendantale
Lacte de lentendement consiste runir diverses
reprsentations sous une reprsentation commune
(CRPu, Bar 129.1.12-13); cette dernire est un
concept.
Lacte de lentendement consiste JUGER.
Lentendement ne peut faire de ces concepts
dautre usage que de juger par leur moyen [] nous
pouvons ramener tous les actes de lentendement
des jugements (129.f.f-130.1.1)
lentendement est une facult de penser
or penser cest connatre par concepts
tout concept est le prdicat dun jugement possible.
Lacte de lentendement consiste parcourir, recueillir et
lier de quelque faon la diversit des lments
sensibles a priori que la sensibilit lui fournit [selon
les rsultats dj obtenus par lesthtique
transcendantale]. Jappelle cet acte synthse.
(CRPu, Bar 135.1.2f) Jentends donc par synthse,
dans le sens le plus gnral de ce mot, lacte qui
consiste ajouter diverses reprsentations les unes
aux autres et en runir la diversit en une
connaissance. (CRPu, Bar 135.2.1-4)
Kant distingue entre synthse, dans le sens le plus gnral de ce mot (CRPu, Bar 135.2.1-2) et la synthse
pure: Cette synthse est pure, quand la diversit nest pas donne empiriquement, mais a priori (comme celle qui
est donne dans lespace et dans le temps). (CRPu, Bar 135.2.4-6) Seule la synthse pure intresse lAnalytique
transcendantale.
Kant distingue galement entre la synthse en gnral [laquelle] est le simple effet de limagination
(135.3.1-2) et lacte qui consiste ramener cette synthse des concepts [lequel] est une fonction qui appartient
lentendement, et par laquelle il nous procure dabord la connaissance dans le sens propre de ce mot. (CRPu, Bar
135.3.5f) Allein, diese Synthesis auf Begriffe zu bringen, das ist eine Funktion, die dem Verstande zukommt, []
(KrV, Wei 117.2.m4-2)
Logique gnrale pure Logique transcendantale
Lacte de lentendement est considr seulement
comme produisant les proprits formelles des
jugements.
Lacte de lentendement, dans son usage logique,
pourrait peut-tre aussi tre dsign par le mot
analyse (voir III, ci-dessous).
Lacte de lentendement est considr comme produisant
le contenu des connaissances, cest--dire ce quil y a
dobjectif dans la connaissance;
et, en particulier, dans le cas de la synthse pure, ce
quil y a dobjectif dans la connaissance a priori dun
objet quelconque.
II. LUNIT DE LACTE DE LENTENDEMENT EST SPCIFIE PAR SA FONCTION
Au dbut de la premire section, il nest pas clair si la dfinition donne l de la fonction, vaut seulement pour
lusage logique de lentendement, et donc seulement pour le contexte de la logique gnrale (non transcendantale).
Mais plusieurs indices, par la suite, montrent que le mot fonction est galement utilis dans le contexte de la
logique transcendantale et sert prciser le principe dunit de lacte de lentendement dont il est question. On peut
donc vraisemblablement considrer que la fonction dfinie comme lunit de lacte qui consiste runir diverses
reprsentations sous une reprsentation commune (CRPu, Bar 129.1.11-13) vaut en un sens spcifique pour lacte
de juger et en un sens gnrique pour lacte de synthse. Ce qui serait cohrent avec le fait que le discours qui
encadre immdiatement la dfinition concerne vaut videmment pour les deux contextes: les concepts supposent
des fonctions, Les concepts reposent sur la spontanit de la pense [] .
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
59
Logique gnrale pure Logique transcendantale
La fonction donne lunit aux diverses
reprsentations [qui se trouvent] dans un jugement
136.2.1-2)
Dans ce contexte, la fonction est spcifie par
lexpression fonction logique.
La mme fonction donne lunit la simple
synthse des reprsentations diverses [qui se
trouvent] dans une intuition, et cest cette unit qui,
prise dune manire gnrale, sappelle un concept
pur de lentendement (136.2.2-5), aussi appel
catgorie.
Dans ce contexte, la fonction est spcifie par
lexpression unit de la synthse.
lentendement au moyen de lunit analytique, []
produit dans les concepts la forme logique du
jugement (136.2.6-7)
lentendement introduit aussi, par la mme opration
<durch eben dieselben Handlungen>, au moyen de
lunit synthtique des lments divers de lintuition
en gnral, un contenu transcendantal dans ses
reprsentations, et cest pourquoi elles sappellent des
concepts purs de lentendement, qui sappliquent a
priori des objets. (136.2.m7-2)
Le fait de ramener la synthse des concepts est une
fonction de lentendement (voir citation CRPu, Bar
135.3.5f, ci-dessus).
III. LARTICULATION ENTRE ANALYSE ET SYNTHSE.
Analyse unit analytique Synthse unit synthtique
La logique gnrale attend que les reprsentations lui
soient donnes dailleurs, do que ce soit, pour les
convertir dabord en concepts, ce quelle fait au
moyen de lanalyse (CRPu, Bar 134.2.1-5; dbut de
10)
Nos reprsentations doivent tre donnes
antrieurement lanalyse quon en peut faire, et
aucun concept ne peut se former analytiquement
quant son contenu. (CRPu, Bar 135.2.6-9) Les
concepts se forment donc dabord synthtiquement,
quant leur contenu; ils rsultent de la synthse
dune diversit (quelle soit donne empiriquement
ou a priori) (CRPu, Bar 135.2.9-11) Et cette
synthse est la premire chose sur laquelle nous
devions porter notre attention lorsque nous voulons
juger de lorigine de notre connaissance.
Cest par le moyen de lanalyse que diverses
reprsentations sont ramenes sous un concept
(traduction N. L. au lieu de : CRPu, Bar 135.5.1-2).
Analytisch werden verschiedene Vorstellungen
unter einen Begriff gebracht (Wei 3, 117.4.1-2)
Lunit ainsi produite peut donc tout naturellement tre
qualifie danalytique; et cest elle quexprime un
jugement. Cest par lanalyse des diverses
reprsentations des corps, et la dcouverte du prdicat
divisible en chacun, que lon peut ramener lesdites
reprsentations sous le concept de divisibilit ce
quon exprime en disant Les corps sont divisibles.
[Suite immdiate de la citation donne gauche]
mais ce ne sont pas les reprsentations, cest la
synthse pure des reprsentations que la logique
transcendantale enseigne ramener des concepts [
savoir] les concepts qui donnent lunit cette
synthse pure et qui consistent uniquement dans la
reprsentation de cette unit synthtique ncessaire
(CRPu, Bar 135.f.m3-136.1.m3)
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
60
Remarquons que le concept dunit utilis pour construire lopposition conceptuelle entre unit analytique et
unit synthtique, ci-dessus, nest pas le concept dunit qui figure dans la table des catgories. Cest probablement
cette ide que Kant exprime explicitement, plus loin, propos de la reprsentation de lunit synthtique de la
diversit, bien que le rapport entre la catgorie et ladite unit y soit un peu plus mdiatis:
[] Cette unit qui prcde a priori tous les concepts de liaison, nest pas du tout la catgorie de
lunit (10); car toutes les catgories se fondent sur des fonctions logiques de nos jugements, et
dans ces jugements est dj pense une liaison, par consquent une unit de concepts donns. La
catgorie prsuppose donc la liaison. Il faut donc chercher cette unit (comme qualitative, 12) plus
haut encore, cest--dire dans ce qui contient le principe mme de lunit de diffrents concepts au
sein des jugements, et par consquent de la possibilit de lentendement, mme au point de vue de
lusage logique.
(CRPu, Bar 154.1.3-f)
IV. LE RAPPORT ENTRE FONCTION LOGIQUE ET CATGORIE
[] Les catgories sont des concepts dun objet en gnral, au moyen desquels lintuition de cet
objet est considre comme dtermine par rapport lune des fonctions logiques des jugements.
Ainsi la fonction du jugement catgorique est celle du rapport du sujet au prdicat, comme quand je
dis: tous les corps sont divisibles. Mais au point de vue de lusage purement logique de
lentendement, on ne dtermine pas auquel des deux concepts on veut attribuer la fonction de sujet,
et auquel celle de prdicat. En effet, on peut dire aussi: quelque divisible est un corps. Au contraire,
lorsque je fais rentrer sous la catgorie de la substance le concept dun corps, il est dcid par l que
lintuition empirique de ce corps dans lexprience ne peut jamais tre considre autrement que
comme sujet, et jamais comme simple prdicat. Il en est de mme des autres catgories.
(CRPu, Bar 152.3.2-f; dernier paragraphe de 14, du
Chap. II. De la dduction des concepts purs de lentendement.)
Les formes des jugements sont identifies par des
adjectifs (universel, particulier, singulier, etc.) qui
qualifient les jugements.
Les concepts purs de lentendement sont identifis par
des substantifs; qui dsignent la forme de la
dtermination confre lobjet (qui dsignent donc
la manire de le penser): unit, pluralit, totalit
Pour se souvenir de ce modle conceptuel par lequel on passe de la logique gnrale la logique
transcendantale, on peut donc le rsumer ainsi:
Dans la logique gnrale pure, tout comme dans la logique transcendantale
il sagit de dcrire la pense par concepts ou pense conceptuelle;
il sagit didentifier le principe qui confre de lunit lacte de lentendement qui est mis en cause;
on peut concevoir ce principe comme la fonction de lacte concern cest ce que fait Kant dans
lintroduction la table des catgories, p. 136.2; mais Kant emploie aussi le mot fonction en un sens plus
spcifique quand il lassortit de ladjectif logique et selon cet emploi lexpression fonction logique (du
jugement, ou dans les jugements) soppose concepts purs de lentendement opposition que fait Kant
en 136.3.
Kant utilise Handlung, au singulier ou au pluriel, pour signifier lacte de lentendement; Barni
traduit par acte dans la premire section (Jentends par fonction lunit de lacte qui consiste
; nous pouvons ramener tous les actes de lentendement des jugements, p. 129-130) et
au dbut de la troisime section (Jappelle cet acte synthse. / Jentends donc par synthse, dans
le sens le plus gnral de ce mot, lacte qui consiste . p. 135.) Mais en 136.2 (deuxime
paragraphe avant la table des catgories), Barni traduit Handlungen (pluriel) par opration (au
singulier).
T H M E 4 . L A N A L Y T I Q U E I. F O N C T I O N S L O G I Q U E S E T C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
61
En logique gnrale, lacte de ramener des reprsentations un concept seffectue par la production de
jugements et lunit de cet acte, celle aussi de son produit, est donne par la fonction logique; lunit du
jugement produit est analytique car cest par lanalyse de reprsentations dj donnes que lentendement peut
les ramener un concept (les unifier sous un concept) et un jugement peut toujours tre interprt comme
lexpression dun rsultat dune telle analyse.
En logique transcendantale, lacte de ramener des reprsentations un concept seffectue par la synthse des
reprsentations fournies par lintuition. Pour les fins de la logique transcendantale, seule la synthse pure est
examiner, puisquil sagit didentifier des conditions de la possibilit des jugements synthtiques a priori.
Lunit de lacte de lentendement, celle aussi de son produit, est donne par le concept pur de lentendement;
lunit de la connaissance a priori ainsi produite est une unit synthtique, puisquelle est obtenue par la
synthse des lments divers de lintuition en gnral (CRPu, Bar 136.2.m5).
La synthse qui produit lunit synthtique des reprsentations est considre comme antrieure celle qui
produit lunit analytique car lanalyse ne peut procder que sur des reprsentations dj donnes.
Dans la logique gnrale pure, tout comme dans la logique transcendantale, il faut distinguer deux niveaux de
concepts et de production de concepts:
le niveau des concepts qui surviennent dans les exemples tels que Les corps sont divisibles et qui sont les
reprsentations sur lesquelles lentendement exerce son acte, sa fonction, au cours de son travail pour
produire des jugements et des connaissances; ces concepts sont ceux des sciences.
le niveau des concepts au moyen desquels le logicien exprime, dans le vocabulaire de la logique (gnrale
ou transcendantale) lunit des actes de lentendement dont il fait la thorie; en logique gnrale, ces
concepts sont les fonctions logiques (12 concepts) ; en logique transcendantale, ces concepts sont les
catgories (12 concepts, si lon considre chaque doublet du groupe Relation comme un concept de
relation; et chaque doublet du groupe Modalit comme un concept de modalit). Ces concepts sont ceux
de la thorie de lentendement et on peut les considrer comme des mtaconcepts, dans la mesure o la
thorie de lentendement tient un mtadiscours relativement au discours des sciences.
62
K <> T h m e # 5 <> K
L A n a l y t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I I . L a d d u c t i o n d e s ca t g o r i e s
4.2.2 La dduction transcendantale des catgories.............................................................................61
4.2.2.1 Les principales coupures...................................................................................................61
4.2.2.2 Reconstitution de la dmarche et des thses.....................................................................65
4.2.2.3 Plan logique de la dduction transcendantale (16-26, 2e dition)..................................72
4.2.2.4 Expos de la premire version..........................................................................................75
4.2.2.5 Comparaison entre la version de la premire dition (DT1) et celle de la deuxime
(DT2) ................................................................................................................................77
4.2.2.6 Ides gnrales pouvant servir de rsum ou de vue densemble de la dduction
transcendantale..................................................................................................................79
4.2.2 La dduction transcendantale des catgories
4.2.2.1 Les principales coupures; le plan thmatique correspondant
Coupure 1. il est clair, daprs ce qui a t dit plus haut, que la premire condition [cest--dire
lintuition], celle sans laquelle nous ne saurions percevoir par intuition des objets, sert en ralit a priori dans
lesprit de fondement aux objets, quant leur forme. Tous les phnomnes saccordent donc ncessairement
avec cette condition formelle de la sensibilit, puisquils ne peuvent apparatre, cest--dire tre
empiriquement perus et donns que sous cette condition. Il sagit maintenant de savoir sil ny a pas aussi
des concepts a priori qui ont une antriorit en tant que conditions qui seules permettent, non pas, certes,
dapercevoir par intuition mais nanmoins de penser quelque chose comme un objet en gnral, auquel cas
toute connaissance empirique dobjets se conforme ncessairement de tels concepts puisque sans eux rien
na plus la possibilit dtre un objet dexprience. (CRPu, Bar 150.1.m23-7, la coupure est indique en gras
par NL.)
Premier thme Deuxime thme Coupure
Lintuition (et ses formes a priori)
comme condition de la possibilit des
phnomnes, comme condition du fait
quils apparaissent, quils soient
donns. Lintuition comme fondement a
priori des objets, quant leur forme.
Rfre la dduction transcendantale
effectue pour lespace et le temps dans
lesthtique; cette dduction est
rappele en 13, p. 148.2-149.1.
Les catgories comme conditions de la
possibilit dobjets en gnral, de
lobjet dexprience, de
lexprience (quant la forme de la
pense) (150.1.f-151.1.1; comme
fondement objectif de la possibilit
de lexprience (CRPu, Bar 151.2.6-
7)
14.
Passage la
dduction
transcendan-
tale des
catgories
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
63
Coupure 2. je dois faire abstraction de la manire dont est donn ce quil y a de divers dans une intuition
empirique, pour ne considrer que lunit que lentendement y ajoute dans lintuition au moyen de la
catgorie. Dans la suite (26) / on montrera, par la manire dont lintuition empirique est donne dans la
sensibilit, que lunit ce cette intuition nest autre que celle que la catgorie prescrit [] et que par
consquent le but de la dduction nest vraiment atteint quautant que la valeur a priori de cette catgorie est
explique relativement tous les objets de nos sens. (CRPu, Bar 161.2.9-162.2.f)
Amlioration de traduction
162.1.5sqq et par consquent, du fait quon a une explication de la validit a priori de cette
catgorie relativement tous les objets de nos sens, cest alors que le but de la dduction
sera pleinement atteint. Le texte de Barni contient un que de trop, celui plac devant
par consquent le but.
Coupure 3. Dans la dduction mtaphysique, nous avons prouv en gnral lorigine a priori des
catgories par leur accord parfait avec les fonctions logiques universelles de la pense; dans la dduction
transcendantale, nous avons expos la possibilit de ces catgories considres comme connaissances a
priori dobjets dintuition en gnral (20-21). Il sagit maintenant dexpliquer comment, par le moyen des
catgories, les objets qui ne sauraient se prsenter qu nos sens peuvent nous tre connus a priori, et cela
non pas dans la forme de leur intuition, mais dans les lois de leur liaison, et comment par consquent nous
pouvons prescrire en quelque sorte la nature sa loi et mme la rendre possible. (CRPu, Bar 170.2.1-13; la
coupure est indique en gras par NL.)
Premier thme Deuxime thme Coupure
la possibilit de ces catgories
considres comme connaissances a
priori dobjets dintuition en gnral
(20-21).
les catgories considres comme
connaissances a priori des objets non
pas dans la forme de leur intuition,
mais dans les lois de leur liaison
170.1
26
la division entre dduction mtaphysique et dduction transcendantale a pour effet de nous faire voir que
les 9-10 constituaient la dduction mtaphysique
les 20-21 constituent lessentiel de la dduction transcendantale accomplie jusque l. Les 13-19
fournissent, titre de prparation, tous les lments qui permettront de complter trs brivement
largumentation dcisive du 20.
le 26 complte la dduction transcendantale des concepts purs de lentendement.
RECONSTITUTION DU PLAN THMATIQUE CORRESPONDANT
Lopposition (DV/OS) entre divers de lintuition sensible (pure ou empirique) et objets des sens. Dans le
premier alina du 26, cette opposition est nonce entre objets dintuition en gnral et objets qui ne sauraient
se prsenter qu nos sens; le premier terme de cette opposition contient le mot objets bien que la formulation de
la thse 20 laquelle il rfre ne contienne pas encore le mot objet.
Lopposition (OSFI/OSLL) entre objets des sens connus dans la forme de leur intuition et objets des sens
connus dans les lois de leur liaison.
1. Les catgories comme conditions rendant possible la synthse du divers des intuitions sensibles en gnral,
en tant que cette synthse repose exclusivement sur lentendement et abstraction faite de la manire dont est
donne ce quil y a de divers dans une intuition empirique (CRPu, Bar 161.2.m4-3; 21.1). [Autre
formulation: les catgories considres comme connaissances a priori dobjets dintuition en gnral
170.2.5-6; 26.1.] [13-21]
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
64
2. Les catgories comme conditions rendant possible la connaissance dobjets de lexprience; ou: la valeur a
priori des catgories expliques en tenant compte de la manire dont lintuition empirique est donne dans
la sensibilit (CRPu, Bar 162.1.1-2) [22-26]
2.1 connus de nous dans la forme de leur intuition [22-25]
2.1.1 en une synthse qui repose uniquement sur lentendement et sans distinction entre objets du sens
interne et objets des sens externes [22-23]
2.1.2 en une synthse de lentendement mdiatise par la synthse de limagination et en tenant compte de
la distinction entre objets du sens interne et objets des sens externes mais en la subsumant sous le
concept dobjets des sens en gnral (dans lintitul de 24) [24-25]
2.2 connus de nous dans les lois de leur liaison, ces lois tant penses comme lois de la nature et ainsi
opposes aux lois de notre entendement. [26]
Revue des principaux concepts
Le concept daperception (pure et empirique)
Aperception est un terme mis en usage par Leibniz dans les Nouveaux Essais (1765) tir du
franais sapercevoir de [ to be aware of ] qui avait t utilis par Pierre Coste, le traducteur de
Locke, pour traduire perceive (Leibniz, 1976, p. 553) Il lutilisa dans la Monadologie (crite en
1714, publie en 1720) pour reprocher au cogito cartsien de ne pas prendre en compte les
perceptions inconscientes, ou perceptions qui ne sont pas aperues (1720, 14). Il dfinit la
perception comme Ltat transitoire qui englobe et reprsente une multiplicit dans une unit
(14) ou, dans le texte de 1714 des Principes de la nature et de la grce, comme ltat interne de la
monade reprsentant les choses extrieures (1976, p. 637). Laperception est la conscience ou la
connaissance rflexive de cet tat interne lui-mme, tat qui nest pas donn toutes les mes ou
une me quelconque tout le temps (p. 637) Ce concept a jou un rle central dans la philosophie
thorique de Kant, et constitue lune des raisons pour lesquelles il a pu dcrire la CRPu comme la
vritable apologie de Leibniz contre ses partisans (Sur une dcouverte daprs laquelle toute
nouvelle Critique de la raison pure serait rendue inutile par une plus ancienne, ou: Rponse
Eberhard, 1790. Cit ici dans la traduction en anglais faite par Henry E. Allison: On a Discovery,
1973, p. 160).
Kant a adopt la distinction de Leibniz entre perception et aperception, la transposant
approximativement sur la distinction entre intuition et entendement. Mais il a considrablement
tendu la fonction de laperception, la rendant ainsi plusieurs gards mieux adapte au cogito
auquel elle devait initialement sopposer. Laperception leibnizienne proprement dite figure dans la
CRPu titre de aperception empirique ou de sens intime qui est la conscience de soi-mme
considrer les dterminations de notre tat dans la perception intrieure (CRPu, Bar 647.f.f-
648.1.6) Laperception empirique, comme cest le cas avec la version leibnizienne, est pisodique et
par elle-mme parpille et sans relation avec lidentit du sujet (CRPu, Bar 155.2.5-6). En tant
que telle elle forme une partie mineure de la psychologie, tandis que sa partenaire laperception
transcendantale est lune des pierres angulaires de la philosophie critique, son importance tant
particulirement centrale dans la dduction du caractre universel et ncessaire a priori des
catgories.
(Cay, KD 82.3-83.1; dbut de larticle Apperception; traduit par NL)
Laperception, la manire dont Kant en rend compte, a jou un rle crucial dans le
dveloppement de lidalisme allemand. Laccent sur la conscience de soi a t inflchi vers
lidalisme subjectif de Fichte dans lequel la conscience de soi subjective fondait la drivation des
intuitions, concepts et ides (Science of Knowledge, 1794). Cependant, chez Kant, laperception
servait seulement de base la liaison dans le jugement: elle faisait que les intuitions appartiennent
au sujet et constituait la source des concepts a priori tout en fournissant le fondement de leur liaison
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
65
dans le jugement. Mais elle ne pouvait pas tre elle-mme dtermine davantage; Kant tait
cependant trs soucieux de la distinguer de toute forme dintuition intellectuelle.
(Ibid., 83.2)
Laperception pure: cest la reprsentation je pense, en tant que reprsentation pouvant accompagner toutes
mes reprsentations, en tant que reprsentation du fait que toutes mes reprsentations sont miennes.
Les synthses
synthse de lapprhension (CRPu, Bar 170.3); apprhension: lacte qui consiste admettre [les
phnomnes, en tant que reprsentations] dans la synthse de limagination.
synthse figure; synthse transcendantale de limagination
dterminer le sens intime conformment lunit synthtique de laperception, cest effectuer la synthse
figure.
synthse intellectuelle <Synthesis des Verstandes, intellectuale Synthesis, Verstandesverbindung>; une
synthse reste purement intellectuelle:
quand elle se rapporte uniquement lunit de laperception (CRPu, Bar 165.2.6-8); elle fournit un
principe de la possibilit de la connaissance a priori, mais seulement en tant que celle-ci repose sur
lentendement (il y a aussi des conditions de possibilit telles que la possibilit repose sur la
sensibilit) (CRPu, Bar 165.2.8-10)
la synthse intellectuelle est celle mise en vidence par le principe suprme de lusage de
lentendement (16 et 17), sauf quelle est conue par rapport au divers dune intuition sensible en
gnral.
quand il y a application simplement dune catgorie [einer bloen Kategorie] au divers dune intuition
sensible en gnral (et pas ncessairement la ntre).
quand limagination nest pas utilise pour effectuer la synthse mais que seul lentendement lest.
(CRPu, Bar 166.1.20-23)
Le principe de lunit originairement synthtique de laperception
16 Le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes reprsentations; car autrement il y aurait en moi
quelque chose de reprsent, qui ne pourrait pas tre pens, ce qui revient dire ou que la reprsentation
serait impossible, ou du moins quelle ne serait rien pour moi. (CRPu, Bar 154.1.1-5)
Autre faon de dire cette phrase: Le concept de reprsentation implique relation une conscience, sinon
actuelle, du moins possible. (Ce qui est une proposition analytique.)
Verneaux interprte la premire phrase du 16 comme:
le je pense doit pouvoir accompagner toutes mes reprsentations, sinon elles sont en moi sans
pouvoir jamais constituer une connaissance
(Ver, VK-II 142.3)
La suite de largumentation serait:
pour quelles constituent une connaissance, il faut quelles soient lies
pour quelles puissent tre lies, il faut quelles appartiennent au moi capable de les lier, cest--dire au
moi qui pense
car la conscience sensible, tant passive, en est incapable, de sorte quelle est diversifie selon la
diversit des reprsentations.
Autre formulation du principe de lunit ncessaire de laperception (principe considr par Kant comme
analytique):
Lunit synthtique de la conscience est donc une condition objective de toute connaissance; non
seulement jen ai besoin pour connatre un objet, mais aucune intuition ne peut devenir un objet
pour moi que sous cette condition; autrement, sans cette synthses, le divers ne sunirait pas en une
conscience.
(CRPu, Bar 158.1)
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
66
Lalina suivant (158.2) contient une autre formulation:
[] toutes mes reprsentations, dans quelque intuition que ce soit, sont ncessairement soumises
la seule condition qui me permette de les attribuer, comme reprsentations miennes, un moi
identique, et en les unissant ainsi synthtiquement dans une seule aperception, de les embrasser sous
lexpression gnrale: je pense.
da alle meine Vorstellungen in irgend einer gegebenen Anschauung unter der Bedingung
stehen mssen, unter der ich sie alleinals meine Vorstellungen zu dem identischen Selbst rechnen,
und also,
als in einer Apperzeption synthetisch verbunden, durch den allgemeinen Ausdruck Ich denke
zusammenfassen kann.
et donc de les concevoir, en tant quunies synthtiquement dans une aperception, sous
lexpression gnrale Je pense.
Verneaux risque la formulation : mes reprsentations sont miennes. Je dirais: pour tre mes reprsen-
tations il est ncessaire et suffisant que des reprsentations soient unies par et dans le je pense.
ou encore: des reprsentations sont les miennes si et seulement si existe un je pense en tant que reprsentation
originaire de lunit synthtique de ces reprsentations dans une conscience.
4.2.2.2 Reconstitution de la dmarche et des thses
Jidentifie ci-dessous les procds discursifs et explicite les thses, pour les sections 13 24. Ces
explications prparent la construction du plan logique.
K a n t m o n t r e qu e l e s ca t g o r i e s de l e n t e n d e m e n t po s e n t un pr o b l m e s p c i a l de
d d u c t i o n t r a n s c e n d a n t a l e et po u r q u o i i l fa u t do n n e r ce t t e d d u c t i o n . Le s
c o n t r a s t e s t a b l i s fo n t re s s o r t i r ce qu e ce t t e d d u c t i o n do i t av o i r de s p c i f i q u e .
13.1 Les dfinitions. [145.1-146.1]
Dduction de droit, dduction de fait.
Dduction empirique, dduction transcendantale; cette dernire est une dduction de droit et sapplique
des concepts a priori . Elle consiste expliquer comment des concepts a priori peuvent se
rapporter des objets (CRPu, Bar 146.1.2-3).
13.2 [146.2-147.1] Nous avons dj suite lEsthtique transcendantale et au premier chapitre de
lAnalytique transcendantale deux espces bien distinctes de concepts qui se rapportent entirement a
priori des objets; ce sont les concepts de lespace et du temps, comme formes de la sensibilit, et les
catgories, comme formes de lentendement. (CRPu, Bar 148.2.2-5)
Pour ces concepts, il ne peut y avoir quune dduction transcendantale, par opposition une dduction
empirique (146.1.5-6; 146.2.6), une drivation physiologique (146.3.m3-2) qui expliquerait la
possession dune connaissance pure (147.1.1-2) plutt que sa lgitimit, sa valeur objective, etc., caractres
qui relvent de questions de droit.
13.3 [147.2-148.1] Une telle dduction transcendantale est ncessaire; non pas absolument, puisque certaines
sciences sen passent (la gomtrie par exemple), mais du moins dans le cas des concepts purs de
lentendement.
13.4 [148.2] Nous avons accompli dj dans lEsthtique transcendantale cette dduction pour les
concepts despace et de temps. [R a p p e l : ] La synthse qui sy opre a une valeur objective car ces
concepts se rapportent ncessairement des objets et rendent possible une connaissance synthtique de ces
objets indpendamment de toute exprience (CRPu, Bar 148.2.3-5)
13.5 [148.3-149.1] Pour ce qui est des catgories, leur valeur objective nest pas encore acquise et elles posent
une difficult propre elles car
( la diffrence des concepts despace et de temps) elles ne nous reprsentent aucunement les
conditions sous lesquelles des objets sont donns dans lintuition;
13.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
67
consquemment des objets peuvent sans doute <allerdings> nous apparatre, sans quils aient
ncessairement besoin de se rapporter des fonctions de lentendement et sans que celui-ci par
consquent en contienne les conditions a priori. (148.3.1-7)
Bien insister sur le fait quil sagit dune hypothse que la dduction transcendantale entend
rfuter.
En bref, la difficult est celle de savoir comment des conditions subjectives de la pense peuvent
avoir une valeur objective. (CRPu, Bar 148.38-9)
[ 1 4 9 . 2 ] K a n t ex h o r t e l e l e c t e u r ne pa s m m e p e n s e r s a f f r a n c h i r de l a pe i n e
q u e co t e n t ce s re c h e r c h e s et m o n t r e l e u r i n l u c t a b i l i t en pr e n a n t po u r
e x e m p l e l e co n c e p t de ca u s e .
K a n t n o n c e l a co n d i t i o n l a q u e l l e l a d d u c t i o n t r a n s c e n d a n t a l e r u s s i r a ,
a u t r e m e n t di t : l e pr i n c i p e s u r l e q u e l el l e de v r a s e r g l e r .
14.1 Thse: la valeur objective des catgories, comme concepts a priori , reposera sur ceci, savoir que seules
elles rendent possible lexprience (quant la forme de la pense). (CRPu, Bar 150.1.m3-151.1.1)
Maj1 Il y a donc des concepts dobjets en gnral qui servent, comme condition a priori, de fondement
toute connaissance exprimentale. (CRPu, Bar 150.1.m5-3)
Maj1.1 Il sagit maintenant de savoir sil ne faut pas admettre aussi antrieurement des concepts a priori
comme condition qui seules permettent, non pas de percevoir intuitivement, mais de penser en
gnral quelque chose comme objet
Maj Cest la relation la reprsentation rend lobjet possible quil convient dtudier ici, et non la
relation lobjet rend la reprsentation possible.
Maj Il ny a pour une reprsentation synthtique et ses objets que deux manires possibles de
concider, de saccorder dune faon ncessaire []. Ou bien cest lobjet qui rend possible
la reprsentation, ou bien cest la reprsentation qui rend lobjet possible. (CRPu, Bar
150.1.1-6)
Min Or, le premier cas ne sapplique pas aux reprsentations a priori et ne concerne donc pas la
difficult que nous avons souleve propos des catgories, lesquelles sont des
reprsentations a priori.
Puisque dans ce cas le rapport entre la reprsentation et ses objets est strictement
empirique. Tel est le cas des phnomnes, relativement ceux de leurs lments
qui appartiennent la sensation.
Min Or, il y a deux conditions qui seules rendent possible la connaissance dun objet: lintuition et le
concept.
Min Or, pour ce qui est de lintuition, nous avons dj montr plus haut [entendons: dans
lEsthtique transcendantale] quelle sert en ralit a priori dans lesprit de fondement aux
objets, quant leur forme. (CRPu, Bar 150.1.21-23)
[En dautres mots, la question de la dduction transcendantale a t rgle pour ce qui est de
lintuition, en tant que reprsentation qui rend possible lapparition des phnomnes, le fait
quils soient donns.]
Maj1.2 sil existait des concepts a priori ayant le statut de conditions qui seules permettent [] de
penser en gnral quelque chose comme objet [] alors toute connaissance empirique des objets
serait ncessairement conforme ces concepts, puisque sans eux il ny aurait rien de possible comme
objet dexprience. (CRPu, Bar 150.1.m14-8)
14.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
68
Ici deux problmes dexgse:
1) trouver linterprtation qui vite de prsenter cette proposition comme une tautologie;
2) trouver le bon sens de la relation logique dimplication.
Si un objet dexprience (donc dtermin) est donn, alors il existe des conditions permettant de
penser en gnral quelque chose comme objet. Il suffit que des objets dexprience soient penss
sous quelque concept pour que lon puisse affirmer lexistence de concepts permettant de penser
quelque chose comme objet en gnral. Si A est une condition ncessaire de B, la conditionnelle
qui exprime cette relation est B implique A. Ici, cest B qui est affirm par la mineure qui suit.
Min1.3 Or toute exprience contient, outre lintuition des sens, par laquelle quelque chose est donn, un
concept dun objet donn dans lintuition ou nous apparaissant. (CRPu, Bar 150.1.m8-6)
Il sagit l du pivot du raisonnement. Kant nonce cette proposition comme si elle exprimait un fait
vident, dobservation courante
Min2 Les catgories sont de tels concepts: Elles se rapportent [] ncessairement et a priori, des objets
dexprience, puisque ce nest que par elles en gnral quun objet <irgend ein Gegenstand> de
lexprience peut tre pens. (CRPu, Bar 151.1.1-f)
Problme dexgse: Pourquoi la thse qui domine 14 ne constitue-t-elle pas la dduction
transcendantale. Parce que Maj1 est programmatique, Maj1.2 est hypothtique et Min1.3 une
observation de fait (qui naffirme pas encore la fonction transcendantale des concepts viss). De
plus, Min2 nest quune dfinition nominale.
14 sert donner une sorte de dfinition de ce que veut dire avoir une valeur objective? Et si
la signification de avoir une valeur objective se trouve prcise en 14, est-ce que les
formulations suivantes squivalent toutes: tre la condition
qui seule permet de penser en gnral quelque chose comme objet
(CRPu, Bar 150.1.m12-11)
qui seule permet que quelque chose soit possible comme objet dexprience
qui seule permet la possibilit des expriences (soit de lintuition qui sy trouve, soit de la
pense) (CRPu, Bar 151..2.4-6)
qui sert de fondement toute connaissance exprimentale <Erfahrungserkenntnis>
(CRPu, Bar 150.1.m4-3)
qui fournit le fondement objectif de la possibilit de lexprience (CRPu, Bar 151.2.6-7)
?
14.2 Consquence pratique tire de la thse: La dduction transcendantale de tous les concepts a priori a donc
un principe sur lequel doit se rgler toute notre recherche, cest celui-ci: il faut que lon reconnaisse dans ces
concepts autant de conditions a priori de la possibilit des expriences (soit de lintuition qui sy trouve, soit
de la pense). (CRPu, Bar 151.2.1-6)
Paraphrase: il nous faudra, pour raliser la dduction transcendantale, trouver quelque chose qui
nous permette de reconnatre
l a fi n de l a s e c t i o n 1 4 , Ka n t an n o n c e l a d d u c t i o n t r a n s c e n d a n t a l e .
Nous sommes maintenant en mesure de rechercher si lon ne peut pas conduire la raison entre ces
deux cueils [lextravagance de Locke, le scepticisme de Hume] et lui fixer des limites dtermines,
tout en laissant ouvert le champ de sa lgitime activit. (CRPu, Bar 152.2.4f)
(Dans la premire dition, il identifie les 3 sources primitives (capacits ou facults de lme) qui
contiennent les conditions de la possibilit de toute exprience [] : [] le sens, limagination et
laperception (CRPu, Bar 151.note a) et annonce les 3 synthses correspondantes.)
D b u t de l a d d u c t i o n t r a n s c e n d a n t a l e . D b u t de l a t h o r i e de l a s y n t h s e . Ka n t
p a r t de l a no t i o n de l i a i s o n et ef f e c t u e un e r g r e s s i o n ex p l i c a t i v e , c. - - d . un e
e x p l i c a t i o n de l a l i a i s o n pa r un e co n d i t i o n de s a po s s i b i l i t .
15.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
69
La liaison (dont on postule la ncessit et la ralit)
est un acte (appel synthse} de lentendement, de la facult de reprsentation, et ne peut jamais nous
venir des sens.
est la reprsentation de lunit synthtique de la diversit.
est la seule reprsentation qui ne puisse nous tre fournie par des objets.
Thse: la reprsentation de cette unit
ne peut rsulter de la liaison
rend possible le concept de la liaison; prcde a priori tous les concepts de liaison. On peut penser
ici aux diverses synthses dont Kant introduira le concept: synthse intellectuelle, figure, de
limagination, de lapprhension
O faudra-t-il aller pour trouver cette unit? Dans ce qui contient le principe de lunit de diffrents concepts
au sein des jugements, principe mme de la possibilit de lentendement, mme au point de vue logique (CRPu,
Bar 154.1) Cette phrase sert de transition et annonce la dfinition de lunit qui sera donne en 16. Remarquons
lemploi que fait Kant de la relation de condition de possibilit; il lutilise comme rgle dinfrence pour complter
une explication.
Commentaires sur 15.
Kant dfinit ngativement le principe de lunit de la diversit dans la synthse. Cest 16 qui va donner
la dfinition positive et qui nous placera demble au niveau le plus lev de la synthse (ou des
synthses).
Il semble clairant de faire intervenir lide de la reproductibilit des phnomnes pour faire comprendre
lide de lunit synthtique de la diversit.
la thorie de la synthse commence en attribuant la synthse lentendement, et nintroduit pas demble
la squence gradue des synthses (synopsis, apprhension, synthse figure, unit de la synthse)
S u i t e de l a t h o r i e de l a s y n t h s e . Ka n t d f i n i t l e co n c e p t ce n t r a l de l a d d u c -
t i o n t r a n s c e n d a n t a l e : l u n i t or i g i n a i r e m e n t s y n t h t i q u e de l a p e r c e p t i o n UO S A .
16.1 [CRPu, Bar 154.2-155.1] Position du fait de laperception comme condition ncessaire de la pense de mes
reprsentations, soit sous lappellation daperception pure, ou originaire, soit sous lappellation
daperception transcendantale.
16.2 & 16.3 Consquence. Lide que laperception pure doit accompagner toutes mes reprsentations me fournit
une solution la question: comment mest-il possible de me reprsenter lidentit de la conscience (CRPu,
Bar 155.2.12-13) compte tenu de la diversit des reprsentations donnes dans lintuition et du caractre
forcment parpill de la conscience empirique de soi? Comment puis-je me reprsenter lidentit du sujet
(155.2.6)? Do me vient ma conscience dun moi identique (CRPu, Bar 156.2.m10)?
le fait de pouvoir lier en une conscience une
diversit de reprsentations
rend possible que je me reprsente lidentit de la
conscience dans ces reprsentations mmes
[Reformulation:] Le fait quexiste telle chose
quune unit originairement synthtique de
laperception accompagnant toutes mes
reprsentations (=thse dominant 16.1)
rend possible [Reformulation:] que je me reprsente que la
conscience qui se retrouve dans ces
reprsentations, dune fois lautre, est la
mme conscience
16.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
70
quelque unit synthtique [de la
conscience]
rend possible
doit tre suppose si
lon veut
comprendre
lunit analytique de laperception (le fait
que ce soit le mme je pense qui se retrouve
dune occurrence une autre de reprsenta-
tions donnes dans lintuition, de sorte que
je puisse produire le concept de ce moi, la
faon dont je produis analytiquement le
concept de rouge en labstrayant des
choses rouges)
Explication de la diffrence entre unit analytique et unit synthtique. Pour comprendre lunit analytique,
on se reprsente la situation classique (en logique) dans laquelle plusieurs individus logiques ont un trait commun,
par exemple le trait rouge, que lon conoit au moyen du concept commun rouge, lissue dun processus
dabstraction. Labstraction prsuppose que je peux reconnatre par analyse la prsence de ce trait en chaque
individu et que je peux me reprsenter ce trait comme liable. En subsumant les individus rouges sous la classe des x
rouges junifie ces reprsentations sous la reprsentation du rouge; le jugement: Les x sont rouges exprime cela,
entre autres; les reprsentations ramenes au concept de rougeur possdent une unit analytique. Pour comprendre
lunit synthtique, on se reprsente le rouge, le vgtal, le comestible, la taille, etc., en somme les proprits que
lon regroupe dans le concept dun objet qui les possde. Dans la reprsentation dune tomate mure, junifie
synthtiquement plusieurs reprsentations de proprits; dans la reprsentation du rouge, junifie analytiquement
tous les objets qui ont, entre autres, la proprit rouge.
M X N X Y Z A B X
x
unit
analytique
unit
synthtique
\
/
`
|
La figure ci-dessus permet de voir la fois la diffrence entre les deux actes dunification et en quel sens
lunit analytique prsuppose, comme le dit Kant, lunit synthtique.
D e 1 7 2 5 , i l s a g i t po u r Ka n t de pa r t i r du pr i n c i p e s u p r m e (l a co n d i t i o n
U O S A ) et de pr o u v e r l a va l e u r ob j e c t i v e de s ca t g o r i e s .
Formulation du principe: tous les lments divers de lintuition [sont] soumis aux
conditions de lunit originairement synthtique de laperception. (CRPu, Bar 157.1.3-5)
Lunit originairement synthtique de laperception est ce qui seul constitue la valeur objective des
reprsentations (CRPu, Bar 157.2.m5-3).
Lunit originairement synthtique de laperception est une condition objective de toute connaissance. (CRPu,
Bar 158.1.4-6)
D f i n i t i o n de l u n i t ob j e c t i v e , no t i o n qu i s e r a ut i l i s e da n s l a m i n e u r e
v e n i r (e n 1 9 ) .
17.
18.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
71
Seule lunit transcendantale de la conscience a une valeur objective; lautre unit de la conscience,
lempirique, na de valeur que subjective.
G r c e un e d f i n i t i o n ap p r o p r i e du j u g e m e n t , Ka n t fa i t l e l i e n en t r e l u n i t
d e s j u g e m e n t s t e l l e qu e t h o r i s e en l o g i q u e g n r a l e pa r l a no t i o n de fo n c t i o n
l o g i q u e ( 9 ) et l u n i t ob j e c t i v e de l a p e r c e p t i o n pu r e .
Ce lien sera utilis dans les trois mineures de 20.
Le jugement nest autre chose quune manire de ramener des connaissances donnes lunit objective de
laperception (CRPu, Bar 160.2.6-8), cest--dire lunit originairement synthtique de laperception.
Autre formulation: les reprsentations, dans un jugement, se rapportent les unes aux autres dans la synthse
des intuitions grce lunit ncessaire de laperception (CRPu, Bar 160.2.17-19)
K a n t fa i t l e l i e n en t r e l u n i t or i g i n a i r e m e n t s y n t h t i q u e de l a p e r c e p t i o n et l e s
c a t g o r i e s et t a b l i t ai n s i l a pr o p o s i t i o n do n t Ka n t di r a en 2 1 qu e l l e co n s t i t u e
l e po i n t de d p a r t d u n e d d u c t i o n de s co n c e p t s pu r s de l e n t e n d e m e n t
( 1 6 1 . 2 . 9 - 1 0 )
Cest par la catgorie que le divers prsent dans une intuition est ramen lunit originairement synthtique
de laperception.
K a n t r s u m e l e ch e m i n pa r c o u r u , an n o n c e l a fo n c t i o n de s 2 2 - 2 5 et do n n e un e
p r c i s i o n de t y p e m i s e en ga r d e , en 16 2 . 2 .
21.1La premire phrase est compose de deux propositions:
la premire est la premire majeure du raisonnement de 20.
la deuxime ( savoir: cela arrive par le moyen des catgories) est la conclusion de 20, une
vocation du rsultat de 20.
Toute la premire phrase de 21 est donc une sorte de rsum-synthse de 20.
21.1 La deuxime phrase. Thse: [La catgorie] montre donc que la conscience empirique dune diversit
donne dans une intuition est soumise une conscience pure a priori, de mme que lintuition empirique est
soumise une intuition sensible pure qui a galement lieu a priori. (CRPu, Bar 161.2.5-8)
intuition sensible pure conscience pure a priori
intuition empirique conscience empirique
La dernire phrase de 21.1 annonce la poursuite de la dduction au 26 et le rle des sections suivantes 22-25
comme complments de ce qui vient dtre affirm des catgories; il faut montrer, dit Kant, avant de passer la
section 26, que la catgorie a une valeur a priori relativement tous les objets de nos sens (CRPu, Bar
162.1.2f)
21.2 [162.2] Rappel de la condition dantriorit et dindpendance du divers donn dans lintuition lenten-
dement ne jouit pas dune capacit dintuition intellectuelle. Lentendement ne fait que lier.
19.
20.
21.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
72
L e s s e c t i o n s 2 2 - 2 5 fo r m e n t ce t t e pa r t i e de l a d d u c t i o n t r a n s c e n d a n t a l e qu i ,
s e l o n 17 0 . 2 . 1 0 ( 2 6 . 1 ) , ex p l i q u e co m m e n t l e s ob j e t s de no s s e n s pe u v e n t no u s
t r e co n n u s a pr i o r i pa r l e s ca t g o r i e s d a n s l a fo r m e de l e u r i n t u i t i o n .
Les formes de lintuition entre lesquelles il sagit de distinguer sont au nombre de deux: lintuition pure et
lintuition empirique. La pertinence de la distinction tient lintrt de distinguer entre les objets mathmatiques et
les objets capables de fournir des sensations.
Les premiers sont des dterminations de lintuition pure,
les seconds, des dterminations des intuitions empiriques.
Kant utilise le mot chose en un sens plus concret que le mot objet.
Thse: Les catgories nont dusage relativement la connaissance des choses quautant que ces choses sont
regardes comme des objets dexprience possible. (CRPu, Bar 163.1.4f)
Maj Elles servent seulement la connaissance empirique
Les choses ne sont donnes dans l espace et dans le temps que comme perceptions, cest--dire
au moyen dune reprsentation empirique. [Pour rendre cette proposition plausible, Kant montre
quelle est vraie mme sil existe des connaissances mathmatiques, car celles-ci ne concernent
que la forme des objets. CRPu, Bar 163.1.14-15] Cependant le statut des concepts
mathmatiques nest pas lucid ici: Kant laisse en suspens la question de savoir sil existe des
choses qui ne peuvent tre reprsentes que suivant la forme de cette intuition sensible pure
(CRPu, Bar 163.1.m19-18)
Min Or cest cette connaissance que lon nomme exprience. CRPu, Bar 163.1.m5-4. [Noter:
lexprience, en tant que connaissance, est donc un produit de lentendement et non de la sensibilit.]
C o m m e n t a i r e s u r l a di f f r e n c e en t r e us a g e (d e l a ca t g o r i e ) l i m i t au x ob j e t s
d e l i n t u i t i o n en g n r a l et us a g e l i m i t ce u x d e n o t r e i n t u i t i o n .
Cette diffrence ne nous sert de rien. [Kant fait allusion la pense dun tre qui ne pourrait pas tre donn
mon intuition.]
I n t r o d u c t i o n de l a di f f r e n c e en t r e UO S A co m m e s y n t h s e pu r e m e n t i n t e l l e c -
t u e l l e et s y n t h s e fi g u r e (o u s y n t h s e t r a n s c e n d a n t a l e de l i m a g i n a t i o n ) .
24.1 Diffrence entre sens intime et UOSA
Amlioration de traduction 165.2.12-f, 24.1 : Mais comme en nous lintuition sensible a priori a pour
fondement une certaine forme qui repose sur la rceptivit de notre capacit reprsentative (la sensibilit),
lentendement peut alors, en tant que spontanit, en agissant sur le divers des reprsentations donnes,
dterminer le sens intime conformment lunit synthtique de laperception et ainsi concevoir lunit
synthtique de laperception du divers de lintuition sensible a priori comme la condition laquelle tous les
objets de notre intuition (lintuition humaine) sont ncessairement soumis; en effet, cest par l, par cette
condition, que les catgories, en tant que simples formes de pense, reoivent une ralit objective, cest--
dire une application aux objets qui peuvent tre donns dans notre intuition, mais donns seulement titre de
phnomnes; car nous ne sommes capables dintuition a priori que par rapport aux phnomnes.
24.2 Thse sur la connaissance du moi comme cas particulier:
je ne me connais que tel que je maperois (CRPu, Bar 168.1.15)
nous ne connaissons notre propre sujet que comme phnomne (CRPu, Bar 168.f.f-169.1.f)
22.
23.
24.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
73
le sens intime ne nous prsente nous-mmes la conscience que comme nous apparaissons et non
comme nous sommes en nous-mmes, parce que notre seule intuition de nous-mmes nest autre que
celle de la manire dont nous sommes intrieurement affects. (CRPu, Bar 166.2.3-8)
24.3 Le sens intime est autre chose que lunit originairement synthtique de laperception. [167.1.13f]
La dmarche prcdente de la dduction transcendantale est voque rtrospectivement par Kant dans un
passage de la dialectique: Il nous faut suivre ici le chemin que nous avons pris plus haut dans la dduction
des catgories, cest--dire examiner la forme logique de la connaissance rationnelle, et voir si par hasard la
raison nest point par l source de concepts <ob nicht etwa die Vernunft dadurch auch ein Quell von
Begriffen werde> qui nous font regarder des objets en eux-mmes comme synthtiquement dtermins a
priori par rapport telle ou telle fonction de la raison. (CRPu, Bar 326.2).
N o u s ve n o n s de vo i r co m m e n t , pa r l e s ca t g o r i e s , l e s ob j e t s de s s e n s pe u v e n t
n o u s t r e co n n u s a pr i o r i d a n s l a fo r m e d e l e u r i n t u i t i o n et i l no u s re s t e
v o i r co m m e n t i l s no u s s o n t au s s i co n n u s a pr i o r i d a n s l e s l o i s d e l e u r
l i a i s o n . (1 7 0 . 2 . 7 - 1 1 )
Les thses seront dtailles dans le plan logique qui suit.
4.2.2.3 Plan logique de la dduction transcendantale (16-26, 2e dition)
Abrviations: UOSA : unit originairement synthtique de laperception (aussi: unit synthtique
originaire de laperception).
DV : le divers de lintuition sensible.
CPE : les concepts purs de lentendement.
DT : dduction transcendantale.
P L A N L O G I Q U E
A S S O R T I D E R E M A R Q U E S S U R L A D M A R C H E (les procds discursifs)
1. Ce quil y a de divers dans une intuition est donc ncessairement soumis
des catgories (CRPu, Bar 161.1.3f) 20
Toutes les intuitions sensibles sont soumises aux catgories, comme aux
seules conditions sous lesquelles DV puisse en tre ramen lunit de
conscience. (intitul de 20. CRPu, Bar 161)
Kant rappelle que, dans la
dmarche qui en arrive cette
formulation, il na pas encore
tenu compte de la manire dont
lintuition empirique est donne
dans la sensibilit (162.1.1-2)
Cette manire, cest la
sensation; il reste introduire
les sens, lexprience avant
darriver la thse qui concerne
lusage exprimental des
CPE.
Tout divers est dtermin par rapport lune des fonctions logiques
du jugement et cest par elle quil est ramen lUOSA 20
26.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
74
Il faut que tous les lments de DV soient soumis aux conditions
de UOAS
17
Tel est le PRINCIPE SUPRME de
la possibilit de toute intuition,
par rapport lentendement;
CRPu, Bar 157.1.2-5.
lunit de lintuition nest possible que par UOSA
16
Postulat initial.
Lacte de lentendement par lequel DV est ramen une
aperception en gnral est la fonction logique des jugements
19
Or les catgories ne sont pas autre chose que ces mmes fonctions
[logiques], en tant que la diversit dune intuition donne est
dtermine par rapport ces fonctions. (CRPu, Bar 161.1.m6-3;
accentuation due NL) 10
2. La catgorie na dautre usage dans la connaissance des choses que de
sappliquer des objets dexprience. (intitul de 22)
Les catgories nont donc dusage relativement la connaissance des
choses, quautant que ces choses sont regardes comme des objets
dexprience possible. (conclusion de 22 dans le texte; 163.1.4f)
22
Cette thse remplace DV par une
conceptualit plus spcifique.
Elle introduit la relation des
catgories aux objets, et par la
notion dobjet des sens, intro-
duit la notion dexprience, puis
celle dexprience possible.
Cest la premire thse qui concer-
ne le rapport des catgories aux
objets de lexprience.
Les catgories ne nous fournissent donc de connaissances des
choses au moyen de lintuition, quautant quelles sont applicables
lintuition empirique, cest--dire quelles servent seulement la
possibilit de la connaissance empirique. (163.1.m9-5)
Or cest cette connaissance que lon nomme exprience.
(163.1.m5-4)
[Le 23 nest quun commentaire de 22.] La thse 2 dtermine les
limites de lusage des concepts purs de lentendement (163.2.1-2).
La thse prcdente a une formula-
tion purement ngative, ou li-
mitative; et le 23 ne fait rien
dautre que souligner ce fait.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
75
3. Lentendement peut [], en tant que spontanit, dterminer le sens
intime, conformment lunit synthtique de laperception, par les
lments divers de reprsentations donnes, et penser ainsi lunit
synthtique de laperception des lments divers de lintuition sensible a
priori comme la condition laquelle sont ncessairement soumis tous les
objets de notre intuition (de lintuition humaine). Cest ainsi que les
catgories, ces simples formes de la pense, reoivent une ralit
objective, et sappliquent des objets qui peuvent nous tre donns dans
lintuition, mais seulement titre de phnomnes (CRPu, Bar 165.2.14-
f).
24
Il sagit des objets des sens en gnral (cf. lintitul), y compris ceux du
sens intime.
Paraphrase: la synthse, tout en continuant dtre loeuvre de
lentendement conformment UOSA, commence ds lintervention de
limagination productrice dans le processus, en tant que facult
dterminante (et pas seulement dterminable).
Les verbes au pass contenus dans
la 2
e
phrase du 24 semblent
faire rfrence ce que nous
avons fait jusquici dans la DT:
nous navons considr que la
synthse intellectuelle contenue
dans les catgories.
Voici la premire formulation posi-
tive (et non seulement limitative)
de la valeur objective des
catgories eu gard leur usage
exprimental; la formulation li-
mitative du tout dernier membre
de phrase (mais seulement
titre de phnomnes) rappelle
la thse 22).
3.1 Je ne me connais nullement comme je suis, mais seulement comme
je mapparais moi-mme. La conscience de soi-mme est donc bien
loin dtre une connaissance de soi-mme, malgr toutes / les
catgories qui constituent la pense dun objet en gnral, en reliant
le divers en une aperception. (CRPu, Bar 170.2.m4-171.1.2)
dernire partie de 24, plus 25
Cette thse rsulte dune
application de la thse 3 au cas
particulier de la reprsentation
de moi que jai dans le sens
intime, reprsentation qui ne
doit pas tre confondue avec la
reprsentation je pense
(=UOSA).
4. Les catgories rendent possible notre connaissance a priori des objets des
sens, non seulement dans la forme de leur intuition (comme il a t
montr dans les thses 2 et 3 ci-dessus) mais encore dans les lois de leur
liaison (CRPu, Bar 170.2.m7.5).
26
Cette thse introduit pour la
premire fois dans DT la notion
de la nature. Il sagit ici
spcifiquement des intuitions
empiriques et de la synthse dj
contenue dans les perceptions.
Autre formulation: toutes les perceptions possibles, par consquent aussi tout ce qui peut arriver la conscience
empirique, cest--dire tous les phnomnes de la nature doivent tre, quant leur liaison, soumis aux catgories. Et
la nature (considre simplement comme nature en gnral, ou en tant que natura formaliter spectata) dpend de ces
catgories comme du fondement originaire de sa conformit ncessaire des lois. (173.2.25-32)
4.1 Toute synthse par laquelle la perception mme est possible est
soumise aux catgories (CRPu, Bar 171.2.m7-5)
Dans le premier exemple (celui de la maison), la synthse de
lapprhension, cest--dire la perception, [] doit [] tre
entirement conforme [ la catgorie de la quantit, comme catgorie
de la synthse de lhomogne dans une intuition en gnral]. (172.1)
Dans le second exemple, celui de la conglation de leau,
lapprhension dans un vnement de ce genre, et par consquent cet
vnement lui-mme, relativement la possibilit de la perception, est
soumis au concept du rapport des effets et des causes. (172.2)
Cette prmisse est donne comme
une nouvelle faon de driver la
thse dj pose propos des
objets des sens en gnral; ce
que cette nouvelle faon a de
particulier, cest quelle fait
commencer la synthse avec la
perception.
Cette prmisse ne permet pas
encore de driver la thse 4.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
76
4.2 Les phnomnes ne sont soumis aucune autre loi de liaison qu
celle que prescrit la facult qui relie (173.2.16-17)
4.3 Or la facult qui relie les lments divers de lintuition sensible est
limagination (173.2.18-19)
La thse 4.3 a t pose en 24
(thse 3)
4.4 Or, puisque toute perception possible dpend de la synthse de
lapprhension
=thse 4.1
4.5 la synthse de lapprhension dpend des catgories
Commentaire restrictif (prcaution): Des lois particulires, concernant des
phnomnes donns empiriquement, sont sans doute soumises ces
catgories, mais elles ne peuvent pas en tre tires compltement.
(173.2.m5-3)
5. [Proposition-rsum.] Les catgories contiennent, du ct de
lentendement, les principes de la possibilit de toute exprience en
gnral. (CRPu, Bar 174.3.m4-2)
6. [Proposition-transition.] Mais comment [les catgories] rendent-elles
possible lexprience, et quels principes de la possibilit de lexprience
fournissent-elles dans leur application des phnomnes?
Noter larticulation entre concepts
et principes; cest elle qui articu-
le lanalytique des principes
lanalytique des concepts.
En introduisant lide dune action de lentendement sur le sens intime cest cela qui caractrise la
synthse figure, ou synthse de limagination , Kant peut gnraliser la thse de la valeur objective des
catgories aux objets des sens en gnral jusquau point de pouvoir tenir compte aussi bien du sens intime (ou
interne) que des sens externes. Le bnfice obtenu est que je peux maintenant compter moi-mme parmi les objets
dont les catgories rendent la connaissance possible, puisque cest dans le sens intime et selon les formes du temps
que se trouve la diversit des intuitions que je suis susceptible davoir de moi-mme, intuitions par lesquelles seules
je peux obtenir une connaissance de moi-mme.
4.2.2.4 Expos de la premire version
Kant annonait lui-mme dans la Prface la premire dition que son texte sur la dduction transcendantale
comportait deux parties. Il employait lui-mme pour les qualifier lopposition conceptuelle entre subjectif et
objectif:
La dduction subjective La dduction objective
[Cette partie] se propose de considrer lentende-
ment par lui-mme au point de vue de sa
possibilit et des facults de connatre sur
lesquelles il repose par consquent, au point de
vue subjectif.
[Cette partie] se rapporte aux objets de ,
lentendement pur, et il faut quelle montre et fasse
comprendre la valeur objective de ses concepts a
priori; aussi tient-elle essentiellement mon but.
(CRPu, Bar 33.3.9-12)
Cette partie examine comment la facult mme
de penser est possible et bien que cet examen ait
une grande importance relativement mon but
principal, il ny appartient pourtant pas
essentiellement (CRPu, Bar 33.3.6f)
La question capitale, traite par la premire
partie, est de savoir ce que lentendement et la
raison, indpendamment de toute exprience,
peuvent connatre (33.3.m4-2)
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
77
cette dernire question est en quelque sorte la
recherche de la cause dun effet donn, et []
sous ce rapport, elle contient quelque chose de
semblable une hypothse (bien quen ralit il en
soit tout autrement, comme je le montrerai dans
une autre occasion) (Ibid., 34.1-5). Cela pourrait
inciter le lecteur penser que je me permets, dans
cette partie, des opinions (33.1.6) seulement.
dans le cas o ma dduction subjective
naurait pas produit en [le lecteur] lentire
conviction que jen attends, la dduction objective,
qui est surtout le but de mes recherches, nen
aurait pas moins toute sa force. (CRPu, Bar
34.1.m5-2)
Commentaire.
Il sagit dune dduction subjective et
psychologique; elle cherche montrer comment
les facults de la connaissance sorganisent pour
constituer une totalit unifie. (Phi, OK I
149.1.8f)
Il sagit dune dduction objective et
transcendantale; elle cherche montrer comment
a priori catgories et phnomnes peuvent se lier
dans la dtermination du donn fourni par la
sensibilit. (Phi, OK I 149.1.8f)
Le problme, pos de manire psychologique, est
donc initialement: comment la synthse est-elle
possible? (Phi, OK I 152.1.1-3)
Kant pose son problme en une perspective
psychologique tout dabord. De l le dbut du 14
de la Critique de la raison pure []. De l aussi la
question: Comment des conditions subjectives de
la pense peuvent-elles avoir une valeur objective,
cest--dire fournir les conditions de la possibilit
de toute connaissance des objets?(Phi, OK I
154.2.1-9)
La dduction objective, quon la considre sous
sa forme de 1781 ou de 1787, est domine par
deux problmes: premirement rfuter les thses
de Hume secondement fixer la fonction exacte
de limagination. Ce second problme lui-mme
trouve son prolongement dans le schmatisme
transcendantal. (Phi, OK I 164.2.1-6)
Concernant la fonction de la dduction subjective et le passage la dduction objective.
[] Prise la lettre cette question [comment des conditions subjectives de la pense] nous
dtourne du criticisme en nous renvoyant la problmatique dogmatique du sujet et de lobjet,
quil dpasse en substituant ce dualisme celui du phnomne et du noumne et en montrant que la
connaissance comme mthode est premire par rapport lobjet et au sujet quelle permet seule de
poser. Nanmoins cette question exprime lapproche psychologique ncessaire du problme de la
dduction [] et elle doit comme telle tre limite, ne pouvant jamais signifier quil sagit de
montrer comment lobjet se ramne au sujet mais seulement que la liaison effective du sujet et de
lobjet comme factum renvoie au principe suprme de la mthode, qui permet de les poser lun
et lautre. Le but fondamental de la dduction subjective est donc le passage dfinitif de la priori
mtaphysique la priori transcendantal , par le dvoilement du principe mthodique qui rend
possible comme drive et non originaire la dualit du sujet et de lobjet. Cest pourquoi lon peut
dire que la dduction subjective est lAufhebung, le dpassement de la subjectivit.
(Phi, OK I 154.2.m5-155.1.1-20)
Les trois premires sections de la dduction transcendantale de 1781 sont respectivement:
1. De la synthse de lapprhension dans lintuition. (CRPu, Bar 643)
2. De la synthse de la reproduction dans limagination. (CRPu, Bar 644)
3. De la synthse de la rcognition dans le concept. (CRPu, Bar 645)
Et cest au milieu de cette troisime section que Kant demande Quest-ce donc quon entend quand on parle dun
objet correspondant la connaissance et par consquent distinct de cette connaissance? (CRPu, Bar 646.3.7-9)
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
78
Cest ce tournant que Philonenko situe le passage de la dduction subjective la dduction objective. Kant fournit
la rponse l, immdiatement aprs la question pose:
Il est ais de voir que cet objet ne doit tre conu que comme quelque chose en gnral = X,
puisquen dehors de notre connaissance nous navons rien que nous puissions y opposer comme y
correspondant.
(CRPu, Bar 646.3.9-f)
Cette rponse est la premire thse de la dduction objective, laquelle sera poursuivie et acheve dans le quatrime
paragraphe 4. Explication prliminaire de la possibilit des catgories comme connaissances a priori.. (CRPu, Bar
649) Le contenu de ces quatre paragraphes sera reprsent runi et li plutt que sparment et isolment
(CRPu, Bar 652.3.1-3) dans la troisime section de la dduction, section intitule Du rapport de lentendement
des objets en gnral et la possibilit de les connatre a priori. (Ibid., 652)
Voici comment Philonenko interprte la transition entre le moment subjectif et le moment objectif de la
dduction:
Mais tandis que laperception transcendantale est dvoile comme le point en lequel les
synthses dcouvrent leur unit, de telle sorte que laperception transcendantale, le pur concept en
son unit, est par la mdiation des synthses de limagination le principe de dtermination du sens
interne, dsormais pos comme le dterminable, nous dcouvrons en mme temps le sens de
lobjectivit, et de subjective la dduction devient transcendantale. Car le rapport du sens interne
laperception transcendantale est le mme que celui de lobjet la conscience comme connaissance.
(Phi, OK I 161.1.1-12)
La rdaction de 1781 peut se rsumer dans ce que Philonenko appelle le syllogisme de la dduction
transcendantale:
Kant vient de dmontrer, en la conclusion de la dduction subjective o lunit de laperception
constitue la rfrence qui permet la dtermination des phnomnes, la proposition suivante: Les
conditions a priori dune exprience possible en gnral sont en mme temps <zugleich> les
conditions de la possibilit des objets de lexprience. [CRPu, Bar 650.3.1-3] Cest la majeure que
nous pouvons admettre en considrant le rsultat de la rfutation de Hume. La dduction
mtaphysique [] nous permet de prsenter la mineure: Les catgories ne sont pas autre chose
que les conditions de la pense dans une exprience possible [CRPu, Bar 650.3.3-7] Do suit la
conclusion: les catgories sont donc des concepts fondamentaux qui servent penser des objets en
gnral correspondant aux phnomnes, et elles ont, par consquent a priori une valeur objective.
[CRPu, Bar 650.3.m5-2] Kant ajoute: cest l proprement ce que nous voulions savoir. [Ibid.,
650.3.2f]
(Phi, OK I 166.2.3-167.1.10)
Philonenko reformule cette conclusion de faon clairante en commentant:
Et, en effet, la dduction transcendantale atteint ainsi son vritable but: elle montre comment des
conditions subjectives de la pense peuvent avoir une valeur objective et dpasse dfinitivement la
problmatique du sujet et de lobjet, tandis quelle fait voir comment les conditions qui permettent
de constituer en une totalit ncessaire les reprsentations, sont aussi les lois qui permettent
dlever les phnomnes la dignit dobjets en les fondant dans la connaissance. Les lois de
lobjet sont aussi les lois de la connaissance et lon peut dire que lessence de la connaissance est
aussi lessence de ltre.
(Phi, OK I 167.1.10-22)
Il faudrait dresser un tableau montrant comment une synthse empirique et une synthse pure est conue par
Kant pour chacune des trois synthses: celle de lapprhension, celle de la reproduction, celle de laperception.
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
79
4.2.2.5 Comparaison entre la version de la premire dition (DT1) et celle de la
deuxime (DT2)
La premire version commence avec la dduction subjective et se termine avec la dduction objective. La
deuxime version nlimine sans doute pas la distinction entre la dduction subjective et la dduction
objective; Kant, en effet, la maintient dans une remarque telle que la suivante:
Mais en cherchant [ dterminer] plus exactement le rapport des connaissances donnes dans
quelque jugement, et en distinguant ce rapport, propre lentendement, de celui [qui se fait] suivant
les lois de limagination reproductrice (lequel na quune valeur subjective), je trouve quun
jugement nest autre chose quune manire de ramener des connaissances donnes lunit objective
de laperception. La fonction que remplit dans ces jugements la copule est est de distinguer lunit
objective des reprsentations donnes de leur unit subjective.
(CRPu, Bar 160.2.1-10)
Cependant, lopposition conceptuelle entre dduction subjective et dduction objective nest certainement
plus celle dont Kant se sert pour ordonner les parties de son texte. Cette opposition ne figure plus comme
telle dans la structure thmatique.
En DT1, la notion de reproductibilit des phnomnes (CRPu, Bar 645.1.14-15) semble jouer un rle plus
important quen DT2, dans lexplication de la notion dunit de la synthse.
tudier: si lunit de la synthse est une condition dfinie seulement pour lentendement (donc au
niveau de la synthse de laperception) ou si elle est dfinie pour chacune des trois synthses
(celle de lapprhension, celle de limagination reproductrice, celle de laperception). En DT1
(Troisime section), immdiatement aprs avoir pos le principe transcendantal de lunit du
divers de nos reprsentations (CRPu, Bar 653.3.m5-4), principe qui semble instituer, tablir
laperception pure, Kant utilise plusieurs formules o figure la notion dunit:
Or lunit des lments divers dans un sujet est synthtique; laperception pure fournit donc un
principe de lunit synthtique du divers dans toute intuition possible./
Mais cette unit synthtique suppose une synthse ou la renferme; et, si la premire doit
ncessairement tre a priori , la seconde aussi doit tre une synthse a priori. Lunit transcendantale
de laperception se rapporte donc la synthse pure de limagination, comme une condition a
priori de la possibilit de tout assemblage des lments divers en une mme connaissance. Or la
synthse productive de limagination peut seule avoir lieu a priori; car celle qui est reproductive
repose sur des conditions exprimentales. Le principe de lunit ncessaire de la synthse pure
(productive) de limagination est donc, antrieurement laperception, le fondement de la possibilit
de toute connaissance, particulirement de lexprience.
Or nous nommons transcendantale la synthse du divers dans limagination, quand,
abstraction faite de la diffrence des intuitions, elle na trait a priori rien dautre chose qu la
liaison des lments divers; et lunit de cette synthse sappelle transcendantale, quand,
relativement lunit originaire de laperception, elle est reprsente comme ncessaire a priori.
Comme cette dernire sert de fondement la possibilit de toutes les connaissances, lunit
transcendantale de la synthse de limagination est la forme pure de toute connaissance possible, et
elle est par consquent la condition a priori de la reprsentation de tous les objets dexprience
possible.
Lunit de laperception relativement la synthse de limagination est lentendement, et
cette mme unit, relativement la synthse transcendantale de limagination, est lentendement
pur.
(CRPu, Bar 653.3.m3-654.3.4)
Noter aussi, dans la rdaction de 1787, loccurrence de la tournure unit synthtique de la
diversit (CRPu, Bar 153.2.f) ct des tournures plus habituelles unit de [cest--dire donne
] la synthse pure [de limagination] CRPu, Bar 136.1.6) et unit transcendantale de la
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
80
conscience de soi (CRPu, Bar 154.2.m5), unit de laperception, unit de la conscience de soi,
etc.
La question du rle que joue ventuellement la notion de reproductibilit dans DT2 me conduit
minterroger sur les sources et sur lexactitude de linterprtation que donne Philonenko de la
notion dunit de la synthse, dans le passage suivant: Nous voici donc en prsence de deux
totalits les intuitions et les concepts ou bien encore le divers et les synthses penses
comme acheves. Or pour quune synthse soit pense comme acheve, il faut quelle puisse tre
pense comme reproductible <Wiederholbarkeit>, ou, si lon prfre une synthse napparat
ncessaire lesprit que sil est toujours / assur de pouvoir la recommencer. Ainsi tandis que les
synthses empiriques, simple fruit de lassociation des ides, ne sont pas ncessairement
reproductibles, les synthses mathmatiques et physiques sont indfiniment reproductibles,
comme lest par exemple une exprience qui confirme une loi. Or on voit clairement quil convient
par del la synthse dajouter une opration qui assurera la reproductibilit de cette synthse. Kant
la nomme unit de la synthse. Cest le moment proprement conceptuel o la synthse jusque l
contingente est leve la ncessit, et ce moment saccomplit dans le concept qui fonde linfinie
reproductibilit de la synthse, car la synthse ne devient vraiment universelle, donc une
connaissance, que lorsquelle est par le concept dtermine comme reproductible indfiniment
(Note: Cf. J. G. Fichtes [sic] Antwortsschreiben an Herrn Professor Reinhold, in Smtliche Werke,
herausgegeben von J. H. Fichte, Bonn, 1845-56., Bd. II, p. 511) (Phi, OK I 152.2-153.1)
Je nai pas russi trouver le mot Wiederholbarkeit dans DT2; ce mot vient probablement du
texte de Fichte auquel Philonenko rfre dans sa note.
la deuxime rdaction [] consiste ramener autant que possible limagination transcendantale
lentendement (Phi, OK I 174.1.3-6).
DT2 place lexplication de lunit originairement synthtique de laperception au tout dbut de lexpos. En
DT1, lexpos culminait avec cette explication.
En DT1, les synthses attribues limagination sont:
la synthse de lapprhension (1)
la synthse de la reproduction dans limagination (2)
la synthse productive de limagination (dans la troisime section; CRPu, Bar 654.1.7-8)
la synthse transcendantale de limagination (dans la troisime section; CRPu, Bar 654.2 et 654.3)
En DT2, on a:
la synthse de lapprhension (26; CRPu, Bar 170.3)
la synthse figure, qui est aussi transcendantale et qui est attribue limagination productrice (24;
CRPu, Bar 165.3-164.1)
limagination reproductrice est attribue une synthse soumise simplement des lois empiriques,
cest--dire aux lois de lassociation (CRPu, Bar 166.1.m6-5). Cependant, on lit avec une certaine
surprise que limagination reproductrice ne concourt en rien [par sa synthse] lexplication de la
possibilit de la connaissance a priori et [que], de ce fait, [elle] nappartient pas la philosophie
transcendantale, mais la psychologie. (CRPu, Bar 166.1.4f)
En DT2, la synthse figure est introduite avant la synthse de lapprhension.
On ne trouve plus dans DT2 une exploitation systmatique et explicite de la notion dun objet en
gnral = X qui est abondamment exploite dans DT1. DT2 introduit la notion dobjet des sens (en 22-
23) avant dintroduire la synthse figure et la synthse de lapprhension.
Il ny a cependant pas de changement important dans les positions thoriques de Kant. Une faon de le
montrer est de comparer les triplets de concepts quon trouve dans les deux versions. (Voir le tableau de la page
suivante.)
[en 1781] Il y a trois sources primitives (facults ou pouvoirs de lme) qui renferment les conditions de
la possibilit de toute exprience et qui ne peuvent driver elles-mmes daucun autre pouvoir de lesprit:
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
81
ce sont les sens, limagination et laperception. L-dessus se fondent: 1 la synopsis du divers a priori
par les sens; 2 la synthse de ce divers par limagination; enfin 3 lunit de cette synthse par
laperception primitive. (CRPu, Bar 151.n)
[en 1781] Il y a trois sources subjectives de connaissance, do drive la possibilit dune exprience en
gnral et de la connaissance de ses objets: le sens, limagination et laperception. Chacune delles peut
tre regarde comme empirique, dans son application des phnomnes donns; mais toutes sont aussi
des lments ou des fondements a priori, qui rendent possible cet usage empirique mme. Les sens
reprsentent les phnomnes empiriquement dans la perception; limagination, dans lassociation (et la
reproduction); laperception, dans la conscience empirique de lidentit de ces reprsentation reproduc-
tives avec les phnomnes par lesquels elles ont t donnes, par consquent dans la rcognition.
Or tout ensemble de la perception repose a priori sur lintuition pure (qui, pour la perception
considre comme reprsentation, est le temps, forme de lintuition interne); lassociation, sur la synthse
pure de limagination; et la conscience empirique, sur la pure aperception, cest--dire sur lidentit
universelle de soi-mme dans toutes les reprsentations. (CRPu, Bar 652.3.3-653.2.f)
[en 1787] Les trois termes sont maintenus: rien nest chang en ce qui concerne les sens comme source
primitive des intuitions; ce qui concerne lImagination est introduit en 24 sous le nom de synthse
transcendantale de limagination et Kant qualifie cette synthse de figure pour la distinguer de la
synthse intellectuelle de lentendement; et le caractre primitif de laperception est raffirm avec autant
de force dans les 16 et 17. Jen conclus qui a vari, cest lordre dexposition des oprations de la
synthse et peut-tre limportance relative du rle de limagination en tant que source primitive.
4.2.2.6 Ides gnrales pouvant servir de rsum ou de vue densemble de la
DDUCTION TRANSCENDANTALE
Le problme critique se dfinit donc ainsi: expliciter la possibilit de lexprience, cest--dire
dgager lessence universelle de la connaissance comme unit des formes de la sensibilit et des
formes catgoriales. Ce problme est celui de la dduction transcendantale, qui tablit la
signification des structures constituant la priori mtaphysique.
(Phi, OK I 116.2)
[] dmonstration des oprations qui constituent la connaissance comme une essence unifie. Cette
dmonstration est la dduction transcendantale laquelle Kant sappliquait encore en 1780.
(Phi, OK I 119.1.5f)
Nous sommes donc parvenus au point o les lments tant runis, il faut oprer leur intgration et
la dcrire, et ce problme est celui de la dduction transcendantale, comme logique de la vrit.
(Phi, OK I 124.2.1-4)
On remarquera que la question de la Dduction transcendantale comme question sur lessence de la
connaissance carte le problme de linnit: ce dernier na de sens quau niveau de la recherche
gntique de fait. La Critique de la Raison pure dpasse le problme de linnit dans la mesure o,
sinterrogeant sur lessence, il lui est indiffrent (fondamentalement) que le concept soit acquis dans
lexprience ou possd (dune manire ou dune autre) avant lexprience. Le problme de
lessence reste entier que le concept doive son existence lexprience ou la constitution
psychologique inne du sujet.
(Phi, OK I 146.1.m18-7)
Deuxime version (1787) Premire version (1781)
Facult Processus et produit
(Indications p. 135-136)
Processus et produit Facult
T H M E # 5. L A N A L Y T I Q U E II. L A D D U C T I O N T R A N S C E N D A N T A L E D E S C A T G O R I E S
_____________________________________________________________________________________________
82
sensibilit Prsentation de la diversit des
intuitions
a) empiriques
Synopsis sensibilit
(les sens)
imagination SA Synthse de
lapprhension: runion des
lments divers dune intuition em-
pirique qui rend possible la
perception, cest--dire la
conscience empirique de cette
intuition comme phnomne).
(CRPu, Bar 170-171; 26)
1.
SA Synthse de lapprhension
Si SA est empirique, elle
correspond la sensation
imagination
sensibilit b) pures
=Condition 1 de la conn. a priori
dun objet quelconque OQ
si SA est pure, elle est la synthse
de la premire dimension du temps:
le prsent
imagination
? 2. SR Synthse de la
reproduction dans lImagination
imagination
imagination Synthse figure (165.3); synth.
transcend. de limagination (24)
=Condition 2 de la conn. a priori
dun OQ
SP Synthse de limagination
productive; synthse
transcendantale de limagination
facult
transcendantale
de limagination
entendement?
entendement Ramener la synth. de limagination
des concepts
a) soit des concepts discursifs
gnraliss partir de lexprience
3.
SRC Synthse de la rcognition
dans le concept
ou unit de la synthse dans
laperception
entendement
b) soit des concepts purs de
lentendement; cest la synthse
pure qui est ramene des
concepts;
=Condition 3 de la conn. a priori
dun OQ
SRC pure.
(CRPu, Bar 645.3-649.2)
(Phi, OK I 159.2-160.1)
entendement
83
K <> T h m e # 6 <> K
L A n a l y t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I I I . S c h m a t i s m e P r i n c i p e s m a t h m a t i q u e s
4.3 Lanalytique des principes..................................................................................................................81
4.3.1 Pr-introduction et introduction.................................................................................................81
4.3.2 Chapitre I. Le schmatisme........................................................................................................82
4.3.2.1 Le problme et sa solution................................................................................................82
4.3.2.2 Commentaires de Philonenko du point de vue .................................................................85
4.3.3 Chapitre II. Systme de tous les principes de lentendement pur..............................................87
4.3.3.1 Gnralits........................................................................................................................87
4.3.3.2 Les principes mathmatiques............................................................................................90
4.3 Lanalytique des principes
4.3.1 Pr-introduction et introduction
A. La sparation entre la thorie (analytique) des jugements et la thorie (dialectique) des raisonnements
Dans la pr-introduction il sagit pour Kant dexpliquer ( nouveau) pourquoi lanalytique transcendantale (en
tant que chapitre de la logique transcendantale) comprend seulement les deux premires des trois parties que
comporte la logique gnrale: lanalytique transcendantale peut traiter des concepts et des jugements mais doit
renvoyer le traitement des raisonnements une partie spciale qui sera la dialectique.
La raison en est qu loccasion des raisonnements, un usage transcendantal de la raison est possible et que
cet usage na pas de valeur objective. On distinguera donc logique de la vrit et logique de lapparence; la premire
donne lieu lanalytique, la seconde la dialectique.
LAnalytique transcendantale peut se diviser comme la logique gnrale en thorie des concepts et thorie des
jugements.
La logique gnrale Lanalytique transcendantale
peut servir de canon pour lentendement et la
raison, mais seulement en ce qui concerne la
forme de la pense en gnral
Lentendement et le jugement y trouvent le
canon de leur usage objectivement valable
(CRPu, Bar 179-180)
ne peut donner de prceptes au jugement,
nenseigne pas dcider si quelque chose
rentre ou non sous une rgle donne (casus
datae legis) (CRPu, Bar 181.1.1-3-4)
a pour fonction propre de corriger et
dassurer le jugement par des rgles
dtermines dans lusage quil fait de
lentendement pur. (182.2.3-5)
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
84
Lavantage de la logique transcendantale sur la logique gnrale est quelle peut indiquer a priori, non
seulement la condition gnrale des rgles (contenue dans le concept pur de lentendement) mais aussi le cas o la
rgle doit tre applique. Cet avantage est d deux raisons:
les concepts dont elle traite (et les principes qui en dcoulent) doivent se rapporter a priori leurs
objets (CRPu, Bar 183.2.8-9); elle svite donc les incertitudes des dmonstrations a posteriori.
elle expose les conditions sous lesquelles peuvent tre donns des objets en harmonie avec ces
concepts (Ibid., 183.2.m6-4). Cest la thorie du schmatisme.
B. Lanalytique des principes considre comme doctrine transcendantale du jugement
Au dbut de lAnalytique des principes, Kant prsente deux reprises cette thorie comme tant la doctrine
du jugement:
Lanalytique des principes sera donc simplement un canon pour le jugement; elle lui enseigne
appliquer des phnomnes les concepts de lentendement, qui contiennent la condition des rgles
a priori. Cest pourquoi, en prenant pour thme les principes propres de lentendement, je me
servirai de lexpression de doctrine du jugement, qui dsigne plus exactement ce travail.
(CRPu, Bar 180.2)
Cette doctrine transcendantale du jugement contiendra donc deux chapitres [].
(CRPu, Bar 183.3.1-2)
Il est cependant opportun de faire remarquer que ladite doctrine du jugement ne va thoriser que le jugement
dterminant, limitation qui ressortira plus tard avec plus dvidence lorsque Kant consacrera sa Critique de la
facult de juger construire la thorie du jugement rflchissant, dsormais toujours soigneusement distingu du
jugement dterminant. Le jugement dterminant sera alors clairement dfini comme celui qui opre une
dtermination:
[] la dtermination, comme subsomption sous une rgle universelle, est lopration schmatique
de limagination qui a parte subjecti runit entendement et sensibilit et a parte rei runit luniversel
et le singulier.
(Philonenko, A., CFJ, Pko 9.4)
C. Ides gnrales pouvant servir de rsum de lanalytique
Tout ce que lentendement tire de lui-mme, sans lemprunter lexprience, ne [peut] avoir pour lui
aucun autre usage que celui de lexp / rience. Les principes de lentendement pur, quils soient
constitutifs a priori (comme les principes mathmatiques), ou simplement rgulateurs (comme les
principes dynamiques), ne contiennent rien que le pur schme pour lexprience possible; car celle-
ci ne tire son unit que de lunit synthtique que lentendement attribue originairement et de lui-
mme la synthse de limagination dans son rapport laperception, unit avec laquelle les
phnomnes, comme data pour une connaissance possible, doivent tre a priori en rapport et en
harmonie.
(CRPu, Bar 265.2.1-266.1.10)
4.3.2 Chapitre I. Le schmatisme
4.3.2.1 Le problme et sa solution
Pourquoi y a-t-il un problme?
la relation entre concepts purs de lentendement et intuitions sensibles ne satisfait pas la condition
dhomognit exige par la subsomption. [CRPu, Bar 187.1-2]
il faut expliquer que les concepts purs de lentendement sappliquent nanmoins!
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
85
[] il doit y avoir un troisime terme / qui soit homogne, dun ct, la catgorie, et de
lautre, au phnomne, et qui rende possible lapplication de la premire au second. Cette
reprsentation intermdiaire doit tre pure (sans lment empirique), et pourtant il faut quelle
soit dun ct intellectuelle, et de lautre sensible. Tel est le schme transcendantal.
(187.3.1-188.1.f)
Intuition
Concept pur
de l'entendement
Schme en tant
que repr-
sentation
sensible
en tant
que repr-
sentation
intellec-
tuelle
Thse solution: Cest au moyen de la dtermination transcendantale du temps que le concept pur de lentendement
sera applicable au phnomne, que le phnomne sera subsumable sous le concept pur de lentendement.
(Thse dominant CRPu, Bar 188.2.)
1. Nous avons au dpart, en prsence lun de lautre, un concept et une intuition pure:
le concept de lentendement contient lunit synthtique pure de la diversit en gnral;
le temps, comme condition formelle des reprsentations diverses du sens intime, et par consquent
de leur liaison, contient une diversit a priori dans lintuition pure.
2. Or le temps est capable de dtermination, conformment au paragraphe 23 de la dduction transcen-
dantale (deuxime dition).
3. une dtermination transcendantale du temps est homogne la catgorie (qui en constitue lunit)
en tant quelle est universelle et quelle repose sur une rgle a priori.
4. elle est homogne au phnomne,
en ce sens que le temps est impliqu dans chacune des reprsentations empiriques de la diversit.
5. C.Q F. D.
Cette dtermination du temps, considre comme la condition gnrale qui seule permet la catgorie de
sappliquer quelque objet, considre comme la condition formelle et pure de la sensibilit, laquelle le concept
de lentendement est restreint dans son usage, nous lappellerons le schme de ce concept de lentendement, et la
mthode que suit lentendement lgard de ces schmes, le schmatisme de lentendement pur. (CRPu, Bar
188.3.m4-189.1.f)
Rsumons le schmatisme, en tant que thorie de lAnalytique transcendantale, au moyen des cinq thses
suivantes:
1. Thse concernant LA FONCTION DU SCHME DANS LA THORIE DES CONCEPTS PURS DE LENTEN-
DEMENT
la fonction du schme est de rsoudre le problme (logique) de la subsomption de la reprsentation
sensible (de lintuition) sous la reprsentation intellectuelle (du concept pur de lentendement).
2. Thse concernant LA POSITION DU SCHME DANS LE MODLE DES FACULTS
le schme est un produit de la sensibilit (plus spcifiquement: de limagination transcendantale dans sa
fonction productrice) et nest rien dautre quune dtermination de la reprsentation pure du temps.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
86
3. Thse concernant LA NATURE PHNOMNOLOGIQUE (comme on le dirait en langage contemporain) OU
PSYCHOLOGIQUE DU SCHME
le schme est la reprsentation dun procd de la pense, et non la reprsentation dune classe dobjets.
EXPLICATION. Le schme nest pas une image. Dans la dduction transcendantale de 1781, Kant mentionnait
limage ainsi: Limagination doit [] rduire en une image le divers quil y a dans lintuition; il faut donc quelle
commence par recevoir les impressions dans son activit, cest--dire par les apprhender. (CRPu, Bar 655.2.4f)
Mais il faut distinguer entre limage, qui est un produit occasionnel, et le procd gnral mis en oeuvre pour la
produire; seul ce dernier est un schme et peut tre considr comme une disposition que possde limagination:
cest cette reprsentation dun procd gnral de limagination servant procurer un concept son
image, que jappelle le schme de ce concept (CRPu, Bar 189.2.3f).
Et Kant dveloppe cette ide par des exemples qui ont une valeur argumentative:
lexemple des cinq points considre comme image du nombre 5, par opposition la pense dun
nombre en gnral;
lexemple du triangle [189.3] et la thse: Il ny a pas dimage dun triangle qui puisse tre jamais
adquate au concept dun triangle en gnral. [] aucune [image] ne saurait atteindre la gnralit
du concept [] Le schme du triangle ne peut exister ailleurs que dans la pense, et il signifie une
rgle de la synthse de limagination relativement certaines figures pures [conues par la pense
pure] dans lespace. (CRPu, Bar 189.3.2-11)
lexemple du concept de chien (189.3.m15-5), considr comme exemple de concept empirique.
4. La thse concernant LA GENSE DU SCHME
le schme est un produit et en quelque sorte un monogramme de limagination pure a priori au moyen
duquel et daprs lequel les images sont dabord possibles (CRPu, Bar 190.1.3-5). Par opposition, les
images sont des produits de limagination empirique. Le schme dun concept pur de lentendement est
quelque chose qui ne peut tre ramen aucune image; il nest que la synthse pure opre
conformment une rgle dunit suivant des concepts en gnral et exprime par la catgorie, et il est
un produit transcendantal de limagination concernant la dtermination du sens intime en gnral, selon
les conditions de sa forme (du temps) (CRPu, Bar 190.1.8-15).
5. La thse concernant LA CONTRIBUTION DU SCHME LA CONSCIENCE DES OBJETS
le schme est la condition de la signification des concepts purs de lentendement (CRPu, Bar 192.2.7-
10).
TABLEAU DES SCHMES
Catgorie concerne Schme
1. Quantit Le nombre (en tant que reprsentation de laddition successive de lunit lunit).
2. Quantit
ralit
ngation
Production de la ralit dans le temps avec accroissement et dcroissement du degr
(intensit) de la sensation.
Pour ce qui est de la catgorie de limitation, est-ce quil lui correspond un schme
spcifique? La notion psychologique de seuil de perception, en tant que
commencement non-nul dun degr de sensation suppose-t-elle un schme
particulier?
3. Relation
linhrence La permanence du rel dans le temps
la causalit La succession des lments du divers, en tant quelle est soumise une rgle.
la communaut La simultanit des dterminations dune substance (phnomnale) par les autres, et
rciproquement, suivant une rgle gnrale.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
87
4. Modalit
la possibilit Laccord de la synthse de reprsentations diverses avec les conditions du temps en
gnral (CRPu, Bar 191.5.1-3)
lexistence Lexistence dans un tout dtermin.
la ncessit Lexistence dun objet en tout temps.
TABLEAU DES DIFFRENTS SCHMES NONCS DANS UN VOCABULAIRE
QUI SPCIFIE LES DTERMINATIONS TRANSCENDANTALES DU TEMPS CHAQUE FOIS IMPLIQUES
1. La srie du temps La production (synthse) du temps lui-mme.
2. Le contenu du temps La synthse de la sensation et du temps: le fait de
remplir le temps lui-mme.
3. Lordre du temps Le rapport qui lie les reprsentations successives dans le
temps.
4. Lensemble du temps Le temps comme corrlatif de lacte de dterminer, par
la pense, si et comment un objet existe au temps.
4.3.2.2 Commentaires de Philonenko du point de vue
de lhistoire de la philosophie.
a) Quelle est la perspective dominante propre Kant?
Celle dune description phnomnologique: dcrire lopration complte de lintelligence (Phi, OK I
177.2.10); une psychologie, plus exactement une phnomnologie de la formation des concepts (Phi, OK I
178.1.2)
b) Cette perspective est adopte pour combattre lempirisme dans les questions concernant les concepts, et a
fortiori, les concepts purs a priori.
[] le problme que pose lempirisme Kant est particulirement difficile. Non seulement
lempirisme nie quil existe des concepts purs et a priori, tout concept procdant selon lui
uniquement de lexprience, mais encore il nie quil existe en fait des concepts: Existence, tendue,
etc., dit Berkeley, sont des abstraits, cest--dire que ce ne sont pas des ides. Ce sont des mots,
inconnus du peuple et pour lui sans usage (Oeuvres choisies de BERKELEY Paris, 1944, tr. G.
Leroy, T. I, p. 142 - n 790). On parle de lide gnrale et abstraite de triangle, mais que lon songe
seulement que le triangle reprsent ne doit tre ni obliquangle, ni rectangle, ni quilatral, ni
isocle, ni scalne: mais la fois tout cela et rien de tout cela. (LOCKE, Essai sur lentendement
humain, L. IV, ch. VII, 9.) Cest dire que lide gnrale et abstraite est selon lempirisme la fois
une impossibilit psychologique et un monstre logique. Une impossibilit psychologique: Si
quelquun a le pouvoir de former, dclare Berkeley, dans son esprit une ide de triangle telle quon
la dcrit ici, il est vain de chercher la lui enlever par la discussion et je ne men charge pas. Tour
mon dsir, cest que le lecteur se rende pleinement et certainement compte sil a ou non, une pareille
ide. mon avis, ce nest une tche difficile accomplir pour personne. Quy a-t-il de plus ais que
de jeter rapidement un regard sur ses propres penses et dprouver si lon a, ou si lon peut parvenir
avoir, une ide qui corresponde la description quon vient de donner de lide gnrale de
triangle, qui nest ni obliquangle, ni rectangle, ni quilatral, ni isocle, ni scalne, mais la fois tout
et rien? (BERKELEY, op. cit. , T. I, pp. 187-189.) Impossibilit logique ensuite: lide gnrale et
abstraite qui est la fois tout et rien est contraire au principe logique du tiers exclu: il faut quune
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
88
chose soit ou noire ou blanche, ou grande ou petite, ou rectangle ou isocle, mais elle ne saurait tre
lun et lautre.
(Phi, OK I 178.2.1-179.1.6)
c) Les thses de Kant.
c.1) Concernant la difficult logique.
la rigueur la difficult nembarrasse pas trop Kant: la logique transcendantale montre suffisamment
quon peut la rsoudre en tablissant la ncessit de jugements synthtiques. (Phi, OK I 179.1.6-10)
Dautre part, Kant accepte de reconnatre les difficults logiques que dnonce lempirisme et dans sa
lettre Tieftrunk du 11 dcembre 1797, il admet que la subsomption du divers sous la catgorie serait une
contradiction contraire la logique si elle seffectuait immdiatement. (Phi, OK I 181.2.2-7) Mais il va
rsoudre cette difficult dans le schmatisme.
c.2) Concernant la difficult psychologique.
Ngativement. Kant concde aux empiristes que limage ne peut fonder le concept. De limage au
concept, il ny a aucune voie. (Phi, OK I 181.1.m6-5) Dans le fait nos concepts sensibles purs nont pas
pour fondement des images des objets, mais des schmes. Il ny a pas dimage dun triangle qui puisse tre
jamais adquate au concept dun triangle en gnral. (CRPu, Bar 189.3.1-4)
Positivement.
P1. Kant vite de rifier lintelligence et ce quelle contient, y compris les images, en concevant le
schme comme une mthode, ou si lon prfre une opration. (Phi, OK I 182.2.11-12)
Or lide de mthode rsout dun seul coup les difficults relatives luniversalit du concept et la
particularit de limage laquelle il doit sappliquer. Dune part la mthode est en elle-mme, comme
le souligne Kant, le principe de construction gnral de limage ou de la figure et il est absurde de
concevoir le principe de construction des triangles comme tant lui-mme triangle! Dautre part
limage construite concrtement, si nous prenons lexemple dun triangle, correspond au concept,
lide gnrale et abstraite, non parce quelle lui ressemble comme une chose une autre chose, mais
parce quelle enveloppe en tant que telle la rgle de construction, qui est prcisment la mthode, le
schme en tant quil rend possible lapplication du concept. Cest donc dire, comme le souligne
Cassirer, que tous nos concepts purs se fondent sur des fonctions et non sur des affections (E.
CASSIRER, Das Erkenntnisproblem, Bd II, p. 715.) (Phi, OK I 183.1.1-f)
P2. dans le schme le concept devient la rgle de lobjet (Phi, OK I 183.2.1-2)
P3. Le schme peut tre dvelopp trois niveaux:
empirique (Le concept de chien signifie une rgle daprs laquelle mon imagination peut
exprimer en gnral la figure dun quadrupde CRPu, Bar 189.3.m11-8)
mathmatique et pur (Le schme dun triangle ne peut jamais exister que dans la pense et il /
signifie une rgle de la synthse de limagination relativement des figures pures dans lespace
CRPu, Bar 189.3.8-11)
transcendantal: tant donn la ncessaire relation de lintuition au concept, en laquelle celle-ci
devient claire et celui-l rempli. (Phi, OK I 183.2.m6-184.1.5)
d) Conclusion. La triple signification du schmatisme [Phi, OK I 184.2-186.1] :
Le schmatisme a une signification psychologique: puisque le schme est mthode et non une chose
intermdiaire entre la ralit sensible et la ralit conceptuelle, il fait apparatre lerreur de lempirisme
qui chosifie lesprit (Phi, OK I 184.2.7-12).
Le schmatisme a une signification mtaphysique: il rsout par lide dune construction mthodique les
apories platoniciennes concernant les relations de lessence intemporelle et universelle et de la diversit
des phnomnes donns dans le temps; le schmatisme est la mise en lumire concrte de la participation
et du rapport de la pense et du temps.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
89
Enfin le schmatisme possde une signification transcendantale : les catgories sont les expressions de la
pense (les essences formelles) qui est pense de ce qui est; or cette pense ne peut saccomplir en soi,
mais aussi pour elle-mme (devenir pour elle-mme pensable) quen se schmatisant, en se remplissant, en
se ralisant dans le temps et, travers celui-ci, lespace: donc la mtaphysique (connaissance de ce qui est)
nest possible comme science que comme une physique et ainsi le schmatisme rend possible lapplication
de la mathmatique pure (les formes de lintuition) aux phnomnes, subsums sous les catgories . (Phi,
OK I 184.2.7-185.1.f)
4.3.3 Chapitre II. Systme de tous les principes de lentendement pur
4.3.3.1 Gnralits
Dune faon gnrale, lAnalytique des principes enseigne appliquer des phnomnes les concepts de
lentendement qui contiennent la condition requise pour formuler des rgles a priori. (Riv, HP-Vl 125.2). Les
rgles obtenues de cette faon constituent ce qui, dans les connaissances scientifiques et dans les connaissances
mtaphysiques, est dj dtermin a priori, du simple fait de la structure de notre esprit.
Le systme de tous les principes (voir le tableau de la page suivante) commence, au premier niveau
darticulation, par tenir compte de la distinction entre les jugements analytiques et les jugements synthtiques.
Premire section. DU PRINCIPE SUPRME DE TOUS LES JUGEMENTS ANALYTIQUES
Cest le principe de contradiction.
Deuxime section. DU PRINCIPE SUPRME DE TOUS LES JUGEMENTS SYNTHTIQUES
Introduction. La question Comment des jugements synthtiques a priori sont-ils possibles? signifie :
Comment est-il possible que des jugements synthtiques a priori aient une valeur objective?
1. Thse 1. Il faut chercher la possibilit des jugements synthtiques a priori dans la manire dont le sens
intime met en rapport limagination et lentendement.
Maj Il faut un troisime terme pour produire la synthse des deux concepts dans un jugement synthtique
(a priori ou non) la diffrence de ce qui se produit dans les jugements analytiques, lesquels
nont pas besoin dun troisime terme.
Min Or, ce troisime terme est le sens intime et sa forme a priori le temps (201.2.7-8] car il faut bien que
ce soit un ensemble [Inbegriff] qui renferme [subsume] toutes nos reprsentations (empiriques,
pures, )
Min Or, sajoutent la forme a priori du temps la synthse faite par limagination et lunit de cette
synthse (fonde sur lunit de laperception) et ces trois termes renferment toutes les sources de nos
reprsentations a priori.
Les trois termes voqus par Kant ne sont pas immdiatement perceptibles quand ils sont
dsigns comme ils le sont en 201.2.7-11; la raison en est que le vocabulaire utilis est
htrogne: en partie celui des facults (sens intime, imagination), en partie celui des
oprations (synthse, unit de cette synthse), en partie celui des reprsentations
(ensemble de nos reprsentations il sagit alors dun contenu; sa forme a priori le temps
il sagit alors dune reprsentation du genre intuition pure; lunit de laperception il sagit alors
dune reprsentation, tout fait unique en son genre, attribue lentendement et susceptible
daccompagner toutes les autres.
La plus claire formulation des trois termes nest pas celle de 201.2
mais celle de 202.f.m2-203.1.2. Les trois termes sont :
1:les conditions formelles de lintuition a priori; 2la synthse de limagination; 3lunit
ncessaire de la synthse au sein dune aperception transcendantale.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
90
Dans cette formulation, on voit mieux comment le terme-milieu correspond au schmatisme.
LA TABLE DES PRINCIPES DES JUGEMENTS SYNTHTIQUES DE LENTENDEMENT PUR
La
succession
dans le
temps
selon la loi
de la
causalit
Les principes
des jugements
synthtiques de
l'entendement
pur
Le Principe suprme de
tous les jugements
synthtiques
Les principes
drivs
Les principes
mathmatiques
Les principes
dynamiques
Axiomes de
l'intuition
Anticipations de
la perception
Analogies de
l'exprience
Postulats de la
pense
empirique
La perma-
nence de la
substance
La simul-
tanit
suivant la
loi de
l'action
rciproque
La
condition
de ce qui
est
empiri-
quement
possible
La
condition
de ce qui
est
empiri-
quement
rel
La
condition
de ce qui
est
empiri-
quement
ncessaire
L'intuition
comme
grandeur
extensive
La grandeur
intensive de
l'objet de
sensation
2. Thse 2. Les principes de lentendement pur, en tant que rgles de lunit synthtique de lexprience en
gnral, ont une valeur objective. [CRPu, Bar 201.3-202.2]
Maj La possibilit de lexprience, en tant que celle-ci donne lobjet, est ce qui donne la ralit objective
toutes nos connaissances a priori (CRPu, Bar 201.4.1-2).
Maj Pour quune connaissance puisse avoir une ralit objective, cest--dire se rapporter un objet
et y trouver sa valeur et sa signification, il faut que lobjet puisse tre donn de quelque faon.
Min Or donner un objet, cest en rapporter la reprsentation lexprience (que celle-ci soit relle ou
simplement possible). (CRPu, Bar 201.3.7-11)
Min Or lexprience repose sur (est rendue possible par) les principes de lentendement pur, en tant quils
sont des rgles gnrales de lunit de la synthse des phnomnes. (CRPu, Bar 202.1.9-11)
3. Thse 3. tout objet est soumis aux conditions ncessaires de lunit synthtique des lments divers de
lintuition au sein dune exprience possible. (CRPu, Bar 202.4.2-f) Tel est le principe suprme de tous les
jugements synthtiques. [202.3-203.1]
Maj Les principes de lentendement pur ont une valeur objective.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
91
Min Lexprience est le seul mode de connaissance qui donne de la ralit tout autre synthse (jusque,
et y compris, la synthse a priori de laperception). (Lire 202.3.)
Comme on le voit, le principe de la dmarche de preuve est de montrer que les conditions de la possibilit de
lexprience en gnral sont en mme temps celles de la possibilit des objets de lexprience (CRPu, Bar 203.1.2-
4).
La relation de condition ncessaire, caractristique de largumentation transcendantale, on le voit nouveau
ici, joue dans les deux sens:
Le jugement synthtique a priori, en tant que principe de lentendement pur, est condition ncessaire de
la possibilit de lexprience et donc des objets de lexprience; (note: puisquune condition de la
possibilit dune chose est toujours une condition ncessaire, ladjectif ncessaire, dans lexpression
prcdente, est redondant et on lomet habituellement). La thse 3 dit que les objets sont soumis aux
conditions ncessaires de lunit synthtique. etc.
Lexprience, en tant que connaissance qui donne les objets, est condition ncessaire du caractre
objectif des jugements synthtiques a priori . En dautres termes, il faut que les concepts et principes de
lentendement pur soient appliqus lexprience, et en reoivent des objets, pour avoir une valeur et
une signification comme instruments de connaissance. La thse 2 dit que les principes satisfont la
condition ncessaire sans laquelle ils ne sauraient tre objectifs.
TABLEAU DES PROPRITS GNRALES DES PRINCIPES PURS DE LENTENDEMENT.
Classes Principes mathmatiques Principes dynamiques
1
er
terme du nom
Axiomes Anticipations Analogies Postulats
2
e
terme du nom
de lintuition de la perception de lexprience de la pense
empirique en gnral
Aspects des
phnomnes
considrs comme objets dune exprience
possible
considrs dans leurs rapports dexistence
Type de liaison Composition de lhomogne Connexion de lhtrogne
agrgation coalition connexion (nexus)
physique
connexion (nexus)
mtaphysique ou
pistmologique
Type de certitude intuitive discursive
Caractre des
principes eu gard
leur fonction vis--
vis lexprience
Les principes sont constitutifs Les principes sont rgulateurs
Corrlat scientifique
(en langage
contemporain)
Problmes de lapplicabilit des
mathmatiques, notamment des gomtries,
aux phnomnes physiques.
Les rfrentiels, les mtriques
Thorie de la
matire, du
mouvement, de la
causalit
Lhypothse, le fait,
la loi
Observons dabord que le vocabulaire prsente une incertitude intressante, concernant lidentit des propo-
sitions qui appartiennent la classe des principes purs de lentendement appelons-la PPE. Peut-on dire
quun axiome de lintuition est un PPE? Je pense que non, et quon peut seulement dire quil existe un PPE qui
concerne les axiomes de lintuition: cest celui qui affirme toutes les intuitions sont des grandeurs extensives
(CRPu, Bar 206). De la mme faon, il existe un PPE qui concerne les anticipations de la perception; mais il est
douteux quon puisse dire quune anticipation de la perception est un PPE. De mme, lAnalytique nous donne
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
92
quatre PPE qui concerne les analogies de lexprience; aucun deux nest une analogie et aucune des analogies nest
un PPE. En revanche, il me semble tout fait plausible que les trois postulats de la pense empirique en gnral
puissent tre considrs comme trois PPE.
4.3.3.2 Les principes mathmatiques
L E S A X I O M E S D E L I N T U I T I O N
La marche gnrale de largumentation est rsume dans le premier paragraphe de la section (CRPu, Bar
206.1), lequel est un ajout de la deuxime dition.
Concept pralable, ncessaire la comprhension du principe qui va tre nonc ici: la dtermination de
lespace et du temps. Larticulation entre une conscience pure et une conscience empirique correspond
larticulation entre les reprsentations gnrales et les reprsentations dtermines du temps et de lespace:
Conscience pure Conscience empirique
Temps et espace en tant quintuitions
pures a priori
Un temps et un espace dtermins
Thse. Toutes les intuitions sont des grandeurs extensives. [=Principe des axiomes de lintuition.]
[Formulations plus explicites: ] a) Pour quun objet soit peru comme phnomne, il faut que la composition
de ses divers lments homognes soit pense comme une unit dans le concept de grandeur.
b) Les phnomnes sont tous des grandeurs extensives, puisquils sont ncessairement reprsents, comme
intuitions dans lespace ou dans le temps, au moyen de cette synthse (cest--dire lunification de lagrgat
dans le concept de grandeur) par laquelle lespace et le temps sont dtermins en gnral.
c) Toutes les intuitions sont des agrgats qui rsultent de la composition dun certain nombre de parties
homognes du divers sensible selon une grandeur.
Cette dernire formulation a lavantage de mentionner explicitement le schme de la quantit,
savoir le nombre.
Maj Les phnomnes ne peuvent donc tre apprhends quau moyen de cette synthse du divers par
laquelle sont produites les reprsentations dun espace et dun temps dtermins, cest--dire par la
composition des lments homognes et par la conscience de lunit synthtique de ces divers
lments (homognes). (CRPu, Bar 206.1.5-9)
Maj Tous les phnomnes doivent avoir la forme dune intuition dans lespace et dans le temps,
cest l une des conditions de la possibilit de leur apprhension.
Min Or la conscience du divers homogne dans lintuition en gnral est le concept dune grandeur (dun
quantum).
K a n t d f i n i t l a no t i o n de g r a n d e u r ex t e n s i v e . [2 0 6 . 2 - 2 0 7 . 1 ]
K a n t ex p o s e s a t h o r i e du fo n d e m e n t de l a s c i e n c e m a t h m a t i q u e . [2 0 7 . 2 - 2 0 8 . 1 ]
K a n t co m m e n t e l e pr i n c i p e de s ax i o m e s de l i n t u i t i o n en en d v o i l a n t l u t i l i t
p o u r l a co n n a i s s a n c e [2 0 8 . 2 - 2 0 9 . 1 ] , s a v o i r :
Ce principe transcendantal de la science mathmatique des phnomnes tend beaucoup notre
connaissance a priori. Cest en effet grce lui que les mathmatiques pures peuvent sappliquer
dans toute leur prcision aux objets de lexprience [].
(CRPu, Bar 208.2.1-5)
Commentaires:
1
2
3
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
93
Le premier principe de lentendement pure fonde un nombre indtermin daxiomes de lintuition (il nest pas
lui-mme lun de ces axiomes). Quels sont ces axiomes? Globalement, ce sont ceux des mathmatiques qui
noncent les principes de la synthse des espaces et des temps en gnral. Plus spcifiquement, et titre
dexemples:
ce sont ceux de la gomtrie considre comme la science mathmatique de ltendue (207.2.2-3); par
exemple entre deux point on ne peut concevoir quune seule ligne droite, [] deux lignes droites ne
renferment aucun espace (207.2.m5-3)
peut-tre Kant compte-t-il parmi les axiomes de lintuition la proposition un triangle se construit avec
trois lignes, dont deux prises ensemble sont plus grandes que la troisime (208.1.4-6); du moins estime-
t-il que cette proposition possde le degr de gnralit attendu dun axiome, car il la contraste avec les
formules numriques, lesquelles nont pas le degr de gnralit requis dun axiome.
peut-tre une proposition telle que: pour tout nombre a et b, il existe un nombre c tel que a + b = c.
Le principe qui rend possibles les axiomes de lintuition prsuppose ou entrane la proposition par laquelle
Kant dit trs explicitement le rapport ncessaire quil conoit entre la gomtrie et la perception de lespace
dans lexprience physique: ce que la gomtrie dit de celle-ci [lintuition pure] sapplique donc celle-l
[lintuition empirique] (CRPu, Bar 208.2.8-10) puisque lintuition empirique, pour Kant, nest possible que
par lintuition pure. La mme thse est ensuite reformule pour les mathmatiques.
L E S A N T I C I P A T I O N S D E L A P E R C E P T I O N
Concernant la formulation: dans la premire dition Kant disait du principe en question quil anticipait
toutes les perceptions, en tant que telles (voir la note a de la page 209); dans la seconde dition, il utilise le gnitif
et prsente le principe comme tant celui des anticipations de la perception ce quon peut expliciter de diverses
faons, en disant par exemple que ledit principe rend compte des anticipations qui accompagnent de fait les
perceptions, ou encore prouve, tablit le fait quil existe des anticipations a priori au fondement de toute perception.
Pour comprendre lintitul mme de la deuxime sorte de principes, on doit noter le sens que Kant donne au
mot anticipation (voir le deuxime paragraphe de lexpos, aprs le paragraphe-rsum ajout par Kant pour la
seconde dition). Comme il le fera par la suite pour le terme postulat il se rfre au grec et voque la
dpicure. Pour nous, cette rfrence nest pas trs clairante tant donn que le mot prolepse na t conserv
que dans le vocabulaire de la rhtorique pour dsigner la figure par laquelle un orateur anticipe une objection quil
attribue un adversaire.
Deux articulations conceptuelles sont utilises par Kant pour nous expliquer la diffrence entre grandeur
extensive et grandeur intensive:
1. Larticulation entre conscience pure et conscience empirique. La diffrence entre lune et lautre peut
tre dcrite dans les termes dune mtaphore de vidage-remplissage: si lon vide lune, on obtient lautre
si lon remplit lune on obtient lautre. [] il peut y avoir une transformation graduelle de la
conscience empirique en conscience pure o le rel de la premire [cest--dire le rel de la sensation,
considr comme une reprsentation purement subjective dont on ne peut avoir conscience quautant que
le sujet est affect (209.2.8-11) ] disparaisse entirement et o il ne reste quune conscience purement
formelle (a priori) du divers contenu dans lespace et dans le temps; par consquent il peut y avoir aussi
une synthse de la production de la quantit dune sensation depuis son commencement, lintuition pure
= 0, jusqu une grandeur quelconque. (CRPu, Bar 209.2.12-20)
2. Larticulation entre apprhension instantane et apprhension [consistant en une] synthse
successive. [210.2] Larticulation se fait de la faon suivante:
Concernant la grandeur extensive Concernant la grandeur intensive
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
94
Lapprhension est une synthse
successive laquelle procde en allant
des parties la reprsentation totale
(210.2.5-6)
lapprhension sopre en un
moment au moyen dune simple
sensation et non par une synthse
successive de plusieurs sensations, et
[] ainsi elle ne va pas des parties au
tout. (210.f.m2-211.1.2)
Attention: La diffrence entre grandeur extensive et grandeur intensive nutilise pas du tout larticulation
entre grandeurs continues et grandeurs discontinues (discrtes).
E X P L I C A T I O N D E T E X T E
(description des contenus propositionnels, et de certains procds discursifs)
210.1 Sil y a quelque chose en chaque sensation, considre comme sensation en gnral (sans
quune sensation particulire soit donne (m8-6) quon peut connatre a priori, ce quelque
chose peut tre nomm anticipation. Cest le caractre trange et surprenant dune telle
anticipation que Kant souligne; autant le terme anticipation des phnomnes pouvait-il
convenir, et sans surprise, aux dterminations pures vises par le principe des axiomes de
lintuition (dterminations pures conues dans lespace et dans le temps, sous le rapport soit
de la figure, soit de la quantit (11-13), autant de telles dterminations sont surprenantes
lorsquelles visent la sensation, et chaque sensation, puisque justement la sensation est
proprement ce qui ne peut pas tre anticip (10-11).
210.2-211.2 Limite une sensation, lapprhension ne remplit quun instant. La sensation, ainsi
considre comme quelque chose dont lapprhension nest pas une synthse successive, qui
irait des parties la reprsentation totale, na pas de grandeur extensive.
Elle a en revanche une autre sorte de grandeur:
ce qui correspond la sensation dans lintuition empirique est la ralit ]realitas
phnomenon)
ce qui correspond labsence de sensation est la ngation = 0
le rel dans le phnomne a donc toujours une grandeur [Gre devrait tre traduit par
grandeur]
cette grandeur je la nomme grandeur intensive. (CRPu, Bar 211.2.4)
211.3 Toute sensation a une grandeur intensive.
211.4 Dfinition de la continuit dune grandeur.
Lespace et le temps sont des grandeurs continues quanta continua.
212.1 Commentaire: les deux premiers principes purs peuvent tre combins pour noncer une
proprit que les phnomnes ont en commun:
Tous les phnomnes en gnral sont donc des grandeurs continues, aussi bien quant
leur intuition, comme grandeurs extensives, que quant la simple perception ( la
sensation et par consquent la ralit), comme grandeurs intensives. (CRPu, Bar
212.1.1-5)
212.2-213.1 Attention! nous ne pouvons pas tirer du principe de la continuit des phnomnes la thse
voulant que tout changement (tout passage dun tat une autre) est aussi continu (CRPu,
Bar (212.2.3-4), car la causalit dun changement en gnral rside tout fait en dehors des
limites dune philosophie transcendantale. Nous ne pouvons, dit Kant, anticiper sur la
physique gnrale, qui est construite sur certaines expriences fondamentales (CRPu, Bar
213.1.3f).
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
95
Comme si Kant, par cette remarque, rpondait par avance lobjection allguant que la physique
moderne, par la thorie quantique, a montr que les changements des phnomnes sont
effectivement discontinus, lorsquon les dcrit au niveau de rsolution que vise la thorie
quantique. [Kant fait-il une prolepse? Anticipe-t-il?] Quelle que soit la force avec laquelle
lintuition pure prescrit ses propres conditions a priori lintuition empirique, Kant laisse ouverte,
pour ainsi dire, la possibilit que nous puissions percevoir dans lexprience des formes du
changement que nous nanticipons justement pas. La nature et ltendue de ce que nous
anticipons est extrmement rduite. (Lautre question, celle de savoir, si la science peut ou doit
admettre au nombre des phnomnes des ralits que nous sommes en principe incapables de
percevoir, reste ouverte et nest pas touche par la remarque prcdente. La conception
contemporaine de la science accepte allgrement des rapports extrmement mdiatiss entre la
nature et la perception et croit audacieusement des constructions qui reprsentent des formes ou
des ralits qui ne sont pas du tout de lordre du perceptible.)
213.2-214.1 Nanmoins, notre principe exerce une influence considrable (dans les sciences) en anticipant
sur les perceptions. Par exemple, il nous permet daffirmer quIl ne peut [] y avoir de
perception, par consquent dexprience, qui prouve, soit immdiatement, soit mdiatement
(quelque dtour quon prenne pour arriver cette conclusion), une absence absolue de toute
ralit dans le phnomne; cest--dire quon ne saurait jamais tirer de lexprience la preuve
dun espace ou dun temps vide. (CRPu, Bar 213.3.4-10)
Kant relate un exemple tir de lhistoire de la physique.
214.2-215.2 Prcaution oratoire de type mise en garde.
Ce que notre principe nous permet danticiper, relativement la sensation, est trs limit et ne
concerne pas ce quon appelle habituellement la qualit de la sensation, par exemple la
couleur, le got, etc. Nous faisons usage du concept de qualit auquel appartient la catgorie
ralit, mais cest en un tout autre sens:
Il est remarquable que nous ne pouvons connatre a priori dans les grandeurs en gnral
quune seule qualit, savoir la continuit, et dans toute qualit (dans le rel du
phnomne) que sa quantit <Quantitt> intensive, cest--dire la proprit quelle a
davoir un degr; tout le reste revient lexprience. (CRPu, Bar 215..2.6f)
Boutroux, concernant les anticipations de la perception: Il faut que les choses aient un degr dinfluence sur nos
sens. Cest la condition requise pour quelles puissent nous fournir des sensations. (BOUTROUX, ., La philosophie
de Kant, 123.f.f-124.1.2)
Commentaire de Philonenko sur lanticipation de la perception.
Lesprit peut non seulement connatre la forme de la sensation mais encore en prvoir, pour ainsi dire, la
matire; cest a la grandeur intensive.
En dfinissant le degr de la sensation partir de 0, Kant affirme la ralit dans son opposition la ngation,
cest--dire au nihil privativum et prsente une thorie de la gense du rel. La gense du rel est, identiquement, la
double gense du sujet et de lobjet. (Phi, OK I 200.1.1-5)
O lon voit que
ralit existence
ralit essence comme possibilit de lexistence du phnomne donn dans la sensation
essence formaliter spectata, cest--dire essence mathmatique (quantit comprise comme
continuit)
essence materialiter spectata, constructible jusqu ce quelle corresponde la donne du sens
interne.
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
96
Pour la poursuite de la rflexion: quelles sont les diverses interprtations possibles de la thse
affirmant que la ralit a des degrs? Peut-on transporter cette thse dans un contexte dontologie
contemporaine? Voici quelques-unes des occurrences de laffirmation de la thse: degr de la
ralit (CRPu, Bar 211.2.m6); Le rel a donc une grandeur [Gre], mais cette grandeur nest
pas extensive. (Ibid., 211.1.2f); toute sensation, par consquent aussi toute ralit dans le
phnomne, si petite quelle puisse tre, a donc un degr (Ibid., 211. 3.1-2) Pourquoi, dans
lexemple de la couleur, affirmer, propos du degr dune couleur, que si faible quil puisse tre,
[il] nest jamais le plus faible [possible] (Ibid., 211.3.7-8)?
T H M E # 6 . L A N A L Y T I Q U E II I . S C H M A T I S M E P R I N C I P E S M A T H M A T I Q U E S
_____________________________________________________________________________________________
97
98
K <> T h m e # 7 <> K
L A n a l y t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I V . L e s p r i n c i p e s d y n a m i q u e s
V . S y n t h s e d e l A n a l y t i q u e
4.3.3.3 Les principes dynamiques..................................................................................95
4.3.3.3.1 Les analogies de lexprience........................................................................95
4.3.3.3.2 Les postulats de la pense empirique............................................................107
4.3.3.4 Vue densemble sur les principes......................................................................110
4.3.4 Chapitre III Du principe de la distinction de tous les objets en gnral en phnomnes et
en noumnes........................................................................................................112
4.4 Synthse de la thorie de la connaissance contenue dans lEsthtique et lAnalytique..................112
4.3.3.3 Les principes dynamiques
Rsum des principes prcdents.
Dans les principes mathmatiques, nous avons identifi des conditions a priori:
de lintuition des phnomnes en tant quobjets possibles, cette condition tant le principe a priori de la
composition de lhomogne pour former des grandeurs extensives;
de la perception (ou de la prsence dune matire non-nulle de sensation percevoir), cette condition
tant le degr que possde le phnomne et par lequel il est capable daffecter la sensibilit.
Les conditions exprimes par le deux principes assurent:
lunit (CPE) quantitative dobjets possibles, unit qui les rend
susceptibles dtre distingus lun de lautre
comparables entre eux
mesurables.
la ralit (CPE) qualitative dobjets possibles, ralit qui les rend perceptibles au sens de
SUSCEPTIBLES DTRE DISTINGUS DU NANT
RELS de part en part (denses: possdant en tout point du temps et de lespace un degr non nul).
eux deux, ces principes assurent la possibilit dappliquer les mathmatiques aux phnomnes. Cest cette
ide mme que Kant exprime en qualifiant ces principes de mathmatiques.
4.3.3.3.1 Les analogies de lexprience
Lexpos des AE commence avec lnonc du principe qui vaut pour les trois analogies: elles
doivent toutes assurer une reprsentation de la ncessit des liaisons entre des perceptions. Ce
principe est dmontr par le raisonnement de 216.1. Voici sa reconstitution explicite.
a)
215.3-
216.1
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
99
(Thse) Lexprience nest possible quau moyen dune reprsentation de la liaison ncessaire des perceptions.
(Maj) On ne peut dterminer lexistence des objets dans le temps quen les liant dans le temps en gnral,
cest--dire au moyen de concepts qui les unissent a priori. (CRPu, Bar 216.1.m6-4)
Le rapport dexistence des lments divers doit tre reprsent dans lexprience tel quil existe
objectivement dans le temps (et non tel quil rsulte de la manire dont lapprhension les assemble
dans le temps)
(Maj) Lexprience est une connaissance qui dtermine un objet par des perceptions (216.1.1-2) et
renferme ce titre lunit synthtique de la diversit [de ces perceptions] au sein dune
conscience (216.1.4-5)
(Min) Or, dans lexprience, les perceptions ne se rapportent les unes aux autres que de manire
accidentelle (et non ncessaire).
Or, le temps ne peut lui-mme tre peru, cest--dire le temps en gnral nest pas une perception.
(Min) Or, ces concepts impliquent toujours la ncessit.
[Ce texte constitue un nouveau dbut de la dmarche dexposition; en effet, ctait ici que
commenait lexpos dans la premire dition; le paragraphe qui prcde est un ajout de la
deuxime dition.]
La division en trois analogies est base sur les 3 modes du temps: permanence, succession, simultanit.
nonc du principe <Grundsatz> qui va guider la dmarche didentification des 3 analogies:
Toutes les dterminations empiriques du temps sont soumises aux rgles de la
dtermination gnrale du temps. (217.1.m5-3)
Ce principe ne fait quexpliciter une prmisse dj utilise dans le raisonnement dintroduction:
on ne peut dterminer lexistence des objets dans le temps quen les liant dans le temps en
gnral. (216.1.m6-5).
Les trois articulations conceptuelles retenir des paragraphes de prsentation (216.2, 216.3, 217.1) sont:
larticulation entre conscience pure (aperception) et conscience empirique (perception).
larticulation entre temps en gnral (comme dans la dduction transcendantale du temps, faite dans
lEsthtique) et temps dtermin. Les analogies ne concernent que la dtermination du temps, et parmi ces
dterminations, seulement celles qui concernent lordre du temps, selon le terme du troisime schme.
larticulation entre les rgles de la dtermination gnrale du temps ce sont les trois analogies et les
dterminations empiriques du temps, lesquelles sont soumises aux rgles mais ne sont pas connues hors
de lexprience. (217.1.7f).
Ce paragraphe nest quune prcaution oratoire (ou commentaire ngatif). Il sagit de lexistence
<das Dasein> la diffrence des 2 premiers principes de lentendement pur; il ne sagit donc pas
de dterminer la synthse de lintuition empirique des phnomnes. La manire dont quelque
chose est apprhend dans le phnomne peut tre dtermine a priori de telle faon que la rgle de sa synthse
puisse fournir cette intuition a priori dans chaque exemple empirique donn, cest--dire la [cette intuition] raliser
dans cette synthse mme. (CRPu, Bar 217.2.4-9) Mais quand il sagit de lexistence dun phnomne, une telle
dtermination a priori de son intuition empirique nest pas possible; on ne peut anticiper ce par quoi lintuition
empirique dune existence se distingue de dautres.
Explication de ce que sont une analogie et un postulat, dans le cadre o lon oppose les principes
dynamiques aux principes mathmatiques qui ont t exposs prcdemment.
b)
216.2
c)
216.3-
217.1
d)
217.2
e)
217.3-
218.1
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
100
PREMIRE CARACTRISTIQUE : Lanalogie, en tant que principe dynamique, concerne les rapports
dexistence entre phnomnes et ce premier titre est un principe rgulateur.
Kant rappelle dabord que la diffrence entre principes mathmatiques et principes dynamiques utilise ou
comporte la diffrence entre principes constitutifs et principes rgulateurs.
Les principes mathmatiques taient constitutifs en ce quils se rapportaient aux phnomnes du point
de vue de leur simple possibilit et nous enseignaient comment ces phnomnes peuvent tre produits
suivant les rgles dune synthse mathmatique, soit quant leur intuition [selon les axiomes de
lintuition], soit quant au rel de leur perception [selon les anticipations de la perception]. (CRPu, Bar
217.3.3-8).
Les principes dynamiques, en revanche, concernent, non la simple possibilit des phnomnes mais leur
existence; comme celle-ci ne se laisse pas construire, les rgles auxquelles elle peut tre soumise a priori
ne concernent que le rapport dexistence [] il sagit seulement, quand une perception nous est donne
dans un rapport de temps avec une autre (qui reste indtermine), de dire, non pas quelle est cette autre
perception et quelle en est la grandeur, mais comment elle est ncessairement lie la premire, quant
lexistence, dans ce mode du temps. (CRPu, Bar 218.1.1-10) ce titre les principes dynamiques sont
des principes rgulateurs.
DEUXIME CARACTRISTIQUE : Lanalogie, en tant que rgle, indique comment chercher dans
lexprience (un terme satisfaisant certains rapports} et un signe pour ly dcouvrir (CRPu, Bar 218.1.20-22)
et ce deuxime titre, elle est un principe rgulateur.
lanalogie, en philosophie: elle est lgalit de deux rapports, non de quantit, mais de qualit : trois
membres tant donns, je ne puis connatre et donner a priori que le rapport un quatrime, mais non ce
quatrime membre lui-mme; jai seulement une rgle pour le chercher dans lexprience, et un signe
pour ly dcouvrir. (CRPu, Bar 218.1.17-22) Par cette caractristique, lanalogie, en philosophie
contraste avec lanalogie en mathmatiques, laquelle est une galit entre deux rapports de grandeurs,
galit telle que, trois termes tant donns, de mme que le rapport de deux dentre eux, on peut identifier
le quatrime terme qui entretiendra le mme rapport avec le troisime donn.
Observons, avec Philonenko, que le En philosophie (218.1.10) de Kant, signifie en philosophie
naturelle, cest--dire en physique, si on rend lide en langage contemporain.
plus spcifiquement: Une analogie de lexprience nest donc quune rgle suivant laquelle lunit de
lexprience (non la perception elle-mme, comme intuition empirique en gnral) doit rsulter de
perceptions (CRPu, Bar 218.1.22-25). Elle dirige donc nos propres facults dans la recherche des
phnomnes et dans le processus de lunification de notre exprience.
TROISIME CARACTRISTIQUE : Cest simplement comme principes de lusage empirique de
lentendement, et non de son usage transcendantal, que ces analogies ont leur signification et leur valeur;
do il suit que les phnomnes ne doivent pas tre subsums sous les catgories en gnral, mais seulement
sous leurs schmes. (CRPu, Bar 218.f.f-219.1.2)
Cette caractristique vaut pour tous les principes synthtiques purs de lentendement (les PSPE). Et la
dmonstration de Kant est trs claire ce sujet. La thse cite linstant est dmontre comme suit:
(Maj) Les principes ne peuvent donc avoir pour but que les conditions de lunit de la connaissance
empirique dans la synthse des phnomnes [accentuation en gras due NL]
= nous cherchons des principes de lusage empirique de lentendement et non de son usage
transcendantal
= les objets auxquels les principes doivent tre rapports [] ne sont que des phnomnes
(219.1.3-6)
= lexprience possible nest que la connaissance parfaite de ces phnomnes (219.1.6-7
accentuation en gras due NL).
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
101
(Min) Or cette synthse nest conue que dans le schme du concept pur de lentendement
219.1.12-13 accentuation en gras due NL)
= elle peut tre conue soit dans le concept pur de lentendement, soit dans son schme
= or, elle ne peut tre conue dans le concept pur de lentendement
> puisque lunit de ce dernier, en tant que celle dune synthse en gnral, se trouve
dans la catgorie [o elle est opre] par une fonction qui nest restreinte par aucune
condition sensible. (219.1.m11-9 accentuation en gras due NL)
Mme si la prsence des schmes dans lnonc des PSPE est une caractristique commune aux 4 sortes
de principes (axiomes, anticipations, analogies, postulats), Kant semble vouloir en tirer une connotation
spciale pour le terme analogie qui dsigne seulement la troisime sorte de principes: Nous serons
donc autoriss par ces principes [tous les PSPE ou seulement les analogies?] nassocier les phnomnes
que par analogie avec lunit logique et gnrale des concepts et, par consquent, (CRPu, Bar
219.1.m9-6, accentuation en gras due NL)
QUATRIME CARACTRISTIQUE (drive de la conjonction des deuxime et troisime prcdentes).
Chaque analogie de lexprience fait correspondre la relation exprime dans la catgorie (de relation) une
relation exprime dans les termes du schme de ladite relation. Chaque analogie est une structure quatre
termes et on a trois telles structures. Le principe gnral en est: La catgorie est la conscience pure comme
le schme est la conscience empirique; ou encore: la catgorie est lunit de la synthse en gnral comme
le schme est lunit de la synthse empirique.
Analyse de la formule Premier rapport = Deuxime rapport
servant de nom au principe:
Principe de
Exprime lunit logique
et gnrale des concepts
selon la catgorie
Exprime lassociation des
phnomnes par analogie avec le
premier rapport
Schme (en tant
que condition
restrictive)
Catgorie Sert penser le principe
mme
Sert dans lexcution du principe,
c.--d. dans son application aux
phnomnes
La
permanence de la substance
Substance
Le X qui persiste au milieu du
changement *
Accidents Ce qui change dans les
phnomnes
la succession suivant la loi
Cause
Le X qui prcde selon une rgle
ncessaire ce qui arrive
dans le temps de la causalit
Effet Ce qui arrive
la
simultanit
suivant la loi de
laction rciproque
Le rapport de laction r-
ciproque entre substances
Le rapport entre choses simultanes
en tant quelles existent en un seul
et mme temps
* La saisie de quelque divers comme un vnement ne dtermine pas sa cause mais seulement quil a
ncessairement un rapport un tat antrieur comme un corrlatif, mais indtermin encore (CRPu, Bar
231.1.m6-5). Selon cette citation, le quatrime terme de lanalogie est bien celui appel jouer la fonction de cause
dans la synthse en cours; mais il nest sans doute pas exclu que la relation se fasse dans lautre sens et que le X
cherch soit appel jouer la fonction deffet, comme je le suppose dans la reconstitution du processus de prdiction
dans le deuxime tableau prsent ci-dessous.
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
102
Note dexgse. Dans le tableau ci-dessus, je risque une interprtation des deux articulations conceptuelles faites par
Kant dans la phrase finale de lintroduction aux Analogies de lexprience: Nous serons donc autoriss par ces
principes nassocier les phnomnes que par analogie avec lunit logique et gnrale des concepts et par
consquent, nous servir, dans le principe mme, de la catgorie; mais dans lexcution (dans lapplication aux
phnomnes) nous substituerons au principe le schme de la catgorie, comme tant la clef de son usage, ou plutt
nous placerons ct delle ce schme comme condition restrictive, sous le nom de formule du principe. (CRPu,
Bar 219.1.8f). Les deux articulations concernes sont:
1. le principe mme versus son excution, son application aux phnomnes;
2. le principe versus la formule du principe.
Sous toute rserve, je propose que lexpression sous le nom de formule du principe dsigne les syntagmes
nominaux au moyen desquels Kant nomme les principes avant de les noncer. Cette interprtation fonctionne
minimalement dans la mesure o les syntagmes concerns comportent tous, effectivement, la mention du schme
ct de la mention de la relation catgoriale correspondante. Cependant, il est curieux que ces appellations soient des
ajouts de la deuxime dition (places dailleurs en sous-titres dans ldition de Weischedel) et que la phrase
alambique que nous cherchons interprter soit de la premire dition. Il faut dire aussi que la traduction de Barni
est ici plutt embarrasse (Fin de la note dexgse.)
Philonenko tente lui aussi de reconstituer une analogie de manire montrer les deux rapports impliqus et
dterminer le quatrime terme. Ainsi, il explique lanalogie 2 dans les termes suivants:
[] supposons donn un rapport entre le mouvement rgulier dune plante, la loi de la gravitation,
et une perturbation du mouvement rgulier, elle-mme dtermine. Trouver la cause de lcart, cest
montrer quelle est la quatrime proportionnelle en indiquant ce quelque chose qui est par rapport
la perturbation comme la loi est par rapport au mouvement rgulier. Ainsi sest ralise la
dcouverte de Neptune par lastronome Galle daprs les calculs faits par Leverrier / pour expliquer
les perturbations dUranus (J. VUILLEMIN, Physique et mtaphysique kantiennes, Paris, 1955, p.
338).
(Phi, OK I 203-204)
Daprs ce passage, Philonenko reconstitue les quatre termes de lanalogie de la faon suivante:
Loi de la gravitation
universelle
X = Neptune, cause de la
perturbation dUranus
Mouvement rgulier
dune plante
Perturbation du
mouvement dUranus
Utilisant la terminologie du modle hypothtico-dductif de lexplication par une loi, je reconstitue lanalogie 2
dune faon lgrement diffrente; je considre la loi elle-mme comme tant le rapport qui se retrouve le mme
dun cas lautre (plutt que de considrer la loi comme une cause, et comme un des termes de lanalogie, ainsi que
Philonenko semble le faire dans sa reconstitution).
Conditions initiales 1 Conditions initiales 2
X = Neptune
Conditions initiales 3
Loi Loi Loi
Effets raliss 1
Mouvement rgulier
dune plante
Effets raliss 2 (connus
avant leur cause) : Le
mouvement dUranus est
perturb
Effets 3 prdits
( dterminer partir
des conditions initiales)
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
103
Cas de la dcouverte de la
cause
Cas de la prdiction de
leffet
Postulat. La distinction entre principes constitutifs et principes rgulateurs, Kant lapplique aux postulats de
la pense empirique aussi bien quaux analogies de lexprience. Cest ce quil commence dire en 218.1.m11: Il
en est de mme des postulats de la pense empirique en gnral, mais il remet beaucoup plus tard, soit CRPu,
Bar 257.2.m12 une explication de ce quil faut entendre par postulat, dans ce contexte.
La premire analogie de lexprience Le principe de la permanence de la substance (CRPu, Bar 219) (Phi,
OK I 205)
POSITION DU PROBLME. Le problme est celui que jappellerais problme de la possibilit de la
construction de lobjet, partir de la constatation dun cart flagrant entre ce que fournit lapprhension simple et
ce que nous croyons concernant la nature dun objet quelconque.
a) La question initiale: [C]onsidrons, comme le remarque Kant, que notre apprhension du divers des
phnomnes est toujours successive et par consquent changeante. (CRPu, Bar 220.2.1-2) Comment
partant de cette apprhension toujours changeante parvenons-nous poser un objet, qui dpasse la simple
multiplicit donne dans lapprhension? (Phi, OK I 206.1.6.12)
b) La nature de lcart: En fait lorsque nous parlons dun objet, nous prtendons savoir plus que nous ne
sommes capables de voir; nous prsupposons que lobjet est plus que ce quil donne de lui-mme, ou,
si lon prfre, quil nest pas exactement limit ce que nos perceptions nous en donnent. Bien plus! le
changement des reprsentations possde au moins deux raisons: lune psychologique et qui est relative
aux fluctuations de mon sens interne et de mon attention lautre physique et qui est propre lobjet.
(Phi, OK I 206.1.12-22)
c) Les 3 croyances qui en rsultent et qui sont justifier: 1 lobjet possde une unit et il est plus que sa
simple reprsentation immdiate 2 les modifications du sens interne ne sont pas des modifications de
lobjet 3 la conscience des modifications de lobjet ne soppose pas la connaissance de lobjet et on
peut toujours distinguer les modifications du sens interne des modifications objectives. (Phi, OK I
206.1.22-m1)
LE PRINCIPE DE LA PERMANENCE DE LA SUBSTANCE. La rponse kantienne ce problme est une sorte
de substantialisation du temps. Cest le temps qui est la vraie substance transcendantale. (Phi, OK I 207.1.m7-6)
NONC DU PRINCIPE : La substance persiste au milieu du changement de tous les phnomnes, et
sa quantit naugmente ni ne diminue dans la nature. (CRPu, Bar 219.2)
cest la catgorie de la relation substance-accident, en tant que schmatise dans le schme de la
permanence qui rend le temps unifi et identique lui-mme. le temps [] o doit tre pens tout
changement des phnomnes demeure, et ne change pas (CRPu, Bar 219.3.m4-2)
la preuve du principe de permanence est donne, sous lintitul PREUVE, dans lalina CRPu, Bar
219.3.1-220.1.f. Cet alina constitue un rsum-synthse des thses de la premire analogie et fut ajout
lors de la seconde dition, en remplacement dun paragraphe de cinq lignes.
Philonenko la dtaille ainsi. Pour rapporter les phnomnes au temps comme permanence, il faut
parvenir une reprsentation permanente du temps laquelle est obtenue de la manire suivante:
ce qui va reprsenter le temps comme un et identique, cest le monde des phnomnes dans sa
totalit (Phi, OK I 208.1.14-15)
cette totalit conserve le mme quantum de matire travers tous les changements;
la matire prise comme totalit reprsente donc la permanence;
la permanence est le schme de la substance;
la matire est lintuition qui remplit le concept pur de substance.
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
104
[nonc du rsultat densemble de la dmonstration:] [la matire] est lensemble des phnomnes
considrs comme une nature constante daprs des lois [rf. CRPu, Bar 253.2] qui nous fournit le
substratum de la reprsentation du temps comme quantum permanent []. On comprend ainsi
comment nous tablissons ici aussi un concept synthtique: Puisquon appelle substance ce qui
subsiste comme sujet des modifications et des relations, cest une vrit analytique que daffirmer
que ce permanent est ncessairement reprsent au moyen du concept de substance. Pour dterminer
des relations dexistence dans le temps, il est donc ncessaire de poser dabord un objet spatial
comme substance permanente: il sagit alors dune proposition synthtique, puisque nous ne nous
contentons pas de dire que la substance est permanente, mais que nous disons que la substance
permanente est ncessairement prsente dans lexprience constitue en connaissance objective. (B.
ROUSSET, La doctrine kantienne de lobjectivit, p. 240) (Phi, OK I 208.1.m6-209.1.f)
Philonenko ajoute cet expos trois remarques intressantes:
1- Les systmes physiques. Puisque nous ne pouvons saisir la nature elle-mme comme substance (la
totalit des phnomnes ntant quune ide de la raison), nous devons choisir des substituts de la nature
des systmes physiques relativement clos qui nous fourniront des lments invariants, partir
desquels nous pourrons mesurer le temps (Cf. J. VUILLEMIN, Physique et mtaphysique kantiennes,
Paris, 1955, pp. 283-284). Ces systmes physiques sont les substances phnomnales. Ce quil y a de
commun entre ces systmes et la nature elle-mme, cest quils sont considrs comme constants et
mesurables comme des quantums de matire []. Grce eux lexistence obtient dans les diffrentes
parties successives de la srie du temps une quantit que lon nomme dure. (CRPu, Bar 221.1.2-4)
(Phi, OK I 209.2)
2- La substance comme relation didentit. La substance, dans ce cadre conceptuel, est une relation
didentit en ce sens quelle est identique la totalit de ses accidents. Au lieu dtre sous les
phnomnes, elle lensemble dun systme de phnomnes, caractris par linvariant qui est la quantit
de matire (Phi, OK I 210.1.1.-3). Cest ce lien troit qui occasionne les allures paradoxales que peuvent
prendre nos expressions, lorsque nous dcrivons le changement; Kant mentionne: on peut dire, au risque
demployer une expression en apparence quelque peu paradoxale, que seul le permanent (la substance)
change et que le permanent nprouve pas de changement, mais une variation (CRPu, Bar 223..2.m6-2).
La traduction de Barni est ici bien mdiocre. La rfrence lallemand est presque ncessaire:
Daher ist alles, was sich verndert , bleibend, und nur sein Zustand wechselt. Da dieser
Wechsel also nur die Bestimmungen trifft, die aufhren oder auch anheben knnen: so knnen wir,
in einem etwas paradox scheinenden Ausdruck, sagen: nur das Beharrliche (die Substanz) wird
verndert, das Wandelbare erleidet keine Vernderung, sondern einen Wechsel , da einige
Bestimmungen aufhren, und andre anheben. (Weischedel vol. III, 224.3-225.1) Les mots en
caractres gras sont mis en relief par moi, pour montrer ce que la traduction a de la difficult
rendre.
3- La pluralit des substances va tre entrine et utilise comme fondement de la troisime analogie; elle
y sera dfinie par laction rciproque, la causalit rciproque. Le rapport de communaut nest que la
synthse de la notion de substance et de la notion de causalit. (Phi, OK I 211.1.2-4)
Problme poursuivre: examiner si la reconstitution donne par Philonenko correspond au
schma suivant.
Perception 1
(rapport 1, un
moment t
1
antrieur
t
2
)
Perception 2
(rapport 2, un
moment t
2
postrieur
t
1
)
substance
permanence
substance
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
105
tat 1 (antrieur)
transformation
tat 2 (postrieur)
Jai tent, pour ma part, la reprsentation suivante de la structure conceptuelle de la premire analogie de
lexprience.
tat 1 (antrieur) tat 1 (antrieur)
transformations
SUBSTANCE
selon laxe du temps
tat 1 (postrieur) tat 2 (postrieur)
Dans cette reprsentation, la dimension horizontale nest pas oriente et reprsente la totalit des cas du monde; elle
reprsente lexistence du constant et du permanent, laquelle rend possible la diffrenciation des tats, cest--dire la
multiplicit des transformations possibles de ce qui peut inhrer une substance.
La deuxime analogie de lexprience Le principe de la succession dans le temps suivant la loi de la
causalit (CRPu, Bar 224)
Lexpos de la deuxime analogie commence par rappeler le principe (prcdent) de la permanence en le
formulant ainsi: tout changement dtat (succession) des phnomnes nest que changement. Changement
dtat traduit Wechsel et changement tout court traduit Vernderung. Voici un schma pour aider
concevoir les deux relations:
Substance
+
tat 1
Relation de changement
Vernderung
Substance
+
tat 2
Substance
tat 1
Relation de changement
dtat
Wechsel
tat 2
Le rsultat de la premire analogie dont Kant a besoin pour tablir la deuxime est:
Tous les phnomnes de la succession dans le temps <Erscheinungen der Zeitfolge insgesamt> ne
sont que des changements.
(CRPu, Bar 224.4.1-3)
Ce quil sagit dcarter, cest lapparition et la disparition de substances.
NONC DE LA DEUXIME ANALOGIE : Tous les changements arrivent suivant la loi de la liaison des effets
et des causes. (CRPu, Bar 224.4)
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
106
Largumentation qui rsume la dmarche de preuve de la deuxime analogie est donne en 225.2 ce sont
des alinas ajouts lors de la 2
e
dition. Le dtail de la dmarche de preuve recommence son dbut avec 225.3:
Lapprhension du divers dans le phnomne. On peut donc, pour faire la reconstitution de la dmarche,
commencer avec 225.3; on reviendra au rsum [225.2] la fin.
PREMIRE TAPE DE LA DMARCHE DE PREUVE DE LA DEUXIME ANALOGIE:
RSOUDRE LE PROBLME DE LA DOUBLE SUCCESSION
[CRPu, Bar 225.2-229.2]
On peut considrer deux types de succession du divers offert la perception:
la succession objective, dans lobjet.
la succession subjective de lapprhension
Je naperois ce doublet que si je distingue
objet
phnomne dsignant un objet
ou encore (cest une distinction quivalente)
ce quil y a de divers dans les phnomnes eux-mmes
la reprsentation de ce divers [] dans lapprhension (CRPu, Bar 226.1.27-29)
Le problme snonce ainsi: laquelle de ces deux successions dtermine lautre? Ou encore: sur quoi me baser
pour connatre le rapport de temps (des phnomnes, des tats) dans lobjet (CRPu, Bar 226.1.3; 228.2.6;
232.3.m6)
Kant montre quil nest pas suffisant davoir conscience dune succession de nos reprsentations
pour tre assur de connatre si et comment des choses se succdent dans lobjet
et quil faut
montrer quelle liaison convient dans le temps ce quil y a de divers dans les phnomnes eux-
mmes, alors mme que la reprsentation de ce divers est toujours successive dans lapprhension
(CRPu, Bar 226.1.26-30).
Exemple de la maison.
Kant formule le problme ainsi: il sagit de trouver une rgle laquelle serait soumise
lapprhension. Il a t tabli en [225.3.1-226.1.23] quil faut distinguer entre objet et
reprsentation de lobjet dans lapprhension.
Explication de 227.1.2-f.
Pour que je puisse distinguer le phnomne maison des reprsentations que jen ai dans lapprhension, et
pour quun accord soit possible entre le concept (maison) que je tire de mes reprsentations et lobjet lui-mme
cet accord tant requis, ne ft-ce qu titre de condition formelle, par la notion de vrit empirique dun jugement,
dune connaissance , il faut trouver une rgle:
telle que cette apprhension puisse tre distingue de toute autre (elle doit tre individue)
et qui fournisse un moyen de lier (selon une liaison ncessaire, et non seulement arbitrairement) le divers
que contient cette apprhension.
Il faut, en dautres mots, que la rgle me permette de dterminer cette apprhension comme tant lapprhension
dune maison (et non pas lapprhension dun puits, du beau temps, des arbres avoisinants); peut-tre mme de
dterminer quil sagit de lapprhension de cette maison plutt que de telle autre.
Il sagit de faire voir
1.1
225.3.1-
227.1.2
1.2
227.1.2-f
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
107
que je nai pas encore une telle rgle dans la seule apprhension; jai diverses faons dordonner les
diverses reprsentations que jai de la maison
mais que cest bien dans lobjet que se trouvera la condition de cette rgle ncessaire: CE QUI DANS LE
PHNOMNE CONTIENT LA CONDITION DE CETTE RGLE NCESSAIRE DE LAPPRHENSION EST
LOBJET. (CRPu, Bar 227.1.3f)
Observons que jusquici le mot cause na pas encore t utilis.
Kant dcrit en dtail la manire dont nous apprhendons ce qui arrive <was geschieht>,
explique ainsi la notion dvnement <Begebenheit> et fait ressortir les conditions de la
reprsentation que nous nous faisons de la succession.
a) ds le dpart, Kant utilise le rsultat de la premire analogie pour carter la possibilit quon peroive la
naissance absolue dune chose ou dun tat, cest--dire la naissance dun tat en labsence dun
phnomne qui contenait cet tat. Voir CRPu, Bar 227.2.1-8.
[] une ralit qui succde un temps vide, par consquent un commencement que ne prcde
aucun tat de choses, ne peut pas plus tre apprhend par moi que le temps vide lui-mme. Toute
apprhension dun vnement est donc une perception qui succde une autre.
(CRPu, Bar 227.2.5-10)
b) [227.2.13-228.2.f] Une fois tabli que lvnement implique ncessairement une succession dtats (et non
une cration dtats), Kant tablit la distinction entre
le cas o je ne fais pas la diffrence entre lordre attribuable mes reprsentations et lordre attribuable
lobjet de mes reprsentations cest le cas signal par lexemple de la maison;
et le cas o je fais cette diffrence: lordre de la srie des perceptions qui se succdent dans
lapprhension est [] dtermin, et elle-mme [lapprhension] en dpend. (CRPu, Bar 227.2.m10-8)
la diffrence de ce qui se passait avec les diverses reprsentations de la maison, dans lexemple ci-
dessus, cet ordre ne peut tre autrement. Cest lexemple du bateau.
Quand quelque chose arrive, la succession des tats du divers rend ncessaire lordre des perceptions
(dans lapprhension du phnomne) (CRPu, Bar 228.2.3f). Nous avons donc une rgle pour ce qui
concerne la succession subjective.
c) Kant en tire la distinction entre la succession objective et la succession subjective.
d) [228.3-229.2] Kant donne maintenant une interprtation transcendantale la succession objective. Ce qui
explique notre incapacit renverser lordre de la succession objective et donc notre capacit de percevoir
quelque chose qui arrive, cest que nous concevons cette relation comme une relation de condition
conditionn. (Note: cette ide est reprise telle quelle en 231.1.9-14.)
Puis donc que cest quelque chose qui suit, il faut ncessairement que je le rapporte quelque chose
dautre qui prcde et de quoi il suit selon une rgle, cest--dire ncessairement, de telle sorte que
lvnement, comme conditionn, nous renvoie srement quelque condition qui le dtermine.
(CRPu, Bar 228.3.6f)
Cest donc toujours eu gard une rgle daprs laquelle les phnomnes sont dtermins dans leur
succession, cest--dire tels quils arrivent, par ltat antrieur, que je donne ma synthse
subjective (de lapprhension) une valeur objective, et ce nest que sous cette supposition quest
possible lexprience mme de quelque chose qui arrive.
(CRPu, Bar 229.2.7f)
Toute cette argumentation est reprise partir de 230.2.
Observations:
1. Le mot cause nest pas encore utilis. Cependant, le mot cause est utilis dans le commentaire
229.3.1-m4 concernant la thorie inductiviste de la cause, thorie qui soppose la prsente.
2. Tout vnement est peru-conu comme SUIVANT dun autre. La relation va en remontant.
1.3
227.2
230.1
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
108
3. La relation de dtermination va de lobjet lapprhension; une autre dtermination va dun tat
antrieur du phnomne un tat postrieur (CRPu, Bar 229.2.m5-4)
4. Le raisonnement kantien se fait encore une fois sous la forme du raisonnement partir de la
condition de possibilit
Il faut P pour que Q soit possible
or Q
donc P
FORMULATION TYPIQUE: ce nest que sous cette supposition quest possible lexprience mme
de quelque chose qui arrive (CRPu, Bar 229.2.3f).
Kant va maintenant gnraliser pour montrer le caractre ncessaire du principe de raison
suffisante. La thse est que nous ne pourrions mme pas nous reprsenter une succession dans
lobjet (CRPu, Bar 230.2.f) si nous nutilisions pas ce principe comme rgle pour dterminer
notre apprhension (cest--dire lordre de nos perceptions dans lapprhension).
La formulation que le temps qui prcde dtermine ncessairement celui qui suit (CRPu, Bar 231.2.3-4) est
donne
comme loi ncessaire de notre sensibilit (231.2.1). En tant que telle, elle concerne laspect subjectif,
elle constitue la condition formelle de toutes nos perceptions.
comme loi essentielle de la reprsentation empirique de la succession dans le temps. (231.2.5-6) En
tant que telle, la loi semble concerner la succession dans lobjet; elle concerne le phnomne comme
dtermin dans le temps quant sa place, et par consquent comme un objet qui peut toujours tre trouv
suivant une rgle dans lenchanement des perceptions (CRPu, Bar 232.2.3-6).
Autre formulation de la loi de la reprsentation empirique de la succession dans le temps, appele cette fois
principe de la raison suffisante:
[] la condition qui fait que lvnement suit toujours (cest--dire dune manire ncessaire) se
trouve dans ce qui prcde.
(CRPu, Bar 232.2.m6-4)
Noter la formulation la continuit dans lenchanement (CRPu, Bar 231.2.m2). Cette affirmation de la
continuit sera reprise plus explicitement plus loin, mais dans un vocabulaire de mathmatique infinitsimale. Voir
237.2.
Rsum ( nouveau) de la preuve du principe de la raison suffisante.
DEUXIME TAPE DE LA DMARCHE DE PREUVE DE LA DEUXIME ANALOGIE:
RSOUDRE LE PROBLME DE LA CAUSALIT SANS SUCCESSION APPARENTE
[CRPu, Bar 233.2-234.2]
Ce deuxime problme peut sappeler galement le problme de LAPPLICABILIT DU PRINCIPE DE
CAUSALIT LA SIMULTANIT DES PHNOMNES, cest--dire au cas o la cause et leffet sont simultans.
La solution du problme consiste distinguer entre lordre du temps et le cours du temps. (CRPu, Bar
233.2.m4-3)
a) Le temps entre la causalit de la cause et son effet immdiat peut svanouir [], mais le rapport de lun
lautre reste toujours dterminable dans le temps. (CRPu, Bar 233.2.m2-234.1.3)
1.4
230.2-
232.2
1.5
232.3-
233.1
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
109
b) La succession reste lunique critrium empirique de leffet dans son rapport avec la causalit de la cause qui
prcde. (CRPu, Bar 234.2.1-4)
c) On peut lier la thorie de laction, qui va suivre, la solution du problme de la causalit sans succession
apparente de la manire suivante:
si lon dporte la relation de succession sur les effets (dans le diagramme C = cause; E = effet)
C
E1 >succession> E2
au lieu de la voir entre la cause et leffet
C >successi on> E
la thorisation de la relation causale en vient intgrer une thorie de la relation daction [Handlung]. On
pourrait considrer que le fait de concevoir la substance comme dernier sujet (235.1.8) de leffet, ou
comme premier sujet de la causalit (235.1.m6) est une manire de distinguer la cause et leffet en
labsence de succession. Mais ce nest pas pour rsoudre le problme de labsence apparente de succession
que Kant introduit la thorie de laction. Son problme est plutt de savoir si laction est un critre de la
substance; et ce problme prsuppose des relations de succession temporelle du fait quil utilise la notion de
changement.
TROISIME TAPE DE LA DMARCHE DE PREUVE DE LA DEUXIME ANALOGIE:
RSOUDRE LE PROBLME DE SAVOIR
SI LACTION EST UN CRITRIUM EMPIRIQUE DE LA SUBSTANCE
[CRPu, Bar 234.3-236.1]
Kant
admet que laction est un critrium empirique suffisant pour prouver la substantialit (CRPu, Bar
235.1.m12-10)
introduit le concept dune substance comme phnomne (235.1.2f)
carte la possibilit dune cration parmi les phnomnes.
QUATRIME TAPE DE LA DMARCHE DE PREUVE DE LA DEUXIME ANALOGIE:
RSOUDRE LE PROBLME DE LA FORME DU PASSAGE ENTRE TATS OPPOSS SUCCESSIFS
[CRPu, Bar 236.2-238.2]
Ce problme est pos en termes seulement de conditions formelles du changement (236.2.m7), et non en
termes de forces. (Note: la notion de changement est plus gnrale que celle dvnement.)
Kant utilise ici comme prmisse Tout changement a une cause, en 236.4.m2, pour arriver la proposition:
cette cause ne produit pas son changement tout dun coup (en une fois et en un moment) mais dans le temps, de
telle sorte que (CRPu, Bar 237.1.1-7).
La thse qui rsulte de ces raisonnements est celle de la continuit de tout changement (CRPu, Bar
237.1.5f; 237.2.1-6).
On trouve une formulation intressante des trois analogies en CRPu, Bar 242.3.m3-243.1.4.
La troisime analogie de lexprience Le principe de la simultanit suivant la loi de laction rciproque ou
de la communaut (CRPu, Bar 238)
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
110
nonc du principe : Toutes les substances, en tant quelles peuvent tre perues comme simultanes dans lespace,
sont dans une action rciproque universelle. (CRPu, Bar 238.3)
4.3.3.3.2 Les postulats de la pense empirique
La signification du terme postulat:
en mathmatiques: la synthse par laquelle nous nous donnons dabord un objet et en produisons le
concept (CRPu, Bar 257.2.m12-9)
ainsi nous nous donnons dans les 3 postulats de la pense empirique
un objet possible
un objet rel
un objet ncessaire
RFUTATION DE LIDALISME
Thse: La simple conscience, mais empiriquement dtermine, de ma propre existence, prouve lexistence des
objets extrieurs dans lespace.
Donn: Jai conscience de mon existence comme dtermine dans le temps.
Majeure: Ma conscience de mon existence dans le temps est ncessairement lie la conscience de la
possibilit de cette dtermination du temps.
Mineure: Or la dtermination de mon existence dans le temps nest possible que par lexistence de choses
relles que je perois hors de moi.
Maj Toute dtermination du temps suppose quelque chose de permanent dans la perception.
Min Or [A] la perception de ce permanent nest possible que par une chose existant hors de moi
et [B] pas seulement par la reprsentation dune chose extrieure moi.
[Formulation alternative du deuxime membre de phrase ci-dessus: ] Ce permanent ne peut
tre une intuition en moi.
[Justification de B: ]
Maj Je nai en moi pas dautres principes de dtermination de mon existence que des
reprsentations
Min Or les reprsentations ont besoin de quelque chose de permanent, distinct delles, et par
rapport quoi leur changement puisse tre dtermin (CRPu, Bar 250.1.3-f)
La mineure de ce raisonnement est typiquement kantienne et clbre. Pourrait-on la reformuler ainsi: Cest
seulement la condition que soit possible pour moi une exprience extrieure que devient possible son tour mon
exprience intrieure en tant que sujet dont lexistence est dtermine dans le temps. Ou encore: il faut que des
intuitions maient t donnes dans le sens externe pour que me soit donne lintuition de moi-mme dans le sens
interne. [Lexpression lintuition de moi-mme se trouve en CRPu, Bar 343.2.9-10; on trouve l galement, dans
les 4 dernires lignes: mon intuition intrieure (en tant que le divers quelle contient peut tre li conformment la
condition gnrale de lunit de laperception dans la pense); mais cette dernire formulation dsigne seulement le
moi dterminable (pas encore le moi dtermin), dans un contexte o il est contrast au moi dterminant.] Ces
deux formulations naffirment peut-tre pas avec assez de force lexistence des choses en tant que distincte des
reprsentations que je peux en avoir.
Cette thse concernant la condition de possibilit de la dtermination de mon existence dans le temps
reviendra dans la rfutation des paralogismes psychologiques; dans ce contexte, elle fera contraste avec la thse
affirmant que dans la reprsentation je pense de laperception transcendantale, je nai pas conscience de mon
existence comme dtermine dans le temps. Ce sera une des difficults de la thorie du sujet transcendantal:
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
111
concevoir le je pense sous la forme jexiste pensant tout en soutenant que mon existence ainsi affirme reste
compltement indtermine.
La rfutation de lidalisme peut galement tre reconstitue sous la forme dune drivation linaire comme
en logique des propositions. (Le signe est limplication matrielle; le terme de droite est lu ici comme une
condition ncessaire du terme de gauche; la condition de possibilit est considre ici par convention comme une
condition ncessaire. Et on convient que le je de la dmonstration vaut pour tout sujet, de sorte quon na pas
expliciter une infrence qui irait dune affirmation faite pour tout sujet une affirmation faite pour je.)
Propositions # Propositions symbolises Justification
Jai conscience de mon existence comme dtermine
dans le temps. [DTj pour Jexiste comme
dtermin dans le temps]
1 C(DTj) Donne
Description des relations transcendantales indpendantes de la conscience que jen ai:
Toute dtermination du temps (DTj) suppose quelque
chose de permanent dans la perception, cest--dire
que je perois (P) quelque chose de permanent (Pjp)
2 DTj Pjp Thorme de
lesthtique
transcendantale
La perception de ce permanent (Pjp) nest possible que
par une chose existant hors de moi (Xc), pas seulement
par la reprsentation dune chose extrieure moi
3 Pjp Xc Thorme de
lesthtique
transcendantale
La dtermination de mon existence dans le temps nest
possible que par lexistence de choses relles que je
perois hors de moi. [[DTj Xc peut tre lu comme
Lexistence des choses hors de moi est la condition
de [la possibilit de] la dtermination du temps
251.1.m5-4 pour mon existence.]]
4 DTj Xc De 2 & 3, par
transitivit.
Noter que la proposition Xc (Les choses extrieures existent hors de moi) ne peut pas encore tre
asserte pour elle-mme. Elle le serait si DTj avait t pose pour elle-mme, si elle avait t
infre de C(DTj); mais Kant ne souhaite pas considrer la dtermination de mon existence
comme un fait dductible de la conscience que jen ai. Sa thse sera plus forte sil sen tient aux
contenus de conscience et sil montre que cest leur niveau que se fait le lien ncessaire entre la
perception de mon existence et celle des choses extrieures.
Description des contenus de ma conscience
Cette conscience dans le temps est ncessairement lie
() la conscience de la possibilit de cette
dtermination du temps, cest--dire la proposition Q
telle que Q est la condition de possibilit de DTj.
5 C(DTj) C(QDTj Q)
o Q est une variable de
proposition.
Thorme de logique
transcendantale.
La condition (Q) de la possibilit dune dtermination
dune existence dans le temps est quil existe des
choses extrieures, daprs la proposition 4 ci-dessus.
6 Q = Xc Daprs 4.
La conscience de ma propre existence [dtermine
dans le temps] est en mme temps une conscience
immdiate de lexistence dautres choses hors de
moi. (251.1.3f)
7 C(DTj) C(Xc) De 5 et 6
O lon voit que tout le poids de la preuve (onus probandi) repose dabord sur la proposition 5 et, en second lieu, sur
la proposition 4, qui permet de poser 6. La proposition 5 attribue la conscience de soi, en tant que conscience
empirique (donc psychologique?) une capacit de faire la relation transcendantale, cest--dire la relation entre une
chose, voire un tat de choses, et la condition de possibilit de cette chose ou tat de choses. Cette relation qui
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
112
constitue lessence mme de largumentation transcendantale (si y est, et si x est tel que x seul rend possible y, alors
x est) est assurment toujours faite dans la conscience du philosophe critique. Mais est-elle est un attribut de la
conscience en gnral: est-ce que chaque sujet fait entre ses contenus de conscience les relations que lidalisme
transcendantal enjoint ou permet de faire?
Concernant le troisime postulat de la pense empirique [CRPu, Bar 253.2-255.1]
Le troisime postulat se rapporte la ncessit matrielle dans lexistence et non la ncessit purement
formelle et logique dans la liaison des concepts. (CRPu, Bar 253.2.2-4)
Thse: ce nest pas de lexistence des choses (des substances), mais seulement de leur tat que nous pouvons
connatre la ncessit, et cela en vertu des lois empiriques de la causalit, au moyen dautres tats donns dans la
perception. (CRPu, Bar 253.2.m14-10) Le raisonnement qui justifie cette thse a deux prmisses, qui sont
exprimes dans les deux phrases qui prcdent immdiatement lnonc de la thse.
Commentaire. La deuxime prmisse affirme que ce nest pas de lexistence des choses (des substances), mais
seulement de leur tat que nous pouvons connatre la ncessit (253.2.m14-12); on peut aisment rapprocher cette
thse de celle qui, chez les philosophes des sciences contemporains, notamment Popper, affirme que les propositions
de la forme Il existe des x, par exemple Il existe des lectrons, sont des propositions mtaphysiques et non
scientifiques.
Les 4 aspects de la ncessit
(aspects qui ne concernent que les rapports des phnomnes suivant la loi dynamique de la causalit
CRPu, Bar 254.1.2-3)
1. Tout ce qui arrive est hypothtiquement ncessaire, cest--dire ncessaire sous la condition de loccurrence
de lantcdent qui en contient la condition.
In mundo non datur casus (consquence de la deuxime analogie).
2. La ncessit conditionnelle (telle qunonce ci-dessus) soppose la ncessit aveugle.
In mundo non datur fatum. Ce principe appartient aux principes de la modalit.
3. Le principe de la continuit (de lenchanement, de la srie) des phnomnes interdit tout saut.
In mundo non datur saltus. Ce principe concerne la condition de la permanence de la substance; voir
lanalogie 1.
4. Le principe de la continuit interdit galement toute lacune entre deux phnomnes.
In mundo non datur hiatus. Ce principe rsume les arguments contre le vide; le vide nayant pas de degr, il
ne peut tre peru, ne peut donner de la matire la sensation. Voir la premire anticipation de la perception.
Concernant lun ou lautre des postulats de la pense empirique
Remarque critique de Kant concernant la question de savoir si le champ de la possibilit est plus grand que
celui qui contient tout le rel et si celui-ci, son tour est [] plus grand que celui de ce qui est ncessaire.
(255.2.1-3) [255.2-256.2]
a) Interprtation de la question.
La question revient demander si toutes choses, comme phnomnes, appartiennent lensemble et au
contexte dune exprience unique dont toute perception donne est une partie qui ne peut tre lie dautres
phnomnes, ou bien si mes perceptions peuvent appartenir (dans leur enchanement gnral) quelque chose
de plus qu une seule exprience possible (255.2.6-12). Ou encore: Peut-il y avoir dautres perceptions
que celles qui en gnral constituent lensemble de notre exprience possible, et par consquent peut-il y
avoir un tout autre champ de la matire? (CRPu, Bar 255.2.m13-9)
b) Argument montrant que cette question nest pas dcidable du point de vue de lentendement.
Lentendement na affaire qu la synthse de ce qui est donn (255.2.m8) et lexprience est la seule
connaissance o les objets nous sont donns (255.2.m14-13).
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
113
Il serait intressant de confronter ces dclarations celles que contient lAnthropologie dune point
de vue pragmatique concernant limagination cratrice et la Dichtung.
Or, les autres formes de lintuition ou de lentendement auxquelles fait allusion lhypothse dune exprience
diffrente de celle thorise ici nappartiendraient pas lexprience qui nous donne nos objets, supposer
quon parvienne penser ces autres formes ce qui est dj bien douteux.
c) Argument montrant la pauvret des raisonnements prtendant que le champ de la possibilit est plus grand
que le champ du rel.
On peut passer validement de lassertion Tout rel est possible lassertion Quelque possible est rel,
mais rien ne justifie que lon interprte cette dernire assertion comme signifiant il y a beaucoup de possible
qui nest pas rel. En effet, que peut-on ajouter au possible pour quil devienne rel?
La seule chose qui pour mon entendement puisse sajouter laccord avec les conditions formelles
de lexprience, cest sa liaison avec quelque perception; et ce qui est li avec une perception suivant
des lois empiriques est rel, encore quil ne soit pas immdiatement peru. (CRPu, Bar 256.1.6-11)
on ne peut conclure de ce qui est donn, et encore moins conclure sans que quelque chose soit donn,
quil puisse y avoir une tout autre srie de phnomnes, par consquent plus quune exprience
unique comprenant tout (CRPu, Bar 256.1.13-14).
d) Commentaire expliquant pourquoi lhypothse relative au champ de la possibilit relve de la raison (de
lusage dialectique de la raison) et non de lentendement (en son usage empirique).
[] la possibilit absolue (qui est valable tous gards [cest--dire indpendamment de la
possibilit de notre exprience] ) nest pas un simple concept de lentendement [] elle appartient
uniquement la raison []
(CRPu, Bar 256.2.4-7)
4.3.3.4 Vue densemble sur les principes
Je donne la page suivante un tableau qui donne une vue densemble sur les principes de lentendement, en
utilisant pour les caractrisations trois des variables kantiennes:
laspect du phnomne auquel le principe sapplique;
la sorte de synthse qui rsulte de lapplication du principe;
le concept qui constitue le principe dunit de chaque synthse.
Jugement de RIVAUD sur les principes :
Ils ne diffrent pas beaucoup des principes noncs par Leibniz et Christian Wolff. Le monde y
apparat comme un, et cette unit se rattache celle de laperception transcendantale. Les notions
premires que le philosophe vient dnoncer lui semblent a priori; elles rsument les directions
ncessaires de notre pense. Mais Kant les a extraites, en fait, dune analyse des procds de la
recherche scientifique. Elles vont lui servir prcisment rfuter les philosophies, grces [sic]
auxquelles il a pu tablir ces principes.
(HP-Vl, Riv 132.1.8f)
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
114
TABLEAU-SYNTHSE DES PRINCIPES PURS DE LENTENDEMENT
Nom du principe Aspect du donn (ou du
phnomne)
Sorte de synthse Concept (unit de la
synthse)
Axiomes de
lintuition
Forme de lintuition des
phnomnes dans lespace
et le temps
composition de lhomogne de type
AGRGATION (phnomnes
comme agrgats 207.1.6)
le concept de GRANDEUR
EXTENSIVE (de
lintuition)
Anticipations de la
perception
le rel de la sensation
le degr daffection
le rel reprsente
quelque chose dont le
concept implique une
existence (215.2.5-6)
rel de la perception
(217.3.7-8)
composition de lhomogne de type
COALITION
synthse de la production de la
quantit dune sensation depuis son
commencement jusqu une
grandeur quelconque (209.2.m14-
11)
se reprsenter en un moment une
synthse de la gradation uniforme
qui slve de 0 une conscience
empirique donne. (215.2.m12-9)
le concept de GRANDEUR
INTENSIVE (de la
sensation)
Analogies de
lexprience
lexprience en tant
quunit synthtique des
perceptions au sein dune
conscience;
exprience en tant que
connaissance des objets
des sens;
rapport des perceptions
en tant que rapport
dexistence <Verhltnis
des Daseins>
Ces principes nont pour but que
les conditions de lunit de la
connaissance empirique dans la
synthse des phnomnes
(219.1.10-11)
CONNEXION de lhtrogne
le concept de SUBSTANCE
et son corrlat le concept
de CHANGEMENT
(comme variation dtat)
le concept de CAUSE;
le concept dACTION
le concept dINTERAC-
TION, ou dACTION
RCIPROQUE
Postulats de la
pense empirique
en gnral
Najoutent pas des
dterminations lobjet
mais concernent son
rapport avec
lentendement [] , avec
le jugement empirique et
avec la raison (dans son
application lexprien-
ce). (244.4.4f)
Aucune synthse de lobjet. le concept de POSSIBILI-
T de lobjet et laccord
avec les conditions FOR-
MELLES de lexprience.
le concept de RALIT
et laccord avec les
conditions MATRIELLES
de lexprience.
le concept de
NCESSIT et laccord
avec les conditions
GNRALES de
lexprience.
T H M E # 7 . L A N A L Y T I Q U E IV. L E S P R I N C I P E S D Y N A M I Q U E S .
_____________________________________________________________________________________________
115
4.3.4 Chapitre III Du principe de la distinction de tous les objets en gnral en
phnomnes et en noumnes
Sommaire des pages 272.3-279.2
Lopposition entre phnomnes et noumnes: 275.1.7-m4
Thse: ce que nous appelons noumne ne doit tre entendu quau sens ngatif (CRPu, Bar
276.1.2f)
Les dfinitions de noumne au sens ngatif et noumne au sens positif sont donnes en
275.3.
277.2 Le concept de noumne est un concept problmatique
non contradictoire
limitatif; ncessaire par cette fonction de limitation
Lentendement stend problmatiquement.
277.3-279.1 Est-ce que le noumne est un objet intelligible (CRPu, Bar 278.1.8)?
Non, nest pas un objet intelligible pour notre entendement.
Un entendement auquel il appartiendrait est un problme.
279.2 Explication de la formule les objets tels quils apparaissent, et [] tels quils sont.
4.4 Synthse de la thorie de la connaissance contenue dans lEsthtique et
lAnalytique
Les aspects respectivement mtaphysique et transcendantal de la thorie de la connaissance dveloppe dans la
Critique de la raison pure.
Dans ces questions le mot de possibilit [] signifie lessence. Donc la question: Comment la
mathmatique pure est-elle possible? signifie: Quelle est lessence de la mathmatique pure? Et puisque la
philosophie transcendantale sinterroge sur le rel objectif, [] sa question est: Quelle est lessence du rel?
lessence tant ce qui rend possible le rel, ce qui fonde la ralit. (Phi, OK I 109.1.1-11)
Linterrogation sur lessence est elle-mme double: elle est mtaphysique dune part et
transcendantale dautre part. Elle est mtaphysique dans la mesure o elle dgage lessence, ou si
lon prfre la structure, [] // montrant que celle-ci nest pas affecte par la particularit et la
contingence de la simple exprience. Elle est transcendantale lorsquelle montre la signification de
la structure, cest--dire comment les essentialits dtermines, par exemple lespace, le temps, la
causalit, sunifient en une totalit, qui fonde la lgitimit des liaisons par lesquelles les phnomnes
sont levs la dignit dobjets dans la connaissance, ou, si lon prfre la lgitimit des jugements.
[] Par l sexplique enfin la dclaration de Kant si peu comprise: Jappelle transcendantale toute
connaissance qui, en gnral, soccupe moins des objets que de nos concepts a priori des objets.
Do lon voit que la Critique de la raison pure est le dveloppement de lessence de la
connaissance et, dans la mesure o lobjet nest que dans la connaissance, le dveloppement de
lessence du rel.
(Phi, OK I 109.2.1-110.1.f)
116
K <> T h m e # 8 <> K
5 . L a D i a l e c t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I . L a p p a r e n c e t r a n s c e n d a n t a l e .
L e s p a r a l o g i s m e s .
5. La Dialectique transcendantale...............................................................................................113
5.1 Le passage de lanalytique la dialectique..........................................................................113
5.2 Problmatique et dmarche de la dialectique transcendantale (Explication du texte de lIntroduction
p. 303-312)............................................................................................................114
5.3 Livre premier de la dialectique transcendantale: Des concepts de la raison pure...........................123
5.4 Livre deuxime de la dialectique transcendantale: Des raisonnements dialectiques de la raison.......126
5.4.1 Chapitre I. Des paralogismes de la raison pure............................................................128
5.1 Le passage de lanalytique la dialectique
De la logique de la vrit la logique de lapparence
Caractrisation de lanalytique comme logique de la vrit:
les jugements accomplis par la facult de juger laquelle quivaut, en ce rle, lentendement sont
DTERMINANTS; ce titre, ils sopposent aux jugements rflchissants.
Les jugements auxquels parvient la raison propos de chacune des trois ides transcendantales
sont-ils des jugements rflchissants? Kant les dcrit-il comme tels? si oui, o?
Lopposition entre jugements dterminants et jugements rflchissants sert-elle construire
lopposition entre analytique et dialectique transcendantales?
en tant que logique de la vrit, lanalytique kantienne ne garde, de lacception aristotlicienne de ce
terme, que lide de dcomposition (du jugement en ses lments) et lide de valeur objective (en tant
que valeur attribue aux concepts et, par eux, aux jugements). Lanalytique kantienne nest pas la logique
du raisonnement dmonstratif; lanalytique aristotlicienne est la logique du raisonnement dmonstratif.
Le passage de lanalytique la dialectique peut tre dcrit
comme un passage dune thorie des concepts et des jugements une thorie des raisonnements
comme un passage dune thorie qui tudie les lments de la pense qui ont une VALEUR OBJECTIVE
une thorie qui tudie les lments de la pense qui ont une APPARENCE DE VALEUR OBJECTIVE. Les
lments de la pense qui ont une valeur objective sont les concepts purs et principes purs de
lentendement. Les lments de la pense qui ont une apparence de valeur objective sont les ides
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
117
transcendantales (ou concepts purs de la raison) et les raisonnements dialectiques, cest--dire des
raisonnements qui concluent des propositions dont le sujet est une IDE TRANSCENDANTALE.
Cest seulement sur la base des oppositions conceptuelles prcdentes, et donc seulement indirectement et par
drivation, que lon peut caractriser le passage de lanalytique la dialectique de la manire suivante: passage
dune thorie de lentendement une thorie de la raison. Il est vrai que cest la raison qui est prise parti dans la
dialectique; mais cest seulement parce que lapparence transcendantale se manifeste dans des raisonnements
(certains raisonnements) et que ceux-ci sont loeuvre de la raison. Mais cela ne signifie pas que ldification des
sciences et des connaissances empiriques dont la possibilit est expose dans lanalytique peut se faire sans
raisonnements, ni que tous les raisonnements sont dialectiques.
Lopposition entre analytique et dialectique nest donc pas celle entre raisonnement dmonstratif et raison-
nement probable, bien quelle repose en partie sur une diffrence qualitative entre jugements:
les raisonnements mens conformment aux rgles de lentendement (attention: on ne dit pas
raisonnements analytiques, cette expression nexiste pas; elle serait trompeuse car elle ferait penser
aux jugements analytiques, et, partant, un autre sens du mot analytique) sont sans doute corrects mais
cest leur VALEUR OBJECTIVE qui est leur caractristique distinctive.
les raisonnements dialectiques sont des sophismes (paralogismes) et cest lAPPARENCE TRANSCEN-
DANTALE dfinie comme un simulacre de valeur objective quils doivent leur non-validit.
Donc la question de laquelle origine le dpartage entre lanalytique et la dialectique est bien: les concepts
purs (penss a priori) sont-ils appliqus, au moment de construire les jugements, des objets donns dans
lexprience, ou non? Autre formulation: existe-t-il des intuitions qui correspondent la reprsentation de lobjet
propos duquel est profr un jugement?
5.2 Problmatique et dmarche de la dialectique transcendantale (Explication du
texte de lIntroduction p. 303-312)
Lobjectif de lintroduction est didentifier la problmatique gnrale de la dialectique. Pour ce faire, Kant
explique la gense du problme, cest--dire par quel mcanisme inhrent la raison elle-mme est engendr le
PRINCIPE TRANSCENDANTAL SUPRME de cette facult. Cest ce principe quil sagira dinterroger et les
formulations du problme principal sont donnes la page 312, la toute fin de lintroduction.
Et les quatre dernires lignes de cette introduction annoncent la division de la dialectique en ses deux parties:
la premire traitera des concepts transcendants (Livre premier. Des concepts de la raison pure.)
et la seconde des raisonnements transcendants et dialectiques. (CRPu, Bar 312.f.3f) (Livre
deuxime. Des raisonnements dialectiques de la raison.)
Pour exposer la gense du problme principal, Kant a besoin
de prciser la nature de lapparence transcendantale
et dinsister davantage quil ne la fait jusqu maintenant sur les diffrences quil tablit entre lenten-
dement et la raison. Et la description des oprations propres la raison introduira une distinction trs
importante entre lusage logique de la raison et son usage transcendantal (ou usage rel).
I. LAPPARENCE TRANSCENDANTALE [303.1-306.1]
Apparence vraisemblance (303.1.2-7)
Apparence phnomne.
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
118
T o u t e l I n t r o d u c t i o n co n s i s t e i d e n t i f i e r l e m c a n i s m e re s p o n s a b l e de l a
p r o d u c t i o n de l a p p a r e n c e t r a n s c e n d a n t a l e ; l i d e n t i f i c a t i o n du m c a n i s m e
p r o d u c t e u r s e r t en m m e t e m p s de di a g n o s t i c qu i fo u r n i r a l a c l pe r m e t t a n t
d c h a p p e r l i l l u s i o n co r r e s p o n d a n t e . Da n s l a pa r t i e I Ka n t pr c i s e l a na t u r e
d e ce t t e ap p a r e n c e en l o p p o s a n t l a p p a r e n c e em p i r i q u e .
Lanalyse de la relation entre apparence et phnomne fait ressortir deux oppositions:
a) Lopposition entre ce qui est dans lintuition et ce qui est dans le jugement
Du point de vue de cette premire opposition, apparence, vrit et erreur sont placer uniquement
dans le JUGEMENT, cest--dire dans le rapport de lobjet notre entendement (303.1.15-16) et non
dans le PHNOMNE.
De quoi lon peut conclure que LES SENS NE SE TROMPENT PAS car ceux-ci ne contiennent aucun
jugement. Autre formulation: la vrit ou lapparence ne sont pas dans lobjet en tant quil est peru
intuitivement (303.1.9-10).
On peut conclure aussi: bien que nous avons dit que le phnomne est ce qui nous apparat, signifiant
par l ce qui apparat aux sens, il ne sagira pas ici, dans la dialectique, de lapparence prise en ce sens.
b) Lopposition entre lapparence empirique (304.2.1-2) et lerreur qui peut ventuellement en
dcouler et lapparence transcendantale
b.1) Reprenons la prmisse de largumentation de Kant:
apparence, vrit et erreur sont placer uniquement dans le JUGEMENT, cest--dire dans le rapport
de lobjet notre entendement (303.1.15-16).
Kant semble expliciter le fait quil sagit bien dun rapport et, qu ce titre, lentendement lui-mme
nest pas plus blmer que les sens, en ce qui concerne lorigine de lerreur et de lapparence, en tant
quelle nous invite lerreur (303.1.m11). Cest sur cette prmisse que Kant insiste en disant que
lentendement, quand il agit par lui-mme (sans tre influenc par une autre cause} (303..1.m7) ne
se trompe pas et mme quil ne le peut pas parce que, ds quil nagit que daprs ses propres lois,
leffet (le jugement) doit ncessairement saccorder avec elles. (303.1.m6-3) Du moins les jugements
ainsi produits sont-ils formellement vrais, puisque cest dans laccord avec les lois de lentendement
que consiste la partie formelle de la vrit (303.1.m3-2); noter que Kant ne parle pas de jugements
matriellement vrais.
b.2) Kant reconnat nanmoins le fait que nous produisons des jugements errons concernant les
phnomnes et fournit une explication qui ne contredit pas les deux thses dj poses (celles voulant
que ni les sens, ni lentendement, par eux-mmes, ne se trompent). Lexplication de lerreur est la
suivante:
[] lerreur ne peut tre produite que par linfluence inaperue de la sensibilit sur lenten-
dement, par quoi il arrive que les principes subjectifs du jugement se rencontrent avec les
principes objectifs, et les font dvier de leur destination.
(CRPu, Bar 304.1.2-6)
Et la reprsentation de cette relation dinfluence est donne par le paralllogramme des forces, utilis
comme construction figure (postulat) permettant de calculer la rsultante de forces qui sinfluencent
lune lautre dans la production dun effet conjoint sur le corps auquel elles sappliquent:
1
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
119
Influence de l'entendement
Influence de la
sensibilit
Lapparence empirique (du genre de celles que produisent les illusions doptique) qui invite
produire des jugements errons empiriques (tels que ceux dont il vient dtre question) est attribue
plus spcifiquement une influence de limagination, tandis que lerreur empirique tait plus
gnralement attribue, dans le paragraphe prcdent, la sensibilit, qui gare lentendement.
b.3) Les diffrences entre lapparence empirique et lapparence transcendantale sont:
la premire surgit dans lapplication empirique des rgles dailleurs justes de lentendement [lorsque]
le jugement est gar par linfluence de limagination (304.2.3-5) tandis que la seconde influe sur
des principes dont lapplication ne se rapporte pas du tout lexprience (304.2.6-7); lillusion
produite par la premire concerne des proprits dobjets possibles de lexprience, tandis que la
seconde nous entrane hors de lusage empirique des catgories et nous abuse par lillusion dune
extension de lentendement pur. (304.2.9-11). Les principes, ou rgles, impliqus dans la production
de jugements empiriques errons sont des PRINCIPES IMMANENTS; ceux impliqus dans la
production des jugements qui prsentent lapparence transcendantale sont des PRINCIPES
TRANSCENDANTS.
Kant en profite pour souligner que lapparence transcendantale est donc autre chose que lerreur
pouvant rsulter de lusage transcendantal ou abus des catgories <den transzendentalen Gebrauch
oder Mibrauch der Kategorien>, qui nest que lerreur de notre facult de juger lorsquelle nest point
suffisamment bride par la critique, et quelle ne prte pas assez attention aux limites du terrain o
lentendement pur peut quitablement sexercer (304.2.m9-4). Bien que le msusage des catgories
puisse nous entraner hors des limites de lexprience possible, il reste que les principes transcendants
constituent un tout nouveau groupe de principes, diffrents des principes immanents dj introduits
dans lanalytique. Un principe transcendant repousse [les] limites [de lexprience] et nous enjoint
mme de les franchir (305.1.4-5); ainsi lapparence quun tel principe produit provient dune exigence
de la raison ce qui est tout autre chose que lerreur de notre facult de juger lorsquelle nest point
suffisamment bride par la critique, et quelle ne prte pas assez attention aux limites du terrain o
lentendement pur peut quitablement sexercer (304.2.m8-4).
E n ca r a c t r i s a n t l e r r e u r de t y p e e m p i r i q u e , l a q u e l l e es t l e co r r l a t de
l a p p a r e n c e em p i r i q u e , Ka n t i n t r o d u i t un e op p o s i t i o n co n c e p t u e l l e en t r e
p r i n c i p e s s u b j e c t i f s et pr i n c i p e s ob j e c t i f s du j u g e m e n t ; i l r u t i l i s e r a ce t t e
o p p o s i t i o n da n s l e x p l i c a t i o n de l a p p a r e n c e t r a n s c e n d a n t a l e , pa g e 30 5 . 2 .
Apparence transcendantale apparence logique [305.2]
Lapparence logique cest celle que lon rencontre dans les sophismes est simplement due au fait
quon na pas suivi les rgles de la logique. Elle disparat lorsquon applique les rgles pertinentes; aussi
est-elle corrigible. [Attention: Barni utilise paralogismes au lieu de sophismes pour traduire
Trugschlsse, en 305.2.2-3 et en 305.3.m4. Il faut prendre garde, pour ne pas se mprendre: Kant ne
rfre pas, en ces deux endroits, aux raisonnements dialectiques quil appellera un peu plus loin les
paralogismes de la raison pure.]
2
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
120
Lapparence transcendantale est au contraire incorrigible. Elle ne porte pas seulement sur la forme du
raisonnement. Lapparence produite par les ides de la raison pure, cest que les objets de ces ides ont une
APPARENCE DE RALIT OBJECTIVE
bien que nous nayons pas de concept intellectuel de ces objets (cest--dire de concept qui puisse tre
montr et devenir lobjet din intuition dans une exprience possible 335.1.6-8)
Premire formulation de lapparence transcendantale:
des principes subjectifs qui ont tout fait lapparence de principes objectifs [] font que la
ncessit subjective dune certaine liaison de certains concepts en nous, exige par lentendement,
passe pour une ncessit objective de la dtermination des choses en soi. (305.2.m11-7)
Lopposition entre dialectique transcendantale et dialectique logique repose sur lopposition
prcdente entre apparence transcendantale et apparence logique. [305.3]
II. DE LA RAISON PURE COMME SIGE DE LAPPARENCE TRANSCENDANTALE [306.2-312.1]
A. La raison en gnral. [306.2-308.2]
K a n t t h m a t i s e l a di f f r e n c e en t r e r a i s o n et e n t e n d e m e n t ; i l ex p l i q u e en qu e l
s e n s l a ra i s o n pe u t t r e d f i n i e co m m e un e f a c u l t d e s p r i n c i p e s pr e n a n t po u r
o b j e t l e n t e n d e m e n t co n s i d r co m m e f a c u l t d e s r g l e s . Au t e r m e de ce
d v e l o p p e m e n t , l e l e c t e u r do i t s a i s i r q u e l es t l e co n c e p t g n r a l de l a fa c u l t
d e ra i s o n .
306.2 La raison a deux usages:
un usage logique; en cet usage elle est une facult logique.
un usage rel; en cet usage elle est une facult transcendantale et contient elle-
mme la source de certains concepts et de certains principes quelle ne tire ni des sens,
ni de lentendement. (306.2.12-14)
306.3
Convention
expliquer
Dans la dialectique transcendantale, nous dfinissons la raison comme la facult des
principes.
Explication donne pour justifier lappellation convenue [307.1-4].
En son sens large purement fonctionnel , le mot principe dsigne une proposition (universelle) utilise
comme principe, cest--dire pour en subsumer ou en driver dautres; nous voudrons entendre principe, ici en un
sens plus troit, absolu (307.4.2) qui tienne compte non seulement de la fonction dune proposition mais de son
origine <seinem eigenen Ursprunge nach>.
307.2.1-2
Dfinition large
de CP
La connaissance par principes, en gnral = connaissance o je reconnais le
particulier dans le gnral par concepts.
Jai une telle connaissance, par exemple, dans le raisonnement: tout raisonnement est
une forme de lacte de driver une connaissance dun principe. (307.2.3-4)
Mais le terme principe est utilis l en son sens large. Et cest seulement en ce sens
large que lon peut dire des principes de lentendement (et des propositions
universelles a priori que lentendement fournit) quils sont des principes.
1
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
121
307.3
Thse PE
Cependant, considrs en eux-mmes, dans leur origine, les principes de lentende-
ment ne fournissent pas une connaissance par principe et ne sont pas eux-mmes des
principes, puisquon ne peut les tirer de simples concepts.
Barni dit: ils ne sont rien moins que des connaissances par concepts. (307.3.2-3)
dans le sens: il ny a aucune qualit quils pourraient possder un degr moindre; en
dautres mots, ils sont loin dtre des connaissances par principe.
La raison en est quils ne seraient mme pas possibles a priori, si nous ny introdui-
sions lintuition pure (cest le cas de la mathmatique) ou les conditions dune
exprience possible en gnral. (307.3.3-6)
307.4
Dfinition
troite de CP
Un principe, au sens absolu est une proposition qui nous fournit une connaissance
synthtique par concepts.
Kant remplace la dfinition large donnes en 307.2 par une dfinition beaucoup plus
troite, qui prend en considration lorigine de la connaissance concerne. Cest
seulement par comparaison avec le sens absolu, que les propositions universelles en
gnral peuvent tre appeles des principes.
307.f-308.1 Si lon prend le mot principe en ce sens troit, on peut douter quune telle
connaissance existe; sans encore dcrter que cest l quelque chose dimpossible (car
notre recherche l-dessus est venir), il est en tout cas trs contraire la
vraisemblance que les objets en soi, que la nature des choses soit soumise des
principes et doive tre dtermine daprs de simples concepts. (308.1.7-9)
Reformulation
de la thse PE
Quoi quil en soit, il est clair au moins par l que la connaissance par principes (prise
en elle-mme) est quelque chose de tout fait diffrent de la simple connaissance de
lentendement [laquelle] ne repose pas en elle-mme (en tant quelle est synthtique)
sur la simple pense, et ne renferme pas quelque chose duniversel par concepts.
(308.1.7f)
308.2.2-4
Dfinition FP
la raison est la facult de ramener lunit les rgles de lentendement sous des
principes. Cette unit est qualifie de rationnelle.
Reprise, en fin dexplication, de la dfinition initiale.
La consquence de ce dveloppement est donc la suivante: Kant annonce quil va montrer que la raison
produit des principes par simples concepts il sagit donc de principes au sens troit du terme mais la question
de savoir si de tels principes constituent des connaissances par principes reste pose: Kant laisse entendre que cette
question va recevoir une rponse ngative, mais prfre ne pas laffirmer comme thse cet endroit-ci, vu que sa
dmarche de recherche est venir.
B. De lusage logique de la raison. [308.4-310.1]
L e bu t de ce t t e s e c t i o n es t
a ) de fa i r e co m p r e n d r e l o p r a t i o n s t a n d a r d de l a ra i s o n da n s s o n us a g e l o g i q u e .
C e t t e t a p e es t i m p o r t a n t e , ca r c e s t s u r ce t t e ca r a c t r i s t i q u e de l u s a g e l o g i q u e
d e l a ra i s o n qu e s e r a ba s e l a ca r a c t r i s a t i o n de l u s a g e r e l de l a ra i s o n .
b ) m o n t r e r l a s o u r c e de l a t r i c h o t o m i e pa r a l o g i s m e / an t i n o m i e / i d a l .
K a n t an a l y s e l i n f r e n c e de l a ra i s o n < V e r n u n f t s c h l u > , c e s t - - d i r e l i n f r e n c e
m d i a t e (s t a n d a r d ) .
2
2.1
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
122
309.1.3-6 Tout raisonnement contient:
a) la phrase qui sert de principe
b) la phrase qui sert de conclusion
c) linfrence (la relation de consquence) qui lie indissolublement la vrit de la dernire
celle de la premire. [Je substitue ici ma traduction celle de Barni, dont le dbut est :
lintermdiaire (la consquence). Le texte de Kant porte: die Schlufolge (Konsequenz).
Commentaire: un peu plus loin, la dernire ligne de ce paragraphe, Kant utilisera le terme
Zwischenurteil et Barni traduit par jugement intermdiaire. En traduisant Schlufolge,
dans la phrase ci-dessus, par lintermdiaire, il fait comme si, pour lui, Schlufolge dsigne
la mme chose que Zwischenurteil. Cela me semble une erreur.*
Kant distingue ensuite entre le raisonnement qui contient seulement deux propositions et celui qui
en contient trois.
A) Le raisonnement deux propositions (infrence immdiate):
Majeure Tous les hommes sont mortels.
Conclusion Quelques hommes sont mortels.
B) Le raisonnement trois propositions (infrence mdiate):
Majeure Tous les hommes sont mortels
Mineure Les savants sont des hommes [jugement intermdiaire;
Zwischenurteil ]
Conclusion Les savants sont mortels.
Le raisonnement qui na pas de proposition intermdiaire prsente une infrence [] immdiate
(consequentia immediata). Jaimerais mieux lappeler infrence de lentendement. (309.1.8-10)
Dans le texte de Kant: Verstandesschlu.
On pourrait aussi bien traduire: raisonnement de lentendement. (N.L.)
Les raisonnements 3 propositions prsentent une infrence mdiate; Kant convient de lappeler
infrence de la raison [ou raisonnement] (309.1.13) Dans le texte de Kant: Vernunftschlu.
On pourrait aussi bien traduire: raisonnement de la raison. (N.L.) Mais Barni veut viter,
apparemment, ce qui lui semble tre un plonasme.
*Dans le texte de Kant: und endlich die Schlufolge (Konsequenz), nach welcher die Wahrheit
des letzteren unausbleiblich mit der Wahrheit des ersteren verknpft ist.. Dans CRPu, T. & P.
1950, et enfin la dduction selon laquelle. Barni interprte la Schlufolge comme tant la
mineure. Tremesaygues & Pacaud interprtent Schlufolge comme tant la dduction, ce qui
constitue une traduction plus littrale (lexicographiquement parlant) et plus facile rconcilier avec
le contenu de la parenthse savoir: le mot Konsequenz. Il est possible, tout en acceptant
cette dernire interprtation, de considrer que Schlufolge dsigne toujours une proposition,
mais ce nest plus du tout la mineure; cest la proposition qui nonce lensemble du raisonnement
sous la forme dune seule conditionnelle, dans laquelle le connecteur est une IMPLICATION
FORMELLE, cest--dire le symbole reprsentant linfrence valide: Si (prmisse P1 & prmisse P2
& ) alors la conclusion C. Dans notre exemple: Si tous les hommes sont mortels et que les
savants sont des hommes, alors, ncessairement, les savants sont mortels. Si le terme
Schlufolge dsigne cet nonc infrentiel, le sens de ladverbe unausbleiblich mapparat
plus plein et plus naturel, car en effet, lnonc infrentiel exprime s a n s r i e n l a i s s e r d e
c t le lien ncessaire entre la conclusion et la phrase qui sert de principe.
K a n t t a b l i t un e co r r e s p o n d a n c e en t r e l e s l m e n t s du ra i s o n n e m e n t et l e s
f a c u l t s .
2.2
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
123
309.2.1-6 Trois des lments mentionns ci-dessus sont dsigns autrement:
a) la rgle (major). [Tous les hommes sont mortels]; cette rgle contient une
condition; pour la voir, il suffit dadopter la formulation que donne la logique
des prdicats: Pour tout x, si x est un homme, alors x est mortel. Cependant,
il convient de ne pas utiliser cette forme, car elle brouillera la diffrence entre
les trois formes possibles de la majeure: catgorique, hypothtique, disjonctive.
Le prdicat de la rgle est mortels.
b) la conclusion, en laquelle je dtermine ma connaissance par le prdicat de la rgle
(conclusio) et par consquent a priori : Tous les savants sont mortels.
c) la mineure, dans laquelle je subsume une connaissance sous la condition de la
rgle: Tous les savants sont des hommes. Je subsume les savants sous la condition
hommes.
a) cest lentendement qui conoit la rgle;
b) cest la raison qui dtermine ma connaissance, qui conclut;
c) cest la facult de juger qui subsume la connaissance sous la rgle.
K a n t ex p r i m e l a di s t i n c t i o n en t r e l e s t r o i s s o r t e s de ra i s o n n e m e n t s da n s l e s
t e r m e s de l a n a l y s e qu i l vi e n t de fa i r e du ra i s o n n e m e n t .
309.2.6-f La majeure met en rapport les deux lments suivants:
a) le prdicat (dans notre exemple: tre mortel) par lequel je dtermine, dans la conclusion, ma
connaissance (des savants)
b) la condition (dans notre exemple tre homme, la proprit humanit) de la connaissance que
jatteins dans la conclusion.
La mme ide exprime dans les termes de Kant: la majeure comme rgle [] reprsente le
rapport entre une connaissance et sa condition
Cest la forme de la relation [troisime classe de concepts purs] dans les jugements (ici dans la
majeure prise comme rgle), qui exprime la sorte de rapport qutablit le raisonnement entre la
connaissance et sa condition. Or, il existe trois sortes de telles relations qui constituent la forme
logique de trois sortes de jugements:
a) la relation entre substance et accident dans les jugements catgoriques;
b) la relation de condition consquence (alias relation de causalit) dans les jugements
hypothtiques;
c) la relation daction rciproque dans les jugements disjonctifs.
Des ces trois sortes de rapports quon retrouve dans les majeures des raisonnements, dcoule quon
aura trois sortes de raisonnements:
a) les raisonnements catgoriques;
b) les raisonnements hypothtiques;
c) les raisonnements disjonctifs.
Kant nannonce pas, cet endroit-ci, pourquoi il pose ce jalon et quoi servira cette typologie des
raisonnements. Mais cest ici que se trouve lorigine du fait que les ides transcendantales seront
au nombre de trois, et les raisonnements dialectiques correspondants au nombre de trois groupes
(un groupe par ide transcendantale).
K a n t ex p r i m e s o u s un e fo r m e g n r a l e l e s r s u l t a t s de s o n an a l y s e ; ce l a do n n e
u n pr i n c i p e qu i n o n c e l e bu t g n r a l qu e po u r s u i t l a ra i s o n l o r s q u e l l e fa i t de s
r a i s o n n e m e n t s .
2.3
2.4
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
124
309.3.1-m2 Raisonner, cest procder la recherche dune condition que doit satisfaire lobjet (ici:
les savants) et qui permette de dire que la conclusion se trouve dans lentendement
daprs une rgle gnrale. Quand cette recherche russit, elle produit, en mme temps
que le raisonnement, une rgle qui vaut aussi pour dautres objets de la
connaissance. (309.3.m3-2) La majeure Tous les hommes sont mortels vaut en
effet pour bien dautres objets que les savants.
[Noter ici que Kant emploie un langage psychologique, ou intentionnel, pour dcrire
le raisonnement.]
309.3.f-
310.1.f
La raison, dans le raisonnement, cherche ramener la grande varit des
connaissances de lentendement au plus petit nombre de principes (de conditions
gnrales) et y oprer ainsi la plus haute unit. (310.1)
Il reste, pour moi, une incertitude. Lorsque Kant parle dune connaissance prsente dans
lentendement daprs une rgle, ou tire dune autre daprs une rgle, je pense la rgle
dinfrence elle-mme, par exemple, au modus ponens. Lorsque Kant assimile directement la rgle
la majeure Tous les hommes sont mortels cest ce quil fait en 309.2.1-2 et confirme ce
sens en disant que la mineure subsume la connaissance sous la condition de la rgle ce quil
fait en 309.2.2-3 , il faut videmment comprendre que la rgle est simplement une connaissance
plus gnrale utilise dans ce raisonnement comme principe; le terme principe est alors pris en
son sens fonctionnel , qui est le sens le plus faible.
Linterprtation kantienne du raisonnement comme oeuvre et opration propres la raison
La section explique en dtail ci-dessus [308.4-310.1] nest que le premier de quatre passages-sources o lon
trouve linterprtation que Kant fait du raisonnement pour les fins de la dialectique transcendantale; les trois autres
passages sont:
311.2; nouvelle description (rappel) de lusage logique de la raison en vue den tirer la maxime
logique, ou principe propre, de cet usage. Petit passage contenu dans la section intitule C. De lusage
pur de la raison.
[] la raison, dans son usage logique, cherche la condition gnrale de son jugement (de la
conclusion) et le raisonnement nest lui-mme autre chose quun jugement que nous formons en
subsumant sa condition sous une rgle gnrale (la majeure). Or comme cette rgle doit tre
soumise son tour la mme tentative de la part de la raison et quil faut ainsi chercher (par le
moyen dun prosyllogisme) la condition de la condition, aussi loin quil est possible daller, on
voit bien que le principe propre de la raison en gnral dans son usage logique est de trouver,
pour la connaissance conditionne de lentendement, llment inconditionn qui doit en
accomplir lunit.
(CRPu, Bar 311.2)
321.3.1-322.2.6
La fonction de la raison dans ses
raisonnements rside dans luniversalit de la
connaissance par concepts, et le raisonnement
lui-mme nest quun jugement qui est
dtermin a priori dans toute ltendue de sa
condition.
Le raisonnement pris pour exemple est:
(Maj.) TOUS LES HOMMES SONT MORTELS
(Min.) CAUS EST UN HOMME
(Concl.) CAUS EST MORTEL
La proposition: Caus est mortel, pourrait tre
tire simplement par lentendement de
lexprience.
Dans le raisonnement ci-dessus, je tire la proposition
Caus est mortel, NON PAS de lexprience mais de deux
autres propositions.
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
125
Mais je cherche un concept contenant la
condition sous laquelle est donn
Cest condition dtre un homme que Caus est mortel.
Autrement dit: dans ce raisonnement, cest parce que Caus
est un homme quon le dclare mortel
le prdicat (lassertion elle-mme) de ce
jugement
le prdicat est mortel; lassertion est lacte dattribuer la
mortalit Caus.
(cest--dire ici le concept dhomme}, Le concept dhomme est celui qui contient (on pourrait
aussi bien dire: qui constitue) la condition qui permet
dattribuer la mortalit Caus
et aprs avoir subsum sous cette condition
prise dans toute son extension (tous les
hommes sont mortels),
Je subsume sous le concept dhomme quand je dis, dans la
mineure: Caus est un homme. Le concept dhomme est
pris dans la mineure avec la mme extension que celle
dtermine par la majeure; or dans la majeure, la classe des
hommes est prise dans sa totalit; le concept dhomme est
pris dans toute son extension.
La mineure dit que Caus appartient la classe de TOUS
LES HOMMES.
je dtermine en consquence la connaissance
de mon objet (Caus est mortel).
Voici la connaissance qui est conditionne; elle est vraie
CONDITION que les prmisses soient vraies aussi. Une
connaissance qui DCOULE dune autre, est conditionne
par cette autre.
Nous restreignons donc, dans la conclusion
dun raisonnement, un prdicat un certain ob-
jet, aprs lavoir pralablement conu dans la
majeure dans toute son extension sous une cer-
taine condition; cest cette quantit complte
de lextension, par rapport une telle condi-
tion, quon appelle luniversalit
(universalitas).
Le prdicat mortel est restreint Caus dans la
conclusion du raisonnement R. Ce prdicat mortel avait
t conu dans la majeure dans toute son extension sous la
condition hommes
326.2-327.1. Lanalyse donne ici du syllogisme sert introduire les notions de srie ascendante et
srie descendante des raisonnements, notions qui vont tre ncessaires la dduction transcendantale
des ides transcendantales. (Voir ci-dessous, section 2 du Livre premier de la Dialectique.)
C. De lusage pur de la raison. [310.2-312.1]
I l s a g i t m a i n t e n a n t d i d e n t i f i e r l e pr i n c i p e t r a n s c e n d a n t a l de l a ra i s o n da n s s o n
u s a g e r e l (p a r op p o s i t i o n l o g i q u e ) .
310.4-311.1 La raison est sans rapport direct, immdiat, des objets et leur intuition.
311.2 le principe propre de la raison en gnral, dans son usage logique, est de trouver pour
la connaissance conditionne de lentendement, llment inconditionn qui doit en
accomplir lunit. (311.2.4f)
Il sagit encore dune maxime logique, mais lapparition de lide dun lment
inconditionn prpare la formulation du principe transcendantal et montre par o va
se faire le passage du logique au transcendantal.
3
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
126
C e s t t r s ex a c t e m e n t ap r s l e pa r a g r a p h e 31 1 . 2 qu e s e fa i t l e pa s s a g e de s
c o n s i d r a t i o n s co n c e r n a n t l e s pr i n c i p e s l o g i q u e s du fo n c t i o n n e m e n t de l a ra i s o n
ce l l e s co n c e r n a n t l e pr i n c i p e t r a n s c e n d a n t a l de s o n fo n c t i o n n e m e n t .
311.3-4 La raison pure, non seulement cherche linconditionn de la connaissance en
remontant la srie des conditions subordonnes, mais admet quavec le conditionn
est donne aussi (cest--dire contenue dans lobjet et sa liaison) toute la srie des
conditions subordonnes, laquelle est par consquent elle-mme inconditionne.
(311.3.2-f)
Tel est le principe suprme de la raison pure.
311.5-312.1 Les propositions drives de ce principe seront synthtiques, mais transcendantes par
rapport tous les phnomnes.
Do lon voit que le mouvement par lequel la diversit est ramene lunit se retrouve aussi bien dans la
dialectique transcendantale qui fait la thorie de lusage rel de la raison que dans lanalytique transcendantale qui
faisait la thorie de lusage empirique de lentendement.
dans lanalytique, cest le divers de lintuition qui tait ramen lunit des concepts;
dans la dialectique, cest la diversit des rgles de lentendement qui est ramene lunit des principes.
Cependant lunit que la raison entrevoit et tente de raliser est telle que la raison lattribue ce qui est connu.
Tandis que lunit que ralise ncessairement (sans intention) mais un degr qui nest pas dterminable
lentendement est telle quelle que la facult suprme (entendement-raison-conscience; quelque chose qui est la
fois conscience de soi, aperception transcendantale et agent de la rflexion transcendantale) lattribue
exclusivement ce qui connat.
Fin de la description dtaille de la dmarche de lIntroduction (303-312).
L A P R O B L M A T I Q U E
Cest justement le principe transcendantal de la raison, en son usage rel, quil sagit dinterroger; et les
questions sont les suivantes:
ce principe a-t-il une valeur objective?
quelle est la nature et lautorit relative de cette exigence dunit par rapport aux pouvoirs et exigences
de lentendement?
est-ce un malentendu qui fait chercher lintgrit des conditions dans les objets eux-mmes? et si oui,
quelles sont les fausses interprtations et les illusions qui peuvent se glisser dans les raisonnements dont
la majeure est tire de la raison pure?
Il sagira donc de
prciser si la raison en elle-mme, cest--dire la raison pure, contient a priori des principes et des
rgles synthtiques et en quoi ces principes peuvent consister (CRPu, Bar 310.23f),
juger de la lgitimit des ides et raisonnements quelle produit sous linfluence de ses principes
dopration,
de dterminer linfluence de la raison pure et [d]en apprcier la valeur (CRPu, Bar 320.2.12-13).
5.3 Livre premier de la dialectique transcendantale: Des concepts de la raison pure
Ce livre est divis en trois sections; les deux premires introduisent et expliquent les notions ncessaires la
dduction transcendantale effectue dans la troisime.
Section 1. Des ides en gnral
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
127
Lintroduction [315.1-316.1] thmatise lopposition entre concept de la raison et concept de lentendement.
Kant introduit la distinction entre conceptus ratiocinati et conceptus ratiocinantes.
Les connotations platoniciennes (selon Kant) du terme ide. Le dpassement de lexprience est
particulirement apparent dans deux domaines:
l o la raison humaine montre une vritable causalit et o les ides sont de vritables causes
efficientes (des actions et de leurs objets) (CRPu, Bar 319.2), cest--dire en morale exemple: lide
de vertu.
cest aussi dans le spectacle de la nature que Platon trouve et avec raison des preuves videntes de ce
que les choses tirent leur origine des ides. Une plante, un animal, lordonnance rgulire du monde (sans
doute aussi tout lordre de la nature) montrent clairement que cela nest possible daprs des ides; qu
la vrit aucune crature individuelle, sous les conditions individuelles de lexistence, nest adquate
lide de la plus haute perfection dans son espce (dans la mesure mme o lhomme diffre de lide
dhumanit quil porte en son me comme modle de ses actions) (319.2).
Section 2. Des ides transcendantales
Il sagit dexpliquer plus en dtail que dans lintroduction la dialectique
lusage logique de la raison qui la conduit engendrer les ides transcendantales selon le principe
transcendantal suprme de la raison (dj introduit);
que cest lusage logique de la raison qui fournit la cl de la dfinition de ce quest un concept rationnel:
Le concept rationnel transcendantal nest donc que celui de la totalit des conditions dun
conditionn donn. Or comme linconditionn seul rend possible la totalit des conditions, et que
rciproquement la totalit des conditions est elle-mme toujours inconditionne, un concept
rationnel pur peut tre dfini en gnral le concept de linconditionn, en tant quil sert de principe
la synthse du conditionn.
(CRPu, Bar 322.2.10-15)
et le fil conducteur pour identifier tous les concepts rationnels. Cet usage logique renvoie exactement aux
trois catgories de la relation:
[] autant lentendement se reprsente despces de rapports au moyen des catgories, autant il y
aura aussi de concepts rationnels purs; il y aura donc chercher un inconditionn dabord pour la
synthse catgorique dans un sujet, en second lieu pour la synthse hypothtique des membres dune
srie <Reihe>, en troisime lieu pour la synthse disjonctive des parties dans un systme.
(CRPu, Bar 322.3)
Kant introduit une srie de nouvelles notions:
le sens tendu du mot absolu dans les expressions totalit absolue dans la synthse des conditions,
ce qui est inconditionn absolument, cest--dire sous tous les rapports (324.3.2-4). On a besoin de cet
adjectif pour dfinir le concept rationnel transcendantal.
[324.3] unit rationnelle des phnomnes vs unit intellectuelle des phnomnes. [] la raison pure
abandonne tout lentendement qui sapplique immdiatement aux objets de lintuition ou plutt la
synthse de ces objets dans limagination. Elle se rserve seulement labsolue totalit dans lUsage des
concepts de lentendement, et cherche tendre lunit synthtique qui est pense dans la catgorie
jusqu linconditionn absolu. On peut donc dsigner cette totalit sous le nom dunit rationnelle
[Vernunfteinheit] des phnomnes, comme celle quexprime la catgorie est appele unit intellectuelle
[Verstandeseinheit]. (CRPu, Bar 324.3.5-13)
Attention. Le dbut du 324.3 comporte un contresens. La premire phrase doit se terminer ainsi:
et il ne sarrte qu ce qui est inconditionn absolument, cest--dire sous tous les rapports.
Connaissant quel type dunit est propre au concept de la raison, nous pouvons maintenant comprendre
lide de la fonction rgulatrice de la raison, eu gard lentendement, ide que Kant explicitera
abondamment dans lAppendice la Dialectique et dans la Critique de la facult de juger et quil nonce
ici dj succinctement: Ainsi la raison [se rapporte] lusage de lentendement [] pour lui prescrire
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
128
de se diriger en vue dune certaine unit, dont lentendement na aucun concept et qui tend embrasser
en un tout absolu tous les actes de lentendement, par rapport chaque objet. (CRPu, Bar 324.3.13-21)
[324.4-326.1] ide transcendantale. Kant tablit lquivalence smantique entre concept rationnel pur et
ide (de la raison). Lavantage de cette quivalence semble purement terminologique car elle permet,
dans le contexte de la CRPu, de marquer lopposition entre concept de la raison et concept de
lentendement, tout en jouant sur la connotation ntre quune ide. Kant prend soin cependant de
prciser que cette connotation pjorative ne vaut que dans le contexte de lusage simplement spculatif
de la raison (325.1.9-10; noter la correction apporte la traduction); en revanche, lide de la raison
pratique (325.1.19), lide pratique (325.1.m10) peut toujours tre donne rellement, in concreto,
bien que partiellement (325.1.20-21) lorsquil sagit de guider lentendement dans son usage pratique,
cest--dire dans lexcution de ses rgles, ce en quoi consiste justement lusage pratique de la raison.
Dans ce paragraphe, la paire conceptuelle usage pratique / usage spculatif est croise avec la
paire entendement/raison et on trouve au nombre des croisements rsultants lexpression
lusage pratique de lentendement, laquelle est plutt rare dans CRPu; dans le voisinage
smantique de cette mme expression figure lallusion aux connaissances pratiques de
lentendement (326.1.2-3) que Kant oppose aux concepts de la nature (ibid. ).
[326.2-328.1] Il sagit pour Kant damorcer pour les concepts de la raison lanalogue de la dduction
transcendantale quil avait accomplie pour les concepts de lentendement:
examiner la forme logique de la connaissance rationnelle, et voir si par hasard la raison nest
point par l source de concepts qui nous font regarder des objets en eux-mmes comme
synthtiquement dtermins a priori par rapport elle ou telle fonction de la raison.
(CRPu, Bar 326.2.6f)
Et il a besoin, pour ce faire, dencore deux notions pralables, toutes deux bases sur cette interprtation
explicite du raisonnement: la raison arrive une connaissance par une srie dactes de lentendement
qui constitue une srie de conditions (CRPu, Bar 326.3.m16-14; accentuation en gras due NL). Or il
existe deux telles sries de conditions:
a) la srie ascendante: la srie des prosyllogismes, cest--dire des connaissances poursuivies du ct
des principes et des conditions dune connaissance donne (CRPu, Bar 327.2.1-4)
b) la srie descendante: la progression qui suit la raison du ct des pisyllogismes [CRPu, Bar
327.2.7-8).
Cest sur la premire srie que va seffectuer la totalisation des conditions qui aboutit au concept
rationnel de linconditionn. Une connaissance ne peut tre considre comme possible a priori que si
elle apparat en conclusion dun raisonnement dont on suppose donns tous les membres de la srie des
conditions (cest--dire la totalit de la srie des prmisses) (CRPu, Bar 327.2.11-13) il faut que la
srie entire soit vraie sans condition, pour que le conditionn, qui en est regard comme une
consquence, puisse tre tenu pour vrai.. Cest l ce quexige la raison qui prsente sa connaissance
comme dtermine a priori et comme ncessaire, soit delle-mme, auquel cas elle na pas besoin de
principe, soit, quand cette connaissance est drive, comme un membre dune srie de principes qui est
elle-mme vraie sans conditions. (CRPu, Bar 327.f.m5-328.1.f)
Section 3. Systme des ides transcendantales
Nous avons jusquici fait la thorie du rapport naturel qui doit exister entre lusage transcendantal de notre
connaissance, aussi bien dans les raisonnements que dans les jugements , et son usage logique (328.2.10-12).
Connaissant
le principe de lusage pur de la raison (trouver pour la connaissance conditionne de lentendement,
llment inconditionn qui doit en accomplir lunit CRPu, Bar 311.2.3f, partie C de lintroduction
la Dialectique)
la diffrence entre le concept de lentendement et celui de la raison et la caractrisation de ce dernier
comme concept de linconditionn, en tant quil sert de principe la synthse du conditionn (CRPu, Bar
322.2.2f, section 2 du Livre premier de la Dialectique)
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
129
quil devra y avoir autant de concepts dinconditionn quil y a de catgories de relations: autant
lentendement se reprsente despces de rapports au moyen des catgories, autant il y aura aussi de
concepts rationnels purs (322.3.1-3)
le mcanisme logique par lequel la raison produit la totalit absolue dans la synthse des conditions
(324.3.2-3), savoir la srie ascendante des raisonnements du ct des prmisses et des principes
nous sommes maintenant en mesure de complter la dduction (subjective) des ides transcendantales, cest-
-dire de les identifier, de dire quel concept rationnel pur correspond chaque genre de rapports que lon
rencontre en nos reprsentations [328.1-329.1]; les ides transcendantales se laissent ramener en trois classes
dont la premire contient lunit absolue (inconditionne) du sujet pensant;
la seconde, lunit absolue de la srie des conditions du phnomne;
la troisime, lunit absolue de la condition de tous les objets de la pense en gnral. (CRPu, Bar
328.4.m3-329.1.f)
et puisquelles forment le systme des objets de recherche de la raison pure, nous sommes galement en
mesure desquisser le systme (architectonique) des connaissances possibles de la Raison pure [329.2], lequel
comprendra une psychologie transcendantale, une cosmologie transcendantale et une thologie
transcendantale. Le mot connaissances, dans un tel contexte, est forcment problmatique, puisque de
lobjet qui correspond une ide, nous ne pouvons avoir aucune connaissance [] nous pouvons en avoir un
concept problmatique. (CRPu, Bar 335.1.4f)
5.4 Livre deuxime de la dialectique transcendantale: Des raisonnements dialectiques
de la raison
Lintroduction rappelle (335.1-2) le rapport que Kant fait entre concept et raisonnement, rapport qui articule
justement les livres un et deux de la dialectique:
bien que lobjet des concepts purs de la raison soit quelque chose dont on na pas de concept intellectuel
(on ne peut montrer cet objet dans une exprience possible et en tirer une intuition)
les concepts purs de la raison ont une ralit transcendantale fonde sur des raisonnements ncessaires
cest par une infrence ncessaire que nous sommes amens eux et quils sont en ce sens invitables.
titre dexplicitation du plan, Kant numre les 3 sortes de raisonnements dialectiques qui vont correspondre
aux trois ides transcendantales et leur donne un nom.
la page suivante, je donne un tableau-synthse intitul La systme des raisonnements dialectiques selon
les objets, procds et objectifs de la raison pure.
Commentaire concernant le tableau-synthse
Remarquons que la deuxime colonne, partir de la gauche, contient une relation entre un concept de dpart
et un concept auquel je (en tant que raison pure) conclus. Le concept de dpart est un concept lgitime, en quelque
sorte; on le trouve parmi les concepts introduits par Kant au cours de lAnalytique transcendantale. On peut se
demander, titre de problme dexgse, si ces concepts de dpart peuvent tre compris, de quelque faon, dans la
description dfinie quelque chose que nous connaissons utilise par Kant pour dcrire les raisonnements
dialectiques en gnral dans le passage qui prcde de peu les formulations de la deuxime colonne ci-dessus:
Il y a donc des raisonnements qui ne contiennent pas de prmisses empiriques et au moyen
desquels, de quelque chose que nous connaissons, nous concluons quelque chose dont nous
navons aucun concept, et laquelle nous attribuons pourtant de la ralit objective, par leffet dune
invitable apparence. (CRPu, Bar 335.2.4-9)
La question se pose du fait que les concepts transcendantaux ne nous reprsentent, par eux-mmes , rien que
nous connaissions; en tant que transcendantaux, ils nont pas de contenu. On se souvient, par exemple, de la thse
selon laquelle le je pense de lunit originairement synthtique de laperception ne me fait rien connatre de moi-
mme, mais me reprsente seulement que je suis (25 de la dduction transcendantale La conscience de soi-mme
est donc bien loin dtre une connaissance de soi-mme CRPu, Bar 169.2.2f).
LE SYSTME DES RAISONNEMENTS DIALECTIQUES SELON LES OBJETS, PROCDS ET OBJECTIFS DE LA RAISON PURE
NOM DU RAI-
SONNEMENT
DIALECTIQUE
DESCRIPTION DU
RAISONNEMENT DIALECTIQUE
[336.2]
TYPE DE RAI-
SONNEMENT
ET DE
SYNTHSE
[322.3]
OBJECTIF DE LA
SYNTHSE
[322.4]
LES RAP-
PORTS PR-
SENTS EN
NOS REPR-
SENTATIONS
[328.3]
TYPE DUNIT
SYNTHTIQUE
INCONDITIONN
E
[328.4-329.1]
Paralogisme
transcendantal
Je conclus du concept
transcendantal du sujet, qui ne
renferme point de diversit,
labsolue unit de ce sujet lui-
mme
Synthse
CATGORIQUE
dans un sujet
La synthse tend
un sujet qui ne soit
plus lui-mme
prdicat
Le rapport au
sujet
Lunit absolue
du sujet pensant
Antinomie (de
la raison pure)
De ce que, dun ct, jai
toujours un concept
contradictoire de lunit
synthtique absolue de la srie, je
conclus la vrit de lunit
oppose, dont je nai pourtant
non plus aucun concept
Synthse
HYPOTHTI-
QUE des
membres dune
srie
La synthse tend
une supposition
qui ne suppose
rien au-del
Le rapport la
diversit de
lobjet dans le
phnomne
Lunit absolue
de la srie des
conditions du
phnomne
Idal de la
raison pure
Je conclus de la totalit des
conditions ncessaires pour
concevoir des objets en gnral,
en tant quils peuvent mtre
donns, lunit synthtique
absolue de toutes les conditions
de la possibilit des choses en
gnral, cest--dire un tre de
tous les tres
Synthse
DISJONCTIVE
des parties dans
un systme
La synthse tend
un agrgat des
membres de la
division qui ne
laisse rien
demander de plus
pour la parfaite
division du
concept
le rapport
toutes choses
en gnral
Lunit absolue
de la condition de
tous les objets de
la pense en
gnral
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
131
5.4.1 Chapitre I. Des paralogismes de la raison pure
Correction: Dans la traduction de Barni, il manque une phrase, au milieu du paragraphe 339.2
entre la phrase qui finit par prsenter toute pense comme appartenant la conscience. et
celle qui commence par Moi, en tant que pensant. La phrase rtablir se lit ainsi dans la
traduction Trmesaygues et Pacaud: Nanmoins, si pur quil soit de toute empirisme (de toute
impression des sens), il sert pourtant distinguer deux espces dobjets daprs la nature de notre
facult de reprsentation. (CRPu, TrPa 279.1.1-4)
La section consacre aux paralogismes psychologiques se comprendra plus facilement si on dcoupe sa
dmarche de la manire suivante:
Kant prsente la topique de la psychologie rationnelle (340.3.m3-2) et ses quatre paralogismes. [339.1-
341.1; les items numrots 1, 2, 3 et 4 sont considrs comme un tableau, non comme un
paragraphe.]
[Premire dmarche de rfutation.] Kant tablit que la psychologie rationnelle a pour unique fondement
la reprsentation vide je pense qui constitue le sujet transcendantal [341.2-343.1] et rfute tour de rle
chacun des quatre paralogismes, en dfaisant linfrence qui y est contenue [343.2-345.1].
[Intermde mtadiscursif.] Kant souligne limportance de la rfutation en cours [345.2].
[Deuxime dmarche de rfutation.] Kant formule en 345.3 le paralogisme dominant qui vaut pour les
quatre paralogismes identifis auparavant et mne la rfutation en 4 tapes:
rfutation logique du paralogisme dominant par identification de la faute logique qui y est commise
( savoir lutilisation dun terme en deux sens diffrents) [345.f-346.f]
remarque enclave consacre un argument de Mendelssohn [347.1-348.1]
rfutation (transcendantale?) du paralogisme dominant considr comme formant un
enchanement synthtique (349.1.1-2), cest--dire un mouvement de synthse de la conclusion
partir des prmisses. [349.1]
rfutation du paralogisme dominant suivant la mthode analytique, cest--dire en partant de sa
conclusion ici, une proposition qui a pour fondement la modalit dexistence et en la
dcomposant pour en savoir le contenu. [349.2-351.1]
[Commentaires terminaux.]
Jugements densemble sur la psychologie rationnelle dcoulant des rfutations. [351.1-2]
Enjeux des rfutations prcdentes pour la philosophie spculative et la philosophie pratique. [352.1-
353.f].
I d e n t i f i c a t i o n de l a t o p i q u e de l a ps y c h o l o g i e ra t i o n n e l l e et de s e s pr i n c i p a l e s
t h s e s .
Note sur lemploi du je et du nous dans la critique du paralogisme de la raison pure.
Ces pronoms dsignent tantt des sujets qui, en tant que soumis lillusion transcendantale
commettent les infrences injustifies quil sagit justement de critiquer (dnoncer) et tantt ces
pronoms dsignent des sujets activement impliqus dans leur rle de critique et se dissociant des
tenants de la psychologie rationnelle. En franais le problme se complique encore un peu plus
quen allemand, du fait que notre langue prfre les tournures de la voix active celles de la voix
passive et introduit le pronom on pour obtenir des expressions telles que On ne se demande
pas si, On lenvisage au point de vue de (342.2) l o lallemand se contente du passif
impersonnel.
P r e m i r e d m a r c h e de r f u t a t i o n . Id e n t i f i c a t i o n du fo n d e m e n t de l a ps y c h o -
l o g i e ra t i o n n e l l e et cl a r i f i c a t i o n de l a re p r s e n t a t i o n pr i s e po u r fo n d e m e n t .
Quest-ce qui rend possible que nous prtendions fonder sur une proposition qui parat empirique un
jugement apodictique et universel tel que celui-ci: tout ce qui pense est constitu tel que la conscience de moi-mme
<Selbstbewutsein> dclare que je le suis?
1
2
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
132
Rponse: nous attribuons ncessairement a priori aux choses toutes les proprits constituant les conditions
qui seules nous permettent de les concevoir. (342.2.8-10) Or la conscience de moi-mme est une telle condition.
Cependant, quand nous faisons cela partir de la proposition je pense, cette proposition nest prise que
dans un sens problmatique, puisque nous ne nous demandons pas si elle peut impliquer la perception dune
existence (comme le cogito, ergo sum de Descartes) (342.2m6-4).
Cette rserve est difficile interprter en tant quacte discursif (ou procd rhtorique). Elle peut
tre interprte comme poursuivant la description de ce que nous faisons: nous nallons pas
jusqu tirer des conclusions dexistence de ce que nous trouvons dans la seule conscience de
nous-mme; ou elle peut indiquer, plutt, que le philosophe critique reprend la parole et se dissocie
du nous collectif pour rinterprter la situation en termes transcendantaux.
Ou bien: nous ne succombons pas ncessairement lillusion transcendantale, quand nous
transportons notre propre existence dautres objets;
ou bien: le fait que nous fassions cela ncessairement et spontanment ne signifie pas que la
thorie critique a tort de dire que la reprsentation je pense nest quune forme vide, car, en fait
(que nous nous en rendions compte ou non) la proposition je pense est alors prise seulement
dans un sens problmatique.
Ou la remarque de Kant nous absout; ou elle raffirme le point de vue de la critique.
La traduction que je ferais du passage on ne se demande pas est trs diffrente de celles de
Barni et de T.-P. Je dirais: La proposition je pense nest cependant prise ici quen un sens
problmatique; problmatique non pas dans la mesure o elle est susceptible de contenir la
perception dune existence (ce que fait le cogito, ergo sum de Descartes) mais en ce sens quon
veut considrer simplement sa possibilit pour voir quelles proprits sont susceptibles de
dcouler dune proposition si simple pour son sujet (que ce dernier existe ou non).
Nous ne pouvons fonder notre connaissance rationnelle de ltre pensant sur autre chose que le cogito, sous
peine de passer la psychologie empirique, une sorte de physiologie du sens intime. Et cest bien ce que fait la
psychologie rationnelle.
Mais les conclusions que la psychologie rationnelle va tirer de la proposition je pense renferment un usage
simplement transcendantal de lentendement. Or cela naugure pas bien
K a n t i n t r o d u i t l a di s t i n c t i o n en t r e l e m o i d t e r m i n a n t et l e m o i d t e r m i n a b l e .
C e t t e di s t i n c t i o n es t pr s u p p o s e pa r l a r f u t a t i o n .
Je ne connais pas un objet par cela seul que je pense. Cela vaut pour moi-mme comme objet ventuel de
connaissance: Je ne me connais pas moi-mme par cela seul que jai conscience de moi comme tre pensant: il me
faut avoir conscience de lintuition de moi-mme, comme dtermine relativement la fonction de la pense.
(343.2.7-11)
Il faut donc toujours distinguer entre le moi dterminant et le moi dterminable. Le moi dont je peux avoir
une connaissance est le moi dterminable et je nen connais quelque chose que dans la mesure o il est dtermin
par un divers donn et synthtis dans lintuition.
D i s s o l u t i o n du l i e n d i n f r e n c e pr s e n t da n s ch a c u n de s qu a t r e pa r a l o g i s m e s .
Cest la rfutation des prdicaments de la psychologie rationnelle, le terme prdicaments dsigne, dans la
terminologie scolastique, les proprits attribues lme, telles quelles sont identifies dans chaque paralogisme.
1
o
Il est vrai que je suis toujours le sujet dterminant du rapport qui constitue le jugement.
Cela ne signifie pas que je suis, comme objet, un tre subsistant par moi-mme ou une substance
(343.3.m5-3)
3
4
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
133
Barni, la suite de la citation donne ci-dessus: Cette dernire proposition a une bien autre porte.
Aussi exige-t-elle des donnes qui ne peuvent tre trouves dans la pense, plus peut-tre que je ne
trouverai / partout ailleurs dans ltre pensant en tant que je lenvisage simplement comme tel.
(343.3.3f-344.1.f)
Tremesaygues & Pacaud, pour le mme passage: Cette dernire proposition va bien loin et cest pour
cela quelle exige aussi des donnes qui ne se trouvent pas du tout dans la pense, et peut-tre (en
tant que jenvisage ltre pensant comme tel) va-t-elle trop loin pour je puisse jamais les (y) rencontrer.
(CRPu, TrPa 284.3.4f)
2
o
Le moi de laperception est logiquement simple, cest--dire singulier. Voil une proposition analytique.
Cela ne signifie pas que le moi pensant, le moi dans la pense, comme dit la psychologie rationnelle, soit
une substance simple.
3
o
Lidentit du moi dterminant dans toute diversit dont jai conscience est contenue dans les concepts
mmes. Voil une proposition analytique.
Mais lintuition dans laquelle le sujet est donn comme objet ne contient pas cette identit, qui quivaut
lidentit de la personne.
4
o
Ma propre existence comme tre pensant est distincte des autres choses hors de moi (et dont mon corps
aussi fait partie); et il est vrai que je la distingue comme telle. Voil une proposition analytique.
Mais cela ne signifie pas que cette conscience de moi-mme est possible sans que me soient donnes des
choses hors de moi, par lesquelles me sont donnes des reprsentations. Il nest pas dit que je puisse exister
simplement comme tre pensant (sans tre homme) possibilit quaffirme la psychologie rationnelle
lorsquelle considre lme comme quelque chose dimmortel.
Chaque fois, dans chacune des 4 thses, il sagit pour Kant
de distinguer (opposer mme) 1 la reprsentation du moi (=moi dterminant) dans le je pense originaire de
laperception et 2 la reprsentation du moi (= moi dterminable} fournie par lintuition dans le sens intime.
daffirmer que ce que contient analytiquement la premire ne signifie pas des proprits correspondantes de la
seconde.
Le rsum ou rsultat des quatre objections se trouve en 345.1.
K a n t s o u l i g n e co m b i e n i l es t fo n d a m e n t a l , du po i n t de vu e de t o u t l e s y s t m e
d e l a C r i t i q u e de l a r a i s o n pu r e de ne pa s l a i s s e r pa s s e r de s j u g e m e n t s
s y n t h t i q u e s a pr i o r i du ge n r e de ce u x qu e l a ps y c h o l o g i e ra t i o n n e l l e fo r m u l e .
[ 3 4 5 . 2 ]
D e u x i m e d m a r c h e de r f u t a t i o n . P r e m i r e t a p e de l a r f u t a t i o n du
p a r a l o g i s m e do m i n a n t .
Largument fait fond sur le fait que ltre dont il est question dans la majeure nest pas le mme que celui
dont il est question dans la mineure. (Cest un argument qui montre un glissement smantique illgitime dans le
raisonnement tudi. Cest ce quoi fait allusion lexpression latine per sophisma figur dictionis, sophisme de la
forme de lexpression: une expression de mme forme est utilise en deux sens diffrents.)
Kant, aprs ce premier nonc de largument nous invite nous reporter la remarque gnrale
sur la reprsentation systmatique des principes (346.2.3-4); Cette remarque se trouve en CRPu,
Bar 258-261 et son titre exact est Remarque gnrale sur le systme des principes. Il nous
rfre galement au passage 269.2.10-21 de la section des noumnes, o il a t prouv que le
concept dune chose qui peut exister en soi comme sujet, et non pas seulement comme prdicat,
nemporte avec lui aucune ralit objective (CRPu, Bar 346.2.4-8).
Largument plus explicite [346.2] suit:
5
6
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
134
le concept je pense nemporte avec lui aucune ralit objective; nous navons donc aucune connaissance
de lobjet quoi il devrait ou pourrait correspondre.
(Majeure) pour quil ait une ralit objective, il faut quil ait pour fondement une intuition constante
(Mineure) or, dans lintuition intrieure nous navons rien de constant, puisque le moi nest que la
conscience de ma pense.
de la rfutation du paralogisme de la substance (le numro 1
o
dans la topique), suit la rfutation du
paralogisme de la simplicit (numro 2
o
). (346.2.4f)
R f u t a t i o n de l a r g u m e n t de M e n d e l s s o h n en fa v e u r de l a pe r m a n e n c e de l m e .
( 3 4 7 - 3 4 8 )
T r o i s i m e e t q u a t r i m e t a p e s de l a r f u t a t i o n du pa r a l o g i s m e do m i n a n t , s e l o n
l a m t h o d e s y n t h t i q u e , pu i s s e l o n l a m t h o d e an a l y t i q u e .
Lordre selon lequel la rfutation aborde les paralogismes (et par eux les prtendues proprits de lme) varie
dune mthode lautre. Pour dcrire lordre adopt dans chaque cas, associons conventionnellement chacun des
paralogismes un symbole littral qui voque la catgorie utilise pour le gnrer: L, pour la quaLit; N, pour la
quaNtit; R, pour la Relation; M, pour la Modalit.
Considrons dabord que les propositions de la psychologie rationnelle sont agences selon la mthode
synthtique; elles forment alors un systme (de propositions) qui part de laffirmation tous les tres
pensants sont des substances (jugement gnr selon la catgorie de relation) pour arriver lexistence
de ces tres (jugement gnr selon la catgorie de la modalit). Tel est dailleurs lordre que suit le
paralogisme dominant. Lordre est donc:
R L N M
Considrons ensuite que les propositions de la psychologie rationnelle sont agences selon la mthode
analytique, cest--dire en pren[ant] pour fondement le je pense comme une proposition donne
renfermant dj en elle une existence, ce qui revient prendre pour fondement la modalit (349.2.2-4).
Lordre est donc:
M R L N
Commentaire. Le rapport entre ce systme de propositions et le paralogisme dominant nest pas
immdiat. Ou bien Kant fait lhypothse que le paralogisme dominant pourrait avoir une forme
diffrente o laffirmation dexistence serait place en prmisse plutt quen conclusion , ou
bien il lit le paralogisme de bas en haut, en dcomposant la conclusion pour en savoir le contenu,
en allant du conditionn ses conditions.
Cette rfutation conclut cette fois que les explications de la nature du moi, comme sujet simplement
pensant, sont aussi impossibles par les principes du matrialisme (350.1.17-18) que par ceux du
spiritualisme.
La prmisse qui devrait survivre pour que lexplication du moi satisfasse les principes matrialistes
est il y a dans lespace un rel simple; ce serait la condition de la possibilit de mon aperception
de moi-mme comme simple. Kant nie ladite prmisse en 350.1.12-16)
La prmisse qui devrait survivre pour que lexplication du moi satisfasse les principes du
spiritualisme est quelque chose de permanent mest donn dans lintuition interne, en tant que je me
pense; ce serait la condition de la possibilit que je me peroive comme substance. Kant nie ladite
prmisse en 350.1.m15-13.
C o m m e n t a i r e s co n c l u s i f s s u r l e s r f u t a t i o n s . [3 5 1 . 2 - 3 5 5 . 1 ]
Concernant le problme de lunion de lme et du corps, Kant dit quil nappartient pas proprement la
psychologie rationnelle dont il est ici question. Le traitement consiste faire remarquer que lme et le corps, en tant
quobjets de connaissance, sont donns lune dans le sens intime et lautre dans les sens externes et que par
7
8
9
T H M E # 8. L A D I A L E C T I Q U E I. L A P P A R E N C E T R A N S C E N D A N T A L E . LE S P A R A L O G I S M E S .
_____________________________________________________________________________________________
135
consquent ces objets ne se distinguent quen tant que lun apparat lautre extrieurement (354.2.m10-9). Quant
au problme plus gnral de savoir comment est possible en gnral une union de substances, il subsiste sans
doute, mais il est sans aucun doute hors du champ de toute connaissance humaine. (355.1.2f)
137
K <> T h m e # 9 <> K
L a d i a l e c t i q u e t r a n s c e n d a n t a l e
I I . L a n t i n o m i e d e l a ra i s o n p u r e
5.4.2 Chapitre II. Antinomie de la raison pure....................................................................133
5.4.2.1 La dmarche densemble du chapitre II................................................................133
5.4.2.2 Description oprationnelle de la section 7. Dcision critique du conflit cosmologique
de la raison avec elle-mme..............................................................................135
5.4.2.3 Les solutions des antinomies...........................................................................137
5.4.3 LAppendice la Dialectique transcendantale...............................................................141
5.4.2 Chapitre II. Antinomie de la raison pure
En passant des paralogismes aux antinomies, on quitte le groupe des raisonnements dialectiques qui sont
engendrs par la recherche de lunit inconditionne des CONDITIONS SUBJECTIVES de toutes nos reprsentations
en gnral; on aborde le groupe des raisonnements dialectiques qui sont engendrs par la recherche de lunit
inconditionne des CONDITIONS OBJECTIVES des objets
soit des phnomnes
soit des objets en gnral. (CRPu, Bar 361)
La diffrence entre antithtique et antinomie (CRPu, Bar 336.2.8-16)
ANTINOMIE. Cest ltat de la raison (CRPu, Bar 336.2.15) dans la deuxime classe de conclusions
sophistiques. Cest le conflit des lois. (CRPu, Bar 362.3.2)
ANTITHTIQUE. Doctrine ou rflexion qui nenvisage les connaissances de la raison que dans leur conflit et
dans les causes de ce conflit. (CRPu, Bar 370.1.7-9) recherche sur lantinomie de la raison pure, ses causes,
son rsultat. (CRPu, Bar 370.1.9-10).
Rectification de la traduction en 370.4.3-371.1.f. Or puisque cette unit de la raison doit dabord,
en tant que synthse selon des rgles, saccorder <kongruieren> avec lentendement et nanmoins
aussi, en tant quunit absolue de ladite synthse, saccorder avec la raison, lunit recherche, si
elle est adquate lunit de la raison, aura des conditions trop grandes pour lentendement, et, si
elle sajuste sur lentendement, aura des conditions trop petites pour la raison.
5.4.2.1 La dmarche densemble du chapitre II
Quelle est la dmarche gnrale que suit Kant dans le chapitre II du Deuxime Livre de la Dialectique? Je
dcris cette dmarche dans le tableau intitul Les procds discursifs des neuf sections de lAntinomie de la raison
pure et dans les indications plus dtailles que je coiffe du sous-titre Plan pragmatique tabulaire du chapitre sur
lAntinomie de la raison pure.
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
138
LES PROCDS DISCURSIFS DES NEUF SECTIONS DE LANTINOMIE DE LA RAISON PURE
P r o c d s
d i s c u r s i f s
I n t i t u l s d e s s e c t i o n s
Position du problme 1
2
Systme des ides cosmologiques
Antithtique de la raison pure
Considrations
mtadiscursives
sur le problme
3
4
5
De lintrt de la raison dans ce conflit avec elle-mme
Des problmes transcendantaux de la raison pure, en tant quil doit absolument y en
avoir une solution possible
Reprsentation sceptique des questions cosmologiques souleves par les quatre
ides transcendantales
Rsolution du
problme
6
7
8
9
Lidalisme transcendantal comme clef de la solution de la dialectique
cosmologique
Dcision critique du conflit cosmologique de la raison avec elle-mme
Principe rgulateur de la raison pure par rapport aux ides cosmologiques
De lusage empirique du principe rgulateur de la raison par rapport toutes les
ides cosmologiques
Plan pragmatique tabulaire du chapitre sur lAntinomie de la raison pure
(Dialectique transcendantale, Livre 2, Chapitre II)
Position du problme.
1. Drivation des quatre ides transcendantales partir des catgories.
2. Identification des quatre antinomies gnres par les 4 ides transcendantales.
Traitement du problme.
Caractrisations mtadiscursives du problme.
3. Identification des enjeux du problme en termes des intrts quy trouvent les parties en conflit (dans
le vocabulaire contemporain, on parlerait probablement denjeux idologiques).
4. Caractrisation du rapport Question/Rponse dans les termes de la logique transcendantale.
5. Description dun traitement du problme qui, avant de produire des arguments susceptibles de
constituer une solution, se contenterait de faire voir labsurdit de chacune des assertions dune
antinomie et ce, pour les quatre antinomies. Cest le traitement sceptique, lequel, en tant que
pralable, a pour utilit de montrer que la question souleve par chaque antinomie repose sur une
supposition dnue de fondement et joue[] avec une ide qui montre mieux sa fausset dans son
application et dans ses consquences que dans sa reprsentation abstraite (CRPu, Bar 411..113-16).
(Une alternative dont les deux membres sont faux cre une situation dindcidabilit; et pour peu quon
assume cette indcidabilit, on suspend son jugement, comme le fait le sceptique.)
Rsolution du problme.
6. Rappel des principes de lIdalisme transcendantal, lesquels permettent dinterprter le problme et de
reconstituer son tiologie.
7. tablissement du diagnostic. Identification de la faute logique prsente dans largument dialectique sur
lequel repose toute lantinomie de la raison pure.
analyse du raisonnement fallacieux: 418.1.5-420.2.f
tablissement de la distinction entre opposition analytique et opposition dialectique, opposition
qui servira interprter la relation entre les deux assertions qui saffrontent dans une antinomie:
420.3-422.1
application de la distinction aux oppositions (dialectiques) prsentes dans les quatre antinomies:
422.1-423.f
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
139
Prescription du remde. Formulation des thses qui vont constituer la solution des antinomies et faire
disparatre le conflit.
8. Identification du principe de la cure. Il sagit de donner au principe de la raison (rechercher
linconditionn dans les rgressions) une interprtation qui en fasse, non plus un principe
constitutif mais un principe rgulateur.
les sortes de rgression empirique et la manire de les instituer.
9. Application du principe de la cure chacune des antinomies et production des propositions
philosophiques qui noncent les principes rgulateurs dans chaque cas de mme que les
propositions qui contiennent les ides cosmologiques sans engendrer un conflit de la raison avec
elle-mme.
Note sur la section 4.
Il faut dabord faire la distinction entre
une totalisation (des conditions) dont on ne sait pas si elle pourrait tre donnes ou non dans une
exprience possible
et une totalisation don sait davance quelle ne peut pas tre donne dans une exprience possible.
La thse de la 4
e
section est quil existe ncessairement une solution aux problmes transcendantaux
cosmologiques, mais que cest une solution purement critique, par opposition une solution dogmatique.
Largument est:
vous savez quaune exprience possible ne saurait dpartager entre les deux modes de totalisation
(synthse finie, synthse qui stend linfini) puisquaucune exprience possible ne fournit une
totalisation des sries rgressives empiriques dont il sagit ici.
la diffrence que vous faites entre une totalisation infinie et une totalisation finie est tout entire dans
lide.
5.4.2.2 Description oprationnelle de la section 7. Dcision critique du conflit
cosmologique de la raison avec elle-mme.
K a n t i d e n t i f i e i c i l e r r e u r s u r l a q u e l l e re p o s e t o u t e l a n t i n o m i e de l a ra i s o n
p u r e . P o u r ap e r c e v o i r l e r r e u r , i l fa u t au pr a l a b l e di s t i n g u e r en t r e un e s r i e (d e
t o u t e s l e s co n d i t i o n s ) p r o p o s e s e u l e m e n t et un e s r i e p r o p o s e et do n n e .
[ S e p t i m e s e c t i o n . 41 8 - 4 2 3 . ]
Dabord: quand le conditionn est donn, une rgression dans la srie de toutes ses condition nous est
propose par l mme. (418.2)
Ensuite: si le Conditionn donn est une chose en soi, alors linconditionn est aussi donn. Mais ce nest
pas le cas pour les phnomnes. Je ne peux donc pas conclure la totalit de la srie de leurs conditions.
Une rgression est propose seulement.
Il rsulte que le raisonnement cosmologique
a une majeure qui prend le conditionn dans le sens transcendantal dune catgorie pure (419.2.2-
3);
a une mineure qui prend le conditionn dans le sens empirique dun concept de lentendement
appliqu de simples phnomnes (419.2.3-5).
La reconstitution du raisonnement dialectique en un seul syllogisme et la critique qui en est faite
rappellent celles faites loccasion du raisonnement psychologique, p. 345.3-346.2. Largument de
la rfutation est sensiblement le mme et le verdict est le mme. Cependant lantithtique a ceci de
1
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
140
particulier que le litige ne se termine pas l [420.2]. Il faut montrer que lopposition antinomique
elle-mme nest quune apparence.
141
LES CONCEPTS ET LES THSES DE LANTINOMIE DE LA RAISON PURE
La catgorie
concerne
[pp. 364-366]
Intgration produisant les
ides cosmologiques
[p. 367]
le tout obtenu
[410.1.6-7]
Le nom du premier
terme des sries
ralisant la totalit de
la synthse rgressive
[p. 368.2]
Les antinomies elles-mmes
(les propositions en relation antithtique:
Th / Ath)
[pp. 373-397]
Questions manifestant lintrt
La totalit
(364.4-365.1)
Lintgrit absolue de
lassemblage du tout donn
de tous les phnomnes
Le tout de la quantit
Le commencement
du monde
La limite du monde
(Th.) Le monde a un commencement dans le
temps
(Ath.) Le monde na pas de commencement; il
est infini dans le temps (373)
(Th.) Le monde est limit dans lespace
(Ath.) Le monde na pas de limite dans
lespace; il est infini
Le monde a-t-il un
commencement?
Y a-t-il quelque limite
ltendue du monde dans
lespace?
La ralit (dans
lespace)
(365.2)
Lintgrit absolue de la
division
Le tout de la division
Le simple (Th.) Il nexiste absolument rien que le simple
et le compos du simple (379)
(Ath.) Il nexiste dans le monde absolument
rien de simple
Y a-t-il quelque part, peut-tre
dans le moi pensant, une unit
indivisible et imprissable, ou
ny a-t-il rien que de divisible et
de passager?
La causalit
(366.2)
Lintgrit absolue de
lorigine <Entstehung> dun
phnomne en gnral.
Le tout de la drivation
<Abstammung>
La spontanit absolue
(libert)
(Th.) Pour expliquer les phnomnes, il est
ncessaire dadmettre, en plus de la causalit
dtermine par les lois de la nature, une
causalit libre (386)
(Ath.) Il ny a pas de libert, mais tout dans le
monde arrive suivant des lois naturelles
Suis-je libre de mes actions, ou,
comme les autres tres, suis-je
conduit par le fil de la nature et
du destin?
La ncessit
comme totalit
des conditions
de lexistence du
contingent
(366.3)
Lintgrit absolue de la
dpendance de lexistence
Le tout de la condition de
lexistence en gnral
La ncessit naturelle
absolue (= ltre
ncessaire) en tant que
ncessit inconditionne
des phnomnes
(Th.) Le monde implique quelque chose qui,
soit comme sa partie, soit comme sa cause, est
un tre absolument ncessaire (391)
(Ath.) Il nexiste nulle part aucun tre
absolument ncessaire, ni dans le monde, ni
hors du monde, comme en tant la cause
Y a-t-il une cause suprme du
monde, ou les choses de la nature
et leur ordre forment-ils le
dernier objet o nous devions
nous arrter dans toutes nos
recherches
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
142
K a n t i n t r o d u i t de u x co n c e p t s : ce l u i d o p p o s i t i o n d i a l e c t i q u e et ce l u i
d o p p o s i t i o n an a l y t i q u e , pu i s s e n s e r t po u r t h o r i s e r l a na t u r e de
l o p p o s i t i o n en t r e l a t h s e et l a n t i t h s e .
La thse et lantithse sont dans une opposition dialectique et paraissent tre dans une opposition
analytique.
Kant montre comment
lopposition contradictoire (quand je suppose le monde comme chose en soi)
se mue en opposition dialectique lorsque je place le monde dans la rgression empirique de la srie
des phnomnes. (CRPu, Bar 422.2)
Consquence: On fait donc disparatre lantinomie de la raison pure dans ses ides cosmologiques, en
montrant quelle est simplement dialectique, et quelle est un conflit produit par une apparence rsultant
de ce que lon applique lide de labsolue totalit, laquelle na de valeur que comme condition des
choses en soi, des phnomnes, qui nexistent que dans la reprsentation, et, lorsquils constituent une
srie, dans la rgression successive, mais non pas autrement. (CRPu, Bar 423.2.1-8)
K a n t t e r m i n e l a s e c t i o n en m o n t r a n t qu e l e x i s t e n c e de l a n t i n o m i e , en t a n t qu e
n o u s co n n a i s s o n s ce qu i l a pr o d u i t , a un e ut i l i t t h o r i q u e . [4 2 3 . 2 - 3 ]
On peut invoquer le fait de lantinomie comme argument dans une dmonstration indirecte de lidalit
transcendantale des phnomnes (CRPu, Bar 423.2.12). La dmonstration se droule ainsi:
Si le monde est un tout existant en soi, il est ou fini ou infini.
Or le premier cas aussi bien que le second sont faux (suivant les preuves, rapportes plus haut, de
lantithse dun ct, et de la thse de lautre). [Voici le rsultat obtenu ci-dessus utilis ici comme
argument.]
Il est donc faux aussi que le monde (lensemble de tous les phnomnes) soit un tout existant en soi.
[par modus tollens appliqu sur la premire prmisse.]
Do il suit par consquent que les phnomnes en gnral ne sont rien en dehors de nos reprsen-
tations, et cest prcisment ce que nous voulions dire en parlant de leur idalit transcendantale.
(CRPu, Bar 423.2.10f)
la dialectique transcendantale nous prvient quon fait fausse route en supposant que les phnomnes et
le monde sensible qui les comprend tous sont des choses en soi (423.3.4-5); on peut bien dire que, ce
faisant, elle vient en aide la mthode sceptique, mais ce qui nest pas du tout la mme chose que venir
en aide au scepticisme.
5.4.2.3 Les solutions des antinomies
8
e
Section: PRINCIPE RGULATEUR DE LA RAISON PURE PAR RAPPORT AUX IDES COSMOLOGIQUES
Succinctement, on peut noncer le principe rgulateur concern de la faon suivante:
chercher le maximum de la srie des conditions du monde sensible seulement dans la rgression de cette
srie, et non dans les choses en soi. (CRPu, Bar 424.1.2-5)
remonter dans la srie des conditions des phnomnes donns sans jamais sarrter dans un
inconditionn absolu (CRPu, Bar 424.1.m19-17)
Le principe dit comment nous devons instituer la rgression empirique (425.2.3-4) et nanticipe pas ce qui
est donn en soi dans lobjet antrieurement toute rgression. (424.1.m6-4)
2
3
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
143
9
e
Section: DE LUSAGE EMPIRIQUE DU PRINCIPE RGULATEUR DE LA RAISON PAR RAPPORT TOUTES LES
IDES COSMOLOGIQUES
I. SOLUTION DE LIDE COSMOLOGIQUE DE LA TOTALIT DE LA RUNION DES PHNOMNES EN UN
UNIVERS.
II. SOLUTION DE LIDE COSMOLOGIQUE DE LA TOTALIT DE LA DIVISION DUN TOUT DONN DANS
LINTUITION [CRPu, Bar 432.5-435.1]
Largumentation de Kant porte sur deux points:
ARGUMENT 1. Le nombre des parties dun tout donn nest pas dtermin par le caractre de la
divisibilit dun corps tendu mais par la division effectue de ce corps.
ARGUMENT 2. Le caractre structur (ou organis) [gegliedert, organisiert] dun tout nest pas la
mme chose que son caractre divisible. Les parties dun tout ne peuvent pas tre la fois dtermines
et en nombre infini. En dautres termes, si une multiplicit de parties est donne dans une synthse la
division rgressive qui a dtermin ces parties nest pas complte, ou totale; et si la division est suppose
complte et totale, les parties ne peuvent tre considres comme dtermines.
Concernant largument 1.
Tout corps, en tant qutendu, est divisible linfini.
la rgression de conditionn condition va ad infinitum et non pas ad indefinitum comme dans le cas
(prcdent, celui de la premire antinomie) o les conditions sont situes lextrieur du tout considr.
cette rgle de la progression linfini sapplique sans aucun doute dans la subdivision dun phnomne,
considr simplement comme remplissant lespace (CRPu, Bar 434.2.1-4). [L]infinit de la division
dun phnomne donn dans lespace se fonde uniquement sur ce que par ce phnomne est donne
simplement la divisibilit, cest--dire une multitude de parties absolument indtermine en soi, tandis
que les parties elles-mmes ne sont donnes et dtermines que par la subdivision. (CRPu, Bar
434.2.13-19)
Nanmoins il nest nullement permis de dire dun tout divisible linfini quil se compose dun nombre
infini de parties.
En effet, bien que toutes les parties soient renfermes dans lintuition du tout
elle [cette intuition] ne contient cependant pas toute la division du tout, laquelle ne consiste que dans la
dcomposition continuelle, ou dans la rgression mme, qui rend dabord relle la srie.
REFORMULATION. Il est ncessaire de distinguer, lorsquon examine le contenu de lintuition donne, entre
la srie entire de la division [] successivement infinie est potentielle ou virtuelle; et les
membres (parties) auxquels la rgression arriverait (si elle allait linfini) ne peuvent tre contenus
dans lintuition qu titre dagrgats et non titre de parties spares les unes des autres; ce sont des
parties non dtermines.
la srie relle de la division, celle donne par la rgression effectue, fournit des parties dtermines
mais comme elle ne peut pas se poursuivre linfini, elle ne peut prsenter une multitude infinie
[de parties] et une synthse de cette multitude en un tout. (CRPu, Bar 433.1.3f)
Cest seulement la srie relle entendons celle qui a t ralise qui peut tre contenue (donne)
dans lintuition.
Commentaire sur la remarque 433.4-434.1. Ma reformulation de la thse de cette remarque: La
diffrence quune impression superficielle nous suggre entre la divisibilit de lespace et celle dun
corps occupant lespace est illusoire.
1. nonc de la prsume diffrence qui pourrait poser un problme. La dcomposition de
lespace ne peut pas exclure la composition (de ce quon a dj obtenu par dcomposition),
puisque lespace cesserait si on faisait cette exclusion. En revanche, la dcomposition du corps
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
144
semble diffrente en ceci: si on exclut la composition, il reste, semble-t-il, quelque chose car, sinon,
le corps ne saccorderait pas avec le concept dune substance laquelle devrait [] subsister dans
ses lments, encore quet disparu lunion de ces lments dans lespace, union par laquelle ils
forment un corps. (CRPu, Bar 434.1.5-8)
2. Solution. Nous nous trompons si nous pensons que quelque chose dinconditionn est donn
lintuition grce la reprsentation de la substance dun corps. il nen est pas de ce qui sappelle
substance dans le phnomne comme de ce que lon penserait dune chose en soi au moyen dun
concept pur de lentendement. Cette substance nest pas un sujet absolu, mais une image
permanente de la sensibilit; elle nest quune intuition dans laquelle ne se trouve rien
dinconditionn. (CRPu, Bar 434.1.7f)
Concernant largument 2.
Quand on conoit un tout comme organis, on conoit ses parties comme dtermines.
Quand on conoit un tout organis comme ayant des structures chaque niveau de rgression, et ce linfini
<bei einem ins Unendliche gegliederten organischen Krper>, on prtend penser la fois que des parties sont
dtermines et sont en nombre infini; or, ce concept est contradictoire:
dune part, ce dveloppement infini est considr comme une srie qui nest jamais complte (infinie)
[dautre part] il est cependant regard comme complet dans une synthse. (CRPu, Bar 434.2.m5-2)
Lincompltude de la srie rgressive dcoule ncessairement de son caractre infini, selon la thse dj contenue
dans largument 1; et la dtermination des parties dans une synthse dcoule du caractre structur, par hypothse,
de chacune des parties obtenues par subdivision, au cours de la rgression.
Si donc un tout est conu comme quantum discretum, la division de ses parties ne peut pas la fois procder
linfini ET donner, chaque nouvelle division, encore un tout discret, organis ou articul <gegliedert>. Dans ce cas
la multitude des units y est dtermine;
elle est donc toujours gale un nombre.
seule lexprience, donc, peut dcider jusquo lorganisation peut aller (CRPu, Bar 435.1.4-7).
Il semble clair quon doit faire une diffrence entre divisible et structur (ou organis). Y a-t-il lieu
de faire galement une diffrence entre compos <zusammengesetzt> et structur <gegliedert,
organisiert, organisch>? Et quen est-il du rapport entre divisible et compos : est-il possible que le
simple (en tant que non-compos) soit nanmoins divisible (en tant quoccupant lespace, lequel
est a priori infiniment divisible)? En tout cas lide que le simple soit divisible ne me semble pas
entrer en contradiction avec la manire dont la divisibilit est explique dans le passage suivant:
La division infinie ne dsigne le phnomne que comme quantum continuum, et elle est
insparable de lide de quelque chose qui remplit lespace, puisque cest dans cette ide quest le
principe de la divisibilit infinie. (CRPu, Bar 434.2.m2-435.1.2)
Concernant le rapport entre les arguments et les propositions de lantinomie, du point de vue de la rfutation.
Reste la question de savoir comment les arguments sont relis la rfutation des propositions
antinomiques; est-ce que le premier argument invalide la thse, et le second lantithse? ou sont-
ce plutt les deux arguments pris conjointement qui empchent le rapport antithtique de se
former?
Est-ce que laffirmation de la divisibilit linfini, pour tout corps tendu, suffit invalider
laffirmation du simple? (est-ce seulement le caractre universel de laffirmation du simple qui est
ni?) Est-ce que largument concernant les corps organiss sadresse seulement lantithse?
Est-ce que la contradiction mentionne par largument 2 est prsente dans lantithse ou sa
dmonstration?
Pour les corps considrs simplement comme remplissant lespace, la dtermination du nombre des
parties dpend du progrs de la division indpendamment du fait que le corps, en tant qutendu, soit divisible
linfini. Le principe de la raison qui sapplique ici, et qui est transcendantal, est le suivant: ne tenir jamais pour
absolument complte la rgression empirique dans la dcomposition de ce qui est tendu (CRPu, Bar 435.1.3f). Ce
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
145
qui suffit nous empcher daffirmer toute proposition qui suppose une rgression complte, aussi bien une
proposition voulant que la rgression complte rvle toujours le simple et ne procde jamais linfini (proposition
telle que la thse de la deuxime antinomie: il nexiste que du simple et du compos du simple), quune proposition
voulant que la rgression complte rvle une infinit de la composition (proposition telle que lantithse de la
deuxime antinomie: il nexiste pas de simple)
Pour les corps considrs comme organiss, la dtermination du nombre des parties est renvoye
lexprience; ce qui nous empche daffirmer universellement et a priori aussi bien la proposition voulant que les
parties soient en nombre fini (proposition telle que la thse de la deuxime antinomie) que la proposition voulant
que les parties soient en nombre infini (proposition telle que lantithse de la deuxime antinomie).
AUTRE FORMULATION
On ne peut conclure lexistence de lobjet simple, car il est illgitime de supposer que la rgression est la
fois complte et finie; il existe au moins un sens dans lequel la division rgressive est toujours infinie et, donc,
incomplte: cest quant le phnomne est conu comme remplissant lespace.
On ne peut conclure la non-existence du simple, car il est illgitime de supposer une infinit de parties
organises (et donc dexclure loccurrence de parties inorganiques, lesquelles seraient simples au sens de non-
organises <nicht gegliedert> ) avant que ne soit effectue la rgression empirique qui donne les parties dans
lintuition.
III. SOLUTION DES IDES COSMOLOGIQUES DE LA TOTALIT DE LA DRIVATION QUI FAIT SORTIR LES
VNEMENTS DU MONDE DE LEURS CAUSES. [CRPu, Bar 437.3-452.2]
La troisime antinomie met en prsence des assertions qui se prononcent sur la question de la causalit libre
ou de la libert. La thse affirme La causalit dtermine par les lois de la nature nest pas la seule do puissent
tre drivs tous les phnomnes du monde. Il est ncessaire dadmettre aussi, pour les expliquer, une causalit
libre. Lantithse, de son ct, affirme quil ny a pas de libert et que tout dans le monde arrive suivant des
lois naturelles. (CRPu, Bar 386.a.1 et b.1).
La solution de la troisime antinomie rside dans la fameuse doctrine kantienne de la double causalit. Les
deux premiers paragraphes lnoncent dj dans ses termes gnraux:
On ne peut concevoir relativement ce qui arrive que deux espces de causalit: lune suivant
la nature, lautre / par la libert. La premire est la liaison dans le monde sensible dun tat avec le
prcdent, auquel il succde daprs une rgle. Or, comme la causalit des phnomnes repose sur
des conditions de temps, et que ltat prcdent, sil et toujours t, naurait pas produit un effet qui
se montre pour la premire fois dans le temps, la causalit de la cause de ce qui arrive ou commence,
a commenc aussi, et son tour, daprs le principe de lentendement, a besoin elle-mme dune
cause.
Jentends au contraire par libert, dans le sens cosmologique, la facult de commencer par
soi-mme un tat dont la causalit ne rentre pas son tour, suivant la loi naturelle, sous une autre
cause qui la dtermine dans le temps. La libert est en ce sens une ide transcendantale pure, qui
dabord ne contient rien demprunt lexprience, et dont ensuite lobjet ne peut mme tre donn
et dtermin dans aucune exprience, parce que cest une loi gnrale, mme pour la possibilit de
toute exprience, que tout ce qui arrive doit avoir une cause, et que par consquent la causalit des
causes qui elles-mmes arrivent ou commencent dtre, doit aussi son tour avoir sa cause; ce qui
transforme tout le champ de lexprience, aussi loin quil peut stendre, en un champ de pure
nature. Mais, comme de cette manire on ne saurait arriver dans la relation causale aucune totalit
absolue des conditions, la raison se cre lide dune spontanit qui peut commencer delle-mme
agir, sans quune autre cause ait d prcder pour la dterminer laction suivant la loi de la liaison
causale.
(CRPu, Bar 437.f.1-438.2.f)
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
146
Largumentation en faveur de cette solution commence par une question propos de la proposition tout effet
dans le monde doit rsulter ou de la nature ou de la libert. Kant demande si cette proposition est rigoureusement
disjonctive et, jugeant que non, va plutt estimer que les deux membres de cette alternative peuvent se trouver
ensemble, mais en des sens diffrents, dans un seul et mme vnement (CRPu, Bar 440.1.4-8). Sans reconstituer
largumentation dans le dtail de sa forme, nous pouvons dgager les thses suivantes qui, ensemble, constituent la
solution du troisime conflit de la raison pure avec elle-mme:
Puisque les phnomnes sont de simples reprsentations qui senchanent suivant des lois empiriques, ils
doivent avoir eux-mmes des causes qui ne sont pas des phnomnes (440.1.m18-16). (PRINCIPE DU
FONDEMENT TRANSCENDANTAL DES PHNOMNES EN GNRAL.)
une cause intelligible de ce genre nest point dtermine relativement sa causalit par des phnomnes
(440.1.m16-14); Elle est ainsi avec sa causalit <samt ihrer Kausalitt> en dehors de la srie, tandis que ses
effets sont dans la srie des conditions empiriques. (m12-10) Attention: cette phrase doit sinterprter en
tenant compte du fait que le sujet dot dun tel pouvoir causal est bien un sujet du monde sensible
(441.2.m10) et du contraste qutablira Kant entre ce sujet du monde sensible et ltre ncessaire apparaissant
dans la solution de la quatrime antinomie. Cette manire [celle qui postule un tre ncessaire, en rponse
la quatrime antinomie] de donner pour principe aux phnomnes une existence inconditionne se
distinguerait donc de la causalit empiriquement inconditionne (de la libert) dont il tait question dans
larticle prcdent, en ce que dans la libert la chose elle-mme <das Ding selbst> faisait partie, comme cause
(substantia phaenomenon), de la srie des conditions et que sa causalit seule tait conue comme
intelligible, tandis quici ltre nces-/saire devrait tre conu tout fait en dehors de la srie du monde
sensible (comme ens extramundanum) et dune manire purement intelligible [] CRPu, Bar 453.f.m8-
454.1.3) Ainsi la chose-cause-libre est en dehors de la srie des conditions empiriques mais nest pas en
dehors de la srie des conditions en gnral.
donc, leffet peut tre considr comme libre, par rapport sa cause intelligible, et en mme temps, par
rapport aux phnomnes, comme une consquence de ces phnomnes suivant la ncessit de la nature.
(440.1.m9-6) (THSE DE LA CO-POSSIBILIT DES CARACTRES LIBRE ET NCESSAIRE POUR UN EFFET
DONN.)
Il est possible, pour un sujet, de possder un pouvoir causal caractre intelligible quant son action et un
pouvoir causal caractre empirique, ou sensible, quant son effet. (441.2.7-10) (THSE DE LA CO-
POSSIBILIT DES CARACTRES INTELLIGIBLE ET SENSIBLE POUR UN SUJET DONN POSSDANT UN
POUVOIR CAUSAL.)
IV. SOLUTION DE LIDE COSMOLOGIQUE DE LA TOTALIT DE LA DPENDANCE DES PHNOMNES
QUANT LEUR EXISTENCE EN GNRAL. [CRPu, Bar 452.3-457.1]
Traduction de CRPu, Bar 454.3.m4-2.
Barni dit: Un tre intelligible de ce genre, un tre absolument ncessaire ft-il impossible en soi,
cest du moins ce que lon ne saurait conclure de la contingence universelle []
Je propose: Aussi impossible que puisse tre un tel tre intelligible <Verstandeswesen> absolu-
ment ncessaire, cette impossibilit ne saurait tre conclue de la contingence universelle [] .
5.4.3 LAppendice la Dialectique transcendantale
Le plus grand usage empirique possible de ma raison
faire de cet tre suprme un schme du principe rgulateur du plus grand usage empirique possible de
ma raison (CRPu, Bar 524.1.3f)
Lunit du systme; le caractre systmatique de la connaissance
Lunit rationnelle est lunit du systme, et cette unit systmatique na pas pour la raison lutilit
objective dun principe qui ltendrait sur les objets, mais lutilit subjective dune maxime qui
lapplique toute connaissance empirique possible des objets. (CRPu, Bar 525.2.11-15)
T H M E # 9. L A D I A L E C T I Q U E II . L E S A N T I N O M I E S .
_____________________________________________________________________________________________
147
rinterprtation de lide du sujet pensant selon sa fonction de principe rgulateur: 526.3; 526.3.m10-
527.1.4
passage lide dunit finale (CRPu, Bar 529.2.2) comme unit formelle suprme: [529.2-530.1] et
[531.1.19-f] Le principe de lunit finale peut toujours tendre lusage de la raison par rapport
lexprience, sans lui faire tort en aucun cas. (CRPu, Bar 531.1.3f)
149
K <> T h m e # 1 0 <> K
6 . L a C r i t i q u e d e l a r a i s o n
p r a t i q u e
6. La Critique de la raison pratique.............................................................................................145
6.1 De la Critique de la raison pure la Critique de la raison pratique...........................................145
6.1.1 De la pense objective la pense subjective..............................................................145
6.1.2 Du problme (cosmologique) de la possibilit dune cause inconditionne au problme
(pratique) de la dtermination de la volont.................................................................146
6.2 La question de la cohrence et de la compatibilit................................................................148
6.3 Les thses de la philosophie pratique de Kant.....................................................................148
6.1 De la Critique de la raison pure la Critique de la raison pratique
6.1.1 De la pense objective la pense subjective
Larticulation principale entre la Critique de la raison pure (dsigne par CRPu ci-aprs) et la Critique de
la raison pratique (dsigne CRPa ci-aprs) est celle que fait Kant entre lusage spculatif de la raison et son
usage pratique. (Cette articulation doit tre distingue soigneusement de celle entre usage empirique et usage
pur de la raison, dont on trouve un exemple en CRPu, Bar 455.3, la fin du chap. II de la Dialectique.) En son
usage spculatif, la raison est implique dans les processus de production de la connaissance et son principal rle est
de fournir des principes lentendement; en son usage pratique, la raison est implique dans les processus de
production de la moralit, et plus gnralement dans les processus qui dterminent les actions humaines.
Cest la mme articulation que lon dcrit en opposant la pense objective la pense subjective, le savoir
la croyance.
Dans ce monde de choses effectivement prsentes indpendamment de mes actes, mais qui ne
deviennent objets de perception et de conception quen fonction de mes facults sensibles et
intellectuelles, je ne peux mempcher de penser ce quelles pourraient, ce quelles devraient tre en
soi: tel est le champ de la croyance laquelle le savoir / doit laisser sa place; en effet, selon la
Critique de la raison pure, lobligation de reconnatre lexistence de la chose en soi suffit pour
fonder la lgitimit de cette pense subjective, prive de toute connaissance objective sur la chose en
soi, quon appelle la foi: la doctrine reste vague, la place est vide, mais elle est ouverte, notamment
dans la prface de la seconde dition; il faudra la Critique de la raison pratique, qui nous engagera
dans ltre et non dans la simple connaissance de ltre, pour fonder une doctrine plus ferme de la
croyance portant sur la nature de ltre en dehors des limites de lexprience possible : ce ne sera pas
lextension dun savoir objectif, mais la motivation renforce dune confiance subjective utile pour
laccomplissement du devoir.
(ROUSSET, Bernard. Prsentation, CRPu, Bar, dition de 1976, p. 17-18)
150
Pour connatre la manire dont Kant traite lui-mme les rapports entre les principes de la raison pure pratique
et ceux de la raison pure thorique, dans le contexte dune proccupation pour la connaissance <Erkenntnis> et en
des termes relativement non techniques, on se rfrera utilement
la Prface de la seconde dition de CRPu. La majeure partie (CRPu, Bar 43.1-51.1) de cette prface est
consacre par Kant justement mettre en perspective les enjeux respectifs de lune et lautre Critique. La
proccupation dominante du prfacier est dassurer son lecteur que les rsultats ngatifs de CRPu, eu gard
aux limites des facults de connaissance, loin dentraner un dsavantage pour la morale et pour la
philosophie qui rflchit lusage pratique de la raison pure, ont une utilit positive de la plus haute
importance. La thse principale affirme que CRPu, en limitant la raison dans son usage spculatif (et en
distinguant finement ce qui relve de cet usage et ce qui relve de lusage pratique) supprim[e] du mme
coup lobstacle qui [] limite lusage pratique [de la raison], ou menace mme de lanantir (CRPu, Bar
46.1.15-17), cet obstacle tant justement de tout faire rentrer dans les limites de la sensibilit; la CRPu a
[] une utilit positive de la plus haute importance. [On le reconnatra] ds quon sera convaincu
que la raison pure a un usage pratique absolument ncessaire (lusage moral), ou elle stend
invitablement au-del des bornes de la sensibilit: car si elle na besoin pour cela daucun secours
de la raison spculative, elle veut pourtant tre assure contre toute opposition de sa part, afin de ne
pas tomber en contradiction avec elle-mme. Nier que la critique, en nous rendant ce service, ait une
utilit positive, reviendrait dire que la police na pas dutilit positive, parce que sa fonction
consiste uniquement mettre obstacle la violence que les citoyens pourraient craindre les uns des
autres, afin que chacun puisse faire ses affaires tranquillement et en sret.
(CRPu, Bar 46.1.17-m12)
la section VII de la Critique de la raison pratique intitule Comment est-il possible de concevoir une
extension de la raison pure, au point de vue pratique, qui ne soit pas accompagne dune extension de sa
connaissance, comme raison spculative? (CRPa, Pic 143-151) Cette section fait partie de la Dialectique de
la raison pure pratique.
6.1.2 Du problme (cosmologique) de la possibilit dune cause inconditionne au
problme (pratique) de la dtermination de la volont
Larticulation prcdente est cependant bien gnrale et on peut lui donner beaucoup plus de contenu en
spcifiant quel concept fait le pont entre la problmatique de CRPu et celle de CRPa. Ce concept est trs exactement
celui de la cause intelligible, en tant quelle est libre; cest, pour le dire dans un langage moins technique, lide de
libert. Cest dans la solution de la troisime antinomie CRPu, 9 III de lAntithtique de la raison pure que
se trouvent les thses et concepts qui conduisent au seuil de CRPa et constituent le passage le plus harmonieux,
conceptuellement, de la problmatique de la premire critique celle de la deuxime. (La doctrine de la double
causalit est dailleurs rappele de faon succincte dans la Prface la seconde dition de CRPu.)
Rappelons les trois thses qui fournissent la solution de la troisime antinomie (voir 5.4.2 ci-dessus, dans le
fascicule Thme 9. La Dialectique transcendantale II. Les antinomies.):
1. Le principe du fondement transcendantal des phnomnes en gnral.
2. La thse de la co-possibilit des caractres libre et ncessaire pour un effet donn.
3. La thse de la co-possibilit des caractres intelligible et sensible pour un sujet donn possdant un
pouvoir causal.
Il conviendrait dajouter ces trois thses la suivante, seule fin dintroduire dans la cause intelligible
jusquici conue comme chose en soi ou comme sujet sensible du monde une entit de type reprsentationnel,
savoir les principes purs de lentendement.
Parmi les causes naturelles il en est aussi qui ont un pouvoir purement intelligible, en ce sens que ce
qui dtermine ce / pouvoir laction ne repose jamais sur des conditions empiriques, mais sur de
purs principes de lentendement, de telle sorte cependant que laction phnomnale de cette cause
est conforme toute les lois de la causalit empirique.[] de cette manire, le sujet agissant, comme
causa phnomenon, [est] enchan la nature, dans tous ses actes, par un lien indissoluble; seul le
151
phnomenon de ce sujet (avec toute sa causalit dans le phnomne) [contient] certaines conditions
qui, si lon voulait remonter de lobjet empirique lobjet transcendantal, devraient tre considres
comme purement intelligibles. (THSE DE LA DTERMINATION DE LACTION LIBRE PAR DES
PRINCIPES DE LENTENDEMENT.)
(CRPu, Bar 444.f.m2-445.1.11)
Commentaire. Lexgse de ce passage est incertaine. Pourrait-on le reformuler en remplaant
principes de lentendement par principes de la raison? Et comment doit-on interprter ladjectif
naturelles dans lexpression causes naturelles? Est-ce que lopposition entre nature et libert
continue de valoir ici? Noter que CFJ affirme ds son troisime paragraphe que la volont comme
facult de dsirer, est en effet une dentre les multiples causes naturelles dans le monde, savoir
celle qui / agit daprs des concepts (CFJ, Pko 21.3.1-22.1.1).
Les thses prcdentes contiennent tous les concepts qui permettent de passer la problmatique de CRPa,
savoir celle de la dtermination de la volont. Kant va effectuer lui-mme ce passage lendroit prcis o il crit:
Appliquons cela lexprience. Lhomme est un des phnomnes du monde sensible, et ce titre il
est aussi une des causes naturelles dont la causalit doit tre soumise des lois empiriques. []
Mais lhomme [] est aussi par un autre [ct], cest--dire relativement certaines facults, un
objet purement intelligible, puisque son action ne peut tre attribue la rceptivit de la sensibilit.
Ces facults, nous / les appelons entendement et raison [].
CRPu, Bar 445.f.m18-446.1.1)
Le propos de Kant nest pas de prouver que lhomme est libre, ni mme de montrer que la libert est possible
(ces prcautions oratoires se trouvent dans le tout dernier paragraphe de 9 III), mais bien de montrer que la nature
nest pas en contradiction avec la causalit libre, mme dans le contexte particulier o, largissant les considrations
cosmologiques, nous parlons des deux types de dterminations qui influent sur les actions humaines: les impratifs
associs au devoir et les causes dterminantes de type empirique (conditions naturelles, mobiles sensibles,
circonstances occasionnelles). Plus spcifiquement, Kant explicite les quelques relations par lesquelles nous
nous reprsentons la causalit de la raison, considre comme facult active. Il attribue la raison les caractres
empirique et intelligible quil a prcdemment distingus dans la solution de la troisime antinomie (et quil
attribuait alors, de faon trs gnrale un sujet du monde sensible ou, plus abstraitement, une chose
possdant un pouvoir causal) et oppose les uns aux autres des traits de la causalit empirique et des traits de la
causalit intelligible; et lon voit apparatre au nombre de ces derniers:
un pur concept cest le devoir servant de principe une action possible (CRPu, Bar 446.3.1-2).
lide que la raison se cre avec une parfaite spontanit un ordre propre suivant des ides auxquelles
elle adapte les conditions empiriques et daprs lesquelles elle tient pour ncessaires des actions qui ne
sont pas arrives et qui peut-tre narriveront pas, mais sur lesquelles elle suppose nanmoins quelle
peut avoir de la causalit (CRPu, Bar 446.f.6f). [Ce qui laisse penser que les ides peuvent exercer le
pouvoir causal, lgard de laction.]
la raison ntant pas elle-mme un phnomne et ntant nullement soumise aux conditions de la
sensibilit, il ny a en elle, mme relativement sa causalit, aucune succession, et par consquent la loi
dynamique de la nature, qui dtermine la succession suivant des rgles, ne peut sy appliquer. (CRPu,
Bar 449.2.6f)
le caractre empirique dun acte volontaire humain nest que le schme sensible du caractre intelligible
de cet acte (CRPu, Bar 449.3.2-6).
En tout ceci Kant sen tient dassez prs la libert en son sens cosmologique nommment attribue la
raison:
[] si la raison peut avoir de la causalit par rapport aux phnomnes, cest quelle est une facult
par laquelle commence vritablement la condition sensible dune srie empirique deffets. Car la
condition qui rside dans la raison nest pas sensible, et par consquent ne commence pas elle-
mme. Nous trouvons donc ici ce que nous cherchions en vain dans toutes les sries empiriques :
152
une condition dune srie dvnements successifs qui est elle-mme empiriquement
inconditionne. (CRPu, Bar 448.2.m9-449.1.1)
Mais en montrant que cette conception de la libert fait partie de la justification quon peut donner du jugement
dimputabilit (par exemple, on blme lauteur dun mensonge mchant), Kant amne la rflexion au seuil des
questions qui vont faire lobjet de CRPa:
Quels principes intelligibles, issus de la raison pure, peuvent servir de fondement et de critre au
caractre moral des actions?
Quelles conditions de laction (humaine) vont concerner la dtermination de la volont elle-mme
(CRPu, Bar 446.3.6-7)?
6.2 La question de la cohrence et de la compatibilit
La structure densemble de la Critique de la raison pratique
Globalement, la structure des deux Critiques est isomorphe sur deux des plus hauts niveaux darticulation.
C r i t i q u e de l a r a i s o n pu r e C r i t i q u e de l a r a i s o n pr a t i q u e
Thorie des lments
Esthtique transcendantale
Logique transcendantale
Analytique transcendantale
Analytique des concepts
Analytique des principes
Dialectique transcendantale
Des concepts de la raison pure
Des raisonnements dialectiques
Mthodologie transcendantale
Doctrine lmentaire de la raison pure pratique
Lanalytique de la raison pure pratique
Des principes de la raison pure pratique
Du concept dun objet de la raison pure pratique
Des mobiles de la raison pure pratique
Dialectique de la raison pure pratique
Dune dialectique de la raison pure pratique en gnral
De la dialectique de la raison pure dans la dtermination du
concept du souverain bien
Mthodologie de la raison pure pratique
Si maintenant nous comparons cette analytique <damit> la partie analytique de la Critique de la
raison pure spculative, un merveilleux contraste nous apparat entre lune et lautre. (CRPa, Pic
42.2) et pages suiv.
La compatibilit des thses
La note 3 (p. 178-181) de CRPa, Pic consiste en une compilation de passages extraits des deux Critiques,
passages qui concernent les rapports entre les deux Critiques.
6.3 Les thses de la philosophie pratique de Kant
On trouve un rsum succinct des positions pratiques de Kant dans la fiche 9 (p. 79-84) de BAy, FK.
153
K <> T h m e # 1 1 <> K
7 . L e c r i t i c i s m e :
u n e r e c o n s t i t u t i o n d a p r s
l a C r i t i q u e d e l a f a c u l t d e j u g e r
7. Le criticisme : une reconstitution daprs la Critique de la facult de juger .....................................149
7.1 La position du problme................................................................................................149
7.1.1 Les trois principes de classement et leurs typologies respectives.....................................150
7.1.2 Le problme de larticulation des typologies. La matrice C-P-D E-J-R (matrice des 6
facults).............................................................................................................156
7.2 Les cls de la thorie des facults contenues dans la Critique de la facult de juger......................165
7.2.1 La problmatique propre la Critique de la facult de juger............................................165
7.2.2 La conceptualit de la Critique de la facult de juger.....................................................169
7.2.3 Les explananda (tats de choses dcrire) et les explicanda (concepts clarifier) eu gard aux
plans dactivit C-P-D............................................................................................177
7.3 Les registres de lecture de la matrice des 6 facults...............................................................179
7.3.1 Registre 1. Le registre des reprsentations. Les facults comme sources ou siges de
reprsentations......................................................................................................181
7.3.2 Registre 2. Le registre des processus.........................................................................193
7.4 La question de lunit de la Critique de la facult de juger......................................................205
8. Le criticisme interprt selon la perspective des abmes de lesprit................................................206
7.1 La position du problme
Dans lIntroduction la Critique de la facult de juger, Kant dclare :
Or, entre la facult de connatre et la facult de dsirer se trouve compris le sentiment de plaisir, tout
de mme que la facult du juger est comprise entre lentendement et la raison.
(CFJ, Pko 27.1.10-12)
Dans la prsente section 7.1, je me propose dexpliquer cette phrase et de lui donner une interprtation qui fasse
ressortir comment les relations entre les facults peuvent elles seules donner voir larchitectonique de la raison
pure dans toute sa momumentalit.
Pour montrer le caractre systmatique de la critique kantienne, je vais dabord montrer les typologies selon
lesquelles Kant distingue et ordonne les facults, puis expliciter le rseau des relations qui stablissent entre ces
facults loccasion des divers processus cognitifs auxquels elles participent. La description de ce systme de
rapports et de processus me donnera loccasion de prciser
154
les concepts et principes que les facults possdent, contiennent, produisent ou appliquent dans laccom-
plissement des diverses tches qui les caractrisent comme agents une Vermgen tant prcisment
cela: une capacit de raliser certaines actions; et aussi les concepts et principes qui servent de fondement
une facult ou son produit, bien quils puissent rsider en une autre facult.
le dcoupage de la philosophie pure qui rsulte des thses kantiennes, selon Kant lui-mme. Je ferai
ressortir les appellations des lments ainsi dcoups: les positions et hypothses thoriques de mme
que les parties de la philosophie pure.
7.1.1 Les trois principes de classement et leurs typologies respectives
Note liminaire: Jai emprunt La Philosophie critique de Kant de Gilles Deleuze la manire de distinguer les trois
principes de classement des facults. partir de l, jai labor mes notions de typologie, de matrice C - P - D E - J -
R et de registre de lecture (de ladite matrice).
Il existe trois principes de classement des facults :
selon la nature du rapport que lesprit, dans ses fonctions de reprsentation en gnral, entretient
avec son milieu (externe ou interne), dans le contexte gnral de son activit: la pense. En
mexprimant ainsi, jutilise lide que Deleuze exprimait dans le passage suivant:
Toute reprsentation est en rapport avec quelque chose dautre, objet et sujet. Nous distinguons
autant de facults de lesprit quil y a de types de rapports.
(Del, PCK 8.2)
selon la nature de ce que produit ou contient lesprit au cours des oprations par lesquelles il exerce
ses pouvoirs. Les contenus ou produits de lesprit sont regroups par Deleuze initialement sous la notion
vague (comme il dit) de reprsentation:
[] facult dsigne une source spcifique de reprsentations. On distinguera donc autant de
facults quil y a despces de reprsenta/tions. []
Toutefois la notion de reprsentation, telle que nous lavons employe jusqu maintenant, reste
vague. Dune manire plus prcise, nous devons distinguer la reprsentation et ce qui se
prsente.
(Del, PCK 13-14)
cette distinction (la premire introduite pour prciser la notion de reprsentation), va correspondre une
distinction entre facults: Ce qui compte dans la reprsentation, cest le prfixe : re-prsentation
implique une reprise active de ce qui se prsente, donc une activit et une unit qui se distinguent de la
passivit et de la diversit propres la sensibilit comme telle. (Ibid. 15.1) (Commentaire sur le texte de
Deleuze: les ides dactivit et dunit sont kantiennes souhait, mais la manire trs franaise de les
amener partir de la morphologie du mot franais reprsentation nest peut-tre pas aussi kantienne,
car le prfixe impliqu dans le terme allemand Vorstellung ne connote pas lide de reprise active
connote par le prfixe re.)
selon la fonction lgislatrice qui prside la construction des rapports de lesprit avec son milieu
(externe ou interne). Kant, dans lintroduction la Critique de la facult de juger, pose le premier
principe de classement (celui selon les types de rapports) et se proccupe cette fois de la question de
savoir quelle facult remplit la fonction lgislatrice eu gard ce que lesprit doit produire lorsquil
tablit chacun des trois types de rapport; la liste des trois facults lgislatrices ainsi obtenue constitue le
troisime classement.
Les principes de classement suggrent des typologies; on obtient une typologie lorsquon choisit un principe
de classement et quon lapplique une multiplicit pertinente. Dans notre cas, il sagit dappliquer les principes aux
pouvoirs de lesprit ou de lme.
155
A. Le classement des facults selon le principe des types de rapports
Le classement selon ce principe fournit la typologie
C - P - D
Cette typologie est celle que jai mentionne dans le cours douverture (thme # 1) pour faire comprendre,
dans le contexte dune premire approche, le lien quon peut faire entre les titres des trois Critiques. Rappelons-la:
C: facult(s) de connatre <Erkenntnisvermgen>; lesprit est en rapport avec des objets et sintresse
la conformit de ses reprsentations avec les objets: rapport de conformit. Eu gard aux facults de
connatre, lintrt de la raison est spculatif.
P: sentiment de plaisir et de peine <Gefhl der Lust und Unlust>; lesprit est en rapport avec lui-mme
loccasion dune reprsentation ou dun processus de reprsentation. La reprsentation est en rapport
avec le sujet, pour autant quelle a sur lui un effet, pour autant quelle laffecte en intensifiant ou en
entravant sa force vitale. (Del, PCK 8.2) Je ne sais pas si le vocabulaire kantien contient une appellation
canonique pour dsigner ce rapport que je prendrai la libert dappeler rapport dattitude, tant
entendu que lattitude dun tre humain lgard de quelque chose est une disposition subjective; Kant
utilise dailleurs lexpression disposition subjective de lme <subjektive Gemtsstimmung> (CFJ,
Pko 146.3.m3-2) Autre formulation possible: rapport dimplication personnelle.
D: facult de dsirer <Begehrungsvermgen>; celle-ci est la facult dtre par ses reprsentations cause
de la ralit des objets de ces reprsentations (CFJ, Pko 26n1; Intro, III); lesprit sintresse au rapport
entre la volont, considre comme pouvoir de dterminer laction, et les tats de choses (du monde)
susceptibles de raliser des fins morales, donc au rapport de causalit.
Kant reprendra plusieurs fois cette typologie:
toutes les facults ou tous les pouvoirs de lme peuvent se ramener ces trois, quon ne peut plus
dduire dun principe commun: la facult de connatre, le sentiment de plaisir et de peine, et la
facult de dsirer.
(CFJ, Pko 26.3)
Cette numration est aussi celle qui sert de fil directeur aux trois livres de la Didactique anthropologique dans
Anthropologie du point de vue pragmatique (1798) je reproduis dans lAppendice 5 le classement des facults
utilis dans lAnthropologie. Bien que le passage suivant nait pas subsist dans le livre publi, il dcrit bien les
rapports que Kant tablit entre les facults:
Lesprit <Gemt> (animus) de lhomme, en tant que c o n c e p t <I n b e g r i f f > [Verneaux:
ensemble] de toutes les reprsentations qui ont lieu en lui a un domaine <Umfang> (sphaera) qui
comprend trois secteurs <Grundstcke> : la facult de connatre, le sentiment de plaisir et de
dplaisir, et la facult de dsirer, dont chacun se subdivise selon le champ de la sensibilit et celui de
lintellectualit (celui de la connaissance sensible ou intellectuelle, de plaisir ou de dplaisir, du
dsir ou de laversion).
(AP, Fou 173.4)
Il sagit de la fin dun passage qui napparat pas dans les ditions publies par Kant, ce dernier layant lui-mme
biff dans le manuscrit de Rostock 1796-97; ce manuscrit est rput avoir servi tablir le Druckmanuscript final de
ldition de 1798, la premire; le passage entier est insrer la page 27, la fin de la section 7; le paragraphe cit
ici est conu comme dbut de la section 8, laquelle avait pour titre, dans le manuscrit, Vom [sic] dem Felde der
Sinnlichkeit in Verhltnis zum Felde des Verstandes).
La graphie donne par ldition Weischedel, pour la dernire partie de la phrase est la suivante:
deren jedes in zwei Abteilungen dem Felde der S i n n l i c h k e i t und der
I n t e l l e k t u a l i t t zerfllt. (dem der sinnlichen oder intellektuellen Erkenntnis, Lust oder
Unlust, und des Begehrens oder Verabscheuens). (ApH, Wei 429n, in fine). lintrieur de la
parenthse, on doit comprendre que les deux adjectifs qualifient les cinq substantifs. Le statut du
156
passage entre parenthses nest pas clair; ce passage est bel et bien prcd dun point et
commence avec une minuscule; il semble sagir dune autre formulation de lide immdiatement
prcdente, comme si Kant avait envisag lune et lautre formulations; il ne faut pas oublier que
les passages ainsi reproduits en note par Weischedel sont, dans loriginal, crits la main (comme
tout le manuscrit de Rostock) et quils peuvent figurer titre de formulation de rechange, ou de
note crite dans la marge; Weischedel indique mme les ratures.
Cette ide introduit une subdivision applicable chacun des lments de C - P - D , savoir la subdivision entre le
sensible et lintellectuel. Cest probablement la mme division que Kant exprime ailleurs en parlant dune facult
suprieure et dune facult infrieure; cette division est le plus souvent applique la facult de connatre, mais on
voit bien ici quelle est tout aussi applicable au sentiment de plaisir et de peine, de mme qu la facult de dsirer
(positivement ou ngativement).
B. Le classement des facults selon le type de reprsentations qui leur est associ
Ce principe de classement fournit une typologie matresse et quatre variantes. Dabord la typologie
matresse :
S : la sensibilit <Sinnlichkeit>
E : lentendement <Verstand>
R : la raison <Vernunft>.
Selon cette typologie, il y a autant de facults que despces de reprsentations; les reprsentations qui
motivent cette tripartition sont
les intuitions de la sensibilit.
les concepts de lentendement, dans la mesure o la synthse des intuitions par des concepts constitue le
caractre commun tous les produits de la pense.
les ides de la raison, en tant que sous-classe de concepts (concepts rationnels) rsultant dune synthse
qui outrepasse les limites de lexprience possible.
L a ty p o l o g i e S - E - R
L e s fa c u l t s L e s re p r s e n t a t i o n s
S la sensibilit <Sinn-
lichkeit>
les intuitions
E lentendement <Verstand> les concepts
R la raison <Vernunft> les ides transcendantales
Tableau 11.1 La typologie obtenue en classant les facults
selon le principe des reprsentations qui leur sont associes.
La manire dont les reprsentations sont associes telle ou telle facult sera indique par Kant au moyen de
divers vocables, selon les contextes; les reprsentations peuvent tre produites par la facult lors de son usage, ou
contenues en elle (en rsidence, pour ainsi dire), ou utilises comme des outils que la facult applique pour effectuer
sa tche. (Je nai pas procd un relev systmatique des relations que Kant tablit et du vocabulaire quil utilise
pour les exprimer. Les trois relations que je viens dnoncer ne constituent donc pas une liste ordonne et complte.)
Or la sensibilit se divise elle-mme en deux, savoir:
a) les sens <Empfindungsvermgen>, qui constituent laspect de pure rceptivit de la sensibilit et dont les
produits sont des sensations;
b) limagination <Einbildungskraft>, qui constitue laspect actif de la sensibilit et dont les produits sont
les synthses pr-conceptuelles. Cest elle que Kant attribue la mise en oeuvre des schmes de mme
que la production des ides esthtiques (jexpliquerai plus avant ci-dessous).
157
Tenant compte de cette division, Kant regroupe parfois les facults en deux classes:
la facult passive, celle dont le pouvoir est la rceptivit.
les facults actives, celles qui produisent des synthses au cours de leur activit: limagination,
lentendement et la raison.
De l, je peux tirer deux variantes de la typologie S - E - R . La variante 1 est la typologie qui fournit les
facults passives aussi bien que les actives : S - I - E - R . La variante 2 est la typologie des facults actives : I - E -
R .
Nous devons distinguer, dune part, la sensibilit intuitive comme facult de rception, dautre
part, les facults actives comme sources de vritables reprsentations. Prise dans son activit, la
synthse renvoie limagination; dans son unit, lentendement ; dans sa totalit, la raison.
(Del, PCK 15.2)
Variante 1 de S - E - R on obtient S s - I - E - R
La typologie Ss I E R
Les facults Les sens Limagination Lentendement La raison
Les sortes de
reprsentation
Les sensations Les synthses
pr-
conceptuelles; les
schmes
Les concepts Les ides
transcendantales
Tableau 11.2 Premire variante de la typologie Sensibilit-Entendement-Raison (S - E - R ).
Variante 2 de S - E - R on obtient I - E - R
La mme que prcdemment, sauf quon limine les sens (Ss) pour ne garder que les facults actives.
Tout de mme que la thorisation des processus qui traitent les intuitions a amen Kant prciser le rle de
limagination, la thorisation dtaille des processus qui traitent les concepts pour en produire des jugements a
amen Kant prciser le rle de la facult de juger, en tant que ce rle peut, eu gard certains jugements, tre
distinct du rle de lentendement. Alors que dans la Critique de la raison pure lentendement pouvait, du fait que la
problmatique tait centre sur les jugements dterminants, tre considr, toutes fins pratiques comme un bras
excutif de la facult de produire des jugements, savoir le bras qui fournit les concepts, il devient essentiel, dans le
contexte plus labor de la Critique de la facult de juger, dinsister sur certaines distinctions entre lentendement et
la facult de juger, le premier tant alors considr spcifiquement comme facult qui impose des conditions
ncessaires la formation des concepts, tandis que la facult de juger a dsormais des usages spcialiss lui
permettant de produire des jugements dont la caractristique est justement une certaine faon de se passer des
concepts. Il convient alors de distinguer les facults selon lusage quelles font des concepts dans la production des
jugements usage dterminant et usage rflchissant. Et puisque cette distinction concerne au premier chef la
facult de juger, il faut pour la clarifier avoir admis pralablement une distinction entre lentendement et la facult
de juger.
La typologie possde alors une structure analogue celle laquelle la logique gnrale nous a habitus en
distinguant le traitement des concepts, celui des jugements et celui des raisonnements. Kant introduit cette typologie
ds le dbut de lAnalytique des principes, se fondant sur larticulation que fait dj la logique gnrale lorsquelle
passe de la considration des concepts celle des jugements.
La logique gnrale est construite sur un plan qui saccorde exactement avec la division des
facults suprieures de la connaissance, qui sont l entendement, le jugement et la raison. Cette
science traite donc, dans son analytique, des concepts, des jugements et des raisonnements, suivant
158
les fonctions et lordre de ces facults de lesprit que lon comprend sous la dnomination large
dentendement en gnral.
(CRPu, Bar 179.1)
cet endroit, cependant, le premier souci de Kant nest pas dentriner un certain classement des facults; son souci
est plutt de montrer que la logique transcendantale ne suivra pas la tripartition de la logique gnrale, puisquon
aura besoin dy distinguer entre analytique et dialectique.
La typologie S - E - R est alors modifie en ce que le E est remplac par la paire E-J; ce qui fournit la variante
3 (voir le tableau 11.3). Et on obtient une quatrime variante, en faisant, comme pour la variante 2, abstraction de la
sensibilit (S) pour ne considrer que les facults suprieures. Je prsente les quatre variantes simultanment dans le
tableau 11.4.
Variante 3 de S - E - R on obtient S - E - J - R
Cest la variante quon obtient, ds la Critique de la raison pure, lorsque Kant distingue entre lentendement
et le jugement, entre lentendement et la facult de juger. Cette distinction a pour effet de faire apparatre une
diffrence entre un sens gnral du terme entendement et un sens plus particulier; et cest loccasion de ce
dernier, le sens plus particulier, que surgit la question de savoir quelles sont les fonctions spcifiques de lune et
lautre facult, de mme que leurs principes respectifs de fonctionnement.
Mise en garde. Avant dtoffer par des textes kantiens les propositions qui prcisent les rapports entre
lentendement et la facult de juger, il faut prendre acte dun dtail philologique utile: le terme allemand
Urteilskraft se traduit en franais tantt par jugement ce que fait rgulirement Barni, tantt par facult
de juger ce que fait rgulirement Philonenko.
Par exemple, lintroduction lAnalytique des principes sintitule dans CRPu, Bar 181 Du jugement
transcendantal en gnral et traduit Von der transzendentalen Urteilskraft berhaupt.
Par exemple, le titre de CFJ, Pko est Critique de la facult de juger et traduit Kritik der Urteilskraft.
Je mentionnerai ci-dessous dautres sens du mot jugement; pour linstant retenons que les mots jugement et
facult de juger peuvent tre strictement synonymes, dans le contexte qui est le ntre. (Fin de la mise en garde.)
Voici, titre damorce de la rflexion, comment Kant introduit, dans la Critique de la raison pure, la
diffrence entre entendement et jugement:
Si lon dfinit lentendement en gnral la facult des rgles, le jugement sera la facult de subsumer
sous des rgles, cest--dire de dcider si quelque chose rentre ou non sous une rgle donne (casus
datae legis ) [] Aussi le jugement est-il le caractre distinctif de ce quon nomme le bon sens <des
sogenannten Mutterwitzes>, et au manque de bon sens, aucune cole ne peut suppler.
(CRPu, Bar 181.1).
Leffet provisoire de cette intervention de la facult de juger est de donner de lextension lentendement dans le
champ de la connaissance pure a priori (182.2.6-7). Il nous faudra extraire dune telle dclaration ce quelle
contient dinformation utile pour la reconstitution du systme des articulations entre les facults.
La typologie que lon obtient lorsquon divise, pour ainsi dire, le concept de lentendement en gnral, pour
faire une place la facult de juger, est celle montre dans le tableau 11.3.
Pour comprendre en premire approximation et dans un langage relativement peu technique ce quexprime la
typologie E - J - R , il est utile de suivre la comparaison anthropologique. Lire: AP, Fou 69.1-3. Le passage 69.5
que voici explicite les exemples:
159
Le serviteur de ltat ou de la maison qui on a donn des ordres formels na besoin davoir que de
lentendement; lofficier qui pour la charge quon lui a confie ne sest vu prescrire que des rgles
gnrales, et auquel on a laiss le soin de dterminer lui-mme ce quil y a faire dans les diverses
occurrences, a besoin de jugement; le gnral qui doit penser les rgles qui sy appliquent a besoin
de raison. Les talents requis pour ces diffrentes dispositions sont trs diffrents: Tel brille au
second rang qui sclipse au premier. [en franais dans le texte allemand]
(AP, Fou 69.5)
La typologie S E J R
Les facults La sensibilit Lentendement La facult de
juger
La raison
Les sortes de
reprsentation
Les intuitions Les concepts Les jugements Les
raisonnements
Tableau 11.3 Troisime variante de la typologie Sensibilit-Entendement-Raison (S - E - R ).
Variante 4 de S - E - R on obtient E - J - R
La mme que prcdemment, sauf quon limine la sensibilit (S) pour ne garder que les facults
suprieures.
T y p o l o g i e S - E - R Typologies
S E R drives
Ss
les sens en tant
que rceptivit
pure
(facult passive)
I
limagination
comme source
des synthses pr-
conceptuelles
E
lentendement en gnral en tant que
facult dont les synthses par
concepts peuvent toujours tre
ramenes des jugements; cette
facult est
R
la raison en
tant que
source des
ides
S s - I - E - R
(facults acti-
ves et passive)
et des schmes
(facult active)
assimile la facult de juger dans
lAnalytique des principes (CRPu);
E et J ne sont pas diffrencis dans le
contexte des jugements dterminants
transcen-
dantales
I - E - R
(facults acti-
ves
seulement)
S
sensibilit en tant que facult de
connatre infrieure
E
entendement
ralisant la
synthse du
concept
J
facult de juger
ralisant la
synthse du
jugement
R
raison
ralisant la
synthse du
raisonnement
S - E - J - R
(facult
infrieure et
facults
suprieures)
ou produisant des
concepts
ou produisant des
jugements
ou produisant
des raison-
nements
E - J - R
(facults
suprieures)
Tableau 11.4 Tableau synoptique des quatre variantes
de la typologie Sensibilit-Entendement-Raison (S - E - R ).
160
C. Le classement des facults selon la fonction lgislatrice
La typologie qui rsulte de ce classement est E - J - R . Cest celle laquelle aboutit lintroduction la
Critique de la facult de juger ; plus prcisment, cest celle qui figure dans la deuxime colonne du tableau prsent
par Kant la fin de cette Introduction.
En explicitant la sorte de jugement lgard de laquelle les facults E - J - R sont lgislatrices, on obtient le
tableau 11.5, qui explicite une partie du message contenu dans le tableau donn par Kant la fin de son Introduction
CFJ. Le tableau 11.5 montre que le troisime principe de classement fournit la mme typologie que la variante 4
dj obtenue en appliquant le deuxime principe de classement. La typologie E - J - R possde donc deux
justifications, deux genses dans la construction de la thorie critique. Ces justifications ne sont pas sans rapport
mais il importe, pour bien saisir la cohrence du systme des facults, de prendre acte aussi bien de ce qui les
distingue que de ce qui les rapproche; on a l un nouvel exemple de larticulation entre la logique transcendantale
et la logique gnrale: la distinction entre jugement dterminant et jugement rflchissant nappartient pas la
logique gnrale mais maintient et utilise dune faon originale la hirarchie que la logique gnrale tablit entre les
concepts, les jugements et les raisonnements.
T y p o l o g i e E - J - R
E lentendement <Verstand> est facult lgislatrice par rapport
au jugement thorique ou jugement de connaissance
J la facult de juger <Urteilskraft> est facult lgislatrice
(quoiquen un sens attnu, si lon compare aux deux autres
lgislations) par rapport au jugement de got et au jugement
tlologique
R la raison <Vernunft> est facult lgislatrice par rapport au
jugement pratique
Tableau 11.5 La typologie E - J - R obtenue en classant les facults
selon leur fonction lgislatrice.
Quant la faon de concevoir le caractre lgislateur des facults concernes, de mme que les concepts
associs de lgislation, loi, lgalit et domaine, jy reviendrai aprs avoir introduit la matrice des facults et la notion
de registre de lecture.
7.1.2 Le problme de larticulation des typologies. La matrice C - P - D E - J - R
(matrice des 6 facults)
7.1.2.1 Le tableau des facults donn par Kant dans lIntroduction la Critique de
la facult de juger
La systmatisation de la doctrine des facults pose plusieurs problmes. Une faon relativement expditive de
commencer lnumration des difficults quune telle systmatisation rencontre est de reproduire le fameux tableau
que Kant prsente la toute fin de son Introduction la Critique de la facult de juger (notre tableau 11.6 le
reproduit).
FACULTS DE LME
DANS LEUR ENSEMBLE
FACULTS DE
CONNAISSANCE
PRINCIPES
a priori
APPLICATION
<Anwendung auf>
Facults de connatre Entendement Conformit la loi Nature
161
Sentiment de plaisir et de
peine
Facult de juger Finalit Art
Facult de dsirer Raison But final Libert
Tableau 11.6 Les facults suprieures dans leur unit systmatique (CFJ, Pko 42).
Ce tableau comporte deux typologies: C - P - D dans la premire colonne, E - J - R dans la deuxime. Cela pose
quelques problmes:
1. Lexpression facults de connatre traduit Erkenntnisvermge et lexpression facults de connais-
sance traduit le mme terme allemand; je ne sais pas pourquoi la traduction du terme allemand nest pas
la mme dune occurrence lautre. Ainsi ce tableau contient deux mentions des facults de
connaissance, et des niveaux logiques diffrents (une fois comme classe, une fois comme lment de
classe). Ce qui pose immdiatement un problme dinterprtation car il est impossible (sous peine
dincohrence flagrante) que les deux expressions aient la mme extension.
2. Ce tableau nous oblige distinguer entre entendement et facult de juger, puisque ces deux facults de la
deuxime colonne sont associes deux facults distinctes situes dans la premire colonne. Nous avons
donc un nouveau problme dinterprtation qui a pour enjeu la cohrence du systme car nous nous
rappelons que lentendement peut lui-mme tre reprsent comme une facult de juger, ce que nous
montre la typologie S - E - R du tableau 11.4 , et que cest bien ce que lAnalytique transcendantale
nous invitait faire:
Comme nous pouvons ramener tous les actes de lentendement des jugements, lentendement
en gnral peut tre reprsent comme une facult de juger.
(CRPu, Bar 129-130)
Lanalytique des principes sera donc simplement un canon pour le jugement <U r t e i l s k r a f t > ;
elle lui enseigne appliquer des phnomnes les concepts de lentendement, qui contiennent
la condition des rgles a priori. Cest pourquoi, en prenant pour thme les principes propres de
lentendement <G r u n d s t z e de s Ve r s t a n d e s > , je me servirai de lexpression de doctrine du
jugement <D o k t r i n de r Ur t e i l s k r a f t > , qui dsigne plus exactement ce travail.
(CRPu, Bar 180.2)
Dans quelles conditions pouvons-nous assimiler entendement et jugement (facult de juger) et dans
quelles conditions cela nous est-il interdit?
3. Le fait que le E de la typologie E - J - R soit associ exclusivement au C de la typologie C - P - D et le fait
que le R de la typologie E - J - R soit associ exclusivement au D de la typologie C - P - D soulve un autre
type de difficult. Nous comprenons bien que les facults places dans la deuxime colonne du tableau
11.6 ont une fonction lgislatrice lgard de celles places dans la premire colonne et que cest bien
cette relation qui constitue la cl de la systmaticit affirme par le tableau; mais lentendement et la
raison nont-ils pas, lgard des lments de C - P - D , des relations autres que celle dtermine par la
fonction lgislatrice? Quel lien convient-il de faire entre la fonction lgislatrice dune facult et son
usage? Comment rconcilier avec le tableau 11.6 le pouvoir de synthse que lAnalytique
transcendantale attribue lentendement dans la gense de tout ce qui est pens? Si toute pense procde
par concepts et que la formation de concepts est la spcialit de lentendement, ne trouvera-t-on pas un
rle pour lentendement lgard du sentiment de plaisir et de peine (et des jugements qui sy forment) et
lgard de la facult de dsirer (et des jugements qui sy forment)? Quant la raison, elle reste
certainement la facult des raisonnements lors mme quelle na pas un rle de lgislatrice; na-t-elle pas
aussi un rle lgard du C et du P de C - P - D ? Comment rappeler le fait quelle fournit des ides qui ont
un rle en C et P? Comment rappeler le rle du principe rgulateur de la raison pure par rapport aux
ides cosmologiques (Huitime et neuvime sections de lAntinomie de la raison pure, CRPu, Bar 424-
457) et lusage rgulateur des ides de la raison pure (Appendice la dialectique transcendantale,
CRPu, Bar 503-518)?
162
4. Les paragraphes 41-44, incl., de lAnthropologie du point de vue pragmatique, sous le titre
Comparaison anthropologique des trois facults suprieures de connatre (AP, Fou 68-72; dans
ldition Weischedel, il sagit des 38-41) semble prsenter une faon darticuler C - P - D et E - J - R qui
est diffrente de celle donne dans le tableau 11.6. Au paragraphe 40, Kant nonce comment il passe
dun sens plus englobant un sens plus restreint du terme entendement:
Lentendement, en tant que facult de penser (de se reprsenter quelque chose par des concepts)
est appele [sic] facult suprieure de connaissance (par opposition la sensibilit, qui est la
facult infrieure) []
Mais le mot entendement est pris aussi en un sens particulier: alors, en tant qulment
dans une division qui comprend deux autres termes, il est soumis lentendement au sens
gnral; la facult suprieure de connatre (considre matriellement, cest--dire non pas en
elle-mme mais dans un rapport la connaissance des objets) consiste en entendement,
jugement, et raison.
(AP, Fou 68.2 et 68.3; 40)
Il me semble que la relation tablie dans ces lignes est celle du tableau 11.7.
Facults de lme <Gemts> dans leur ensemble Facults de connatre
Lentendement, en tant que facult de penser ,
[] facult suprieure de connaissance (par
opposition la sensibilit, qui est la facult
infrieure)
E Entendement (au sens
particulier)
J Jugement - Facult de juger
R Raison
Sentiment de plaisir et de peine
Facult de dsirer
Tableau 11.7 Les 2 typologies suggres par la double extension du mot entendement,
daprs le 40 de lAnthropologie.
Ce tableau tablit des relations autres que celles du tableau 11.6, puisque la facult de juger et la raison
sont toutes deux considres comme des aspects particuliers de lentendement au sens gnral et quelles
ne sont mises en rapport ni avec le sentiment de plaisir et de peine ni avec la facult de dsirer; ces
nouvelles relations et le classement qui en rsulte sont-ils compatibles avec la tableau 11.6? Le
classement donn en 11.7 ne fait-il pas droit limpression nonce dans la remarque 3 ci-dessus,
savoir que le rle de la facult de juger ne se limite pas lgifrer pour le sentiment de plaisir et de
peine; et que le rle de la raison ne se limite pas lgifrer pour la facult de dsirer? De plus, le fait de
subsumer E, J et R sous lentendement en gnral entrane que la distinction entre E, J et R, dans ce
contexte, doit pouvoir tre explique sans recourir aux diffrences entre les fonctions de lgislation de
ces trois facults.
Le tableau 11.6 comporte aussi des difficults lies linterprtation des rapports tablir entre les lments
des colonnes 3 et 4. Si on se rappelle que la libert est une ide de la raison pure, on se demande quel rapport tablir
entre cet item et les deux autres items de la quatrime colonne; car ni lart ni la nature ne sont jamais prsents
comme des ides de la raison. En ce qui concerne la libert, cest la solution de la troisime antinomie de la raison
pure qui donne Kant loccasion de lintroduire; et il est ventuellement trs explicite sur son caractre dide :
La libert nest ici traite que comme une ide transcendantale par laquelle la raison pense
commencer absolument la srie des conditions dans le phnomne par quelque chose
dinconditionn au point de vue sensible [].
(CRPu, Bar 452.2.13-17, la fin de la remarque claircissement
de lide cosmologique dune libert unie la loi gnrale de la ncessit naturelle.)
163
7.1.2.2 Proposition dune matrice deux typologies croises
Dans le but de construire une reprsentation capable de montrer les rapports entre les facults et entre les
thories kantiennes de ces facults, je me propose de dployer le tableau du dbut de la Critique de la facult de
juger. (CFJ, Pko 42), qui est mon tableau 11.6 ci-dessus.
Puisque le but de ce tableau, selon Kant, est de montrer lunit systmatique des facults suprieures, on
peut penser, il me semble, que les deux premires colonnes du tableau ont une certaine priorit et que, partant,
chaque ligne de ce tableau tente de fournir deux traits pour caractriser le rapport qui stablit (au sein du systme
kantien) entre les facults occupant les deux premires cases de ladite ligne, de la manire suivante:
Facults de lme
<Gemts> dans leur
ensemble
(Typologie C - P - D )
Facults de connatre
(Typologie E - J - R )
Facults de connatre Entendement
Trait 1 du rapport entre les
facults de connatre et
lentendement, du point
de vue des principes a
priori qui y sont
impliqus.
Trait 2 du rapport entre les
facults de connatre et
lentendement, du point
de vue de ce sur quoi le
principe concern est
appliqu.
Sentiment de plaisir et de
peine
Facult de juger
Trait 1 du rapport entre le
sentiment de plaisir et de
peine et la facult de
juger, du point de vue des
principes a priori qui y
sont impliqus.
Trait 2 du rapport entre le
sentiment de plaisir et de
peine et la facult de
juger, du point de vue de
ce sur quoi le principe
concern est appliqu.
Facult de dsirer Raison
Trait 1 du rapport entre la
facult de dsirer et la
raison, du point de vue
des principes a priori qui
y sont impliqus.
Trait 2 du rapport entre la
facult de dsirer et la
raison, du point de vue
de ce sur quoi le principe
concern est appliqu.
Tableau 11.8 Le tableau 11.6 interprt comme explicitation partielle du systme des relations
qui existent entre les typologies C - P - D et E - J - R (colonne 1 et colonne 2).
Cette lecture du tableau de Kant nest clairante que si lon explicite bien les deux typologies que montrent
les deux premires colonnes.
la premire colonne rfre aux facults dun point de vue plus global que celui de la seconde; les
lments de la typologie C - P - D sont en quelque sorte les trois plans de lactivit humaine, les trois
pouvoirs dagir, lgard desquels la rflexion philosophique voudra produire des connaissances; les
facults de la typologie C - P - D peuvent aussi tre dsignes par des expressions telles que les suivantes
(dont certaines sont mtaphoriques) :
les facults considres selon le type dactivit quelles servent raliser; dans un vocabulaire plus
moderne que kantien, on dirait peut-tre: les facults cognitives, les facults motives, les facults
morales. En ce sens large, lexpression les facults peut aussi bien tre remplace par des
expressions telles que les habilets, les pouvoirs, la capacit.
les facults qui produisent le savoir, les facults qui grent les attitudes, les facults qui norment
lagir;
les facults considres comme des secteurs <Grundstcke> de la pense. Cette mtaphore apparat
dans le texte de lAnthropologie cit ci-dessus lors de lintroduction de la typologie C - P - D (8.1.1
A); le texte comporte les trois mtaphores:
164
Lesprit <Gemt> (animus) de lhomme a un domaine <Umfang> (sphaera)
Ce domaine comprend trois secteurs <Grundstcke>
Chaque secteur a deux champs <Felde>.
Le caractre spatial des mtaphores indique que la typologie C - P - D sert dlimiter les facults
seulement comme des espaces lintrieur desquels ou sur lesquels travailleront (pour ainsi dire) des
agents qui seront les facults E - J - R ; ces dernires seront caractrises tout autrement, on le verra ci-
dessous. Une autre mtaphore caractre spatial serait: les facults comme siges des processus (de
pense).
les facults considres selon les types de rsultats quelles sont censes procurer: les facults qui
dterminent ce qui est (ou: ce quun sujet peut connatre), celles qui dterminent ce quon ressent
(ou: lattitude quun sujet a raison dexprimer par jugements lgard de ses propres artefacts et de
la nature ), celles qui dterminent ce qui doit tre (ou : ce quun sujet doit faire).
les pouvoirs de synthse (des intuitions tires de lexprience), les pouvoirs dutilisation du
sentiment pour juger, les pouvoirs de causalit libre. Selon linterprtation de Philonenko qui sera
rapporte ci-dessous, les pouvoirs du deuxime groupe peuvent tre considrs comme des pouvoirs
de communication (entre humains).
la deuxime colonne considre les facults comme des agents susceptibles daccomplir certaines tches
en raison des forces ou des outils dont ils disposent, en raison des procdures ou mcanismes quils
mettent en oeuvre. Les facults de cette deuxime colonne
sont des agents dots de rles et de juridictions et les processus de pense sont les tches qui leur
sont dvolues.
sont donc caractrises soit par des reprsentations instrumentales quelles ont et quelles
appliquent, soit par des faons de faire (y inclus, ce que Kant appelle leur usage <Gebrauch>, soit
par des reprsentations ET des faons de faire.
et sont prsentes comme des facults de connaissance en ce sens que ce sont elles qui vont
produire les connaissances relatives aux lments de C - P - D ; ces connaissances consisteront
dterminer, par exemple, propos des facults C - P - D ,
quel est leur fonctionnement normal, quels sont les mcanismes qui y jouent;
comment on rsout les problmes propres chaque plan dactivit: les problmes de la
connaissance objective, les problmes de la connaissance affective ou du rapport vcu au
monde, les problmes de la connaissance morale;
quelles sont les conditions qui contraignent lesdites activits et qui en favorisent lheureuse
issue, do les aspects de lgislation, de norme, etc.
Avec cette comprhension de la diffrence entre les facults de C - P - D et celles de E - J - R , jesquisse la
solution, en premire approximation du moins, du problme que posait, dans le tableau 11.6, la caractrisation de C
comme facults de connatre et celle de E - J - R comme facults de connaissance. La connaissance dont il sagit
na effectivement pas la mme extension dans lune et lautre occurrences:
C dsigne la connaissance objective des phnomnes de la nature; ce type de connaissance, dans le
cadre de la thorie kantienne de la connaissance, est contrast avec le sentiment (les reprsentations
produites sur le plan de la facult dprouver du plaisir ou de la peine) et avec la croyance (les
reprsentations produites sur le plan de la facult de dsirer). [NOTE. Le terme sentiment, en langage
contemporain ne me semble pas avoir les mmes connotations que chez Kant. Il serait peut-tre
prfrable, aujourdhui, de traduire le Gefhl kantien par les connaissances subjectives, lattitude,
le vcu Ce dernier terme fait lui-mme problme; sil est compatible avec le point de vue kantien, ce
sera plutt en son sens phnomnologique quen son sens psychologique.]
Le prototype de la connaissance de type C serait la connaissance scientifique empirique.
En revanche, quand on dit que E - J - R sont des facults de connaissance, la connaissance dont il sagit
comprend la fois
165
lensemble des reprsentations au moyen desquelles nous pensons le monde, non seulement
celles qui satisfont les rgles de la connaissance objective, mais galement celles qui ne les satisfont
pas et qui nous permettent nanmoins de penser le beau, le tlologique (la finalit de la nature)
et le moral. Le prototype de la connaissance du beau est la posie <Dichtung> ou le discours en tant
quoeuvre dart; celui de la connaissance du tlologique est la technique; celui de la connaissance
morale est le droit.
lensemble des reprsentations au moyen desquelles nous pensons C - P - D . Ce sont les connais-
sances philosophiques (ou rflexives) par lesquelles nous tablissons les proprits et les limites de
C - P - D ; les prototypes de ces connaissances sont la thorie critique dans son ensemble, et la
philosophie transcendantale.
Muni de cette interprtation des deux typologies impliques dans les tableaux 11.6 et 11.7, je vois tout
lavantage que lon pourrait tirer dun schme de classement qui croiserait les typologies C - P - D et E - J - R , cest--
dire qui montrerait la fois
quand on lirait les colonnes : ce que chaque lment de E - J - R , pris pour lui-mme, fournit ou rend
possible eu gard aux plans dactivits C, P et D, respectivement;
quand on lirait les lignes: comment chaque lment de C - P - D , pris pour lui-mme, ncessite ou
utilise les interactions entre les lments de E - J - R .
De cette faon, il deviendra possible de montrer, non seulement le rle lgislatif assign E, J et R selon les
trois relations exhibes dans le tableau 11.6 (E - C , J - P et R - D ), mais de montrer galement les autres rles que
jouent les facults de connatre suprieures E, J et R, eu gard aux trois plans dactivit C - P - D sur lesquels stend
la pense humaine. Il nous sera davantage possible de tenir compte des contenus des trois Critiques pour apercevoir
le caractre systmatique de la thorie des facults dans le criticisme. Le croisement des typologies C - P - D et E - J -
R donne une matrice deux entres 3 3 et si on y reporte linformation contenue dans le tableau 11.8 on obtient
le tableau 11.9. (NOTE. Je prciserai dans un moment quels sont les autres rles mentionns linstant, de mme
que les autres traits mentionns dans le tableau 11.9, au moyen de mon concept de registre de lecture (de la
matrice C - P - D E - J - R ).
Il sera possible, sur la matrice des 6 facults, de distinguer notamment
en ce qui concerne la raison
la raison dans son rapport aux objets de la facult pure-et-simple <bloen> de connatre (CRPa,
Pic 14.1.1-2), savoir notre C, par lintermdiaire des concepts que lentendement en donne.
(CRPu, Bar 329.3.5-6) et par lintermdiaire de ce que la facult de juger tlologique ramne
lunit finale <Zweckmig>.
la raison dans son rapport la facult P du plaisir et de la peine; en ce rapport elle dtermine la
facult de juger rflchissante (tlologique aussi bien questhtique) juger des objets sur la base
du sentiment par lequel ces objets sont reprsents dans la facult du plaisir et de la peine.
la raison dans son rapport, non aux objets, mais [une] volont et sa causalit (CRPa, Pic
14.2.m9-8), cest--dire la facult D.
en ce qui concerne la facult de juger
son rapport la facult C de connaissance; en ce rapport la facult de juger est dsigne comme sens
commun, avec des connotations qui rfrent la logique naturelle qui constitue la principale force du
gros bon sens; la facult de juger tlologique a galement un rapport privilgi la facult de
connatre dans la mesure o elle est la facult de juger la finalit relle (objective) de la nature par
lentendement et la raison. (CFJ, Pko 39.2.2f)
son rapport la facult P du plaisir et de la peine; en ce rapport la facult de juger a une double
identit la mesure de sa double fonction; a) elle est dabord facult du got et, ce titre, est
dsigne nouveau comme sens commun, mais cette fois avec une connotation tout diffrente de la
prcdente; il sagit en effet daffirmer la possibilit de la communication entre les sujets humains,
sur la base de lidentit (postule) de leur constitution phnomnologique (on dirait aujourdhui: sur
166
la base de leur structure intentionnelle). b) dautre part, elle est facult de la systmaticit dans la
mesure o elle interprte le sentiment de plaisir en termes de finalit objective de la nature et
dtermine pour elle-mme, lors de sa rflexion sur les reprsentations des phnomnes, des maximes
de recherche dont leffet se traduit par lunit de la science.
son rapport la facult de dsirer; en ce rapport, la facult de juger rapporte le particulier des actions
luniversel de la loi en dterminant si laction particulire est conforme la loi.
la double mdiation que Kant envisage pour cette facult lorsquil anticipe que
elle ralisera aussi bien un passage de la pure facult de connatre, cest--dire du domaine
du concept de la nature, au domaine du concept de libert, quelle rend possible dans
lusage logique le passage de lentendement la raison.
(CFJ, Pko 27.1.4f)
Les deux dimensions de la matrice des 6 facults permettront de montrer ces mdiations; la
deuxime, notamment, se lira sur la colonne J, o lon verra la facult de juger rflchissante
amnager justement le passage de la facult de juger dterminante la facult pratique rationnelle
en nous (CFJ, Pko 194.2.m3-2).
en ce qui concerne lentendement
son rapport la facult C de connatre laquelle il fournit les rgles universelles de la synthse des
intuitions au moyen des concepts.
son rapport la facult P de plaisir et de peine; en ce rapport, cest laccord des facults
reprsentatives entre elles, nommment lentendement et limagination, qui produit le plaisir comme
reprsentation de ce qui, dans lobjet, est beau et intelligible (final). Et cest en ce rle que
lentendement participe la production des jugements esthtique et tlologique.
Facults suprieures de connatre
Entendement Facult de juger Raison
Facults de
connatre
Traits 1 et 2 du tableau 11.8;
ventuellement dautres
traits
Rles de la facult de juger eu
gard aux facults de connatre
Rles de la raison eu gard aux
facults de connatre
Sentiment de
plaisir et de
peine
Rles de lentendement eu
gard au sentiment de plaisir et
de peine
Traits 1 et 2 du tableau 11.8;
ventuellement dautres
traits
Rles de la raison eu gard au
sentiment de plaisir et de peine
Facult de
dsirer
Rles de lentendement eu
gard la facult de dsirer
Rles de la facult de juger eu
gard la facult de dsirer
Traits 1 et 2 du tableau 11.8;
ventuellement dautres
traits
Tableau 11.9 La matrice deux entres que jobtiens en croisant les typologies C - P - D et E - J - R
(des tableaux 11.6 et 11.8). Quand je fais abstraction du contenu des neuf cases o sintersectent les entres,
je lappelle la matrice des 6 facults.
La matrice des 6 facults offre neuf cases pour caractriser neuf relations entre les 6 facults. Il suffirait que
lon ajoute la typologie E - J - R (de lentre horizontale) la sensibilit S, avec ou sans sa subdivision (Ss, I), pour
obtenir une matrice capable de reprsenter cette autre opposition conceptuelle que fait Kant, dans sa thorie des
facults, savoir lopposition entre les facults suprieures et les facults infrieures. (Les matrices C - P - D S -
E - J - R et C - P - D I - E - J - R auraient 12 cases.) Je naurai pas le temps ici dutiliser ces matrices plus complexes,
mais je crois que leur utilit pour llaboration de la synthse du criticisme est aussi grande que celle de la matrice
que je vais dvelopper, laquelle est plus simple en ceci seulement que je ny reprsente pas la sensibilit.
Pour que les trois colonnes de droite de la matrice des six facults logent un maximum dinformation, je vais
rduire les entres verticales leur plus simple expression (donc crire C, P et D) et rtrcir ladite colonne.
167
Par simplification, jomettrai la mention Facults suprieures de connatre dans lentre horizontale et je
conviens de dsigner les facults concernes par une seule majuscule, dans le texte des cases de la matrice (donc
jcrirai E, J et R).
7.1.2.3 Les facults qui ne peuvent pas apparatre dans la matrice des 6 facults
Il existe deux facults qui, pour des raisons diffrentes, sont trop englobantes pour tre reprsentes sur la
matrice des six facults propose ci-dessus.
1. LA RAISON PURE COMME TRIBUNAL ET COMME SOURCE DE TOUTES LES CONNAISSANCES PURES
Dans la recherche des connaissances quil est possible dobtenir a priori au sujet des pouvoirs de lesprit et de
leurs limites, la raison est dans une relation rflexive avec elle-mme car elle occupe la fois la position de
juge et celle de prvenu: considre comme tribunal suprme, la raison ne figure pas dans la matrice des 6
facults; considre comme prvenu, elle y figure.
Le discours kantien qui explicite le mieux la nature de la raison comme tribunal est celui qui traite des fins et
des intrts de la raison pure dans llaboration de lentreprise critique elle-mme; cest dailleurs cette ide
des fins de la raison que Deleuze prend comme fil conducteur pour exposer lensemble de la philosophie
critique dans son petit livre La Philosophie critique de Kant.
a) la raison est la facult qui produit (crit) la Critique
b) la raison a des fins, et ce sont les fins dernires de ltre humain. Kant dfinit la philosophie
comme la science du rapport de toutes connaissances aux fins essentielles de la raison humaine; ou
comme lamour prouv par ltre raisonnable pour les fins suprmes de la raison humaine (Critique
de la raison pure, et Opus posthumum). Les fins suprmes de la Raison forment le systme de la
Culture. (Del, PCK 5.1) Bien plus, seules les fins culturelles de la raison peuvent tre dites absolument
dernires. La fin dernire est une fin telle que la nature ne peut suffire leffectuer et la raliser en
conformit avec lide, car cette fin est absolue (Critique du jugement, 84). (Del, PCK 5-6)
c) la relation rflexive: Contre le rationalisme, Kant fait valoir que les fins suprmes ne sont pas
seulement des fins de la raison, mais que la raison ne pose pas autre chose quelle-mme en les posant.
Dans les fins de la raison, cest la raison qui se prend elle-mme pour fin. Il y a donc des intrts de la
raison, mais, en plus, la raison est seul juge de ses propres intrts. Les fins ou intrts de la raison ne
sont justiciables ni de lexprience, ni dautres instances qui resteraient extrieures ou suprieures la
raison. Kant rcuse davance les dcisions empiriques et les tribunaux thologiques. (Del, PCK 7.2)
Jemploie une relation mta pour caractriser la relation entre la raison au registre 1 et la raison
au registre 3; le concept de cette relation ne se trouve pas dans Kant; il est postrieur Kant,
probablement postrieur 1910, puisquon ne le trouve pas encore dans les Principia mathematica
de Russell. Il est explicitement dfini chez Carnap
De ce point de vue le plus englobant, la raison est parfois dsigne comme la facult de connaissance pure
<reines Erkenntnisvermgen> et je crois que Kant la considre ce titre lorsquil la met en charge de lentreprise
critique elle-mme, dans son ensemble, et ultimement, de la rflexion philosophique tout entire; lorsquil lui
attribue, par exemple, la dcision davoir renonc aux choses en soi :
Sans ces antinomies la raison naurait jamais pu se dcider admettre un principe qui restreint ce
point le champ de sa spculation, ni consentir les sacrifices en lesquels tant desprances si
brillantes doivent svanouir compltement; car maintenant mme, alors quen compensation de
cette perte un usage dautant plus grand lui est ouvert au point de vue pratique, elle ne parat pas se
sparer sans douleur de ces esprances, ni parvenir se librer de ce vieil attachement.
(CFJ, Pko 168.2.9-f)
Depuis la prface la Critique de la raison pure Kant a utilis de multiples fois cette sorte de dramatisation en
laquelle tout le sort et lenjeu de lentreprise critique revient la raison. Lorsque ce rle est dvolu la raison, il ne
convient plus, il me semble, de le distinguer de celui que la thorie critique elle-mme attribue aux autres facults:
168
imagination, entendement, facult de juger Kant a conscience de ce dcalage; et cest en partie pour sen
expliquer, je prsume, quil prcise longuement dans lIntroduction la Dialectique transcendantale de CRPu en
quel sens il faut alors concevoir la raison.
Les passages suivants constituent un petit chantillon de ceux, nombreux, qui prsentent ainsi la raison
simplement comme la facult de [] tout ce qui dans la pense est a priori, et ne vient pas de lexprience :
Connaissance par la raison <Vernunfterkenntnis> et connaissance a priori sont une mme chose.
(Critique de la raison pratique, Prface, paragr. 14; ma traduction). Connaissance rationnelle et
connaissance a priori sont choses identiques. (CRPa, Pic 9.2.9-10) <mithin ist Vernunfterkenntnis und
Erkenntnis a priori einerlei.> (KpV, Wei 117.1.1-2)
Ich verstehe hier unter Vernunft das ganze obere Erkenntnisvermgen, und setze also das Rationale dem
Empirischen entgegen. Kritik der reinen Vernunft, A 835; B 863, dition faite par Kehrbach, in-16,
Reclam. (Cit par LALANDE, A., Vocabulaire, 1960, 885b.)
De tout cela rsulte lide dune science spciale qui peut sappeler Critique de la raison pure. En effet,
la raison est la facult qui nous fournit les principes de la connaissance a priori. La raison pure est donc
celle qui contient les principes au moyen desquels nous connaissons quelque chose absolument a priori.
(CRPu, Bar 72.2.1-6)
La manire toute particulire dont la raison pure occupe son poste de facult suprme apparat avec nettet
dans cette familire et nanmoins surprenante phrase de lIntroduction de CFJ : la critique de la raison pure []
consiste en trois parties : la critique de lentendement pur, de la facult de juger pure, et de la raison pure, facults
qui sont dites pures parce quelles lgifrent a priori. (CFJ, Pko 27.2.5f) O lon voit, curieusement, la critique de
la raison pure apparatre comme une partie delle-mme, et la raison aussi, comme un sous-ensemble propre delle-
mme.
2. LA FACULT DE LA NATURE
Il existe, en franais comme en allemand, une acception ni philosophique, ni technique, ni mme
psychologique du terme facult, selon laquelle la facult (de faire quelque chose) est simplement la capacit (de
faire quelque chose) et constitue ainsi le substantif correspondant lun des sens du verbe pouvoir. Lhomme peut
fabriquer des voitures et la nature peut creuser des canyons, activer des volcans, dessiner des orchides; on exprime
la mme ide, quoiquen un langage plus relev, en disant que lhomme a la facult de fabriquer des voitures et la
nature, la facult de creuser des canyons. Et tel est bien le terme utilis par Kant, lorsque, considrant la nature dans
son ensemble, il exprime les deux ides-thmes de la Critique de la facult de juger, savoir que la nature a la
facult de produire de belles choses et de produire la vie. Cette acception du terme facult, je la qualifierais
volontiers dencyclopdique, voquant ainsi quelle appartient au niveau de langage auquel les dictionnaires
encyclopdiques sen tiennent assez typiquement, pour noncer des faits. Et la Critique de la facult de juger est
tout autant une thorie de cette facult de la nature quune thorie de notre facult de juger, puisquaussi bien cest la
dernire qui permet et exige que la nature nous apparaisse dote de sa facult.
On dit trop peu de la nature et de sa facult <Vermgen> dans les produits organiss quand on la
nomme un analogon de lart.
(CFJ, Pko 193.4, 65; KdU, Wei 486.3)
[] la perfection naturelle interne [] [des] tres organiss [] ne peut tre pense et explique
par aucune analogie avec un pouvoir physique quelconque connu de nous, cest--dire un pouvoir
naturel <Naturvermgens>.
(CFJ, Pko 194.1.m7-3)
Dans la citation suivante, le mot pouvoir traduit le mme mot Vermgen et donc la mme facult que
dans la citation prcdente :
[] ds que nous avons dcouvert dans la nature un pouvoir <Vermgen> de raliser des produits,
qui ne peuvent tre penss par nous que daprs le concept des causes finales []
CFJ, Pko 199.2; KdU, Wei 494.2.
169
Cet emploi du terme facult <Vermgen> ramne sur le terrain du langage ordinaire mon enqute sur la
thorie kantienne des facults. Et il nest pas mauvais que lenqute aboutisse l, puisquon a parfois tendance
rifier indment le concept de facult, mme quand il rfre nos capacits de penser.
3. LA VOLONT COMME FACULT DE LA NATURE
La volont considre comme facult naturelle <Naturvermgen> (CFJ, Pko 22.3.1-11) ne peut pas figurer
dans la matrice des 6 facults parce que la description et lexplication de ses modes de dtermination ne relvent pas
de la philosophie thorique, strictement parler. Non pas quils relvent davantage de la philosophie pratique; ils ont
une certaine relation la philosophie thorique mais nen sont que des corollaires. La volont, ainsi considre, est
dtermine pour son action technique par des rgles techniques-pratiques (rgles de lart, rgles de prudence, rgles
dhabilet) et par des connaissances scientifiques.
Toutes les rgles techniques-pratiques [] ne doivent, dans la mesure o leurs principes
reposent sur des concepts, tre comptes que comme des corollaires de la philosophie thorique.
Elles ne concernent, en effet, que la possibilit des choses daprs des concepts naturels, dont
relvent non seulement les moyens quon rencontre pour cela dans la nature, mais encore la volont
elle-mme (comme facult de dsirer, par consquent comme facult naturelle <Naturvermgen>,
dans la mesure o elle peut, conformment ces rgles, tre dtermine par des mobiles naturels.
(CFJ, Pko 22.3.9-11)
7.2 Les cls de la thorie des facults contenues dans la Critique de la facult de juger
Note liminaire. Je signale au lecteur que, du point de vue de mon prsent projet de synthse des trois Critiques sous
la forme dun systme des facults, jai trouv particulirement utiles les passages suivants de la Critique de la
facult de juger :
Introduction (CFJ, Pko 21-42).
36. Du problme dune dduction des jugements de got (Ibid., 122.3-123.3).
Remarque I (CFJ, Pko 166.1-168.1) et Remarque II (Ibid., 168.2-169.2) insres la fin de la section
57. Solution de lantinomie du got. Cest dans la deuxime remarque que se trouve explicite lide:
Quil y ait trois sortes dantinomies la raison sen trouve dans <le fait> quil y a trois facults de
connaissance: lentendement, la facult de juger et la raison, dont chacune (comme facult de connatre
suprieure) doit avoir ses principes a priori (CFJ, Pko 168.3.1-4).
76. Remarque (Ibid., 215.2-218.2) et 77. De la qualit propre de lentendement humain, grce
laquelle le concept dune fin naturelle et pour nous possible (Ibid. , 219.1-223.1). La section 76 prend
du recul par rapport lexpos en cours et rappelle le mode de fonctionnement de lentendement et celui
de la raison, tels quils ont t poss dans la Critique de la raison pure. Ces modes de fonctionnement
continuent dtre admis, servent de base aux thories spcialises dveloppes ici pour le jugement de
got et le jugement tlologique et font donc figure de constantes travers les trois Critiques, du moins
en ce qui concerne la thorie des facults.
7.2.1 La problmatique propre la Critique de la facult de juger
La prsente section 8.2.1 propose une description sommaire des problmes que Kant cherche rsoudre
dans CFJ et plusieurs explications de termes qui expriment les concepts fondamentaux de cette troisime Critique.
Joffre ces diverses remarques comme matriel lire, titre prparatoire, avant une lecture attentive de la Critique
de la facult de juger. Je prends donc ici non pas une attitude dexgte mais une attitude de pdagogue; il me
semble en effet que le lecteur de Kant peut tre libr de lobligation dinfrer par lui-mme seulement, et partir du
seul texte kantien, les rudiments des oppositions conceptuelles de base (par exemple, entre finalit subjective et
finalit objective, entre fin subjective et fin objective, entre principe subjectif et principe objectif) et que, sil est
ainsi libr, la rapidit de sa progression dans la pense kantienne sera considrablement accrue.
170
Les dfinitions simplifies et/ou commentes que je donne maintenant ne sont donc que des balises pour une
lecture ultrieure.
LE PASSAGE DE LA Critique de la raison pure LA Critique de la facult de juger.
Le fil conducteur qui sert la fois passer des deux premires Critiques la troisime et unifier les parties
de la troisime est la finalit. Cest donc le concept de finalit qui va nous servir penser ce fil conducteur; et nous
savons dj, puisque cest un acquis de la Critique de la raison pure, que nous parlerons aussi bon droit de lIde
de finalit, lorsque nous voudrons souligner le caractre rationnel de ce concept. (Je suivrai la convention adopte
par Philonenko dcrire le mot Ide avec une majuscule lorsque je parle dune ide de la raison au sens kantien.)
a) Reportons-nous dabord la partie de la section 9 de CRPu: IV. Solution de lide cosmologique de la
totalit de la dpendance des phnomnes quant leur existence en gnral [CRPu, Bar 452.3-456.1]. La solution
de la quatrime antinomie consiste 1 maintenir que tous les phnomnes sont contingents, en raison de leur
dpendance lgard de leur cause, quant leur existence, et ce, aussi loin que lon remonte dans la srie ascendante
de leurs conditions causales; et 2 poser comme possible un tre ncessaire en dehors de la srie des conditions.
Leffet de la solution est dans ce cas-ci, comme dans les cas des trois premires antinomies, de convertir
lexigence dinconditionn qui sert de principe la raison, et de considrer ce principe non plus comme un principe
constitutif mais seulement comme un principe rgulateur qui adresse lentendement les injonctions suivantes
applicables aux recherches portant sur la nature :
aussi loin quon le peut, chercher la condition dans une exprience possible;
ne pas driver une existence quelconque dune condition place en dehors de la srie empirique;
ne pas nier, pour autant, que toute la srie puisse avoir son fondement dans quelque tre intelligible
(CRPu, Bar 454.2).
Commentaire. Observons que cette solution diffre de celle apporte la troisime antinomie, laquelle posait la
possibilit dune chose-cause (substantia phnomenon) qui faisait partie de la srie des conditions en gnral (pas
des conditions empiriques) et dont [l]a causalit seule tait conue comme intelligible (CRPu, Bar 453.3.3f).
b)Cette solution a un double effet que Kant signale lui-mme en CRPu, Bar 454.3 :
limiter la raison pour quelle ne perde pas le fil des conditions empiriques
restreindre la loi de lusage de lentendement, deux titres:
lempcher de dcider de la possibilit des choses en gnral
lempcher de tenir lintelligence pour impossible (c.--d. lempcher de conclure limpossibilit
dun tre intelligible ncessaire).
La solution autorise donc deux usages de la raison:
lusage empirique de la raison nest point affect (CRPu, Bar 455.3.1-3)
lusage pur de la raison (par rapport aux fins) (CRPu, Bar 455.f.f-456.1.1; accentuation en gras due
NL) nest pas exclu. [La citation donne ici montre la premire mention que fait Kant, dans CRPu, dun
usage de la raison par rapport aux fins; cest le tout premier jalon de lexplicitation du problme de la
finalit, lequel nest cependant pas encore pos, encore moins pos comme problme pour une thorie du
jugement.]
Or cest prcisment cet usage pur de la raison par rapport aux fins qui va tre explicit dans la deuxime partie de
lAppendice la dialectique.
c) La partie de la Dialectique intitule Du but final de la dialectique naturelle de la raison humaine [CRPu,
Bar 519.1-538.1], plus prcisment dans le rsum qui commence en 525.2 pour faire le point sur les trois ides
va dvelopper le lien entre la notion dintelligence (de ltre ncessaire) et celle de finalit. Le lien est
fait par Kant loccasion de son commentaire-rsum sur la troisime ide transcendantale, celle de
Dieu; mais ltre ncessaire suppos dans la solution de la troisime antinomie, lintelligence dj
171
mentionne l avant mme de traiter le chapitre consacr lidal de la raison pure se trouvent ici
viss. Le lien se fait exactement dans le passage suivant:
Lunit formelle suprme, qui repose exclusivement sur des concepts rationnels, est lunit
finale des choses, et lintrt spculatif de la raison nous oblige regarder toute ordonnance
dans le monde comme si elle tait sortie des desseins dune raison suprme. Un tel principe
ouvre en effet notre raison applique au champ des expriences des vues toutes nouvelles qui
nous font lier les choses du monde suivant des lois tlologiques et nous conduisent par l la
plus grande unit systmatique possible de ces choses. Lhypothse dune intelligence
suprme, comme cause unique de lunivers, mais qui la vrit nest que dans lide, peut donc
toujours tre utile la raison et ne saurait jamais lui nuire.
(CRPu, Bar 529.2.1.1-13; accentuation en gras due NL)
va construire lopposition conceptuelle qui reviendra constituer lantinomie de la facult de juger tlolo-
gique, savoir:
lien tlologique / lien purement mcanique ou physique
(nexus finalis) / (nexus effectivus)
ainsi que les problmes que soulve lexplication en biologie, par exemple le danger de cesser la
recherche des causes physiques des phnomnes psychologiques ou biologiques pour sen remettre la
soi-disant dcision souveraine dune raison transcendante (CRPu, Bar 531.1.11-12), aux insondables
dcrets de la sagesse suprme (531.1.24-25).
va affirmer en ultime conclusion que la vritable destination de cette suprme facult de connatre est de
ne se servir de toutes les mthodes et des principes de ces mthodes que pour poursuivre la nature jusque
dans ce quelle a de plus intime suivant tous les principes possibles dunit, dont le principal est celui de
lunit des fins, mais jamais pour sortir de ses limites, hors desquelles il ny a plus pour nous que le
vide. (CRPu, Bar 537.3.8-15).
LA PROBLMATIQUE ET LA DMARCHE GNRALES DE CFJ
a) Comme les objets principaux des deux parties de la CFJ sont des jugements rflchissants, lensemble de
louvrage poursuit la thorisation de la rflexion transcendantale amorce dans lappendice au chapitre III de
lAnalytique De lamphibolie des concepts de la rflexion rsultant de lusage empirique de lentendement et de
son usage transcendantal.
Or, la rflexion est le procs inverse de celui qui caractrise le schmatisme transcendantal. Le schmatisme
transcendantal est le procd de limagination pour procurer un concept (universel) son image (particulier) la
rflexion est le procd de lesprit pour procurer ce qui est particulier (image) sa signification universelle (son
concept). (CFJ, Pko 9.4.m6-2) Et Philonenko de renvoyer la section IV de lIntroduction CFJ, intitule De la
facult de juger comme facult lgislative a priori.
Ce problme de la rflexion transcendantale non pas celui dexpliquer ce quelle est mais bien plutt celui
pos elle Kant lnonce succinctement, dans la partie V de son Introduction CFJ, de la faon suivante:
c o n s t i t u e r u n e ex p r i e n c e co h r e n t e p a r t i r d e s p e r c e p t i o n s d o n n e s d u n e
n a t u r e co m p r e n a n t u n e mu l t i p l i c i t ce r t a i n e m e n t i n f i n i e d e s l o i s em p i r i q u e s
(CFJ, Pko 32.2.4-6; accentuation en gras due NL)
et dclare que ce problme se trouve a priori dans notre entendement. (Ibid. , 32.2.6-8) Lexpos kantien de ce
problme et la description rsume de sa solution courent sur les deux paragraphes [CFJ, Pko 32.2-33.2]; je vais
tenter den reformuler lessentiel, dans un langage relativement simple.
Devant la tche dunifier les multiples lois particulires donc contingentes de la nature, lentendement
maintient le critre dobjectivit et assume la tche des jugements dterminants; mais les lois empiriques ne sont pas
un genre dobjet propos desquels il peut dterminer quoi que ce soit; il doit alors se contenter dun principe adopt
comme fondement de la rflexion (plutt que comme fondement de la dtermination) et passer la main la facult
de juger; cest celle-ci qui aiguille la facult de connatre dans lune ou lautre direction et qui fait la diffrence entre
172
i subsumer sous une rgle de lentendement avec application de la rgle lobjet et dtermination de
lobjet
et
ii subsumer sous une rgle non donne par lentendement (seulement souhaite par lui) avec application de
la rgle la facult (principe subjectif, et non pas objectif) et rflexion sur la manire dont la facult
attribue la nature une proprit qui permet, ou explique, que la nature soit en accord avec notre facult
de connatre (comme celle-ci le prsuppose).
Cest prcisment lorsque la facult de juger sengage dans loption ii quelle assume sa fonction de facult
rflchissante. Et cest en tant que telle quelle se donne la loi de la spcification de la nature par rapport ses lois
empiriques (CFJ, Pko 33.3.5-6), laquelle consiste prcisment penser la nature selon une finalit. (Le verbe
spcifier est employer ici selon la syntaxe indique par Kant: la nature spcifie ses lois universelles suivant le
principe de la finalit pour notre facult de connatre CFJ, Pko 33.3.11-13.)
b)La Critique de la facult de juger esthtique. La section 36. Du problme dune dduction des jugements
de got de CFJ contient une formulation particulirement clairante du problme initial de la Critique de la facult
de juger esthtique; cette formulation est clairante en ce quelle est mise en parallle avec une formulation du
problme correspondant qui a t pos propos des jugements de connaissance dans la Critique de la raison pure:
Dans CRPu Dans CFJ
Caractristiques du
jugement dont la
critique doit faire la
thorie
- le concept dun objet en gnral est li
la perception qui en donne les prdicats
empiriques
- un jugement de connaissance est produit;
- un sentiment de plaisir est li la
perception de lobjet et lui tient lieu de
prdicat
- un jugement esthtique est produit;
- le jugement trouve son fondement dans
des concepts a priori de lunit
synthtique du divers dans lintuition,
concepts fournis par lentendement
- le jugement dtermine lobjet, en fournit
une connaissance et relve de lusage
thorique de la facult de juger
- le jugement a pour fondement un principe
a priori subjectif que la facult de juger
se donne elle-mme comme loi
(principe de la finalit de la nature)
- le jugement ne dtermine pas lobjet,
nen fournit pas une connaissance, et
relve de lusage esthtique de la facult
de juger (CFJ, Pko 168.3.m7-6)
Le problme initial comment des jugements de connaissance
synthtiques a priori sont-ils possibles?
(CFJ, Pko 122.3.m4-3)
comment un jugement est-il possible, qui
uniquement partir du sentiment personnel
du plaisir que procure un objet, indpendam-
ment de son concept, juge a priori ce plaisir
comme dpendant en tout autre sujet de la
reprsentation de cet objet, cest--dire sans
devoir attendre une approbation trangre?
(CFJ, Pko 123.2.1-f)
Tableau 11.10 Le parallle tabli par Kant entre le problme initial de la Critique de la raison pure et celui de la
Critique de la facult de juger.
La formulation donne en 35 du problme initial de la Critique de la facult de juger esthtique contient sans
doute des expressions dont la comprhension doit tre approfondie par la lecture des sections de lAnalytique du
Beau (1 22); mais elle a le grand avantage dtre trs explicite et de faire apparatre quelle est une spcialisation
du problme gnral de la philosophie transcendantale auquel la Critique de la raison pure nous avait habitus:
comment des jugements synthtiques a priori sont-ils possibles? (CFJ, Pko 123.3.2f)
c) La Critique de la facult de juger tlologique a pour problme initial: Parmi les objets des facults de
connaissance sen trouve-t-il qui possdent objectivement un caractre de finalit, cest--dire auxquels la facult de
173
juger peut attribuer une finalit objective au moyen dun jugement tlologique? En dautres mots, quels sont les
principes dterminants des jugements tlologiques qui permettraient de comprendre la fois leur possibilit, leur
invitabilit et leurs limites de validit?
La rponse de Kant consistera dire :
Il est certes permis dattribuer une finalit objective aux objets dont nous construisons le concept, par
exemple aux figures de la gomtrie; mais cette finalit objective nest bien sr que formelle et ne nous
dit rien au sujet de la finalit des objets naturels.
Les objets des sens nont pas de finalit objective que nous puissions leur attribuer bon droit en tant
quobjets de la nature, puisquaucune des intentions (ou buts) de la nature ne peut tre connue de nous, si
tant est que la nature ait jamais eu quelque intention. Nanmoins, le jugement tlologique est utilis
bon droit dans ltude que nous faisons de la nature, si nous lutilisons seulement selon lanalogie avec
la causalit finale <Kausalitt nach Zwecken> (CFJ, Pko 182.2.3-4) et seulement pour la gouverne de
nos propres facults au moyen de principes rgulateurs.
d)Dans la Critique de la facult de juger, la manire dont la finalit oriente toute la dmarche densemble est
dcrite par anticipation dans lIntroduction; les neuf sections de celle-ci rsument de faon dense (cela rend le texte
trs difficile saisir en premire lecture) la dmarche elle-mme, les motifs qui en dterminent les tapes et les
principales thses qui la ponctuent. Occupons-nous ici de la dmarche.
lIntroduction la Critique de la facult de juger, o Kant sefforce darticuler lune sur lautre la
reprsentation esthtique et la reprsentation logique du concept de finalit.
La dmarche densemble comporte les trois moments suivants :
Kant explique dabord lIde de la finalit en gnral, telle que requise par la raison, dans sa
considration de la nature, pour fonder lunit de lexprience quelle en a et quelle en veut avoir.
[Sections I-V]
Kant introduit une variante de lIde de finalit, ou en drive une application particulire, en tablissant
une liaison du sentiment de plaisir avec le concept de la finalit de la nature. Cette tape de la
dmarche constitue lesthtisation de la finalit de la nature. [Sections VI-VII] Le concept qui en ressort
est celui de finalit subjective de la nature. Je donne en Appendice 4 une paraphrase de la section VI, en
dcoupant les principaux moments de la dmarche de Kant dans cette section.
Kant spcifie une deuxime interprtation particulire de la finalit en gnral, en ltendant aux fins que
la nature pourrait poursuivre lorsquelle produit des tres organiss (les vivants). [Sections VIII-IX].
Le concept qui ressort de cette dmarche est celui de finalit objective de la nature.
Les moments de cette dmarche sont insrs dans une opration qui leur sert constamment de contexte, savoir
ltablissement des liens entre la troisime Critique et les deux prcdentes, de manire prsenter la thorie de la
Facult de juger comme le moyen dunir en un tout les deux parties de la philosophie (CFJ, Pko 25; dans le titre
de la section III) et, partant, les diverses parties du systme kantien lui-mme.
7.2.2 La conceptualit de la Critique de la facult de juger
7.2.2.1 Le vocabulaire du jugement
Le mot franais jugement peut signifier :
ou bien la facult de juger; dans ce cas il traduit Urteilskraft, Beurteilungsvermgen (CFJ, Pko
197.1.5) ou Vermgen zu urteilen. Barni utilise rgulirement le mot jugement en ce sens;
Philonenko utilise plutt facult de juger je lai signal dj.
ou bien lacte de juger; dans ce cas il traduit Beurteilung.
ou bien le rsultat de lacte de juger, rsultat quon exprime canoniquement par une proposition; dans ce
cas, il traduit Urteil.
174
Il faudra par consquent tre prt tenir compte de cette polysmie, lorsque certains passages savreront
compliqus ou difficiles comprendre. Comme cest probablement la deuxime acception qui est la moins frquente
celle o le jugement est un acte jen prsente quelques occurrences susceptibles de nous la rendre plus
familire :
Nous possdons une facult de [] trouver une satisfaction dans le simple jugement
<Beurteilung> [des formes dun objet donn dans la reprsentation].
(CFJ, Pko 132.3.1-3)
La proprit de la nature de contenir pour nous loccasion de percevoir dans le jugement de certains
de ses produits la finalit interne []
(CFJ, Pko 172.3.m4-2)
[] on use bon droit du jugement <Beurteilung> tlologique, du moins problmatiquement, dans
ltude de la nature; mais ce nest que pour sa soumettre, suivant lanalogie avec la causalit finale,
aux principes de lobservation et de la recherche, sans prtendre lexpliquer par l.
(CFJ, Pko 182.2.1-5)
[] la beaut de la nature, cest--dire son accord avec le libre jeu de nos facults de connatre dans
lapprhension et le jugement de sa manifestation []
(CFJ, Pko 198.2.1-3)
il est [] non seulement permis, mais encore invitable, en ce qui concerne les lois empiriques des
fins naturelles dans les tres organiss, de faire usage du jugement tlologique <teleologische
B e u r t e i l u n g s a r t > comme principe de la thorie de la nature par rapport une classe particulire
de ses objets.
(CFJ, Pko 200.2.5f)
Quelques productions de la nature matrielle ne peuvent pas tre considres comme possibles
daprs de simples lois mcaniques (leur jugement exige une toute autre loi de causalit : celle des
causes finales).
(CFJ, Pko 203.4.1-f)
7.2.2.2 Le vocabulaire de la finalit
Pour se construire une reprsentation ordonne et simple des principaux concepts associs la finalit, il est
utile de commencer par se replacer dans le contexte de la Dialectique transcendantale de CPu. La solution du
troisime conflit des ides transcendantales est expose dans la 9
e
Section : DE LUSAGE EMPIRIQUE DU
PRINCIPE RGULATEUR DE LA RAISON PAR RAPPORT TOUTES LES IDES COSMOLOGIQUES de CPu et
constitue la troisime partie de cette section, savoir III. Solution des ides cosmologiques de la totalit de la
drivation qui fait sortir les vnements du monde de leurs causes. Et la simple mention des deux intituls qui sont
subordonns celui de cette partie III suffit nous rappeler quelle tait la solution de la troisime antinomie :
Possibilit de lunion de la causalit libre avec la loi gnrale de la ncessit naturelle
claircissement de lide cosmologique dune libert unie la loi gnrale de la ncessit naturelle.
Maintenant si cette Ide dune cause libre est applique au sujet humain avec lhypothse quil est capable de
dterminer certaines de ses actions, on obtient le concept duquel partira la Critique de la raison pratique. Si cette
Ide dune cause libre est applique un tre qui aurait pu concevoir la nature, on obtient lIde dune finalit de la
nature qui peut justement jouer un rle positif en servant de fondement certaines maximes de la raison; les
maximes en question sont celles par lesquelles la raison guide lentendement dans sa recherche des lois de la nature
et par ce rle de principes rgulateurs que Kant leur fait jouer se trouve rendue possible (et aussi explique) cette
unit de la nature que toutes les recherches empiriques postulent et recherchent de fait, alors que la raison, fidle
son habituelle recherche dinconditionn, lexige comme but final <Endabsicht> de sa propre activit. Cette ide est
exprime explicitement dans lAppendice la dialectique transcendantale je lai cite ci-dessus :
Lunit formelle suprme, qui repose exclusivement sur des concepts rationnels, est lunit finale
<zweckmige> des choses, et lintrt spculatif de la raison nous oblige regarder toute
175
ordonnance <Anordnung> dans le monde comme si elle tait sortie des desseins <Absicht> dune
raison suprme.
(CRPu, Bar 529.2.1-5; dans le passage intitul
Du but final <Endabsicht> de la dialectique naturelle de la raison humaine)
partir de cette Ide de finalit, peut slaborer la conceptualit de la troisime Critique.
La libert, cest ce qui exprime le caractre inconditionn de la causalit dune chose en soi. La finalit, cest
ce qui exprime le caractre intentionnel de la causalit dune chose en soi. Cest pourquoi Kant dsigne souvent la
finalit au moyen dune spcification du concept de causalit lui-mme: causalit [] des causes finales
<Kausalitt der Endursachen> (CFJ, Pko 206.2.m3); causalit daprs des fins <Kausalitt nach Zwecken>
(CFJ, Pko 63.2.8); ce type de causalit nest possible que chez un tre (une chose en soi) dont la facult dagir est
dtermine par des concepts (CFJ, Pko 189.2.3-4); aussi la finalit est-elle galement appele la causalit par
concepts.
En tant que concept, la finalit est
soit le rapport causal lui-mme (entre une chose en soi capable de cette causalit) et son effet (en latin
dans le texte allemand: nexus finalis).
soit une proprit de ce rapport; la liaison finale <Zweckverbindung> (CFJ, Pko 64.1.6).
soit une proprit de ltre, ou de la facult, dont la causalit est par concepts. (Le plus souvent,
lexpression finalit de la nature dsigne une proprit de la nature mme sil nous est absolument
impossible daffirmer cette proprit comme si ctait quelque chose que nous sommes capables de
connatre et mme sil nous est impossible de connatre quoi que ce soit de la nature comme chose en
soi; nous pouvons cependant penser la nature comme ayant une telle proprit et toutes les Ides ne sont
que cela: des reprsentations qui nont pas de valeur objective, de ralit objective.)
soit une proprit dun objet, quand lunit ou la possibilit de cet objet rsulte (est vue comme rsultant)
du fait que lobjet ait t pens; ou encore: quand la convenance de cet objet eu gard nos facults de
connatre est vue comme rsultant du fait que lobjet ait t pens.
soit une proprit de la forme dun objet. [] on nomme finalit de la forme dune chose laccord de
celle-ci avec une constitution qui nest possible que daprs des fins. (CFJ, Pko 29.1.1-3)
Il faut se familiariser avec les quelques concepts relatifs la finalit:
a) le prdicat final <Zweckmig> signifie relatif la finalit ou relatif une fin, et la fin dont il
sagit est toujours le but, sauf dans les expressions o le sme intentionnel et le sme ordinal sont tous
les deux prsents; je nai prsentement en tte que deux expressions o final va signifier dernier :
Endabsicht (comme dans la citation donne 3 paragraphes plus haut, tire de CRPu) o End est le
sme ordinal et absicht est le sme intentionnel.
Endzweck, o End est le sme ordinal et zweck est le sme intentionnel.
Ces deux expressions sont traduites (chez Barni et Philonenko) par but final.
b) La cause finale <Endursache> est
soit lagent capable de se dterminer produire son effet par la reprsentation de cet effet;
gnralement, cest un entendement (le ntre ou un autre) qui occupe cette position dagent, puisque
cest gnralement lentendement qui produit le concept.
soit le concept qui dtermine lagent produire son effet, concept qui est une reprsentation de
leffet produire.
c) CFJ contient plusieurs dfinitions de ce quest une fin. En voici quelques-unes.
[] le concept dun objet, dans la mesure o il comprend en mme temps le fondement de la ralit
de cet objet, se nomme une fin.
(CFJ, Pko 28.4.1-29.1.1)
176
la fin, en gnral, est ce dont le concept peut tre regard comme le principe de lobjet lui-mme
[]
(CFJ, Pko 69.2.5-7)
d) Les sortes de finalit
Premire division. La finalit se divise en finalit subjective et finalit objective :
la finalit subjective est celle attribue des objets de la nature sur la seule base de leffet de plaisir
prouv par nous, le sujet qui peroit ces objets. La finalit subjective est celle dont leffet est
ressenti dans le sujet; elle est celle par laquelle lobjet semble tre lavance comme dtermin
pour notre facult de juger (CFJ, Pko 85.2.6-7). En dautres termes : pour que notre imagination
puisse sentendre avec notre entendement lors de la simple apprhension de certains phnomnes, il
faut que la nature soit comme si elle avait t faite dans le but de nous donner le plaisir de cet accord.
Cette finalit est dite subjective en ce sens que notre raction subjective devant le phnomne est
le seul critre de cette hypothtique finalit. Cest la finalit subjective qui est examine dans la
Critique de la facult de juger esthtique.
la finalit objective est celle dont leffet est aperu dans lobjet. Cette finalit est attribue des
objets de la nature sur la base des proprits quils ont eux-mmes et quils pourraient possder en
raison dune fin dont ils sont la ralisation, indpendamment de la raction quils pourraient susciter,
par ailleurs, dans le sujet. Dans le cas de la finalit objective, non seulement la finalit de la nature
est reprsente dans la forme de la chose, mais son produit mme est reprsent comme fin
naturelle. (CFJ, Pko 39.1.10-12) La finalit objective concerne la possibilit de lobjet lui-mme
suivant les principes de la liaison finale <Zweckverbindung> (CFJ, Pko 64.1.5-6). Elle est la
relation de lobjet une fin dtermine. (CFJ, Pko 68.f.2f) Cest la finalit objective qui est
examine dans la Critique de la facult de juger tlologique.
Deuxime division. La finalit se divise en finalit formelle et finalit matrielle (ou relle)
la finalit formelle est celle attribue la forme seule des objets ou phnomnes donns dans la
perception, donc abstraction faite de la sensation considre comme matire de lintuition. Cest elle
qui est souvent qualifie de finalit [] sans fin (CFJ, Pko 63.2.m10). Jexplique cette formule
dans la section f) qui suit.
[] Le moment formel dans la reprsentation dune chose, cest--dire laccord de la
diversit suivant une unit (sans que soit dtermin ce que celle-ci doit tre) ne nous fait
par lui-mme connatre absolument aucune finalit objective. En effet puisquil est fait
abstraction de cette unit comme fin (ce que la chose doit tre), il ne subsiste en lesprit du
sujet intuitionnant rien dautre que la finalit subjective des reprsentations. Celle-ci
dsigne bien une certaine finalit de ltat reprsentatif dans le sujet et en cet tat une
aisance du sujet saisir <auffassen> une forme donne dans limagination, mais non la
perfection dun objet quelconque, qui nest pas en ce cas pens par le concept dune fin.
(CFJ, Pko 69.2.m15-4)
Je ne suis pas parvenu dcider sil y a un ou deux concepts de finalit formelle; ou plutt si le
prdicat formelle et le prdicat sans fin expriment le mme concept ou deux concepts
distincts. Sil y avait l deux concepts distincts, ce serait d deux emplois du mot forme:
1dans un cas, la forme concerne est celle de lobjet reprsent, en tant quelle plat
mes facults;
2dans lautre cas, la forme concerne est celle de la relation de finalit;
on a une relation de finalit avec des contenus, lorsque les trois termes de cette relation sont
dtermins: savoir la fin, la cause (qui agit selon la reprsentation-fin) et leffet;
mais on na que la forme dune relation de finalit lorsque un ou deux des trois termes de la
relation sont indtermins, comme cest le cas lorsque nous pensons la finalit dont leffet est notre
plaisir sans pourtant parvenir identifier la fin ni la cause (en tant que volont dtermine par cette
fin).
NOTE. La finalit intellectuelle peut tre considre comme une sorte de finalit formelle; il sagit
de cette finalit observe dans lessence des choses (en tant que phnomnes) (CFJ, Pko
177
185.2.m6-5), cest--dire dans les choses dont lessence est adquatement reprsente dans le
concept que nous en construisons. Typiquement, les choses qui satisfont cette condition sont les
figures gomtriques (le cercle, le triangle, etc.) et les figures mathmatiques (CFJ, Pko 186.2.14).
Cette finalit est toujours une sorte de finalit objective.
la finalit matrielle est celle attribue aux objets ou phnomnes considrs dans leur ralit, donc
avec leurs prdicats qui fournissent la sensation; aussi la finalit matrielle est-elle galement
qualifie de relle. Elle exige comme principe une fin.
Troisime division. La finalit se divise en finalit pratique et finalit naturelle.
la finalit pratique est celle que lon attribue un sujet humain, et, plus spcifiquement, sa facult
de dsirer (ou volont), lorsquon pense cette dernire comme chose en soi dote dune causalit
libre. La causalit libre est son tour dfinie comme la capacit de sautodterminer par la
reprsentation de leffet produire par laction ce qui prsuppose la possibilit, pour une telle
chose en soi, dtre linitiatrice absolue dune chane causale, donc dtre cause sans dpendre
causalement dune cause antrieure.
la finalit naturelle est celle que nous attribuons un objet ou phnomne lorsque nous tablissons
entre lui et sa cause la relation complte de causalit finale (telle que dabord conue pour un
entendement quelconque) avec ses trois lments: 1 une fin reprsente dans une Ide; 2 une cause
dont la dtermination nest possible que par une fin; 3 un effet qui nest possible que par cette
cause. On attribue la nature une finalit naturelle, lorsquon pense la facult dagir de celle-ci par
analogie avec celle du sujet humain. Cest la finalit que nous concevons lorsquil sagit de juger
un rapport de cause effet, que nous ne parvenons considrer comme lgal, que si nous posons au
fondement de la causalit de sa cause lIde de leffet comme condition de possibilit de cette
causalit. (CFJ, Pko 186.3.3-6) Il nest lgitime de faire cette analogie que dans les contextes o la
facult de juger se contente de rflchir (c.--d. objectiver son propre fonctionnement).
Quatrime division. La finalit se divise en finalit externe et finalit interne
la finalit externe (ou relative CFJ, Pko 187.1.5; 63. De la finalit relative de la nature la
diffrence de la finalit interne.) de ltre naturel est celle que lon attribue un objet ou phnomne
de la nature lorsquon le considre en tant que moyen pour lusage final dautres causes (CFJ, Pko
187.1.2-3), entendons de causes autres que celle qui la produit lui-mme; le vocabulaire kantien
distingue deux sortes dautres causes: cette finalit se nomme lutilit (pour lhomme) ou aussi
convenance (pour tout autre crature) (Ibid., 187.1.4-5).
la finalit interne de ltre naturel. Une finalit est interne si et seulement si elle est simultanment
objective, matrielle (relle), lgale <gesetzlich> [je traduirais ladjectif allemand par nomique] et
quen plus nous considrons immdiatement leffet comme production artistique <Kunstprodukt>
(CFJ, Pko 186.3.2f; 63). Un objet nest final (reli une fin) en ce sens interne, que si la fin
entrevue par sa cause se ralise entirement avec lui et quil nest pas ncessaire, pour raliser
entirement cette fin, que cet objet serve en plus quelque chose dautre ou quelquun dautre. La
finalit naturelle interne est celle qui sert penser la possibilit des tres naturels organiss,
savoir les vivants : le produit qui manifeste ce type de finalit en tant qutre organis et
sorganisant lui-mme, peut tre appel une fin naturelle <N a t u r z w e c k > (CFJ, Pko 193.2.2f)
Cinquime division. La finalit pratique se divise en finalit techniquement pratique et finalit
moralement pratique.
7.2.2.3 Les sortes de finalit et la division de la philosophie
Il sagit de prciser, relativement aux prdicats pratique et thorique, comment se rpartissent les
contextes demploi des concepts de finalit et de savoir si, au bout du compte, ces contextes appartiennent la
philosophie thorique ou la philosophie pratique.
Le concept de finalit a des aspects qui permettent de lui associer des contextes demploi de deux sortes:
178
les contextes quon peut faire appartenir la philosophie thorique
les contextes quon peut faire appartenir la philosophie pratique.
A. Lorsque la finalit est considre comme le principe duquel dpend la convenance entre la forme de la nature
et nos facults, ses contextes demploi sont en philosophie thorique. Dans cette situation, on a alors
lobligation de spcifier les diffrences entre
jugements de connaissance
et jugements de rflexion.
On doit galement spcifier les diffrence entre les concepts qui permettent la production des connaissances
(ce seront forcment des concepts de la nature) et les concepts qui, sans permettre un accroissement des
connaissances, permettent
soit la dimension esthtique de lexprience et la communicabilit des dispositions subjectives dans les
limites dun sens commun
soit une systmatisation de notre exprience de la nature et de notre science de la nature.
Poussant plus avant la diffrenciation, la Critique, dans CFJ, aura galement pour tche de montrer que ce
sont justement deux interprtations de la finalit qui fournissent le principe de la distinction entre les
jugements tlologiques et les jugements esthtiques.
B. Lorsque la finalit est considre comme le principe duquel dpend la dtermination des actions imputables
des agents, ses contextes demploi sont alors des candidats susceptibles dappartenir la philosophie
pratique, mais tous ne seront pas retenus. Et la tche de la Critique est de dpartager entre
la finalit entendue en son sens technique (et qui concerne donc ce qui est techniquement pratique); la
thorie de ce type de finalit ne relve dj plus de la philosophie (pure), mais de disciplines empiriques
occupes identifier des modes naturels de dtermination de la volont (celle-ci tant alors considre
comme facult naturelle): la prudence, lhabilet, la connaissance des faits de la nature et des traits de
caractre des personnes, etc.
et la finalit entendue au sens moral; cest en ce sens seulement que la finalit est un concept de la
libert et que la dtermination de laction par des fins concerne le sujet humain et relve de la
philosophie pratique.
7.2.2.4 Concernant la seconde division (formelle/matrielle)
du concept de finalit
Pour expliquer le concept de finalit formelle et de finalit sans fin, je trouve utile de prsenter une
paraphrase en langage simple (plus simple que celui de Kant) de certains passages de 10 et de 11. Ce procd
prsente linconvnient dintroduire ici du matriel que ma dmarche dexposition devrait prsenter seulement dans
les matrices des registres 1 et 2 de la section E ci-dessous; mais, dun autre ct, ma dmarche prescrit que
jexplique maintenant le sens des concepts kantiens et que je les prsente comme le vocabulaire dans lequel seront
nonces les thses. Or, je nai pas trouv, pour expliquer ce concept, de moyen plus pdagogique que le suivant.
Il sagit de savoir quel est le fondement du jugement qui exprime le plaisir intellectuel produit en nous par la
perception des objets beaux, en dautres termes quel est le fondement du jugement esthtique.
(Paraphrase de 10. De la finalit en gnral. ) Pour concevoir la finalit dun objet, nous plaons, dans
le cas paradigmatique, une reprsentation de cet objet, un concept de cet objet, dans une volont et nous supposons
que ce concept, alors appel fin, dtermine cette volont produire lobjet en question.
Lexemple classique est la finalit de la statue sculpte; on suppose que le sculpteur possde une
reprsentation (un concept) de la statue produire et que cette reprsentation dtermine la volont du
sculpteur: lobjet qui en rsulte a la forme et lexistence qui avaient dabord t penss dans la reprsentation
(forma finalis).
Dans le cas du plaisir que nous prouvons loccasion de notre apprhension de certains objets de notre
exprience, voil un tat de notre esprit <Gemtszustand> qui est leffet de quelque cause; ce serait
179
assurment un effet final (c.--d. un effet de type fin, obtenu la manire dune fin, selon la relation de
finalit) si nous pouvions en placer la reprsentation dans une volont qui sest laiss dterminer par cette
reprsentation et qui a agi selon cette reprsentation. Or, nous ne pouvons placer dans la nature ni une telle
reprsentation (ni une telle fin; ni, dailleurs, aucune fin), ni une telle volont (ni une volont comme facult
en gnral, ni la volont dtermine de produire ce plaisir en nous). Parlerons-nous nanmoins dune finalit
de la nature pour dsigner sa causalit relativement notre plaisir? Kant dit: oui, nous pouvons le faire
pourvu que
1 nous constations ltat de choses suivant :
[] nous ne pouvons expliquer et comprendre [la] possibilit [de notre plaisir, considr
comme tat de notre esprit] que dans la mesure o nous admettons son fondement une
causalit daprs des fins, cest--dire une volont qui en aurait ordonn la disposition daprs la
reprsentation dune certaine rgle.
(CFJ, Pko 63.2.6-9)
2 et que nous reconnaissions alors que la finalit laquelle nous recourons est dune sorte un peu
particulire puisquelle est seulement une finalit au point de vue de la forme, une finalit sans fin :
La finalit peut donc tre sans fin <Die Zweckmigkeit kann also ohne Zweck sein>, dans la
mesure o nous ne posons pas les causes de cette forme en une volont; bien que nous ne
puisions obtenir une explication comprhensible de sa possibilit, quen drivant celle-ci dune
volont. Or il ne nous est pas toujours ncessaire de saisir par la raison (en sa possibilit), ce
que nous observons. Ainsi <Also> nous pouvons tout au moins observer une finalit au point de
vue de la forme, sans mettre son fondement une fin (comme tant la matire du nexus finalis),
et la remarquer dans les objets, mais, il est vrai, seulement par rflexion.
(CFJ, Pko 63.2.10-f; suite immdiate de la citation prcdente.)
(Paraphrase du titre de 11. Le jugement de got na rien dautre son fondement que la forme de la finalit dun
objet (ou de son mode de reprsentation). et de son deuxime paragraphe.) Ce que cette finalit a de purement
formel peut sexprimer aussi par lexpression contenue dans le titre de 11, de sorte quon a trois expressions
quivalentes pour expliciter ce quest la finalit formelle:
une finalit sans fin
une finalit selon la forme (seulement)
la forme de la finalit.
Le lecteur de Kant voudra bien prendre garde au vocabulaire utilis pour formuler la thse dominante de 11 : []
la principe dterminant <du jugement de got> [] ne peut donc tre que la finalit subjective dans la
reprsentation dun objet, sans aucune fin (ni objective, ni subjective), cest--dire par consquent la simple forme
de la finalit dans la reprsentation [].. Pour interprter lopposition objective/subjective survenant ici, il faut se
placer dans le contexte de la section 10, que jai longuement paraphras ci-dessus. Pour comprendre quune finalit
subjective nimplique pas forcment une fin subjective, il faut aller au-del de lidentit des adjectifs employs ici:
la finalit est dite subjective parce que la facult de juger lattribue la nature sur la seule base du constat
de plaisir vu comme effet;
la fin objective est celle qui serait place dans la volont de la nature si la facult de juger parvenait
identifier une telle fin et une telle volont ce qui nest pas le cas, comme le montre 10.
la fin subjective est la reprsentation qui servirait de fin lauteur du jugement de got et qui
dterminerait la volont de celui qui prouve le plaisir intellectuel exprim par ce jugement; et cest le
premier paragraphe de 11 qui carte la possibilit quune telle fin serve de principe dterminant au
jugement de got.
une fin de la nature est dfinie comme la fois objective et matrielle :
Lexprience conduit notre facult de juger au concept dune finalit objective et matrielle,
cest--dire au concept dune fin de la nature, mais seulement lorsquil sagit de juger un rapport de
cause effet, que nous ne parvenons considrer comme lgal <gesetzlich>, que si nous posons au
180
fondement de la causalit de sa cause lIde de leffet comme condition de possibilit de cette
causalit.
(CFJ, Pko 186.3.1-6)
LE CONCEPT DE DTERMINATION ET LE PRDICAT DTERMINANT
concept dtermin par opposition concept indtermin;
principe dterminant dun jugement;
jugement dterminant par opposition jugement rflchissant.
Kant oppose conceptuellement usage dterminant et usage rflchissant de la facult de juger.
en ce qui concerne lusage dterminant de la facult de juger. Voir CFJ, Pko 30.4.
La facult de juger dterminante sous les lois universelles transcendantales, que donne
lentendement, ne fait que subsumer; la loi lui est prescrite a priori et il ne lui est pas ncessaire de
penser pour elle-mme une loi pour pouvoir subordonner le particulier dans la nature luniversel.
(CFJ, Pko 28.2)
la facult de juger rflchissante; la facult de juger en son usage rflchissant; les jugements
rflchissants (CFJ, Pko 37.3.m3); un jugement de rflexion formel <ein formales Reflexionsurteil>
(CFJ, Pko 122.4.6-7).
[] la rflexion sur les lois de la nature se rgle sur la nature et [] celle-ci ne se rgle pas sur les
conditions suivant lesquelles nous cherchons en acqurir un concept tout fait contingent par
rapport elle.
(CFJ, Pko 28.2.4f)
Par ailleurs, Kant utilise aussi les mots dterminant et dterminer dans des contextes o il sagit de
savoir quel est le principe dterminant dun jugement, ou quest-ce qui dtermine (au sens de fonder) un
jugement. Le texte kantien proposera donc des contextes dans lesquels il sera question
dun principe dterminant pour un jugement rflchissant
dun principe dterminant pour un jugement dterminant.
Ainsi nous apprendrons, en CFJ 11, que la finalit subjective dans la reprsentation dun objet est le principe
dterminant du jugement de got, lequel nest pas un jugement dterminant puisque la facult de juger esthtique
nest pas dterminante mais bien rflchissante. Ce qui montre que le mot dterminant, dans le syntagme
principe dterminant <Bestimmungsgrund> na pas le mme sens que dans le syntagme jugement dterminant;
notamment, on ne peut pas appliquer au syntagme principe dterminant larticulation dterminant/rflchissant
pour former le syntagme principe rflchissant.
LE VOCABULAIRE DE LOBJECTIVIT: LA RPARTITION DES PRDICATS OBJECTIF ET SUBJECTIF
La prsente section concerne une particularit du vocabulaire kantien qui doit absolument tre aperue et
comprise trs tt, au cours de la lecture de CFJ, faute de quoi peut sinstaller une confusion conceptuelle qui risque
dentraver pour longtemps la comprhension du texte. Les prdicats objectif et subjectif ont deux emplois
distincts et logiquement indpendants :
selon le premier emploi, il sagit de spcifier de quelle finalit il sagit; objectif signifie dont leffet
est aperu dans lobjet; subjectif signifie dont leffet est ressenti dans le sujet.
selon le second emploi, il sagit de spcifier, propos dun concept ou dun principe, sil est objectif ou
subjectif. Cette proprit est pistmologique et qualifie le rapport que ces reprsentations (concept ou
principe) entretiennent avec ce quelles reprsentent:
un concept est objectif sil dtermine lobjet quil reprsente tout en dterminant un tat de la facult
o il apparat; un concept est subjectif sil dtermine seulement un tat de la facult o il apparat
sans dterminer lobjet quil reprsente; en ce sens, une fin subjective nest rien de plus quune fin
181
conue par le sujet et pour lui: remporter llection est une fin subjective du candidat la fonction de
dput.
un principe est objectif quand il fait connatre (au sens thorique) quelque chose de lobjet par le
jugement quil fonde; un principe est subjectif quand il fonde un jugement sans faire connatre (au
sens thorique) quelque chose de lobjet vis par ce jugement.
Lorsque Kant pose le problme de savoir quel est le principe dterminant dun jugement de finalit donn,
de savoir sur quoi un tel jugement est fond, il en vient utiliser les deux emplois peu de distance lun de lautre,
notamment lorsquil explique
que le principe de finalit objective est un principe subjectif, que le concept de finalit objective, dans
certains contextes, na pas de ralit objective.
quaucune fin subjective ne peut [] tre au fondement du jugement de got (CFJ, Pko 64.1.3-4) mais
que la finalit subjective lest, et peut seule ltre. (CFJ. 11).
Le lecteur doit tre conscient de la dualit des emplois pour que de tels noncs ne soient pas nigmatiques.
Au dbut de la section 75. Le principe dune finalit objective de la nature est un principe critique de la
raison pour la facult de juger rflchissante., Kant nonce titre dexemples deux principes affirmant tous deux la
finalit objective de la nature et fait observer que lun est un principe objectif et lautre un principe subjectif. Ce
passage montre trs clairement les deux emplois de la paire de prdicats objectif/subjectif et je trouve utile que
le lecteur de Kant prenne conscience de cette dualit bien avant dtre rendu, dans sa lecture de CFJ, la section
75. Voici les deux noncs :
La production de certaines choses de la nature ou mme de la nature tout entire nest possible que par
une cause, qui se dtermine intentionnellement laction
[] daprs la constitution particulire de mes facults de connatre je ne puis juger autrement de la
possibilit de ces choses et de leur production quen concevant pour celles-ci un cause, qui agit par
intention, par consquent un tre, qui est producteur par analogie avec la causalit dun entendement.
(CFJ, Pko 212.2.1-9)
Bien que ces noncs naffirment pas la mme chose, chacun deux peut tre appel un principe de la finalit
objective de la nature (au sens de : affirmant la finalit objective de la nature). En disant que le premier est objectif
et le second subjectif, Kant fait voir que le prdicat objective dans lexpression finalit objective de la nature
nest pas employ dans le mme sens que le mme prdicat dans lexpression principe objectif pour la facult de
juger dterminante (CFJ, Pko 213.1.4-5).
Je signale ici cette diffrence de sens titre de particularit importante du vocabulaire kantien et non titre
dexplication de la thse dominante de la section 75. Je discuterai plus bas le contenu thorique des affirmations de
Kant voques ici.
7.2.3 Les explananda (tats de choses dcrire) et les explicanda (concepts
clarifier) eu gard aux plans dactivit C - P - D
Les liens logiques entre les parties D et E qui suivent sont les suivants:
jnonce dabord les explananda et les explicanda de la philosophie critique kantienne; les deux termes
latins dsignent des choses expliquer, telles quon peut les formuler ou identifier ltape o elles
reprsentent des problmes pour la pense:
explananda dsignent des tats de choses, faits et phnomnes en tant que ce sont des objets
expliquer par des thories;
explicanda dsigne des concepts ou notions, en tant ce que sont des objets expliquer par des
dfinitions ou clarifications de termes. Jemprunte Rudolf Carnap ce sens spcialis de
lexplication philosophique.
182
Les termes mentionns cette tape-ci appartiennent en principe au vocabulaire pr-thorique et
dsignent des ralits qui sont considres comme admises, quoi non comprises, et des notions qui ont
cours, bien quelles requirent des clarifications.
ensuite, en E, je tente de dcrire la production thorique kantienne; je divise nouveau cette tape :
dabord, je rponds la question: Quelles sont, daprs la Critique, les reprsentations qui sont
associes aux diverses facults en tant quoutils ou principes de leur activit spcifique? La rponse
cette question devrait idalement constituer une sorte dinventaire de la conceptualit kantienne, en
termes de concepts a priori et de principes a priori qui ont un rle transcendantal.
puis je tente de rappeler les principales thses du criticisme en les subsumant sous le dnominateur
commun de processus : lorsque Kant rsout les problmes quil sest poss, il dit comment chaque
facult agit, comment, en particulier, elle utilise les reprsentations quelle possde ou construit pour
produire les types de pense qui lui conviennent (certaines de ces penses tant des connaissances).
Les reprsentations des facults rapparaissent dans la description des processus mais je leur ajoute
une information plus complexe concernant la manire dont elles sont utilises pour produire le
rsultat expliquer; la description des processus est dynamique.
troisimement, pour faciliter la synthse et la mise en mmoire, je fais mention, dans les cases
correspondantes de la mme matrice des 6 facults, des principales appellations au moyen desquelles
on tiquette les principales constructions thoriques dont jai rappel certaines thses dans le tableau
des processus.
Autre faon dnumrer les thmes les plus englobants:
lien entre les lois de fonctionnement des facults et les lois de la nature
lien entre finalit et pratique des sciences de la nature (activits de recherche scientifique)
lien entre finalit et pratique des arts
lien entre finalit et action morale; ou encore: entre finalit et poursuite du bonheur.
Explananda (tats de choses dcrire, expliquer) Explicanda
(concepts clarifier)
C les conditions de possibilit du jugement de connaissance <Erkenntnisurteil>,
thorique
lunit de lexprience comme source de connaissance
lunit de la science comme systme des lois de la nature
le caractre de ncessit propre aux lois universelles de la nature
le Savoir en tant que
connaissance objective;
lexprience
le moi, le monde, Dieu
les conditions de possibilit du jugement mathmatique (Faut-il mentionner le
jugement logique?)
le Savoir en tant que
connaissance formelle
(mathmatique)
les conditions de possibilit du jugement tlologique sur la nature
la technique de la nature;
lunit de la nature suivant des lois empiriques et lunit de lexprience
(comme systme daprs des lois empiriques) (CFJ, Pko 31.1.17-19)
lunit de la nature en gnral comme systme des fins (CFJ, Pko 196 67)
la Nature en tant que
systme
la Science en tant que
systme
les tres organiss (la vie)
la coexistence de la causalit naturelle et de la causalit libre
P les conditions de possibilit du jugement esthtique ou jugement de got
Laptitude des hommes se communiquer leurs penses (CFJ, Pko 129.2.1)
le Beau; le Got; le Sublime
dans la nature; dans lart
la diffrence entre le beau
et lagrable, entre le
beau et le bon
laccord de lentendement avec limagination (et plus gnralement: le plaisir
d la synergie des facults)
183
D les conditions de possibilit du jugement moral le Devoir; le bon (ce qui est
moralement bien)
le fait de la moralit La foi et lobjet de foi; la
croyance
Lesprance et lobjet
desprance
Tableau 11.11 Les objets (prthoriques) de la rflexion critique, rpartis selon la typologie C - P - D .
Peut-on associer aux explananda et explicanda un complment circonstanciel qui exprime soit une contrainte
que la problmatique impose par avance une ventuelle solution-explication, soit du moins une attente lgard de
lventuelle solution-explication? Pour amorcer une rflexion de ce genre, je prsente le tableau
Contrainte Attente
C maintenir la physique de Newton et, plus spcifiquement, le caractre universel et ncessaire des lois
newtoniennes du mouvement, tout en expliquant le statut particulier des sciences formelles.
concilier le finalisme (vitalisme?) et le mcanisme dans ltude scientifique des tres vivants.
P concilier connaissance rationnelle (par concepts) et connaissance par sentiment tout en sauvant la thse de la
possibilit de la communication intersubjective.
D
respecter lautonomie de la volont du sujet (contrainte probablement juge normale dans lesprit de la
philosophie des Lumires <Aufklrung> ).
donner un appui aux conceptions du pouvoir fondes sur le droit (au sens lac du terme).
concilier science et foi, savoir et croyance.
Tableau 11.12 Exemples de contraintes dont pourrait faire mention une description fine
des problmatiques initiales des Critiques.
7.3 Les registres de lecture de la matrice des 6 facults
Une fois quon a dispos les six facults sur une matrice deux entres orthogonales, il faut prciser quel type
dinformation on veut placer dans les cases de la matrice; plus prcisment, on veut prciser par quel type
dinformation on caractrisera le rapport que Kant tablit entre une facult du groupe E - J - R et une facult du
groupe C - P - D . Un tel rapport possde plusieurs aspects et une description homogne doit dire quels aspects sont
pris pour objet lors dun parcours donn de la matrice. Le concept quon va utiliser pour dterminer ce type
dinformation, pour identifier laspect choisi lors dune description du rapport, constitue ce que jappelle un
registre de lecture, eu gard la matrice; cest ce concept, en effet, qui assure une certaine homognit logique
et smantique linformation quon va rpartir sur les cases de la matrice, lesquelles reprsentent, en tant quespace
abstrait, le rapport (voire les rapports possibles) entre deux facults. (Et si on fusionne deux cases, on peut
reprsenter un rapport entre trois facults, comme dans le cas o E et J ne sont plus diffrencis, et quon les met en
rapport avec C; et ainsi de suite.).
Ici le lecteur de Kant a le choix entre plusieurs possibilits selon le niveau de rsolution auquel il choisit
doeuvrer. Aprs plusieurs essais, jai opt pour deux registres de lecture :
le registre des reprsentations. Je vais inscrire sur ce registre les contenus reprsentationnels des
facults, contenus considrs dans lune ou lautre des fonctions suivantes (qui constituent les divers
emplois du terme reprsentation) :
ce qui, dans la facult, reprsente lobjet (par exemple, une intuition);
ce qui sert doutil la facult dans laccomplissement de ses fonctions (par exemple, une rgle
exprime par un concept a priori);
ce que la facult produit en propre (par exemple, une Ide transcendantale);
184
ce qui sert de principe ou de fondement lopration de la facult et lui confre son caractre
nomique <gesetzlich> (par exemple, le principe de dtermination du jugement de got).
le registre des processus. Je vais inscrire sur ce registre les oprations imputes aux facults. Mon
objectif (qui ne sera ici atteint que bien imparfaitement) est de montrer comment Kant conoit le travail
des facults, en recensant systmatiquement les verbes daction et, dune faon gnrale, le vocabulaire
dynamique que Kant utilise. Ici le choix des niveaux de rsolution les plus appropris pose un problme
de taille car
il nest pas sr que les deuxime et troisime Critiques atteignent des niveaux de rsolution aussi
levs que ceux de la Critique de la raison pure;
les niveaux de rsolution les plus bas, ceux qui identifient les actions les plus globales (par exemple:
laction produire un jugement de connaissance) peuvent nidentifier que le thme ou
lexplanandum dune thorie sans encore identifier des actions conues spcifiquement par cette
thorie, en ce quelle a doriginal. De sorte quil faut identifier le seuil en-de duquel la description
nest pas encore tout fait significative, en tant que rsultat danalyse.
Une fois consignes les oprations des facults, il peut tre intressant, du point de vue de la synthse, de
rpartir sur les cases et rgions de la matrice des 6 facults, les noms des thories que forment les thses avances
par Kant lors de sa description des oprations des facults. Je tenterai don de prsenter, la suite des tableaux
constituant le deuxime registre de lecture de la matrice, une nomenclature des thories constitutives du criticisme
(tableau 11.25).
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C
Reprsentations et processus dcrits dans CRPu et impliquant la facult de juger dterminante.
Ralisation de la critique des jugements de connaissance
C
Reprsentations et processus dcrits dans CFJ et impliquant la facult de juger rflchissante
P
dans la production des jugements tlologiques
Reprsentations et processus dcrits dans CFJ et impliquant la facult de juger rflchissante
dans la production des jugements esthtiques
Coupure entre la philosophie thorique et la philosophie pratique
P
Reprsentations et processus dcrits dans CRPa et impliquant la facult de juger pratique
D
dans la production des jugements moraux
Tableau 11.13 Reprsentation, sur la matrice des 6 facults, des zones que dfinissent
les rapports entre les facults du groupe E - J - R et celles du groupe C - P - D .
Dans tous les tableaux de la prsente section 7.3, puisque la plupart des citations sont extraites de CFJ, Pko,
je conviens domettre les lettres CFJ, Pko dans lindication de ces rfrences ce qui me fait sauver beaucoup
despace. Si une rfrence mentionne une autre source, celle-ci sera indique explicitement.
Avertissement. Tous les tableaux qui composent les deux registres de lecture de la matrice des 6 facults sont
donns ci-dessous davantage pour montrer une mthode de travail loeuvre que pour consigner les rsultats
dtaills dune application soutenue de cette mthode. Le lecteur qui trouvera intressante cette faon de
systmatiser la thorie kantienne des facults et par elle le criticisme lui-mme est invit complter les tableaux,
car ils ne contiennent prsentement que des informations sommaires et bien des vides.
185
7.3.1 Registre 1. Le registre des reprsentations. Les facults comme sources ou
siges de reprsentations
7.3.1.1. Les reprsentations comme outils, fondements ou illusions de lactivit
thorique des facults
Je ne reprendrai pas ici les explications abondantes contenues dans ma prsentation des textes de la Critique
de la raison pure, cest--dire dans les exposs groups sous les thmes #1 #9 du prsent ouvrage. Le lecteur sy
rfrera au besoin.
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C Les 12 concepts purs (ou
catgories)de E, regroups selon la
quantit, la qualit, la relation, la
modalit.
Les principes (synthtiques) purs
de lentendement:
les axiomes de lintuition
les anticipations de la perception
les analogies de lexprience
les postulats de la pense
empirique en gnral
Ides transcendantales de R :
lunit absolue
du sujet pensant: le moi
de la srie des conditions du
phnomne: le monde
de la condition de tous les
objets de la pense en gnral:
Dieu.
Le principe de tous les jugements synthtiques: tout objet est soumis
aux conditions ncessaires de lunit synthtique des lments divers de
lintuition au sein dune exprience possible. (CRPu, Bar 202.4.2-f)
Le principe de tous les jugements synthtiques a priori : les conditions
de la possibilit de lexprience en gnral sont en mme temps celles de
la possibilit des objets de lexprience, et cest pourquoi elles ont une
valeur objective dans un jugement synthtique a priori. (Ibid., 203.1.2-f)
Les principes rgulateurs
lgard de E : 1) homognit du
divers sous des genres plus levs;
2) varit de lhomogne sous des
espces infrieures; 3) affinit de
tous les concepts.
Les concepts de la rflexion trans-
cendantale (identit et diversit,
convenance et disconvenance, etc.)
Raisonnements dialectiques :
les paralogismes (concernant le
moi)
les antinomies (concernant le
monde)
lidal de la raison pure
(concernant Dieu)
Le principe rgulateur de lextension maximale de lusage empirique de lentendement et de la raison;
poursuite de la rgression (Cf. appendice de la dialectique transcendantale)
Tableau 11.14 Registre des reprsentations, pour les facults impliques
dans la production des jugements de connaissance.
7.3.1.2. Les reprsentations comme outils, fondements ou illusions de lactivit
rflexive des facults
Concernant le jugement tlologique
En 73. Aucun des systmes prcits ne ralise ce quil prtend (cinquime de la dialectique de CFJ),
Kant dit de tous ces systmes: Ils veulent expliquer nos jugements tlologiques sur la nature (CFJ, Pko 208.3.1-
2). Cest galement ce quil veut faire. Cependant, Kant voudra distinguer, parmi les jugements tlologiques,
186
ceux qui ont pour objet des choses dont lessence nous est donne dans un concept; typiquement, ce sont
les figures gomtriques (le cercle, le triangle, etc.) et les tres mathmatiques;
ceux qui ont pour objet les tres matriels non organiss;
ceux qui ont pour objet les tres matriels organiss (66);
ceux qui ont pour objet la nature en gnral considre comme un systme, cest--dire comme une
multiplicit dont lunit, pour nous, ne peut que rsider dans un rapport une fin il sagira justement
de trouver comment concevoir cette dernire.
La thorie critique se propose de dterminer dans quels cas et en quel sens une finalit peut tre affirme, bon
droit, de la nature.
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C le concept particulier a priori de
la finalit de la nature; il a son
origine uniquement dans la facult
de juger rflchissante
le principe de la finalit de la
nature
la loi de la spcification de la
nature
le concept dune chose comme fin
naturelle en elle-mme (194.2.1-
2)
lIde dun fondement incondition-
n de la nature obtenue par
lanalogie avec lIde que la raison
se fait de sa propre causalit
inconditionne (par rapport la
nature), cest--dire la libert
(217.2.4-5)
lIde de la nature en totalit
comme dun systme daprs la r-
gle des fins (197.2.5-6)
Maxime du jugement de la
finalit interne des tres
organiss : Un produit organis
de la nature est celui en lequel tout
est fin et rciproquement aussi
moyen. Il nest rien en ce produit,
qui soit inutile <umsonst>, sans
fin, ou susceptible dtre attribu
un mcanisme naturel aveugle.
(195.1.1-f; 66.)
Le principe transcendantal dune
finalit de la nature
Ce principe est driv de
lexprience; mais il doit avoir
pour fondement un principe a
priori
Tableau 11.15 Registre des reprsentations, pour les facults impliques
dans la production des jugements tlologiques.
Les rapports entre la facult de connatre C et la facult de juger rflchissante J.
75. Le principe dune finalit objective de la nature est un principe critique de la raison pour la
facult de juger rflchissante.
(CFJ, Pko 212; titre de section.)
Or ce principe [dont la facult de juger rflchissante a besoin pour remonter du particulier
dans la nature jusqu luniversel] ne peut tre autre que le suivant: puisque les lois universelles de
la nature ont leur fondement dans notre entendement, qui les prescrit la nature (il est vrai
187
seulement daprs son concept universel en tant que nature), les lois empiriques particulires,
relativement ce qui demeure en elles dindtermin par les lois universelles, doivent tre
considres suivant une unit telle quun entendement (non le ntre il est vrai) aurait pu la donner au
profit de notre facult de connatre, afin de rendre possible un systme de lexprience daprs des
lois particulires de la nature. Ce nest pas que lon doive pour cela admettre rellement un tel
entendement (car cest, en effet, la facult de juger rflchissante seulement que cette Ide sert de
principe pour rflchir et non pour dterminer), mais au contraire cette facult, ce faisant, se donne
une loi seulement elle-mme, et non la nature.
[] le principe de la facult de juger, en ce qui concerne la forme des choses de la nature
sous des lois empiriques en gnral, est la finalit de la nature en sa diversit, ce qui signifie que par
ce concept on se reprsente la nature comme si un entendement contenait le principe de lunit de la
diversit de ses lois empiriques.
La finalit de la nature est ainsi un concept particulier a priori, qui a son origine uniquement dans
la facult de juger rflchissante.
(CFJ, Pko 28.3.1-29.2.3; dans lIntroduction)
Le caractre subjectif du concept de finalit de la nature et du principe qui lui correspond est maintes fois
affirm par Kant.
[] ce concept transcendantal dune finalit de la nature nest ni un concept de la nature, ni un
concept de la libert, parce quil nattribue absolument rien lobjet ( la nature), mais reprsente
seulement lunique manire suivant laquelle nous devons procder dans la rflexion sur les objets de
la nature en vue dune exprience compltement cohrente, et par suite cest un principe subjectif
(maxime) de la facult de juger.
(CFJ, Pko 31.1.m7-2).
[] Ce principe de la raison ne lui appartient que subjectivement, cest--dire comme maxime : tout
dans le monde est bon quelque chose; dans le monde rien nest vain.
(CFJ, Pko 197.2.m6-4)
Le concept de finalit naturelle peut-il ds lors tre considr comme un concept rationnel? Deleuze nous dit
que non. Ce concept drive des Ides de la raison (en tant quil exprime une unit finale [=conforme une fin] des
phnomnes) [mais] ne se confond pas avec une Ide rationnelle, car leffet conforme cette causalit se trouve
effectivement donn dans la nature. (Del, PCK 90.2) Pour affirmer que le concept en question nest pas un concept
rationnel, Kant dit : Le concept dune chose, comme fin naturelle en elle-mme, nest pas ainsi un concept
constitutif de lentendement ou de la raison mais il peut tre cependant un concept rgulateur pour la facult de
juger rflchissante, pour guider la recherche sur les objets de ce genre et rflchir sur leur principe suprme []
(CFJ, Pko 194.2.1-5; accentuation en gras due NL).
Voici un excellent rsum, pour ce qui est des caractristiques du concept de fin naturelle.
Le concept dune chose, comme fin naturelle en elle-mme, nest pas ainsi un concept
constitutif de lentendement ou de la raison; mais il peut tre cependant un concept rgulateur pour
la facult de juger rflchissante, pour guider la recherche sur les objets de ce genre et rflchir sur
leur principe suprme daprs une analogie loigne avec notre causalit suivant des fins en gnral,
cette rflexion servant moins la connaissance de la nature ou de son fondement originaire
<Urgrund> que celle de la facult pratique rationnelle en nous, en analogie avec laquelle nous
considrons la cause de cette finalit.
(CFJ, Pko 194.2.1-f)
Pour quune chose soit une fin naturelle,
il faut dabord que lexistence et la forme des parties soient lies en un tout, et que cette liaison soit une
condition ncessaire de la possibilit du tout. Dans ce cas, la chose elle-mme, en tant que tout, est une
fin en gnral (non pour les parties mais pour ltre qui en a lIde.) Cette premire condition est
ncessaire mais elle nest pas suffisante; quand la possibilit dune chose nest pense que de cette faon,
188
on a un artefact <Kunstwerk>, cest--dire quelque chose dont la cause rside dans un tre raisonnable
qui est externe la chose.
il faut ensuite que les parties de la chose soient la fois des causes et des effets les unes par rapport aux
autres, cest--dire que chacune, en plus dtre cause par les autres et un outil (organe) pour les autres,
soit galement un organe produisant les autres parties (CFJ, Pko 193.2.m7).
[] que les parties de cette chose se lient dans lunit dun tout, en tant rciproquement les
unes par rapport aux autres cause et effet de leur forme.
(CFJ, Pko Ibid. , 192.4.5-7)
En utilisant le vocabulaire technique de Kant, on peut noncer plus succinctement ces deux conditions en disant
quil faut 1 que la chose elle-mme soit une fin en gnral et 2 que la cause de lexistence et de la liaison des
parties soit interne la chose. Un produit de la nature qui satisfait ces conditions est un tre organis et
sorganisant lui-mme (CFJ, Pko 193.2.2f). Cette dfinition, notons-le en passant, est tonnamment contemporaine
quand on la rapproche des thses de Varela sur la fermeture organisationnelle et lautopose des vivants.
propos du concept de fins dans la nature comme fins intentionnelles (CFJ, Pko 214.2.14), Kant raffirme
plusieurs reprises quil na pas de ralit objective; ainsi :
Il nous est mme a priori impossible de justifier comme acceptable <als annehmungsfhig zu
rechtfertigen> un tel concept dans sa ralit objective.
(CFJ, Pko 214..2.18-19)
Un problme dexgse. Sil est vrai que le concept de fin naturelle est utilis comme principe subjectif et
rgulateur pour dterminer un jugement rflchissant tlologique, il reste quil vaut avec autant de ncessit pour
notre facult de juger humaine que sil tait objectif (CFJ, Pko 218.2.3f; accentuation en gras due NL). Cest
peut-tre pour cette raison quil doit avoir pour le moins lapparence dune valeur objective ou un certain degr de
ralit objective; cest ainsi que jinterprte le passage suivant:
Dans la nature les tres organiss sont [] les seuls, qui, lorsquon les considre en eux-
mmes et sans rapport dautres choses, doivent tre penss comme possibles seulement en tant que
fins de la nature et ce sont ces tres qui procurent tout dabord <zuerst> une ralit objective au
concept dune fin, qui nest pas une fin pratique, mais une fin de la nature, et qui, ce faisant, donnent
la science de la nature le fondement dune tlologie, cest--dire dune manire de juger ses objets
daprs un principe particulier, que lon ne serait autrement pas du tout autoris introduire dans
cette science (parce que lon ne peut nullement apercevoir a priori la possibilit dune telle forme de
causalit).
(CFJ, Pko 194.3.1-f; 65.)
Ou peut-tre faut-il penser que le concept de fin de la nature, en tant quil est associ la maxime du jugement de la
finalit interne des tres organiss (telle qunonce en 195.1, premier paragraphe de 66) et que celle-ci trouve son
occasion <Veranlassung> dans lobservation empirique, donc que le concept de fin de la nature est dabord <zuerst>
dot dune ralit objective, et que cest par la suite, lorsquon le gnralise dans le concept a priori de finalit de la
nature quil devient, cette fois en tant que concept de la raison, un concept subjectif, dpourvu de ralit objective.
(Je ne considre pas entirement rgl ce problme dexgse.)
On pourrait peut-tre terminer cet inventaire des reprsentations associes la facult de juger tlologique
en mentionnant les reprsentations qui, daprs lAnalytique du jugement tlologique, ne peuvent pas assumer la
fonction de fondement eu gard au jugement tlologique :
la satisfaction objective (CFJ, Pko 186.2.f) que procure la facult P la perfection relative [] des
figures mathmatiques (CFJ, Pko 186.2.13-14).
la finalit pratique de la nature.
le plaisir et la peine qui rsultent [] de la dtermination de [la facult suprieure de dsirer] par la loi
morale (CFJ, Pko 27.1.m5-4)
189
Concernant le jugement esthtique
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
P E est requis comme facult de la
dtermination de lobjet et de sa
reprsentation (sans concept),
daprs le rapport de celle-ci au
sujet et son sentiment interne et
cela dans la mesure o ce jugement
est possible daprs une rgle
universelle.
plaisir [prouv] devant cet
accord de la nature avec nos
facults de connatre [accord] que
nous considrons comme
simplement contingent (38.1.2-6)
le plaisir est le principe de la
dtermination du jugement de got.
le principe de lidalisme de la
finalit (173.2.1)
plaisir de la simple rflexion
(126.3.3-4)
plaisir pris au sublime de la
nature, comme plaisir de la
contemplation (126.2.1-5)
lIde indtermine du
suprasensible en nous (165.2.6)
les principes a priori de la
satisfaction ne peuvent tre saisis
dans des concepts dtermins
(170.1.f)
lIde du supra-sensible, comme
principe de la finalit subjective de
la nature pour notre facult de
connatre (169.2.m5-3)
E fournit un concept dtermin du
produit en tant que fin [], mais
aussi une reprsentation (bien
quindtermine) de la matire,
cest--dire de lintuition, pour la
prsentation de ce concept
(147.2.6-8)*
la finalit subjective dans la repr-
sentation dun objet, sans aucune
fin (ni objective, ni subjective),
cest--dire par consquent la
simple forme de la finalit dans la
reprsentation, par laquelle un
objet nous est donn (64.1.m8-5)
le concept de beaut en tant
que finalit subjective formelle
(182.2.m5)
Ides intellectuelles (144.3.4-5)
par opposition Ides esthtiques
(de limagination)
plaisir (dans le sentiment moral)
(123.4.8) comme consquence du
jugement moral (125.3)
Tableau 11.16 Registre des reprsentations, pour les facults impliques
dans la production des jugements esthtiques.
* NOTE associe au tableau 11.16. Le concept dtermin et la reprsentation indtermine mentionns ici ne
sont comprhensibles que si on tient compte du rapport entre limagination et lentendement. Voir des prcisions
ce sujet, ci-dessous.
LES DIVERSES REPRSENTATIONS DE LA FACULT DU PLAISIR. Comme elles sont assez nombreuses,
Kant consacre plusieurs dveloppements montrer comment elles se distinguent les unes des autres ou comment
elles sont associes les unes aux autres. (Je ne systmatise pas ces relatons ici.)
Lagrable, qui en tant que tel ne reprsente lobjet que par rapport au sens, doit, pour tre appel
bon comme objet de la volont, tre dabord ramen sous les principes de la raison au moyen du
concept dune fin.
(CFJ, Pko 52-53)
Lagrable, le beau, le bon dsignent donc trois relations diffrentes des reprsentations au
sentiment de plaisir et de peine, en fonction duquel nous distinguons les uns des autres les objets ou
les modes de reprsentation. Aussi bien les expressions adquates pour dsigner leur agrment <die
Komplazenz> propre ne sont pas identiques. Chacun appelle agrable ce qui lui FAIT PLAISIR
190
<vergngt>; beau ce qui lui PLAT simplement <gefllt>; bon ce quil ESTIME, approuve
<geschtzt, gebilligt>, cest--dire ce quoi il attribue une valeur objective.
(CFJ, Pko 54.3 in 5)
THSE DU PRINCIPE DTERMINANT DU JUGEMENT DE GOT. Lunique principe de la facult de juger
dans le jugement esthtique est linterprtation idaliste de la finalit subjective qui consiste en un accord se
prsentant de lui-mme, sans fin et par hasard, mais de caractre final pour les besoins de la facult de juger
concernant la nature et ses formes produites suivant des lois particulires. (CFJ, Pko 170.2.4f) Kant nonce aussi
cette thse dans le titre mme dune section, savoir 75. Le jugement de got na rien dautre son fondement
que la forme de la finalit dun objet (ou de son mode de reprsentation). Comme le jugement de got ne concerne
que le rapport des facults reprsentatives entre elles, pour autant quelles sont dtermines par une reprsentation
(CFJ, Pko Ibid., 64.1.2f), jexpliciterai ci-dessous en 7.3.2.1 Linteraction des facults dans la production des
jugements la nature du rapport entre limagination et lentendement.
Les relations entre le beau comme prdicat du jugement de got et les reprsentations contenues dans
limagination et la raison :
[] le modle suprme, le prototype <Urbild> du beau est une simple Ide que chacun doit produire
en soi-mme et daprs laquelle il doit juger tout ce qui est objet du got, tout ce qui est exemple du
jugement de got et mme le got de tout un chacun. Ide signifie proprement: un concept de la
raison, et Idal : la reprsentation dun tre unique en tant quadquat une Ide.
(CFJ, Pko 73.2.6-12)
[] [Ce prototype] ne sera cependant quun Idal de limagination, prcisment parce quil ne
repose pas sur des concepts, mais sur la prsentation [].
(Ibid., 73.2.m7-5)
Pour reprsenter efficacement les diverses reprsentations qui participent la production du jugement
esthtique, il faut ajouter lentre horizontale de la matrice des 6 facults les deux facults que jai convenu
dexclure au dpart, savoir la sensibilit en tant quorgane de la sensation et limagination. En effet, la
reprsentation produite par limagination est une composante ncessaire de la liste des reprsentations impliques
dans le jugement esthtique, puisque cest le rapport entre limagination et lentendement qui affecte la facult du
plaisir et de la peine. Cette extension de la matrice des six facults sera encore plus invitable, lorsquon voudra
reprsenter les Ides esthtiques que Kant introduit dans lAnalytique du Sublime et montrer la relation quelles
entretiennent avec les Ides de la raison. La modification que requiert la matrice est montre dans le tableau 11.17.
Ss I E J R
P la matire de la
sensation
<Vergngen>
ce qui plat dans la
sensation
lIde esthtique (49)
le plaisir prouv
comme accord des
facults
reprsentatives
le concept dont lId.
esth. fournit une
prsentation; le concept
en tant quexpression
inadquate de Id. esth.
le principe
subjectif de la
finalit
subjective
les Ides de R;
le concept pur
rationnel du
supra-sensible
Tableau 11.17 La zone P du registre des reprsentations, montrant lextension de la typologie E - J - R
en S s - I - E - J - R , pour tenir compte des reprsentations fournies par limagination,
dans le processus de production des jugements esthtiques.
Voici deux dfinitions de ce que sont les Ides esthtiques :
191
[] par lexpression Ide esthtique jentends cette reprsentation de limagination, qui donne
beaucoup penser, sans quaucune pense dtermine, cest--dire de concept, puisse lui tre
adquate et que par consquent aucune langue ne peut compltement exprimer et rendre intelligible.
On voit aisment quune telle Ide est la contrepartie (le pendant) dune Ide de la raison, qui
tout linverse est un concept, auquel aucune intuition (reprsentation de limagination) ne peut tre
adquate.
(CFJ, Pko 143.f.2-144.1.f)
En un mot : lIde esthtique est une reprsentation de limagination associe un concept
donn, et qui se trouve lie une telle diversit de reprsentations partielles, dans le libre usage de
celles-ci, quaucune expression, dsignant un concept dtermin, ne peut tre trouve pour elle, et
qui donne penser en plus dun concept bien des choses indicibles, dont le sentiment anime la
facult de connaissance et qui inspire la lettre du langage un esprit <und mit der Sprache, als
bloem Buchstaben, Geist verbindet>.
(CFJ, Pko 146.2.1-f)
LENTENDEMENT DANS LE JUGEMENT ESTHTIQUE
[] bien que lentendement soit requis pour le jugement de got, en tant que jugement esthtique
(comme pour tous les jugements), ce nest point cependant comme facult de la connaissance dun
objet quil est requis, mais comme facult de la dtermination de celui-ci et de sa reprsentation
(sans concept), daprs le rapport de celle-ci au sujet et son sentiment interne et cela dans la
mesure o ce jugement est possible daprs une rgle universelle.
(CFJ, Pko 70.f.7f)
JUGEMENT ESTHTIQUE ET LGALIT
La finalit esthtique est la lgalit de la facult de juger en sa libert.
(CFJ, Pko 107.1.m9-8)
LE JUGEMENT ESTHTIQUE EST-IL FOND SUR UN CONCEPT?
La position de Kant est ici trs subtile et dispose dune petite marge de manoeuvre car il sagit pour lui
dun ct, dinsister sur le fait que le jugement de got ne subsume pas son objet sous un concept ce
qui permet daffirmer que son principe dterminant ne peut tre un concept (CFJ, Pko 70.2.3)
de lautre ct, dinsister sur le fait que le jugement de got a une valeur ncessaire pour chacun, une
valeur universelle, bien quil soit personnel <Privaturteil>, et que donc il doit se ramener quelque
concept (CFJ, Pko 164.2.1).
Cest dailleurs trs exactement la question de savoir si un jugement de got se fonde sur un concept ou non qui
donne lieu lantinomie du got: la rponse affirmative non critique entrant en contradiction avec la rponse
ngative non critique.
Toute lastuce va consister montrer que le concept, auquel on rapporte lobjet dans ce type de jugement,
nest pas pris dans le mme sens dans les deux maximes de la facult de juger esthtique (CFJ, Pko 163.f.4f); Kant
va tablir une diffrence capitale entre
le concept considr comme rgle de lentendement applicable lobjet du jugement, rgle dont la
fonction est de dterminer lobjet pour le penser (en faisant la synthse du divers intuitif)
et le concept considr comme Ide applicable une reprsentation largie englobant lobjet et le sujet,
applicable la situation constitue dun sujet jugeant un objet sensible; au moyen de cette Ide, il devient
possible de penser ce que la facult de juger elle-mme (donc aussi le sujet ) a duniversel en tant que
facult de reprsentation du type sentiment de plaisir et de peine, place en prsence de phnomnes. La
rflexion transcendantale est ici son meilleur.
Il est donc utile, il me semble, de prsenter en regard lune de lautre les rponses kantiennes la question Quel est
le principe dterminant du jugement de got?; en effet, les rponses niant la prsence du concept (de
192
lentendement) doivent tre comprises comme tant contrebalances par celles affirmant la prsence du concept (de
la raison). Je montre ces rponses dans le tableau 11.18.
Il faut nier quil se trouve au fondement du jugement
de got quelque principe a priori (CFJ, Pko 169.1.7-
8); le got juge toujours daprs des principes de
dtermination empiriques, tels par consquent quils ne
peuvent tre donns qua posteriori par les sens (Ibid.,
169.3.2-4)
son principe dterminant nest pas un concept, mais le
sentiment (du sens interne) de laccord dans le jeu des
facults de lesprit, dans le mesure o celui-ci ne peut
qutre senti. (Ibid., 70.2.m15-13)
Le plaisir est ainsi dans le jugement de got dpendant
dune reprsentation empirique et ne peut tre li a
priori aucun concept (on ne peut dterminer a priori
quel objet conviendra ou non au got, il faut en faire
lexprience);
Le concept qui est au fondement de lobjet (et aussi du
sujet jugeant) en tant quobjet des sens, cest--dire en
tant que phnomne (164.4.9-11),
qui sert de principe dterminant au jugement de got et
lui confre une valeur universelle (164.4.m6) est
mais il est cependant le principe de dtermination
de ce jugement, par cela seul que lon a conscience quil
repose simplement sur la rflexion et les conditions
universelles, quoique seulement subjectives, de laccord
de celle-ci avec la connaissance des objets en gnral,
pour lesquelles la forme de lobjet est finale. (38.1.2-f)
le concept de ce qui peut tre considr comme le
substrat supra-sensible de lhumanit. (164.f.2f)
lIde indtermine du supra-sensible en nous
(165.2.6)
Le concept de lentendement est :
dtermin ou dterminable;
objectif;
dtermine lobjet, en fait connatre quelque chose.
Le concept qui fonde le jugement esthtique est
indtermin et indterminable;
subjectif;
ne fait rien connatre de lobjet.
Tableau 11.18 Lexplicitation de la thse nonant le principe dterminant
des jugements de got.
Dautres formulations donnent des indications additionnelles sur le concept qui sert de fondement au
jugement esthtique :
le substrat supra-sensible de toutes [les] facults [du sujet] (quaucun concept de lentendement
natteint}, donc cela mme en rapport auquel cest le fin donne par lIntelligible notre que daccorder
toutes nos facults de connatre. )CFJ, Pko 168.1.1-4)
le concept rationnel <Vernunftbegriff> transcendantal du supra-sensible (CFJ, Pko 164.2.m4-3)
Le jugement de got se fonde sur un concept (un principe en gnral de la finalit subjective de la
nature pour la facult de juger), au moyen duquel cependant rien ne peut tre connu ou prouv par
rapport lobjet, parce quil est en soi indterminable et impropre la connaissance; toutefois le
jugement reoit de par ce concept de la valeur pour tous (ce jugement tant dailleurs en chacun singulier
et accompagnant immdiatement lintuition), parce que le principe dterminant du jugement se trouve
peut-tre dans le concept de ce qui peut tre considr comme le substrat supra-sensible de lhumanit.
(CFJ, Pko 164.f.1-f)
193
7.3.1.3. Les reprsentations comme outils, fondements ou illusions de lactivit
pratique des facults
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
D Les 12 catgories de la libert par
rapport aux concepts du bien et du
mal. (CRPa, 1
re
partie, Livre 1,
Chap. II) Concepts pratiques a
priori.
Le concept de finalit, en tant quil
sadresse D: finalit pratique de
la libert
Le bien et le mal en tant que
concepts de la raison pratique.
Le concept de libert, en tant que
concept de la causalit propre une
volont.
Limpratif catgorique
exprimant le devoir.
Les maximes morales.
Le principe mtaphysique de la
finalit pratique, laquelle doit tre
pense dans lIde de la
dtermination dune volont libre
(CFJ, Pko 29.f.2f)
Tableau 11.19 Registre des reprsentations, pour les facults impliques
dans la production des jugements moraux.
Limpratif catgorique exprimant le devoir peut tre formul de diverses faons, selon laspect de la
volont auquel il sadresse (BAy, FK 81-82):
a) adress la volont considre comme facult dagir daprs la reprsentation dune loi: Agis en telle
sorte que la maxime de ta volont puisse toujours valoir en mme temps comme principe dune
lgislation universelle. (CRPa, Pic 30.2) La loi morale.
b) adress la volont considre comme facult dagir daprs la reprsentation de fins: Agis de telle
sorte que tu traites lhumanit aussi bien dans ta personne que dans la personne dautrui, toujours comme
une fin, jamais comme un moyen.
c) nonc dans une formule qui combine les prcdentes: Agis de telle manire que la maxime de ton
action ait pour fin toi-mme comme personne humaine.
Le tableau 11.19 est plutt lacunaire en son tat actuel. Les problmes relis la nature des reprsentations
que lesprit entretient lors de la dtermination des jugements moraux devraient pouvoir fournir des observations
inscrire dans ce tableau. Je rappelle, par exemple, que le lien entre les concepts pratiques et la facult P du plaisir
et de la peine est problmatique et rend controverse la question de savoir si, ou dans quelle mesure, la philosophie
pratique appartient la philosophie transcendantale. Jai voqu ces problmes dans la section 1.2.3.2 du Thme
#1. Les contextes de la Critique de la raison pure. Puisquil est pertinent ici de recenser les concepts pratiques, et
de dterminer sils se trouvent en D ou en P, je reproduis nouveau la note de Kant que javais cite :
Tous les concepts pratiques se rapportent des objets de satisfaction ou daversion, cest--dire de
plaisir ou de peine, et, par consquent, au moins indirectement, des objets de sentiment. Mais
comme le sentiment nest pas une facult reprsentative des choses, mais quil rside en dehors de
toute facult de connatre, les lments de nos jugements, en tant quils se rapportent au plaisir ou
la peine, appartiennent la philosophie pratique, et non pas lensemble de la philosophie
transcendantale, qui ne soccupe que des connaissances pures a priori.
(CRPu, Bar 600n)
194
7.3.1.4. Les formulations qui regroupent des reprsentations et montrent des
rapports entre C, P et D
TROIS FORMULATIONS DE LIDE DU SUPRA-SENSIBLE
Dans la Remarque II place la fin de 57, Kant identifie les Ides de la Raison en faisant varier les
dterminations du supra-sensible:
le supra-sensible en gnral, sans autre dtermination, en tant substrat de la nature
le supra-sensible, comme principe de la finalit subjective de la nature pour notre facult de connatre
le supra-sensible comme principe des fins de la libert
le supra-sensible comme principe de laccord [des fins] avec la libert dans le domaine moral (CFJ,
Pko 169.2.4-f).
On voit aisment comment chaque version de lIde correspond un ou plusieurs des plans dactivits que jai
reprsents par des tages de la matrice des 6 facults.
7.3.1.5. De lopportunit de distinguer, ou non, entre facult de juger et
entendement
Les rapports entre entendement et facult de juger sont classer dabord en deux groupes:
ceux qui accentuent lindistinction. Ces rapports exploitent de diverses manires lide nonce ds le
dbut de lAnalytique transcendantale: Comme nous pouvons ramener tous / les actes de lentendement
des jugements, lentendement en gnral peut tre reprsent comme une facult de juger
<U r t e i l s k r a f t >. (CRPu, Bar 129.f.f-130.1.2) Mme dans ce contexte, la distinction initiale vaut
toujours, mme sil nest pas toujours opportun ou pertinent den tenir compte: [L]a facult de juger ne
se propose que [l]application [des concepts a priori de lentendement] (KANT, CFJ, Pko 18.4.2f)
ceux qui accentuent la distinction. Ces derniers seront surtout explicits dans la Critique de la facult de
juger puisque la distinction repose principalement sur la distinction entre lusage dterminant de la
facult de juger et son usage rflchissant (dfinition: CFJ, Pko 27.3-28.1; premire application : ibid.
30.4.1-31.1.m8). LAnthropologie continue de tenir compte de cette distinction.
Concernant la distinction et les autres relations tablir entre la facult de juger et lentendement, voir CFJ,
Pko 30.4; 34.1.10f; 34.3-35.1; 38.4-39.1.
Les paramtres considrer dans ltablissement de cette distinction:
le caractre lgislateur (ou seulement lgal, nomique) de la facult et, plus gnralement, sa fonction
dans la production des jugements concerns (esthtique, tlologique);
si le principe qui sert de loi la facult, eu gard la dtermination des jugements, est objectif ou
subjectif; si ce principe est constitutif ou rgulateur;
la production (ou non) dun concept de lobjet reprsent dans les jugements a priori;
la fonction de la reprsentation produite (utilise?) par la facult: si cest un concept, il dtermine lobjet,
si cest une intuition, cette dernire ne fait que prsenter <darstellen> lobjet et elle peut galement
prsenter un concept dj donn.
Les concepts appartiennent lentendement mais pour sen servir il faut produire des jugements. Cest ce
rapport simple entre entendement et facult de juger que Kant rutilise au dbut de lAnalytique des principes:
CRPu, Bar 179-183.
Lanalytique des principes sera donc simplement un canon pour le jugement; elle lui enseigne
appliquer des phnomnes les concepts de lentendement, qui contiennent la condition des rgles a
priori. Cest pourquoi, en prenant pour thme les principes propres de lentendement , je me servirai
de lexpression de doctrine du jugement, qui dsigne plus exactement ce travail.
(CRPu, Bar 180.2)
195
Il est implicite, ce moment de lexpos, que les facults dcrire concourent la production de connaissances
(puisque tel est le thme circonscrit par la problmatique initiale de CRPu) et que la diffrence entre entendement,
facult de juger <Urteilskraft> et raison est en corrlation avec la diffrence que fait dj la logique gnrale entre
concepts, jugements et raisonnements, du simple point de vue de la forme des reprsentations. Est galement
prsente dans ce contexte lide que la dnomination large dentendement en gnral (CRPu, Bar 179.1)
comprend ces trois facults.
Cependant, comme il existe des jugements qui ne dterminent pas leur objet, cest--dire dont la fonction
nest pas de penser lindividualit dun objet sous luniversel dun concept mais dont la fonction est plutt
dexprimer soit le plaisir intellectuel prouv en la reprsentation de lobjet (cas du jugement esthtique), soit
certaines injonctions que la facult se donne elle-mme pour produire de lunit dans ldifice de ses
reprsentations (cas du jugement tlologique), il faut bien parvenir distinguer dans la facult de juger, des
fonctions spcialises et faire varier en consquence, au besoin, le lien de collaboration entre la facult de juger et
lentendement; car autant la fonction dterminante de la facult de juger prsuppose et complte celle de
lentendement, autant la fonction rflchissante met en oeuvre un mcanisme qui esquive celle de lentendement et
lui devient trangre par le but quelle vise.
7.3.1.6. Les facults comme pouvoirs lgislatifs
Le pouvoir lgislatif des facults sentend de deux manires
soit comme pouvoir de se donner sa propre loi, plutt que de la trouver ailleurs (dans lexprience ou
dans une autre facult)
soit comme pouvoir de se donner sa propre loi ET de la prescrire quelque chose dautre (tantt lobjet
donn dans lexprience, tantt une autre facult).
Quand une facult fonctionne selon une loi quelle se donne, elle a une lgalit <Gesetzmigkeit> et elle est
lgale <gesetzlich; que je prfre traduire par nomique> . Quand une facult prescrit sa loi, elle a un domaine
<Gebiet> et elle est lgislatrice <gesetzgebend> . Donner une loi quivaut lgifrer.
A. Pour ce qui est des trois facults C - P - D , il est possible dtablir une correspondance entre la
terminologie drive du concept de loi et lopposition entre facult suprieure et facult infrieure.
1. Concernant la facult de connatre. Lopposition est faite entre la sensibilit et lentendement; et cest
seulement lentendement qui est facult lgale et lgislatrice.
Tant que la synthse est empirique, la facult de connatre apparat sous sa forme infrieure: elle
trouve sa loi dans lexprience et non pas en elle-mme. Mais la synthse a priori dfinit une facult
de connatre suprieure. Celle-ci, en effet, ne se rgle plus sur des objets qui lui donneraient une loi;
au contraire, cest la synthse a priori qui attribue lobjet une proprit qui ntait pas contenue
dans la reprsentation. Il faut donc que lobjet lui-mme soit soumis la synthse de reprsentation,
quil se rgle lui-mme sur notre facult de connatre, et non linverse. Quand la facult de connatre
trouve en elle-mme sa propre loi, elle lgifre ainsi sur les objets de connaissance.
(Del, PCK 10.2)
Dans lAnthropologie du point de vue pragmatique, sous le titre De la facult de connatre, dans la mesure o
elle est fonde sur lentendement, Kant nonce la mme relation en remplaant loi par rgle (dans ce passage,
toutefois, laccent est mis sur la relation entre suprieure et infrieure :
40. Lentendement, en tant que facult de penser (de se reprsenter quelque chose par des concepts)
est appele [sic] facult suprieure de connaissance (par opposition la sensibilit, qui est la facult
infrieure); en effet, tandis que la facult des intuitions (pures ou empiriques) ne saisit dans les
objets que lindividu, la facult des concepts saisit luniversalit de leurs reprsentations, la rgle
laquelle le multiple des intuitions sensible [sic] doit tre subordonn pour produire lunit dans la
connaissance de lobjet. Lentendement vrai dire est plus lev que la sensibilit, mais celle-ci
est plus ncessaire et on peut moins se passer de la sensibilit; avec elle, les animaux sans
196
entendement peuvent se tirer daffaire en cas de besoin, en suivant des instincts inns; elle est
comme un peuple sans chef; inversement, un chef sans peuple (entendement priv de sensibilit) ne
peut absolument rien. Il ny a donc pas entre les deux facults de rivalit de rang, bien quon appelle
lune suprieure, lautre infrieure.
(AP, Fou 68.2)
NOTE. Dans cette hirarchie, limagination, de laquelle procde la composition du divers de lintuition, fait partie
de la facult infrieure de connatre.
2. Concernant la facult de dsirer.
forme infrieure: la volont est dtermine de manire pathologique, par exemple, par lintermdiaire
dun plaisir li lobjet reprsent.
forme suprieure:
Pour que [la facult de dsirer] accde sa forme suprieure, il faut que la reprsentation cesse
dtre une reprsentation dobjet, mme a priori. Il faut quelle soit la reprsentation dune pure
forme. Si dune loi on enlve par abstraction toute matire, cest--dire tout objet de la volont
comme principe dterminant, il ne reste rien que la simple forme dune lgislation universelle.
(Critique de la raison pratique, Analytique, thorme 3) La facult de dsirer est donc suprieure, et
la synthse pratique qui lui correspond est a priori, lorsque la volont nest plus dtermine par le
plaisir, mais par la simple forme de la loi. Alors, la facult de dsirer ne trouve plus sa loi hors
delle-mme, dans une matire ou dans un objet, mais en elle-mme: elle est dite autonome.
(Del, PCK 12.1)
3. Concernant le sentiment du plaisir et de la peine. Un sentiment suprieur du plaisir sera dfini comme le
sentiment du beau et un autre comme le sentiment de laccord des facults entre elles.
On peut comparer notre typologie celle de Verneaux. Cette dernire est base sur le schme C-
P-D crois avec les deux niveaux (VoK, tome 2, p. 19sqq.). La faon dont il dgage les cinq
sens du terme facult (Ibid., p. 18) ne donne pas lieu une typologie.
B. Pour ce qui est de lentendement et de la raison, cest la rfrence deux domaines qui exprime le plus
directement leur pouvoir lgislatif do la commode opposition entre concepts de la nature et concepts de la
libert.
Notre facult de connatre en totalit possde deux domaines, celui des concepts de la nature,
et celui du concept de libert; elle lgifre, en effet, a priori par ces deux genres de concepts. La
philosophie se divise donc aussi, en accord avec cette facult, en philosophie thorique et en
philosophie pratique. Mais le territoire sur lequel elle tablit son domaine et sur lequel elle exerce sa
lgislation, est toujours seulement lensemble des objets de toute exprience possible, dans la
mesure o ils ne sont tenus pour rien de plus que de simples phnomnes; sil en tait autrement on
ne pourrait concevoir aucune lgislation de lentendement qui les concerne.
La lgislation par des concepts naturels <Naturbegriffe> seffectue par lentendement et elle
est thorique. La lgislation par le concept de la libert seffectue par la raison et elle est simplement
pratique. Cest seulement dans ce qui est pratique que la raison peut lgifrer; en ce qui concerne la
connaissance thorique (de la nature) elle ne peut, partant de lois donnes (dont elle est instruite
grce lentendement), que tirer par des raisonnements des conclusions, qui demeurent toujours
seulement au niveau de la nature. Inversement, l o il y a des rgles pratiques, la raison ne lgifre
pas pour autant car ces rgles peuvent tre techniques-pratiques.
Lentendement et la raison ont donc deux lgislations diffrentes sur un seul et mme
territoire de lexprience, et celles-ci ne doivent pas sy gner lune lautre.
(CFJ, Pko 24.2.1-4.3)
Ce sont ces relations qui sont montres dans le tableau que Kant dessine la fin de son Introduction la Critique
de la facult de juger. Mais on remarquera que la facult de juger pose un problme du fait dtre place dans la
mme colonne que deux facults lgislatrices possdant des domaines propres; en effet, dans la mesure o la facult
197
de juger mentionne l procure des connaissances affectant la facult de plaisir et de peine et o le principe qui lui
procure sa lgalit est la finalit, il ne peut tre question de lui reconnatre une lgislation du genre de celles que la
citation prcdente vient doctroyer lentendement et la raison. Tout lenjeu de CFJ est l: expliquer comment
(en quoi, pourquoi, moyennant quoi, dans quelles limites et conditions, etc.) la facult de juger peut tre lgale
sans tre lgislatrice; moins que elle soit lgislatrice sans tre dterminante.
Dans lAppendice 6, je rappelle les dfinitions techniques donnes par Kant des termes champ, territoire,
domaine et je construis un tableau montrant comment se rpartissent les concepts dont il est question dans la
thorie des facults, lorsquon les compare entre eux selon leur territoire et leur domaine.
Tout de mme que la question du pouvoir lgislatif se pose propos des facults, elle peut se poser galement
propos de la critique elle-mme qui fait la thorie des ces facults, en tant que lauteur ou lagent de la critique est
aussi une facult, savoir la raison pure. La critique des facults de connatre, considres dans ce quelles peuvent
a priori, na proprement aucun domaine pour ce qui est des objets. (CFJ, Pko 25.3.1-3) Donc la critique ne
lgifre pas eu gard aux objets (c.--d. les facults) quelle fait connatre (quelle a comme domaine). Elle a un
champ: les prtentions des facults.
C. Pour ce qui est de la facult de juger, lopposition conceptuelle qui correspond le mieux lopposition
entre une facult lgislatrice et une facult qui ne lest pas est celle entre facult de juger dterminante et facult
de juger rflchissante.
Concernant la facult de juger: elle lgifre exclusivement en son usage dterminant, en lequel elle se
confond avec la lgislation de lentendement. Quant la facult de juger rflchissante, elle ne lgifre pas,
proprement parler, mais elle se donne elle-mme sa propre loi et fonctionne de faon nomique <gesetzlich> en
raison du caractre a priori des principes qui fondent ses jugements.
[] dans la famille des facults suprieures de connatre il existe encore un moyen-terme entre
lentendement et la raison. Celui-ci est la facult de juger, dont on peut supposer avec raison,
suivant lanalogie, quelle pourrait bien aussi contenir en soi, sinon une lgislation qui lui soit
propre, toutefois un principe particulier pour chercher des lois, en tout cas un principe a priori
simplement subjectif, qui, alors mme quaucun champ dobjets ne lui conviendrait comme domaine
propre, peut cependant avoir quelque territoire et dans des conditions telles que ce principe seul
pourrait y avoir de la valeur.
(CFJ, Pko 26.2)
D. Pour ce qui est des rapports entre limagination et lentendement, il est question parfois dune
hirarchie, mais je ne suis pas sr quil sagisse dun pouvoir lgislatif. Dans le cas du jugement de got, par
exemple : lentendement est au service de limagination et non limagination au service de celui-ci. (CFJ, Pko
82.1.2f) On sait que Kant par le volontiers dune libre lgalit de limagination (Ibid., 80.4.2-4) et aussi de la
lgalit de lentendement; mais limagination est-elle lgislatrice <gesetzgebend>? A-t-elle un domaine?
7.3.2 Registre 2. Le registre des processus
chaque tableau qui reprsente une zone du registre des processus, jajoute une petite grille, que
jappelle grille de contrle et qui contient ou non des donnes titre dexemples; elle est fournie
pour permettre au lecteur un exercice danalyse ou de synthse.
A. Lexercice danalyse consiste prendre les cinq catgories donnes ci-dessous et les utiliser
pour interroger le texte kantien au cours de la lecture et de ltude de la Critique de la facult de
juger. Les catgories ont alors pour fonction dattirer lattention du lecteur sur des aspects de la
thorie quil tudie; la grille sert consigner ce quil observe.
B. Lexercice de synthse consiste prendre les cinq catgories donnes pour construire un
rsum ordonn de ce qui a t compris et retenu de la lecture et de ltude faites auparavant. La
grille sert consigner ce que le lecteur a retenu de sa lecture.
198
Les catgories suivantes sappliquent en principe la description-explication de chacun des
processus pris pour objet par la Critique :
a) nature (et origine?) de la reprsentation prsente en la facult;
b) nature de lobjet et ce qui lui advient; (je prsuppose ici quune reprsentation reprsente
gnralement quelque chose et cest ce quelque chose que jappelle lobjet de la
reprsentation);
c) nom du processus et de la facult qui le ralise; si le processus se dcompose en plusieurs
oprations : nom de chaque opration et de la facult qui en est lagent;
d) proprits du jugement lui-mme (proprits du jugement de connaissance; proprits du
jugement tlologique, etc.)
e) nonc(s) du principe dterminant de la facult de juger et/ou du jugement quelle produit.
7.3.2.1. Linteraction des facults dans la production des jugements
REMARQUES GNRALES SUR LA POSSIBILIT ET LA MANIRE DE DISTINGUER LES FACULTS ENTRE ELLES
Le registre des processus pourrait galement sappeler le registre de laccord des facults.
[] tout accord dtermin des facults, sous une facult dterminante et lgislatrice, suppose
lexistence et la possibilit dun accord libre indtermin. Cest dans cet accord libre que le
jugement, non seulement est original (ce quil tait dj dans le cas du jugement dterminant), mais
manifeste le principe de son originalit. Daprs ce principe, nos facults diffrent en nature, et
pourtant nen ont pas moins un accord libre et spontan, qui rend possible ensuite leur exercice sous
la prsidence de lune dentre elles, selon une loi des intrts de la raison. Toujours le jugement est
irrductible ou original: ce pourquoi il peut tre dit une facult (don ou art spcifique). Jamais il
ne consiste en une seule facult, mais dans leur accord, soit dans un accord dj dtermin par lune
dentre elles jouant un rle lgislateur, soit plus profondment dans un libre accord indtermin, qui
constitue lobjet dernier dune critique du jugement en gnral.
(Del, PCK 87.2)
La facult des concepts, quils soient confus ou distincts, est lentendement; et bien que
lentendement soit requis pour le jugement de got, en tant que jugement esthtique (comme pour
tous les jugements), ce nest point cependant comme facult de la connaissance dun objet quil est
requis, mais comme facult de la dtermination de celui-ci et de sa reprsentation (sans concept),
daprs le rapport de celle-ci au sujet et son sentiment interne et cela dans la mesure o ce
jugement est possible daprs une rgle universelle. (CFJ, Pko 70.2.8f)
Entendement et imagination en tant que facults de connaissance ET facults de reprsentation. Voir CFJ, Pko 60.4-
61.2; CFJ, Pko 78.3.m2-79.1.3
Concernant la distinction entre facult de juger esthtique et facult de juger tlologique.
La facult de juger esthtique est [] une facult particulire pour juger les choses daprs une rgle
et non suivant des concepts. La facult de juger tlologique nest pas une facult particulire, mais
seulement la facult de juger rflchissante en gnral, dans la mesure o elle procde, comme
partout dans la connaissance thorique, daprs des concepts, mais en suivant par rapport certains
objets de la nature des principes particuliers, qui sont ceux dune facult simplement rflchissante
et ne dterminant pas les objets; et ainsi de par son application elle appartient la partie thorique de
la philosophie et en raison de ses principes particuliers, qui ne sont pas dterminants comme il le
faut dans une doctrine, elle doit aussi constituer une partie particulire de la critique au lieu que la
facult de juger esthtique ne contribue en rien la connaissance de son objet et doit donc faire
partie seulement de la critique du sujet qui juge et de ses facults de connaissance, dans la mesure o
elles sont susceptibles de principes a priori []
(CFJ, Pko 40.1.m19-3)
199
Ce passage contient ce quil faut pour comprendre pourquoi la thorie du jugement tlologique concerne une
facult qui a un rapport la facult C des connaissances thoriques mme si elle ne dtermine pas ses objets, cest--
dire mme si elle nest que rflchissante : cest quelle procde daprs des concepts et contribue la connaissance
de ses objets (par exemple la connaissance des tres organiss, la connaissance de la nature dans son ensemble).
Mais lentendement et la facult de juger tlologique sont galement en rapport avec la facult P du plaisir et de la
peine, dans le processus de production du jugement tlologique; en effet lentendement, eu gard aux lois
particulires de la nature (et non pas les lois universelles), cherch[e] avec intention atteindre lune de ses fins
ncessaires, je veux dire lintroduction dans la nature de lunit des principes (CFJ, Pko 34.1.m5-3) et se trouve
donc en mesure dprouver le plaisir li ncessairement la ralisation dune intention lorsque la facult de juger
attribue la nature, via le principe subjectif a priori de la finalit de la nature (ou loi de la spcification de la nature
par rapport ses lois empiriques), lunit cherche. Cette ide et cette thse sont exposes dans la section VI de
lIntroduction CFJ; cest cette ide qui justifie que je dessine dans le tableau une partie du rectangle
reprsentant la thorie du jugement tlologique dans la partie suprieure de la zone horizontale consacre la
facult P. Mais on voit que cette ide ne sert pas du tout tablir une diffrence entre facult de juger esthtique et
facult de juger tlologique, puisque cest justement lide de finalit quelles ont en commun comme principe
subjectif de dtermination.
LES CARACTRISTIQUES DU JUGEMENT DE CONNAISSANCE
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C synthse des intuitions au moyen
des concepts purs de E;
dterminations des objets en tant
quunit du divers au moyen de la
rgle de E
subsomption des objets particuliers
donns dans lintuition empirique
sous des objets universels;
en nonant les principes purs de
E, J ne fait qunoncer les
conditions de cette subsomption
R, en son usage logique, produit les
raisonnements; elle tend
expliciter les conditions des
jugements.
R, en son usage spculatif, pose les
objets auxquels aboutit son
exigence de totalisation des
conditions.
synthse des lois universelles de la
nature dans des jugements
synthtiques a priori
R guide J et E en fournissant des
principes pour la gouverne des
facults (pr. rgulateurs) et non
pour la dtermination des choses.
Tableau 11.20 Registre des processus, pour les facults impliques
dans la production des jugements de connaissance.
Cest lAnalytique transcendantale de CRPu qui contient les descriptions les plus soignes et les plus longues
de linteraction des trois facults I, E et J, lors des processus de synthses menant la production des jugements de
connaissance. Comme les neuf premiers thmes du prsent ouvrage sont consacrs CRPu, il nest pas ncessaire
que jy revienne beaucoup ici. Je signale seulement qu plusieurs reprises CFJ voque brivement les principaux
processus de synthse dcrits dans lAnalytique transcendantale ainsi que les oprations qui y taient assignes
lentendement et au jugement. Ds lIntroduction de CFJ, par exemple, 13 lignes dune belle densit rappellent
linteraction entre lentendement et la facult de juger dterminante, telle que la thorisait CRPu :
Nous trouvons [] dans les fondements de la possibilit dune exprience, tout dabord il est
vrai, quelque chose de ncessaire, je veux dire les lois universelles, sans lesquelles la nature en
gnral (comme objet des sens) ne peut pas tre pense; et ces lois reposent sur les catgories,
appliques aux conditions formelles de toute intuition pour nous possible, pour autant que lintuition
est galement donne a priori . Sous ces lois, ainsi, la facult de juger est dterminante; en effet, elle
na rien dautre faire que subsumer sous des lois donnes. Par exemple, lentendement dit : tout
changement a sa cause (loi universelle de la nature); la facult de juger transcendantale na rien de
200
plus faire que dindiquer la condition de la subsumption sous le concept de lentendement a priori
propos; et cest la succession des dterminations dune seule et mme chose.
(CFJ, Pko 30.f.1-f)
Ainsi Kant rappelle lgamment comment, dans CRPu, la catgorie causalit et dpendance (CRPu, Bar 137) il
faisait correspondre la deuxime analogie de lexprience Principe de la succession dans le temps suivant la loi de
la causalit: Tous les changements <Vernderungen> arrivent suivant la loi de liaison des effets et des causes.
(CRPu, Bar 224.4.1-f)
G R I L L E D E C O N T R L E
a
b lobjet est dtermin par un concept de lentendement.
c
d
e
LES CARACTRISTIQUES DU JUGEMENT TLOLOGIQUE
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C production de lunit dans la
liaison des lois empiriques
particulires de la nature par
laccord des lois de la nature avec
les facults
la reprsentation de la finalit [objective], puisquelle [rapporte] la
forme de lobjet [] une connaissance dtermine de lobjet sous un
concept donn, na rien voir avec un sentiment de plaisir pris aux
choses, mais sadresse lentendement pour le jugement porter sur
elles. Si le concept dun objet est donn, lopration de la facult de
juger, dans lUsage de ce concept en vue de la connaissance, consiste
dans la prsentation (exhibitio), cest--dire quelle doit placer ct du
concept une intuition correspondante [] (38.f.m5-39.1.5)
Nous regardons les fins naturelles comme prsentations du concept
dune finalit relle (objective), et nous les jugeons [] par
lentendement et par la raison (logiquement, daprs des concepts).
(39.1.5f)
Tableau 11.21 Registre des processus, pour les facults impliques
dans la production des jugements tlologiques.
La thse gnrale de la critique de la facult de juger tlologique est
que nous disposons des concepts requis pour concevoir la finalit objective de la nature,
que nanmoins nous ne pouvons pas connatre cette finalit faute de pouvoir dterminer la fin que
poursuit la nature et lentendement qui concevrait cette fin
que nanmoins nous ne pouvons concevoir les tres organiss de la nature autrement que comme
possibles exclusivement en raison dune causalit selon des fins
201
que, par consquent, notre raison nous oblige concevoir la nature tout entire comme un systme selon
des fins, sans quoi ne serait pas possible une unit cohrente de notre exprience de la nature.
Cest dans les sections 75. Le principe dune finalit objective de la nature est un principe critique de la
raison pour la facult de juger rflchissante. et 76. Remarque que Kant fait la description la plus explicite de
linteraction des trois facults E - J - R dans le mcanisme de production du jugement tlologique.
Lintervention de la raison est dcrite, notamment, par un raisonnement partir du caractre contingent des
lois particulires de la nature :
[] le concept dune chose dont nous ne nous reprsentons lexistence ou la forme comme
possibles que sous la condition dune fin, est insparablement li au concept de sa contingence
(daprs les lois de la nature).
(CFJ, Pko 213.3.1-4; 75)
[suite de la citation prcdente] Or comme le particulier, comme tel, contient quelque chose de
contingent par rapport au gnral, et que cependant la raison exige lunit dans la liaison des lois
particulires de la nature, cest--dire la lgalit (laquelle lgalit du contingent se nomme finalit),
alors que la dduction des lois particulires partir des lois universelles par dtermination du
concept de lobjet est impossible a priori en ce qui concerne la contingence que ces lois particulires
comprennent, le concept de la finalit de la nature dans ses production devient pour la facult
humaine de juger par rapport la nature un concept ncessaire, mais non un concept portant sur la
dtermination des objets eux-mmes, donc un principe subjectif de la raison pour la facult de juger,
qui en tant que rgulateur (non constitutif) vaut avec autant de ncessit pour notre facult de juger
humaine que sil tait un principe objectif.
(CFJ, Pko 218.2.15f; 76)
Le concept dune finalit par des fins (lart) possde certes de la ralit objective, comme celui dune
causalit daprs le mcanisme de la nature (CFJ, Pko 212.1.m16-14); quant au concept dune causalit de la
nature daprs la rgle des fins [] sa ralit objective ne peut tre garantie par rien, puisquil ne peut pas tre tir
de lexprience et quil nest pas ncessaire non plus pour la possibilit de lexprience. (Ibid., 212.1.m14-6)
[] le concept de la finalit de la nature dans ses productions devient pour la facult humaine de
juger par rapport la nature un concept ncessaire, mais non un concept portant sur la dtermination
des objets eux-mmes, donc un principe subjectif de la raison pour la facult de juger, qui en tant
que rgulateur (non constitutif) vaut avec autant de ncessit pour notre facult de juger humaine,
que sil tait un principe objectif.
(CFJ, Pko 218.2.7f)
Le principe de la finalit objective de la nature nest quun principe de plus pour soumettre les phnomnes de la
nature des rgles (CFJ, Pko 182.2.8-9): ce nest pas un principe dexplication de la nature.
Si la causalit de la nature tait conue comme intellectuelle et que ce principe de la drivation de ses
produits partir de leurs causes tait jug constitutif (au lieu de rgulateur), on aurait le concept de fin naturelle : le
jugement tlologique serait produit par la facult de juger dterminante, et le concept de fin naturelle serait un
concept de la raison (CFJ, Pko 182.2.m3); il nappartiendrait pas en propre la facult de juger.
Thses ngatives
La finalit naturelle externe (relative) nautorise aucun jugement tlologique absolu (CFJ, Pko
188.3.3f).
Les fins naturelles internes ne se trouvent nullement dans une cause efficiente, mais seulement dans
lide [sic] de celui qui juge <des Beurteilenden> (CFJ, Pko 195.2.m4-3)
G R I L L E D E C O N T R L E
a
202
b lobjet nest pas dtermin par le jugement
c
d
e
LES CARACTRISTIQUES DU JUGEMENT DE GOT
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
P production du plaisir driv de
laccord de I avec E, loccasion
de la simple apprhension (voir
36.3.1-9). I fournit lintuition et la
composition du divers [] [et E
fournit] le concept comme
reprsentation de lunit de cette
composition
1
((121.2.m4-2)
J constitue la condition subjective
de tous les jugements esthtiques
la reprsentation de la finalit [subjective] repose sur le plaisir
immdiat pris la forme de lobjet dans la simple rflexion sur elle
(38.4.m7-5)
Nous regardons la beaut de la nature comme la prsentation du
concept de la finalit formelle (simplement subjective), et nous [la]
jugeons [] par le got (esthtiquement, grce au sentiment de plaisir)
[] (39.1.m7-2)
Tableau 11.22 Registre des processus, pour les facults impliques
dans la production des jugements esthtiques.
1
NOTE 1 (du tableau 11.22). Le texte franais donne ici par erreur le mot comprhension au lieu du mot
composition.
Le croisement que la matrice des six facults reprsente entre J et P est nonc par Kant de la manire
suivante :
[] [les jugements esthtiques] appartiennent [] la facult de connatre seule et prouvent une
relation immdiate de cette facult au sentiment de plaisir et de peine suivant un certain principe a
priori, quil ne faut pas confondre avec ce qui peut tre principe de dtermination de la facult de
dsirer.
(CFJ, Pko 19.2.8-12)
Dans cette description, la facult de connatre est J, le sentiment de plaisir et de peine est P et le principe a priori
origine de R. Tout en affirmant le croisement entre J et P, la remarque de Kant nous prvient quil ne faut pas le
confondre avec un autre croisement, celui qui reliera J D.
La thse principale de lesthtique dcrit ce que fait le jugement esthtique : [] le jugement esthtique
rapporte uniquement au sujet la reprsentation par laquelle un objet est donn (CFJ, Pko 70.2.m20-19), tant
entendu que cette reprsentation nest pas la mme que celle par laquelle il est pens ]Ibid., 72.2.5-6). Le
jugement esthtique
permet de remarquer [] la forme finale dans la dtermination des facults reprsentatives qui
soccupent avec cet objet. Aussi bien le jugement sappelle esthtique parce que son principe
203
dterminant nest pas un concept, mais le sentiment (du sens interne) de laccord dans le jeu des
facults de lesprit, dans la mesure o celui-ci ne peut qutre senti.
(CFJ, Pko 70.2.m19-13)
Concernant le rle de lentendement dans la production du jugement esthtique, nous en avons une premire
indication ds lIntroduction CFJ, dans la manire dont Kant nous dcrit ce que jai appel lesthtisation de la
finalit (section IV; je paraphrase les thses et dcris la dmarche de ce passage dans lAppendice 4). Notre
entendement cherche avec intention atteindre lunit de la nature, et partant lunit de lexprience, au moyen de
principes; et cest parce que cette intention est dabord prsente quun plaisir est ressenti, par la facult P, lorsque
lentendement dcouvre la possibilit de lunion, sous un principe qui les comprend, de deux ou plusieurs lois
empiriques de la nature htrognes (CFJ, Pko 34.3.6-8). Car la ralisation dune intention, tout comme la
satisfaction dune attente, est lie au sentiment de plaisir; et si lintention est intellectuelle, le plaisir qui lui
correspond lest aussi.
Mais pour comprendre comment lentendement peut unifier des intuitions ou mme y apercevoir quelque
chose au profit de la facult de juger, alors mme quil ne les subsume pas sous un concept dtermin procd
qui aurait pour effet de dterminer un objet , il faut tre attentif au procd que Kant appelle prsentation
<Darstellung> et quil impute limagination. [] limagination est la facult de la prsentation <das
Vermgen der Darstellung> (CFJ, Pko 73.2.m5-4). En ce sens technique, prsenter consiste placer ct du
concept une ou plusieurs intuitions correspondantes; et comme les intuitions sont les reprsentations propres
limagination, cest par elle que lesprit peut penser des contenus sans les penser par des concepts; et cest ce
procd qui rend possible que la facult de juger rflchissante puisse juger par sentiment plutt que par concept.
Ainsi les tres qui sont censs correspondre des ides de la raison, lors mme quils ne peuvent tre reprsents par
des concepts peuvent ltre dans une prsentation (lIdal du beau, 17, en est un exemple) et des Ides esthtiques
peuvent prsenter <darstellen> un concept sans que ce dernier leur soit adquat, ou sans que ce dernier soit mme
dtermin. La prsentation est donc un processus ncessaire la production dun jugement esthtique et par
consquent limagination se trouve ncessairement implique dans la production dun tel jugement.
Cest dans la section 35 que Kant fait le plus explicitement la description des rles de limagination et de
lentendement dans le mcanisme de production du jugement esthtique.
Puisque les concepts constituent dans un jugement son contenu (ce qui appartient la connaissance
de lobjet), et que le jugement de got nest pas dterminable par des concepts, il se fondera donc
seulement sur la condition subjective formelle dun jugement en gnral. La condition subjective de
tous les jugements est la facult de juger elle-mme ou la facult judiciaire. Lusage de cette facult,
par rapport une reprsentation par laquelle un objet est donn, requiert laccord de deux facults
reprsentatives: celui de limagination (pour lintuition et la composition du divers) et de lentende-
ment (pour le concept comme reprsentation de lunit de cette composition). Or comme aucun
concept de lobjet ne se trouve ici au fondement du jugement, cet accord ne peut consister que dans /
la subsumption [sic] de limagination elle-mme (dans une reprsentation, par laquelle un objet est
donn) sous la condition selon laquelle lentendement passe en gnral de lintuition aux concepts.
Cest--dire comme la libert de limagination consiste prcisment en ceci quelle schmatise sans
concepts, il faut que le jugement de got repose sur une simple sensation de lanimation rciproque
de limagination dans sa libert et de lentendement dans sa lgalit, par consquent donc sur un
sentiment, qui permet de juger lobjet daprs la finalit de la reprsentation (par laquelle un objet
est donn) en ce qui concerne lincitation lactivit de la facult de connatre en son libre jeu. Le
got, en tant que facult de juger subjective, comprend un principe de la subsumption [sic], non pas
des intuitions sous des concepts, mais de la facult des intuitions ou prsentations (cest--dire de
limagination) sous la facult des concepts (cest--dire lentendement), pour autant que la premire
en sa libert saccorde avec la seconde en sa lgalit.
(CFJ, Pko 121.f.8-122.1.f)
Les mmes ides sont rappeles loccasion de la dfinition du gnie (49), le contexte tant celui de la production
dune oeuvre dart (par exemple un pome; Kant donne comme exemple un pome de Frdric le Grand). Les
principales interactions entre les facults sont:
204
un concept (dtermin) donn par lentendement limagination associe des Ides esthtiques, riches en
contenu mais peu labores, du point de vue conceptuel;
limagination (comme facult de connaissance productive) [tire ces Ides] de la matire <Stoffe> que la
nature relle lui donne (CFJ, Pko 144.2.1-3) et transforme librement cette matire selon des principes
qui nont pas tre ceux de lentendement et qui peuvent tre ceux de la raison, aboutissant ainsi, le cas
chant, des reprsentations de quelque chose qui se trouve au-del des limites de lexprience.
[] tandis que dans lusage de limagination en vue de la connaissance, limagination est
soumise la contrainte de lentendement et la limitation, qui consiste pour elle tre accorde
aux concepts de lentendement, en revanche dans une perspective <Absicht> esthtique elle est
libre []
(CFJ, Pko 146.3.3-7)
en introduisant dans la prsentation <Darstellung> dun concept des Ides esthtiques, limagination
largit le concept lui-mme esthtiquement dune manire illimite []
et elle met en mouvement la facult des Ides intellectuelles (la raison) (CFJ, Pko 144.4.4-7).
lentendement applique, unifie et exprime (pense, quoique toujours inadquatement) les Ides esthtiques
non dans le but daccrotre les connaissance mais dans le but danimer les facults de connatre (CFJ,
Pko 146.3.m9-8) et le libre accord de limagination avec la lgalit de lentendement (CFJ, Pko
147.2.m4) qui se ralise spontanment chez le gnie, en raison dun disposition de sa nature a pour
effet de rendre communicable autrui la disposition subjective de lme <subjektive Gemtsstimmung>
qui accompagne le concept.
Concernant le jugement esthtique:
jugement personnel <Privaturteil> (CFJ, Pko 164.3.5)
cest un jugement dont la reprsentation est rapporte uniquement au sujet suivant le processus qui
produit le plaisir :
Si le plaisir est li avec la simple apprhension (apprehensio) de la forme dun objet de
lintuition, non rattache un concept en vue dune connaissance dtermine, alors la
reprsentation se trouve par l rapports non lobjet, mais uniquement au sujet et le plaisir ne
peut rien exprimer dautre que la convenance <Angemessenheit> de cet objet aux facults de
connatre, qui sont mises en jeu dans la facult de juger rflchissante et dans la mesure o elles
sy trouvent, cest--dire simplement une finalit subjective formelle de lobjet. En effet, cette
apprhension de formes dans limagination ne peut jamais seffectuer, sans que la facult de
juger rflchissante, mme inintentionnellement, ne la compare, tout le moins, avec sa facult
de rapporter des intuitions des concepts. Si donc en cette comparaison limagination (comme
facult des intuitions a priori) se trouve mise en accord inintentionnellement grce une
reprsentation donne avec lentendement, comme facult des concepts, alors lobjet doit tre
regard comme final <zweckmig> pour la facult de juger rflchissante. Un tel jugement est
un jugement esthtique sur la finalit de lobjet [].
(CFJ, Pko 36.3.1-f; dans Introduction,
VII. De la reprsentation esthtique de la finalit de la nature.)
[] le jugement sappelle esthtique parce que son principe dterminant nest pas un concept,
mais le sentiment (du sens interne) de laccord dans le jeu des facults de lesprit, dans la
mesure o celui-ci ne peut qutre senti.
(CFJ, Pko 70.2.m16-13)
Kant conceptualise un passage de la satisfaction esthtique (plaisir propre au got) la satisfaction dordre
moral (plaisir propre au sentiment moral.
Nous possdons une facult de juger simplement esthtique pour juger sans concepts des
formes et trouver une satisfaction dans le simple jugement <Beurteilung> de celles-ci; nous faisons
de cette satisfaction une rgle pour chacun, sans que le jugement se fonde sur un intrt ou en
205
produise un. Dun autre ct nous possdons aussi une facult de juger intellectuelle, afin de
dterminer pour de simples formes de maximes pratiques (dans la mesure o elles se qualifient
delles-mmes comme lgislation universelle) une satisfaction a priori, dont nous faisons pour
chacun une loi, sans que notre jugement se fonde sur un quelconque intrt; mais alors il en produit
un. Dans le premier jugement le plaisir ou la peine sont propres au got et dans le second au
sentiment moral.
(CFJ, Pko 132.3.1-f)
Je crois que nous pouvons reprsenter cette ide sur la matrice des 6 facults, en laissant la zone consacre la
thorie du jugement moral empiter vers le haut sur les lignes de la matrice o jinscris les reprsentations et
processus propres la P, la facult du plaisir et de la peine. Tout comme le jugement tlologique contient (nous
lavons signal plus haut) des reprsentations qui affectent la facult P du plaisir et de la peine, il se trouve que le
jugement moral, cause du sentiment moral qui lui est associ, en contient aussi.
G R I L L E D E C O N T R L E
a le sentiment de lagrable est leffet sur P de la reprsentation de lobjet en tant quil fait plaisir <vergngt>
le sentiment du beau est leffet sur P de la reprsentation de lobjet en tant quil plat simplement <gefllt>
le sentiment du bon est leffet sur P de la reprsentation de lobjet en tant quil est estim <geschtzt,
gebilligt>
b Lobjet dans le jugement esthtique nest pas dtermin par un concept
c
d
e
LES CARACTRISTIQUES DU JUGEMENT MORAL
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
P R suscite dans le sentiment moral
un intrt immdiat [pour les
Ides] (132.4.2-3)
D dtermination de la volont,
comme cause libre (chose en soi)
par les concepts de la libert :
limpratif
production des actions morales
dtermination de la volont par des
concepts de la nature: production
des actions finalit technique
Tableau 11.23 Registre des processus, pour les facults impliques
dans la production des jugements moraux.
Le jugement moral [] par les concepts, sans aucune rflexion prcise, subtile et pralable, conduit
accorder un intrt gal immdiat (CFJ, Pko 133.2.11-16) au beau et au bien; lintrt au beau de la nature (Ibid.,
206
133.3.5-6) est un intrt libre, tandis que [lintrt au bien moral] est un intrt fond sur une loi objective (Ibid.,
133.2.m12-11).
G R I L L E D E C O N T R L E
a lobjet est laction et ltat de choses rsultant de laction
b lobjet est dtermin par la volont libre
c
d
e le principe du jugement est la loi morale
7.3.2.2. Les thories explicatives et leur articulation comme parties de la philosophie
pure
Les thories explicatives ou descriptives que lon peut faire correspondre diverses cases ou rgions du
registre des processus peuvent tre numres sur un tableau dont la structure de base est celle de la matrice des six
facults. un niveau de rsolution relativement bas, un tel tableau ne montre que les correspondances gnrales que
laissent apercevoir dj les tables des matires des trois Critiques. (Voir le tableau 11.24.)
C r i t i q u e de l a r a i s o n pu r e C r i t i q u e de l a
r a i s o n pr a t i q u e
C r i t i q u e de l a
f a c u l t de j u g e r
I. Crit. de la f.j.
esthtique
II. Crit. de la f.j.
tlologique
Thorie des lments
Esthtique transcendantale
Logique transcendantale
Analytique transcendantale
Analytique des concepts
Analytique des principes
Dialectique transcendantale
Des concepts de la raison pure
Des raisonnements dialectiques
Mthodologie transcendantale
Analytique de la raison
pratique
Des principes
Du concept
Des mobiles
Dialectique de la raison
pure pratique
Analytique de la f.j.
esthtique
Analytique du Beau
Analytique du Sublime
La Dialectique de la f.j.
esthtique
lantinomie du got
Mthodologie du got
Analytique de la f.j.
tlologique
Dialectique de la f.j.
tlologique
lantinomie de la f.j.]
Mthodologie de la f.j.
tlologique
Tableau 11.24 La systmaticit de la division en Analytique, Dialectique et Mthodologie,
dans les trois Critiques.
Mais un niveau de rsolution plus lev, l o il devient possible de faire des divisons et articulations plus
fines entre les thories, le tableau de la nomenclature des thories permet dvoquer, tout en les ordonnant, les
solutions que Kant fournit et les positions quil prend dans larne intellectuelle (les ismes). Voir le tableau 11.25.
207
Entendement (E) Facult de juger (J) Raison (R)
C Analytique des concepts (CRPu)
Thorie de lunit originairement
synthtique de laperception.
Analytique des principes (CRPu)
Le schmatisme.
Thorie de la rflexion
transcendantale
Analytique transcendantale
(une dsignation plus spcifique serait
Analytique de la facult de juger dterminante)
Idalisme transcendantal thorie de lidalit des objets des sens
(173.3.1)
Dialectique transcendantale (une
dsignation plus spcifique serait
Dialectique de la facult de juger
dterminante; ou Dialectique de
la raison thorique
1
)
Thorie transcendantale du jugement thorique. Thorie transcendantale du
jugement dialectique.
La tlologie, comme science, nappartient aucune doctrine, mais seulement la critique (230.2.1-2; 79).
Lidologie de la recherche
Analytique de la facult de juger tlologique
thorie du jugement tlologique
Dialectique de la facult de juger
tlologique
P
Thorie (de la perception) du beau Thorie du sens commun
Analytique de la facult de juger esthtique
Idalisme de la finalit subjective
thorie du jugement tlologique
Dialectique de la facult de juger
esthtique
D Thorie du jugement pratique
Analytique de la raison pure pratique Dialectique de la raison pure
pratique
La mtaphysique des moeurs
Tableau 11.25 Les thories qui composent les Critiques.
1
Note 1. Cette appellation serait cependant peut-tre trop peu discriminante si on voulait quelle dsignt seulement
la dialectique transcendantale contenue dans CRPu, car il semble bien que le terme raison thorique doive
comprendre aussi la raison qui construit les raisonnements dialectiques de la tlologie et de lesthtique, si tant est
que ces deux thories appartiennent la philosophie thorique. (Fin de la Note 1.)
Si lon veut tenir compte des diffrences fines que le criticisme tablit entre les concepts de la nature qui
sont construits par la raison pour penser lobjet de ses connaissances pures, on peut suivre le fil directeur qui nous
est dj fourni dans lArchitectonique de la raison. La raison, dans ltude rationnelle de la nature,
a un usage physique, ou immanent : alors la nature est tudie en tant que la connaissance en peut tre
applique dans lexprience (in concreto); la mtaphysique de la nature est alors physiologie rationnelle
immanente et considre la nature comme lensemble de tous les objets des sens, par consquent telle
quelle nous est donne, mais seulement suivant les conditions a priori sous lesquelles elle peut nous tre
donne en gnral. (CRPu, Bar 629.2). Les deux parties de cette physiologie immanente sont 1 la
208
physique rationnelle (elle tudie lensemble des objets des sens extrieurs, cest--dire la nature
corporelle); et 2 la psychologie rationnelle (elle tudie lobjet du sens intime, lme, et, suivant les
concepts fondamentaux de lme en gnral, la nature pensante CRPu, Bar 629.2.m8-6).
a un usage hyperphysique, ou transcendant : alors la nature est tudie du point de vue de la liaison des
objets de lexprience qui dpasse toute exprience; la mtaphysique de la nature est alors physiologie
rationnelle transcendante et se divise en 1 cosmologie transcendantale (elle tudie la liaison interne
des objets de lexprience mais au-del des limites de lexprience, donc le monde, considr comme
lunit inconditionne de la srie des conditions du phnomne) et 2 thologie transcendantale (elle
tudie la nature du point de vue de sa liaison externe un tre lev au-dessus de la nature).
La Critique fixe des objets, des principes et des limites pour chacune de ces parties de la mtaphysique
traditionnelle de la nature
pour la physique rationnelle dans lAnalytique transcendantale et la Dialectique transcendantale de
CRPu;
pour la psychologie rationnelle dans la Dialectique transcendantale de CRPu, l o sont rsolus les
paralogismes de la raison pure;
pour la cosmologie transcendantale, dans lAntinomie de la raison pure (CRPu, Dialectique transcendan-
tale) et dans la Dialectique de la facult de juger tlologique (CFJ);
pour la thologie transcendantale, dans lIdal de la raison pure (CRPu, Dialectique transcendantale),
dans la Dialectique de la facult de juger tlologique (CFJ) et, pour partie, dans la section
VI. Lexistence de Dieu comme postulat de la raison pure pratique. de la Dialectique de la raison pure
pratique (CRPa).
Quant la mtaphysique qui devrait correspondre la Critique de la raison pratique et en constituer le
prolongement doctrinal, Kant y rfre sous le nom de mtaphysique des moeurs. Cette discipline comprend
comme parties principales une thorie du droit et une thorie de la vertu, auxquelles Kant apportera dimportants
dveloppements.
LEXPLICATION DE LUNIVERSALIT DU JUGEMENT DE GOT.
Le passage suivant non seulement expose largumentation qui aboutit la thse de luniversalit du jugement
de got mais constitue aussi une sorte de rsum de lAnalytique du Beau, dans la mesure o il contient presque
tous les concepts qui ont t mis en oeuvre pour dcrire le rle des facults dans la production du jugement
esthtique.
Le plaisir pris la beaut [] nest ni un plaisir de jouissance, ni celui dune activit
conforme une loi, ni celui de la contemplation qui mdite daprs des Ides, mais cest le plaisir de
la simple rflexion. Sans avoir pour guide quelque fin ou quelque principe ce plaisir accompagne
lapprhension commune dun objet par limagination, comme facult de lintuition, en relation
lentendement, comme facult des concepts, par la mdiation dun procd <Verfahren> de la
facult de juger que celle-ci doit galement mettre en oeuvre au profit de lexprience la plus
vulgaire; la seule diffrence est quici il ne sagit que dun concept empirique objectif, tandis que l
(dans le jugement esthtique} il sagit pour elle de percevoir la convenance de la reprsentation
lopration harmonieuse (subjectivement finale) de deux facults de connatre en leur libert, cest-
-dire de sentir avec plaisir ltat reprsentatif. Ce plaisir doit ncessairement en chacun reposer sur
les mmes conditions, parce quelles sont les conditions subjectives de la possibilit dune
connaissance en gnral, et la proportion de ces facults de connatre, qui est exige pour le got,
lest aussi pour lentendement commun et sain, que lon doit prsumer en chacun. Cest pourquoi
celui qui juge avec got (suppos seulement quintrieurement il ne se trompe pas et ne prenne pas
la matire pour la forme et lattrait pour la beaut) peut attribuer la finalit subjective, cest--dire sa
satisfaction procdant de lobjet tout autre homme et admettre que son sentiment est
communicable universellement et cela sans la mdiation des concepts.
(CFJ, Pko 126.3.1-f; la fin de 39. De la communicabilit dune sensation.)
209
7.4 La question de lunit de la Critique de la facult de juger
Les objectifs densemble de la Critique de la facult de juger sont relativement clairs. CFJ vient rpondre
deux besoins ressentis par Kant.
Premirement, le besoin de faire droit un type de reprsentation qui se rapporte lobjet mais qui
chappe la lgislation du concept dans la mesure o ce quil procure est du plaisir (de la peine) plutt
que de la connaissance: ce besoin invite thoriser une sorte dcart significatif entre cette connaissance
par sentiment et la connaissance par concepts. (Il faut prendre garde cependant de ne pas interprter trop
rapidement le terme sentiment que je viens dutiliser, selon ses acceptions contemporaines.)
Deuximement, le besoin de faire droit une Ide de la raison (la finalit de la nature) qui peut possder
un usage non dialectique (elle doit donc tre blanchie du stigmate dvalorisant qui marque les principes
subjectifs prenant des airs de principes objectifs) et qui respecte mal (ou du moins malaisment) la
distinction entre usage pratique et usage spculatif de la raison, en ce sens quelle sert de principe
pratique (injonction) lgard de lentendement (et non de la volont) en son usage thorique et quelle
est applicable la conduite de la recherche scientifique. Aussi Kant va-t-il prfrer parler du concept de
finalit que de lide de finalit, dans lIntroduction, faisant ainsi passer en arrire-plan les
connotations relativement pjoratives associes lexpression ides transcendantales.
Devant ces objectifs la question sest pose de savoir sils sont suffisamment articuls pour donner une unit
la Critique de la facult de juger. Cet ouvrage nest-il pas en fait compos de deux parties qui auraient aussi bien
pu tre publies sparment et qui nont t lies lune lautre que par un fil conducteur relativement superficiel:
lide de finalit de la nature, subdivise pour les besoins de la cause en finalit subjective et finalit objective.
Plusieurs commentateurs de Kant ont pris position sur cette question et Philonenko rappelle quelques-unes dentre
elle dans son Introduction la traduction franaise quil donne de CFJ.
La position de Philonenko sur ce point vaut quon la prsente, au mme titre que sa traduction, tant donn
que les prsentes notes introduisent la lecture de cet ouvrage.
Philonenko propose deux faons dapercevoir lunit de la CFJ, partir de lidentification de sa question
capitale (CFJ, Pko 10.2.3):
selon un premire interprtation, qui assure en quelque sorte un lien horizontal entre les trois Critiques
(12.f.2-3), CFJ est une tentative pour rsoudre le problme capital de la philosophie moderne:
lintersubjectivit. (CFJ, Pko 10.2.3f).
selon une deuxime interprtation, on aperoit un autre lien que lon pourrait cette fois nommer
vertical (12.f.2f), car il tablit des rapports hirarchiques (en un sens prciser) entre les thmes de la
rflexion kantienne, considrs comme objets-problmes. Selon cette approche, la Critique de la facult
de juger tlologique traite le problme de lorganisation de la nature (microcosme et macrocosme) et
traite ainsi la problmatique du systme (par opposition celle de la synthse, qui caractrise plutt
CRPu). En deuxime lieu, la Critique de la facult de juger esthtique traite le problme de la vie ou
plus justement encore le problme de lindividualit (CFJ, Pko 14.2.2-3 accentuation en gras due
NL), lequel devient, sous lun de ses aspects, le problme de lintersubjectivit et de la communication
(14.2.m6-5), le problme de la synthse des individualits dans un sens universel (14.2.2f).
Concernant la premire interprtation. Le jugement de got a pour condition le sens commun; ce dernier
est la condition ncessaire de la communicabilit universelle de notre connaissance, qui doit tre prsume en toute
logique et en tout principe de connaissance qui nest pas sceptique. (Kant, CFJ, Pko 79.1.4f) De cette ide,
Philonenko tire le sens de CFJ par rapport aux deux autres Critiques:
210
On voit ds lors apparatre le sens de la Critique de la facult de juger et sa relation aux deux autres
Critiques. La Critique de la facult de juger fonde et achve la Critique de la raison pure et la
Critique de la raison pratique en dveloppant lexprience originelle prsuppose en toutes deux
comme rflexions sur la pense humaine. De l sa haute porte / systmatique dans lensemble de la
critique. La Critique de la facult de juger remplit cette tche systmatique en se constituant comme
une logique de lintersubjectivit, cest--dire comme une logique de la signification.
(Philonenko, CFJ, Pko 11.4.1-12.1.4)
Cette logique du sens fournit alors la cl de lunit de CFJ, pourvu quon interprte la thorie de la facult du got
comme une rflexion sur lexprience de la communication et la thorie de la facult de juger en son usage
tlologique comme une rflexion sur la rencontre significative de lhomme et du monde (Ibid., 12.1); dans cette
dernire interprtation, la notion de sens est rcuprable dans la mesure o lon considre que lattribution dune
finalit la nature est bel et bien une stratgie qui rend cette nature significative pour nous, et que cest l son enjeu
principal.
8. Le criticisme interprt selon la perspective des abmes de lesprit
LA QUESTION DE LUNIT DES TROIS CRITIQUES
Selon Philonenko, il ny a pas dunit systmatique vritable entre les trois critiques: La Critique de la
facult de juger, en particulier, ne parat pas avoir t prvue ds le point de dpart dans le plan densemble de la
philosophie transcendantale. (Phi, OK I 12) Cet auteur jugera aussi quil ny a pas dintuition fondamentale
unificatrice du kantisme, considr comme lensemble de la production philosophique de Kant:
Lide bergsonienne dune intuition fondamentale soutenant la totalit de la doctrine ne sapplique
pas la philosophie kantienne. Il nexiste vritablement pas de fil dor qui permette denchaner
dans une seule vision toute la pense kantienne.
(Phi, OK I 13)
Caygill, dans Kant and the Age of criticism, accentue cette ide et appelle de ses voeux une biographie de
Kant qui ne soit pas un more or less sophisticated teleological narrative of his development (Cay, KD, p. 8): To
use Kants own distinction, his thought would then be read less as a definitive body of philosophy than as an open-
ended process of philosophizing, one in which the philosophical tradition was re-invented in the face of changes in
the structures of University, Church and State, as well as in the publishing industry and the reading public. (Ibid.,
p. 8) la toute fin de cet essai, Caygill reprend lide de non-achvement en disant que la manire kantienne de
philosopher est caractrise par de studied equivocations et par une sensitivity to aporia, caractres quil oppose
ironiquement aux efforts que firent les post-kantiens de realize philosophy, whether through the nation, the
proletariat or the overman et au fait quils ont ainsi transformed Kants philosophizing into philosophy (Ibid.,
p. 8).
Cependant, il est possible en un autre sens, de concevoir des articulations qui forment systme entre les objets
de recherche des trois Critiques, cest--dire leurs problmatiques. Une mise en place relativement systmatique est
donne par Philonenko dans sa Prface CFJ. Elle se fonde sur la notion dabme et sur la supposition que les
grands problmes qui proccupaient Kant taient, pour lui, mis en perspective dans une doctrine des abmes de
lesprit:
Nous trouvons souvent sous la plume de Kant le mot : abme. Bien quil ne lait point systmatise
nous pouvons dcouvrir chez lui une vritable doctrine des abmes de lesprit. Deux grandes bornes
marquent le chemin de lesprit travers les abmes. Au point de dpart de ce chemin se prsente
lesprit humain pntr de la puissance de ses jugements mathmatiques. [] lhomme qui calcule,
construit son objet et en ce sens lhomme mathmaticien est comparable un entendement
archtype. Cet entendement archtype est le terme du chemin. Cest lide dun entendement pour
lequel le possible et le rel, la pense et lintuition seraient une seule et mme chose
2
[2. Critique de
la facult de juger, 76-77.]; entendement non plus seulement constructeur donc, mais aussi
211
crateur. Entre ces deux entendements, en lhomme et Dieu, se prsente une srie de problmes, qui
sont autant dabmes de lesprit. Ces abmes sont ceux de lexistence objective, de lorganisation, de
lindividualit, de la personnalit.
(CFJ, Pko 13.1)
Les liens que lhypothse cite permet Philonenko dtablir sont rsums dans le tableau que jintitule LES
PROBLMATIQUES RESPECTIVES DES QUATRE CRITIQUES EN TERMES DABMES DE LESPRIT.
LES PROBLMATIQUES RESPECTIVES DES QUATRE CRITIQUES EN TERMES DABMES DE LESPRIT
Abme
Thme-problme;
problmatique
Formulations des problmes;
commentaires
Ouvrage qui
traite
le problme
LEXISTENCE OBJECTIVE
Problmatique de la synthse
Comment puis-je connatre un objet que je ne pose pas?
[] ce qui, par son existence mme, ne dpend pas de moi?
[] comment puis-je tre conscience dunivers et non pas
seulement conscience de soi?
CRPu
LORGANISATION
Problmatique du systme
La nature comme systme des
fins (CFJ, 67)
Quest-ce qui rend possible que les phnomnes, malgr leur
extrme diversit, puissent tre compars rationnellement et
relis de manire former un systme?
Ltre organis est caractris par la finalit interne; il
appartient un ordre de choses que les principes de
lentendement physicien ne permettent pas de pntrer
(14.1.3-5)
CFJ tlologique
LINDIVIDUALIT (en tant que
ralise dans lhomme)
Partic.: pb de lintersubjectivit
et de la communication.
[] comment des individualits [humaines] peuvent se
relier (14.2.m12-11). Lindividualit est considre comme
ce que lhomme possde de spcifique, eu gard aux
systmes organiss.
CFJ esthtique
LA PERSONNALIT Quelle est la destination de lhomme? CRPa
Tableau 11.26 La reconstitution du criticisme en termes dabmes de lesprit,
selon le Professeur Philonenko.
L o elle est, sur le chemin de lesprit travers les abmes, la CFJ relie nature et libert, philosophie
thorique et philosophie pratique, en indiquant le sens de lindividualit humaine dans la rflexion sur la
communication et en permettant de comprendre lorganisation en laquelle elle se dvoile. CFJ, Pko 15.1.8-11)
212
213
B i b l i o g r a p h i e
________________________________________________________
DITION ALLEMANDE DE RFRENCE
Kant, Immanuel, 1981. Werke in zehn Bnden, dit par Wilhelm Weischedel, dition
spciale de 1981, sur la base de la quatrime rimpression photoreproduite rvise de ldition
de Darmstadt de 1956. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
________________________________________________________
OUVRAGES DE KANT POUR LESQUELS NOUS AVONS INTRODUIT UN SYMBOLE DE RFRENCE
AP, Fou KANT, Emmanuel. Anthropologie du point de vue pragmatique. Traduction de Michel
Foucault. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1964.
ApH, Wei KANT, Immanuel. Anthropologie in pragmatischer Hinsicht. P. 395-690 du tome 10 de:
Kant, Immanuel, 1981.
CFJ, Pko KANT, Emmanuel. Critique de la facult de juger. Traduction de A. Philonenko. Paris:
Librairie philosophique J. Vrin, 1968.
CRPa, Pic KANT, Emmanuel. Critique de la raison pratique. Traduction de Franois Picavet.
Collection Bibliothque de philosophie contemporaine. Paris: Presses universitaires de
France, 1960.
CRPu, Bar KANT, Emmanuel. Critique de la raison pure. Traduction de Jules Barni, revue par P.
Archambault. Chronologie, prsentation et bibliographie de Bernard Rousset. Paris: Garnier-
Flammarion, 1976. Une nouvelle dition, en 1987, remplace la Prsentation de B. Rousset
par une Prface de Luc Ferry.
CRPu, TrPa KANT, Emmanuel. Critique de la raison pure. Traduction de A. Tremesaygyes et B. Pacaud.
Prface de Charles Serrus. Collection Bibliothque de philosophie contemporaine. Paris:
Presses universitaires de France, 1950, XXXII + 586 p.
CFJ, Mer KANT, Immanuel. Critique of Judgment. Traduit par James Creed Meredith. Oxford: Oxford
University Press, 1973. [Cest cette dition que cite Howard Caygill, dans Cay, KD.]
CRPa, Bec KANT, Immanuel. Critique of Practical Reason. Traduit par Lewis White Beck.
Indianapolis: Bobbs-Merrill, 1976. [Cest cette dition que cite Howard Caygill, dans Cay,
KD.]
CRPu, Smi KANT, Immanuel. Critique of Pure Reason. Traduit par Norman Kemp Smith. Londres:
Macmillan, 1978. [Cest cette dition que cite Howard Caygill, dans Cay, KD.]
D70, Mo KANT, Emmanuel. La Dissertation de 1770. Traduction avec une introduction et des notes
par Paul Mouy. Collection Bibliothque des textes philosophiques. Paris: Librairie philo-
sophique J. Vrin, 2
e
d.: 1951. [Il existe sans doute des ditions plus rcentes.]
214
KpV, Wei KANT, Immanuel. Kritik der praktischen Vernunft. P. 107-302 du tome 6 de: Kant,
Immanuel, 1981.
KrV, Wei KANT, Immanuel. Kritik der reinen Vernunft. Tome 3 (p. 1-307 + 5 p. non numrotes) et
tome 4, (5 p. non numrotes + p. 308-717 + 3 p. non numrotes) de: Kant, Immanuel, 1981.
KUk, Wei KANT, Immanuel. Kritik der Urteilskraft. P. 171-620 du tome 8 de: Kant, Immanuel, 1981.
________________________________________________________
OUVRAGES DE COMMENTATEURS POUR LESQUELS JAI INTRODUIT UN SYMBOLE DE RFRENCE
BAy, FK BOULAD-AYOUB, Josiane. Fiches pour ltude de Kant. Troisime dition, revue et mise
jour. Collection Symbolique et Idologie, no S18, de la srie Recherches et Thories.
Montral: Dpartement de philosophie de lUniversit du Qubec Montral, 1990. 144 p.
Cay, KD CAYGILL, Howard. A Kant Dictionary. Collection The Blackwell Philosopher
Dictionaries. Oxford et Cambridge: Blackwell Publishers, 1995. x + 454 p.
Del, PCK DELEUZE, Gilles. La Philosophie critique de Kant. Collection SUP Initiation
philosophique, no 59. Paris: Presses universitaires de France, 1971, 107 p.
Fy, Prf FERRY, Luc. Prface. Texte qui prsente ldition de 1987 de: KANT, Emmanuel.
Critique de la raison pure. Collection GF, no 257. Paris: Garnier-Flammarion. P. I-XXIII,
insres aprs la p. 8.
Phi, OK I PHILONENKO, Alexis. La Philosophie pr-critique et la Critique de la raison pure. Tome I
de: LOeuvre de Kant: La philosophie critique. Cinquime dition. Collection la recherche
de la vrit. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1993. (Premire dition: 1969.) 358 p.
Phi, OK II PHILONENKO, Alexis. Morale et politique. Tome II de: LOeuvre de Kant: La philosophie
critique. Cinquime dition. Collection la recherche de la vrit. Paris: Librairie
philosophique J. Vrin, 1972. 292 p.
Riv, HP-V1 RIVAUD, Albert. De lAufkla^rung Schelling. Premire partie de La philosophie allemande
de 1700 1850. Tome V de: Histoire de la philosophie. Collection Logos. Paris: Presses
universitaires de France, 1967, d. 1968.
Ver, VK-I VERNEAUX, Roger. Doctrines et mthodes. Tome I de: Le Vocabulaire de Kant. Collection
Philosophie de lesprit. Paris: Aubier-Montaigne, 1967.
Ver, VK-II VERNEAUX, Roger. Les pouvoirs de lesprit. Tome II de: Le Vocabulaire de Kant.
Collection Philosophie de lesprit. Paris: Aubier-Montaigne, 1973.
__________________________________________________________________
BIBLIOGRAPHIE COMPLMENTAIRE (PEU OU PAS UTILISE DANS LES NOTES DE COURS)
ARENDT, Hannah. Juger: Sur la philosophie politique de Kant. Collection Politique. Paris: Seuil, 1991. 245 p.
ISBN 2 02 012399 1.
ASCHENBRENNER, Karl. A Companion to Kants Critique of Pure Reason: Transcendental Aesthetic and
Analytic. Lanham (Mar.): University Press of America, 1983. xvi 318 p.
[UQAM, Centrale: B2779A83.]
215
BARRET-KRIEGEL, Blandine (sous la dir. de). Philosophie politique: Kant. Paris: Presses universitaires de
France, 1992. 240 p. [Voir le contenu du recueil, dans les Notes bibliographiques.) ISBN:
2 13 043955 1.
BECK, Lewis White (dir. publ.). The Philosophy of Immanuel Kant. New York: Garland.
[Eleven of the most important books on Kants philosophy, reprinted in 14 volumes. (De
George, The Philosophers Guide, p. 60) ]
BOUTROUX, mile. La Philosophie de Kant (1896-1897). Paris: Vrin, 1926, 438 p.
CAYGILL, Howard. Kant and the Age of Criticism. In CAYGILL, H. A Kant Dictionary, p. 7-29.
CLAVEL, Maurice. Critique de Kant. Paris: Beauchesne, 1983.
COPLESTON, Frederick. The French Enlightenment to Kant. Partie I de: Modern Philosophy. Vol. 6 de: A History
of Philosophy. Garden City (New York): Image Books (a division of Doubleday & Co.), 1964
(1960). 280 p.
DELBOS, Victor. La Philosophie pratique de Kant. Paris: Alcan, 1905.
GOLDMANN, Lucien. Introduction la philosophie de Kant. Collection Ides, n
o
146. Paris: Gallimard, 1967,
318 p. [dition originale: Paris: Presses universitaires de France, 1948.]
GRONDIN, Jean. Kant.zur Einfhrung. Coll. Die Deutsche Bibliothek CIP-Einheitsaufnahme. Hambourg:
Junius Verlag, 1994, 168 p.
HEIDEGGER, Martin. Kant et le problme de la mtaphysique. Traduit par Waelhens-Biemel. Paris: Gallimard,
1953, 308 p.
HFFE, Ottfried. Immanuel Kant . Traduit de lallemand en anglais par Marshall Farrier. Collection SUNY series
in Ethical Theory. New York: State University of New York Press. 290 p. ISBN
0 7914 2094 9.
[Hffe gives a clear, understandable description of Kants phiosophical development and
influence, and he sets forth Kants main ideas from the Critique of Pure Reason and the ethics
to the philosophy of law, history, religion, and art. In his critical treatment, Hffe shows why
Kants philosophy continues to be relevant and challenging to us today. Thomas Pogge.]
KRNER, Stephen. Kant. Coll. Pelican Original. Harmondsworth (England): Penguin Books, 1972, 232 p.
[1955.]
LACHIZE-REY, Pierre. LIdalisme kantien. Paris: Vrin, 1950, 509 p.
LONGUENESSE, Batrice. Kant et le pouvoir de juger: Sensibilit et discursivit dans lAnalytique
transcendantale et la Critique de la raison pure. Collection pimthe Essais
philosophiques. Paris: Presses universitaires de France, 1993. xxv + 482 p.
MARTY, Franois. La Naissance de la mtaphysique chez Kant. Paris: Beauchesne, 1980, 592 p.
NAGEL, Gordon. The Structure of Experience: Kants System of Principles. Chicago: University of Chicago Press,
1983. vii + 283 p.
[UQAM: Centrale: B2779N3.]
216
PASCAL, Georges. La Pense de Kant. Paris: Bordas, 1966, 198 p.
ROUSSET, Bernard. Prsentation. Texte qui prsente ldition de 1976 de: KANT, Emmanuel. Critique de la
raison pure. Collection GF, no 257. Paris: Garnier-Flammarion. P. 9-21.
ROVIELLO, Anne-Marie. LInstitution kantienne de la libert. Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1985.
SERRUS, Charles. LEsthtique transcendantale et la science moderne. Paris: Alcan, 1930, 196 p.
SPECK, J. (dir. publ.). Handbuch wissenschaftstheoretischer Begriffe. En trois volumes. Collection Uni-
Taschenbcher, no 968. Gttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1980. 782 p.
SCRUTON, Roger. Kant I: The Critique of Pure Reason, chap. 10, p. 137-148 de: Kant and Idealism,
troisime partie, p. 135-194 de: SCRUTON, Roger, From Descartes to Wittgenstein.
. Kant II: Ethics and Aesthetics, chap. 11, p. 149-164 de: Kant and Idealism, troisime
partie, p. 135-194 de: SCRUTON, Roger, From Descartes to Wittgenstein.
. From Descartes to Wittgenstein: A Short History of Modern Philosophy. Londres, Boston et
Henley: Routledge & Kegan Paul, 1981. vi + 298 p.
SWING, Kaecho T. Kants Transcendental Logic. New Haven: Yale University Press, 1969, 388 p.
UNIVERSIT DOTTAWA. Les Actes du Congrs dOttawa sur Kant. Ottawa: ditions de lUniversit dOttawa,
1976, 541 p.
VUILLEMIN, Jules. Physique et mtaphysique kantiennes. Paris: Presses universitaires de France, 1955.
WEIL, ric. Problmes kantiens. Paris: Vrin, 1963, 198 p.
WIKE, Victoria. Kants Antinomies of Reason: Their Origin and Their Resolution. Washington: Washington
University Press of America, 1982.
[Sommaire: This work analyzes Kants antinomies of reason. It considers four points. First,
it shows that there is no univocal definition of kantian antinomy. Second, the theoretical and
practical antinomies are found to arise from an ambiguity common to their highest objects.
Third, the theoretical and practical antinomies are shown to be resolved in different ways in
spite of their common origins. Finally, the practical antinomy is shown to depend on the
theoretical antinomies.]
217
A p p e n d i c e s
Appendice 1.
Ce que veut dire tre transcendantal
1. Le terme transcendantal qualifie dabord des actions ou des processus.
1.1 Des actions attribuables au thoricien de la connaissance et, plus gnralement, le point de vue duquel il
se place pour thoriser.
1.1.1 En gnral: le point de vue, lapproche
a le point de vue transcendantal est caractris par un mode dargumentation qui utilise le schma
dinfrence suivant:
Le jugement (synthtique) assert est vrai, car sil ne ltait pas, alors lexprience ne serait pas du
tout possible. Ce schma dinfrence repose donc sur le fait que lexprience est possible en
gnral, mais il nutilise pas de faits dexprience particuliers. (Drieschner, M., article
transzendental/Transzendentalphilosophie, p-. 653-655 de: Speck, J. (dir. publ.), Handbuch
wissenschaftstheoretischer Begriffe, p. 653.)
b la mthode
Ce que signifie mthode transcendantale. Voir Phi, OK I 119.2-122.1.
Il existe une difficult intellectuelle immdiate dont Kant se rendait bien compte, et qui mne une
explication du mot transcendantal (terme technique qui a aussi peu voir avec la mditation
transcendantale quavec les tudes transcendantales de Liszt). Prenons la question Comment la
logique est-elle possible?. Quel argument pourrait nous permettre dexpliquer les principes de la
logique sans les prsupposer dj lui-mme? Semblablement, si les principes synthtiques a priori
de lentendement sont aussi fondamentaux pour la pense que laffirmait Kant, la tentative mme
dtablir leur validit doit en mme temps la postuler. Cest la raison pour laquelle Kant qualifia sa
mthode philosophique de transcendantale, puisquelle comprenait un effort de transcender par
une argumentation ce que largumentation devait prsupposer. (Roger Scruton, From Descartes to
Wittgenstein, p. 140)
1.1.2 Actions et procds spcifiques du thoricien
a la problmatique transcendantale
b lexposition transcendantale (des concepts despace et de temps)
c la dduction transcendantale (des concepts purs de lentendement)
1.2 Des actions ou processus attribuables ltre humain pris comme sujet de la connaissance, ou lune de
ses facults
1.2.1 Actions attribues au sujet
a lusage transcendantal de lentendement, (dune facult autre?)
Lopposition entre usage transcendantal et usage empirique est donne et utilise par Kant ds
CRPu, Bar 113.1.7f (Introduction la logique transcendantale, II. De la logique transcen-
dantale): Lapplication <Gebrauch> de lespace des objets en gnral serait transcendantale;
mais borne simplement aux objets des sens, elle est empirique. La diffrence du transcendantal et
de lempirique nappartient donc qu la critique des connaissances et ne concerne point le rapport
de ces connaissances leur objet.
218
usage transcendantal de notre connaissance (CRPu, Bar 328.2.10-11); soppose usage
logique [de notre connaissance].
usage transcendantal [de la raison] (CRPu, Bar 326.2.4)
b lusage transcendantal dun principe, dun concept
c laperception transcendantale
1.2.2 Actions attribues aux facults
a la synthse transcendantale de lapprhension
b la synthse transcendantale de limagination
c la synthse du concept et de lexprience
Kant called this synthesis [of concept and experience] transcendental, meaning that it could never
be observed as a process, but must always be supposed as a result. (Roger Scruton, 1981, p. 141.1)
2. Le terme transcendantal qualifie, en deuxime lieu, des produits dactions ou de processus
2.1 Des termes mtadiscursifs
2.1.1 Des connaissances
Jappelle transcendantale toute connaissance qui ne porte point en gnral sur les objets, mais sur
notre manire de les connatre, en tant que cela est possible a priori []. Un systme de concepts
de ce genre serait une philosophie transcendantale. (CRPu, Bar 73.1.8-12. Section VII de
lIntroduction.)
connaissance transcendantale (CRPu, Bar 279.2.12; dans lAnalytique des principes, Chap. III -
Du principe de la distinction de tous les objets en gnral en phnomnes et noumnes) a le sens
de connaissance des noumnes.
2.1.2 Des thories
lesthtique, lanalytique et la dialectique transcendantales
lidalisme transcendantal
2.1.3 Des disciplines
la logique transcendantale
la philosophie transcendantale
2.2 Des termes discursifs
2.2.1 Les produits de la recherche transcendantale ou les lments (produits?) des pouvoirs de notre me
qui ont une fonction de condition de possibilit
les concepts purs de lentendement: voir si une catgorie peut tre qualifie de transcendantale ou si
cest seulement lune ou lautre proprit de catgorie qui est ainsi qualifie: tre une rgle
transcendantale, tre une condition transcendantale dunit, etc.
concepts transcendantaux de la raison (CRPu, Bar 325.2.1)
concept rationnel transcendantal (CRPu, Bar 324.3.1)
les principes transcendantaux, ceux de lentendement, ceux de la raison, celui ou ceux de la facult
de juger
Le principe de la finalit formelle de la nature est un principe transcendantal de la facult de
juger (titre V de lIntroduction la Critique de la facult de juger, (CFJ, Pko 29)
jugements transcendantaux (CRPu, Bar 323.1.10)
les concepts purs de la raison: ides transcendantales
lois transcendantales (CRPu, Bar 117.1.m3-2; fin de lintroduction la logique transcendantale)
2.2.2 Les tats des reprsentations ou du matriau de la connaissance dans le processus ou dans le sujet
lunit transcendantale de la conscience de soi (CRPu, Bar 154.2)
2.2.3 Certains objets
lobjet transcendantal = X
219
Lentendement limite donc la sensibilit, sans tendre pour cela son propre domaine, et, en
lavertissant de ne pas prtendre sappliquer des choses en soi, mais de se borner aux
phnomnes, il conoit pour lui un objet en soi, mais simplement comme un objet
transcendantal qui est la cause du phnomne (qui nest pas par suite lui-mme un phnomne),
mais qui ne peut tre conu, ni comme quantit, ni comme ralit, ni comme substance, etc.,
(parce que ces concepts exigent toujours des formes sensibles o ils dterminent un objet), et de
qui nous ignorons absolument par suite sil se trouve en nous ou hors de nous, sil disparat en
mme temps que la sensibilit, ou si, celle-ci carte, il subsiste encore. (CRPu, Bar 297.2.1-
13; dans lappendice De lamphibolie)
2.2.4 Des proprits dobjets
la finalit transcendantale (CFJ, Pko 32.2.m4), la dfinition de cette expression tant donne entre
parenthses dans le texte: en relation la facult de connatre du sujet
3. Le terme transcendantal qualifie en troisime lieu, mais plus rarement
3.1 Une facult
a limagination transcendantale (cf. la dduction transcendantale des catgories)
bla facult de juger transcendantale (CFJ, Pko 30.4.m4-3)
Citations organises selon la numrotation de la classification prcdente
1.
1.1
1.2
1.3
2.
3.
Les oppositions conceptuelles dans lesquelles figure le terme transcendantal
Op1. Transcendantal / empirique
lopposition usage transcendantal / usage empirique dun concept.
Exemple: CRPu, Bar 113.1.7f.
Se rappeler, par exemple, dune autre opposition o figure le terme empirique, et qui est
beaucoup plus frquente: Mais jentends ici par raison toute la facult de connatre suprieure, et
joppose par consquent le rationnel lempirique. (CRPu, Bar 623.1..3f; dans lArchitectonique
de la raison pure avant mme la dfinition de la philosophie comme lun des deux types de
connaissance rationnelle, le type o celle-ci a lieu par concepts.)
Dans cette opposition, le terme transcendantal a une connotation pjorative; mais le sme pjoratif ne vient
pas contredire les smes que le terme, dans ce contexte, possde en commun avec lacception originale (p. ex. dans
esthtique transcendantale). Le sme commun est bien: qui est indpendant de lexprience, avec la double
spcification a) qui nen a pas t tir et b) qui ne laisse pas restreindre lexprience, dans son application.
Lattitude impute au sujet humain qui fait un usage transcendantal de son entendement est analogue (peut-tre)
celle adopte par le thoricien qui construit la philosophie transcendantale analogue, mais non pareillement
justifie.
Concernant lexistence ou la non-existence de lusage transcendantal de lentendement et/ou des concepts
purs de lentendement.
Comme il ny a point, ainsi que nous lavons montr plusieurs fois, dusage transcendantal des
concepts purs de lentendement, non plus que de ceux de la raison (CRPu, Bar 428.3.1-3)
se fonde uniquement sur un usage transcendantal de la raison (CRPu, Bar 428.3.5-6)
lopposition ralit empirique vs idalit transcendantale.
220
Op2. Transcendantal / transcendant
Re: la diffrence entre transcendantal et transcendant.
Cest une chose de dire que transcendantal na pas le mme sens que transcendant; cest une autre chose
de dire que transcendantal soppose transcendant.
Une opposition conceptuelle fournit un cart smantique qui fait partie de la dfinition dun concept; cest un
cart smantique distinctif; il est de premier front.
Il nexiste pas, ma connaissance, dopposition conceptuelle dfinitoire entre transcendantal et
transcendant. Les dfinitions respectives de ces termes ne contiennent pas une relation qui les opposerait lun
lautre.
Op3. Transcendantal / synthtique a priori
Une connaissance transcendantale sexprime dans un jugement synthtique a priori : ladjectif
transcendantal dsigne la mthode philosophique, la thorie, latgumentaion (Transzendentalphilosophie) tandis
que ladjectif synthtique a priori dsigne le rsultat (Jugement) et la connaissance transcendantale se rpartit
selon le schma gnral analytique/synthtique et a priori/a posteriori . (Drieschner, M., in Speck, Handbuch,
p. 654.
Op4. Transcendantal / mtaphysique
transcendantal soppose mtaphysique dans le contexte: faire une exposition mtaphysique du concept
despace vs faire une exposition transcendantale du concept despace.
Op5. Transcendantal / gnral
soppose gnral dans le contexte: logique gnrale vs logique transcendantale.
Sur le rapport entre logique gnrale et logique transcendantale, voir Phi, OK I 113.1. Philonenko
mentionne plusieurs commentateurs qui ont cru que la logique transcendantale tait drive de la
logique gnrale et soutient que Loin de dpendre de la logique formelle, la logique
transcendantale la conditionne.
Op5. Transcendantal / logique
rflexion logique versus rflexion transcendantale (CRPu, Bar 282.2.m4-283.1.f)
Op5. Philosophie transcendantale / physiologie (rationnelle)
noter que dans lArchitectonique de la raison pure loppos de philosophie transcendantale est
physiologie (rationnelle), de sorte que la manire dont il faut entendre l le mot transcendantal nest pas
indique dans une opposition lexicale explicite.
221
Appendice 2.
Concernant la smantique (ou lexgse) du terme facult de juger
Cest la doctrine transcendantale du jugement (en tant que partie de lAnalytique de la Logique
transcendantale) qui va faire la thorie de cette subsomption. Kant rappelle, en passant, que cette partie de la logique
transcendantale qui va traiter de la manire de prvenir les faux pas du jugement (lapsus judicii ) dans lusage du
petit nombre de concepts purs que nous fournit lentendement (CRPu, Bar 182.2.m2-183.1.1) relve de la
philosophie considre comme critique (propdeutique) et non de la philosophie considre comme doctrine. [Le
fait de reprendre le mot doctrine, dans lexpression doctrine transcendantale du jugement, est donc un peu
maladroit] Lanalytique des concepts a indiqu la rgle (ou plutt la condition gnrale des rgles) qui est
donne dans le concept pur de lentendement et maintenant lanalytique des principes va indiquer en plus, et
toujours a priori, le cas o la rgle doit tre applique. (CRPu, Bar 183.2.4-5)
La partie qui est consacre la facult dterminante dans la CRPa est intitule De la typique <die Typik> du
jugement pur pratique (CRPa, Pic 70-74; fin du chap. II).
NOTE. Selon Verneaux, il faut distinguer la facult-de-juger <Urteilskraft> de la facult de juger
<Vermgen zu urteilen> qui est une des nombreuses dfinitions de lentendement. (Ver, VK-II 249.1). Soit; mais
quelle distinction faire entre Vermgen zu urteilen et Urteilskraft? Sera-ce la mme que entre Verstand et
Urteilskraft? Pour suivre Verneaux et dcouvrir quoi mne son assertion, il faudrait comparer les deux assertions
suivantes:
Die Urteilskraft ist ein Vermgen zu urteilen
Der Verstand ist ein Vermgen zu urteilen
et dterminer en quoi la premire nest ni une dfinition de Urteilskraft ni analytique puisque ces deux caractres
doivent lui faire dfaut si elle doit se distinguer de la deuxime proposition, laquelle est cense avoir, selon
Verneaux, le type danalyticit propre une dfinition.
Verneaux raisonne comme suit:
Verstand = Vermgen zu urteilen; par dfinition.
Verstand nest pas la mme chose que Urteilskraft.
Donc, Vermgen zu urteilen nest pas la mme chose que Urteilskraft.
La majeure sappuie sur des passages tels que le suivant: Comme nous pouvons ramener tous les actes de
lentendement des jugements <Urteile>, lentendement en gnral <der V e r s t a n d berhaupt> peut tre
reprsent comme une facult de juger <e i n V e r m g e n z u u r t e i l e n >. En effet, daprs ce qui a tt dit
prcdemment, il est une facult de penser <Vermgen zu denken>. Or penser, cest connatre par concepts []
(CRPu, Bar 129-130; Analytique des concepts, chap. I, Premire section: De lusage logique de lentendement en
gnral.)
Cest la majeure de ce raisonnement qui me semble errone; je ne crois pas que le passage cit (ni aucun
autre, dailleurs) tablisse entre Verstand et Vermgen zu urteilen une relation aussi forte que lquivalence logique
propre une dfinition. Le passage dit seulement que lorsquon considre lentendement un niveau de gnralit
suffisant (Verstant berhaupt) et que lon considre quoi il conduit, savoir penser, on peut se le reprsenter
comme une facult de juger. Cette exgse contient quatre lments qui empchent de voir une dfinition dans le
passage cit: 1 berhaupt; 2 la relation faite entre penser et juger: pour penser on part des concepts mais on va au
jugement, car un concept est virtuellement le prdicat dun jugement; 3 la relation exprime par tre reprsent
comme; 4 larticle une qui ne peut pas exprimer une relation didentit entre le sujet et le prdicat de cette
phrase.
mon avis, cest tort que Verneaux laisse croire au lecteur de Kant que la distinction entre Vermgen zu
urteilen et Urteilskraft est lexicalise et quil faudrait, par consquent, la lexicaliser aussi dans la traduction en
adoptant, par exemple, une diffrence de graphie du genre suivant: facult-de-juger pour Urteilskraft et facult
222
de juger pour Vermgen zu urteilen. Les deux passages suivants sont tout fait probants, il me semble, pour
montrer que la diffrence entre les deux expressions nest pas lexicalise, cest--dire quelle ne correspond pas
une distinction ou opposition conceptuelle :
La condition subjective de tous les jugements est la facult de juger elle-mme ou la facult
judiciaire <das Vermgen zu urteilen selbst, oder die Urteilskraft>.
(CFJ, Pko 121.2.m8-7; 35. Le principe du got est le principe subjectif de la facult de juger
<Urteilskraft> en gnral. )
Nous possdons une facult de juger simplement esthtique pour juger sans concepts des formes
<ein Vermgen der blo sthetischen Urteilskraft, ohne Begriffe ber Formen zu urteilen> et trouver
une satisfaction dans le simple jugement <Beurteilung> de celles-ci; nous faisons de cette
satisfaction une rgle pour chacun, sans que le jugement <Urteil> se fonde sur un intrt ou en
produise un. Dun autre ct nous possdons aussi une facult de juger intellectuelle, afin de
dterminer <ein Vermgen einer intellektuellen Urteilskraft, [] zu bestimmen> pour de simples
formes de maximes pratiques (dans la mesure o elles se qualifient delles-mmes comme
lgislation universelle) une satisfaction a priori, dont nous faisons pour chacun une loi, sans que
notre jugement <Urteil> se fonde sur un quelconque intrt; mais alors il en produit un. Dans le
premier jugement le plaisir ou la peine sont propres au got et dans le second au sentiment moral.
(CFJ, Pko 132.3.1-f; KUk, Wei 397.2.1-f)
La cooccurrence des deux syntagmes (Vermgen zu urteilen et Urteilskraft) dans la dernire citation montre bien
quelle grammaire logique correspond la diffrence entre eux; lorsque Kant a besoin de donner un complment
dobjet au verbe urteilen, il est bien oblig dutiliser la forme syntaxique qui rend le verbe autonome et capable de
rgir ses complments (quand on lui en donne) ou dtre employ absolument. (Fin de la NOTE.)
223
Appendice 3.
La notion da priori
1. a priori est dabord un adverbe de manire.
2. Il peut tre employ adjectivement mais cest par drivation.
Comme dterminant dun substantif, par exemple, il forme une tournure qui se laisse gnralement
comprendre comme une ellipse:
connaissance a priori signifie gnralement: connaissance obtenue a priori;
jugement a priori signifie: jugement affirm, port, conclu, nonc a priori.
3. Comme substantif, a priori est encore davantage driv.
Il peut rsulter dune abstraction visant dsigner le concept pens par Kant lorsquil emploie le terme a
priori adjectivement ou adverbialement. La priori signifie alors : le concept, ou la notion, da priori . Cette
substantivation est lgitime et normale en mtadiscours.
Le problme du double niveau de ce qui fonctionne a priori: a) ce qui fonctionne a priori dans la
sensibilit; b) la connaissance a priori de que jai de ce qui fonctionne a priori dans la sensibilit.
224
Appendice 4.
Le passage du principe tlologique lesthtique (thorie du beau)
Je prsente ci-dessous une paraphrase de la section VI de lIntroduction CFJ. On pourrait appeler ce passage
(33.f-35.2) lesthtisation de la finalit, la suggestion du titre de la section VII de lIntroduction de la Critique
de la facult de juger.
Kant introduit dabord la notion dintention. Lapplication des lois universelles de lentendement la nature
seffectue sans aucune intention de la part de nos facults de connatre. En revanche, la recherche dun ordre
de la nature selon ses lois particulires exige une intention: lentendement cherche atteindre lune de ses
fins ncessaires, je veux dire lintroduction dans la nature de lunit des principes : fin que la facult de juger
doit ensuite attribuer la nature, parce quen ceci lentendement ne peut lui prescrire aucune loi. (CFJ, Pko
34.1.4f)
Or, la ralisation de toute intention est lie au sentiment de plaisir (CFJ, Pko 34.2.1 accentuation en gras
due NL).Variante de ldition de lAcadmie: la ralisation de cette intention est lie au sentiment de
plaisir. (Attention: ce nest pas le plaisir de voir se raliser un dsir, car la facult de dsirer nest pas ici
implique. Seul le rapport de lobjet lintention de lentendement est concern.)
Troisimement, Kant dfinit la nature esthtique dune reprsentation dun objet comme tant la relation de
cette reprsentation au sujet (non lobjet), comme tant ce qui est simplement subjectif dans la
reprsentation.
Or il y a deux espces dlments subjectifs dans la reprsentation: les lments qui peuvent tre intgrs (ou
qui servent) la connaissance de lobjet et ceux qui ne le peuvent pas. Llment subjectif, qui dans une
reprsentation ne peut devenir une partie de la connaissance, cest le plaisir ou la peine qui y sont lis. (CFJ,
Pko 36.2.1-3)
Or la finalit est un lment subjectif et nest pas une qualit <Beschaffenheit> de lobjet lui-mme (CFJ,
Pko 36.2.5-7) ne fait pas partie de la connaissance de lobjet. Un objet est dit final seulement parce que sa
reprsentation est immdiatement lie au sentiment de plaisir (CFJ, Pko 36.2.m5-4)
Donc la reprsentation dun objet comme conforme une fin (comme final) est une reprsentation esthtique
de la finalit.
Il faut maintenant passer de la reprsentation esthtique au jugement esthtique. Ce passage a deux
conditions: a) la forme de lobjet convient aux facults de connatre (un plaisir apparat au niveau de la simple
apprhension); b) limagination, en tant que facult de rapporter des intuitions des concepts, se trouve mise
en accord inintentionnellement, grce une reprsentation donne, avec lentendement (CFJ, Pko 36.3.m4-3).
Un tel jugement ne se fonde sur aucun concept existant de lobjet et ne procure aucun concept de lobjet.
(CFJ, Pko 36.f.f-37.1.1) Ces deux conditions sont runies dans la formule suivante qui nonce la condition
universelle, quoique subjective, des jugements rflchissants : laccord final dun objet (quil soit un produit
de la nature ou de lart) avec le rapport, exig pour toute connaissance empirique, des facults de connatre entre
elles (de limagination et de lentendement). (CFJ, Pko 37.f.m2-38.1.2)
La facult de juger daprs un tel plaisir se nomme le got.
225
Appendice 5.
Le classement des facults dans LAnthropologie du point de vue pragmatique
PREMIRE PARTIE. Didactique anthropologique
LIVRE I. De la facult de connatre
De la connaissance de soi <Vom Bewutsein seiner selbst> 1-6
De la sensibilit par opposition lentendement 7-27
De limagination 28-39
Comprend : la facult de linvention sensible <das sinnliche Dichtungsvermgen> (31-33), la facult de
rendre prsent le pass et lavenir par limagination (34-36), linvention involontaire dans ltat de sant,
cest--dire le rve (37), la facult de dsignation (facultas signatrix) (38-39).
De la facult de connatre dans la mesure o elle est fonde sur lentendement 40-59
Comparaison anthropologique des trois facults suprieures de connatre [ savoir: lentendement, le
jugement (judicium) et la raison] (41-44)
Des dficiences et des maladies de lme en rapport avec la facult de connatre (45-53)
Des talents dans la facult de connatre (54)
De la diffrence spcifique de lesprit qui compare et de lesprit qui spcule (55-59)
LIVRE DEUX. Le sentiment de plaisir et de dplaisir 60-72
Du plaisir sensible
A. Du sentiment de lagrable ou du plaisir sensible dans la sensation dun objet (60-66)
B. Du sentiment du Beau, cest--dire du plaisir en partie sensible, en partie intellectuel dans lintuition
rflchie, ou encore du got (67-72)
LIVRE TROIS. De la facult de dsirer 73-88
Des motions dans leur opposition avec la passion (74)
Des motions en particulier (75-79)
Des passions (80-86)
Du bien physique suprme (87)
Du bien physique et moral suprme (88)
DEUXIME PARTIE Caractristique anthropologique.
226
Appendice 6.
Comparaison des concepts entre eux selon leur aptitude lgifrer
Une des manires dont Kant conceptualise le pouvoir lgislatif des facults est de classer leurs concepts selon
le rapport quils entretiennent avec les objets quils reprsentent. La spcification de ces rapports lui permet de
dfinir quatre classes dobjets. On peut alors se servir de ces classes pour demander, propos de certains concepts
ou sortes de concepts si leurs objets appartiennent ou non ces classes; en dautres mots, on peut demander si tel
concept a un territoire, ou non; sil a un domaine ou non. Pour les principaux concepts impliqus dans la thorie des
facults, je dresse le tableau A6 qui donne cette information.
VOCABULAIRE TECHNIQUE (convenu dans lIntroduction la Critique de la facult de juger)
Kant distingue le champ <das Feld>, le territoire <der Boden> (territorium) et le domaine <das Gebiet>
(ditio) des concepts, ces distinctions tant bases sur la manire dont les concepts se rapportent des objets, afin
den constituer, autant que possible, une connaissance (CFJ, Pko 23.4)
CHAMP. Des concepts, dans la mesure o ils sont rapports des objets, sans que lon considre si une connais-
sance de ceux-ci est ou non possible, possdent leur champ, qui est dtermin seulement daprs le rapport de
leur objet notre facult de connatre en gnral. (CFJ, Pko 23.5)
TERRITOIRE. La partie de ce champ quil nous est possible de connatre constitue un territoire pour ces concepts et
pour la facult que cette connaissance requiert. (ibid.)
DOMAINE. La partie de ce territoire o ils lgifrent, est le domaine (ditio) de ces concepts et des facults de
connatre qui leur conviennent. (CFJ, Pko 23.5)
DOMICILE. Les concepts de lexprience <Erfahrungsbegriffe> ont leur territoire dans la nature, comme ensemble
de tous les objets des sens mais non un domaine (ils nont quun domicile <Aufenthalt>, domicilium); cest
parce que sils sont en vrit produits de manire nomique <gesetzlich> ils ne lgifrent pas <nicht
gesetzgebend>; [au lieu de cela] les rgles fondes sur eux sont empiriques et par consquent contingentes.
(CFJ, Pko 24.1) (NOTE. Kant ne donne pas dexemple de la manire dont les domiciles sont dsigns.)
Concepts de
lexprience
Concepts a priori
de la nature
Concept de la
finalit
Concept
a priori
de
lentendement
de la raison de la nature* de la libert
Territoire
(objets dont la
connaissance
est possible)
La nature, comme
ensemble des
objets des sens.
(Ces concepts ont
a fortiori un
champ : la
nature.)
Lexprience En tant que prin-
cipes constitutifs :
aucun.
En tant que pr.
rgulateurs, ont
indirectement le
mme territoire
que E et J
peut
cependant avoir
quelque ter-
ritoire et dans
des conditions
telles que ce
principe seul
pourrait y avoir
de la valeur.
(CFJ, Pko 26.2)
Lexprience
Domaine
(objets
lgard
desquels les
concepts ont
valeur de
rgle, ou loi)
Aucun La nature, en tant
que phnomne;
le sensible en tant
quobjet
reprsent dans
lintuition
En tant que prin-
cipes constitutifs:
aucun
En tant que prin-
cipes rgulateurs :
la facult de juger
et lentendement
Aucun. Le supra-
sensible**;
le sujet, comme
chose en soi;
nest pas
reprsent dans
lintuition
227
Tableau A6. La fonction lgislatrice des concepts, telle quexprime
dans la terminologie des territoires et domaines.
* NOTE associe au tableau A6. ce concept transcendantal dune finalit de la nature nest ni un concept de la
nature, ni un concept de la libert, parce quil nattribue absolument rien lobjet ( la nature), mais reprsente
seulement lunique manire suivant laquelle nous devons procder dans la rflexion sur les objets de la nature en
vue dune exprience compltement cohrente, et par suite cest un principe subjectif (maxime) de la facult de
juger. (CFJ, Pko 31.1.m8-2; dans lIntroduction, avant la distinction entre finalit objective et finalit subjective.)
** NOTE associe au tableau A6. Le supra-sensible constitue un champ illimit mais o nous ne trouvons pour
nous aucun territoire et en lequel nous ne pouvons avoir de domaine propre la connaissance thorique ni pour les
concepts de lentendement, ni pour les concepts de la raison; aussi bien au profit de lusage thorique que pratique
de la raison nous devons occuper ce champ avec des Ides, auxquelles [] nous ne pouvons attribuer quune ralit
pratique, et par l notre connaissance thorique ne se trouve pas tendue le moins du monde au supra-sensible.
(CFJ, Pko 24-25, Intro, II)
228
Appendice 7.
Conventions dcriture adoptes pour le prsent ouvrage
La dsignation des parties des ouvrages de Kant
Le format mtalinguistique. Exemple :
le chapitre intitul De la dduction des concepts purs de lentendement
Le format doctrine, pour les parties dont le titre est galement un dsignateur de doctrine: jcris lexpression
entire avec une majuscule initiale (sans guillemets, sans italique).
Exemple. Pour la Critique de la raison pure, il existe exactement huit tels intituls :
lEsthtique transcendantale
la Logique transcendantale
lAnalytique transcendantale
lAnalytique des concepts
lAnalytique des principes
la Dialectique transcendantale
lAntinomie de la raison pure
la Mthodologie transcendantale.
Le format rfrence; la spcification dune partie dans une rfrence est inhabituelle; quand lidentification
dune partie exige que je prcise un ou plusieurs embotements, la rgle est daller de lenglobante
lenglobe. Exemple :
La facult de dsirer est la facult dtre par ses reprsentations cause de la ralit des objets de ces
reprsentations (CFJ, Pko 26n1; Intro, III)
Le format titre subordonn. Jentends ici par titre subordonn tout titre subordonn au titre de louvrage tout
entier. Lorsque je ne souhaite pas utiliser les tournures mtalinguistiques qui servent indiquer un titre la
manire dune citation, mais plutt me servir dun titre comme dsignateur de partie, comme je le fais avec
des dsignateurs tels que le Chapitre III ou la section 17, je dlimite le titre par les signes diacritiques
. Ces titres sont accompagns de leur nom de partie chaque fois que celui-ci consiste en une section
numrote; dans les autres cas, je considre facultative la mention du nom de partie (chapitre, livre,
division, etc.). Exemple :
On trouve, dans les passages Remarque I et Remarque II insrs la fin de la section 57.
Solution de lantinomie du got, des indications prcieuses concernant les rapports que les facults
entretiennent entre elles du point de vue gnral englobant les trois Critiques.
COROLLAIRE. Les titres peuvent apparatre avec lun ou lautre des trois statuts suivants:
avec le statut de citation, comme nimporte quelle autre partie dun ouvrage. Dans ce cas, la citation est
soumise aux conventions de format valant pour toute citation: indication graphique et rrrence.
avec le statut de mention; dans ce cas, les guillemets mtalinguistiques suffisent (pas besoin de
rfrence). Exemple : Si je veux faire remarquer une formulation utilise dans un titre, je pourrais crire
On remarque que le titre de la section 65 de CFJ est explicitement lnonc de la thse dominante
et pas seulement lindication dun thme: Les choses en tant que fins naturelles sont des tres
organiss.
avec le statut dindicateur de partie; dans ce cas, le format est celui dcrit ci-dessus sous lappellation
format titre subordonn.
229
Les citations
Toute citation comporte une indication graphique de son statut de texte emprunt et une rfrence la source
de lemprunt.
Pour ce qui est de lindication graphique :
Quand le texte cit est insr dans le corps du paragraphe o il survient, lindication graphique est
lemploi de guillemets. (Voir les conventions concernant les guillemets.)
Quand le texte cit est retir, ou spar, du corps du paragraphe o il survient, cest cette particularit de
la mise en page (alina avant et aprs, retrait par rapport aux marges de gauche et de droite) qui constitue
lindication graphique; dans ce cas, je nutilise donc pas de guillemets (chevrons) pour marquer le dbut
et la fin de la citation.
Pour ce qui est des rfrences, jutilise une notation dont la syntaxe complte est page.paragraphe.ligne-
page-paragraphe-ligne.
Par abrviation, la syntaxe peut devenir: page.paragraphe.ligne-ligne, page.paragraphe-paragraphe;
dans ce dernier cas, le passage commence avec la premire ligne du premier paragraphe mentionn et se
termine avec la dernire ligne du deuxime paragraphe mentionn.
Jutilise galement des lettres: m pour moins; f pour final, finale ou finales; n pour
note.
Les exemples suivants devraient suffire faire connatre la totalit du code :
26.2.9-10 signifie: page 26, paragraphe 2, lignes 9-10.
26.2.m7-4 signifie: de la ligne 7 la ligne 4, en comptant les lignes partir du bas du paragraphe
(verbalisant, on dirait de moins 7 moins 4).
26.2.4f signifie: page 26, par. 2, les 4 dernires lignes.
26.2.f signifie: page 26, par. 2, dernire ligne.
26.f signifie: page 26, dernier paragraphe en entier (lignes 1 f).
26n27.4-7 signifie: page 26, note 27, lignes 4-7.
LES ITALIQUES DANS LES CITATIONS.
Les italiques qui apparaissent dans le texte kantien traduit en franais indiquent:
soit des mots latins
soit des mots mis en valeur par Kant dans le texte allemand
soit des titres douvrage.
Les italiques, dans le texte kantien dit par Weischedel, indiquent des variantes entre ldition prise pour
base et les autres; les sur-espacements indiquent les italiques du texte kantien. Comme je nai gnralement pas
tenir compte des variantes dans mes citations, je ne reproduis pas les italiques de Weischedel (sauf mention
expresse) mais je reproduis les sur-espacements. Le texte de Weischedel ne met pas en italique les mots latins qui
figurent dans le texte kantien (par exemple: a priori, apprehensio); mes citations de Weischedel respectent cette
convention. Cest sans doute pour respecter lusage qui prvaut dans la typographie des textes franais que le texte
kantien traduit par Philonenko et publi chez Vrin met les mots latins en italique; et mes citations tires de l
respectent aussi cet usage.
LES INSERTIONS EN ALLEMAND DANS LES CITATIONS QUE JE DONNE DE BARNI OU DE PHILONENKO.
Si Barni ou Philonenko ont eux-mmes insr des expressions allemandes dans le texte franais, je reproduis
toujours ces insertions lorsque je cite leur texte. Cependant, je crois moi-mme utile parfois de donner lexpression
allemande alors quelle ne figure pas dans le texte franais; mes raisons sont varies: parfois lintrt de lallemand
230
est philologique et concerne le vocabulaire, parfois je veux justement faire remarquer quelque chose que la
traduction ne rend pas ou rend mal.
Rsultat: lorsquune insertion allemande apparat dans une citation que je fais, mon lecteur ne peut savoir si
linsertion est de moi ou du traducteur que je reproduis. Cette perte dinformation me parat bnigne et vaut mieux,
je pense, que la complication supplmentaire quaurait entrane lajout dune convention graphique marquant mes
insertions.
Les notes
Jai laiss dans mon texte des notes qui ont diverses fonctions par rapport au texte principal et qui, souvent,
indiquent le caractre inachev de la rdaction en cours. Je ne me suis pas rsolu donner ces notes le format
standard des notes infrapaginales justement parce que leur statut et leur fonction, dans bien des cas, ne
correspondent pas ceux dune notre infrapaginale standard. De plus, la manipulation et la numrotation des appels
de notes auraient introduit dans le traitement informatis du texte (rparti en plusieurs documents) des complications
dont jai voulu me passer.
Conventions rgissant lcriture des passages en allemand
La citation en allemand. Si je cite un passage en allemand pour lui-mme (non lintrieur dune autre
citation mais lintrieur de mon discours), japplique les rgles standard
guillemete si elle survient dans le corps dun paragraphe
non guillemete si elle est mise en retrait par rapport au corps du paragraphe
caractre comme dans loriginal
Exemple.
Le dispositif de rfrence au texte-source ou la langue-source. Si jinsre, dans du texte franais, un mot
ou une expression allemands afin dindiquer quels sont les correspondants allemands des items franais
utiliss (que ce soit au cours dune citation donne en franais ou dans un passage que domine mon propre
discours)
les dlimiteurs sont les parenthses angulaires: <>. Il faut viter les crochets car ils ont dj un usage,
lequel est diffrent.
les caractres sont comme dans loriginal allemand de ldition Weischedel (litalique indique du texte
qui se trouve seulement dans lune des deux ditions, le romain indique le texte commun aux deux
ditions; le surespacement des lettres est utilis pour mettre en valeur).
Exemple. Quand Kant veut prciser en quoi le jugement <Uk> diffre de lentendement pris en son
sens troit, dans le schme typologique E-J-R, il dit: Si lon dfinit lentendement en gnral la
facult des rgles, le jugement sera la facult de subsumer sous des rgles, cest--dire de dcider si
quelque chose rentre ou non sous une rgle donne (casus datae legis) [] Aussi le jugement est-il
le caractre distinctif de ce quon nomme le bon sens <des sogenannten Mutterwitzes>, et au
manque de bon sens, aucune cole ne peut suppler. (CRPu, Bar 181.1)
Les mentions ditems allemands. Si jinsre, dans le texte franais, un mot ou une expression allemands qui
ne sont pas une citation et qui font partie de la syntaxe de la phrase en franais
italique
a) Si litem mentionn est autonyme, je mets des guillemets.
Exemple. Le terme allemand Urteilskraft se traduit en franais tantt par jugement, tantt par
facult de juger.
231
b) Si litem mentionn nest pas autonyme, je ne mets pas de guillemets.
Exemple. Soit; mais quelle distinction faire entre Vermgen zu urteilen et Urteilskraft? Sera-ce la
mme que entre Verstand et Urteilskraft? Pour suivre Verneaux et dcouvrir quoi mne son
assertion, il faudrait comparer les deux assertions suivantes:
Die Urteilskraft ist ein Vermgen zu urteilen
Der Verstand ist ein Vermgen zu urteilen
et dterminer en quoi la premire nest ni une dfinition de Urteilskraft ni analytique puisque ces
deux caractres doivent lui faire dfaut si elle doit se distinguer de la deuxime proposition, laquelle
est cense avoir, selon Verneaux, le type danalyticit propre une dfinition.
Les rfrences
Pour les ouvrages dsigns au moyen dune abrviation, je suis la mthode auteur-titre:
dans le cas des oeuvres de Kant, labrviation rfre dabord au titre puis au traducteur (Barni, Picavet,
etc.) ou lditeur (Weischedel);
dans le cas des oeuvres des commentateurs, labrviation mentionne dabord lauteur, puis le titre:
Phi, OK I, Del, PCK.
Pour les ouvrages dsigns sans abrviation convenue, jutilise le systme auteur-date:
dabord le nom de lauteur (en romain maigre), puis la ou les initiales; la date est place aprs une
virgule, la page aprs une virgule.
232
Appendice 8.
Errata du texte franais de CRPu adopt comme rfrence de base du prsent
ouvrage
KANT, EMMANUEL, CRITIQUE DE LA RAISON PURE,
traduction J. Barni, revue par P. Archambault, ditions Garnier-Flammarion, 1976.
Cette liste derrata vaut galement pour ldition GF-Flammarion de 1987,
prface par Luc Ferry.
Endroit
Lire
(texte corrig)
Au lieu de
(texte erron)
32.3.4 sur ltendue donner de ltendue donner
33.3.2 que nous nommons entendement et que nous nommons et
Or si tant est que la raison doive se trouver
en ces sciences, il faut quon y connaisse
quelque chose a priori
38.3.5 dautre part), dautre part,
38.3.9 si grand ou si petit que soit si grande ou si petite que soit
42.1.m2 a priori des choses a priori les choses
44.n1 de la raison pure a beaucoup de la raison a beaucoup
45.1.1-2 la mthode suivie jusquici en mtaphysique la mthode suivie en mtaphysique
46.1.20 (lusage moral), o elle lusage moral, o elle
52.1.17 teint), montra comment teint, montra comment
64.1.9 un jugement synthtique. un jugement analytique.
75.2.5-6 la moralit et ses concepts la moralit et de ses concepts
76.1.2-3 sous lesquelles seules les objets sous lesquelles seuls les objets
81.3.5 quoi seul les sensations quoi seules les sensations
85.1.4-5 le concept universel despaces en gnral le concept universel despace en gnral
89.2.4 ne leur servait ne lui servait
90.4.6 toutes les grandeurs dun objet toutes les grandeurs dune chose
109.2.m2-110.1.2 ne peut jamais tre autrement que sensible,
cest--dire quelle comprend seulement la
manire dont nous sommes affects par des
objets. [la syntaxe ne peut jamais tre que
sensible peut signifier ne peut jamais tre
seulement sensible; pour cette raison, elle
est en partie ambigu.]
ne peut jamais tre que sensible [pour nous],
cest--dire contenir autre chose que la
manire dont nous sommes affects par des
objets.
111.3.3 fournit la rgle), elle fournit la rgle, elle
113.1.8 connaissance ou son usage connaissance et son usage
114.3.14 la fois suffisant et universel suffisant la fois et universel
131.3.14-15 que lme est non-mortelle que lme nest pas mortelle
233
Note: On doit suivre ici la lecture de ldition de lAcadmie (nichtsterblich) qui corrige le nicht sterblich de
ldition originale, car, sinon, le reste de la phrase (jai bien rellement affirm au point de vue de la forme
logique) na pas de sens. Ldition Wilhelm Weischedel (Darmstadt, 1956, 1975, 1981) mentionne la correction
apporte par ldition de lAcadmie.
134.2.17-135.1.1 faire de cette diversit une connaissance faire de cette connaissance une diversit
136.2.4-5 cest cette unit qui, pour le dire dune
manire gnrale, sappelle un concept pur
de lentendement
cest cette unit qui, prise dune manire
gnrale, sappelle un concept pur de
lentendement
150.1.20 celle sans laquelle nous celle sous laquelle nous
150.1.m5 Il y aura donc Il y a donc
150.1.m2 comme concepts a priori, reposera comme concept a priori, repose
153.1.26 contraire, le suppose toujours contraire, la suppose toujours
154, titre 16 originairement synthtique ordinairement synthtique
154.2.8 au je pense dans le mme sujet o se
rencontre cette diversit dlments. Mais
au je pense. Mais
157.1.12 le: je pense le: je pense
157.2.2 Celles-ci consistent dans Celle-ci consiste dans
157.3.3 entirement indpendante de entirement indpendant de
161.1.14 fonctions (10). fonctions (13).
Note: Ldition de lAcadmie apporte la correction (10) au lieu du (13) qui semble tre un lapsus.
163.1.10 empirique de ce qui empirique, de ce qui
164.1.10 lintuition en gnral, quelle soit lintuition en gnral; quelle soit
164.2.3 supposition que rien de supposition, que rien de
166.1.24 productrice et la distingue par l de
limagination reproductrice, dont la synthse
productrice, dont la synthse
Note: Lomission du membre de phrase indiqu produit un complet contresens.
172.2.5 phnomne considr comme phnomne, considr comme
173.2.7 et les premires ne sont et les premiers ne sont
173.2.28-32 soumis aux catgories, catgories dont la
nature (considre simplement comme
nature en gnral) dpend comme du
fondement originaire de sa conformit des
lois (en tant que natura formaliter spectata).
soumis aux catgories, et la nature
(considre comme nature en gnral, ou en
tant que natura formaliter spectata) dpend
de ces catgories comme du fondement
originaire de sa conformit ncessaire des
lois.
174.note.10-11 consquent la connaissance consquent de la connaissance
174.3.7 les concepts de ses objets les concepts de ces objets
188.3.6 comme conditions dune comme condition dune
192.4.8-193.1.2 sensatio realitas phnomenon, constans et
perdurabile rerum substantia phnomenon -
- aeternitas, necessitas phnomena etc.).
sensatio realitas phaenomenon, constans et
perdurabile rerum substantia
phnomenon. TERNITAS, NECESSITAS,
phnomena, etc.).
234
Note: Je suis ldition Weischedel, lequel reproduit loriginal. Weischedel mentionne que ldition de lAcadmie
change phnomena, la fin du passage, pour phnomenon. La lecture de Weischedel nest pas dpourvue de
toute ambigut, mais elle signale au moins que cest une erreur dajouter une virgule aprs NECESSITAS et que
lemploi des petites capitales en romain (cest--dire non en italique) ne semble pas rsulter de conventions
appliques systmatiquement: si les petites capitales sont censes indiquer lesquels, parmi les mots latins, sont en
italique dans loriginal, les mots sensatio et constans devraient, eux aussi, tre en petites capitales.
204.3.13 la pense empirique le pense empirique
210.2.19 grandeur, mais que cette grandeur quantit, mais que cette quantit
Note: Il sagit du terme allemand Gre. Il est traduit par grandeur la fin du mme paragraphe (211.1.3).
214.1.17-18 de telle sorte quen aucun deux de telle sorte quen aucune delles
214.1.19 tout rel dune mme qualit a nanmoins un
degr de celle-ci
tout rel dune mme qualit a nanmoins
son degr
[Voici la traduction de Tremesaygues &
Pacaud de 214.1.16-23; elle est meilleure
que celle de Barni:] si deux espaces gaux
peuvent parfaitement tre remplis de
matires diverses, de telle sorte quil ny ait
dans aucun deux un point o ne se trouve la
prsence de la matire, tout rel dune mme
qualit a pourtant le degr (de rsistance ou
de pesanteur) de cette qualit, degr qui,
sans que diminue la grandeur extensive ou le
nombre, peut dcrotre jusqu linfini avant
que cette qualit disparaisse dans le vide et
svanouisse.
217.2.2f son intuition empirique se distingue son intuition empirique ne se distingue
219.3.2f ne peuvent tre reprsentes quen lui ne peuvent tre reprsents quen lui
220.2.14 seul possible seule possible
223.2.m4 seul le permanent (la substance) subit du
changement,
seul le permanent (la substance) change,
Note: Il sagit de traduire la forme passive wird verndert.
224.5.1-225.1.f (Le principe prcdent [] la preuve.) Le principe prcdent [] la preuve.
224.5.10-11
Note: Dans lnonc du principe, changement dtat traduit Wechsel et changement, dernier mot de
lnonc, traduit Vernderung. Wechsel contient lide de remplacement; Vernderung contient lide de
transformation. Une paraphrase explicative pourrait se formuler ainsi: Tout ce qui parat cesser ou commencer
dexister nest en fait que la transformation de quelque chose qui prexiste.
227.1.6-8 ne peut tre reprsent comme objet []
quen tant que
ne peut tre reprsent que comme objet []
en tant que
228.2.9 de lun (ce qui arrive) suive selon une rgle
celle de lautre (ce qui prcde).
de lun (qui arrive) suivre selon une rgle
celle de lautre (qui prcde).
228.2.11-12 quelque chose dautre qui prcde et quil
suit
quelque chose dautre qui prcde et qui le
suit
232.3.8 la srie des reprsentations qui se suivent
lune lautre
la srie de lune des reprsentations qui se
suivent
235
235.1.11-12 toute transformation
[ou encore: ] tout changement daspect
toute vicissitude
235.1.m7 quexigent quexigeraient
238.1.m4 que notre propre apprhension que notre propre adhsion
239.1.m9 dans lautre dans dautre
244.5.9 leur ralit leur galit
255.2.m14 nappartiendraient-elles pas nappartiendraient-ils pas
269.2.2 gnral par exemple gnral que par exemple
272.2.13 forme pure de lusage forme pure et lusage
275.2.2-3 ne peut jamais faire plus, sil opre a priori,
quanticiper
ne peut faire a priori en aucun cas
quanticiper
282.2.3 reprsentations sous un seul concept reprsentations sous concept
283.2.6 (numerica identitas) (numerica identitus)
283.2.21 identitatis indiscernibilium) identibatis indiscernibilium)
287.2.m10-9 concepts de la rflexion empiriques ou
abstraits
concepts de la rflexion, empiriques mais
abstraits
Note: abstraits traduit abgesondert; il sagit de concepts tirs de lexprience par induction gnralisatrice.
288.1.1 identiques ou diffrents identiques ou indiffrents
289.1.16-17 quand un principe rel [Realgrund] dtruit quand un principal dtruit
296.1.8 tout un mode suivant tout un mode suivant
296.2.3 aucun schme de la sensibilit aucun schma de la sensibilit
299.5.8 2. Objet vide dun concept, 2. Objet vide de concept,
305.3.10 les paralogismes les paralogiques
307.1.1 Lexpression principe Lexpression de principes
Note: En langage contemporain, on dirait Lexpression principe. La premire occurrence de principe traduit
Prinzip et la deuxime traduit Principium.
307.2.1 connaissance par principes connaissance par principe
307.3.1 principes de lentendement pur principes de la raison pure
309.1.4 la relation dinfrence lnonc intermdiaire
Note: Il sagit de traduire Schlufolge. (Voir les notes de cours).
310.2.4 pouvoir subalterne dimprimer des
connaissances donnes une certaine forme
pouvoir subalterne, imprim des
connaissances donnes, une certaine forme,
310.2.18 subjective dconomie subjective de cette conomie
Note: conomie traduit Haushaltung; on traduirait plus littralement conomie domestique.
311.1.7 ce qui arrive a une cause ce qui arrive une cause
311.1.10 rapport une exprience rapport dune exprience
311.2 le conditionn se rapporte analytiquement, il
est vrai, une condition
le conditonn se rapporte bien une
condition
318.1.4 ferait de la vertu devrait faire de la vertu
236
320.2.m2 (sensatio); (cognitio);
322.3.4 inconditionn dabord conditionn dabord
323.1.12-13 que quelque chose est considr en soi et a
par consquent une valeur intrinsque
[Tremesaygues et Pacaud)
que cest une chose prise en elle-mme
quon attribue quelque chose et que cela lui
convient dons intrinsquement [N.
Lacharit]
que quelque chose est considr dune chose
en soi, et a par consquent pour elle une
valeur intrinsque
323.1.m11-10 et par l cette chose est absolument
ncessaire;
et par l absolument impossible
324.3.3 et ne sarrte qu ce qui est inconditionn
[ou encore: ] et ne sarrte jamais qu ce qui
est inconditionn
et jamais il ne sarrte ce qui est
inconditionn
325.1.9-10 spculatif de la raison spculatif de lentendement
328.1.1 elle na pas besoin il nest pas besoin
328.1.3 qui est elle-mme vraie qui est en elle-mme vraie
328.3.3 aux objets, et ces objets lobjet, et ces objets
355.4.1 En revanche, la proposition : je pense,
dans la mesure o elle affirme : jexiste
pensant, nest pas une simple fonction
logique;
Au contraire, si la proposition : je pense,
signifie jexiste pensant, elle nest plus une
fonction purement logique;
365.1.9-10 ne sont pas subordonnes, mais coordonnes ne sont pas coordonnes, mais subordonnes
367.1.7 elles constituent ils constituent
370.3.7 de mme que la proposition qui lui est
contraire
comme la proposition contraire
406.1.13 navons point dobligation navons point dobligs
410.1 mais tout ce qui peut y tre donn nest pas
lui-mme une perception si on le rassemble
en un tout absolu
mais tout ce qui peut y tre donn, rassembl
en un tout absolu, nest lui-mme quune
perception
Cette correction est suggre par ldition de lAcadmie, laquelle remplace par keine le
eine du texte des ditions prcdentes.
416.2.9 saurions la percevoir saurions le percevoir
440.2.9 bien que ses effets bien que ces effets
456, sous-titre toute lantinomie toute lautonomie
625.1.m2-1 du droit qua la raison de rechercher ces du droit qu la raison de reprocher ces
Vous aimerez peut-être aussi
- Mon Ebook Les EnergiesDocument211 pagesMon Ebook Les EnergiesBerengere Vial100% (1)
- Il Cern Cce:: D'Oue Signifie S'orienterDocument228 pagesIl Cern Cce:: D'Oue Signifie S'orienterRomain BernardPas encore d'évaluation
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Emmanuel Kant. Avant Apres PDFDocument127 pagesEmmanuel Kant. Avant Apres PDFsimon669Pas encore d'évaluation
- ! Bréhier SchellingDocument336 pages! Bréhier SchellingRobert FrippPas encore d'évaluation
- Introduction à la méthodologie de la pensée écrite: Édition revue et corrigéeD'EverandIntroduction à la méthodologie de la pensée écrite: Édition revue et corrigéePas encore d'évaluation
- Guitton Jean - Portrait de Marthe RobinDocument231 pagesGuitton Jean - Portrait de Marthe RobinAngie Belhocine SImonelli100% (1)
- Roman Picaresque Espagnol À La Lumière de La PoétiqueDocument43 pagesRoman Picaresque Espagnol À La Lumière de La PoétiqueDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- SpinozaDocument149 pagesSpinozaFrédéric DautremerPas encore d'évaluation
- Philo AntiqueDocument4 pagesPhilo AntiqueAlain TerrieurePas encore d'évaluation
- Philosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Soleil Dans La Nuit (Entretiens Radioactifs)Document272 pagesLe Soleil Dans La Nuit (Entretiens Radioactifs)LaBestiole100% (2)
- Mois de Victoire 2020Document148 pagesMois de Victoire 2020Gaston GNIDEHOUPas encore d'évaluation
- Systeme Cle Maitresse 9Document9 pagesSysteme Cle Maitresse 9jipiz100% (1)
- Carnap-La Tache de La Logique de La Science - CompletDocument16 pagesCarnap-La Tache de La Logique de La Science - Completgandon100% (1)
- Notions de Philosophie - AutruiDocument134 pagesNotions de Philosophie - AutruiFrancesco RolliPas encore d'évaluation
- Glossaire de PhilosophieDocument16 pagesGlossaire de PhilosophieGreg2102Pas encore d'évaluation
- Cours de DroitDocument68 pagesCours de Droitfouad100% (3)
- Isabelle Garo - Marx - Une Critique de La Philosophie - Seuil (2000)Document352 pagesIsabelle Garo - Marx - Une Critique de La Philosophie - Seuil (2000)gabyroffPas encore d'évaluation
- Philosophie Morale Et PolitiqueDocument5 pagesPhilosophie Morale Et PolitiqueJonas LewisPas encore d'évaluation
- Actes Enseigner Philosophie 121456Document261 pagesActes Enseigner Philosophie 121456Mamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- D'où Nous Viennent Nos Idées? Métaphysique Et Intermédialité, 2010Document142 pagesD'où Nous Viennent Nos Idées? Métaphysique Et Intermédialité, 2010MechoulanPas encore d'évaluation
- Sujet Bac Blanc HLP Janvier 2023Document1 pageSujet Bac Blanc HLP Janvier 2023lyblancPas encore d'évaluation
- Cicero - Le - DestinDocument35 pagesCicero - Le - DestinDionisie Constantin Pirvuloiu100% (1)
- Depraz, Natalie - Husserl - La Crise de L'humanite Europeene PDFDocument81 pagesDepraz, Natalie - Husserl - La Crise de L'humanite Europeene PDFpolix1Pas encore d'évaluation
- Verite, Certitude, EvidenceDocument9 pagesVerite, Certitude, EvidenceJunior SimeusPas encore d'évaluation
- Arendt 2conditionhommemoderne FicheDocument15 pagesArendt 2conditionhommemoderne Ficheeforgues564Pas encore d'évaluation
- L.-F. Schön, Philosophie Transcendantale Ou Système D'emmanuel Kant, Abel Ledoux, Paris, 1831Document405 pagesL.-F. Schön, Philosophie Transcendantale Ou Système D'emmanuel Kant, Abel Ledoux, Paris, 1831Portail philosophiquePas encore d'évaluation
- 9782290353028Document38 pages9782290353028katimere GastonPas encore d'évaluation
- Histoire de La Philosophie - Temps ModernesDocument61 pagesHistoire de La Philosophie - Temps Moderneseris_lashtamPas encore d'évaluation
- La - Croix - Dans - L'ancien - Testament - Ian FlandersDocument46 pagesLa - Croix - Dans - L'ancien - Testament - Ian FlandersHÉRITIER MULENGELA KAMBUYIPas encore d'évaluation
- Traduire en Poète PDFDocument26 pagesTraduire en Poète PDFDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Cours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandCours de philosophie positive d'Auguste Comte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Destination de l'homme de Johann Gottlieb Fichte: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- La Parole Et La Priere Au Moyen-Age. Le PDFDocument44 pagesLa Parole Et La Priere Au Moyen-Age. Le PDFRayonnement IslamiquePas encore d'évaluation
- B.bourgeois, Le Savoir Absolu Selon HegelDocument2 pagesB.bourgeois, Le Savoir Absolu Selon HegelGKF1789100% (1)
- Sophiste (Monique Dixsaut)Document58 pagesSophiste (Monique Dixsaut)xfgcb qdljrkfgle100% (1)
- Enjeux Et Strategies Des Marques Generalistes Et Specialistes Sur Le Marche Ethno-CosmetiqueDocument22 pagesEnjeux Et Strategies Des Marques Generalistes Et Specialistes Sur Le Marche Ethno-CosmetiqueBinta BahPas encore d'évaluation
- Philosophie CultureDocument113 pagesPhilosophie Cultureroberto estradaPas encore d'évaluation
- Le déterminisme entre sciences et philosophie: Revue Matière premièreD'EverandLe déterminisme entre sciences et philosophie: Revue Matière premièrePas encore d'évaluation
- L'apologie de La Guerre Dans La Philosophie ContemporaineDocument30 pagesL'apologie de La Guerre Dans La Philosophie ContemporaineMichel Bourot100% (1)
- Qu'Est-ce Que Les Lumières - KantDocument5 pagesQu'Est-ce Que Les Lumières - KantTristanPas encore d'évaluation
- Jean-Louis Michon, Le Soufî Marocain Ahmad Ibn 'Ajïba Et Son MVrâj. Par VajdaDocument2 pagesJean-Louis Michon, Le Soufî Marocain Ahmad Ibn 'Ajïba Et Son MVrâj. Par VajdadrjacbonPas encore d'évaluation
- Passage Du Mythe À La Raison Et de La Def de La PhiloDocument6 pagesPassage Du Mythe À La Raison Et de La Def de La Philohyppolitesergot86100% (1)
- Bon Cours D'introduction Sur La Vérité en Philosophie - WikibooksDocument21 pagesBon Cours D'introduction Sur La Vérité en Philosophie - WikibooksAA BBPas encore d'évaluation
- Fichage Kant Pas À PasDocument25 pagesFichage Kant Pas À PasJulien SorelPas encore d'évaluation
- Critique de la raison pure d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandCritique de la raison pure d'Emmanuel Kant: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Emmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIADocument10 pagesEmmanuel Levinas - Altérité Et Transcendance - ACTU PHILOSOPHIAToxophilus TheLuckyPas encore d'évaluation
- Philosophie A GregDocument44 pagesPhilosophie A GregعبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- L'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSDocument8 pagesL'Idée Des Artistes Panofsky, Cassirer, Zuccaro Et La Théorie de L'art - TrotteinSAhmed Kabil100% (1)
- Stéphane Vibert: Imaginaire Et Culture - Castoriadis Lecteur de L'anthropologie SocialeDocument12 pagesStéphane Vibert: Imaginaire Et Culture - Castoriadis Lecteur de L'anthropologie SocialeDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Discours de La PhilosophieDocument163 pagesDiscours de La Philosophieazrak samawiPas encore d'évaluation
- Leçon 2Document4 pagesLeçon 2Aminata ThiamPas encore d'évaluation
- L'inutilité Du Cours de PhilosophieDocument15 pagesL'inutilité Du Cours de PhilosophieAnonymous 6N5Ew3Pas encore d'évaluation
- Bruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDocument11 pagesBruno Karsenti: La Transcendance de L'autonomieDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Knowledge by PresenceDocument143 pagesKnowledge by PresenceSahrian100% (1)
- Livret Agrégation Externe Philosophie 2012Document37 pagesLivret Agrégation Externe Philosophie 2012Lesabendio7Pas encore d'évaluation
- AristoteDocument4 pagesAristoteFrédéric DautremerPas encore d'évaluation
- Gaston Bachelard - L'Épistémologie Non-CartésienneDocument14 pagesGaston Bachelard - L'Épistémologie Non-CartésienneAlexyu RasqualPas encore d'évaluation
- Chrysippe À L'académieDocument21 pagesChrysippe À L'académieMaxime PorcoPas encore d'évaluation
- L'Utilité de La Philosophie-1Document4 pagesL'Utilité de La Philosophie-1diallohaliloullahPas encore d'évaluation
- Daniel Pimbé-Nietzsche (1997)Document80 pagesDaniel Pimbé-Nietzsche (1997)Florencia GaillourPas encore d'évaluation
- Lecon Introductive 2023Document8 pagesLecon Introductive 2023Zied AyadiPas encore d'évaluation
- Le Pakao Philo Pour Tous-1Document100 pagesLe Pakao Philo Pour Tous-1diarra gningPas encore d'évaluation
- Mémoire Sur La Philosophie de Leibniz - Foucher de CareilDocument698 pagesMémoire Sur La Philosophie de Leibniz - Foucher de CareilAlabernardesPas encore d'évaluation
- Russell Philosophie ExplicationDocument3 pagesRussell Philosophie ExplicationLadji Mamoudou KabaPas encore d'évaluation
- Karl PopperDocument9 pagesKarl PopperAliPas encore d'évaluation
- Nouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240gDocument278 pagesNouveaux Essais Sur L'entendement Humain (... ) Leibniz Gottfried Bpt6k5667240ggrão-de-bicoPas encore d'évaluation
- Chap 1 - L'héritage de La Pensée GrecqueDocument6 pagesChap 1 - L'héritage de La Pensée GrecqueLouis BergPas encore d'évaluation
- Le CriticismeDocument14 pagesLe Criticismedelanautakou38Pas encore d'évaluation
- Lire Le Coran Avec Paul Ricoeur-LibreDocument9 pagesLire Le Coran Avec Paul Ricoeur-Librepain666killerPas encore d'évaluation
- Garrigou Lagrange Le RéalismeDocument13 pagesGarrigou Lagrange Le RéalismePagilisPas encore d'évaluation
- Comte-Opuscules Philo SocialeDocument43 pagesComte-Opuscules Philo SocialeAnonymous 59RRzvPas encore d'évaluation
- PDF Nietzsche Blondel AuroreDocument77 pagesPDF Nietzsche Blondel AurorePerse OkuyanPas encore d'évaluation
- La Verité Fiche de RevisionDocument4 pagesLa Verité Fiche de RevisionTaghzoutiPas encore d'évaluation
- Yvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementDocument24 pagesYvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementALBERTO PAULO NETOPas encore d'évaluation
- Psychologie Religieuse Et ThéologieDocument21 pagesPsychologie Religieuse Et ThéologieDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Sophie Klimis: Quel Sujet, Quelle Démocratie, Quelle Commu-Nauté - Improvisation Libre Sur Trois Thèmes ClassiquesDocument20 pagesSophie Klimis: Quel Sujet, Quelle Démocratie, Quelle Commu-Nauté - Improvisation Libre Sur Trois Thèmes ClassiquesDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Philippe Urfalino: La Démocratie - Nécessaire Auto Limitation, Impossible Auto-InstitutionDocument13 pagesPhilippe Urfalino: La Démocratie - Nécessaire Auto Limitation, Impossible Auto-InstitutionDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Arnaud Tomès: Castoriadis Et La Critique de La RationalitéDocument8 pagesArnaud Tomès: Castoriadis Et La Critique de La RationalitéDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- François Bordes: Penser Le Labyrinthe - Archives, Démocratie Et CréationDocument8 pagesFrançois Bordes: Penser Le Labyrinthe - Archives, Démocratie Et CréationDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Frédéric Brahami: Castoriadis - Le Projet D'autonomie Comme Projet de VéritéDocument9 pagesFrédéric Brahami: Castoriadis - Le Projet D'autonomie Comme Projet de VéritéDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Gerassimos Stephanatos - D'Une Subjectivité Réfléchissante Toujours À Faire ÊtreDocument13 pagesGerassimos Stephanatos - D'Une Subjectivité Réfléchissante Toujours À Faire ÊtreDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Marcel Thiry. Postface Par Pascal Durand.Document27 pagesMarcel Thiry. Postface Par Pascal Durand.Davo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Florence Giust-Desprairies: Entre Psychè Et Social-Historique, Le Chainon Manquant de L'intersubjectivitéDocument12 pagesFlorence Giust-Desprairies: Entre Psychè Et Social-Historique, Le Chainon Manquant de L'intersubjectivitéDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Recherches Sur L'africa Vetus, Vol.2Document199 pagesRecherches Sur L'africa Vetus, Vol.2Davo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Vol4 No11 12 AyadDocument15 pagesVol4 No11 12 AyadLorenzo DíazPas encore d'évaluation
- Penser L'état. Rousseau Ou HegelDocument23 pagesPenser L'état. Rousseau Ou HegelDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- SartreDocument88 pagesSartreDavo Lo SchiavoPas encore d'évaluation
- Théorie Et Esthétiques de La MétaphoreDocument1 140 pagesThéorie Et Esthétiques de La MétaphoreDavo Lo Schiavo100% (1)
- LE MAITRE ET SON DISCIPLEDocument4 pagesLE MAITRE ET SON DISCIPLEceddobitvPas encore d'évaluation
- Docket Trim 4 2023 ModDocument5 pagesDocket Trim 4 2023 ModBoris Hristi BidiasPas encore d'évaluation
- 300 Maximes de Saints Orthodoxes PDFDocument56 pages300 Maximes de Saints Orthodoxes PDFJock Ewing100% (1)
- LA NEUVAINE A SAINT JOSEPH Du 11 Au 19 MarsDocument4 pagesLA NEUVAINE A SAINT JOSEPH Du 11 Au 19 MarsADJEPas encore d'évaluation
- RD2012 01Document24 pagesRD2012 01pakabore1Pas encore d'évaluation
- FR ManagementbyObjectivesDocument185 pagesFR ManagementbyObjectivesBeka AsraPas encore d'évaluation
- Table Des Articles 1-100Document64 pagesTable Des Articles 1-100Sacramentum hoc magnum estPas encore d'évaluation
- Fin Judaisme Terre D Islam Shmuel TriganoDocument32 pagesFin Judaisme Terre D Islam Shmuel TriganoOmar GhamidiPas encore d'évaluation
- LZTTTTZ: Li Tcononia (ÀirittoDocument23 pagesLZTTTTZ: Li Tcononia (ÀirittoFarouk HarazPas encore d'évaluation
- La médisance - الغيبة (sa définition, son jugement, sa gravité... ) - La science légiférée - العلم الشرعي - 1608904465885Document6 pagesLa médisance - الغيبة (sa définition, son jugement, sa gravité... ) - La science légiférée - العلم الشرعي - 1608904465885Idrissa KouyatéPas encore d'évaluation
- RORE Communique-2008-12-22 Couvert Angleterre Gnostique PDFDocument11 pagesRORE Communique-2008-12-22 Couvert Angleterre Gnostique PDFAngelo BandiniPas encore d'évaluation
- Alain Moloto Livre Louange Et Adoration PDFDocument2 pagesAlain Moloto Livre Louange Et Adoration PDFmarthetamallahPas encore d'évaluation
- Jophiel - 10 Décembre 2011Document7 pagesJophiel - 10 Décembre 2011Les TransformationsPas encore d'évaluation
- Alexander Alexakis. The Greek Patristic Testimonia Presented at The Council of Florence (1439) in Support of The Filioque Reconsidered. Revue Des Études Byzantines, Tome 58, 2000. Pp. 149-165.Document18 pagesAlexander Alexakis. The Greek Patristic Testimonia Presented at The Council of Florence (1439) in Support of The Filioque Reconsidered. Revue Des Études Byzantines, Tome 58, 2000. Pp. 149-165.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- D&D 4E - Livro Do Jogador - Biblioteca ÉlficaDocument319 pagesD&D 4E - Livro Do Jogador - Biblioteca ÉlficaSandro Felipe100% (2)
- Sartre, CORPUSDocument6 pagesSartre, CORPUSManuelGonzalezAnidoPas encore d'évaluation
- Devoir D'histoireDocument3 pagesDevoir D'histoireJulien SaouasPas encore d'évaluation
- 295 - Donner La Dîme de Ses Revenus À Son ÉgliseDocument5 pages295 - Donner La Dîme de Ses Revenus À Son Églisejose claudePas encore d'évaluation