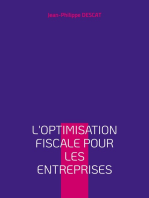Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Comptabilité Analytique Dans Les PME
Transféré par
sanaechakriTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Comptabilité Analytique Dans Les PME
Transféré par
sanaechakriDroits d'auteur :
Formats disponibles
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Ddicace
Dieu source de toute connaissance
la Dame du Royaume de mon cur ma tendre mre
mon grand seigneur, qui a toujours garni mes chemins de force et lumiremon
trs cher pre
mes frres et ma sur En leur souhaitant tout le succs et le bonheur du
monde
toute ma famille pour lamour et le respect quils mont toujours accord
tous mes amis Pour une sincrit si merveilleusejamais oubliable
toute personne Qui m'a aid franchir un horizon dans ma vie
Aimablement
Je ddie ce modeste travail
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Remerciement
La ralisation de ce travail naurait pas t possible sans la participation de certaines
personnes que je tiens remercier trs sincrement.
Je remercie :
Madame Majda ALAOUI, pour ses considrables conseils, ses pistes de recherche, et sa
disponibilit qui mont permis de raliser ce travail dans les meilleures conditions ;
Monsieur Mourad HAMESS le directeur financier de la socit HEB ainsi que ses
collaborateurs pour leur gentillesse, leur aide prcieuse et leur amabilit me consacrer
un peu de leur temps en dpit de leurs obligations tout au long de la priode de stage au
sein de la socit ;
cette tape de mon parcours, je dsire remercier galement tous ceux qui mont
accompagn dans ce parcours aussi bien le corps professoral que le corps administratif
de lcole Nationale de Commerce et de Gestion Oujda, et spcialement les professeurs
de loption Audit & Contrle de Gestion ;
Enfin, merci tous qui ont contribu de prs ou de loin la ralisation de ce modeste
travail.
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Sommaire
Ddicace ---------------------------------------------------------------------------------------------3
Remerciement--------------------------------------------------------------------------------------4
Sommaire--------------------------------------------------------------------------------------------5
Rsum -----------------------------------------------------------------------------------------------6
Liste des tableaux ---------------------------------------------------------------------------------7
Liste des figures ------------------------------------------------------------------------------------8
Liste des formules ---------------------------------------------------------------------------------9
Liste des abrviations --------------------------------------------------------------------------10
INTRODUCTION GENERALE -------------------------------------------------------------------11
PREMIERE PARTIE : Le cadre thorique ----------------------------------------------------14
Introduction de la premire partie ---------------------------------------------------------14
Chapitre I : La comptabilit analytique dans les PME -------------------------------------15
Section 1 : La ralit de la comptabilit analytique dans la PME ------------------------16
Section 2 : La comptabilit analytique, un outil de gestion optimale des cots ------28
Chapitre II : La problmatique dvaluation du cot de production--------------------33
Section 1 : Les mthodes classiques ----------------------------------------------------------34
Section 2 : Les nouvelles mthodes -----------------------------------------------------------40
Conclusion de la premire partie -----------------------------------------------------------44
SECONDE PARTIE : La conception dun systme de cot standard au sein
de lentit HEB
Introduction de la seconde partie ----------------------------------------------------------45
Chapitre I : Prise de connaissance externe et interne de HEB ----------------------46
Section 1 : Secteur du BTP : Chiffres cls, dfis et perspectives -------------------------46
Section 2 : Prsentation de Hamss des quipements publics et Btiments (HEB) ---53
Chapitre II : La conception du systme de comptabilit analytique au sein de HEB
Section 1 : le choix des mthodes --------------------------------------------------------------58
Section 2 : La formation du cot de revient --------------------------------------------------65
Conclusion de la seconde partie -------------------------------------------------------------87
Conclusion gnrale ----------------------------------------------------------------------------88
Table des matires -------------------------------------------------------------------------------90
Bibliographie --------------------------------------------------------------------------------------93
Annexes ---------------------------------------------------------------------------------------------94
5
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Rsum :
Abstract :
Face aux changements du march
et la croissance du secteur des
In order to adapt with market
btiments et travaux publics, les
changes
entreprises
doter
cobstruction and civil engineering
doutils de matrise de leur
sector, companies must develop
performance financire, afin de
management
garantir leur comptitivit sur le
financial performance in order to
long-terme. La maitrise de la
ensure their competitiveness in
performance se ralise par la
the long term. The mastery of
maitrise
performance is achieved through
doivent
des
se
cots.
Loutil
and
the
tools
growth
of
of
their
permettant la gestion des cots
cost
est la comptabilit analytique.
management is cost accounting.
Lutilisation de cet outil, ncessite
The use of this tool requires a
une conception fonde sur une
design based on a solid theoretical
base thorique solide, et renforc
foundation, and is strengthened
par des piliers de mthodes
by
ralisables dans la pratique. Le
memory discusses the details of a
prsent mmoire, traite les dtails
practical project of the full cost
dun
method by analysis centers.
projet
pratique
de
la
control.
pillars
of
The
tool
methods.
cost
This
mthode des cots complet par
les centres danalyses.
Mots-cls :
Comptabilit analytique, Cots,
Centre danalyse, Cot complet.
Keywords :
Cost accounting, Cost, Analysis
centre, full cost.
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Liste des tableaux
Tableau 1: La nuance entre la comptabilit gnrale et la comptabilit analytique ...................... 25
Tableau 2: Valeur ajoute aux prix de l'anne prcdente chains base 1998 .............................. 47
Tableau 3: Fiche d'identification de la socit .................................................................................. 53
Tableau 4: Chiffre d'affaire mensuel (moyen) ................................................................................... 55
Tableau 5: Les produits ....................................................................................................................... 56
Tableau 6: classification des centres danalyse de lHEB ...................................................................... 61
Tableau 7: Liste des charges corporables de HEB............................................................................. 68
Tableau 8: les charges de la comptabilit analytique ....................................................................... 71
Tableau 9: Tableau de la rpartition primaire .................................................................................. 72
Tableau 10: Tableau de rpartition secondaire ................................................................................ 75
Tableau 11: Cot d'achat de Ciment ................................................................................................... 77
Tableau 12: Cot d'achat de sable 04 ................................................................................................. 77
Tableau 13: Cot d'achat de sable lav .............................................................................................. 78
Tableau 14: Cot d'achat de Gravette G1 ........................................................................................... 78
Tableau 15: Cot d'achat de Gravette G2 ........................................................................................... 78
Tableau 16: Cot d'achat de Gravette 6/10 ....................................................................................... 78
Tableau 17: Cot d'achat de Grain de riz ........................................................................................... 79
Tableau 18: Cot d'achat de l'adjuvant .............................................................................................. 79
Tableau 19: Fiche de stock des matires premires CMUP (fin de priode) .................................. 80
Tableau 20: Cot de production du bton ............................................................................................................ 81
Tableau 21:Cot de production de l'Agglos ......................................................................................................... 81
Tableau 22: Fiche de stock des produits finis ................................................................................... 83
Tableau 23: Cot de revient de bton ................................................................................................ 84
Tableau 24: Cot de revient de l'Agglos ............................................................................................. 84
Tableau 25: Rsultat analytique de bton ......................................................................................... 85
Tableau 26: Rsultat analytique de l'Agglos ...................................................................................... 85
Tableau 27: Analyses des rsultats .................................................................................................... 85
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Liste des figures
Figure 1: Classification des charges de la CA selon l'objet de cot. ................................................. 15
Figure 2 : Lobjectif de la comptabilit analytique ............................................................................ 21
Figure 3: Caractristiques de cot ...................................................................................................... 22
Figure 4: la comptabilit gnrale est un outil d'information externe ............................................ 26
Figure 5 : Processus de la dcision ..................................................................................................... 30
Figure 6 : Processus de contrle de gestion ...................................................................................... 31
Figure 7: La rpartition des charges .................................................................................................. 35
Figure 8: Cot partiel ..................................................................................................................................................... 37
Figure 9: les IDE reus par le secteur du BTP.................................................................................... 48
Figure 10: l'attractivit des IDE par secteur ...................................................................................... 48
Figure 11: Emploi par branche d'activit de la population active occupe au niveau national :
trimestriel............................................................................................................................................. 49
Figure 12 : Composition du groupe HEB............................................................................................ 54
Figure 13: Le processus d'exploitation de HEB ................................................................................. 55
Figure 14: Lorganisation des centre de lHEB .................................................................................. 64
Figure 15: La dtermination des charges de la comptabilit analytique. ....................................... 66
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Liste des quations
quation 1: Formule de CUO ...................................................................................................................................... 35
quation 2: Formule du taux de frais ..................................................................................................................... 35
quation 3: Coefficient d'imputation rationnelle .............................................................................................. 38
quation 4: Cot d'imputation rationnelle ........................................................................................................... 38
quation 5: Diffrence d'imputation....................................................................................................................... 38
quation 6: Formule de cot cible ........................................................................................................................... 42
quation 7: quation des charges de la CA .......................................................................................................... 70
quation 8: quation du rsultat de la CA ............................................................................................................ 70
quation 9: Cot d'achat .............................................................................................................................................. 77
quation 10: Formule de calcul du cot de production .................................................................................. 80
quation 11: Formule de calcul du cot de revient .......................................................................................... 83
quation 12: Formule de calcul du rsultat analytique .................................................................... 84
quation 13: Formule de calcul du rsultat global de l'entreprise .................................................. 85
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Liste des abrviations
BTP : Btiments et travaux publics
CA : Cot dachat
CAE : Comptabilit analytique dexploitation
CG : Contrle de gestion
CGe : Comptabilit gnrale
CMUP : Cot moyen unitaire pondr
Coef. IR. : Coefficient dimputation rationnelle
CP : Cot de production
CR : Cot de revient
CUO : Cot dunit duvre
HEB : Hamss des quipements publics et btiments
IR : Imputation rationnelle
MOD : Main duvre directe
RA : Rsultat analytique
10
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Introduction gnrale
Le secteur des btiments et travaux publics marocain a connu, durant les dernires
annes, une dynamique effervescente aprs une priode de stagnation prolonge, due
principalement la mfiance des investisseurs vis--vis de lconomie interne, ainsi les
incidences de la crise mondiale de 2008.
En parallle, les pouvoirs publics ont amorc le renouvellement du cadre juridique
du secteur, mis au point un systme de libralisation de la construction afin de garantir la
qualit et la scurit des logements, et, enfin, adopt de nombreuses mesures incitatives
favorisant lactivit des promoteurs immobiliers.
Il est donc clair que lenvironnement des entreprises oprant dans le secteur des
btiments et travaux publics (BTP) est caractris par une concurrence accrue, des clients
exigeants et une rglementation renforce. Ceci impose des contraintes de ralisation de
la performance conomique et de loptimisation de la gestion comptable et financire.
Devant ces impratifs, les entreprises doivent se doter doutils de calcul des cots
et danalyse des rsultats efficients. Do lintrt de mettre en place une comptabilit
analytique au sein des organisations. En effet, cette dernire constitue, pour le
gestionnaire, un instrument privilgi pour connatre les conditions de fonctionnement
de son entreprise, matriser les cots et, ainsi, prparer les dcisions.
De ce fait, limplantation dune comptabilit analytique au sein de la socit HEB
Taza est primordiale si lon veut garantir la comptitivit de lentreprise et assurer sa
prennit sur le long terme. Cependant, sa mise en place sur terrain ncessite des bases
thoriques solides, prenant en considration les enjeux du secteur dactivit, de la taille
dentreprise et de son organisation interne.
Partant de ce constat, la problmatique de notre projet de fin dtude traitera la
mise en place dune comptabilit analytique au sein de HAB et son impact sur la
performance globale de la PME. cette problmatique surgissent de nombreuses
questions :
11
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Quel est lintrt pour lentreprise dinstaurer un systme de comptabilit
analytique ?
Quelle mthode de calcul des cots privilgie ?
Quelles sont les tapes de sa conception ?
Quel est son apport aux gestionnaires de lentreprise ?
Dans le but de rpondre ces questions, nous aborderons dans une premire
partie le cadre thorique de la comptabilit analytique dans le contexte des PME. Nous
parlerons, donc, succinctement de la structure et caractristiques des PME et la ncessit
dun outil de gestion adquat la prise des dcisions efficaces. Ainsi que les diffrentes
mthodes conues pour sa mise en uvre.
Ensuite, nous concrtiserons le processus de mise en uvre dune comptabilit
analytique sur terrain dans une deuxime partie. Dans ce cadre, nous expliciterons les
enjeux de choix de la mthode adopter, fixerons les objectifs qui lui sont assigns et
prsenterons son fonctionnement, cest--dire les modalits de calcul des cots, de
dtermination des marges et danalyse des rsultats en dtail.
12
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Schma illustratif de la problmatique de travail
Intrt managrial
Intrt thorique
-
Limportance dinstauration
dun systme permettant le
calcul de cot, afin de
pratiquer une politique de prix
efficace, ainsi ladquation des
objectifs avec les moyens
- La
gestion
intuitive
de
lentreprise, reprsente une
perte importante en termes de
marge de gain dans certains
produits.
Problmatique
Quel impact dun systme de comptabilit analytique sur la
performance globale de la PME ?
Prcise : linstauration dun systme de comptabilit analytique et son
impact sur la performance de lentreprise.
Originale : lentreprise ne dispose pas dune comptabilit analytique, ni
dun service de contrle de gestion ou de calcul de cot
Pertinente : sur le plan thorique : traitement dune thmatique concrte
Sur le plan managrial : concevoir un systme de calcul de cot, permet
de rationaliser la gestion, et rentabiliser les dcisions prises par les dirigeants.
Littrature post-question de
recherche
- La gestion des PME : les particularits
de la gestion des PME ;
- Le lien avec la problmatique consiste
concevoir un systme de calcul de
cot adapt ces particularits, afin
doptimiser la gestion.
Design mthodologique
Approche de terrain :
- Mthode mobilise : rechercheintervention ;
Approche rsultat : Outils danalyse :
-
tude qualitative (entretiens indivi.)
Ouverture : comment optimiser la maitrise du cot
des produits tout en respectant les exigences de
lenvironnement ?
13
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Premire partie :
Le cadre theorique de la
comptabilite analytique
Le mode de la gestion de lentreprise est llment
dterminant de la performance globale de lentreprise, dans un
march assez ouvert.
Pour atteindre la performance exige par les dtenteurs
des capitaux, faire face une concurrence sauvage , ainsi
satisfaire les exigences du roi du march le client , il faut
dtenir des modes et outils de gestion optimale.
La performance financire ce mesure par la rentabilit
des capitaux, cette rentabilit se gnre par des marges de
bnfice des produits de lentreprise. Afin daccroitre ces
marges, il faut maitriser les cots puisque le prix gnralement
est impos soit par le march soit par des rglementations.
Dans cet objectif, nous allons chercher un outil de
management performant, permettant doptimiser la gestion de
lentreprise HEB, afin datteindre sa performance financire.
Pour cela, nous allons dans un premier chapitre, discuter
limportance de la comptabilit analytique dans loptimisation
de la gestion. Dans le deuxime chapitre nous allons traiter la
problmatique de la mthode dvaluation du cot de revient.
14
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Chapitre I : La comptabilit analytique dans les PME
La PME correspond une entreprise dont leffectif permanent ne dpasse pas 200
personnes et qui a ralis, au cours des deux derniers exercices, soit un chiffre d'affaires
annuel hors taxes n'excdant pas 75 M.MAD, soit un total de bilan annuel n'excdant pas
50 M.MAD 1. Selon la charte de la PME.
Toutes les sources dinformations statistiques confirment la suprmatie de la PME
dans le tissu productif national avec un pourcentage qui dpasse 99%.
Figure 1: Le poids des PME dans l'conomie nationale
Source : http://www.emergence.gov.ma/
L'analyse du comportement managrial des PME marocaines s'explique
essentiellement par le statut des dirigeants. Certains entrepreneurs se dcident de crer
des entreprises parce qu'ils ont un excdent de capitaux, d'autre deviennent crateurs
hritiers. Dans les deux cas, il est difficile de dire qu'ils ont un esprit dentrepreneur ou
des risquophiles.
Le propritaire dirige, gre, et participe la production. Cette participation voque
le non sparation de la proprit et du contrle ; c'est--dire, d'une part, la russite de la
1
Dahir no 1-02-188 du 12 Joumada I 1423 (23 juillet 2002) portant promulgation de la loi n o 53-00 formant
charte de la petite et moyenne entreprise.
15
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
croissance de leur entreprise se trouve confronte aux risques de perte de contrle et de
difficults financires et d'autre part le problme de la croissance et de l'indpendance
financire se prsente eux comme un enjeu permanent multiple.
Ce comportement des investisseurs, ainsi la gestion hasardeuse ne vont pas sans
effets ngatifs sur l'activit et la performance de l'entreprise.
Section 1 : La ralit du contrle de gestion dans les PME :
Il apparat clairement que les managers ambitieux disposent de donnes
comptables plus diverses, plus dtailles et labores plus frquemment que les
conservateurs anciens2. Laffirmation de Philippe Chapellier dcrit la ralit du tissu
conomique marocain : une catgorie minoritaire des entreprises, (ayant des managers
ambitieux), disposent des outils de gestion et pilotage les plus modernes et performants.
Lautre catgorie majeure reprsente par les PME et PMI, ne dispose que des pratiques
traditionnelles caractrises par un mode de gestion alatoire fonde sur lexprience.
I-
Lintrt du contrle de gestion dans les PME :
1- La PME, une entreprise traditionnelle :
En PME, le savoir partage par les acteurs repose sur des notions dintuitivit3
Bollecker et Naro expliquent la gestion intuitive des PME par tout dans le monde, par une
absence dinstrumentation fonctionnelle.
Cette absence se compense par le sens dinitiative et la dominance de leffet
dexprience dans le processus de prise de dcision. Par ailleurs, les routines, rponses
comportementales issues du rfrentiel cognitif, apparaissent comme un mcanisme de
coordination et de capitalisation des connaissances oprationnelles (Guilhon et Huard)4.
Philippe Chapellier , Profils de dirigeants et donnes comptables de gestion en PME Revue internationale
P.M.E. : conomie et gestion de la petite et moyenne entreprise, vol. 10, n 1, 1997, p. 9- 41.
3
Marc BOLLECKER et G. NARO, Le contrle de gestion aujourdhui : Dbats, controverses et perspectives,
dition VIBERT, Octobre 2014
4
GUILHON Bernard, HUARD Pierre, ORILLARD Magali, ZIMMERMANN Jean-Benot (eds), Economie de la
connaissance et organisations : Entreprises, Territoires, Rseaux, 1997.
16
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Cette gestion fonde sur lintuition et leffet dexprience est lun des lments
explicatifs du taux de mortalit lev des PME (une entreprise sur quatre cre en 1988
tait toujours en activit en 20035). Labsence dun lien logique entre les finalits traces
et les objectifs oprationnels, ainsi les outils mis en uvre pour la ralisation de ces
objectifs, sont les facteurs principaux de cette mortalit leve.
Le contrle de gestion, une solution alternative :
Le contrle de gestion a pour objectif dun ct, de sassurer quil y ait concordance
entre les stratgies dfinies et les performances ralises. De lautre ct, il permet de
contrler, matriser, mesurer et analyser tous les aspects inhrents lactivit de
lentreprise.
Les objectifs sont fixs au niveau stratgique, les rsultats sont gnrs au stade
oprationnel. Dans ce sens, le contrle de gestion doit tre linterface de liaison entre les
services oprationnels et les services fonctionnels dune part, et entre ces deux services
et ladministration gnrale (propritaires de fonds gnralement dans le cas des PME).
Cette interface se manifeste travers plusieurs outils de gestion et de pilotage, savoir :
les tableaux de bord, les systmes de cots, la budgtisation
En somme, il est primordial pour une PME, davoir au moins, une comptabilit
analytique, permettant le calcul des cots gnrs par la fabrication des
produits/services. Laspect facultatif de la comptabilit analytique du point de vue
juridique, a devenu obligatoire dune vision conomique oriente rsultat.
LECONOMISTE, Une enqute sur la mortalit des entreprise , Edition no 2835 du 06/08/2008,
www.leconomiste.com
17
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
2- Existe-il vraiment un contrle de gestion aux PME :
2-1- Le contrle organisationnel :
Le contrle de gestion en PME apparait sous une forme particulire. Il est dilue
dans le contrle organisationnel6. Les entreprises qui suivent la tendance managriale,
ont intgr le service de contrle de gestion, mais il reste limit dans laspect
organisationnel, travers les outils basiques de gestion : budgtisation, la comptabilit
analytique de gestion, lanalyse du compte de rsultat Elles nont pas arriv encore un
vritable systme de pilotage et de suivi de la performance globale de lentreprise.
2-2-
Le contrle de gestion, fonction inadapte aux caractristiques des
PME :
Le caractre marquant de la prise de dcision dans de la PME, est la concentration
une seule personne, propritaire dirigeant. Et dans la majorit des cas, un caractre
familial. Ces deux caractres influencent les modes de gestion.
Ce qui rend les choses loin du cadre du contrle de gestion, qui se caractrise par
la rigueur, lefficacit, lefficience... La rigueur et la crativit ne peuvent cohabiter que
trs difficilement (Berland et Persiaux, 2008). Mintzberg (1982). La rigueur du contrle
de gestion ne pourra pas sadapter la crativit de lentrepreneur centre de lentreprise.
Le contrle de gestion entant que systme de pilotage de la performance est peu
dvelopp dans les PME. Il est limit dans la formation des comptes (cots et rsultats), il
naccomplit pas sa vritable fonction de contrle de la dlgation des responsabilits. Il
est gnralement intgr la demande des parties prenantes, pour rpondre des
exigences de scurit et dassurance des intrts de ces derniers.
Le dveloppement du contrle de gestion commence ds que lentreprise dpasse
les frontires de la catgorie PME (250 salaris permanents par exemple), et entre dans
la catgorie des ETI (entreprises de taille intermdiaire). cette phase, les dirigeants se
trouvent obligs de dlguer les responsabilits aux managers de chaque service.
Marc BOLLECKER et G. NARO, Le contrle de gestion aujourdhui : Dbats, controverses et perspectives,
dition VIBERT, Octobre 2014.
18
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
II-
La comptabilit analytique, loutil dominant dans les PME :
Figure 2: Classification des charges de la CA selon l'objet de cot.
Charge 1
Produit 1
Charge 2
Comptabilit
analytique
Produit 2
Produit 3
Charge n
Source : labor par nos soins
Les cots que lon dtermine dpendent des choix qui ont t fait pour les calculer.
Le principal enjeu pour le dcideur sera de choisir loutil le plus appropri au problme
qui lui est pos. Ainsi donc, il est possible de se reprsenter la comptabilit de gestion
comme une bote outils, constituant autant dinstruments mobilisables dans une prise
de dcision.
Cependant, pour utiliser bon connaissance ces outils, certains concepts doivent
tre matriss. La comptabilit analytique est dabord un langage que nous allons
examiner dans ce chapitre en essayant, non seulement de dfinir les termes, mais
danalyser les prsupposs quils recouvrent et les volutions quils ont connues.
1- Historique :
Il ne sagit pas dassimiler la naissance dun phnomne sa premire
apparition 7 Marc NIKITIN.
La connaissance des cots est, depuis le dbut de la rvolution industrielle, un
impratif de base de la prise de dcision. La notion de comptabilit industrielle vue le jour
7
Marc NIKITIN, la naissance de la comptabilit industrielle en France , Thse de doctorat, Universit de Paris
DAUPHINE- 1992
19
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
trs tt, par la mise en place des systmes de calcul aptes faciliter la gestion. Les
historiens recensent ainsi des systmes prcurseurs de comptabilit industrielle ds la fin
du XVIIe sicle en Grande Bretagne (notamment dans les forges et fonderies de la rgion
de Sheffield). En France une doctrine apparat partir des annes 1860 et on situe en
1885 lapparition du premier manuel.
Appele au dbut comptabilit industrielle puis comptabilit analytique
dexploitation, elle dsigne lensemble des lments du systme comptable considrs du
point de vue de lintrt quils prsentent pour la gestion interne.
Mme si les grands principes n'ont pas t changs, la comptabilit a d s'adapter
aux exigences conomiques modernes. Le dveloppement des mthodes de gestion et
l'apparition d'un nouveau service dans l'organisation des entreprises appel contrle
de gestion ont contribu au dveloppement de la comptabilit analytique.
La comptabilit analytique s'articule non plus autour des comptes comptables
classiques, ceux du plan comptable gnral, mais autour de codes daffaires spcifique
chaque entreprise traduisant leurs caractristiques organisationnelles. Nanmoins, la
tenue d'une comptabilit classique reste ncessaire pour rpondre aux questions fiscales.
2- Dfinition de la comptabilit analytique :
La comptabilit analytique est un outil daide la dcision utilis par les
contrleurs de gestion dans le souci de matrise des cots. Dans ce sens, elle permet de
recenser, calculer et analyser les donnes relatives aux cots8 . C. Riveline.
Elle associe chaque produit ses propres cots directs et indirects, quils aient t
encourus dans lexercice ou dans des priodes prcdentes. Elle divise les rsultats par
centre de dcision (centre de responsabilit ou encore centre danalyse) permettant un
meilleur pilotage, ou les consolide par ligne dactivit, afin de mieux en apprcier la
situation. Elle est parfois associe dautres techniques de gestion comme la gestion
budgtaire ou la gestion par les objectifs, qui elle fournit les lments de comparaison.
C. Riveline, cours d'valuation des cots, l'Ecole des mines de Paris. 2005
20
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 3 : Lobjectif de la comptabilit analytique
Politique de prix
Cot dachat
cot de production
cot de revient
prix de vente
Analyse des carts
Fixation des objectifs
Ralisation
Comptabilit analytique
Source : labor par nos soins.
Du fait de sa complexit et des cots de mise en uvre, la comptabilit analytique
sest gnralise avec lapparition de linformatique et des ERP qui ont fortement abaiss
le cot de la collecte et du traitement dune information dtaille. Elle concerne dsormais
toutes les formes et toutes les tailles dentreprises, dont elle est un des lments clefs
du systme dinformation.
La comptabilit analytique est un outil dinformation indispensable au contrle de
gestion, c'est--dire il nest pas possible de faire fonctionner de faon efficace le contrle
de gestion dans une organisation selle ne dispose pas dune comptabilit analytique pour
la dtermination des cots, afin de tracer les bons dcisions et plans daction permettant
datteindre la performance globale de lentreprise.
2-1-
Objet de cot :
Un cot est dfini comme tant la somme des charges directes ou indirectes relatives
un lment dfini au sein du processus comptable. La dtermination des cots calculer
21
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
se fait en fonction des activits de lentreprise, de sa structure, de ses objectifs de gestion
et de son pilotage9.
Gnralement un cot se caractrise par trois aspects :
Figure 4: Caractristiques de cot
Source : Ouvrage DCG 11 contrle de gestion, Edition DUNOD, Claude ALAZARD et Sabine SEPARI, P : 47.
a. Champ dapplication :
Le champ dapplication de cot varie selon la vision et laspect organisationnel de
lentreprise :
Fonction conomique : nous distinguons plusieurs types de cot selon les
processus de lentreprise (Administration, production, distribution)
P. MELEVELLEC Les systmes de cots : Objectifs, paramtre de conception et analyse
compare, Broch 4 octobre 2005
9
22
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Moyen dexploitation : nous pouvons calculer le cot dune machine, dun poste
de travail, dun rayon
Activit dexploitation : selon lactivit de lentreprise, nous calculons le cot
(cot des marchandises vendues, cots des produits fabriqus)
Responsabilit : cest une division de lentreprise en des sous-ensembles ou
sections dites homognes auxquelles nous affectons la responsabilit.
b- Moment de calcul10 :
La classification selon le moment de calcul nous prsente deux catgories de cots :
Cot historique : dit aussi cot rel ou cot constat, cest un cot calcul aprs
sa ralisation effective, c'est--dire un cot calcul posteriori. Dans ce cas lentreprise
sengage dans une logique de feed-back, ou une logique ractive, c'est--dire la raction
suit laction (laction est le cot engendr).
Cot prtabli : cest un cot bas sur les prvisions statistiques et des
projections des donnes historiques et des tendances de lactivit.
c- Contenu :
En contrle de gestion, le calcul du cot peut tre soit, en incorporant lensemble des
charges enregistres au niveau de la comptabilit gnrale, soit par lincorporation dune
partie des charges.
2-2-
Types de cot11 :
En fonction de traitement des charges de la comptabilit gnrale avant le calcul du
cot, nous distinguons :
10
Claude ALAZARD et Sabine SEPARI, Ouvrage DCG 11 contrle de gestion, Edition DUNOD, 3eme dition,
2013.
11 Claude ALAZARD et Sabine SEPARI, Ouvrage DCG 11 contrle de gestion, Edition DUNOD, 3eme dition,
2013.
23
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
a- Cot complet :
Ce cot intgre la totalit des charges relatives lobjet du calcul de cot (produit,
activit, poste de travail ), il en existe deux catgories :
les cots complets traditionnels :
Le calcul du cot suite cette dmarche consiste incorporer la totalit des
charges enregistres dans le compte des produits et charges CPC de la comptabilit
gnrale. Comme son nom lindique traditionnel cette mthode a t adopte aux
premires annes de dveloppement des systmes de calcul du cot.
les cots complets conomiques :
Lapplication du cot complet conomique exige un traitement pralable des
charges de la comptabilit gnrale, dans le but de ventiler les charges lies lobjet de
cot, afin de reflter une fiabilit conomique du cot.
b- Cot partiel :
Ce cot loppos du cot complet, est obtenu par lincorporation dune partie des
charges en fonction du cas tudi.
On distingue deux sortes de cots partiels.
Les cots variables :
Sont des cots intgrant seulement les charges qui varient en fonction du volume
dactivit de lentreprise sans quil y ait ncessairement une exacte proportionnalit entre
la variation des charges et celle du volume de production.
Par exemple : achat des matires premire, main duvre,
La ventilation des charges de la comptabilit gnrale dans ce cas se fait en
liminant les charges caractre fixe.
24
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Les cots directs :
Sont des cots lis directement lobjet de calcul, on carte dans ce cas lensemble
des charges indirectes.
3- La diffrence entre la comptabilit analytique et la comptabilit
financire 12:
Lentreprise est une entit conomique parmi dautres en interaction permanente,
cette interaction formalise par lenregistrement de la comptabilit gnrale dite
financire. Cette comptabilit a t complte par lapparition de la comptabilit
analytique. La premire est un outil dinformation financire et juridique, obligatoire par
la loi. Par contre la deuxime est un outil facultatif danalyse et de contrle permettant la
prise des bonnes dcisions.
Tableau 1: La nuance entre la comptabilit gnrale et la comptabilit analytique
Vision lgale
Vision
Comptabilit gnrale
Comptabilit analytique
Obligatoire
Facultative
de Globale
Dtaille
lentreprise
Horizon
Pass
Prsent et futur
Nature des flux
Externe
Interne
Documents de base
Externe
Interne & externe
Classement
des Par nature
Par destination
charges
Objectif
Financier
conomique
12 Anthony, Les diffrences entre comptabilit analytique et comptabilit gnrale , Reporting
Business, http://www.reportingbusiness.fr/
25
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Rgles
Imposes
Souples et volutives
Utilisateur
Tiers et direction
Tous les responsables
Nature
des Prcises & certifies
Rapides & pertinentes
informations
Source : Cours de la comptabilit de gestion, S4, Mme H. Benjana, ENCGO (adapt)
3-1- La comptabilit gnrale est un outil de mesure financire13 :
La comptabilit gnrale est un outil dinformation destin lenvironnement de
lentreprise. Il ncessite donc un langage commun pour unifier les informations
financires en circulation entre les diffrentes parties concernes.
Figure 5: la comptabilit gnrale est un outil d'information externe
Client
Banque
E/se
tat
CNSS
F/sr
Source : labor par nos soins.
13
Thierry JACQUOT & Richard MILKOFF, Comptabilit de gestion Analyse et maitrise des cots , dition
Pearson, 2011, p. 55.
26
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Cette cohrence des informations de la comptabilit gnrale est assure par les
dispositifs du plan comptable (PC), ainsi le code gnral de la normalisation comptable
(CGNC) au niveau national, et par les normes internationales IAS/IFRS.
3-2-
La comptabilit analytique est un outil de prise de dcision14 :
La comptabilit analytique ne porte pas le caractre lgal, elle est donc un choix de
la direction gnrale de lentreprise, afin damliorer sa performance travers une prise
des bonnes dcisions au bon moment dans les bonnes conditions.
Lobjectif essentiel de la comptabilit analytique est la dtermination des
diffrents cots (le cot dachat, le cot de production et le cot de revient), dans le but
de les maitriser et amliorer le profit par produit/service ou activit.
14
Thierry JACQUOT & Richard MILKOFF, Comptabilit de gestion Analyse et maitrise des cots , dition
Pearson, 2011, p. 55.
27
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 2 : La comptabilit analytique, un outil de gestion optimale des cots15
Dans un objectifs damliorer sa gestion et renforcer la performance financire,
linstauration dun systme de comptabilit analytique, sinscrit dans une logique de :
Dcortiquer le rsultat de lentreprise :
Le rsultat de la comptabilit gnrale reflte le profit global ralis au cours dun
exercice complet (gnralement 12 mois), par contre la comptabilit analytique
dcortique ce rsultat global, en des rsultats analytiques pour chaque produit / service
ou activit, ainsi la priode de calcul est courte.
Dceler les centres gnrateurs de profit :
La comptabilit analytique cherche dtecter les centre gnrateurs de profit afin
de les renforcer et ceux gnrateurs des pertes (ou des profits faibles) pour les corriger.
Mesurer le retour sur investissement :
Lvaluation de la performance financire ainsi que la rentabilit des activits,
permet lentreprise de mesurer le retour de ses investissements.
Tracer la stratgie de lentreprise face la concurrence ;
La comptabilit analytique est un outil de prvision permettant de tracer la carte
de route de lentreprise et fixer ses objectifs cout comme long terme. Ainsi la
comptabilit analytique est un outil de calcul et de maitrise des cots, afin de faire face
la concurrence.
I- Objectif de la comptabilit analytique
La comptabilit analytique est un mode de traitement de l'information comptable
et conomique dont lobjet essentiel est de permettre aux entreprises travers une
analyse approprie des charges, la dtermination du cot des biens et services offerts par
l'entreprise. Ce premier objectif, permet gnralement de rpondre aux besoins de
15
Thierry JACQUOT & Richard MILKOFF, Comptabilit de gestion Analyse et maitrise des cots , dition
Pearson, 2011, p. 57
28
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
gestion des entreprises et de surveiller l'volution des cots de revient afin dagir sur les
prix de vente en cas d'augmentation des cots de manire prserver le bnfice.
La comptabilit analytique permet de remplir dautres missions notamment
d'valuer certains postes du bilan (exemple : les stocks de produits fabriqus),
d'apprcier la rentabilit des centres d'activits (ateliers, services,...), comme elle permet
de disposer d'une base solide pour la ngociation des subventions lies certains produits
ou activits d'intrt public, et enfin elle sert comme outil de contrle de gestion.
En outre la comptabilit analytique est en mesure de fournir aux diffrents
responsables des informations de gestion leur permettant de mieux piloter leur unit
ainsi que de faciliter le contrle et la coordination des activits. Cette comptabilit permet
galement d'clairer les choix budgtaires dans les domaines dinvestissement et
dexploitation.
Dans le domaine de linvestissement, le cot du bien ou du service que l'on
envisage raliser peut tre retenu comme critre de slection entre plusieurs projets.
Pour ce qui est du domaine de lexploitation, une analyse pousse des cots, permet
d'accder certaines informations (cot marginal, seuil de rentabilit) qui peuvent
clairer les niveaux dactivit susceptibles dtre retenus.
En rsum, l'intrt d'une comptabilit analytique rside dans la possibilit pour
l'entreprise16 :
De connatre et de matriser le cot des produits raliss et des services
fournis ;
De dterminer les rsultats et marges par produit, activit, client ou secteur
gographique ;
De prendre de bonnes dcisions et d'orienter la planification de l'activit ;
16
Thierry JACQUOT & Richard MILKOFF, Comptabilit de gestion Analyse et maitrise des cots , dition
Pearson, 2011, p. 56
29
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
De fournir des paramtres de contrle des cots et la gestion des centres
d'activit.
II- La comptabilit analytique au service du contrle de gestion
La comptabilit analytique joue une place centrale dans le processus de gestion de
lentreprise, au niveau de la phase contrle .
Grer une entit conomique, cest utiliser au mieux les ressources rares
disponibles afin datteindre les objectifs fixs. Dans une entreprise, lobjectif de
rentabilit, bien que ntant pas le seul, est souvent privilgie.
Pour atteindre ces objectifs, il faut prendre des dcisions, et veiller ce que la mise
en uvre de ces dcisions donne les rsultats escompts, en cas dcart, la raction par
des actions correctives. Ce que nous pouvons reprsenter par la figure suivante :
Figure 6 : Processus de la dcision
Prvision
Evaluation
et analyse
des carts
Adaptation
des
moyens
Objectif
Dcision
Rsultat
Action
Mise en
oeuvre
Source : labor par nos soins.
Dans la pratique, les rsultats ont toujours la mauvaise tendance diverger par
rapport aux objectifs, tout simplement parce que lentreprise doit affronter un
environnement, cest--dire un ensemble dautres agents socioconomiques qui ont les
mmes objectifs. Bien videmment, on essaie danticiper les dcisions de ces agents (les
30
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
concurrentes par exemple) en tablissant des prvisions qui se traduisent par des
budgets. Or, il est ncessaire, si lon veut garder la matrise de la situation, de mettre en
place un systme de contrle permettant de dclencher une alerte, quand des carts
importants apparaissent entre prvisions et ralisations, afin de prendre les dcisions
correctrices qui simposent, selon le schma suivant :
Figure 7 : Processus de contrle de gestion
Prvisions
Objectifs
Dcisions
Source : labor par nos soins.
Environnement
Actions
Rsultats
Actions
correctives/
prventives
Ce mcanisme est dit un mcanisme de feed-back . Concrtement, il suppose la
mise en uvre dun systme de contrle budgtaire, reposant sur les procdures
suivante :
tablissement de prvision budgtaire ;
Calcul priodique des cots et des rsultats ;
Calcul et analyse des carts entre prvisions et ralisations.
Grce un tel systme, nous pouvons garder la matrise des cots, et viter les
chutes par rapport au budget fix.
On voit que la connaissance des cots, grce la comptabilit analytique,
permettra dintroduire en gestion un aspect normatif, cest--dire la possibilit de
31
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
comparer la ralit une norme, de comparer les cots rels des cots prvisionnels,
encore dnomms cots prtablis ou standard .
La comparaison priodique des cots rels aux cots prvus permettra danalyser
des carts budgtaires et dinduire des dcisions correctrices. Lun des objectifs de la
comptabilit analytique est de fournir dans le cadre de ce systme les informations
comptables ncessaires au contrle budgtaire. Dans cette optique, nous pouvons
considrer la comptabilit analytique comme lun des instruments du contrle de gestion.
La gravit de la concurrence, ainsi les changements
de lenvironnement conomique, rendent la comptabilit
analytique indispensable pour loptimisation de la gestion
de lentreprise dans sa version moderne.
Cette discipline, facultative, se caractrise par une
diversit des mthodes et pratiques. Ce qui pose problme
aux entreprises qui veulent linstaurer.
Pour rsoudre cette problmatique, nous allons
prsenter une tude critique des mthodes les plus
utilises, afin de dlimiter le champ de travail, et choisir la
mthode la plus adapte notre cas dtude.
32
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Chapitre II : La problmatique dvaluation du cot de revient
Lconomie mondiale nos jours se caractrise par louverture du march
international aux entreprises de services et manufacturires grce aux progrs
techniques et technologiques dans plusieurs domaines, ainsi quune dlimitation ou
encore une annulation des barrires aux changes commerciaux.
Cette ouverture aux nouveaux marchs permet une baisse des cots des matires
premires et par consquence des produits finis moins couteux, et une croissance du
chiffre daffaires. Cependant, la concurrence est acharne ou sauvage . Afin de bien se
positionner et faire face aux risques du march et de la concurrence, les entreprises ont
besoin de systmes dinformation comptable capable de leur fournir des donnes
rcentes et fiables sur les produits, les cots, les marges bnficiaires et les tendances en
matire de consommation.
Linformation sur les cots de production et le cot de revient donnera aux
gestionnaires une vision claire pour la prise des dcisions. De plus, ces donnes pourront
tre une source de rectification en cas dcart entre les prvisions et les ralisations, afin
damliorer la rentabilit, et optimiser le travail du service de contrle des cots.
Pour rpondre cette exigence dinstauration dun systme de comptabilit
analytique, afin doptimiser la gestion des cots, lentreprise se trouve devant une
problmatique plus complexe : quelle mthode de calcul de cot ?
Dans ce chapitre nous allons essayer de traiter les mthodes de cot les plus
utilises, pour ensuite, slectionner celle la plus adapte aux particularits de notre entreprise,
et son secteur dactivit. Dans ce sens, ce chapitre sera dcompos en deux sections, dans la
premire nous allons traiter les mthodes classiques du cot, et le deuxime sera consacr aux
mthodes modernes.
33
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 1 : Les mthodes classiques
I. La mthode du cot complet :
1. Principe de la mthode :
La mthode des cots complets est la plus utilise en comptabilit analytique, parce
quelle permet de calculer le cot complet dun produit, dune activit ou dun groupe de
produits, et quelle offre une analyse des cots par centre de responsabilit, ce qui rend le
calcul plus fiable.
Le principe de cette mthode se base sur le dcoupage de lentreprise en des
sections homognes, appeles centres danalyse . Dans ce sens, nous distinguons deux
types de centres :
-
Centres principaux : dans lesquels, les charges indirectes sont affectes
directement au cot, comme les centres dapprovisionnement, de production ou
de distribution.
Centres auxiliaires : dont lensemble de leurs cots sont au service dautres
centres principaux. Il sagit essentiellement des centres administratifs et de
support tels que la gestion du personnel, le transport et ladministration17.
Ensuite, nous choisissons une unit duvre qui reprsente lunit de mesure de
chaque centre danalyse. Elle est dfinie comme tant une unit corrle un ensemble
de cots homognes et qui permet donc de les imputer 18.
Ensuite, nous passons la pratique de la mthode, qui consiste rpartir les charges
sur lensemble des centres danalyse dans un premier temps, cette tape sappelle la
rpartition primaire . Dans un deuxime temps, nous procdons une rpartition
secondaire, qui consiste rpartir les soldes des centres auxiliaires sur les centres
principaux.
17
M. ERRADI, La conception dune comptabilit analytique dans le secteur immobilier ; thse de fin dtude ;
ISCAE, 2011/2012
18
Boutti R., Comptabilit analytique dcisionnelle : A l'heure des IAS/IFRS, Collection Expertise, 2004, p. 106.
34
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 8: La rpartition des charges
Source : Margerin J., Comptabilit analytique
Aprs la phase de la rpartition des charges indirectes, nous passons au calcul des
cots dunit duvre (CUO). Nous distinguons : Le cot dunit duvre et le taux de frais.
-
Le cot dunit duvre : pour les centres ayant une unit de mesure physique
non montaire.
quation 1: Formule de CUO
Total des charges du centre
CUO =
Nombre dunit duvre
Le taux de frais : pour les centres ayant une unit de mesure montaire.
quation 2: Formule du taux de frais
Total des charges du centre
CUO =
Nombre dunit duvre
35
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
2. Intrts et limites19 :
2.1. Intrts :
La mthode intgre lensemble des charges (directes et indirectes) dans la
formation du cot de revient du produit objet de cot ;
Elle divise lentit en des centres de responsabilit : c'est--dire chaque centre
est responsable de ses cots et ses ralisations ;
2.2. Limites :
La complexit de lapplication en cas de diversit des produits ;
Cette mthode ne tient pas compte de la variation dactivit.
II. La mthode du cot partiel :
1. Principe de la mthode :
Le cot complet consiste affecter les charges directes et indirectes au prix de
revient de la production de lentreprise, ce qui prsente une limite lorsquil sagit dune
entreprise ayant une structure multi-produits. Cest pourquoi, lutilisation de la mthode
des cots partiels, appele galement mthode du direct costing ou variable costing parat
plus pertinente.
La version originale de cette mthode, appele direct costing ou cot direct
simple , consiste prendre en considration que les charges variables. Cette version a
t amliore et devenue cot direct volu , qui inclut en plus des charges variables,
les charges fixes spcifiques au produit.
Le calcul se fait en plusieurs tapes. Tout dabord, nous dterminons la marge sur
cot variable, en dduisant le cot variable des ventes du chiffre daffaires. Enfin, nous
obtenons le rsultat en dduisant les charges fixes de cette marge.
19
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions Francis
Lefebvre, (dition 2013/2014)
36
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 9: Cot partiel
Source : projet dinstauration de CA au sein de Gharb Papier Carton
2. Intrts et limites de la mthode 20:
Dans la gestion de lentreprise, il ny a pas une mthode parfaite. Toute mthode a
des intrts dans un contexte et des limites dans un autre.
2.1. Intrts :
Cette mthode mesure lapport de chaque produit la couverture de ses charges
fixes.
Cette mthode est simple mettre en exergue : elle vite la complexit de la
rpartition des charges indirectes, elle se focalise sur les charges directes.
Elle aide la prise des dcisions stratgiques : un produit qui ne couvre pas son
cot variable sera abandonn ou sous-trait.
2.2. Limites :
Cette mthode sintresse aux seules charges variables, elle est donc peu
pertinente pour les activits qui prsentent dimportantes charges fixes indirectes ;
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions
Francis Lefebvre, (dition 2013/2014)
20
37
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Cette mthode favorise les produits forte marge sur cot variable, et influence
les politiques productives de lentreprise.
III. La mthode de limputation rationnelle :
1. Principe de la mthode :
La mthode de limputation rationnelle des frais fixes vienne corriger la limite de
non prise en compte de la variation dactivit de la mthode des cots complets. Son
principe est dviter la volatilit des cots unitaires par rapport au niveau dactivit. Ceci
se fait en dfinissant un niveau dactivit normale pour chaque centre de responsabilit.
Ensuite, nous calculons un coefficient dimputation rationnelle, que nous
multiplions par les frais fixes avant de les imputer aux cots. Ce coefficient se calcule de
la manire qui suit :
quation 3: Coefficient d'imputation rationnelle
Activit relle
Coef. Ir. =
Activit normale
Donc, le cot dimputation rationnelle :
quation 4: Cot d'imputation rationnelle
Cot dIr. = charges variables + (Charges fixes * Coef. Ir.)
Et la diffrence dimputation :
quation 5: Diffrence d'imputation
IR = Charges fixes (charges fixes * Coef. Ir.)
Cette diffrence dimputation sexplique par deux scnarios :
-
En cas de sous-activit, elle correspond au cot de la sous-activit, cest--dire la
partie des charges fixes non absorbe par la production de lentreprise ;
38
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
En cas de suractivit, elle correspond au gain de suractivit et se matrialise par
une valeur ngative.
2. Intrts et limites 21:
2.1. Intrts :
Cette dcomposition aide les gestionnaires comprendre lorigine
dvolution des cots, la hausse comme la baisse.
2.2. Limites :
Une mthode assez lourde appliquer,
Une mthode peu objective, surtout pour la dtermination du niveau de
lactivit normale.
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions
Francis Lefebvre, (dition 2013/2014)
21
39
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 2 : les nouvelles mthodes
I. La mthode ABC : Activity Based Costing
1. Principe de la mthode :
Lenvironnement de lentreprise a connu un changement important depuis les
annes 80, la concurrence acharne, les exigences de plus en plus personnalises des
clients et, par voie de consquence, la diminution du cycle de vie des produits. Ceci a
affect les modes de production des entreprises qui ont commenc travailler en juste-temps et en flux tendus.
Dans ce contexte, la classification classique des couples cots directs/cots
indirects ou cots fixes/cots variables, a perdu son utilit dans la mesure o les charges
de structure sont devenues les plus dominantes avec le dveloppement des activits
immatrielles.
Pour combler ce vide, la mthode de cot base dactivit a vu le jour aux tatsUnis au dbut des annes 80.
La mise en uvre de cette mthode consiste identifier lensemble des activits
de lentreprise permettant la fabrication des biens et services, auxquelles nous affectons
des inducteurs gnrant la consommation des cots. Ensuite, nous regroupons les
activits ayant le mme inducteur, dans un processus pour que nous pourrons simplifier
les calculs dune part, et disposer dune vision transversale de la chane de valeur dautre
part22.
2. Intrts et limites23 :
2.1. Intrts :
Le dcoupage en activits permet de mieux rpartir les charges
indirectes ;
22
Robert S. KAPLAN Stevenson R. ANDERSON, TDABC La mthode ABC pilote par le temps , Groupe
Eyrolles, 2008
23
Khalid, OULAD SEGHIR, Contrle de gestion I , ENCGO 2013/2014
40
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Les inducteurs dactivit apportent une premire approche de la
performance de chaque activit ;
La mthode ABC impute aux cots des objets les ressources rellement
consommes.
2.2. Limites :
La principale limite du modle base dactivits rside dans sa complexit.
II. La mthode du cot prtabli :
Un cot prtabli est un cot dtermin lavance, utilis principalement pour
faciliter le contrle de gestion travers lanalyse des carts entre les prvisions et les
ralisation en cot rel, ainsi que pour permettre aux responsables davoir une vision
future de lvolution de lactivit 24. Dans ce sens, nous distinguons trois types essentiels
de cots prtablis, que sont le cot standard, le cot cible et le cot budgtis.
1. Cot standard :
1.1.
Principe de la mthode :
Comme sa nomination, il se rfre une norme, cette norme peut tre interne ou
externe. La norme peut nous renseigner des quantits de matires premires, la
qualification de main duvre employe, etc.
Le cot constat correspond au prix auquel "on paie les choses" ex post alors que
le cot prtabli correspond un cot calcul ex ante25 (Viens-Bitker, 1989).
1.2.
Intrts et limites26 :
1.2.1. Intrts :
Lamlioration de la performance de lentreprise ;
Lanticipation des conditions defficience de lactivit ;
24
Khalid OULAD SEGHIR, Contrle de gestion approfondi , ENCGO, 2014/2015
Viens-Bitker C., Leclerq B. Collecte et laboration de linformation conomique ncessaire au calcul des cots
de la dcision thrapeutique. Arch. Mal. Cur, 1989, 82 (III), 49-53.
25
26
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions Francis
Lefebvre, (dition 2013/2014)
41
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Lintroduction de mesures correctives en cas de non atteinte des standards
pralablement fixs.
1.2.2. Limites :
La rigidit des standards adopts peut poser problme ;
Le changement de lenvironnement peut bouleverser les prvisions.
2. Cot cible :
2.1.
Principe de la mthode :
Le cot cible, ou target cost en anglais, correspond au cot qui dcoule de
lanalyse de la demande du march. En dautres termes, le cot cible est le cot que le
produit ou le service ne doit pas dpasser, sous peine de ne pas tre ou demeurer
comptitif sur le march 27.
Nous le calculons par formule suivante :
quation 6: Formule de cot cible
Cot cible = prix de vente la marge
Cette mthode, qui trouve son origine dans lindustrie automobile japonaise,
commence ainsi par la dtermination du prix de vente qui dpend essentiellement du
march (clients, concurrence, distributeurs). Ensuite, lentreprise identifie la marge de
bnfice que lentreprise souhaite engranger, pour enfin pouvoir dgager le cot que
lentreprise doit chercher atteindre28.
2.2.
Intrts et limites29 :
2.2.1. Intrts :
27
Jacquot T., Milkoff R., Comptabilit de gestion : analyse et matrise des cots, Dareios & Pearson Education,
2011,
28
K. OULAD SEGHIR, Cours de contrle de gestion approfondie ; ENCGO. 2014/2015
29
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions Francis
Lefebvre, (dition 2013/2014)
42
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Permettre aux gestionnaires dadopter une stratgie de rduction des cots
partir des phases de conception et de fabrication des produits ;
Des produits de qualit au plus faible cot possible.
2.2.2. Limites :
Les biais dinformation concernant les attentes des clients en externe ;
Les conflits dintrts entre les diffrents services de lentreprise en interne.
3. Le cot budgtis :
3.1.
Principe de la mthode :
Le cot budgtis correspond un objectif vis court terme. Il est donc
particulirement adapt llaboration des budgets annuels puisquil rpond au besoin
de suivi du budget afin dapporter les actions correctives temps.
Cette mthode se fait en accompagnement des mthodes traditionnelles
puisquelle ne dispose pas dun processus de fonctionnement propre elle.
Nous constatons que cette mthode ne serait efficace que si elle est applique de
manire raliste, tenant compte des enjeux de lenvironnement de lentreprise, sa
structure de gestion et la qualit de son cadre de production. Ceci se concrtise dans le
choix des standards suivre et les cots cibles atteindre, qui ncessitent une adaptation
et une actualisation permanentes.
3.2.
Intrts et limites30 :
3.2.1. Intrts :
Correspond un objectif vis court terme ;
Permet dadopter des actions correctives temps.
3.2.2. Limites :
Elle ne dispose pas dun schma de fonctionnement propre ;
Elle ncessite une adaptation et une actualisation permanente.
30
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de son conseil, Editions Francis
Lefebvre, (dition 2013/2014)
43
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Conclusion de la premire partie
Cette rflexion pralable la conception dun
modle de la comptabilit analytique, nous a permis de
caractriser le cadre thorique du travail, ainsi les
principes de fonctionnement des mthodes ncessaires.
Le traitement thorique du sujet, nous a prsent
une vision globale sur le traitement des cots, selon les
diffrentes mthodes disponibles. Ainsi, limportance de la
mise en uvre dune telle mthode pour amliorer la
performance de lentreprise.
Cette phase pralable, nous permettra dans la partie
suivante de choisir la mthode correspondante notre
entreprise, et ensuite la mise en uvre de la mthode
choisie.
44
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
SECONDE PARTIE :
La conception dun systeme de cout
standard au sein de lentite HEB
Aprs avoir dmontr le bien fond et lintrt du
sujet sur le plan thorique et expos un bon nombre de
mthodes comptables analytiques, nous entamerons la
seconde partie du rapport par une application pratique
dans lentreprise daccueil HEB .
Nous y prsentons dans un premier chapitre le
secteur dactivit du BTP, en gnral, et celui des
quipements et btiment en particulier, pour arriver la
conception de la comptabilit analytique proprement dite
dans le 2me chapitre.
Il est noter que la collaboration de lquipe et la
disponibilit des donnes ont t pour nous des lments
essentiels pour la ralisation du prsent travail.
45
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Chapitre I : Prise de connaissance externe et interne de HEB
Le traitement thorique du sujet ne suffit pas pour la mise en place dun tel projet.
Il est ncessaire dapprofondir la recherche par une analyse de lenvironnement de travail,
travers le secteur dactivit et ses spcificits, ainsi lentreprise objet dtude.
Dans ce cadre, nous allons essayer dans ce chapitre de prsenter le secteur
dactivit BTP , ensuite, nous allons donner une synthse sur le fonctionnement, ainsi
la structure organisationnelle de lentreprise HEB
Section 1 : Secteur du BTP : Chiffres cls, dfis et perspectives
Le BTP est lun des secteurs les plus dynamiques du tissu conomique marocain.
Sa participation la croissance du PIB ne cesse de se consolider. Cest aussi lun des
secteurs les plus attractifs en matire dinvestissement national et tranger, ainsi le plus
crateur demplois.
I- les chiffres cls du secteur de BTP :
1- La contribution la croissance conomique :
Les diffrents secteurs dactivits de lconomie marocaine ont contribu une
dynamique remarquable, caractrise par un taux de croissance variant entre 3,6% et
4,8% durant la priode allant de 2009 jusqu 2012, comme le souligne la Banque
Mondiale31.
31
Le site officiel de la banque mondiale : http://donnees.banquemondiale.org/
46
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 2: Valeur ajoute aux prix de l'anne prcdente chains base 1998
Source : Note dinformation sur la situation conomique nationale au 4eme trimestre 2014
Cette dynamique caractrisant le dbut de la deuxime dcennie de ce sicle, a t
renforc par les chiffres du dernier tableau du bord de la direction des tudes et
prvisions financires . Ce rapport affirme que le secteur du btiment et travaux
publics contribue hauteur de 6,6% du total des valeurs ajoutes aux prix courants et
22,3% de celles relatives aux activits secondaires entre 2008 et 2013, et une
croissance de 6% en fin 201432.
2- l'attractivit dinvestissement :
Lattirance de linvestissement dans le secteur du BTP se reflte au niveau de la
structure des IDE reus depuis 2001. En effet, sur 227,2 milliards MAD
dinvestissements trangers reus par le Maroc entre 2001 et 2009, le secteur BTP a
canalis 17,2%, soit plus de 39,1 milliards de dirhams.
32
Direction des tudes et des prvisions financires, Tableau de bord Mai 2015 , Secteur du btiment et
travaux publics.
47
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 10: les IDE rus par le secteur du BTP
Source : Office des changes
Le secteur du BTP est considr comme lun des secteurs les plus attractifs en
matire dinvestissements. Comme nous montre la figure ci-dessous, il occupe la 2eme
place, aprs le secteur de lindustrie en 2013.
Figure 11: l'attractivit des IDE par secteur
Source : Office des changes
48
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
3- La cration demploi :
Le secteur du BTP emploie prs dun millions de personnes soit 9,3% de la
population active occupe, dont 11% dans le milieu urbain.
Figure 12: Emploi par branche d'activit de la population active occupe au niveau national :
trimestriel
Source : Haut-commissariat au plan, http://www.hcp.ma
Comme nous constatons sur le graphe ci-dessus, le secteur agricole, fort et pche
et le secteur des services (avec leurs sous-secteurs), emploient presque 80% de la
population active occupe, et le secteur des BTP seul, emploie 9.3%.
II- les dfis et perspectives du secteur de BTP :
Le secteur du btiment et travaux publics (BTP) connait une croissance trs soutenue
depuis presque dix ans. Aprs la diminution enregistr en 2009 et dbut 2010 d aux
incidences de la crise mondiale sur lconomie nationale, les statistiques officielles
confirment la reprise partir de 201133. Pourtant, la croissance du secteur souffre de
plusieurs dfis.
33 Bouchab Benhamida, Prsident de la Fdration Nationale du BTP :
Les dfis de la croissance du secteur du
BTP, 2011
49
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
1. Dfis du secteur des BTP :
1.1.
louverture totale du march national du BTP
La crise des conomies europennes pousse un nombre important des entreprises
de sud de lEurope, de tailles distinctes et parfois de fiabilit incertaine, traverser la
frontire de lconomie nationale.
La rglementation marocaine ne prvoit aucune disposition permettant de se
prmunir des pratiques de dumping ou de dvolution de contrats des entreprises
dfaillantes dans leurs pays dorigine. Cette concurrence sauvage dstabilise le tissu des
entreprises marocaines et pose problme quant la bonne fin de certains projets34.
1.2.
Lenteur du processus de rforme
La rforme de certains textes rglementant de la gestion des marchs publics
connat une lenteur qui entrave la bonne marche dun nombre important de projets en
cours, et parfois lannulation du contrat avant la rception dfinitive du march public.
1.3.
Labsence dune stratgie claire et cohrente :
Labsence dune stratgie nationale cohrente, ayant un objectif de soutenir
lentreprise nationale oprante dans le secteur, afin daccroitre sa position dans le march
national et international.
1.4.
La gestion traditionnelle :
Les PME et TPE reprsentent la majorit des entreprises actives dans le secteur, ce
type dentreprise se caractrise par laspect familial. Donc elles doivent fournir un effort
considrable pour ne pas rater la course, ltat de sa part doit jouer un rle vital dans le
dveloppement et la prservation de cet outil qui doit tre considr comme un
patrimoine national indispensable la production de la richesse, la cration de lemploi
et la ralisation des projets stratgiques du pays.
34 http://www.aufaitmaroc.com ; Les dfis de la croissance du secteur du BTP ; le 04/11/2010
50
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
2. Les perspectives du secteur de BTP :
Face ces contraintes, le BTP au Maroc dispose de plusieurs atouts lui permettant
dafficher des perspectives de dveloppement trs optimistes. En effet, le secteur connait
une croissance trs soutenue depuis presque dix ans maintenant. Le monde de la
construction est en effervescence en cette fin danne (2014)35.
Ce rythme devrait se poursuivre pour les annes venir au vu des programmes
dinvestissements importants prvus en matire dinfrastructures (lautoroute
Casablanca-Beni Mellal, la voie express Taza-Al-Hoceima ) et dhabitat.
2.1.
Rythme maintenu grce aux chantiers de ltat
Linfrastructure au Maroc poursuit sa progression danne lautre. Le march du
BTP se maintient en sappuyant sur plusieurs aspects, entre autres le la croissance du
tourisme, le dveloppement urbain, ce qui a lanc la vente des matriaux de construction,
notamment le ciment.
2.2.
Pas de crise pour le BTP
Dans le secteur des btiments et travaux public au Maroc, on na pas parl dune
crise. Le ralentissement de la croissance tait gnralement un problme du secteur priv
suite la suppression des avantages fiscaux accords prcdemment aux promoteurs. Par
contre les chantiers tatiques, ont suit un rythme croissant.
35
Article du journal la vie co ; site web www.lavieeco.com; date : 05/12/2014
51
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
En gros les BTP est un secteur stratgique de
l'conomie marocaine de par sa contribution au PIB, la
formation brute de capital fixe (FBCF) et la cration
d'emplois. Initialement tourn vers la satisfaction des
besoins du march local, il s'ouvre de plus en plus sur
l'extrieur o les produits et le savoir-faire marocains sont
trs demands.
Cependant, lentreprise marocaine du secteur du
BTP reste confronte certains dfis quelle devra relever
afin de maintenir son rythme de croissance.
52
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 2 : Hamss des quipements publics et Btiments (HEB)
I- identification de lentreprise :
Tableau 3: Fiche d'identification de la socit
Dnomination sociale
HEB (Hamss des quipement publics et
Btiment)
Forme juridique
Socit anonyme (S.A.) (groupe)
Secteur dactivit
BTP
Objet
Construction et btiment
Rnovation de btiment
Travaux
auxiliaires
pour
btiments
Travaux en bton (Filiale
TAZA)
Direction gnrale
Abdeslam Elhamss
Filiale de Taza : Morad Elhamss
Date de cration
1988
Filiale de Taza : 2006
Effectif
100 250
Sige social
bd. Mohamed V. Imm. Al Ouafa
AKNOUL
Source : informations internes de lentreprise
HEB a t cre en 1988 AKNOUL, linitiative de la famille Elhamss, en 2006 et
vu la croissance de la demande en matire des produits de bton au niveau de la ville Taza
et ses entours. Ils ont dcid douvrir un site 12 km de TAZA.
Ce site a bnfici dune demande trs importante, grce aux travaux de lautoroute
Fs-Oujda , ainsi le lancement du chantier de la voie express Taza-Al-Hoceima . En
53
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
plus de ces grands chantiers publics, la ville Taza a connu ces dernires annes une
croissance anormale dans lhabitat sociale.
II.
Composition du groupe :
Figure 13 Composition du groupe HEB
AKNOUL
Construction et btiment
Rnovation de btiment
Travaux auxiliaires pour btiments
Localit
TAZA
TAZA
Source : labor par nos soins.
Le site dans objet de notre projet dinstauration dun systme de comptabilit
analytique, se situe prs de Taza, il a une autonomie relative dans sa gestion
oprationnelle, par contre laspect stratgique li directement la direction gnrale du
groupe dAKNOUL.
54
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 14: Le processus d'exploitation de HEB
Sable
Grain de riz
Centrale
bton
Bton: B1, B2, B3,
B4
Usine
Agglos / Hourdis
Poutrelle
Poutrelle
Gravette: G1,G2
Stock
Fer
Ciment
Adjuvant
Source : labor par nos soins.
Lapprovisionnement de lentreprise se fait gnralement en six matires
premires essentielles, savoir : le sable (concass / lav), Grain de riz, Gravette (G1 /
G2), Fer, Ciment et ladjuvent.
1. Les ralisations :
Tableau 4: Chiffre d'affaire mensuel (moyen)
Produit
Chiffre daffaire mensuel
Bton
10.181.250
Agglos
3.389.161,8
Poutrelles
1.466.948
Source : information interne
Le chiffre daffaire reprsente une moyenne de lanne 2013. Vu que lactivit de
lentreprise souffre dune priode de bas de saison (entre Novembre et Mars). Donc les
donnes ne reprsentent pas un chiffre daffaire exact de chaque mois.
55
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
2. Les produits :
Tableau 5: Les produits
Produit
Rfrence
Agglos
20/20/50
15/20/50
10/20/50
07/20/50
Poutrelle
En mtre linaire
Bton
B1
B2
B3
B4
56
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Chapitre 2 : La conception du systme de comptabilit analytique au
sein de HEB.
Dans limpratif damliorer sa comptitivit, ainsi de saisir les opportunits de
march, nous allons essayer dans ce chapitre dlaborer un systme de comptabilit
analytique permettant la maitrise du cot et la gestion quotidienne efficace.
La dtermination du cot de revient nest pas une mission facile comme dans la
thorie. Elle ncessite une tude synthtique de la socit ainsi son environnement
conomique.
La complexit du travail ainsi labsence dun homme du mtier (Contrle de
gestion) qui pourra nous encadrer et tracer les pistes dinvestigation, nous a pouss
consacrer une grande partie du temps que nous avons pass au sein de la socit,
analyser la situation de lentreprise, travers des entretiens avec le personnel de
ladministration ainsi les responsables des ateliers.
La mise en place de la comptabilit analytique doit conduire une meilleure
connaissance des cots permettant de produire au plus bas prix sur le march pour
faciliter leur coulement et de placer ces produits dans les meilleures conditions pour
retirer plus profit. Elle ncessite en outre la participation de tous les responsables et un
systme dinformation permanent adapt aux besoins de lentreprise. La mthode qui
demeure fiable pour le cas de HEB est la mthode des cots complets, car elle rpond au
mieux au besoin de la socit en termes dinformations utiles pour la prise de dcision, il
favorise une simplicit quant la participation des diffrentes parties prenantes qui
auront une influence sur lenchainement des activits et du processus de mise en place.
Pour cela, dans cette partie nous allons essayer dans un premier temps au niveau
du premier chapitre, de donner une vision globale sur la structure de la PME marocaine,
tout en essayant danalyser lenvironnement de notre socit HEB. Et par la suite au
niveau du deuxime chapitre nous allons justifier la mthode utilise et le modle de
calcul du cot de revient.
57
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 1 : le choix des mthodes
ce niveau danalyse, nous serons amens suivre la dmarche gnrale qui
consiste reprendre toutes les charges de la comptabilit gnrale et de les analyser pour
les prparer tre intgrs en comptabilit analytique.
Daprs des entretiens avec les responsables des services et ateliers de
lentreprises et des comparaisons avec des entits du mme secteur, nous avons conclus
que la mthode des centre danalyse, est la plus adapte notre entreprise HEB vu son
activit et son organisation.
La mthode des centres danalyse consiste dcouper lentit en des sousensemble homognes, appels centres danalyses ou sections homognes , dans le
but daffecter chaque centre ses propres cots. Cette tape permet de responsabiliser
chaque centre en termes de cot et de performance.
En premier lieu, nous allons classer les centres danalyses en centres oprationnels
et centre de structure. Ensuite nous allons rpartir les charges en charges incorporables
et charges non incorporables. Puis nous serons amens faire la distinction, au sein des
charges incorporables retenues, entre charges directes et indirectes, pour arriver la
formation du cot de revient objet de notre recherche.
I.
la justification du choix de la mthode des centres danalyse
Ladoption dune telle mthode ne vienne pas par intuition. Il est ncessaire de
rpondre lensemble des contraintes traites dans la problmatique, et prendre en
considration la capacit dadaptation des responsables de lentreprise en termes de
simplicit de la dmarche. Dautre part, la marge de temps dont on dispose (un mois aprs
fixation de la problmatique) son tour caractrise le choix de la mthode, bien
videment avec vocation de raliser les objectifs assigns ce projet.
58
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
1. Les critres de choix de la mthode :
La nature de lactivit : une entreprise commerciale nest plus une entreprise
industrielle en terme des besoins, une entreprise de fabrication des biens nest plus
une entreprise de prestation des services. En effet, la mthode de calcul de cot
doit tre souple, et adapt avec les besoins de lactivit de lentreprise.
Le mode de gestion de lentreprise : les procdures de la prise de dcision
centralis ladministration gnrale, ne sont pas les mmes pour une entreprise
dcentralise. Ainsi que la formation des responsables de lentreprise doit tre
prise en compte pour dfinir une mthode adquate.
Les contraintes budgtaires : le choix dune telle mthode ne doit pas prsent
un cot surestim, parce que lobjectif est de maitriser le cot et non plus avoir des
cots supplmentaires.
2. La mthode choisie :
Aprs des discussions et entretiens approfondies avec lensemble des
responsables de lentreprise, et la consultation des travaux dans des secteurs
similaires, ainsi la particularit de lactivit de lentreprise et le mode de gestion,
parce qui ncessite lutilisation dun outil simple est efficace. Nous avons jug
ncessaire de choisir la mthode des cots complets des centres danalyse.
59
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
II.
la classification des centres danalyse
1. Dfinition du centre danalyse :
Un centre danalyse est un compartiment dordre comptable dans lequel sont
analyss, pralablement leur imputation aux comptes de cots des produits, des
lments de charges indirectes36.
Donc le centre danalyse doit intgrer un ensemble de charges indirectes
homognes, do lappellation section homogne .
2. Typologie des centres danalyse :
2.1.
Centres principaux :
Ce sont des centres dont les charges peuvent tre imputes directement au cot de
revient des produits, ils sont lis directement lactivit principale de lentreprise :
Approvisionnement, production, distribution
2.2.
Centres auxiliaires :
Ils correspondent des centre qui ne sont pas lis directement lactivit de
lentreprise, leurs cot font objet dune rpartition sur les autres centre principales :
centre administration, gestion de personnel
2.3.
Centre de structure :
Ils correspondent des centres d'analyse dont l'activit ne peut tre mesure par
une unit physique. On utilise donc une assiette de calcul montaire appele assiette de
frais (exemples : la centaine de MAD de charges, la centaine de MAD d'approvisionnement,
etc.) pour mesurer le niveau d'activit.
3. Dcoupage de HEB en des centres danalyse :
Le dcoupage de la socit en subdivisions fonctionnelles doit reflter au
maximum la ralit organisationnelle et fonder les diffrentes fonctions conomiques
36
M. GERVAIS ; Contrle de Gestion, 9e dition, ECONOMICA ; 2009 ; page : 56
60
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
ncessaires laccomplissement de ses activits. Celui pour lequel nous avons opt est
largement inspir du vcu quotidien de HEB et de son organisation.
Tableau 6: classification des centres danalyse de lHEB
Premire classification
section
Deuxime classification
Oprationne Justification
Principal
ou
structure
justification
ou
auxiliaire
Administratio Structure
Aucune
n gnrale
d'uvre
unit Auxiliaire
Le
cot
de
cette
fonction auxiliaire est
rparti sur les autres
physique ne peut
tre
Principales
par lintermdiaire des
dfinie ce niveau.
Les charges lies
ce
fonctions
centre
clefs de rpartition plus
ou moins arbitraires.
sont
essentiellement
des
charges
de
structure lies
lexistence
de
l'appareil
productif. En effet,
le
centre
continuera
supporter la quasitotalit des mmes
charges, mme un
niveau
de
production zro.
61
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Stockage
Oprationnel Les charges lies Auxiliaire La section stockage
sont
offre l'essentiel de
essentiellement
des
charges
oprationnelles
sections principales :
dont l'existence est
lie
au
ses prestations aux
niveau
conditionnement,
traitement, et surtout
dactivit : en
la distribution
production zro, il
ny
aura
pas
dentretien
des locaux, loyer,
lectricit
Approvisionn Oprationnel Les
ement
charges Principal
En principe, tous les
relatives cette
frais
section varient en
fonction du niveau
d'activit. En effet,
la
frquence
dachat
d'approvisionnement
peuvent tre
imputs directement
des
aux cots d'achat
matires
premires et des
fournitures dpend
des produits.
principalement du
niveau
de
leur
consommation qui
62
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
dpend
lui
de
limportance de la
demande
sur
le
march.
Centrale
bton
Oprationnel Les
charges Principal
Tous les frais de ce
relatives
ce
centre sont imputs
centre
varient
directement au cot de
niveau
production du bton
selon
le
dactivit, et elles
sont
lies
directement
au
cot de production
du bton .
Centre
poutrelle
Oprationnel Les
charges Principal
Tous les frais de ce
relatives
ce
centre sont imputs
centre
varient
directement au cot de
niveau
production
selon
le
dactivit.
du
Poutrelle ces
diffrents types.
Centre Usine
Oprationnel Les
charges Principal
Tous les frais de ce
relatives
ce
centre sont imputs
centre
varient
directement au cot de
niveau
production
selon
le
dactivit.
du
Hourdis
Agglos
et
ces
diffrents types.
63
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 15: Lorganisation des centre de lHEB
Approvisionnement
Centrale bton
Centres principales
Centre Usine
Centre poutrelle
HEB
Distribution
Administration gnrale
Centres auxilliaires
Stockage
Source : labor par nos soins.
64
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Section 2 : La formation du cot de revient
I. Le traitement analytique des charges
1. La dtermination des charges de la comptabilit analytique :
Les charges enregistres en comptabilit gnrale constituent les donnes de base
pour le calcul des couts. Elles rsultent de la mise en uvre des principes comptables (et
parfois de rgles fiscales) qui dans certains cas ne peuvent satisfaire les besoins de la
comptabilit analytique, parce quelles ont un caractre global et synthtique.
Par ailleurs, en comptabilit analytique, les couts doivent :
Avoir une signification conomique
tre le reflet de lexploitation normale et courante
Permettre des comparaisons dans le temps et dans lespace
Une analyse de charges pralablement tout traitement, permet :
De distinguer celles incorporer aux cots de celles qui ne sont pas
retenir ;
De crer des charges afin dliminer linfluence sur les cots des diffrences
lies la structure financire et la nature juridique de la socit.
Dans ce sens, nous serons amens suivre la dmarche gnrale qui consiste
reprendre toutes les charges de la comptabilit gnrale et de les traiter pour les prparer
tre intgrer dans la comptabilit analytique.
Ceci dcoule du fait que les charges ne concourent pas toutes dans le calcul des
couts ; il faut exclure certaines qui nont pas un lien avec lexploitation et en rajouter
dautres pour dterminer les charges qui sont incorporables la comptabilit analytique.
65
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Figure 16: La dtermination des charges de la comptabilit analytique.
Source : labor par nos soins
1.1.
les charges de la comptabilit gnrale :
Les charges de la comptabilit gnrale sont reprsentes dans la balance gnrale
de la socit.
1.2.
les charges non incorporables :
Les charges non incorporables correspondent des charges saisies en comptabilit
gnrale mais non retenues dans le calcul des cots en comptabilit analytique.
Nous ne retiendrons donc pas :
Toutes les charges sur exercice antrieur :
Achats revendus de marchandises sur exercice antrieur (6118)
Achat matriel et fournitures sur lexercice antrieur (6128)
66
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Autres charges externes sur exercices antrieur (6148)
Charges de personnel sur exercice antrieur (6178)
Les charges dexploitation qui ne relvent pas lactivit normale ou qui ne sont pas
suffisamment prennes :
Les dotations dexploitation aux amortissements des immobilisations en
non-valeur (6191)
Les charges financires :
Les charges dintrt (631)
Les pertes de change (633)
Les autres charges financire (638)
Les dotations financires (639) (dont les DEP pour risques et charges :
6393)
Les charges non courantes
La valeur nette actuelle des immobilisations cdes (651)
Autres charges non courantes (658) (dont les pnalits sur march 6581,
les crances
irrcouvrables 6585 et les autres charges non courantes
6587)
Les dotations non courantes (659)
1.3.
les charges incorporables :
Les charges incorporables sont les charges pour lesquelles lincorporation aux
cots est juge raisonnable , ce sont les charges lies au cycle dexploitation de
lentreprise.
67
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 7: Liste des charges corporables de HEB
Charges dexploitation
612
6121100 ACHATS CIMENTS
6121101 ACHATS POUTRELLES 25 / 20 D10
6121102 ACHATS POUTRELLES 10 / 20 D10
6121104 ACHATS POUTRELLES 14 / 20 D10
6121105 ACHATS POUTRELLES 20 / 20 D10
6121106 POUTRELLE 25 / 20 D10
6121107 P.T.S ( 5 x 3.50 ) ( 2.40 x 6 )
6121108 P.T.S ( 3.50 x 3.50 ) ( 2.40 x 6 )
6121109 ACHAT HUIL CHRYSO
6121110 ACHAT SIKA
6121111 ACHAT FER
6121112 SABLE LAVE ACHAT
6121
ACHAT MAT PREM
61223
ACHAT DE COMBUSTIBLE
61226
ACHAT DE FOURNITURE DE MAGASIN
6125210
FOURNITURE D'ENTRETIEN MECANIQUE
6125220
PNEUS ET COMBRE A AIR
6125230
FOURNITURE D'ENTRETIEN GENERALE
68
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
613
614
616
6125
ACHAT NON STOCKES DE MAT & FOURN
61252
ACHAT DE FOURNITURE D'ENTRETIEN
61262
ACHAT D'ETUDE
61310
TAXE SUR SABLE
61311
LOCATION DE TERRAIN
6143
DEPLACEMENT MISSION
61455
FRAIS DE TELEPHONE
61472
FRAIS SUR EFFETS DE COMMERCE
6147201
FRAIS ESCOMPTE FITONOVO
6167
IMPOTS ET DROITS ASSIMILES
61671
DROIS D'ENREGISTREMENT DE TIMBRE
61673
TAXES SUR LES VEHICULES
Source : document interne de lentreprise (extrait du systme)
1.4. les charges suppltives :
Les charges suppltives sont des charges ignores par la comptabilit gnrale,
mais elles doivent tre prises en compte pour avoir un cot de revient rel, on trouve
gnralement deux charges :
La rmunration des capitaux ;
69
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
La rmunration de lexploitant.
Pour le cas de HEB, nous avons jug aprs discussion avec de prendre en
considration la rmunration de lexploitant. Nous avons fix une somme de
10 000
MAD/ mois.
1.5. les charges de la comptabilit analytique :
Aprs le traitement des charges de la comptabilit gnrale, en appliquant les deux
formules de base suivantes :
quation 7: quation des charges de la CA
Charges de la CA = charges de la CG charges NI + charges S
Ou :
quation 8: quation du rsultat de la CA
Rsultat de la CA = Rsultat de la CG + charges NI charges S
Avec :
CA : comptabilit analytique
CG : comptabilit gnrale
NI : non incorporable
S : suppltives
70
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Dans notre cas de lentreprise HEB, cause de la confidentialit des donne exige
par les responsables de lentreprise, nous ne pouvons pas donnes les dtails des charges.
Tableau 8: les charges de la comptabilit analytique
Charges incorporables
22. 319. 320, 88
Charges suppltives
10.000,00
Charges
de
la
comptabilit 22.329.320,88
analytique
Les charges de la comptabilit analytique feront lobjet dune rpartition primaire
sur lensemble des centres de responsabilit : Administration gnrale, stockage,
approvisionnement, centrale bton, usine, poutrelle et distribution.
Cette rpartition permet daffecter chaque centre danalyse les charges relatives
son activit principale, dans le but de le responsabiliser en termes de cot et de
performance.
71
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
2. La rpartition primaire :
Cette tape consiste rpartir la totalit des charges aprs ventilation analytique,
sur lensemble des centres de lentit (auxiliaires et principaux).
Tableau 9: Tableau de la rpartition primaire
Centres auxiliaires
Centres principaux
Charges
Centrale
Administ.
Stockage
Approvisi.
ACHATS CIMENTS
bton
Usine
Poutrelle
2913471,51
2913471,51
2913471,51
Distribu.
ACHATS
POUTRELLES 25 / 20
D10
35350
ACHATS
POUTRELLES 10 / 20
D10
1266666,9
ACHATS
POUTRELLES 14 / 20
D10
872314
ACHATS
POUTRELLES 20 / 20
D10
253641,14
POUTRELLE 25 / 20
D10
103569
P.T.S (5 x 3.50) (2.40
x 6)
167776
P.T.S (3.50 x 3.50)
(2.40 x 6)
ACHAT
432400
HUIL
CHRYSO
565700
ACHAT SIKA
60756
ACHAT FER
284271,66
ACHAT SABLE LAVE
925365
ACHAT MAT PREM
95632
72
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
ACHAT
DE
COMBUSTIBLE
ACHAT
DE
FOURNITURE
DE
MAGASIN
1910439,865
1910439,865
126780,9967
126780,9967 126780,9967
81000
FOURNITURE
D'ENTRETIEN
MECANIQUE
PNEUS ET COMBRE
A AIR
226099,99
FOURNITURE
D'ENTRETIEN
GENERALE
ACHAT
55242,18
82863,27
27621,09
357114,99
357114,99
238076,66
15600
15600
15600
11500
16500
13000
NON
STOCKES DE MAT &
FOURN
119038,33
ACHAT
59519,165 59519,165
DE
FOURNITURE
D'ENTRETIEN
ACHAT D'ETUDE
18277,31
TAXE SUR SABLE
LOCATION
189520
DE
TERRAIN
2195474,5
DEPLACEMENT
MISSION
FRAIS
DE
TELEPHONE
12331,92
FRAIS SUR EFFETS
DE COMMERCE
CHARGES
68703,08
DE
PERSONNEL
FRAIS
39000
6000
6000
22500
ESCOMPTE
FITONOVO
73
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
IMPOTS ET DROITS
ASSIMILES
10820,3
DROIS
D'ENREGISTREMENT
DE TIMBRE
TAXES
SUR
4605
LES
VEHICULES
TOTAL
DE
REPARTITION
79500
LA
2.547.750,44 146.519,2 2.502.668,165 5.390.149,54
5.648.870,62 6.150.362,96 22.500
PRIMAIRE
Dans lobjectif deffectuer une rpartition des charges globales de 22.319.320, 88
MAD dune manire plus au moins fiable, nous avons simul les avis de lensemble des
responsables des centres objet dtudes pour pouvoir dterminer les raisons de la
rpartition.
Daprs le tableau ci-dessus, nous constatons que les centres de production
(centrale bton, usine et poutrelle) ont support la grande partie des charges, ce qui est
justifi par lactivit de lentreprise.
Cette tape nest quune phase prliminaire de travail de traitement des charges,
et qui sera suivie dune deuxime rpartition dite secondaire . Cette rpartition vise
laffectation des charges des centres auxiliaires, ceux dits principaux, afin de lier chaque
charge son origine ou son objet.
74
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
3. La rpartition secondaire :
Aprs avoir affect chaque centre danalyse ses propres charges au niveau de la
rpartition primaire. Nous nous retrouvons devant des totaux des centres auxiliaires, qui
ne sont pas lies directement au cot de revient de produit objet de cot. Donc il est
ncessaire dannuler ces soldes par une rpartition secondaire, qui vise partager les
soldes des centres auxiliaires entre les autres centres principaux selon des cls de
rpartitions.
Tableau 10: Tableau de rpartition secondaire
Centres auxiliaires
Centres principaux
Centrale
Administration Stockage
Approvis.
bton
Usine
Poutrelle
Distribution
2547750,44
2502668,17
5390149,54
5648870,62
6150362,96
22500,00
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
10,00%
254775,04
254775,04
254775,04
254775,04
254775,04
10,00%
00,00%
20,00%
10,00%
10,00%
00,00
14651,92
14651,92
14651,92
TOTAUX DE LA
REPARTITION
146519,17
PRIMAIRE
REPARTITION SECONDAIRE
Administration
-2547750,44
Stockage
-146519,17 14651,92
TOTAUX DE LA
REPARTITION
0,00
0,00
2772095,13 5644924,59 5918297,58 6419789,92 291926,96
SECONDAIRE
NATURE UO
Tonne de MP mtre carr
Nombre
mtre
d'unit
linaire
produite
produit
100 de CA
achet
produit
NOMBRE UO
265727,15
13575,00
1093278,00
104782,00
328776,32
CUO
10,43
415,83
5,43
61,27
0,89
75
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
4. Les charges directes :
Pour rendre notre projet efficace, nous allons nous concentrer sur les premires
phases de traitements de charges afin de garantir une dtermination juste des montants
intgrer dans les cots des produits de la socit.
Pour cela, nous proposons que laffectation des charges directes soit au moment de
la saisie de la charge ou du produit. En effet, le responsable doit exiger que chaque pice
justificative doive tre vise et approuve par la cellule de gestion, comporte le code
analytique du dpartement qui a rellement support la charge. Ainsi laffectation
constitue linscription directe dans la comptabilit gnrale dans les champs prvus cet
effet au niveau de la fentre analytique qui saffiche.
Les charges directes peuvent tre scindes en deux catgories :
La matire premire consomme :
Ciment ;
Sable
Sable lav
Gravette (G1, G2, 6/10)
Grain de riz
Adjuvant
Eau
Fer
La main duvre directe MOD : Il sagit des ouvriers travaillant directement pour
la production, et qui sont rmunrs mensuellement en fonction du nombre
dheures travailles. Cette charge se compose des salaires et des charges sociales.
II. Le calcul des cots :
Le calcul du rsultat analytique par produit, il est ncessaire de passer par le calcul
du cot dachat des matires premires consommes, cot de production des produits
finis pour obtenir enfin le cot de revient, qui fera lobjet dune soustraction du prix de
vente du produit pour dterminer le gain unitaire.
76
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
1. Cot dachat :
Le cot dachat des matires premires et fournitures est calcul sur la base du prix
dachat qui figure sur les factures, major par des frais accessoires (transport sur achat, frais
dinstallation). Nous allons prsenter ci-aprs le cot dachat des huit matires premires
entrantes dans la fabrication des produits finis.
Formule de calcul :
quation 9: Cot d'achat
Cot dachat= charges directes (prix dachat HT) + charges indirectes (centre approvisionnement)
Tableau 11: Cot d'achat du Ciment
CIMENT
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat 1
1314
1314
Frais
d'achat
10,43
10,43
Cot
d'achat
1324,4321 1324,43
Source : labor par nos soins
Tableau 12: Cot d'achat du sable 04
Sable 04
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat 1
120
120
Frais
d'achat
10,43
10,43
Cot
d'achat
130.43
130,43
Source : labor par nos soins
77
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 13: Cot d'achat du sable lav
Sable lav
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
160
160
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
170.43
170,43
Source : labor par nos soins
Tableau 14: Cot d'achat d Gravette G1
Gravette G1
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
120
120
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
130.43
130,43
Source : labor par nos soins
Tableau 15: Cot d'achat de Gravette G2
Gravette G2
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
120
120
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
130.43
130,43
Source : labor par nos soins
Tableau 16: Cot d'achat de Gravette 6/10
Gravette 6/10
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
120
120
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
130.43
130,43
Source : labor par nos soins
78
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Les trois types de gravette et le grain de riz ont le mme prix dachat 120 MAD le
tonne, donc des cots dachat identiques.
Tableau 17: Cot d'achat de Grain de riz
Grain de riz
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
120
120
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
130.43
130,43
Source : labor par nos soins
Tableau 18: Cot d'achat de l'adjuvant
Adjuvant
Qt (t)
PU
MT
Prix d'achat
Frais d'achat
10,43
10,43
Cot d'achat
16.43
16,43
Source : labor par nos soins
Le calcul des cots dachat des matires premires se composent du prix dachat
HT figurant sur la facture de doit de chaque commande, et les charges indirectes du
centre Approvisionnement values 10.43 MAD/Tonne.
Aprs la dtermination des cots dachat, il ncessaire de passer par un inventaire
de stock, travers la mthode de CMUP.
2. Linventaire permanent des stocks des matires premires :
Linventaire des stocks permet de dterminer un cot la consommation des
matires premires (sorties). Vu que le prix des matires premires reste fixe pendant la
priode passe au sein de la socit, il nest pas ncessaire de remplir la fiche de stock.
79
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Pour le besoin futur, nous prsentons ci-dessous une fiche de stock remplir au
moment de calcul de stock.
Tableau 19: Fiche de stock des matires premires CMUP (fin de priode)
Sortie
../../.
Entre
../../.
Sortie
../../.
Entre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant
../../.
0,00
0
0,00
Unitaire
Entre
Prix
../../.
Quantit
Sortie
Montant
../../.
0,00
Unitaire
0,00
Stock
Prix
Quantit
Prix
SI
Montant
Quantit
../../.
Unitaire
Mouvement
Sorties
Date
Entres
Source : labor par nos soins
3. Le cot de production :
Le cot de production consiste ajouter les charges indirectes lies la production,
aux charges directes (consommation des MP, HMOD ).
La formule de calcul est la suivante :
quation 10: Formule de calcul du cot de production
Cot de production= charges directes (consommation) + charges indirectes de production
80
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 20: Cot de production du bton
BETON
Qt
PU
MT
CIMENT
0,400
1324,43211
5297,72844
GRAVETTE G1
0,595
130,43
776,07106
GRAVETTE G2
0,412 130,43211
537,380297
GRAINS DE RIZ
0,274
130,432111
357,383984
SABLE LAVE
0,538
170,432111
916,924757
ADJUVANT
6400
16,4321109
105165,51
EAU
184
368
H-MOD
60
60
CHARGES INDIRECTES
8803
415,83
3660572,61
COT DE PRODUCTION PAR LOT
8803 427.917
CHARGES DIRECTES
SABLE 0/4
3766955
Source : labor par nos soins
Tableau 21: Cot de production de l'Agglos
AGGLOS
Qt
PU
MT
CIMENT
0,100
1324,43211
132,44321
GRAVETTE G1
0,600
130,43
78,25926
GRAINS DE RIZ
0,400
130,43
52,17284
SABLE 0/4
0,700
130,43
91,30248
EAU
165
330
H-MOD
47
47
CHARGES DIRECTES
GRAVETTE G2
SABLE LAVE
ADJUVANT
81
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
CHARGES INDIRECTES
5,43
5,43
COT DE PRODUCTION PAR
LOT
1,00
736,60
736.60
102
7.22
736
(Gachet) en Kg
Unit *
Gachet = 17*6 unit
1965 / (17*6) = 102
Source : labor par nos soins
Explication des calculs :
(*) 1 Gachet = 1965 Kg
1 Gachet = 17 * 6 unit
Donc : 1 Gachet = 102 unit
1 Gachet cot 109.42 MAD
Donc : le cot unitaire = 109.42 / 102 = 1.87 MAD
Comme nous lavons cit dans la prsentation de la socit, le produit AGGLOS ,
est une srie des rfrence (20/20/50 15/20/50 10/20/50 07/20/50), ce qui
change la quantit dunit par Gachet. Donc le cot de production unitaire varie selon la
rfrence du model, mais le cot de Gachet est le mme.
4. Linventaire permanent des stocks des produits finis
Linventaire des stocks permet de dterminer le cot des sorties des produits finis
(ventes). Vu que nous somme dans la phase dinstauration du systme de calcul de cot,
donc nous ne disposons pas dinformations ncessaires fiables concernant le cot des
produits en stock.
Pour cette raison et pour le besoin futur, nous prsentons ci-dessous une fiche de
stock remplir au moment du calcul de stock.
82
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 22: Fiche de stock des produits finis
0,00
../../. Sortie
../../. Entre
0,00
../../. Sortie
../../. Entre
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Montant
../../. Entre
0,00
Prix
Unitaire
../../. Sortie
Quantit
0,00
Montant
0,00
Stock
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prix
Unitaire
Montant
Quantit
Prix
Unitaire
../../. SI
Sorties
Quantit
Mouvement
Date
Entres
../../..
Source : labor par nos soins
5. Cot de revient :
Nous obtiendrons le cot de revient, en ajoutant les charges de distribution au cot de
production dj calcul. En cas de disponibilit de plusieurs lots en stock avec des cots de
production diffrents, nous les valuons avec le CMUP au lieu de cot de production de
dernier lot.
La formule de calcul du cot de revient :
quation 11: Formule de calcul du cot de revient
Cot de revient= Cot de production + charges indirectes de distribution
83
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Tableau 23: Cot de revient de bton
BETON
Qt
PU
MT
Cot
production
de 1,00
427,92
427,92
Frais
distribution
de 1,00
0,89
0,89
428,81
428,81
PU
MT
Cot de revient
1,00
Source : labor par nos soins
Tableau 24: Cot de revient de l'Agglos
AGGLOS
Qt
Cot
production
de 1,00
7,22
7,22
Frais
distribution
de 1,00
0,89
0,89
8,11
8,11
Cot de revient
1,00
Source : labor par nos soins
6. Rsultat analytique :
Le rsultat analytique pour un produit, est la diffrence entre le prix de vente et le
cot de revient du produit.
Le rsultat global de lentreprise est constitu par la somme de tous les rsultats
analytiques de lensemble des produits et/ou services.
quation 12: Formule de calcul du rsultat analytique
Rsultat analytique = Prix de vente - Cot de revient
84
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
quation 13: Formule de calcul du rsultat global de l'entreprise
Rsultat global de lentreprise = Rsultats analytiques
Tableau 25: Rsultat analytique de bton
BETON
Qt
PU
MT
Prix de vente
1,00
750,00
750,00
Cot de revient
1,00
428.81
428.81
Rsultat
analytique
1,00
321,19
321,19
Qt
PU
MT
Prix de vente
1,00
3,10
3,10
Cot de revient
1,00
8,11
8,11
Rsultat
analytique
1,00
- 5,01
- 5,01
Source : labor par nos soins
Tableau 26: Rsultat analytique de l'Agglos
AGGLOS
Source : labor par nos soins
Tableau 27: Analyses des rsultats
Produit
Rsultat
analytique
Bton
321,19
Agglos
-5,01
Rsultat global
316,18
Source : labor par nos soins
85
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Les rsultats analytiques obtenus priori nous montrent limportance de perte
supporte par lentreprise au niveau de lAgglo.
Le rsultat unitaire par tonne de bton est de 321.19 MAD, compense la perte
engage par lAgglos (-5.01 MAD/unit).
La gestion intuitive base sur leffet dexprience et le suivi de la tendance du
march, dans une logique ractive, saperoit clairement dans les rsultats obtenus.
III. Constats :
Notre travail de conception dun systme de comptabilit analytique au sein de
lentreprise HEB Taza, nous a permis de sortir avec deux constats, concernant les cots
engags pour les deux principaux produits bton et Agglos :
Une demande forte de bton : la dynamique de secteur de lhabitat social, ainsi
les chantiers publics. Gnralement ces projets nutilisent pas lagglo base de ciment
et sable, mais leur demande se focalise sur le bton .
Le rsultat analytique ou la marge de gain de lentreprise pour le bton
supporte la perte engendre par lagglo.
Sur cette base, nous recommandons aux responsables de la socit de :
Dune part, donner plus dimportance la demande de bton, afin daccroitre
plus le chiffre daffaire, et augmenter le rsultat global de lentreprise.
Dautre part, ralentir le rythme de production de lagglo tout en essayant de
dtecter lorigine de la perte.
86
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Conclusion de seconde partie
Notre vision de travail dans lentreprise HEB a t
concrtise,
par
cette
conception
du
systme
de
comptabilit analytique, par la mthode des centres
danalyse.
Lefficacit et lefficience ont t nos principaux
objectifs, afin davoir dlimit la problmatique essentielle
de la gestion de lentreprise.
Nous avons palp dans cette partie, la complexit et
la difficult de la mise en exerce une mthode qui est simple
dans sa littrature. Mais en ralit,
elle demande une
grande analyse et surtout une logique de travail et de
raisonnement considrable.
Ainsi, la conduite dun tel projet, ncessite une
maitrise parfaite de lactivit de lentreprise, afin de fournir
des informations fiables, pour obtenir des bonnes dcisions
visant lefficacit et lefficience de lentreprise.
87
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Conclusion gnrale
Un projet de fin dtude est la synthse de tout un parcours dapprentissage dans
un domaine trs vaste, qui ncessite une capacit danalyse, cest le management
dentreprise. Notre projet consiste concrtiser le cur de notre spcialit dtude le
contrle de gestion , la maitrise du cot travers un systme de comptabilit analytique
efficace.
La conception dune comptabilit analytique dans une socit de btiments et
travaux publics est, comme nous lavons jug, dune importance suprme. En effet, elle est
indispensable la matrise des cots, la gestion des stocks et loptimisation de la
performance globale de lentreprise.
Dans ce sens, latteinte de notre objectif de dpart ncessite une tude pralable
la conception du systme mettre en uvre. Il est noter que le choix de la mthode la
plus adquate lentreprise tudie est ltape pivot, dont dpend significativement la
russite de du livrable de projet.
Comme en management du projet , une conception bien fonde donnera des
rsultats efficaces. Pour cela, nous avons consomm la majeure partie du temps de travail
dans ltape pralable.
Ceci dit, nous avons choisi une mthode qui consiste calculer le cot complet
relatif chaque produit, travers lequel nous dterminons le cot des centres de
responsabilit, qui regroupent les principales activits de lentreprise.
Grce ce systme, lentreprise arrivera produire des informations fiables et
pertinentes, permettant la prise des bonnes dcisions au bon moment. Plus encore, ce
systme permet aux responsables dassurer le suivi de lvolution des cots, des stocks et
des rsultats, et ainsi davoir une vue synthtique et transversale sur lvolution de
lactivit.
Cependant, il est impratif de noter que, tout au long de notre projet, nous avons
dvelopp uniquement le cadre conceptuel de la comptabilit analytique. En dautres
termes, nous avons mis en place les bases thoriques dun projet de cration dun service
88
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
ddi la comptabilit analytique, et nous avons prsent une version dessai qui sera
mise la disposition des responsables de lentreprise pour la pratique effective.
La mise en exergue, ncessite lengagement dun responsable dune formation
adquate, afin doptimiser les objectifs du projet. Donc, notre projet permet de crer un
poste de travail un contrleur de gestion dbutant , pour assurer le bon
fonctionnement du systme.
Enfin, il est signaler que la mise en place dun systme de comptabilit analytique
visant la maitrise de cot, nest pas laboutissement. Ce nest quune porte ouvert un
nouveau dbat, qui consiste discuter la problmatique de loptimisation du cot des
produits tout en respectant les exigences de lenvironnement. Cette problmatique
pourra tre le sujet dun PFE futur dans la mme socit, ou une autre de mmes
caractristiques.
89
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Table des matires
Liste des tableaux -------------------------------------------------------------------------------------7
Liste des figures ----------------------------------------------------------------------------------------8
Liste des formules -------------------------------------------------------------------------------------9
Liste des abrviations ------------------------------------------------------------------------------10
INTRODUCTION GENERALE ------------------------------------------------------------------------11
PREMIERE PARTIE : Le fondement thorique de la comptabilit analytique -------------13
Introduction de la premire partie --------------------------------------------------------------14
Chapitre I : La comptabilit analytique dans les PME ------------------------------------------15
Section 1 : La comptabilit analytique dans la PME : Quelle ralit ?------------------------16
I- Lintrt du contrle de gestion dans les PME --------------------------------------------------16
1- La PME, une entreprise traditionnelle ---------------------------------------------------------16
2- Existe-il vraiment un contrle de gestion aux PME -----------------------------------------18
2-1- Le contrle organisationnel --------------------------------------------------------------------18
2-2- Le contrle de gestion, fonction inadapte aux caractristiques des PME -----------18
II- La comptabilit analytique, loutil dominant dans les PME --------------------------------19
1- Historique ------------------------------------------------------------------------------------------19
2- Dfinition de la comptabilit analytique ------------------------------------------------------20
2-1-Objet de cot ----------------------------------------------------------------------------------------21
2-2-Types de cot ---------------------------------------------------------------------------------------23
3- La diffrence entre la comptabilit analytique et la comptabilit financire ---------25
3-1-La comptabilit gnrale est un outil de mesure financire ------------------------------26
3-2-La comptabilit analytique est un outil de prise de dcision -----------------------------27
Section 2 : La comptabilit analytique, un outil de gestion optimale des cots -----------28
I- Objectif de la comptabilit analytique ------------------------------------------------------------28
II- La comptabilit analytique au service du contrle de gestion -----------------------------30
Chapitre II : La problmatique dvaluation du cot de production-------------------------33
Section 1 : Les mthodes classiques ----------------------------------------------------------------34
I- La mthode du cot complet------------------------------------------------------------------------34
1- Principe de la mthode -----------------------------------------------------------------------------34
2- Intrts et limites ------------------------------------------------------------------------------------36
2-1- Intrts ----------------------------------------------------------------------------------------------36
2-2- Limites ----------------------------------------------------------------------------------------------36
II- La mthode du cot partiel------------------------------------------------------------------------36
1- Principe de la mthode -----------------------------------------------------------------------------36
2- Intrts et limites ------------------------------------------------------------------------------------37
2-1- Intrts ----------------------------------------------------------------------------------------------37
2-2- Limites ----------------------------------------------------------------------------------------------37
III- Limputation rationnelle --------------------------------------------------------------------------38
1- Principe de la mthode -----------------------------------------------------------------------------38
2- Intrts et limites ------------------------------------------------------------------------------------39
2-1- Intrts ----------------------------------------------------------------------------------------------39
2-2- Limites ----------------------------------------------------------------------------------------------39
Section 2 : Les nouvelles mthodes -----------------------------------------------------------------40
I- La mthode ABC : Activity Based Costing -------------------------------------------------------40
90
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
1- principe de la mthode -----------------------------------------------------------------------------40
2- Intrts et limites ------------------------------------------------------------------------------------40
2-1- Intrts ----------------------------------------------------------------------------------------------40
2-2- Limites ----------------------------------------------------------------------------------------------41
II- La mthode du cot prtabli---------------------------------------------------------------------41
1- Cot standard ----------------------------------------------------------------------------------------41
1-1-Principe de la mthode ---------------------------------------------------------------------------41
1-2-Intrts et limites ----------------------------------------------------------------------------------41
1-2-1- Intrts -------------------------------------------------------------------------------------------41
1-2-2- Limites -------------------------------------------------------------------------------------------42
2- Cot cible ----------------------------------------------------------------------------------------------42
2-1- Principe de la mthode ---------------------------------------------------------------------------42
2-2- Intrts et limites ---------------------------------------------------------------------------------42
2-2-1- Intrts -------------------------------------------------------------------------------------------42
2-2-2- Limites -------------------------------------------------------------------------------------------43
3- Cot budgtis ---------------------------------------------------------------------------------------43
3-1- Principe de la mthode --------------------------------------------------------------------------43
3-2- Intrts et limites ---------------------------------------------------------------------------------43
3-2-1- Intrts -------------------------------------------------------------------------------------------43
3-2-2- Limites -------------------------------------------------------------------------------------------43
Conclusion de la premire partie ----------------------------------------------------------------44
SECONDE PARTIE : La conception dun systme de cot standard au sein de lentit HEB
Introduction de la seconde partie ----------------------------------------------------------------45
Chapitre I : Prise de connaissance externe et interne de HEB -----------------------46
Section 1 : Secteur du BTP : Chiffres cls, dfis et perspectives ------------------------------46
I- les chiffres cls du secteur de BTP ----------------------------------------------------------------46
1- La contribution la croissance conomique ---------------------------------------------------46
2- L'attractivit dinvestissement -------------------------------------------------------------------47
3- La cration demploi --------------------------------------------------------------------------------49
II- les dfis et perspectives du secteur de BTP ----------------------------------------------------49
1- Dfis du secteur des BTP ---------------------------------------------------------------------------50
1-1- Louverture totale du march national du BTP ---------------------------------------------50
1-2- Lenteur du processus de rforme --------------------------------------------------------------50
1-3- Labsence dune stratgie claire et cohrente -----------------------------------------------50
1-4- La gestion traditionnelle -------------------------------------------------------------------------50
2- Les perspectives du secteur de BTP --------------------------------------------------------------51
2-1- Rythme maintenu grce aux chantiers de ltat --------------------------------------------51
2-2- Pas de crise pour le BTP -------------------------------------------------------------------------51
Section 2 : Hamss des quipements publics et Btiments (HEB) ------------------------53
I- Identification de lentreprise -----------------------------------------------------------------------53
II- Composition du groupe ----------------------------------------------------------------------------54
1- Les ralisations --------------------------------------------------------------------------------------55
2- Les produits ------------------------------------------------------------------------------------------56
Chapitre II : La conception du systme de comptabilit analytique au sein de HEB
Section 1 : le choix des mthodes ----------------------------------------------------------------58
I- la justification du choix de la mthode des centres danalyse-------------------------------58
1- Les critres de choix de la mthode --------------------------------------------------------------59
2- La mthode choisie ----------------------------------------------------------------------------------59
II- la classification des centres danalyse -----------------------------------------------------------60
91
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
1- Dfinition du centre danalyse --------------------------------------------------------------------60
2- Typologie des centres danalyse ------------------------------------------------------------------60
2-1- Centres principaux -------------------------------------------------------------------------------60
2-2- Centres auxiliaires --------------------------------------------------------------------------------60
2-3- Centres de structure ------------------------------------------------------------------------------60
3- Dcoupage de HEB en des centres danalyse ---------------------------------------------------60
Section 2 : La formation du cot de revient ---------------------------------------------------65
I- Le traitement analytique des charges ------------------------------------------------------------65
1- La dtermination des charges de la comptabilit analytique -------------------------------65
1-1- Les charges de la comptabilit gnrale ------------------------------------------------------66
1-2- Les charges non incorporables -----------------------------------------------------------------66
1-3- Les charges incorporables ----------------------------------------------------------------------67
1-4- Les charges suppltives --------------------------------------------------------------------------69
1-5- Les charges de la comptabilit analytique ---------------------------------------------------70
2- La rpartition primaire -----------------------------------------------------------------------------72
3- La rpartition secondaire --------------------------------------------------------------------------75
4- Les charges directes ---------------------------------------------------------------------------------76
II- Le calcul des cots -----------------------------------------------------------------------------------76
1- Cot dachat ------------------------------------------------------------------------------------------77
2- Linventaire permanent des stocks des matires premires -------------------------------80
3- Le cot de production ------------------------------------------------------------------------------80
4- Linventaire permanent des stocks des produits finis ---------------------------------------82
5- Cot de revient ---------------------------------------------------------------------------------------83
6- Rsultat analytique ----------------------------------------------------------------------------------84
III- Constats ----------------------------------------------------------------------------------------------86
Conclusion de la seconde partie -----------------------------------------------------------------87
Conclusion gnrale --------------------------------------------------------------------------------88
Table des matires --------------------------------------------------------------------------------------90
Bibliographie ---------------------------------------------------------------------------------------------93
Annexes ----------------------------------------------------------------------------------------------------94
92
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Bibliographie
Ouvrages :
Claude ALAZARD & Sabine SEPARI, Contrle de gestion MANUEL &
APPLICATIONS 6e dition, DECF 7 ; 2004
Christian Larguier, Gestion de la PME, Guide pratique du chef d'entreprise et de
son conseil, Editions Francis Lefebvre, (dition 2013/2014)
GUILHON Bernard, HUARD Pierre, ORILLARD Magali, ZIMMERMANN Jean-Benot
(eds), Economie de la connaissance et organisations : Entreprises, Territoires,
Rseaux, 1997 ;
Marc BOLLECKER et G. NARO, Le contrle de gestion aujourdhui : Dbats,
controverses et perspectives, dition VIBERT, 2014
Michel GERVAIS, Contrle de Gestion, 9e dition, ECONOMICA, 2009 ;
Thierry JACQUOT & Richard MILKOFF, Comptabilit de gestion Analyse et
maitrise des cots , dition Pearson, 2011 ;
Viens-Bitker C., Leclerq B. Collecte et laboration de linformation conomique
ncessaire au calcul des cots de la dcision thrapeutique. Arch. Mal. Cur,
1989, 82 (III), 49-53.
Travaux de recherches et publications :
ABOUZID Fouzia, Mmoire de fin dtude la conception dune comptabilit
analytique au sein dune PME, cas de CCGT , ISCAE 2012 ;
La direction des tudes et prvisions financires ; Le tableau de bord sectoriel,
Mai 2015 :
Marc NIKITIN, la naissance de la comptabilit industrielle en France , Thse de
doctorat, Universit de Paris DAUPHINE- 1992
Philippe Chapellier Profils de dirigeants et donnes comptables de gestion en
PME Revue internationale P.M.E. : conomie et gestion de la petite et moyenne
entreprise, vol. 10, n 1, 1997, p. 9- 41.
Pierre MEVELLEC, LES PARAMETRES DE CONCEPTION DES SYSTEMES DE
COUTS ETUDE COMPARATIVE , HAL, 8 avril 2011 ;
ZAROUALI Mohamed Jamal Eddine, Le Secteur des BTP au Maroc : Aspects
conomiques et Sociaux, septembre 2014 ;
Cours et sminaires :
BENJANA Hajar, Comptabilit de gestion Cours S3, ENCGO, 2012
OULAD SEGHIR Khalid, Contrle de gestion Cours S8, ENCGO, 2014
Site web :
Google : Des recherches sur www.google.com
HCP : http://www.hcp.ma/
LECONOMISTE : http://www.leconomiste.com/
Office de change : http://www.oc.gov.ma/portal/
Reporting business : http://www.reportingbusiness.fr/
93
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Annexe 1 : Fiche de pointage des heures machines
tat des heures de machines
Service / atelier
Responsable
Anne / mois
Code machine
Heures machines dbut
Heures machines fin
94
La proposition dun systme de comptabilit analytique : HEB Taza
Annexe 2 : Fiche de pointage des heures de main duvre
tat des heures de main doeuvre
Service / atelier
Responsable
Anne / mois
Code ou nom
Heures de dbut
Heures de fin
95
Vous aimerez peut-être aussi
- Discours de Soutenance ANDJU MichelDocument8 pagesDiscours de Soutenance ANDJU MichelCHRISTIAN LAURIC100% (6)
- MemoireDocument33 pagesMemoireKhaoula ElPas encore d'évaluation
- Comptabilité Analytique 1Document128 pagesComptabilité Analytique 1misbah mohamedPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Conception Et Mise en Place D'un Système de Comptabilité AnalytiqueDocument43 pagesRapport de Stage Conception Et Mise en Place D'un Système de Comptabilité AnalytiqueAyoub Jadia67% (3)
- La Conception de La Comptabilité Analytique Pour La Mise enDocument89 pagesLa Conception de La Comptabilité Analytique Pour La Mise enmonherz80% (5)
- Manuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueD'EverandManuel du système comptable OHADA: Théorie et pratiqueÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Etude Et Implantation Du LEANDocument77 pagesEtude Et Implantation Du LEANAIT ELHAJ BRAHIM100% (1)
- Rapport de StageDocument15 pagesRapport de StageMélène Juissie100% (8)
- Memento Comptable MarocainDocument507 pagesMemento Comptable MarocainAbderrahmaneLamriPas encore d'évaluation
- Le Controle de Gestion OperationnelDocument55 pagesLe Controle de Gestion Operationnelrachid160580% (5)
- Revue Analytique Et Contrôle Interne Outils de Détection Des RisquesDocument91 pagesRevue Analytique Et Contrôle Interne Outils de Détection Des RisquesOthmane Mourahib60% (5)
- Rapport de Stage T Comptable E T S GestiDocument33 pagesRapport de Stage T Comptable E T S GestiImane TahiriPas encore d'évaluation
- Contrôle de GestionDocument39 pagesContrôle de GestionSlimanou Shahrazed88% (8)
- Le Système d'information comptable au milieu automatiséD'EverandLe Système d'information comptable au milieu automatiséÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Méthodologie de recherche et théories en sciences comptablesD'EverandMéthodologie de recherche et théories en sciences comptablesPas encore d'évaluation
- Memoire Ramzi Juin 2007 Systeme D'information Gestion de CarrièreDocument126 pagesMemoire Ramzi Juin 2007 Systeme D'information Gestion de CarrièreRefusée Approbation Environ0% (1)
- BUSINESS PLAN Travaux DirigésDocument40 pagesBUSINESS PLAN Travaux DirigésGabriel Nk100% (4)
- Mise en Place de La Comptabilité AnalytiqueDocument65 pagesMise en Place de La Comptabilité Analytiquemohcinechekkour100% (2)
- These Professionnelle Projet Conception Comptabilite AnalytiqueDocument64 pagesThese Professionnelle Projet Conception Comptabilite AnalytiqueHamza Maarouf100% (2)
- Comptabilité Analytique EtpsDocument74 pagesComptabilité Analytique Etpsmisbah mohamedPas encore d'évaluation
- Memoire Conception Comptabilite Analytique PDFDocument85 pagesMemoire Conception Comptabilite Analytique PDFMouadHousny78% (9)
- Conception Et Mise en Oeuvre de La Comptabilité AnalytiqueDocument115 pagesConception Et Mise en Oeuvre de La Comptabilité Analytiquesindras100% (4)
- Comptabilité AnalytiqueDocument122 pagesComptabilité AnalytiqueGhizlane Bassite100% (2)
- Conception D'une Comptabilite Analytique Au Sein de La Societe InfoprintDocument82 pagesConception D'une Comptabilite Analytique Au Sein de La Societe InfoprintKhalid Boudekkara Mernissi100% (4)
- Memoire LP BonDocument54 pagesMemoire LP BonCharles OctavePas encore d'évaluation
- Le Controle de Gestion en Mouvement Ed1 v1Document322 pagesLe Controle de Gestion en Mouvement Ed1 v1Fatima Ezzahra Hirry100% (5)
- Contrôle de GestionDocument30 pagesContrôle de Gestionskba_else96% (24)
- Contrôle de Gestion DECFDocument471 pagesContrôle de Gestion DECFngzouly96% (26)
- La Gestion Budgétaire Comme Outi de Contrôle de Gestion PDFDocument161 pagesLa Gestion Budgétaire Comme Outi de Contrôle de Gestion PDFNiema OuladPas encore d'évaluation
- La Tenue de La ComptabiliteDocument33 pagesLa Tenue de La ComptabiliteHakim Alger Mg100% (1)
- Contrôle de GestionDocument15 pagesContrôle de GestionToufik ZeroukPas encore d'évaluation
- Méthode de Direct CostingDocument3 pagesMéthode de Direct Costingmaha chokrafiPas encore d'évaluation
- Introduction A La Comptabilité AnalytiqueDocument20 pagesIntroduction A La Comptabilité AnalytiqueYunessEl100% (3)
- La Comptabilité de Gestion Essai de La Mise en Place de La Méthode ABCDocument195 pagesLa Comptabilité de Gestion Essai de La Mise en Place de La Méthode ABCYou Ness100% (2)
- Comptabilité GénéraleDocument50 pagesComptabilité GénéraleKarim Malghich100% (1)
- Tenue Compt FranceDocument44 pagesTenue Compt Franceamine864550% (2)
- Organisation ComptableDocument41 pagesOrganisation ComptableHicham Alaoui0% (1)
- (MFE) Processus D - Élaboration Des BudgetsDocument54 pages(MFE) Processus D - Élaboration Des BudgetsNiema OuladPas encore d'évaluation
- Pfe GB Ab PDFDocument46 pagesPfe GB Ab PDFEl Amine50% (2)
- La Tenue de La ComptabiliteDocument42 pagesLa Tenue de La ComptabiliteHaythem Trabelsi100% (4)
- La Mise en Place Dun Outil de Contrôle de Gestionlactivity Based Costing ABC Ou Comptabilité Par PDFDocument57 pagesLa Mise en Place Dun Outil de Contrôle de Gestionlactivity Based Costing ABC Ou Comptabilité Par PDFpaco0072Pas encore d'évaluation
- Mise en Place D'une Comptabilité Par Activité Dans Un Etablissement Public de SantéDocument187 pagesMise en Place D'une Comptabilité Par Activité Dans Un Etablissement Public de SantéAiman Khemakhem100% (1)
- Memoire Online - Mise en Place D'une Comptabilité Dans Une Entreprise - Laure EsDocument24 pagesMemoire Online - Mise en Place D'une Comptabilité Dans Une Entreprise - Laure EsHervéPas encore d'évaluation
- Systeme D'information Comptable Cours-1Document15 pagesSysteme D'information Comptable Cours-1Osmän Abdøu IbrPas encore d'évaluation
- Analyse FinancièreDocument99 pagesAnalyse Financièreang19el94% (17)
- La Tenue de La Comptabilité - ABDUU Octobre 2009Document40 pagesLa Tenue de La Comptabilité - ABDUU Octobre 2009Zee Rar97% (32)
- Systeme D'info Comptable Et FinancierDocument35 pagesSysteme D'info Comptable Et FinancierSara Bennani100% (1)
- Presentation Memoire AcgsiDocument34 pagesPresentation Memoire AcgsimohcinechekkourPas encore d'évaluation
- Les Outils Du Controle de GestionDocument17 pagesLes Outils Du Controle de GestionMajdaElAzhari0% (1)
- Audit Par Cycle-IscaeDocument18 pagesAudit Par Cycle-IscaeEssoulahi EssoulahiPas encore d'évaluation
- Les Tableaux de BordDocument39 pagesLes Tableaux de BordNabil Oggadi100% (1)
- Nouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiqueD'EverandNouvelle méthode d'interprétation des états financiers - Guide d'accompagnement: Une approche socio-économiquePas encore d'évaluation
- La Performance des PME: La Performance des PME - une histoire d'amour ou : le bonheur au travail, est-ce possible ?D'EverandLa Performance des PME: La Performance des PME - une histoire d'amour ou : le bonheur au travail, est-ce possible ?Pas encore d'évaluation
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- PFE CHAYMAE LAKHLIFI Version PDFDocument93 pagesPFE CHAYMAE LAKHLIFI Version PDFMarwan Hammadi100% (1)
- PFE Cheikh Nema Cheikh AbdellahiDocument89 pagesPFE Cheikh Nema Cheikh AbdellahiTaha ElPas encore d'évaluation
- M743Document219 pagesM743Soufiane100% (1)
- Memoire FinalDocument161 pagesMemoire FinalUlrich MouafoPas encore d'évaluation
- Rapport PFE-VFDocument64 pagesRapport PFE-VFmed chahinePas encore d'évaluation
- Amélioration du Taux de Rendement Synthétique TRS (OEE) de la ligne MM02 - SOUHAÏLA LAHFOURDocument66 pagesAmélioration du Taux de Rendement Synthétique TRS (OEE) de la ligne MM02 - SOUHAÏLA LAHFOURImane BenatiaPas encore d'évaluation
- Mémoire Sahar PDFDocument78 pagesMémoire Sahar PDFHanenHanenPas encore d'évaluation
- La Méditerranée Une Interface de lUE CroquisDocument3 pagesLa Méditerranée Une Interface de lUE CroquisDaphné ScetbunPas encore d'évaluation
- Fiche Pratique 1 Calcul Et Analyse Du TurnoverDocument2 pagesFiche Pratique 1 Calcul Et Analyse Du TurnoverbellahcenePas encore d'évaluation
- MonnaieDocument14 pagesMonnaieعبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- These - Iso 9001 - v2015 PDFDocument81 pagesThese - Iso 9001 - v2015 PDFbousnina100% (1)
- Introduction Et Chapitre 1 GRHDocument45 pagesIntroduction Et Chapitre 1 GRHdaniellatshala876Pas encore d'évaluation
- Etude LogistiqueDocument36 pagesEtude LogistiquedondudonPas encore d'évaluation
- CoinbaseDocument8 pagesCoinbasedaneelec125Pas encore d'évaluation
- Guide Transition - Iatf 16949 - L'essentiel de La Version 2016Document12 pagesGuide Transition - Iatf 16949 - L'essentiel de La Version 2016Ziyad ElamraniPas encore d'évaluation
- g4 ExcelDocument6 pagesg4 ExcelTirech Cherif100% (4)
- 1533 Is Not - 3108Document2 pages1533 Is Not - 3108Nancy GUELDRYPas encore d'évaluation
- Fiscalite Et Optimisation by l33tDocument2 pagesFiscalite Et Optimisation by l33tDinoPas encore d'évaluation
- CV Emma 2Document2 pagesCV Emma 2emmanuel mamyPas encore d'évaluation
- Jauzsh DiagnosticDocument41 pagesJauzsh Diagnosticppqd8kqmwdPas encore d'évaluation
- 2semestre L2 FB 2021-2022 - 221025 - 163925Document13 pages2semestre L2 FB 2021-2022 - 221025 - 163925Sylvie RamazaniPas encore d'évaluation
- Asana Co-Marketing - FRDocument30 pagesAsana Co-Marketing - FRAgence TriomphePas encore d'évaluation
- Modèle D'examen Math Fin - 2021Document2 pagesModèle D'examen Math Fin - 2021chunchun123Pas encore d'évaluation
- Optimisation Et Efficacité Fiscale 2132Document2 pagesOptimisation Et Efficacité Fiscale 2132MarwaneEl-lamraniPas encore d'évaluation
- 2008 EL-Maliya Num 43Document66 pages2008 EL-Maliya Num 43talaini100% (1)
- 176 Revue n124 Def+cover BD DefDocument68 pages176 Revue n124 Def+cover BD Defnadine zanoniPas encore d'évaluation
- Gestion de Tresorerie 1Document75 pagesGestion de Tresorerie 1hammiPas encore d'évaluation
- Les IDE Au MarocDocument62 pagesLes IDE Au MarocJawahir SalwaPas encore d'évaluation
- Annuaire Des Associations Professionnelles Et Organisations PatronalesDocument121 pagesAnnuaire Des Associations Professionnelles Et Organisations Patronalesahcen saididj100% (1)
- TCC1Document5 pagesTCC1ogx55Pas encore d'évaluation
- Thabani Nyoni: Décembre 2020Document31 pagesThabani Nyoni: Décembre 2020Maxwell TamwoPas encore d'évaluation
- Cours FPL Controle de GestionDocument10 pagesCours FPL Controle de Gestionwijdane.missor1Pas encore d'évaluation
- Aeo 2021 - Chap2 - FRDocument30 pagesAeo 2021 - Chap2 - FRArnaud RAOUMBAPas encore d'évaluation
- TD 1Document3 pagesTD 1nada333Pas encore d'évaluation
- Quelles Sont Les Limites de La Théorie Keynésienne Daprés Les MonétaristesDocument2 pagesQuelles Sont Les Limites de La Théorie Keynésienne Daprés Les MonétaristesZakariaePas encore d'évaluation