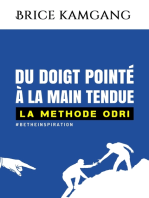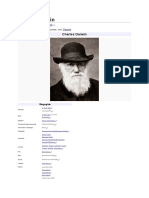Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
050107pedagogie Des Opprimes
Transféré par
GhislainCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
050107pedagogie Des Opprimes
Transféré par
GhislainDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pdagogie des opprims
de Paulo Freire
Des principes daction transposables Pour le Rseau des coles des citoyens.
Rsum et commentaires tablis par Anne Minot
Janvier 2003
Pdagogie des opprims
De Paulo Freire
Des principes daction transposables Pour le Rseau des coles des citoyens.
Ce livre a t rdig en 1969. Lauteur y expose les principes dune mthode de conscientisation quil exprimenta de1962 1964, au Brsil, o il fut charg dun vaste programme dalphabtisation par le ministre de lducation et le de la culture et qui toucha prs de deux millions dhommes et de femmes analphabtes, puis au Chili, de 1964 1967, sous le gouvernement dEduardo Frei.
Paulo Freire sinscrit dans une optique de lutte pour la libration des populations opprimes. Sa pratique dalphabtisation lamne comprendre la place primordiale de la conscientisation comme pralable toute action transformatrice. Il sefforce donc de prciser les attitudes mentales et relationnelles qui obscurcissent ou qui clairent la conscience personnelle et collective. Il appuie sa rflexion sur lanalyse marxiste des rapports de force entre les groupes humains et une thique humaniste de laction humaine. Cet ouvrage sadresse aux leaders rvolutionnaires, cest dire ceux qui accompagnent les populations opprimes dans un processus de conscientisation et de libration. Bien que situs historiquement et gographiquement, les analyses des rapports humains et les principes daction pdagogiques exposs dans ce livre me semblent transposables notre poque et dans nos pays dvelopps. Ce quon y peroit, ce nest pas dabord une page dhistoire, mais une parole forte sur les fondements de relation humaines constructrices et non destructrices, quelles se situent au niveau interpersonnel ou collectif ; une parole pour nous, aujourd'hui, dans un pays riche, o opprims et oppresseurs se trouvent dans des situations diffrentes des paysans chiliens ou brsiliens des annes 60.. Lauteur nexpose pas ici une mthode au sens oprationnel du terme mais plutt les fondements d'une action de transformation des relations humaines. Ces principes ont sembl prcieux rentendre dans le cadre de la rflexion sur la pdagogie RECIT En effet, son analyse peut fortement clairer un projet d'ducation citoyenne, aujourdhui.
La rflexion se dveloppe suivant 4 axes de questionnement :
I Pourquoi une pdagogie des opprims? Qu'est-ce que la situation d'oppression et comment s'exprime-t-elle dans la contradiction
opprim/oppresseur? Peut-on sortir de cette contradiction ? A quelles conditions ?
II Pourquoi l'ducation traditionnelle ne peut tre libratrice? Analyse de la conception "bancaire" de l'ducation et de ce qu'elle met en jeu en terme de relation
entre ducateur et duqu, mais aussi en terme de conception du savoir et de la ralit.
III Pourquoi le dialogue est au cur dun processus dducation qui a pour but la libration de lhomme ? IV Quelles sont les caractristiques dune action dialogique lacte ducatif et l'acte rvolutionnaire. ou antidialogique dans
I Pourquoi une pdagogie des opprims ?
La situation d'oppression est une situation qui dshumanise oppresseurs et opprims. Cette dshumanisation n'est pas une fatalit, ni une donne d'ordre ontologique; elle est le rsultat d'un ordre injuste qui engendre la violence et le moins-tre . C'est un processus qui peut et doit tre invers. Mais un travail pdagogique est ncessaire pour clairer les dformations de lanalyse du monde et de soimme que la situation d'oppression entrane et librer les forces de transformation. En effet, opprim et oppresseur sont dans des modes d'tre et des visions du monde et d'eux-mmes dont ils n'ont pas forcment conscience. Ils sont "immergs" dans la situation et la vivent comme incontournable et inchangeable. La prise de conscience de cette immersion , de cette "adhrence" lordre injuste tabli est le premier pas vers une libration et une transformation possibles. Elle ncessite un cheminement et un accompagnement. Ce cheminement est le premier acte de libration. Cest pourquoi pdagogie et transformation de la ralit sont intimement lies. Aucune mthode pdagogique n'est neutre mais reflte un certain style de rapport humain . La pratique de l'ducation en elle-mme est porteuse de libration ou d'alination non par le contenu des ides qu'elle transmet, mais d'abord par la relation ducateur/ duqu qu'elle instaure.
Qui est l'opprim? En quoi est-il alin ?
3
Paulo Freire analyse l'opprim comme un tre double. Il accueille en lui l'oppresseur, du fait de sa situation objective ; il est donc la fois lui-mme et l'autre. L'opprim est attir fortement par la personne de l'oppresseur et son mode de vie. Il voudrait accder ce mode de vie et l'tre de l'oppresseur. Il pense comme loppresseur, il fait sienne sa vision du monde. Dans le mme mouvement, l'opprim se dprcie ; intriorisant le jugement de l'oppresseur, il se croit incapable. L'opprim a peur de la libert, peur de courir le risque d'autre chose, de l'autonomie. Il a plutt tendance s'adapter, faire comme les autres sans pour autant arriver une solidarit authentique. L'opprim veut tre mais a peur d'tre. Il est immerg dans l'ordre tabli par l'oppresseur son profit et n'en voit pas la ralit. Tant qu'il n'a pas localis en lui-mme la prsence de l'oppresseur et tant qu'il n'a pas acquis sa propre conscience, il aura des attitudes fatalistes face sa propre situation. Pire, quelquefois, recevant la violence de la situation, il la renvoie horizontalement sur ses camarades ou sa famille. Mais, en ragissant ainsi loppression, il devient lui-mme oppresseur.
Qui est l'oppresseur?
La situation de confort de celui qui opprime repose sur linjustice impose celui qui est opprim. Toute personne, situe par sa classe sociale et son niveau de vie du ct des oppresseurs, a, de fait, intrt ce que cette situation dinjustice demeure pour continuer avoir ce qu'il a. Il est, de fait complice de loppression faite lopprim, quil soit ou non conscient, quil soit ou non personnellement responsable. L'application du droit pour tous reprsente pour l'oppresseur une grande violence son droit personnel et des restrictions importantes ce qu'il considre comme son plus-tre et sa libert. En effet, l'oppresseur, immerg dans le systme de loppression et sa logique, ne peut se concevoir lui-mme en dehors de la possession et de la domination directe, concrte, matrielle, du monde et des hommes. - Il transforme tout en objet de domination - Il voit tout en terme de profit, car l'argent est pour lui la mesure de toute chose. Par ailleurs, l'oppresseur a tendance penser quil a atteint un degr dhumanit plus lev et que cela lui est rserv. Celle des autres est mme, dans des cas extrmes considre comme une subversion - Il doute des capacits du peuple. - Il a tendance, consciemment ou pas chosifier l'autre , cest dire le nier en tant que sujet libre et conscient, ne pas lui accorder les mmes capacits. - Il pourra mme agir gnreusement pour le bien des gens, en donnant un peu de son surplus mais en gardant les personnes ainsi assistes dans ltat dinfriorit dont il a besoin pour maintenir sa situation de dominant. Cest ainsi que Paulo Freire analyse avec svrit laction humanitaire quil distingue nettement dune action humaniste . Paulo Freire nanalyse pas ici des comportements psychologiques conscients et volontaires, mais des relations objectives dans lesquelles les uns et les autres sont pris, de fait.
Le dpassement de la situation d'oppression.
Il ne sagit pas dinverser la situation doppression, mais de la dpasser, de transformer les relations oppresseurs/opprims qui sont si naturellement inscrites dans notre quotidien. Une action de libration ne peut donc utiliser les mmes procds que l'action d'oppression, mme avec un but contraire. Si cest le cas, elle ne libre personne. Il n'y a de transformation ou de dpassement de la situation d'oppression que par le 4
passage d'une relation de domination/dpendance une relation de dialogue.(Paulo Freire appelle cette relation dialogique ). Ce passage se ralise travers une prise de conscience personnelle et une analyse critique de la ralit et de sa propre situation dans cette ralit ; ce que Paulo Freire appelle un travail d insertion critique dans la ralit", qui permet une comprhension la fois subjective et objective de cette ralit: subjective parce que c'est un sujet qui comprend et agit, objective parce qu'il comprend et agit sur une ralit qui n'est pas lui. (attitude qu'il oppose deux dformations, quil appelle le subjectivisme et la rationalisation). En consquence, lacte pdagogique doit partir de la ralit de lduqu , et le mener, par la formation, une analyse et un engagement personnel. Enfin, une relation ne se transforme vraiment que par un changement dattitude des deux cts. La transformation ne peut tre mene bien par un seul des antagonistes. Elle demande la participation active , personnelle et libre de l'opprim. On ne peut librer les hommes sans eux. Elle demande aussi une transformation dattitude de celui qui accompagne lopprim.
"Personne ne libre autrui, personne ne se libre seul, les hommes se librent ensemble."
- Dans la situation d'oppression, ce n'est pas l'injustice qui est le plus grave mais c'est le type de relation sur laquelle elle repose car c'est elle qui dshumanise. La lutte pour supprimer l'injustice qui nous apparat comme une ncessit , si elle ne tend qu inverser les rapports de force, ne rsoudra pas les choses: elle les inversera peut-tre, mais ce qui importe c'est de modifier le type de relation que nous entretenons tous (opprims comme oppresseurs) avec l'autre et avec le monde
II La conception bancaire de l'ducation et lducation libratrice
La conception bancaire
Dans le chapitre II, Paulo Freire analyse les attitudes qui sous-tendent l'acte pdagogique dans les pdagogies pratiques par le groupe dominant dans une situation d'oppression. Il dfinit la conception pdagogique traditionnelle comme une"conception bancaire" de lducation parce qu'il analyse l'acte pdagogique pratiqu comme un acte de dpt d'une matire inerte et prdfinie dans un contenant vide prt recevoir et mmoriser. La situation ducateur/duqu est une situation ingale et sens unique o il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ;ceux qui parlent et ceux qui coutent ; ceux qui dposent et ceux qui sont censs archiver puis mmoriser. Lenseignement sadresse un homme abstrait qui, objectivement, nexiste pas, puisque nexistent que des hommes concrets. La ralit qui est ainsi transmise est une ralit fige, compartimente, prvisible, coupe de la ralit existentielle et globale qui pourrait lui donner sens. Cette dichotomie rend passif, ne tient pas compte de la personne duque comme sujet, ne dveloppe pas la conscience critique ; pire, elle entretient la situation d'oppression en l'aggravant, car elle justifie l'ordre tabli et l'adaptation de lopprim cet ordre. Elle rend impossible un savoir constructeur de la personne. Paulo Freire conclut alors : Il n'y a alors, ni crativit, ni transformation, ni savoir.
L'ducation libratrice
Celle-ci tablit un autre type de relation : celle de deux sujets qui sduquent mutuellement dans lanalyse de la ralit. Il ny a plus deux entits opposes : ducateur/duqu: chacun devient les deux simultanment.
"Personne n'est l'ducateur de quiconque, personne ne s'duque lui-mme, seuls les hommes s'duquent ensemble, par l'intermdiaire du monde."
L'objet de connaissance n'est plus le but de l'acte cognitif, il n'est plus la proprit de l'ducateur, mais un objet de mdiation, l'intermdiaire entre plusieurs sujets connaissant.
III Le dialogue, essence de lducation vue comme pratique de la libert.
Dans ce chapitre Paulo Freire sefforce dabord de dvelopper les fondements philosophiques de la place centrale quil accorde au dialogue dans lducation et dans lorganisation des relations humaines. Si lhomme se dfinit par la relation, le dialogue est lexpression essentielle de cette relation. Si lhomme se dfinit par la parole, le dialogue permet lchange de cette parole. (la parole est prise ici comme une parole transformatrice, cratrice, la fois langage et action) Prononcer une parole authentique, cest dj transformer le monde. La parole a deux dimensions, daction et de rflexion. Si elle nest que discours, elle est verbiage. Si elle nest quaction, elle est activisme. Or, personne ne peut prononcer une parole vritable tout seul, et personne ne peut imposer aux autres sa parole en refusant la leur. Le dialogue est donc pour ces raisons une ncessit existentielle. Il analyse ensuite les attitudes humaines que cela exige et entrane : lhumilit, lesprance, la confiance, lamour Dans un deuxime temps, il explore la place du dialogue dans la conception dune pdagogie libratrice des potentialits de lhomme. Dans une telle pdagogie, - la ralit concrte de lhomme duqu est premire, avant mme le contenu enseigner ou la ralit transformer. - ce qui duque, ce nest pas dabord ni seulement le contenu du programme , mais le type de relation que lon tablit avec celui quon duque loccasion de lchange provoqu par le sujet abord.
Le dialogue doit donc commencer ds llaboration du programme ducatif.
- Il permet de comprendre et de prendre en compte les situations concrtes de vie des personnes formes - Il permet ensuite de connatre la conscience quelles en ont, leurs divers niveaux de perception, deuxmmes et du monde dans lequel ils vivent. Cest travers le dialogue que lon peut saisir les conditions structurelles dans lesquelles le langage et la pense de lautre prend forme. Le formateur doit rechercher travers la pense langage de la personne forme, quil met en relation avec la ralit, le niveau de perception et la vision du monde de celui qui il sadresse. Il dveloppe longuement ce propos ce quil appelle dans sa mthode pdagogique la recherche de lunivers thmatique du peuple ou des thmes gnrateurs qui sont le point de dpart partir desquels se construisent les contenus..
Le dialogue rentre ensuite en jeu dans le processus mme de formation.
Cest travers le dialogue, en effet, quune situation concrte cesse dtre subie comme invitable et peut commencer sanalyser comme un problme rsoudre, un dfi adress lhomme pour crer quelque chose de nouveau.
IV Action dialogique et antidialogique.
Dans le quatrime chapitre, Paulo Freire largit son analyse critique ce quil appelle laction culturelle globale (laccompagnement des opprims par les leaders rvolutionnaires). Il dtaille les caractristiques dune action antidialogique telle quelle est pratique dans une situation doppression et, loppos, celles dune action dialogique qui fonde toute action culturelle visant la libration et le dpassement de la situation doppression.
L'action antidialogique.
Laction mene par les oppresseurs est une action antidialogique qui nie, bafoue ou se mfie du dialogue comme mode daction. Elle sappuie en effet sur:
- une attitude de conqute
Lattitude de conqute consiste dpouiller lautre de sa parole, de ses moyens dexpression, de sa culture. Conqute ou invasion culturelle o le dominant envahit le contexte culturel de l'autre avec ses modles de valeurs. Le domin, subissant cette invasion depuis lenfance (par lducation et les mdias),est immerg dans la culture du dominant, la pense comme naturelle ou lie la modernit et donc meilleure que la sienne, croit son infriorit et auto censure sa propre crativit. Il finit par se voir lui-mme et la situation dans laquelle il vit avec les yeux des dominants et non les siens. Lauteur fait ce propos la critique des institutions officielles de formation (foyers familiaux, coles primaires et secondaires, universits) qui n'chappent pas aux influences des conditions objectives de la structure environnante et fonctionnent gnralement comme des agences de formation de futurs envahisseurs". Il observe ce mme phnomne l'intrieur des familles. Pour dtruire la vision du monde de l'autre, l'oppresseur lui propose - un monde d'illusions. La mythification est une des armes culturelles de l'oppression : (le mythe selon lequel lordre de loppresseur est un ordre de libert, o chacun est libre de choisir son lieu de travail ; le mythe du droit de tous lducation ; le mythe de lgalit entre tous ; le mythe de la proprit comme fondement du dveloppement de la personne humaine ; le mythe de lardeur au travail des oppresseurs 8
et de la paresse des opprims).Le messianisme est une autre de ces illusions: (quelqu'un qui vient apporter un salut de l'extrieur pour lequel on n'a qu' suivre les instructions) - .un monde fig, statique , auquel il faut s'adapter car on ne peut rien faire d'autre. (le contraire d'un problme rsoudre ou d'un dfi adress l'homme); - la pratique de la division. Diviser pour rgner est la rgle de tous les oppresseurs. Celle-ci facilite le maintien de la domination. Diviser, isoler, maintenir dans une vision parcellaire des problmes. Pour lauteur, la mise en valeur hypocrite des revendications communautaristes relve chez certains dirigeants de cette pratique de division. - la manipulation. Manipuler, c'est chercher conformer l'autre ses objectifs propres en captant son adhsion par des moyens pervers .Quand l'autre est faible, il se laisse manipuler plus facilement. On peut manipuler par des mythes, par des pactes, par des promesses. La manipulation cherche anesthsier, empcher l'autre de penser seul, lamener sournoisement adopter sa propre pense.
L'action dialogique
Celle-ci se prsente comme l'antithse de la prcdente: L o loppresseur pratique la conqute, le leader rvolutionnaire et le peuple rechercheront des pratiques de coopration .Celle-ci repose sur la rencontre de deux sujets, sur la participation active de chacun sa libration . L o loppresseur instaure la division, l'action dialogique cherchera tablir l'union . Loin de manipuler le peuple, les leader linciteront sorganiser pour une tche commune. L o il y avait invasion culturelle, on trouvera une autre attitude culturelle o ceux qui atteignent lunivers populaire, viennent pour dcouvrir le monde avec le peuple et non pour lenseigner, pour dcouvrir les diffrences et sappuyer sur elles, pour crer ensemble une culture nouvelle sans aucune imposition de part ou dautre, arriver ce que lauteur appelle la synthse culturelle . Paulo Freire sattardent longuement aux responsabilits de ceux qui duquent le peuple. Il met en garde ceux-ci sur le fait que laction dialogique nest pas naturelle. Elle ncessite une transformation profonde de nos modes d'action habituels, labandon des mythes dont nous sommes nourris ds lenfance et qui sont trs ancrs l'intrieur de nous mmes - ce qui ne se fait pas si facilement que cela-. Il faut, en effet, "cesser d'tre "au dessus" ou " l'intrieur" comme des trangers, pour tre "avec" comme des compagnons". Il insiste aussi .sur le risque d'tre pris par la peur de la libert, du nouveau, du risque.
Conclusions provisoires
Pour conclure, quels principes peut-on retenir comme fondateurs de cette pdagogie ? - considrer lautre comme un sujet au mme titre que soi : cela suppose de tenir compte de ses connaissances, de son exprience et de sa vision du monde Le dialogue est le fondement de toute pdagogie libratrice, depuis llaboration jusqu la mise en uvre ; - Avoir conscience de soi, de sa propre situation objective, de sa culture, de ses tendances dans une relation. Il n'y a pas de solidarit relle avec l'opprim sans une transformation profonde chez l'oppresseur:dans son mode d'tre au monde, dans sa relation son propre panouissement, dans son regard sur l'autre (et en particulier l'tranger, le pauvre...) 9
- Si nous, riches du monde riche, nous voulons vraiment travailler tablir un autre monde possible, la premire exigence est une prise de conscience de nous-mmes, de notre situation objective dans le monde et une analyse sans complaisance de la vision de nous-mme et du monde quelle entrane . - Lacte pdagogique est dabord un acte de relation et de dialogue. Les contenus dducation ne peuvent se concevoir indpendamment de cette relation. Les mthodes de transmission rvlent leur sens aux contenus. On ne peut apprendre quen tant acteur de son apprentissage. Il ne sagit pas de consommer des ides, mais den produire et de les transformer grce laction et au dialogue. Il ny a pas un transmetteur, un rcepteur et un contenu extrieur quil sagirait de dposer. Il y a des sujets qui sduquent mutuellement et qui transforment leur conscience par lintermdiaire de la dmarche de comprhension du monde.
Je ne peux penser pour les autres ni par les autres ni sans les autres.
Pour plus d'informations vous pouvez consulter notre site www.recit.net Nous contacter par mail recit@recit.net ou par tlphone 06 67 05 58 95 RECIT 15 avenue Robert Fleury 78 220 VIROFLAY (France)
10
Vous aimerez peut-être aussi
- Frantz FANON - Peau Noire Masques BlancsDocument1 pageFrantz FANON - Peau Noire Masques BlancslyblancPas encore d'évaluation
- L'Accroche Narrative, Un Entraînement Pour L'Intelligence ÉmotionnelleD'EverandL'Accroche Narrative, Un Entraînement Pour L'Intelligence ÉmotionnellePas encore d'évaluation
- FLO - Intérêt de La Philosophie Négro Africain PDFDocument35 pagesFLO - Intérêt de La Philosophie Négro Africain PDFdrago_rossoPas encore d'évaluation
- INTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutDocument2 pagesINTRODUCTION Selon Jean Pierre Vernant La Question de L Origine de La Philosophie PeutArdy NsemiPas encore d'évaluation
- Dimensions Du PouvoirDocument285 pagesDimensions Du Pouvoirdavid balibalPas encore d'évaluation
- L'Invention de Soi - Une Theorie de L'iden - Kaufmann, Jean-ClaudeDocument396 pagesL'Invention de Soi - Une Theorie de L'iden - Kaufmann, Jean-ClaudeagnesmarianoPas encore d'évaluation
- Resumé-Pedagogie Des OpprimesDocument10 pagesResumé-Pedagogie Des Opprimesalexcypriano2100% (2)
- (Alice Miller Libres de Savoir Ouvrir Les Yeux BooDocument67 pages(Alice Miller Libres de Savoir Ouvrir Les Yeux BooGhislainPas encore d'évaluation
- AcculturationDocument5 pagesAcculturationArno PatyPas encore d'évaluation
- LCFF Magazine N°38 AbonnéDocument27 pagesLCFF Magazine N°38 AbonnéRaquel Marcos SánchezPas encore d'évaluation
- Pensee Africaine e EducationDocument7 pagesPensee Africaine e EducationaelijahPas encore d'évaluation
- These Corpus Belhani TobalDocument732 pagesThese Corpus Belhani TobalZïnbē MėäãmërPas encore d'évaluation
- Groupe InconscientDocument350 pagesGroupe InconscientnaoufalstitouPas encore d'évaluation
- Abbé Mbabula - La Philosofie Africaine Face A Son Age PDFDocument8 pagesAbbé Mbabula - La Philosofie Africaine Face A Son Age PDFCeleste CostaPas encore d'évaluation
- Subjectiver Le SexeDocument21 pagesSubjectiver Le SexegenrePas encore d'évaluation
- De Lestime de Soi À Lestime Du SoDocument252 pagesDe Lestime de Soi À Lestime Du Som.rouabhi40Pas encore d'évaluation
- Dossier La Violence Et Le Sacré René GirardDocument7 pagesDossier La Violence Et Le Sacré René GirardRobert LamothePas encore d'évaluation
- Introduction Aux Études de GenreDocument28 pagesIntroduction Aux Études de GenreLucie SabléPas encore d'évaluation
- Les Effets Langagiers Du Discours PolitiqueDocument16 pagesLes Effets Langagiers Du Discours PolitiquePierrot LefouPas encore d'évaluation
- La Pedagogie Des Opprimes de Paulo Freire Public3a9 en 1970Document111 pagesLa Pedagogie Des Opprimes de Paulo Freire Public3a9 en 1970DOCTOR AGONPas encore d'évaluation
- Michel Leiris, Race Et CivilisationDocument55 pagesMichel Leiris, Race Et CivilisationzarerPas encore d'évaluation
- LACAN 1973-1974 - FRDocument484 pagesLACAN 1973-1974 - FRcristianPas encore d'évaluation
- Découverte Et Évolution de La Sociologie - G1Document59 pagesDécouverte Et Évolution de La Sociologie - G1Da PotatooPas encore d'évaluation
- Etude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Document18 pagesEtude Ethnobotanique Dans Le Sud-Est de Chlef (Algerie Occidentale)Akrem ZouabiPas encore d'évaluation
- Connaître Le Potentiel Des ImagesDocument6 pagesConnaître Le Potentiel Des ImagesAlanSmithee31Pas encore d'évaluation
- Mission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur ManagementDocument336 pagesMission 2004 Comment Accroitre Les Performances Par Un Meilleur Managementludtch3321Pas encore d'évaluation
- (Adele Faber, Elaine Mazlich) Parents Épanouis, eDocument294 pages(Adele Faber, Elaine Mazlich) Parents Épanouis, eGhislain100% (2)
- La Créolisation CulturelleDocument12 pagesLa Créolisation CulturelleArmando CARVAJAL REBOLLAR100% (1)
- Etre Femme Selon TertullienDocument7 pagesEtre Femme Selon TertullienAlbocicade100% (1)
- Cours de Sociologiue: Inégalités, Familles, GenreDocument17 pagesCours de Sociologiue: Inégalités, Familles, GenreSacha CPas encore d'évaluation
- Projet Miriam Cpas de La LouviereDocument31 pagesProjet Miriam Cpas de La LouviereJaphet AnafakPas encore d'évaluation
- Histoire de L'eglise 2 Moyen AgeDocument43 pagesHistoire de L'eglise 2 Moyen AgeWendy PaulPas encore d'évaluation
- Biographie Du Père Meirad HebgaDocument6 pagesBiographie Du Père Meirad HebgaMarkus GwodogPas encore d'évaluation
- Des Psychologues À L'ecoleDocument280 pagesDes Psychologues À L'ecoleDrelinPas encore d'évaluation
- La Double ContrainteDocument36 pagesLa Double ContraintecallotPas encore d'évaluation
- 3062-1 - Au Commencement Était Le Verbe PDFDocument4 pages3062-1 - Au Commencement Était Le Verbe PDFSmooth BigmackPas encore d'évaluation
- L'Analyse ThymiqueDocument7 pagesL'Analyse ThymiqueamicusphilologiaePas encore d'évaluation
- CHARLIER-DOUCET, Rachelle - Anthropologie, Politique Et Engagement Social. L'expérience Du Bureau D'ethnologie D'haïtiDocument19 pagesCHARLIER-DOUCET, Rachelle - Anthropologie, Politique Et Engagement Social. L'expérience Du Bureau D'ethnologie D'haïtiAnonymous OeCloZYz100% (1)
- Marcel Gauchet Textes ChoisisDocument10 pagesMarcel Gauchet Textes ChoisisNICOMAQUE IIPas encore d'évaluation
- Le Problème de L'afrique Par Peter VakuntaDocument2 pagesLe Problème de L'afrique Par Peter VakuntaPeter Massimo De QuissemaPas encore d'évaluation
- Introduction WokismeDocument1 pageIntroduction WokismeiygiluhPas encore d'évaluation
- La Dynamique Des Groupes-600KoDocument17 pagesLa Dynamique Des Groupes-600KoIman LahlouPas encore d'évaluation
- Julien Freund Et L'Essence Du Politique Relation Ami Ennemi Comme Un Des Trois Pilliers Du PolitiqueDocument23 pagesJulien Freund Et L'Essence Du Politique Relation Ami Ennemi Comme Un Des Trois Pilliers Du PolitiqueMarius BertolucciPas encore d'évaluation
- Culture PDFDocument5 pagesCulture PDFSafaa NajjayPas encore d'évaluation
- BOURDIEU. Domination Masculiner ResumeDocument11 pagesBOURDIEU. Domination Masculiner ResumefpadrianPas encore d'évaluation
- L'Afro-Futurisme: Par LineDocument13 pagesL'Afro-Futurisme: Par LineLine hobballahPas encore d'évaluation
- Spiritualite & SanteDocument21 pagesSpiritualite & SanteIsmaël Louis Christian OWANLELEPas encore d'évaluation
- Theme de MemoireDocument46 pagesTheme de Memoireemana44100% (1)
- Qui Ou Qu'est-Ce Qui Est Derrière L'écran Les Aventures de La ChairDocument19 pagesQui Ou Qu'est-Ce Qui Est Derrière L'écran Les Aventures de La Chairricardofonseca01Pas encore d'évaluation
- (EXTRAIT) Culture & Interculturalité. Figures D'altérité.Document3 pages(EXTRAIT) Culture & Interculturalité. Figures D'altérité.CéliaCarpaye100% (1)
- La Fin de L'essentialisme, Pour Une Éthique UniverselleDocument6 pagesLa Fin de L'essentialisme, Pour Une Éthique UniverselleCédric Stolz NxsPas encore d'évaluation
- La Pulsion Et L'intersubjectivité - Vers L'entre-Je (U) - René Roussillon - 2010 (Châpitre)Document18 pagesLa Pulsion Et L'intersubjectivité - Vers L'entre-Je (U) - René Roussillon - 2010 (Châpitre)BRENIAUX FABIENNEPas encore d'évaluation
- DiffusionnismeDocument5 pagesDiffusionnismeYvan Tresor AssembePas encore d'évaluation
- Les Écrivains Afro Antillais À Paris by Buata MalelaDocument443 pagesLes Écrivains Afro Antillais À Paris by Buata Malelajoana AYUKPas encore d'évaluation
- Cahiers de LaudiovisuelDocument185 pagesCahiers de LaudiovisuelCherif Mouhamed Habib GueyePas encore d'évaluation
- Pendant Des SièclesDocument3 pagesPendant Des SièclesLina BOUSLIMPas encore d'évaluation
- Cours Philo 1Document10 pagesCours Philo 1jalalPas encore d'évaluation
- Mini Mémoire de La VéritéDocument13 pagesMini Mémoire de La VéritéDani FerrerPas encore d'évaluation
- Sociologie Visuelle, Photographie Documentaire Et Photo Journalisme Tout (Ou Presque) Est Affaire de ContexteDocument20 pagesSociologie Visuelle, Photographie Documentaire Et Photo Journalisme Tout (Ou Presque) Est Affaire de ContexteAna CienfuegosPas encore d'évaluation
- WebercoursDocument18 pagesWebercoursMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- IdentitéDocument3 pagesIdentitéJoel DJENGUEPas encore d'évaluation
- Louis Corman, Nietzsche Psychologue Des ProfondeursDocument2 pagesLouis Corman, Nietzsche Psychologue Des ProfondeursLuiz Carlos de Oliveira e SilvaPas encore d'évaluation
- Charles DarwinDocument36 pagesCharles DarwinZébé Médard OUGUEHIPas encore d'évaluation
- Marcel Gauchet La Fin de La Domination Masculine Débat N°200Document25 pagesMarcel Gauchet La Fin de La Domination Masculine Débat N°200Laurence Driouch100% (2)
- Inalco Fiche Passeport 2016Document2 pagesInalco Fiche Passeport 2016GhislainPas encore d'évaluation
- Socio-Psychologie de L'éducation D'adultes en Afrique SubsaharienneDocument279 pagesSocio-Psychologie de L'éducation D'adultes en Afrique SubsaharienneGhislainPas encore d'évaluation
- Spinoza Avait Raison - Antonio R. DamasioDocument354 pagesSpinoza Avait Raison - Antonio R. DamasioGhislain100% (5)
- Guide Pratique Des Formalités Administratives À L'intention Des Entrepreneurs Au Cameroun PDFDocument64 pagesGuide Pratique Des Formalités Administratives À L'intention Des Entrepreneurs Au Cameroun PDFThierry Otis100% (1)
- Organisation & Gestion Des Entreprises: Chapitre 2Document17 pagesOrganisation & Gestion Des Entreprises: Chapitre 2bouzianePas encore d'évaluation
- Bi Grammaire Chapitre 3Document30 pagesBi Grammaire Chapitre 3Oumar SaadouPas encore d'évaluation
- La Revolution FrancaiseDocument5 pagesLa Revolution Francaisealehandro ozarPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Supervision IndustrielleDocument6 pagesChapitre 1 Supervision IndustrielleJunior IssonguiPas encore d'évaluation
- Introduction A La Science PolitiqueDocument5 pagesIntroduction A La Science PolitiqueHürrem KIPIRTIPas encore d'évaluation
- Le Seigneur Et Ephraïm - Jacob LorberDocument5 pagesLe Seigneur Et Ephraïm - Jacob Lorberestaran0% (3)
- Horaires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFDocument7 pagesHoraires Aleop 312 1-9-2023 Au 28-6-2024 PDFtitouanmacheferPas encore d'évaluation
- PDF Programme Scf-2Document7 pagesPDF Programme Scf-2Kaddouri KaddaPas encore d'évaluation
- G120 CU250S2 BA13 0414 FraDocument414 pagesG120 CU250S2 BA13 0414 Frafernando NOGUEIRAPas encore d'évaluation
- S1-4 fONCTIONS CONTINUESDocument2 pagesS1-4 fONCTIONS CONTINUEST3C GamingPas encore d'évaluation
- AntidotesDocument9 pagesAntidotesStradin Bien-aimePas encore d'évaluation
- 013 Les Paraboles de Jesus en Saint LucDocument4 pages013 Les Paraboles de Jesus en Saint LucDr. Prevot Chirac BATSINDILAPas encore d'évaluation
- Notebook MF1442 3Document41 pagesNotebook MF1442 3ScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Maquette Du Master Génie Civil - Master PDFDocument4 pagesMaquette Du Master Génie Civil - Master PDFMohammed Mammar KouadriPas encore d'évaluation
- Chap 6 - Diag de ClassesDocument16 pagesChap 6 - Diag de ClassesalaesahbouPas encore d'évaluation
- Annexe Archeologie Projet Fevrier 2011Document126 pagesAnnexe Archeologie Projet Fevrier 2011Pierre KinyockPas encore d'évaluation
- Introduction XMLDocument9 pagesIntroduction XMLayoubkhPas encore d'évaluation
- Compte Rendu - at CAO Elec S2Document36 pagesCompte Rendu - at CAO Elec S2boukariPas encore d'évaluation
- PP Complet BoucettaDocument354 pagesPP Complet BoucettaRakia BenPas encore d'évaluation
- Rapport Sur COMPTABILITÉ MAROCAINE COMPTABILISATION DES ÉCARTS DE CHANGE.Document4 pagesRapport Sur COMPTABILITÉ MAROCAINE COMPTABILISATION DES ÉCARTS DE CHANGE.MOHAMED El ALAOUIPas encore d'évaluation
- CA Peut Pas Rater Epub - 6Document1 pageCA Peut Pas Rater Epub - 6vebokebPas encore d'évaluation
- Sur Un Air D'offenbachDocument12 pagesSur Un Air D'offenbachscribdPas encore d'évaluation
- Circulaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985Document3 pagesCirculaire DGS 3A 667 Bis Du 10 Octobre 1985mourad laatatPas encore d'évaluation
- Etude de Marche Des FromagesDocument3 pagesEtude de Marche Des FromagesMeryem Nejma100% (2)
- Exercices Synchrones 25487Document13 pagesExercices Synchrones 25487lukaPas encore d'évaluation
- Ballèvre Et Al - 2013 - SGMBDocument93 pagesBallèvre Et Al - 2013 - SGMBNicolas PetitmagnePas encore d'évaluation