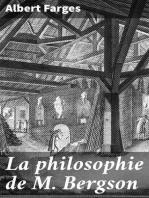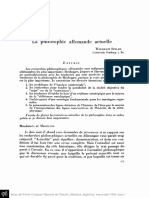Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Evans-Pritchard - Antropologie Sociale PDF
Evans-Pritchard - Antropologie Sociale PDF
Transféré par
Maxim HristiniucTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Evans-Pritchard - Antropologie Sociale PDF
Evans-Pritchard - Antropologie Sociale PDF
Transféré par
Maxim HristiniucDroits d'auteur :
Formats disponibles
E.E.
EVANS-PRITCHARD (1950)
ANTHROPOLOGIE
SOCIALE
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie partir de :
E. E. Evans-Pritchard (1950),
Anthropologie sociale
Prface de Michel Panoff.
Paris : Petite Bibliothque Payot, 1977, 177 pages. Collection
Sciences de lhomme dirige par le Dr. G. Mendel, no 132.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Comic Sans 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Les formules utilises par Engels dans ce livre ont t rcrites
avec lditeur dquations de Microsoft Word 2001.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
Table des matires
PRFACE
1.
TENDUE DU SUJET
2.
ORIGINES THORIQUES
3.
DVELOPPEMENTS THORIQUES ULTRIEURS
4.
LA RECHERCHE SUR LE TERRAIN ET LA TRADITION
EMPIRIQUE
5.
LES TUDES ANTHROPOLOGIQUES MODERNES
6.
L'ANTHROPOLOGIE APPLIQUE
BIBLIOGRAPHIE
POSTFACE de Michel PANOFF
Retour la table des matires
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
E. E. EVANS-PRITCHARD
Professeur l'Universit d'Oxford, hritier des grands fondateurs de
l'cole anglaise (Malinowski, Radcliffe-Brown), est connu en particulier
pour son admirable livre sur les Nuer.
Dans cette Anthropologie sociale, il expose, l'intention d'un large
public, ses vues sur l'objet, l'histoire et les exigences scientifiques d'une
discipline devenue fort la mode.
Michel Panoff souligne dans la postface de l'ouvrage l'actualit des
aperus thoriques du professeur Evans-Pritchard (en particulier la
discussion des notions de structure et de fonction), et met l'accent sur la
ncessit de l'enqute sur le terrain qui demeure l'honneur de la
grande tradition britannique.
Retour la table des matires
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
PRFACE
Retour la table des matires
Cet ouvrage reprsente le texte de six confrences donnes la B. B. C. au cours
de l'hiver 1950, reproduites ici telles qu'elles furent prononces, si l'on excepte
quelques petites modifications verbales sans importance.
Pour la plupart des gens, l'anthropologie sociale n'est encore gure plus qu'un
nom, aussi puis-je esprer que la radiodiffusion de ces propos permettra une meilleure comprhension de ce qu'elle est et des mthodes qu'elle utilise. Je suis persuad
que leur publication rendra le mme service. Comme il existe peu de manuels d'introduction l'anthropologie sociale, je crois que cet ouvrage peut galement tre utile
aux tudiants qui s'initient l'anthropologie dans les universits. Jy ai donc ajout
une courte bibliographie.
J'ai dj mis nombre des ides que j'exprime ici, et souvent sous la mme forme.
Je remercie les Reprsentants de Clarendon Press et les diteurs de Man, Blackfriars
et Africa de m'avoir accord l'autorisation de les reprendre ici 1.
Je remercie Mr. K. 0. L. Burridge pour l'aide qu'il m'a apporte dans la prparation de ces confrences et mes collgues de l'Institut d'Anthropologie Sociale
d'Oxford pour les commentaires critiques qu'ils en ont faits.
E. E. E.-P.
Anthropologie sociale, Confrence inaugurale prononce Oxford, le 4 fvrier 1948; Clarendon
Press, 1948; Anthropologie sociale : le pass et le prsent , confrence prononce Oxford,
Exeter College Hall, le 3 juin 1950; Man, 1950, n 198; Anthropologie sociale dans Blackfriars
1946; L'Anthropologie applique , confrence prononce la Socit Anthropologique de
l'Universit d'Oxford, le 29 novembre 1945, Africa, 1946.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
1
TENDUE DU SUJET
Retour la table des matires
Je vais essayer au cours de ces confrences de vous donner un aperu de ce qu'est
l'anthropologie sociale. Je me suis rendu compte que les profanes, et mme des gens
fort cultivs, n'en ont que de trs vagues notions. Il semble que le mot d'anthropologie
fasse surgir l'esprit des images de singes, de crnes, de rituels tranges et de
superstitions sauvages. Je ne pense pas avoir de grandes difficults vous convaincre
que ces associations d'ides sont fort loignes du sujet qui nous proccupe.
Mes explications seront fonction de cette proccupation et je n'oublierai pas qu'un
grand nombre de mes auditeurs ignorent totalement ce qu'est l'anthropologie sociale
et que les autres n'en ont qu'une ide errone. Quant ceux qui connaissent quelque
peu le sujet, je leur demanderai de me pardonner si je leur parais de temps autre un
peu lmentaire.
Dans cette premire confrence, j'essaierai de dterminer grosso modo les limites
et les ambitions de l'anthropologie. Dans les deuxime et troisime, j'en exposerai le
dveloppement thorique. Dans la quatrime, j'expliquerai en quoi consiste ce que
nous appelons travail sur le terrain. Dans la cinquime confrence, j'illustrerai par des
exemples puiss dans la recherche contemporaine l'volution des thories et du travail
sur le terrain. Dans la dernire confrence, j'expliquerai quelles peuvent tre les
applications de l'anthropologie sociale dans le domaine pratique.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
Je me limiterai l'anthropologie sociale en Angleterre dans la mesure du possible,
afin d'viter de compliquer la prsentation de mes exposs et de les surcharger car s'il
fallait relater le dveloppement de l'anthropologie en Europe et en Amrique, il me
faudrait comprimer le matriel au maximum : ce que l'on gagnerait en quantit ne
compenserait pas ce que nous perdrions sur le plan de la clart et de l'homognit.
Une restriction dans le domaine prsent n'a pas l'importance qu'elle pourrait avoir
pour d'autres disciplines car, prcisons-le, l'anthropologie sociale s'est dveloppe de
faon trs indpendante en Angleterre. Je ne manquerai pas, toutefois, de faire
mention des chercheurs trangers qui ont pu exercer une influence notoire sur la
pense des chercheurs britanniques.
Mme l'intrieur des limites que je viens de fixer, il n'est pas facile de formuler
avec prcision et clart les buts et les mthodes de l'anthropologie sociale, du fait que
les anthropologues eux-mmes professent des opinions diffrentes. Il arrive qu'ils
soient unanimes sur un certain nombre de points mais sur d'autres, les avis divergent
comme c'est souvent le cas lorsqu'il s'agit d'un sujet relativement neuf et limit; les
conflits d'opinion deviennent alors des conflits de personnalit car les savants ont une
forte propension s'identifier leurs opinions.
Je pense que les prfrences personnelles ne sont pas nocives lorsqu'elles sont
ouvertement exprimes. Ce qui est plus dangereux, ce sont les ambiguts. L'anthropologie sociale dispose d'un vocabulaire technique restreint, de sorte qu'il faut recourir au langage quotidien qui n'est, hlas, que fort imprcis. Des mots tels que
socit , culture , coutume , religion , sanction , structure , fonction , politique et dmocratie , n'ont pas toujours le mme sens selon les
diffrents utilisateurs et les diffrents contextes. Les anthropologues pourraient
certainement crer des termes nouveaux ou attribuer une signification technique
spcifique des mots emprunts au langage courant, mais outre le fait que les chercheurs auraient s'accorder sur cette signification, si cette pratique se gnralisait, le
jargon des crits anthropologiques ne serait bientt intelligible qu'aux spcialistes de
cette discipline. S'il faut choisir entre l'imprcision des termes emprunts au langage
quotidien et les obscurits du jargon spcialis, je prfre encore le moindre mal que
reprsente le langage quotidien car ce que l'anthropologie a choisi d'tudier concerne
tout le monde, elle ne doit pas se limiter ceux qui l'tudient professionnellement.
Le terme anthropologie sociale est utilis en Angleterre et, dans une certaine
mesure, aux tats-Unis, pour dsigner une certaine branche de l'anthropologie qui est
l'tude de l'homme sous diffrents aspects. Son tude porte sur les socits et les cultures humaines. En Europe, la terminologie est diffrente : quand on parle d'anthropologie (qui pour nous signifie l'tude de l'homme dans son ensemble), on se rfre
ce que nous appelons en Angleterre l'anthropologie physique, c'est--dire l'tude
biologique de l'homme. Ce que les Anglais appellent anthropologie sociale, porte, en
Europe, le nom d'ethnologie ou de sociologie.
Mme en Angleterre, l'expression anthropologie sociale n'a pris son sens actuel
que depuis peu. On a enseign cette matire sous le nom d'anthropologie ou d'ethnologie, depuis 1884 Oxford, depuis 1900 Cambridge et depuis 1908 Londres la
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
premire chaire universitaire qui porta le nom d'anthropologie sociale fut celle de Sir
James Frazer Liverpool en 1908. Le sujet s'est vu rcemment reconnatre une importance accrue et l'anthropologie sociale est enseigne sous ce nom dans un certain
nombre d'universits de Grande-Bretagne et du Commonwealth. Comme elle est
l'une des branches du vaste sujet que reprsente l'anthropologie, on l'enseigne souvent
conjointement avec les autres branches : anthropologie physique, ethnologie, archologie prhistorique et parfois linguistique et gographie humaine. Comme les deux
dernires matires ne figurent que rarement au programme des examens d'anthropologie dans ce pays, je ne m'en occuperai pas. Pour ce qui est de l'anthropologie
physique, elle n'a que peu de rapports avec l'anthropologie sociale pour le moment,
tant surtout une branche de la biologie du fait qu'elle comprend des sujets tels que
l'hrdit, la nutrition, la diffrenciation des sexes, l'anatomie compare, la physiologie des races et la thorie de l'volution de l'homme.
C'est avec l'ethnologie que nous entretenons les liens les plus troits. Il est
indispensable pour le comprendre de savoir que l'anthropologie sociale estime que
son champ d'action englobe toutes les cultures et toutes les socits humaines, la
ntre y compris, bien que, pour des raisons que j'exposerai plus loin, elle ait choisi de
s'attacher plus particulirement l'tude des socits primitives. Les ethnologues
tudient les mmes peuples et c'est pourquoi il existe un lien troit entre les deux
disciplines.
Il importe de prciser toutefois que si l'anthropologie sociale et l'ethnologie s'intressent aux mmes types de populations, leurs buts sont fort diffrents. S'il n'existait
pas autrefois de frontire bien nette entre l'anthropologie sociale et l'ethnologie, elles
sont dornavant considres comme des disciplines clairement distinctes. La tche de
l'ethnologue consiste classer les populations sur la base de leurs caractristiques
raciales et culturelles, puis d'expliquer leur rpartition actuelle ou passe en fonction
des mouvements de population, des mlanges et de la diffusion des cultures.
La classification des peuples et des cultures constitue une dmarche prliminaire
essentielle aux comparaisons qu'effectue l'anthropologie sociale entre les socits
primitives, parce qu'il est plus pratique, je dirai mme ncessaire, de commencer par
comparer des peuples appartenant un mme type de culture c'est--dire ceux que
Bastian rpartissait, il y a fort longtemps, en provinces gographiques 1. Lorsque
toutefois les ethnologues cherchent reconstituer l'histoire des peuples primitifs,
ceux qui ne possdent pas d'archives historiques, ils se voient obligs de partir de
dductions bases sur des preuves indirectes pour laborer des conclusions qui ne
peuvent raisonnablement constituer qu'un faisceau de probabilits. Il arrive aussi
qu'un certain nombre d'hypothses diffrentes ou mme contradictoires concourent
aux mmes conclusions. De sorte que l'ethnologie n'est pas de l'histoire au sens
courant du terme, car l'histoire ne dit pas quels vnements auraient pu se produire,
mais ceux qui ont eu lieu rellement, et comment. L'ethnologie tant incapable de
nous renseigner avec prcision sur la vie sociale passe des peuples primitifs, ses
1
Adolf Bastian : Controversen in der Ethnologie, 1893.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
spculations, qu'il faut dissocier de ses classifications, n'ont qu'une signification limite pour l'anthropologie sociale.
On considre volontiers l'archologie prhistorique comme une branche de l'ethnologie, parce qu'elle cherche reconstituer l'histoire des peuples et des cultures
d'aprs les indices culturels et les dbris humains mis au jour par les fouilles des
gisements gologiques. Elle s'appuie aussi sur les preuves indirectes et, comme
l'ethnologie, n'est gure utile l'anthropologie sociale sur le plan qui l'intresse, c'est-dire les ides et les institutions des civilisations dont les archologues classent les
ossements et les objets qu'ils dcouvrent.
Une autre branche de l'anthropologie, la technologie compare, celle surtout des
peuples primitifs, est aussi, telle qu'on l'enseigne habituellement, un complment de
l'ethnologie et de la prhistoire.
La tche de l'anthropologie sociale est tout autre. Elle analyse, comme je le dmontrerai bientt, le comportement social, gnralement sous ses formes institutionnalises telles que la famille, les systmes de parent, l'organisation politique, les
modes de procdure lgale, les cultes religieux, etc., et les relations existant entre ces
diverses institutions; elle les tudie soit dans les socits contemporaines, soit dans
les socits historiques pour lesquelles il existe suffisamment d'informations dignes
de foi permettant de procder ces tudes.
Ainsi, tandis que telle coutume d'un peuple, localis sur une carte de rpartition,
intresse l'ethnologue en tant que preuve d'un mouvement ethnique et culturel ou
indice d'une relation passe entre populations, elle intressera galement l'anthropologue en tant que portion du systme social de cette population l'poque actuelle. Il
est possible que cette coutume ait t emprunte une autre population, mais une
telle probabilit n'a gure de signification pour l'anthropologue puisqu'on ne peut
dmontrer avec certitude qu'elle ait t emprunte et si tel est le cas, il est pratiquement impossible de dterminer quand, comment et pourquoi cet emprunt s'est
produit. Certaines populations d'Afrique orientale, par exemple, considrent le soleil
comme le symbole de leur divinit. Certains ethnologues y verront l'indice d'une
influence de l'gypte ancienne. L'anthropologue, sachant qu'il ne peut dmontrer le
pour ou le contre de cette hypothse, cherchera plutt tablir une relation entre ce
symbolisme solaire et l'ensemble des croyances et des cultes de ces populations. S'il
arrive que l'ethnologie et l'anthropologie sociale utilisent les mmes lments
d'information ethnographique, c'est dans un but trs diffrent.
Le programme des cours d'anthropologie l'universit pourrait tre reprsent par
trois cercles intersects figurant respectivement les tudes de biologie, d'histoire et de
sociologie ; les intersections reprsenteraient alors l'anthropologie physique, l'ethnologie (comprenant elle--mme l'archologie prhistorique et la technologie compare), et l'anthropologie sociale. Bien que l'homme primitif constitue un sujet d'tude
commun ces trois disciplines anthropologiques, elles n'en ont pas moins, comme
nous l'avons vu, des buts et des mthodes trs diffrents et c'est au travers de circonstances historiques, en relation avec la thorie darwinienne de l'volution, qu'elles sont
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
10
enseignes des degrs divers dans les universits et figurent conjointement au programme de l'Institut Royal d'Anthropologie.
Mes collgues ne sont certes pas tous satisfaits de ces arrangements. Certains
d'entre nous voudraient voir l'tude de l'anthropologie associe plus troitement
celle de la psychologie ou ce qu'il est convenu d'appeler les sciences sociales, comme par exemple la sociologie, l'conomie, les sciences politiques, tandis que d'autres
verraient volontiers l'anthropologie enseigne en mme temps que des matires fort
diverses. La question est videmment complexe et je n'ai aucunement l'intention de
m'tendre plus avant. Je me bornerai dire que les solutions dpendent surtout de
l'optique dans laquelle on considre l'anthropologie sociale, d'autant plus qu'il existe
des opinions fort diffrentes entre ceux qui considrent l'anthropologie comme une
science naturelle et ceux qui, comme moi, la rangent dans le domaine des humanits.
Cette divergence d'opinion s'accentue plus encore lorsqu'on cherche dterminer les
rapports de l'anthropologie avec l'histoire. J'apporterai quelques prcisions ce sujet
dans une autre confrence, car il est indispensable de connatre l'volution du sujet
pour comprendre les raisons de ces divergences d'opinion.
Je viens, d'une manire quelque peu dcousue, de dterminer brivement la position de l'anthropologie sociale en tant que discipline universitaire. Je vais donc
dsormais ne parler que d'anthropologie sociale, sujet de ces confrences et seul sujet
dans lequel je sois comptent. Lorsque je parlerai d'anthropologie, sans ncessairement prciser anthropologie sociale , il faudra nanmoins comprendre que c'est de
l'anthropologie sociale qu'il s'agit.
Il me semble indispensable, avant d'aller plus loin, de rpondre la question :
Qu'est-ce que les socits primitives et Pourquoi les tudie-t-on ? Puis
j'expliquerai ce que nous tudions prcisment chez elles et de quelle faon.
Le mot primitif tel qu'il est dsormais compris par la littrature anthropologique ne signifie aucunement que ces socits aient connu une existence antrieure
celles d'autres socits ou qu'elles leur soient infrieures. Pour autant que nous le
sachions, les socits primitives ont connu une histoire au moins aussi longue que la
ntre. D'une certaine faon, et bien qu'elles ne jouissent pas d'un degr de dveloppement quivalent au ntre, il arrive aussi que dans certains domaines elles rvlent
des dveloppements plus pousss.
Cela tant dit, on peut arguer que le mot est mal choisi, mais il est dsormais tellement ancr dans la langue qu'on peut difficilement lui en substituer un autre.
Nous nous bornerons donc prciser que les anthropologues utilisent ce terme
pour dsigner des socits qui sont numriquement restreintes, occupent un territoire
peu tendu, ont des contacts sociaux extrieurs limits et n'ont en comparaison de
socits plus avances qu'une technologie et des structures conomiques sommaires
et o l'on observe une fonction sociale peu spcialise. Certains anthropologues ajou-
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
11
teraient sans doute d'autres caractristiques, comme l'absence de littrature et, partant
de l, de toute systmatisation de l'art, de la science et de la thologie 1.
On nous reproche parfois de consacrer trop de temps l'tude des socits primitives. On a dit encore qu'il serait plus utile de consacrer ce mme temps l'laboration d'une solution aux problmes de notre propre socit. Une telle suggestion n'est
pas draisonnable, mais il se trouve que pour de multiples raisons, ces socits
primitives retiennent depuis longtemps l'attention de ceux qui s'intressent aux institutions sociales. Ds le XVIIIe sicle, elles retinrent l'attention des philosophes parce
qu'elles offraient l'exemple de ce qu'on supposait tre la condition de l'homme vivant
l'tat naturel, avant l'institution d'un gouvernement civil. Au XIXe sicle, elles mobilisrent aussi l'intrt des anthropologues qui pensaient que ces socits fourniraient
d'importants indices quant l'explication de l'origine des institutions. Plus tard, les
anthropologues s'intressrent elles parce qu'elles offraient l'exemple d'institutions
rduites leur plus simple expression et qu'il est de rgle de commencer toute tude
par l'examen du plus simple pour parvenir l'examen du plus complexe et pour lequel
l'tude du plus simple constitue un apport positif.
Cette dernire raison de s'intresser aux socits primitives prit une importance
accrue au fur et mesure que se dveloppait ce qu'il est convenu d'appeler l'anthropologie fonctionnelle d'aujourd'hui, car plus on se rend compte que la tche de l'anthropologie sociale consiste tudier les institutions sociales en tant que parties interdpendantes des systmes sociaux, plus il s'impose d'tudier ces socits aux structures trs simples, aux cultures trs homognes et qu'on peut tudier dans leur ensemble, avant de se lancer dans l'analyse de socits civilises plus complexes, donc
beaucoup moins faciles cerner.
D'autre part, l'exprience a prouv qu'il est plus facile d'observer des peuples dont
la culture diffre totalement de la ntre, l'tranget et les particularits de leur mode
de vie nous tant rapidement videntes, ce qui fait que l'interprtation bnficiera
d'une plus grande objectivit.
Il existe une autre raison dterminante d'tudier les socits primitives l'heure
actuelle : elles se transforment si rapidement qu'il faut les tudier maintenant, avant
qu'elles ne puissent plus l'tre. Ces systmes sociaux qui disparaissent constituent des
variations structurales uniques dont l'tude nous aide considrablement comprendre
la nature de la socit humaine, car dans une tude comparative des institutions, le
nombre de socits tudies est moins significatif que l'tendue de leurs variations.
En dehors de cette considration, l'tude des socits primitives comporte une valeur
intrinsque. Elles sont intressantes en elles-mmes du fait qu'elles offrent la description du mode de vie, des valeurs et des croyances de peuples qui vivent dmunis de
ce que nous considrons normalement comme les lments minimum du confort et de
la civilisation.
Il nous semble par consquent indispensable de procder une tude systmatique d'un nombre maximum. de ces socits primitives, d'autant plus que les anthro1
Robert Redfield : The Folk Society , The American Journal of Sociology, 1947.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
12
pologues n'en ont tudi fond qu'un nombre restreint, de telles tudes exigeant
beaucoup de temps et les anthropologues n'tant pas encore trs nombreux.
Bien que nous nous intressions surtout aux socits primitives, je tiens souligner que nous ne bornons pas nos tudes ces seules socits. En Amrique, o
l'anthropologie sociale est plus favorise dans les universits qu'en Angleterre et dans
le Commonweath, les Amricains ou des chercheurs forms par eux ont fait des
tudes trs importantes sur des socits plus volues : en Irlande, au Japon, en
Chine, en Inde, au Mexique, au Canada et aux tats-Unis mme.
Je consacrerai l'une de mes confrences l'tude d'Arensberg et de Kimball sur
l'Irlande du Sud.
Pour diverses raisons, comme le manque de personnel et le nombre considrable
de peuples primitifs dans les pays du Commonweath, les anthropologues britanniques
ont pris un certain retard sur ce point prcis, mais ils sont en train de compenser en
tendant leur champ d'action des populations qui ne sauraient en aucun sens tre
tiquetes comme primitives. Durant ces dernires annes, les tudiants de l'Institut
d'Anthropologie Sociale d'Oxford se sont lancs dans diverses tudes de communauts rurales en Inde, aux Antilles, en Turquie, en Espagne, ainsi que chez les
Bdouins d'Afrique du Nord, et de la vie rurale et urbaine en Angleterre. Il faut aussi
parler des tudes anthropologiques rcentes faites par les anthropologues britanniques
sur des socits historiques, les sources littraires se substituant ici l'observation
directe. Je pense notamment des tudes telles que celles de Sir James Frazer sur les
anciens Hbreux et certains aspects de la culture romaine, de Sir William Ridgeway
et de Jane Harrison dans le domaine hellnique, de Robertson Smith sur la socit
arabe ancienne, d'Hubert sur l'histoire des Celtes.
Je me dois de souligner que l'anthropologie sociale, au moins thoriquement, est
l'tude de toutes les socits humaines et pas seulement des socits primitives,
mme si dans la pratique et par commodit, elle se consacre l'heure actuelle surtout
aux institutions de peuples moins complexes car il est bien vident qu'il ne peut
exister de discipline spare, limite l'tude de ces seules socits. Lorsqu'un
anthropologue fait une enqute parmi un peuple primitif, il tudie la langue, la loi, la
religion, les institutions politiques, l'conomie et ainsi de suite... de sorte qu'il
s'intresse aux mmes sujets que le chercheur qui tudie ces phnomnes dans les
grandes civilisations. N'oublions pas qu'en interprtant des observations amasses
chez les peuples primitifs, l'anthropologue les compare toujours, mme de faon
implicite, sa propre socit.
L'anthropologie sociale doit donc tre considre comme faisant partie des tudes
sociologiques; c'est une branche dont l'tude s'attache plus particulirement aux
socits primitives. Lorsqu'on parle de sociologie, on pense plutt l'tude de problmes particuliers aux socits civilises. Si nous attribuons ce mot ce sens particulier, la diffrence entre l'anthropologie sociale et la sociologie rside alors dans le
choix du champ d'action, mais, prcisons-le, il existe aussi de grandes diffrences sur
le plan des mthodes. L'anthropologue tudie directement les socits primitives; il
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
13
habite sur place pendant des mois ou des annes, tandis que la recherche sociologique
s'effectue principalement sur la base de documents et de statistiques. L'anthropologue
tudie les socits en tant qu'entits. Il tudie l'cologie, l'conomie, les institutions
politiques et juridiques, les structures familiales, les systmes de parent, les religions, les techniques, les arts, etc. en tant que partie intgrante de systmes sociaux
globaux. Le travail d'un sociologue, d'un autre ct, est gnralement trs spcialis,
du fait qu'il s'attache des phnomnes isols tels que le divorce, la criminalit,
l'hygine mentale, l'agitation sociale et les motivations de l'industrie. La sociologie a
de nombreux points communs avec la philosophie sociale et la planification sociale.
Elle cherche non seulement dcouvrir comment fonctionnent les institutions, mais
essaye de dcider comment elles devraient fonctionner et, pour ce faire, comment les
modifier; toutes ces proccupations sont parfaitement trangres l'anthropologie.
Lorsque je parlerai de sociologie au cours de ces confrences, ce n'est pas dans ce
sens mais d'un point de vue beaucoup plus vaste, c'est--dire en tant qu'ensemble des
connaissances thoriques concernant les socits humaines.
C'est la relation entre cet ensemble de connaissances thoriques et la vie sociale
primitive qui constitue le sujet de l'anthropologie sociale. Ce dernier point ressortira
clairement lorsque j'aurai trac les grandes lignes de son histoire, car beaucoup de nos
connaissances conceptuelles ou thoriques se fondent sur des crits qui n'ont en
aucune faon (et mme indirectement) de rapport avec les socits primitives. Je vous
demanderai donc de tenir compte, tout au long de ces confrences, de deux faits
intimement lis : l'largissement de la thorie sociologique, dont la thorie anthropologique n'est qu'un aspect, et l'accroissement des connaissances concernant les socits primitives auxquelles on a appliqu la thorie sociologique, laquelle fut ensuite
reformule en un ensemble de connaissances spcialises s'appliquant elles.
Je dois maintenant dfinir la place de l'anthropologie sociale au sein d'un domaine
culturel beaucoup plus vaste, afin de donner une ide claire des problmes que doit
affronter l'anthropologue. Je me ferai certainement mieux comprendre en numrant
quelques sujets de thse soutenus par les tudiants en anthropologie d'Oxford au
cours de ces dernires annes.
Voici les titres des quelques thses rcentes : La situation du chef dans le
systme politique actuel des Ashanti (Afrique Occidentale), tude de l'influence
des changements sociaux contemporains sur les institutions Ashanti , Fonction
sociale de la religion dans une communaut Sud-indienne (les Coorgs), L'organisation politique des Nandi (Afrique Orientale), Structure sociale en Jamaque, en
fonction des distinctions raciales , Le rle de la dot dans certaines socits
africaines , tude du symbolisme de l'autorit politique en Afrique , tude
comparative des diverses formes d'esclavage , Organisation sociale chez les Yao,
du Nyassaland du sud (Afrique Centrale), Rgime foncier chez les Bantous
d'Afrique orientale , Le statut des femmes chez les Bantous du Sud (Afrique du
Sud), Inventaire des sanctions sociales des tribus Naga de la frontire indobirmane , Organisation politique des Prairies (Amrique du Nord), tude des
litiges frontaliers chez les Ashanti (Ouest africain), Signification du rang social en
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
14
Mlansie , Organisation sociale chez les Esquimaux du centre et de l'est ,
Dlits et droit coutumier (Indonsie et Afrique).
On verra d'aprs ces quelques titres de quelle nature sont les tches et les
proccupations des anthropologues; on remarquera tout d'abord que la plupart de ces
sujets de thses n'ont rien de particulirement envotant; elles ne s'attachent ni
l'exotisme, ni au pittoresque et n'ont rien de bien romanesque. Ce sont des enqutes
prcises et prosaques sur divers types d'institution sociale.
Il faut remarquer galement que ces enqutes portent sur des peuples ou des
groupes de populations spcifiques situs en Afrique, en Inde du Sud, en Jamaque,
la frontire indo-birmane, en Amrique du Nord, dans les rgions polaires, dans les
les du Pacifique et l'Indonsie. Je tiens attirer l'attention sur cette large distribution
gographique afin de souligner combien le champ d'action de l'anthropologie est
vaste, et s'il permet la recherche de s'exercer dans des pays fort varis, il prsente de
ce fait des difficults certaines quant l'enseignement et, dans une certaine mesure,
exige une certaine spcialisation rgionale. Au sens le plus troit son domaine comprend les peuplades mlansiennes et polynsiennes du Pacifique, les aborignes
d'Australie, les Esquimaux et les Lapons des rgions polaires, les peuples mongols de
Sibrie, les peuples noirs d'Afrique, les Indiens du continent amricain et les groupes
les moins volus de l'Inde, de Birmanie, de Malaisie et d'Indonsie, c'est--dire des
milliers de cultures et de socits diffrentes. Au sens le plus large, la recherche
anthropologique englobe les populations plus volues, quoique relativement simples, des territoires asiatiques, de l'Afrique du Nord, d'Europe, ce qui reprsente une
quantit norme de cultures et de sous-cultures, de socits et de socits secondaires.
On remarquera galement que l'chantillonnage des thses cites plus haut comprend des tudes portant sur les institutions politiques et religieuses, les questions de
classes et de castes fondes sur la couleur, le sexe et le rang social, les institutions
conomiques, les institutions juridiques ou para-juridiques, le mariage, l'adaptation au
milieu social, l'organisation sociale tout entire et les structures de l'un ou l'autre
peuple. L'anthropologie sociale ne s'occupe pas seulement des diverses socits humaines, mais effectue aussi des recherches trs diverses. Tout dpartement d'anthropologie suffisamment quip au point de vue du personnel s'efforce de traiter pendant
les cours sur les socits primitives, un minimum de notions essentielles sur le chapitre des liens de parent, de la famille, des institutions politiques compares, de
l'conomie compare, des religions compares et des systmes juridiques compars,
en mme temps que des notions plus gnrales sur les institutions, les thories sociologiques en gnral et l'histoire de l'anthropologie sociale. Certains cours portent
aussi sur l'tude des socits de certaines rgions ethno-gographiques; d'autres cours
traitent de questions plus spcifiques telles que la morale, la magie, la mythologie, les
sciences, l'art primitif, les techniques primitives, les langues et bien entendu des
thses de tel ou tel anthropologue ou sociologue.
Il est bien vident qu'un anthropologue, tout en ayant une connaissance gnrale
des diverses rgions ethnologiques et des disciplines sociologiques, ne peut tre un
expert que dans une ou deux matires. Il en va de mme pour l'anthropologie que
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
15
pour les autres domaines scientifiques : la spcialisation va de pair avec l'acquisition
de connaissances plus gnrales. L'anthropologue deviendra donc un spcialiste des
questions africaines, mlansiennes, ou s'attachera plus particulirement l'tude des
Indiens d'Amrique. Il ne cherchera plus alors dborder le cadre des territoires qu'il
a choisi d'tudier, l'exception de monographies gnrales traitant de questions qui
rejoignent le sujet de ses propres proccupations, comme dans le cas d'tudes traitant
des institutions juridiques ou religieuses auxquelles il s'intresse particulirement. On
a dj consacr une abondante littrature aux Indiens d'Amrique par exemple, ou
aux Bantous, pour qu'un chercheur puisse s'attacher aux uns ou aux autres exclusivement.
La tendance la spcialisation devient de plus en plus marque ds l'instant o la
population tudie possde une littrature ou se rattache une tradition littraire et
culturelle plus largie. Le chercheur qui s'intresserait particulirement aux Bdouins
ou aux paysans arabes doit immanquablement connatre la langue parle ainsi que la
langue classique de leur hritage culturel, ou dans le cas des communauts paysannes
indiennes, il lui faudra avoir de solides notions de littrature et de sanscrit, langue
classique de la tradition rituelle et religieuse.
L'anthropologue, tout en limitant ses recherches certaines rgions, doit approfondir un ou deux sujets pour devenir un vritable spcialiste sinon il ne sera qu'un
Matre-Jacques. Il n'est pas possible de procder une tude comparative des systmes juridiques primitifs sans possder dj un srieux bagage en matire de droit et
de jurisprudence en gnral, ou d'tudier l'art primitif sans avoir une solide culture
dans le domaine artistique.
Comme on le voit, l'enseignement de l'anthropologie n'est pas facile, surtout
lorsque (et c'est le cas d'Oxford en particulier) elle est enseigne aprs la licence ou
au niveau de la recherche; quand un grand nombre d'tudiants travaillent sur des
documents concernant des territoires trs loigns les uns des autres ou sur des
problmes trs diffrents, il est vident qu'il est trs difficile de leur accorder individuellement une attention suffisante. Sir Charles Oman fait allusion cette situation
lorsqu'il cite le cas des professeurs d'histoire d'Oxford qui tentrent sans succs d'laborer un enseignement convenable pour des licencis qui s'en vont l'aveuglette au.
gr de leur fantaisie 1. Il faut avouer que la situation n'est pas aussi grave en anthropologie qu'en histoire, car l'anthropologie sociale se prte plus la gnralisation et
possde des bases thoriques gnrales que n'a pas l'histoire. Non seulement, il existe
des similitudes manifestes entre les diffrentes socits primitives dans le monde,
mais elles peuvent en outre se classer par l'analyse structurale en un nombre limit de
types, ce qui donne au sujet une certaine unit. Les anthropologues tudient une
socit primitive de la mme manire, qu'elle se trouve en Polynsie, en Afrique ou
en Laponie; quant au sujet particulier de leur recherche, systmes de parent, cultes
religieux ou institutions politiques, il est tudi en fonction de l'ensemble de la structure sociale dans laquelle il est inscrit.
Charles Oman : On the Writing of History, 1939, p. 252.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
16
Avant d'expliquer plus en dtails ce que nous appelons structure sociale, je tiens
souligner une autre particularit de ces thses car elles posent un problme essentiel
pour l'anthropologie actuelle, sur lequel je reviendrai dans une autre confrence.
Toutes les thses ont pour sujet des thmes sociologiques, c'est--dire qu'elles
procdent l'analyse approfondie des relations sociales, des rapports entre les membres d'une mme socit ou entre diffrents groupes sociaux. Ce que je cherche
prciser ici, c'est que ce sont des tudes de socits plutt que de cultures. La diffrence trs profonde qui existe entre les deux concepts a orient la recherche et la
thorie anthropologiques dans deux directions diffrentes.
Laissez-moi vous donner quelques exemples. Lorsqu'on entre dans une glise
anglaise, on voit les fidles enlever leur chapeau et garder leurs chaussures, mais la
mosque, on verra les musulmans enlever leurs chaussures et conserver leur chapeau.
On observera le mme phnomne en entrant dans une maison anglaise ou sous une
tente de Bdouins. Ce sont l des diffrences de culture ou de coutume. Le but et la
fonction du comportement est le mme dans les deux cas : il vise une manifestation
de respect, mais il s'exprime de faon diffrente dans les deux cultures. Voici maintenant un exemple plus complexe : les Bdouins arabes nomades possdent un certain
degr le mme type de structure sociale que certaines populations nilotiques seminomades d'Afrique orientale, mais leurs cultures respectives sont diffrentes. Les
Bdouins vivent dans des tentes, les Nilotiques dans des huttes et sous des auvents.
Les Bdouins possdent des troupeaux de chameaux, les Nilotiques lvent des btes
cornes, les Bdouins sont musulmans, les autres appartiennent une autre religion
et ainsi de suite. Un autre exemple, plus complexe encore, consisterait tablir la
distinction entre ce que nous nommons civilisation hellnique et civilisation hindoue
- et socit hellnique et socit hindoue.
Nous nous trouvons devant deux concepts diffrents ou deux abstractions issues
d'une mme ralit. Bien qu'on ait cherch donner une dfinition propre chacune
et que la relation de l'une avec l'autre ait fait l'objet de nombreuses discussions, on a
rarement examin ces questions de faon systmatique; elles demeurent donc assez
confuses. Parmi les premiers anthropologues, Morgan, Spencer et Durkheim concevaient le but de ce qu'il est dsormais convenu d'appeler l'anthropologie sociale,
comme la classification et l'analyse fonctionnelle des structures sociales. Ce point de
vue est encore celui des adeptes de Durkheim en France. Il subsiste parmi certains
anthropologues britanniques d'aujourd'hui ainsi que dans la sociologie formelle
allemande 1. D'un autre ct, Tylor et un certain nombre de chercheurs, plus particulirement ports vers l'ethnologie, pensent que le but de l'anthropologie est de classer
et d'analyser les cultures. Ce point de vue domina pendant longtemps l'anthropologie
amricaine et s'explique, je pense, par le fait qu'ils tudiaient des socits indiennes
qui, fractionnes ou dsintgres, se prtaient plus facilement des enqutes culturelles qu' des recherches sur les relations sociales; il faut ajouter que les chercheurs
amricains n'avaient pas l'habitude du travail intensif sur le terrain, lacune due leur
ignorance des langues vernaculaires (au contraire des chercheurs britanniques) et que
Georg Simmel : Soziologie, 1908; Leopold von Wiese : Allgemeine Soziologie, 1924.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
17
les Amricains taient plus enclins tudier la culture et les coutumes que les relations sociales. Il existe videmment d'autres raisons leur prise de position.
Lorsqu'un anthropologue dcrit une socit primitive, la distinction entre la
socit et la culture s'estompe parce qu'il dcrit la ralit, le comportement de base
qui d'une certaine faon les contient toutes les deux. Il dcrira par exemple de quelle
faon un individu manifeste du respect ses anctres; mais lorsqu'il s'agit d'interprter ce comportement, il doit en dgager des abstractions la lumire des problmes
particuliers qui le proccupent. Si ce sont des problmes de structure sociale, il doit
envisager l'ensemble des relations sociales des individus concerns par l'enqute,
plutt que d'entrer dans le dtail de l'expression culturelle.
C'est ainsi qu'une interprtation, qui peut n'tre que partielle, du culte des anctres
pourrait consister dmontrer en quoi il est compatible avec les structures familiales
ou les liens de parent. Les actions culturelles ou coutumires accomplies par un
homme dans le but d'exprimer son respect ses anctres, le fait par exemple qu'il fait
un sacrifice et que ce sacrifice consiste en un buf ou une vache, requiert une
interprtation diffrente; celle-ci peut tre partiellement et la fois psychologique et
historique.
Cette distinction mthodologique est encore plus vidente lorsque l'on entreprend
des tudes comparatives, car si l'on cherche donner simultanment deux sortes
d'interprtations, on est presque certain, dans la plupart des cas, de tomber dans la
confusion. Dans les tudes comparatives, on ne doit pas comparer les choses en ellesmmes mais certains dtails particulirement caractristiques. Si l'on dsire faire une
comparaison sociologique du culte des anctres dans un certain nombre de socits,
on doit comparer des ensembles de relations structurales entre individus. On commence donc ncessairement, dans chacune de ces socits, par isoler ces relations de
leur mode particulier d'expression culturelle, sinon la comparaison ne sera pas
possible. Ce que l'on fait, c'est de srier les problmes afin de les tudier sparment
en fonction de la recherche qu'on se propose de faire. De cette faon, on n'tablit pas
de distinctions entre diffrents types de phnomnes (la socit et la culture ne sont
pas des entits), mais on distingue entre diverses sortes d'abstractions.
Si j'ai prsent plus haut l'anthropologie sociale comme l'tude des cultures et des
socits primitives, c'est justement pour ne pas compliquer les choses ce stade. Je
viens d'expliquer o rsidait la difficult et, pour le moment, je m'en tiendrai l; mais
je tiens rappeler combien les opinions sur ce sujet restent divises vu l'extrme
complexit du problme. Je dois souligner encore que l'tude des problmes poss
par la culture conduit, et doit conduire mon avis, les dfinir dans le cadre de l'histoire ou de la psychologie, tandis que les problmes poss par l'tude des socits
humaines doivent tre dfinis dans le cadre de la sociologie. Je pense, quant moi,
que les deux sortes de problmes sont aussi importants l'un que l'autre, mais on doit
avant toute autre chose procder une tude structurale.
Je reviendrai donc aux thses. Quiconque a pu lire certaines d'entre elles a pu
remarquer qu'elles ont toutes un point commun; elles analysent tout ce qu'elles
doivent analyser : la chefferie, la religion, les diffrences raciales, le rgime de la dot,
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
18
l'esclavage, le rgime foncier, le statut de la femme, les sanctions sociales, le rang, la
procdure juridique, etc., non pas en tant qu'institutions isoles et autonomes mais en
tant que parties intgrantes des structures sociales et en fonction de ces structures.
Qu'appelle-t-on alors une structure sociale? Je ne puis, au cours de cette premire
confrence, donner une rponse dfinitive et je resterai donc assez vague; j'y reviendrai par la suite, mais je dirai d'ores et dj que les avis sur ce point divergent invitablement. Il est extrmement difficile de dfinir une fois pour toutes ce type de
concept de base. Je vais tout de mme essayer de vous donner quelques indications
prliminaires sur ce que nous dsignons gnralement par le terme de structure.
Il est manifeste qu'on trouve des constantes et des lments de rgularit dans la
vie sociale, qu'une socit doit fonctionner selon un certain ordre, sinon ses membres
ne pourraient vivre ensemble. Les individus savent quel comportement ils sont censs
avoir, ils connaissent le comportement que les autres individus dans les diverses
circonstances de la vie sont censs adopter; ils s'arrangent donc pour coordonner leurs
activits selon des rgles tablies et une certaine chelle de valeurs, car c'est la seule
faon pour eux de vaquer leurs affaires, sparment ou ensemble, et donc se
maintenir au sein de la socit. Ils peuvent prvoir, anticiper les vnements et vivre
en harmonie avec leurs semblables, parce que chaque socit possde une forme ou
un cadre qui nous permet de parler de systme ou de structure, l'intrieur de laquelle
et selon laquelle se droule la vie de chaque individu. L'usage du mot structure dans
ce sens implique l'existence d'une certaine cohrence, d'une suite logique du comportement des membres d'une socit, suffisamment du moins pour viter les controverses et les conflits violents; la structure implique une durabilit que n'ont pas la
plupart des phnomnes de la vie humaine.
Il arrive que les individus qui vivent au sein d'une socit ne soient pas ou ne
soient que partiellement conscients des structures de cette socit. C'est prcisment
le rle de l'anthropologue de dcouvrir ces structures.
Une structure sociale totale, c'est--dire la structure tout entire d'une socit donne, se compose d'un certain nombre de structures ou systmes subsidiaires; c'est
alors que nous parlons de systme de parent, de systme conomique et de systme
politique et religieux.
Les activits sociales l'intrieur de ces systmes ou structures s'organisent autour
d'institutions telles que le mariage, la famille, les marchs, la chefferie, etc. Lorsque
nous parlons des fonctions de ces institutions, nous entendons le rle qu'elles jouent
dans le maintien de la structure.
Je pense que la plupart des anthropologues seraient plus ou moins d'accord avec
ces dfinitions. C'est lorsque nous commenons nous demander quelle sorte d'abstraction est une structure sociale et ce que nous entendons par fonctionnement d'une
institution, que nous nous heurtons aux premires difficults et que les avis diffrent.
J'espre que ces questions apparatront plus clairement une fois que j'aurai donn un
aperu de l'volution thorique de l'anthropologie sociale.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
19
2
ORIGINES THORIQUES
Retour la table des matires
Je vais essayer, au cours de cette seconde confrence, et au cours de la suivante,
de donner un aperu de l'histoire de l'anthropologie. Je n'ai nullement l'intention de
dresser ici une sorte d'inventaire chronologique des anthropologues et de leurs crits;
je voudrais plutt retracer l'volution des concepts gnraux de l'anthropologie, de ses
thories et illustrer cet inventaire en m'appuyant sur quelques anthropologues et leurs
crits 1.
Nous venons de voir que l'anthropologie est une discipline trs nouvelle, en ce
sens qu'elle n'est enseigne dans les universits que depuis peu de temps et plus
rcemment encore sous ce nom. D'un autre ct, on peut dire qu'elle est ne en mme
temps que les toutes premires spculations de l'humanit, car partout et de tout
temps, les hommes ont cherch expliquer la nature de la socit. Il est donc malais
de dterminer exactement quand est ne l'anthropologie sociale. Cela dit, il n'est pas
indispensable ni profitable, au-del d'un certain point, d'essayer de retrouver le point
de dpart. L'anthropologie a vritablement vu le jour au cours du XVIIIe sicle. Elle
est l'enfant de ce Sicle des Lumires dont elle porte encore l'empreinte.
1
Voir les ouvrages de : A. C. Haddon : History of Antropology, d. rev. et corrige, 1934; Paul
Radin : The Method and Theory of Ethnology, 1933; T. K. Penniman : A Hundred years of
Anthropology, 1935; R. H. Lowie : The History of Ethnological Theory, 1937.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
20
En France, on peut parler d'anthropologie partir de Montesquieu (1689-1755).
Son ouvrage le plus clbre, De l'Esprit des lois (1748), trait de philosophie
politique, et mme sociale, est surtout connu pour les thories trs particulires que
professait Montesquieu; il pensait que le climat avait une influence sur le caractre
des peuples; on connat aussi ses remarques sur la sparation des pouvoirs dans le
gouvernement. S'il nous intresse au plus haut point, c'est qu'il pensait dj que dans
une socit, tous les phnomnes taient interdpendants les uns des autres.
On ne peut comprendre le droit international constitutionnel, criminel et civil que
si l'on prend en considration le rapport qui existe entre eux, ainsi que celui existant
entre l'environnement physique d'une population, l'conomie, le nombre d'individus,
les croyances religieuses, les coutumes et les manires et le temprament particulier
de ces individus. Le but de son ouvrage est d'examiner:
... tous ces rapports : ils forment tous ensemble ce qu'on appelle l'Esprit des
lois 1.
Montesquieu a utilis le mot lois dans des sens diffrents, mais il entendait
gnralement ... les rapports ncessaires qui drivent de la nature des choses 2,
c'est--dire les conditions qui rendent possible l'existence d'une socit humaine et les
circonstances prcises qui permettent une socit particulire d'exister. Le temps
qui m'est imparti ne me permettra pas d'analyser les arguments de Montesquieu plus
en dtail, mais je tiens nanmoins souligner la distinction qu'il tablit entre la notion
de nature d'une socit et son principe ; la nature est ce qui la fait telle et son
principe, ce qui la fait agir. L'une est sa structure particulire et l'autre, les passions
humaines qui la font mouvoir 3... Il fait donc la distinction entre la structure sociale
et le systme de valeurs qui fonctionne l'intrieur de celle-ci.
Aprs Montesquieu, l'anthropologie franaise se poursuit avec des crivains tels
que d'Alembert, Condorcet, Turgot et, d'une manire gnrale, les Encyclopdistes et
les Physiocrates jusqu' Saint-Simon (1760-1825), qui fut le premier mettre la
notion d'une science de la socit . Ce descendant d'une illustre famille tait un
homme remarquable. Authentique produit du Sicle des Lumires, il croyait passionnment la science et au progrs; il dsirait par-dessus tout laborer une science
positive des relations sociales qui, selon lui, taient analogues aux relations organiques en physiologie : il insistait sur le fait que les savants doivent analyser les faits et
non les concepts. On comprend pourquoi la plupart de ses disciples taient socialistes
et collectivistes; le mouvement finit par s'enliser dans une sorte de passion religieuse
et par s'vanouir tout fait dans la strile recherche de la femme idale, celle qui
aurait pu jouer le rle du Messie fminin. Le disciple le plus clbre de Saint-Simon,
qui finit par se fcher avec lui, fut Auguste Comte (1798-1857).
1
2
3
De l'Esprit des Lois, d. Gonzague Truc, Garnier, p. 11.
Ibid., p. 5.
Ibid., p. 23.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
21
Comte tait un penseur plus systmatique que Saint-Simon mais ne lui cdait en
rien sur le plan de l'excentricit; c'est lui qui baptisa la science nouvelle de la socit :
il l'appela sociologie . Les nombreux philosophes rationalistes franais qui suivirent, restrent dans la ligne directe de la tradition saint-simonienne; Durkheim et ses
disciples, ainsi que Lvy-Bruhl, devaient donner le ton l'anthropologie britannique
et l'influencer profondment.
En Angleterre, les moralistes cossais furent les anctres de notre anthropologie et
leurs crits sont trs caractristiques du XVIIIe sicle. Les plus connus sont David
Hume (1711-1776) et Adam Smith (1723-1790). On ne les lit plus gure de nos jours.
Ces philosophes soutenaient que les socits sont des systmes naturels; ils entendaient par l que la socit dcoule de la nature humaine et non d'un contrat social, au
sujet duquel Hobbes et tant d'autres avaient abondamment crit. C'est dans ce sens
qu'ils parlaient de moralit naturelle, de religion naturelle, de jurisprudence naturelle
et ainsi de suite. D'aprs eux les socits, considres en tant que systmes naturels
ou organismes, devaient tre tudies empiriquement ou inductivement et non selon
les mthodes prnes par le rationalisme cartsien. La thse de Hume en 1739 s'intitulait Trait de la nature humaine : tentative d'introduction d'une mthode exprimentale de raisonnement pour l'tude des sujets de morale . Ils taient galement de
grands thoriciens et ils s'attachrent surtout dfinir ce qu'ils appelaient les
principes gnraux et que nous appelons aujourd'hui des lois sociologiques 1.
Ces philosophes taient persuads que le progrs est sans limites, l'appelant encore amlioration et perfectibilit; ils croyaient aussi l'existence de lois du progrs.
Pour laborer ces lois, ils eurent recours ce que Comte appela plus tard la mthode
comparative.
Cette mthode, telle qu'ils l'utilisrent, impliquait qu'en tous lieux et en tous
temps, la nature humaine demeure fondamentalement la mme, que les individus suivent tous le mme chemin par des stades identiques, qu'ils avancent graduellement en
mme temps que de faon continue vers un tat de perfection; il est toutefois reconnu
que certains n'y arrivent que plus lentement que les autres.
Il est exact qu'il n'existe aucune preuve tangible de ce qui s'est pass aux premiers
stades de notre histoire mais, la nature humaine tant constante, on peut donc supposer que nos anctres vcurent de la mme faon que les peaux-rouges d'Amrique et
autres peuples primitifs lorsqu'ils vivaient dans des conditions similaires et un
niveau culturel quivalent. En comparant toutes les socits connues et en les classant
selon leur degr d'amlioration, il devient alors possible de reconstituer l'histoire de
notre socit et de toutes les socits humaines, bien qu'il soit impossible de dterminer avec certitude quand et quels vnements furent gnrateurs de progrs.
Dugald Stewart qualifiait cette dmarche d'histoire thorique ou conjecturale.
C'est une sorte de philosophie de l'histoire qui cherche isoler les grands vnements
et les courants gnraux et considre les vnements particuliers comme de simples
1
Gladys Bryson : Man and Society, 1945.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
22
incidents. Lord Kames formule ainsi cette mthode : Nous devons nous contenter
de rassembler les faits et les circonstances que nous pouvons trouver dans les lois des
diffrents pays : si, une fois runis, ces faits constituent un systme plausible de
causes et d'effets, nous pouvons rationnellement conclure que le progrs a t le mme pour toutes les nations, tout au moins dans les circonstances les plus importantes
de l'histoire de ces nations; car les accidents, c'est--dire les caractres particuliers
une population ou un gouvernement, produiront toujours certaines particularits 1.
Puisque ces lois du dveloppement existent et qu'une mthode permet de les dcouvrir, il va de soi que la science humaine que ces philosophes cherchaient laborer,
tait une science normative, visant la cration d'une thique matrialiste fonde sur
l'tude de la nature humaine dans la socit.
Nous avons dj dans les spculations des crivains du XVIIIe sicle les fondements d'une thorie de l'anthropologie telle qu'elle sera formule au sicle suivant, et
mme l'poque actuelle : importance des institutions, thse selon laquelle les socits humaines sont des systmes naturels, insistance sur l'utilit d'une mthode empirique et inductive dans le but de dcouvrir et de formuler les principes universels des
lois, et cela en fonction des stades du dveloppement mis au jour par l'usage de la
mthode d'histoire conjecturale et dont le but ultime enfin consiste dterminer
scientifiquement une thique.
Ces crivains ont jou un rle important dans l'histoire de l'anthropologie : ils ont
cherch formuler des principes gnraux et s'efforcrent d'tudier des socits et
non des individus. Pour tablir ces principes gnraux, ils tudirent les institutions,
les inter-relations structurelles, leur croissance et les besoins auxquels elles rpondaient. Adam Ferguson, par exemple, dans son ouvrage Commentaire sur l'histoire
de la socit civile (1767), ainsi que dans d'autres, aborde divers sujets : les modes
de subsistance, la varit des races humaines, la tendance de l'homme se grouper en
socits, les principes de croissance dmographique, les arts, le commerce, le rang
social de l'individu et la rpartition sociale.
Les socits primitives occupaient une part importante des questions qui intressaient les philosophes et ceux-ci pour leur documentation avaient recours ce qui
avait t crit sur ces socits, mais en dehors de leur propre culture et de leur
poque, l'Ancien Testament et les classiques restaient leur source principale. On
n'avait des socits primitives que d'assez pauvres notions, bien que les voyages des
explorateurs du XVIe sicle eussent, mme l'poque de Shakespeare, par exemple,
contribu laborer une certaine image du sauvage, comme par exemple celui que
personnifiait Caliban pour les gens cultivs; les crivains qui tudiaient les questions
politiques et juridiques ou les coutumes, commenaient prendre conscience de la
grande diversit des coutumes des divers peuples en dehors d'Europe. Montaigne
(l533-1592) en particulier consacra de nombreuses pages de ses Essais ce que
nous appellerions aujourd'hui la documentation ethnographique.
Aux XVIIe et XVIIIe sicles, les philosophes prirent comme exemple les socits
primitives pour tayer leurs thories sur la nature des socits barbares, par opposi1
Lord Kames : Historical-Law-Tracts, vol. I, 1758, p. 37.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
23
tion aux socits polices, c'est--dire les socits au stade prcdant l'tablissement
d'un gouvernement, que ce gouvernement soit librement choisi ou accept sous la
pression d'un despote. C'est ces socits que Locke (1632-1714), en particulier, fait
allusion lorsqu'il nonce ses thories sur la religion, le gouvernement et la proprit.
Il avait lu tous les ouvrages consacrs aux peaux-rouges de la Nouvelle-Angleterre,
mais le fait qu'il ne connaissait qu'un type de socit amrindienne contribua fortement fausser son optique.
Les crivains franais de cette poque conurent l'homme naturel d'aprs ce qu'on
avait crit au sujet des Indiens du Saint-Laurent, en particulier ce qu'avaient dit
Sagard et Joseph Lafitau au sujet des Hurons et des Iroquois 1. Rousseau s'inspira largement de ce qu'il avait lu sur les Carabes d'Amrique du Sud.
Si j'ai fait mention de l'usage qu'ont fait certains auteurs du XVIe et du XVIIIe
sicle, des ouvrages traitant des peuples primitifs, c'est parce qu'ils ont marqu le
dpart d'un intrt pour les socits moins volues qui ne devait pas se dmentir; cet
intrt pour la nature et l'volution des institutions sociales au milieu du XIXe sicle,
devait donner naissance ce qui est depuis devenu l'anthropologie.
Les crivains franais et anglais dont j'ai parl, taient ce qu'on nommait l'poque des philosophes et ils se considraient comme tels. En dpit de leurs nombreuses
discussions sur l'empirisme, il se fiaient plus la rflexion et au raisonnement priori
qu' l'observation directe de socits existantes. La plupart du temps, l'exception
peut-tre de Montesquieu, ils se servaient de faits pour illustrer ou corroborer les
thories auxquelles ils aboutissaient par pure spculation. Ce n'est que vers le milieu
du XIXe sicle, qu'on se mit faire des tudes systmatiques sur les institutions
sociales. Entre les annes 1861 et 1871 furent publis des ouvrages que nous considrons comme les classiques de notre discipline : Ancient Law de Maine (1861) et
son autre ouvrage : Village-Communities in the East and West (1871), Das
Mutterrecht de Bachofen (1861), La Cit Antique de Fustel de Coulanges (1864),
Primitive Marriage de MeLennan (1865), Primitive Culture de Tylor (1871), et
Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family de Morgan (1871).
Il est vrai que ces livres n'taient pas tous directement consacrs aux socits
primitives. Maine s'occupait des socits de la Rome ancienne et en gnral des peuples indo-europens; Bachofen tudiait les traditions et les mythologies de l'antiquit
classique, mais ceux dont les recherches ne s'appliquaient pas particulirement aux
socits primitives tudiaient des institutions qu'on pouvait leur comparer, de par leur
stade volutif peu avanc et traitaient leur sujet d'un point de vue sociologique,
comme je vais le dmontrer.
Ce sont McLennan et Tylor en Angleterre et Morgan en Amrique qui se penchrent les premiers sur les socits primitives, trouvant que le sujet mritait que des
savants s'y arrtent. Ils furent les premiers slectionner parmi la grande quantit
1
Gabriel Sagard : Le grand voyage du pays des Hurons, 1632; J. F. Lafitau : Moeurs des sauvages
Amriquains compares aux murs des premiers temps, 1724. Voir aussi J. L. Myres, in British
Association for the Advancement of Science, Winnipeg, 1909.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
24
d'crits consacrs aux peuples primitifs, des informations qu'ils grouprent de faon
systmatique, jetant ainsi les premires bases de l'anthropologie sociale.
Les auteurs du milieu du XIXe sicle, comme les philosophes avant eux,
cherchaient dgager la recherche sur les institutions sociales de toute vaine spculation. Ils pensaient russir en adoptant une dmarche strictement empirique et
l'emploi rigoureux de la mthode comparative. On a vu comment cette mthode fut
applique par les philosophes sous le nom d'histoire hypothtique ou conjecturale.
C'est Auguste Comte qui lui donna une dfinition nouvelle et plus prcise dans son
Cours de Philosophie Positive (1830). On verra comment l'anthropologie moderne,
l'ayant dbarrasse de son historicisme, la redfinit en tant que mthode fonctionnelle.
Selon Auguste Comte, il existe une relation fonctionnelle entre les faits sociaux
de diffrente sorte, ceux que Saint-Simon et lui-mme appelaient des sries de
faits sociaux, politiques, conomiques, religieux, moraux, etc. Tout changement au
sein de l'une de ces sries provoque des changements correspondants dans les autres
sries. C'est l'tablissement de ces correspondances ou inter-dpendances entre une
catgorie de fait social et une autre, qui constitue le but de la sociologie. On atteindra
ce but en appliquant la mthode logique des variations concomitantes, parce qu'elle
est la seule mthode valable dans le cas d'un phnomne social trs complexe dans
lequel il est difficile d'isoler les variables simples.
C'est l'appui de cette mthode que les crivains dont j'ai parl, mais encore ceux
qui les suivirent, crivirent d'normes volumes destins expliquer les lois qui
rgissent l'origine et l'volution des institutions sociales : le mariage monogame dcoulait de la promiscuit, la proprit du communisme, le contrat du statut, l'industrie
du nomadisme, la science positive de la thologie, le monothisme de l'animisme. Il
arriva parfois, sur le chapitre des questions religieuses en particulier, que les explications fournies s'inspirent des motivations psychologiques (que les philosophes
appelaient nature humaine) ou encore des incidences historiques. Les deux grands
sujets de discussion taient alors l'volution de la famille et de la religion. Les
anthropologues victoriens n'taient pas prs de se lasser de ces deux sujets et c'est en
analysant certaines de leurs conclusions qu'on trouvera l'explication de l'orientation
anthropologique de cette poque : tout en restant violemment opposs sur certains
points, en Particulier sur la question de savoir comment interprter les phnomnes,
ils se retrouvaient d'accord sur les buts et les mthodes.
C'est un juriste cossais, Sir Henry Maine (1822-1888), qui fut le fondateur en
Angleterre du droit compar ; il prtendait que la famille patriarcale constitue la
forme originelle et universelle de la vie sociale et que l'autorit absolue du patriarche,
poutre matresse de cet difice, a donn naissance un certain stade de toutes les
socits, l'agnation, c'est--dire la filiation en ligne masculine. Un autre juriste, le
Suisse Bachofen, aboutit a une conclusion diamtralement oppose quant la forme
de la famille primitive; fait curieux, lui et Maine publirent leurs conclusions au
cours de la mme anne. Selon Bachofen, il y eut d'abord et partout promiscuit, puis
les systmes sociaux matrilinaire et matriarcal apparurent et ce n'est que beaucoup
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
25
plus tard dans l'histoire de l'homme que ces systmes se virent remplacs par le
systme patrilinaire et patriarcal.
Un troisime juriste, toujours cossais, J. F. McLennan (1827-1881), croyait
fermement aux lois gnrales de l'volution sociale, mais il avait ses propres paradigmes et ne se priva point de ridiculiser les thses de ses contemporains. Il pensait
en effet que les premiers hommes vivaient dans un tat de promiscuit sexuelle, alors
que toutes les preuves connues concordent dmontrer qu'ils vivaient partout en
petits groupes matrilinaires et totmiques et qu'en outre, ils pratiquaient la vengeance du sang. Ces hordes, sur le plan politique, taient indpendantes les unes des
autres, chacune tait constitue en groupe exogamique, consquence directe de l'infanticide des nouveau-ns de sexe fminin, de sorte que les hommes enqute d'pouses devaient aller les chercher dans d'autres tribus. Ces premires socits, en pratiquant la polyandrie, finirent par remplacer leur systme matrilinaire par le systme
patrilinaire, tandis que la famille adoptait peu peu la structure que nous lui
connaissons maintenant. Il y eut d'abord la tribu, puis la gens et enfin la famille. La
thse de McLennan fut reprise par un autre cossais, grand spcialiste de l'Ancien
Testament et l'un des fondateurs de la religion comparative, William Robertson Smith
(1846-1894), qui l'appliqua aux premiers documents relatant l'histoire des Arabes et
des Hbreux 1.
Sir John Lubbock (1834-1913), devenu Baron Averbury, prtendit aussi que le
mariage tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu de la promiscuit primitive 2.
Cette opinion semble avoir pris des proportions quasi obsessionnelles chez les
crivains de ce temps. La thorie la plus complique et, dans une certaine mesure, la
plus fantastique qu'ait engendre la mthode comparative, fut celle d'un juriste
amricain, L. H. Morgan (1818-1881), qui prtendait entre autres choses, que l'volution de la famille et du mariage ne traversait pas moins de quinze stades, partant de
l'tat de promiscuit archaque pour aboutir au mariage monogame et la famille telle
que nous la trouvons constitue dans la civilisation occidentale. Engels, sduit par
l'hypothse des phases, reprit ces thories fantaisistes et les incorpora la doctrine
marxiste.
On peut remarquer, dans les divers crits des auteurs dont nous avons parl plus
haut, quelle norme importance ils accordaient ce que McLennan nommait des
symboles et Tylor des survivances . Les survivances sociales se voyaient compares aux organes rudimentaires de certains animaux et aux lettres muettes de
certains mots. Elles sont dpourvues de toute fonction fondamentale et, en auraientelles une, qu'elle ne saurait tre que secondaire et trs diffrente de la fonction originale. Ces auteurs pensaient que ces survivances, n'tant que des vestiges du temps
pass, apportaient la preuve que cette srie de stades sociaux tait en fait une srie
historique; une fois dtermin l'ordre selon lequel se droulent ces stades, il nous
reste essayer de dfinir quelles sont les influences qui provoquent le passage d'un
stade un autre. Robertson Smith pensait, comme McLennan avant lui, que la coutume du lvirat confirme l'hypothse selon laquelle la polyandrie, dans une socit
1
2
Kinship and marriage in early Arabia, 1885.
The Origin of Civilisation, 1870.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
26
donne, tait pratique une poque antrieure. Dans le mme ordre d'ides, Morgan
prtendait que le systme classificatoire de la terminologie de parent, selon lequel un
individu appelle pre tous les individus mles de la mme gnration que son
pre, mre toutes les femmes de la gnration de sa mre, frre et sur
tous les enfants de ces individus et fils et fille tous les enfants de ceux-ci,
dmontre que les membres de ces socits archaques avaient d vivre auparavant
dans un tat de promiscuit sexuelle plus ou moins accuse.
Lorsqu'on examine de quelle faon les anthropologues du XIXe sicle tudiaient la
religion, on retrouve l'emploi de la mme mthode, bien qu'ici, comme je l'ai mentionn, on trouve une combinaison de spculations relevant de l'histoire et de la psychologie, avec en plus certaines considrations s'inspirant de la nature humaine. C'est
ainsi que Sir Edward Tylor (1832-1917), qui se montra gnralement plus prudent et
plus critique que la majorit de ses contemporains et vita soigneusement de tomber
dans l'outrance du systme des stades , chercha dmontrer que toutes les croyances religieuses et tous les cultes drivent de la mauvaise interprtation de phnomnes tels que les rves, les transes, les visions, les maladies, l'tat de veille et celui
du sommeil, de la vie et de la mort.
Sir James Frazer (1854-1941), qui fut le premier crivain de talent prsenter
l'anthropologie au grand public, croyait lui aussi fermement aux lois sociologiques :
l'volution des socits passe par trois stades successifs, la magie, la religion et la
science. Selon lui, l'homme primitif tait domin par la magie qui, comme la science,
interprte la nature comme une srie d'vnements se produisant suivant un ordre
invariable, sans l'intervention d'agents personnifis 1. Bien que le magicien, comme
le savant, accepte les lois de la nature, ces lois qu'il croit connatre et pouvoir utiliser
ses propres fins, ne sont pas, dans le cas du magicien, de vritables lois mais des
lois imaginaires. Avec le temps les individus les plus intelligents de la socit finirent
par s'en apercevoir; pour compenser cette dsillusion, ils fabriqurent des tres
spirituels aux pouvoirs suprieurs ceux des mortels, donc des divinits qui pouvaient changer le cours de la nature au profit de l'homme, pour autant qu'on leur consacre un culte propitiatoire. Le stade de la religion est donc atteint. L'homme devait
s'apercevoir nouveau de son erreur et c'est alors l'avnement du troisime et dernier
stade de son volution, le stade scientifique.
Les anthropologues victoriens furent, certes, de brillants chercheurs. Ils possdaient une vaste culture et leur intgrit intellectuelle ne saurait faire de doute. Ils
accordrent sans doute trop d'importance aux similitudes de coutume et de croyance
et pas assez aux variations et aux diffrences, mais ils s'attaquaient cependant un
problme rel et nullement imaginaire : trouver l'explication des similitudes remarquables existant dans des socits souvent extrmement lointaines les unes des autres,
historiquement et gographiquement; nous leur devons videmment un grand nombre
de nos notions anthropologiques modernes, La mthode comparative leur permettait
de distinguer le particulier du gnral et, partant de l, d'tablir une classification des
phnomnes sociaux.
J. G. Frazer, Ghe Golden Bough The Magic Art, 1922, vol. l, p. 51.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
27
C'est Morgan qui le premier a jet les bases de l'tude comparative des systmes
de parent, qui est devenue une partie essentielle de la recherche anthropologique.
McLennan a laiss une documentation trs importante dmontrant la pratique trs
frquente du mariage par capture dans les crmonies nuptiales des socits nonvolues; en outre il fut le premier dmontrer que l'exogamie (terme dont il est le
crateur) et le totmisme sont des pratiques trs rpandues dans les socits primitives, et par consquent nous lui devons deux des plus importants de nos concepts.
On doit McLennan et Bachofen, contre-courant de la thse des origines patriarcales de la famille, d'avoir attir l'attention sur l'existence de socits matrilinaires
dans toutes les parties du monde et de lui avoir attribu l'importance qu'elle mritait
sur le plan sociologique. Tylor, entre autres contributions importantes, a dmontr
l'universalit des croyances animistes et dota notre vocabulaire du terme animisme . Frazer tablit l'universalit des croyances magiques et expliqua que leur structure logique peut, par l'analyse, tre rduite deux types lmentaires, la magie homopathique et la magie par contagion . Il a rassembl de nombreux exemples
de royaut divine et diverses autres institutions et coutumes, ce qui lui permit d'en
montrer la frquence en tant que systmes culturels et sociaux.
Soulignons encore le sens critique dont ils firent preuve, au contraire de nombre
de leurs prdcesseurs. Ils eurent la chance de pouvoir disposer d'une importante
documentation pour travailler, mais ils utilisrent leurs connaissances de faon plus
systmatique que les philosophes dont Maine se plaignait : Les recherches du juriste sont autant sujettes caution que les recherches des physiciens et des mdecins
avant que l'observation n'ait remplac la supposition. Leurs thories plausibles et
comprhensives ne sont aucunement prouves, comme la Loi de la Nature ou le
Contrat Social qui semble runir les suffrages de tous aux dpens de la prudente
recherche dans le domaine de l'histoire de la socit et des lois archaques 1.
Les spculations philosophiques, qui ne sont pas tayes par l'vidence des faits,
n'ont gure de valeur. C'est la prudente recherche de Maine et de ses contemporains qui favorisa une valuation correcte des institutions sociales; ils slectionnrent
et classrent les documents, fournissant ainsi l'indispensable corpus de faits ethnographiques qui faisait jusqu'alors dfaut et d'o l'on pouvait dsormais tirer des
conclusions valables et les vrifier.
Un des grands mrites des crivains du XIXe sicle, c'est d'avoir tudi les institutions sociales avec une optique proprement sociologique, c'est--dire en termes de
structure sociale et non en termes de psychologie individuelle. Ils vitrent de conclure par dduction comme le faisaient si souvent les philosophes, en partant des
postulats sur la nature humaine; ils cherchrent plutt expliquer les institutions en
les comparant d'autres institutions d'une mme socit, qu'elles soient contemporaines ou aient exist une poque antrieure.
C'est ainsi que lorsque McLennan voulut analyser l'exogamie, il rejeta rsolument
toute explication biologique ou psychologique du tabou de l'inceste et prfra l'expliquer par rfrence la coutume de l'infanticide des filles, des vengeances du sang et
1
Ancient Law, 1912, p. 3.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
28
des cultes totmiques. Il n'expliqua pas le mariage par capture en recourant des
motivations psychologiques, mais dmontra le rapport qui existait entre ce rite et les
rgles d'exogamie, ajoutant qu'il tait et pouvait tre une survivance des pratiques de
rapines. Il suggra encore que le systme patrilinaire pouvait tre issu du systme
matrilinaire la suite d'une combinaison des pratiques de polyandrie et de patrilocalit; et montra comment le culte de dieux-animaux et de dieux-vgtaux, ses symboles, ses relations hirarchiques rciproques, tel qu'on pouvait l'observer chez les
juifs, en Inde, dans la Grce et la Rome antique, avait pu tre produit par le totmisme et une structure tribale totmique. McLennan croyait fermement la thorie
selon laquelle les institutions sociales sont fonctionnellement interdpendantes. Par
exemple, il estimait qu'une explication complte de l'origine de l'exogamie exige la
dmonstration que partout o existe l'exogamie, existe aussi le totmisme; que
lorsque le totmisme existe, il existe la pratique de vengeance du sang; lorsque cette
pratique existe, on remarque que cette vengeance est une obligation religieuse; lorsque cette obligation existe, l'infanticide des filles est pratiqu; lorsque cet infanticide
existe, on se trouve en face d'un systme de parent par les femmes. Si l'on ne peut
prouver l'un ou l'autre de ces points, on compromet l'argumentation tout entire 1.
Maine s'intressait aussi aux questions sociologiques, comme les rapports entre la
loi, la religion et la morale, les consquences sociales de la codification des lois dans
diverses circonstances historiques, les effets de l'volution de Rome, en tant qu'empire militaire, sur l'autorit lgale du pre de famille, la relation entre patria postestas
et agnation et l'volution de la loi base sur le statut celle base sur le contrat dans
les socits dynamisme historique. En abordant la question sous cet angle, Maine se
prononait en faveur de la mthode d'analyse sociologique et rejetait ce que nous
appelons aujourd'hui les motivations psychologiques. Ce que les hommes ont pu
faire aux premiers temps de leur histoire ne constitue sans doute pas une recherche
strile ou impossible, mais comment arriver connatre avec certitude leurs motivations profondes? Toutes les descriptions des conditions de vie des humains aux
premiers ges de l'humanit supposent que l'humanit ne connaissait pas la plupart
des circonstances que nous-mmes connaissons aujourd'hui, et que, dans cette situation hypothtique, elle prouvait les mmes sentiments et les mmes prventions qui
la meuvent maintenant, alors qu'en fait ces ractions sont prcisment fonction de
circonstances qui ne sont plus du tout les mmes 2.
En d'autres termes, les institutions primitives ne doivent pas tre interprtes en
fonction de la mentalit de l'enquteur civilis, parce que sa mentalit est le produit
d'institutions totalement diffrentes. Penser d'une autre faon serait obligatoirement
verser dans les dformations de psychologues , ce travers si sou. vent dnonc par
Durkheim, Lvy-Bruhl et d'autres sociologues franais.
Je ne cherche pas suggrer ici que les thories des anthropologues victoriens
taient entirement justes. Les anthropologues modernes petit petit en ont rejet la
1
2
Studies in Ancient History (Deuxime srie), 1896, p. 28.
Ancient Law, pp. 266-267.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
29
plupart et il ne fait aucun doute que certaines de ces thories, que nous considrons
aujourd'hui comme des monuments d'ineptie, le furent galement en leur temps.
Je ne suis pas non plus partisan de leur mthode d'interprtation; je cherche surtout ici valuer l'influence de ces divers crivains afin qu'on comprenne mieux
l'anthropologie d'aujourd'hui. Songez que les changements sociaux qui se sont produits en Europe cette poque, conduisirent un grand nombre de philosophes de
l'histoire, d'conomistes et de statisticiens en parti. culier, s'interroger sur le rle
jou par les masses dans l'histoire, plutt que sur celui que peuvent jouer les individus ; on prfrait tudier l'histoire des grands courants que celle d'vnements particuliers, de sorte que les chercheurs commencrent rechercher les similitudes et les
rcurrences 1. L'tude des institutions se prte aisment cette dmarche, en particulier cella des hommes primitifs; dans ce cas, on ne peut que conjecturer Les
grandes lignes de l'volution; le rle jou par des individus prcis ou l'influence de
certains vnements reste indterminable car il est impossible de les reconstituer par
la mthode comparative ou n'importe quelle autre.
Les anthropologues du XIXe sicle avaient sans doute, peu de choses prs, sur
un certain nombre de points, la mme opinion que les anthropologues d'aujourd'hui,
mais sur d'autres leurs conceptions taient diamtralement opposes, tellement
opposes qu'il est difficile de lire leurs constructions thoriques sans irritation - et
l'anthropologue contemporain ne ressent qu'embarras devant l'espce d'autosatisfaction de ses prdcesseurs. Bon nombre de termes ont d'ailleurs subi des modifications de contenu et l'optique est diffrente; les connaissances allant croissant,
certains concepts se sont vus totalement modifis; il est bon de rappeler en outre que
l'tat de nos connaissances s'est singulirement accru et que ce que l'on acceptait
comme des faits n'tait souvent gure plus que le produit d'une observation superficielle ou de prjugs. Il n'en demeure pas moins que la mthode comparative applique la reconstitution de l'histoire n'a gnralement conduit qu' des conclusions
injustifiables et totalement invrifiables.
Les anthropologues du sicle dernier croyaient crire l'histoire des premiers hommes et lorsqu'ils manifestaient de l'intrt pour les socits primitives, c'est surtout
parce qu'ils pensaient pouvoir les utiliser dans leur essai de reconstitution, bien
hypothtique, de l'histoire ancienne, de l'humanit en gnral, et de leurs propres
institutions en particulier. Ancient Law de Maine porte le sous-titre suivant : Ses
rapports avec l'histoire ancienne de la socit et avec les ides contemporaines.
Tylor intitula d'abord son livre Recherches sur l'Histoire Ancienne de l'Humanit;
Sir John Lubbock intitula son ouvrage Origines de la civilisation et les essais de
McLennan furent runis en deux volumes portant le titre : tudes d'Histoire
Ancienne.
Quoi de surprenant ce qu'ils crivent sur ce qu'ils considraient tre de l'histoire
puisque toutes les recherches d'alors taient de nature rigoureusement historique.
1
G. P. Cooch : HIstory and Historians in the Nineteenth Century, 1949, chap. XXVIII.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
30
L'approche gntique, qui avait donn d'tonnants rsultats en philologie, se retrouvait dans les travaux sur le droit, la thologie, l'conomie, la philosophie et la
science 1. On cherchait avec passion, et je dirai mme obsession, dcouvrir l'origine
de toute chose : l'origine des espces, de la religion, des lois et ainsi de suite, et toujours selon la mthode qui consistait expliquer le plus proche par le plus
loign 2.
Je mentionnerai brivement certaines des objections que l'on peut opposer cette
mthode destine expliquer les institutions, reconstituer leur volution partir de
leur origine suppose, car il est essentiel de comprendre pourquoi les anthropologues
britanniques se sont, par la suite, dtourns du mode d'interprtation utilis par leurs
prdcesseurs.
Je pense que tout le monde est dsormais d'accord sur le fait que les institutions
ne doivent pas tre envisages, encore moins expliques, en fonction de leur origine,
que cette origine soit conue comme le vritable dbut, comme la cause ou plus
simplement, comme la forme lmentaire de ces institutions. Il est certainement fort
utile de connatre l'volution d'une institution et quelles ont t les circonstances de
cette volution, lorsqu'on cherche comprendre une institution, mais son histoire ne
saurait, en aucun cas, expliquer comment cette institution fonctionne dans la vie
sociale. Savoir comment elle est devenue ce qu'elle est et savoir comment elle fonctionne, sont deux choses trs diffrentes et je reviendrai ultrieurement sur ce point.
Mais dans le cas des anthropologues du XIXe sicle, nous ne sommes pas en face
d'une histoire critique, mme au sens courant au milieu du sicle, lorsque l'histoire
n'tait qu'un genre littraire ignorant encore l'tude systmatique des sources. En
effet, les historiens de cette poque s'appuyaient au moins sur des documents qui
faisaient dfaut aux auteurs reconstituant l'volution des institutions primitives. Leur
reconstitution historique tait purement conjecturale et gure plus qu'un ensemble de
suppositions plus ou moins gratuites. Si l'on admet l'hypothse que l'homme descend
du singe, on peut raisonnablement supposer qu' un moment ou un autre, les relations sexuelles aient t quelque peu confuses et se poser la question: comment le
mariage monogame a-t-il pu s'instituer partir de cet tat de choses? les reconstitutions et les suppositions dans ce domaine ne peuvent tre que pure spculation et on
ne saurait les admettre comme faits historiques.
Il faut remarquer que la mthode comparative applique aux institutions sociales
et visant seulement tablir des corrlations, sans vouloir mme leur donner une
valeur chronologique, comporte une grave faiblesse que Tylor, malgr toutes ses connaissances et le secours des mthodes statistiques, n'est pas parvenu compenser. Les
faits soumis l'analyse, isols du contexte qui leur donnait leur signification, s'avraient inexacts ou insuffisants.
On s'aperut aussi qu'il tait extrmement difficile sinon impossible, en face de
phnomnes sociaux complexes, de dterminer quelles units devaient tre analyses
1
2
Lord Acton : A Lecture on the Study of History, 1895, pp. 56-58.
Marc Bloch : Apologie pour l'Histoire ou le mtier d'historien, 1949.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
31
selon la mthode des variations concomitantes. S'il est ais de se demander si le
totmisme et les clans vont de pair, il est plus difficile de dfinir le totmisme et le
clan. Il est beaucoup plus malais encore de donner la dfinition de concepts tels que
proprit , monogamie , dmocratie , esclavage , criminalit , et bien
d'autres.
Les grandes difficults de ces recherches, compliques par la croissance des
institutions et des ides, consistaient dcider ce qu'on considrait comme l'exemple
typique d'un fait social. Lorsqu'on dcouvre un cas de polygamie dans le monde
musulman, doit-on le compter comme un cas particulier ou le prendra-t-on comme
symbole de tous les autres? Les institutions parlementaires qui s'inspirent du systme
britannique et qu'on trouve dans de nombreux pays, va-t-on les compter comme
autant d'institutions ou n'en reprsenteront-elles qu'un seul type?
Je pense avoir tabli clairement que l'anthropologie du XIXe sicle se distinguait
de l'anthropologie actuelle sur deux points essentiels. Elle cherchait interprter les
institutions en dmontrant d'o elles tiraient leur origine et par quels stades de
dveloppement elles taient passes. Nous pouvons, je crois, rserver pour plus tard
la question de la pertinence du dveloppement historique dans la recherche sociologique, l o l'histoire est vritablement connue. On pense gnralement que l'histoire
des institutions des peuples primitifs nous tant inconnue, il est indispensable de
procder une tude systmatique des institutions dans leur tat actuel avant d'noncer une thorie expliquant leur origine et leur volution. Quant la question de savoir
d'o proviennent ces institutions et de quelle faon elles ont volu, elle constitue en
soi un autre problme essentiel la bonne comprhension du fonctionnement des
institutions au sein de la socit, mais qu'on doit tudier sparment et selon une
technique diffrente.
On pourrait dire que les anthropologues du XIXe sicle considraient l'anthropologie sociale et l'ethnographie comme une seule et mme discipline, contrairement
l'usage actuel.
La seconde diffrence sur laquelle je voudrais attirer votre attention apparat
progressivement l'anthropologue d'aujourd'hui. Dans ma premire confrence, j'ai
soulign qu'il fallait distinguer entre la notion de culture et celle de socit. Les
anthropologues du sicle dernier semblent n'en avoir t qu' demi conscients, sinon
ils auraient d en gnral considrer la culture, et non les relations sociales, comme le
but essentiel de leur recherche. La culture leur apparaissait comme un phnomne
concret. Ils considraient l'exogamie, le totmisme, la filiation utrine, le culte des
anctres, l'esclavage, comme de simples coutumes et c'est une tude de ces coutumes
ou phnomnes concrets qu'ils pensaient effectuer. La pense, crase par le poids
des ralits culturelles, tait incapable de procder une analyse comparative
correcte.
Ce n'est qu' la fin du sicle que les anthropologues se mirent classer les socits
en prenant les structures sociales, au lieu des cultures, comme facteur de classification et il tait dsormais permis d'esprer que l'anthropologie allait procder des
tudes comparatives valables.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
32
La distinction tant faite une fois pour toute entre ethnologie et anthropologie,
celle-ci put dfinir l'objet de ses recherches : tude des relations sociales, ce qui permit d'valuer les problmes que pose une telle tude. Restait laborer une mthode
de travail. Si l'on utilise toujours la mthode comparative, c'est dans un but trs
diffrent, ainsi que l'objet qu'elle compare.
En dehors de ces diffrences de mthode, il faut mentionner une sorte de divorce
de pense avec les anthropologues du sicle dernier, c'est du moins mon sentiment.
Leurs reconstitutions taient non seulement conjecturales mais elles impliquaient des
jugements de valeur. tant tous libraux et rationalistes, ils croyaient ncessairement
et avant tout au progrs, justifis en cela par les bouleversements matriels, politiques, sociaux et philosophiques qui agitaient l'Angleterre victorienne. L'industrialisation, la dmocratie et l'avnement de la science taient en soi des phnomnes
bnfiques, mais tous ces penseurs proposaient une explication des institutions sociales qui ne rsistait gure un examen approfondi : ils interprtaient les institutions
sociales comme les hypothtiques degrs menant au progrs. A l'extrmit de cette
sorte d'chelle, ils plaaient les institutions et les croyances telles qu'elles existaient
en Europe et en Amrique au XIXe sicle, et l'autre extrmit, les antithses de ces
institutions et croyances. Les degrs allant d'une extrmit l'autre taient censs
reprsenter les diffrents stades de l'histoire de l'volution. Il restait donc dcouvrir
dans la littrature ethnologique existante des exemples propres illustrer chacun de
ces stades. Ces anthropologues, qui prtendaient s'inspirer de la mthode empirique
pour tudier les institutions sociales, ne furent pas moins enclins la spculation et au
dogmatisme que les philosophes du sicle prcdent; ils se crurent tenus d'tayer
leurs thses par une surabondance de faits rels, obligation que ne s'imposrent
nullement les philosophes.
Les anthropologues d'aujourd'hui ne semblent pas s'enthousiasmer outre mesure
pour l'chelle de valeurs accepte par leurs prdcesseurs. Il faut sans doute attribuer
un certain scepticisme l'abandon de la mthode volutionniste au profit de la
mthode inductive et fonctionnelle, la question tant : peut-on considrer les changements sociaux du XIXe sicle comme un progrs rel? Quelle que soit la diversit des
opinions, il faut reconnatre que l'optique de l'anthropologie moderne trahit un certain
conservatisme sur le plan thorique. Elle cherche plus dceler les facteurs d'intgration et d'quilibre au sein d'une socit qu' dterminer un processus de progrs en
fonction des phases de l'volution. Je crois que la principale cause de confusion chez
les anthropologues du XIXe, n'tait pas tant le fait qu'ils croyaient au progrs et
cherchaient une mthode qui leur permette d'en reconstituer la progression; ils avaient
parfaitement conscience que leurs schmas, restaient au niveau d'hypothses invrifiables. Elle tait plutt qu'ils avaient hrit du Sicle des Lumires, la conviction que
les socits sont des systmes naturels, c'est--dire des organismes subissant une
certaine volution qui peut se rsumer en principes et en lois gnrales. On prsentait
les relations logiques comme des relations relles et ncessaires et les classifications
typologiques comme les paliers historiques et invitables de l'volution. On voit bien
comment en combinant la notion de loi scientifique et celle de progrs, on est conduit
dans la recherche anthropologique comme dans la philosophie de l'histoire cette
tyrannique conception des stades, dont la prtendue invitabilit leur donne une
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
33
coloration normative. Naturellement, ceux qui croyaient que la vie sociale pouvait
s'expliquer en termes de lois scientifiques concluaient que des types identiques
d'institutions devaient driver de formes semblables, lesquelles provenaient leur
tour de prototypes semblables. Dans ma prochaine confrence, j'examinerai plus
avant ce dernier point en fonction de l'tat actuel de l'anthropologie sociale.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
34
3
DVELOPPEMENTS
THORIQUES ULTRIEURS
Retour la table des matires
Dans ma dernire confrence, j'ai expos les caractristiques principales des
crivains des XVIIIe et XIXe sicles dont on peut dire qu'ils ont, dans une certaine
mesure, tudi les institutions sociales sous l'angle anthropologique. Ils utilisaient la
mthode naturaliste et empirique, en intention, sinon en pratique, et enfin et surtout,
la mthode gntique. Leur pense tait domine par la notion de progrs, l'amlioration des manires et des coutumes; on partait de la grossiret pour arriver la
civilit, de la sauvagerie la civilisation; la mthode de recherche labore par ces
chercheurs, c'est--dire la mthode comparative, fut surtout applique dans le but de
reconstituer le cours hypothtique de ce dveloppement. C'est sur ce point prcis que
l'anthropologie d'hier diffre de l'anthropologie d'aujourd'hui.
A la fin du sicle dernier, les chercheurs commencrent ragir contre la tendance qui prtendait expliquer les institutions sociales par la reconstitution de leur
pass; les attaques taient diriges particulirement contre les comparaisons de
phnomnes parallles, tenues pour idalement unilinaires. On a souvent dnomm,
tort d'ailleurs, cette anthropologie gntique, une anthropologie volutionniste; on
la retrouve transforme et habille de neuf dans les crits de Steinmetz, de Nieboer,
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
35
de Westermark, de Hobhouse 1 et d'autres encore, puis elle finit par perdre tout crdit.
Certains anthropologues se tournaient dsormais, divers degrs, du ct de la
psychologie, qui leur semblait dtenir des possibilits prometteuses et leur permettrait
de rsoudre leurs problmes sans devoir recourir l'histoire hypothtique. Cette
tentative dchafauder l'anthropologie sociale sur les fondations de la psychologie
s'est avre, hier comme aujourd'hui, aussi valable que celle qui consiste construire
un btiment sur des sables mouvants.
On peut, il est vrai, dceler dans certains crits des deux sicles prcdents des
tentatives d'explications psychologiques; les crivains qui ont sembl prter attention
aux motivations psychologiques ne le firent certes pas dans le but dlibr de
suggrer que les coutumes et les institutions pouvaient tre analyses en fonction des
sentiments et des impulsions de l'individu. Nous avons vu que ces crivains, au contraire, rejetaient une telle suggestion. Remarquez qu' l'poque aucune mthode
n'aurait pu se prvaloir de la qualification de psychologie exprimentale et lorsque des anthropologues tels que Tylor et Frazer se tournrent vers la Psychologie,
c'est plutt la psychologie associationniste qu'ils faisaient appel. Lorsque cette sorte
de psychologie perdit tout attrait, ils en restrent aux interprtations intellectualistes
dmodes qu'ils en avaient tires. D'autres anthropologues connurent plus tard les
mmes dboires avec la psychologie introspective. Je pense en particulier aux crits
sur la religion, la magie, le tabou et la sorcellerie de Marett, Malinowski et autres
Britanniques, de Lowie, Radin et autres Amricains 2. Ces auteurs cherchent
expliquer le comportement social vis--vis du sacr, en fonction des divers tats
affectifs de l'individu: la haine, l'envie, l'amour, la crainte, la peur, l'tonnement,
l'impression de merveilleux ou de surnaturel, la projection de la volont, etc. Ce
comportement est cr par les tensions affectives et les sentiments de frustration; sa
fonction est cathartique, expltive ou stimulante. L'volution des diverses mthodes
psychologiques exprimentales dmontra que toutes ces explications demeuraient
confuses, incorrectes et dnues de fondement. Certains anthropologues contemporains, en Amrique notamment, non dcourags par l'chec de leurs prdcesseurs,
veulent encore laborer une terminologie qui tiendrait la fois du vocabulaire
psychologique behaviouriste et psychanalytique, appel encore psychologie de la
personnalit ou psychologie des motivations et du comportement.
On peut faire un certain nombre d'objections au sujet de ces tentatives d'explication des faits sociaux par la psychologie de l'individu. Une objection s'applique toutes : la psychologie et l'anthropologie tudiant respectivement des phnomnes trs
diffrents, on voit donc trs mal comment on pourrait appliquer l'une les conclusions de l'autre. La psychologie est l'tude de la vie individuelle. L'anthropologie
sociale tudie des systmes sociaux. Le psychologue et l'anthropologue peuvent se
trouver devant les mmes comportements de base, mais leur tude porte sur des
niveaux d'abstraction diffrents.
1
S. R. Steinmetz : Ethnologische Studien zur ersten Entwicklung der Strafe, 1894; J. Nieboer :
Slavery as an Industrial System, 1900; E. Westermark : The Origin and Development of the Moral
Ideas, 1906; L. T. Hobhouse : Morais in Evolution, 1906.
R. R. Marett : The Threshold of Religion, 1909; B. Malinowski: Magic, Science and Religion ,
in Science, Religion and Reality, 1925; R. H. Lowie : Primitive Religion, 1925; P. Radin : Social
Anthropology, 1932.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
36
Voici un exemple : douze jurs dcident de la culpabilit d'un individu et le juge
le condamne une certaine peine. Les faits ayant une signification sociologique dans
ce cas sont : l'existence de la loi, les diverses institutions juridiques et les processus
lgaux qui en permettent l'application lorsqu'il y a eu dlit; et l'action de la socit
politique par l'intermdiaire de ses reprsentants consiste punir le criminel. Au
cours du droulement de ce processus, les penses et les sentiments de l'accus, du
jury et du juge subiront des variations suivant le moment, autant que peuvent varier
l'ge, la couleur des cheveux et des yeux des divers protagonistes, mais ces variations
ne sont d'aucun intrt, du moins dans l'immdiat, pour l'anthropologue. Il ne s'intresse pas aux acteurs du drame en tant qu'individus mais en tant que personnes jouant
un certain rle dans le droulement de la justice. Par contre, pour le psychologue qui
tudie les individus, les sentiments, les motivations, les opinions, etc. des acteurs sont
de premire importance et les procdures juridiques ne sont que secondaires. Cette
diffrence fondamentale qui oppose l'anthropologie la psychologie est le pont aux
nes de l'enseignement de l'anthropologie sociale. Les deux disciplines ne peuvent
tre profitables l'une l'autre, et dans ce cas extrmement profitables, qu'en poursuivant indpendamment leurs recherches respectives, selon des mthodes qui leur sont
propres.
Parmi les diverses critiques qu'eurent essuyer les anthropologues de l'cole
volutionniste du XIXe sicle, il faut mentionner les attaques des deux autres
coles de pense : les diffusionnistes et les fonctionnalistes.
Les critiques de ceux qu'on appela les anthropologues diffusionnistes, se basaient
sur le fait vident que la culture est souvent emprunte et n'apparat pas de la
mme faon dans des socits diffrentes par un processus de gnration spontane,
imputable des potentiels sociaux communs et aux manifestations communes la
nature humaine. Nous connaissons par exemple l'histoire d'une invention, dans le domaine de la technologie, de l'art, de la pense, des coutumes; nous nous apercevons
presque toujours que l'invention n'est pas ne indpendamment chez plusieurs peuples, dans des lieux et des moments diffrents, mais qu'elle est le fait d'un peuple,
en un endroit prcis et un moment dtermin de son histoire et qu'elle s'est propage
compltement ou partiellement, en partant du peuple inventeur pour parvenir aux
autres. Si nous examinons la question d'un peu plus prs, nous voyons qu'il n'a exist
qu'un nombre limit de centres importants de dveloppement et de diffusion de la
culture et qu'au cours du processus d'emprunt et d'assimilation d'autres cultures, les
traits diffuss peuvent subir toutes sortes de modifications et de changements.
Puisqu'on peut dmontrer que les inventions, pour l'historique desquelles nous possdons des preuves, se sont vues diffuses de cette faon, il est donc permis de supposer
que, lorsque nous trouvons des objets matriels, des concepts et des coutumes semblables chez des peuples primitifs en diffrentes parties du monde, ceux-ci se sont
rpandus de la mme faon partir d'un nombre limit de centres de dveloppement
culturel; mme s'il n'existe vritablement aucune preuve de cette diffusion, en dehors
de celle qu'implique la similitude et la distribution gographique, surtout si les traits
communs sont complexes et se prsentent groups.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
37
La porte de cet argument l'encontre des thories gntiques des anthropologues
du sicle dernier est vidente. Si l'on russit dmontrer que les institutions d'un
peuple donn se retrouvent, par quelque hasard historique, chez un autre peuple, on
peut difficilement les considrer comme le prolongement naturel et invitable des
institutions antrieures et les prsenter comme preuve l'appui d'une loi de la
croissance.
L'influence du diffusionnisme reste prdominante en Amrique. En Angleterre,
cette influence fut de courte dure, consquence partiellement due l'emploi abusif
qu'en firent Elliot Smith, Perry et Rivers 1 et aussi parce que ses reconstructions
parurent aussi conjecturales et invrifiables que les reconstructions gntiques que le
diffusionnisme prtendait attaquer. Quant aux anthropologues fonctionnalistes dont je
vais maintenant parler, ils considraient le combat qui opposait les volutionnistes et
les diffusionnistes comme une querelle intestine entre ethnologues, qui de ce fait ne
les concernait point.
Les fonctionnalistes reprochaient ces deux courants de pense de ne proposer
que des hypothses non vrifies et invrifiables et d'expliquer la vie sociale en
fonction du pass. Ce n'est gure la dmarche adopte dans l'tude des sciences naturelles, domaine que les anthropologues britanniques considrent comme tant le leur.
Pour comprendre comment vole un avion ou fonctionne le corps humain, il faut
d'abord tudier les lois de la mcanique et les lois de la physiologie et il n'est point
besoin de connatre l'histoire de l'aronautique ou les thories concernant l'volution
biologique. De mme, il y a diverses faons d'tudier une langue : on analyse la
grammaire, la phontique, la smantique, etc. sans qu'il soit indispensable d'apprendre l'histoire du vocabulaire. L'histoire des mots appartient une autre branche de la
linguistique, je veux dire la philologie. Dans le mme ordre d'ides, une histoire des
institutions juridiques britanniques d'aujourd'hui nous apprendra seulement comment
elles sont devenues ce qu'elles sont maintenant, mais certainement pas comment elles
fonctionnent dans le contexte social actuel. Pour le savoir, il faut effectuer une tude
prcise, et appliquer les mthodes exprimentales propres aux sciences naturelles.
L'histoire et les sciences naturelles ont des buts diffrents, appliquent des mthodes et
des techniques diffrentes et vouloir tudier les deux la fois ne peut que crer la
plus parfaite confusion.
Dans l'tude des peuples primitifs, c'est la tche de l'historien des peuples primitifs, donc de l'ethnologue, de dcouvrir s'il le peut quel chemin ont parcouru les
institutions pour parvenir leur tat prsent. C'est la tche de l'homme de science, de
l'anthropologue, de dcouvrir quelles fonctions elles exercent au sein des systmes
sociaux auxquels elles appartiennent. Mme nanti des meilleures sources d'information, l'historien ne peut nous fournir que la succession des vnements accidentels
qui ont fait qu'une socit est devenue ce qu'elle est. On ne peut pas dduire ces
vnements de principes gnraux et ces principes ne sauraient tre dgags de ces
vnements accidentels. Les anthropologues du XIXe sicle se trompaient donc sur
deux points essentiels : ils reconstruisaient l'histoire sans donnes relles et ils
1
G. Elliot Smith : The Ancient Egyptians, 1911; W. J. Perry : The Children of the Sun, 1923, W. H.
R. Rivers : The History of Melanesian Society, 1914.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
38
cherchaient tablir des lois sociologiques en utilisant une mthode qui ne saurait en
aucun cas conduire cette formulation. Les chercheurs finirent par admettre ce point
de vue; l'anthropologie compltement divorce de l'ethnologie put dfinir son champ
d'action actuel, l'intrieur de l'tude de l'homme au sens le plus large du terme.
Les anthropologues maintiennent que les socits sont des systmes naturels dont
toutes les parties sont interdpendantes, chacune fonctionnant au sein d'un rseau
serr de relations indispensables au maintien du tout; ils disent aussi que la vie
sociale peut tre formule en termes de lois scientifiques qui permettent de faire des
prvisions. Il y a l un certain nombre de propositions. J'en examinerai brivement
deux qu'on peut rsumer comme suit : les socits sont des systmes et ces systmes
sont des systmes naturels qui peuvent tre ramens des variables; par consquent,
leur histoire n'entre pas dans le cadre d'une enqute sur la nature de ces systmes.
Il est vident qu'il existe, dans une certaine mesure, un ordre, une cohrence et
une constance de la vie sociale. Si ces facteurs n'existaient pas, personne ne pourrait
vivre normalement ni satisfaire ses besoins les plus lmentaires. On est oblig
d'admettre que cet ordre est provoqu par la systmatisation ou l'institutionnalisation
des activits sociales, de sorte que certaines personnes doivent y jouer un rle dtermin, que les activits exercent certaines fonctions dans la vie sociale en gnral.
Pour reprendre un exemple que nous avons dj donn, le juge d'un tribunal, les
jurs, les avocats, les huissiers, la police et l'accus ont des rles prcis et l'action du
tribunal consiste tablir la culpabilit et punir les criminels. Les individus qui
occupent ces positions varient selon les cas, mais la forme et les fonctions des
institutions restent constantes. Il est vident que le juge, les avocats, les huissiers et la
police ont des rles professionnels qu'ils ne pourraient pas jouer s'il n'existait pas une
certaine organisation conomique; ils ne sont pas tenus, par exemple, de produire et
de prparer leur nourriture mais ils peuvent l'acheter avec la rmunration qu'ils
peroivent pour avoir accompli leur devoir; il y a aussi une certaine organisation
politique qui maintient la loi et l'ordre public afin qu'ils puissent exercer leur fonction
en toute quitude... et ainsi de suite.
Tout cela est tellement vident que les ides de systme social, structure sociale,
rles dans la socit et fonction sociale des institutions se retrouvent sous une forme
ou une autre, ds les premiers crits philosophiques portant sur la vie sociale. Sans
revenir sur les noms que j'ai dj noncs dans ma dernire confrence, notons que
les concepts de structure et de fonction apparurent chez Montaigne, qui parlait de
bastiment et de liaison sur le chapitre de la loi et des coutumes en gnral :
C'est comme un bastiment de divers pices jointes ensemble, d'une telle liaison
qu'il est impossible d'en esbranler une, que tout le corps ne s'en sente... 1.
De la Coustume et de ne Changer aisment une Loy Receu , Essais, N. R. F., Bibliothque de
la Pliade, 1946, p. 118.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
39
Cette conception du systme social, dont la notion de fonction sociale fait partie,
est prsente tout au long de l'expos de Montesquieu sur la nature et les principes des
diffrents types de socit, dans lequel il parle de la structure d'une socit et des
rapports entre ses diffrentes parties; nous la trouvons avec plus ou moins de force
dans tous les crits des philosophes du XVIIIe sicle qui se proccuprent des
institutions sociales. Au dbut du XIXe sicle, ce concept est clairement nonc par
Auguste Comte, et s'il n'est pas toujours explicitement formul et est subordonn aux
concepts d'origine, de cause et de stades du dveloppement, on le retrouve chez tous
les anthropologues de cette poque.
Vers la fin du sicle, et davantage encore au cours du ntre, ce concept a pris de
plus en plus d'importance, allant de pair avec l'orientation de la pense en gnral. De
la mme manire qu'auparavant dans tous les domaines, l'orientation fonctionnelle se
retrouve partout avec la biologie fonctionnelle, la psychologie fonctionnelle, le droit
fonctionnel, l'conomie fonctionnelle, etc., et bien entendu l'anthropologie fonctionnelle.
Ce sont Herbert Spencer et mile Durkheim qui les premiers attirrent l'attention
des anthropologues sur l'analyse fonctionnelle. Les crits philosophiques de Herbert
Spencer (1820-1903) ne sont gure lus aujourd'hui mais ils exercrent, durant la vie
de leur auteur, une influence considrable. Spencer et Comte taient dous du mme
clectisme qui les poussa s'intresser toutes les connaissances humaines, dans
l'intention d'laborer aussi compltement que possible une science de la culture et de
la socit, science dcrite par Spencer comme superorganique 1. A son avis, l'volution de la socit humaine (bien que pas ncessairement celle de socits particulires) est la continuation naturelle et invitable de l'volution organique. Les groupes
tendent invariablement s'agrandir et par voie de consquence s'organiser, puis
s'intgrer du fait que, plus la diffrenciation culturelle est grande, plus les parties de
l'organisme social sont interdpendantes. L'utilisation que fit Spencer de l'analogie
biologique de l'organisme, malgr tout le danger que comporte ce point de vue, a
beaucoup contribu l'laboration des concepts de structure et de fonction en anthropologie sociale, en insistant sur le fait qu' chaque stade de l'volution sociale, il
existe ncessairement une interdpendance entre les institutions d'une socit, qui
doivent toujours tendre un tat d'quilibre si elles veulent survivre. Il se fit aussi
l'avocat passionn des lois sociologiques, structurales et gntiques.
Les crits d'mile Durkheim (1858-1917) exercrent une influence encore plus
grande et plus directe sur l'anthropologie sociale. Il faut reconnatre qu'il joua un rle
dterminant dans l'histoire de l'anthropologie, en raison de ses thories sociologiques
et aussi grce la faon dont il les appliqua l'tude des socits primitives, parfaitement soutenu par des collgues et des lves infiniment dous 2.
1
2
The Study of Sociology, 1872 ; The Principles of Sociology, 1882-1883.
Voir : De la Division du Travail Social: tude sur l'Organisation des Socits Suprieures, 1833;
Les Rgles de la Mthode Sociologique, 1895; Le Suicide: tude de Sociologie, 1897; Les Formes
lmentaires de la Vie Religieuse : le Systme Totmique en Australie, 1912; Voir aussi les
articles in l'Anne sociologique de 1898 et suiv.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
40
On peut rsumer ainsi la position de Durkheim: on ne peut pas expliquer les faits
sociaux en fonction de la psychologie individuelle, ne serait-ce que parce qu'ils existent en dehors de l'esprit individuel. Une langue, par exemple, existe avant que naisse
dans une socit l'individu qui parlera cette langue; elle continuera d'exister aprs que
cet individu ait disparu. Il se borne l'apprendre, comme le firent ses anctres et le
feront ses descendants. C'est un fait social, une sorte de sui generis qui ne peut tre
compris qu'en relation avec d'autres faits du mme ordre, c'est--dire une partie du
systme social, et en termes de sa fonction dans le maintien de ce systme.
Les faits sociaux se caractrisent par leur gnralit, leur transmissibilit et leur
contrainte. Tous les membres d'une socit possdent en gnral les mmes habitudes
et les mmes coutumes, une langue et un code moral communs; ils vivent l'intrieur
des mmes institutions lgales, politiques et conomiques. Tous ces facteurs forment
une structure plus ou moins stable qui survit en ses points essentiels pendant de longs
laps de temps, les gnrations se les lguant les unes aux autres. L'individu ne fait
que passer au travers de la structure en quelque sorte. Elle n'est pas ne et ne mourra
pas avec lui, car elle n'est pas un systme psychique mais un systme social dot
d'une conscience collective de nature trs diffrente de la conscience individuelle. La
totalit des faits sociaux qui composent la structure ont le caractre d'obligations.
L'individu qui ne s'y soumet pas risquera perptuellement des punitions et des dsagrments de nature juridique ou morale. Normalement, il n'a ni le dsir ni l'occasion
de faire autre chose que de s'y conformer. Un enfant n en France de parents franais
ne peut apprendre que le franais et n'aura jamais le dsir de ne pas l'apprendre.
On a beaucoup critiqu Durkheim pour sa conception de la vie collective ainsi
que sa thorie de l'me collective, mais bien que ses crits soient souvent de nature
mtaphysique, il n'a certainement jamais conu de pareille entit. Il appelait reprsentation collective ce que nous appelons en Angleterre l'ensemble des valeurs, des
croyances et des coutumes communes que l'individu, n dans n'importe quelle socit, apprend, accepte, pratique et transmet. Son collgue, Lucien Lvy-Bruhl (18571939), a brillamment analys le contenu idologique de ces reprsentations
collectives dans une srie d'ouvrages qui exercrent une influence considrable en
Angleterre, bien que les anthropologues britanniques ne se soient pas privs de les
critiquer svrement ou, plus simplement, de les mal interprter 1. Admettant que les
croyances, les mythes et les ides en gnral des peuples primitifs sont le reflet de
leurs structures sociales, et par consquent varient selon chaque socit, il chercha
surtout dmontrer la faon dont les peuples primitifs laborent ces systmes, dont il
appela le principe logique, la loi de la participation mystique. Il pratiqua l'analyse
structurale autant que Durkheim, mais alors que Durkheim analysait les activits
sociales, Lvy-Bruhl analysait les ides qui y taient associes.
L'importance de Durkheim dans l'histoire de l'volution conceptuelle de l'anthropologie sociale n'aurait pas t plus grande dans notre pays qu'en Amrique, s'il
n'avait pas exerc une telle influence sur le Professeur A. R. Radcliffe-Brown et le
Professeur B. Malinowski, les deux hommes qui ont fait de l'anthropologie britannique ce qu'elle est aujourd'hui. Tous ceux qui parmi nous enseignent l'anthropologie
1
Voir : Les Fonctions Mentales dans les Socits Infrieures, 1912, La Mentalit Primitive, 1922.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
41
en Angleterre et dans le Commonwealth sont directement ou indirectement leurs
lves.
Je reparlerai de Malinowski (1884-1942) en particulier dans la confrence que je
consacrerai au travail sur le terrain. L'anthropologie fonctionnelle a t pour lui
beaucoup plus qu'un simple principe de technique pratique; il l'utilisa aussi en tant
que vhicule littraire, capable d'intgrer des observations descriptives. Il eut cependant beaucoup de mal l'envisager comme un concept mthodologique et il semble
qu'il n'ait pas russi l'employer avec clart pour traiter les abstractions de la thorie
gnrale. Le Professeur Radcliffe-Brown russit beaucoup mieux dfinir une
thorie fonctionnelle ou organiciste de la socit. Il l'a prsente sous une forme
systmatique, avec une grande clart et une grande prcision de style et d'expression.
Le professeur Radcliffe-Brown a dit que le concept de la fonction appliqu aux
socits humaines est fond sur l'analogie qui existe entre la vie sociale et la vie
organique 1. S'inspirant de Durkheim, il dfinit la fonction d'une institution sociale
comme la correspondance existant entre l'institution sociale et les conditions indispensables l'existence de l'organisme social; la fonction exprime ainsi, et je cite
nouveau le Professeur Radcliffe-Brown, est la contribution qu'une activit partielle
apporte l'activit totale dont elle fait partie. La fonction d'un usage social particulier
consiste en la contribution qu'il apporte la vie sociale tout entire en tant que
fonctionnement du systme social tout entier 2.
Les institutions sont donc prsentes comme fonctionnant l'intrieur d'une
structure sociale constitue par des tres humains individuels relis par un ensemble
dfini de relations sociales, l'intrieur d'un tout intgr 3. La continuit de la
structure est maintenue par le processus de la vie sociale ou, en d'autres termes, la vie
sociale d'une communaut est le fonctionnement de sa structure. Conu de telle faon, un systme social possde donc une unit fonctionnelle. Ce n'est pas un assemblage mais un organisme ou un ensemble intgr. Le Professeur Radcliffe-Brown
prcise que lorsqu'il parle d'intgration sociale, il suppose que la fonction de la
culture consiste unir les tres individuels au sein de structures sociales plus ou
moins stables, c'est--dire en des systmes stables de groupes qui dterminent et
rgularisent la relation de ces individus les uns avec les autres et qui favorisent
l'adaptation externe l'environnement physique, et l'adaptation interne entre individus ou groupes constituants, pour que la vie sociale soit ordonne et vivable. Je crois
que cette hypothse doit tre le premier postulat de toute tude sur la culture et sur la
socit, se voulant objective et scientifique 4.
L'laboration des concepts de structure sociale, de systme social et de fonction
sociale tels que les dfinit le Professeur Radcliffe-Brown dans cette dernire citation,
et mise en pratique par les anthropologues d'aujourd'hui, a grandement contribu
1
2
3
4
On the Concept of Function in Social Science , American Anthropologist, 1935, p. 394.
Ibid., p. 397.
Ibid., p. 396.
The present position of Anthropological Studies , confrence prsidentielle, British Association
for the Advancement of Science, Section 1-1, 1931, p. 13.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
42
dfinir les problmes que s'assigne la recherche sur le terrain. Les anthropologues du
XIXe sicle se contentaient de laisser des non-spcialistes rcolter des faits partir
desquels ils laboraient leurs thories, et ils ne pensaient pas faire eux-mmes des
tudes directement chez les peuples primitifs. Cette attitude s'explique par le fait
qu'ils travaillaient sur des bribes de culture, de coutumes, qu'ils pouvaient ventuellement runir dans le but de dmontrer la grande similitude ou l'norme diffrence
existant entre les croyances et les coutumes, ou encore pour illustrer les stades du
progrs humain. Lorsqu'on eut compris qu'une coutume n'a pratiquement aucune
signification ds l'instant o elle est isole de son contexte social, il apparut clairement qu'il faudrait dsormais entreprendre des tudes dtailles auprs des peuples
primitifs, observer ceux-ci dans toutes les circonstances de leur existence et que seuls
des anthropologues professionnels taient qualifis pour faire ces tudes; eux seuls
connaissaient les problmes thoriques, possdaient les connaissances et les
informations indispensables la rsolution de ces problmes; enfin ils taient les
seuls pouvoir obtenir les moyens matriels ncessaires de telles tudes.
Les fonctionnalistes, convaincus de la relation existant entre toutes choses, sont
donc partiellement responsables de cette nouvelle orientation de l'anthropologie et
des tudes sur le terrain telles qu'on les pratique aujourd'hui.
L'anthropologie fonctionnelle ayant soulign l'importance du concept de systme
social et la ncessit d'tudier systmatiquement les socits primitives dans, leur tat
actuel, dlimita avec nettet les limites respectives des domaines propres l'anthropologie et l'ethnologie, mais encore incita l'tude thorique des institutions s'astreindre l'observation directe de la vie sociale des peuples primitifs. Nous avons vu
comment, au XVIIIe sicle, les thories philosophiques sur la nature et l'origine des
institutions sociales s'illustrrent occasionnellement d'exemples puiss dans les
rapports tablis par des explorateurs auprs de certaines tribus primitives. On a vu
aussi comment ces socits primitives devinrent elles-mmes le point de mire d'une
poigne de savants qui, tout en s'intressant au dveloppement de la culture et des
institutions, n'avaient que trop tendance faire aveuglment confiance aux informations accumules par des non-spcialistes; il y avait encore divorce complet entre
le penseur thorique et l'observateur.
Dans l'anthropologie fonctionnelle, ceux-ci finirent par se runir, comme je le
montrerai en dtail dans ma prochaine confrence; l'anthropologie, dans le sens que
nous lui donnons aujourd'hui, prit son essor en tant que discipline distincte dont la
tche tait l'tude des problmes thoriques de la sociologie en gnral, analyss en
fonction des observations directes effectues chez les peuples primitifs.
L'approche fonctionnelle eut une autre consquence elle modifia le but et l'application de la mthode comparative. J'ai expliqu que les anthropologues d'autrefois
voyaient dans la mthode comparative le moyen de procder une reconstruction de
l'histoire en l'absence d'authentiques documents historiques. Ils l'utilisaient surtout
pour comparer des exemples de coutumes ou d'institutions particulires glanes au
petit bonheur dans n'importe quel point du globe. Une fois accepte la notion de
systme comme postulat de base, pour reprendre les termes du Professeur RadcliffeBrown, l'objet de la recherche cesse d'tre une classification ethnologique, et l'labo-
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
43
ration de catgories culturelles et de thmes de dveloppement hypothtique. Elle
devient, dans l'tude de socits choisies comme telles, la dfinition des activits
sociales par rapport leur fonction au sein des systmes sociaux; dans les tudes
comparatives, c'est la comparaison des institutions en tant que parties intgrantes des
systmes sociaux ou par rapport la vie tout entire des socits dans lesquelles on
les trouve. Les anthropologues modernes comparent des systmes de relations et non
des coutumes. C'est une autre question sur laquelle je reviendrai plus tard.
J'aborderai maintenant le second postulat de l'anthropologie fonctionnelle: les
systmes sociaux sont des systmes naturels qui peuvent tre rduits des lois
sociologiques, avec comme corollaire, que la connaissance prcise de leur histoire n'a
pas une importance dcisive sur le plan scientifique. Je dois admettre que ce dernier
postulat me semble un exemple du plus parfait positivisme doctrinaire! On a le droit,
me semble-t-il, de demander ceux qui affirment que le but de l'anthropologie
sociale est de formuler des lois sociologiques semblables aux lois formules par les
sciences naturelles, de produire des formulations qui ressemblent ce qu'on appelle
lois dans ces sciences. Jusqu' maintenant, on ne connat rien qui ressemble, de prs
ou de loin, ce qu'il est convenu d'appeler lois en sciences naturelles, sinon des affirmations quelque peu naves, trahissant une optique nettement dterministe, tlologique et pragmatique. Les gnralisations tentes jusqu' maintenant restent si vagues
et si gnrales qu'elles ne peuvent gure tre utiles, mme si on les admet comme
vraies; elles tendent en ralit devenir de simples tautologies et des platitudes qui ne
dpassent pas les vulgaires dductions du bon sens.
Les choses tant ainsi, nous pouvons reposer la question : les systmes sociaux
sont-ils vritablement des systmes naturels et peut-on, par exemple, comparer vraiment un systme juridique un systme physiologique ou mme un systme
plantaire? Je ne vois, quant moi, aucune raison qui puisse inciter considrer les
systmes sociaux comme des systmes de mme sorte que les systmes organiques
ou inorganiques. Il me semble que ce sont des systmes compltement diffrents qui
gouvernent les socits humaines; cette dmarche ne peut mener qu' des discussions
striles. De toute faon, je ne suis pas oblig de prouver l'inexistence de ces lois; la
dmonstration incombe ceux qui prtendent qu'elles existent.
Ceux qui partagent l'avis que je viens d'exprimer sur ce point prcis doivent se
demander si ce que prtendent les fonctionnalistes, savoir que l'histoire d'une institution n'aide aucunement la comprendre, est l'heure actuelle acceptable, car cette
thse repose prcisment sur une conception du systme social et de la loi applique
aux agissements humains, qui est incompatible avec nos opinions. Un bref coup d'il
sur cette question me permettra de prciser ma propre position. Je ne voudrais pas, du
fait que je critique certains postulats fonctionnalistes, prter confusion et je tiens
prciser que sur certains autres points, j'adhre pleinement cette position et celle
de mes matres, les professeurs Malinowski et Radcliffe-Brown; je ne voudrais pas
laisser penser que je tiens les socits pour des phnomnes inintelligibles, impossibles tudier systmatiquement -ou encore que je ne crois pas la possibilit de
conclusions gnrales en ce qui les concerne.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
44
Lorsque je parle ici d'histoire, je ne reviens pas sur les hypothses ethnologiques,
qu'elles soient d'essence gntique ou diffusionniste. Je crois que ce problme particulier est rgl une fois pour toutes. Je voudrais valuer l'importance relle de la
connaissance de l'histoire d'une socit dans le cadre d'une tude sur les institutions
sociales, ceci dans le cas o l'histoire nous serait connue avec certitude et prcision.
Les philosophes du XVIIIe sicle n'accordrent pas grande importance ce problme
parce qu'ils ne pensaient pas que l'tude des institutions puisse tre autre chose que
l'tude de leur dveloppement et que le but final de leurs recherches consistait formuler clairement une histoire naturelle de la socit humaine. Ils conurent donc les
lois sociologiques comme les lois du progrs. Mise part la question des lois, car sur
ce point les anthropologues amricains professent le mme scepticisme que moimme, l'anthropologie amricaine reste nettement oriente du ct de l'histoire. C'est
pourquoi les anthropologues fonctionnalistes britanniques considrent l'anthropologie
amricaine comme plus proche de l'ethnologie; on pense en Angleterre que la recherche de l'histoire des socits n'entre pas dans le cadre de l'anthropologie sociale et
que, de plus, la connaissance de leur histoire n'est d'aucune aide lorsqu'on cherche
comprendre comment fonctionnent les institutions; cela dcoule de la conviction que
les socits sont des systmes naturels, qui doivent tre analyss selon les mthodes
(pour autant qu'elles soient applicables aux divers cas) employes par des chercheurs
scientifiques tels que les chimistes et les biologistes.
Cette question prend de plus en plus d'importance notre poque, alors que les
anthropologues se sont mis tudier des socits appartenant des systmes culturels
historiques. Tant qu'ils tudiaient des socits telles que les aborignes d'Australie ou
les indignes du Pacifique qui n'ont point d'histoire crite, la question de l'histoire ne
se posait mme pas. Mais on s'est mis tudier les communauts paysannes en Inde
et en Europe, les nomades arabes, et les anthropologues ne peuvent esquiver le
problme : il leur faut choisir d'ignorer ou de prendre en considration le pass social
lorsqu'ils procdent l'tude du prsent social de ces communauts.
Ceux qui parmi nous n'acceptent pas la position fonctionnaliste sur la question de
l'histoire soutiendront que, bien qu'il faille procder des tudes distinctes d'une
socit (certaines concernant son tat actuel, d'autres son volution dans le pass) et
donc, pour ce faire, qu'il faille employer des techniques appropries chaque tude et qu'il vaudrait mieux dans le cas de ces tudes distinctes (du moins en certaines
circonstances) faire faire ces tudes par des chercheurs diffrents -, il n'en reste pas
moins vrai que la connaissance du pass d'une socit favorise une bien meilleure
comprhension de la nature de sa vie sociale actuelle. L'histoire ne se borne pas tre
une succession de changements mais, comme certains chercheurs l'ont fait remarquer,
elle est aussi un processus de croissance. Le pass est contenu dans le prsent, luimme contenu dans l'avenir. Je ne veux pas dire que la vie sociale est intelligible en
fonction de la connaissance de son pass; mais que cette connaissance permet une
comprhension plus profonde que dans le cas ou nous n'avons aucune notion de ce
pass. Il est vident aussi que les problmes de dveloppement social ne peuvent tre
analyss qu' la lumire de l'histoire; de plus, l'histoire peut seule fournir les lments
d'une situation exprimentale satisfaisante, permettant de tester les hypothses de
l'anthropologie fonctionnelle.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
45
On pourrait continuer longtemps encore sur cette question, mais l'auditeur pensera
peut-tre qu'il appartient plus un congrs de spcialistes de la rsoudre et qu'elle
risque d'chapper un public moins averti. Contentons-nous donc d'avoir pos les
donnes principales du problme et constat les diffrences d'opinion. J'ai expliqu
mon point de vue, savoir que l'anthropologie sociale relve plus du domaine des lettres que de celui des sciences naturelles; je me dois donc d'exposer ce que je considre comme le but de l'anthropologie et les mthodes qui doivent tre appliques.
A mon avis, elle se rapproche beaucoup plus de certaines disciplines littraires,
telles que l'histoire sociale, l'histoire des institutions et des ides (par opposition
l'histoire anecdotique et politique), que des sciences naturelles. La similitude entre
cette sorte d'historiographie et l'anthropologie sociale a t masque par le fait que les
anthropologues font en direct des tudes de la vie sociale, tandis que les historiens
font des tudes indirectes, en ce qu'ils puisent leurs informations dans des documents
crits et autres sources; par le fait que les anthropologues tudient les socits
primitives qui ne possdent pas d'histoire crite; par le fait que les anthropologues
tudient gnralement des problmes synchroniques, alors que les historiens tudient
des problmes diachroniques. Je suis de l'avis du professeur Kroeber 1, qui estime que
ce sont l des diffrences techniques de perspective et non de but ou de mthode; que
la mthode de l'historiographie et de l'anthropologie sociale consiste essentiellement
en une intgration descriptive, mme si l'anthropologie sociale se situe habituellement sur un plan d'abstraction plus lev que la synthse historique et que l'anthropologie, plus que l'histoire, cherche tablir des comparaisons et des gnralisations.
A mon avis, le travail de l'anthropologue s'effectue en trois phases. Dans une
premire phase, en qualit d'ethnographe, il va s'tablir au milieu d'un peuple primitif
et s'initie leur mode de vie. Il apprend parler leur langue, penser en fonction de
leurs concepts et ragir suivant leur chelle de valeurs. Puis il revoit son exprience
en fonction des concepts et du systme de valeurs qui sont ceux de sa propre culture
et des connaissances particulires la discipline qu'il pratique. En d'autres termes, il
fait la traduction d'une culture en une autre.
Dans la seconde phase, et toujours dans le cadre de l'tude ethnographique d'une
socit primitive particulire, il essaye d'aller au-del du stade littraire et impressionniste afin de dcouvrir l'ordre structural de la socit, pour la rendre intelligible
non seulement au niveau de la conscience et de l'action, c'est--dire telle qu'elle
apparat ses membres ou l'tranger qui s'est initi ses faons de vivre et a
particip sa vie, mais aussi au niveau de l'analyse sociologique 2. De la mme faon
qu'un linguiste n'apprend pas seulement comprendre, parler et traduire une langue
trangre, mais cherche aussi assimiler ses rgles phonologiques et grammaticales,
de mme l'anthropologue ne se contente pas d'observer et de dcrire la vie sociale
d'un peuple primitif; il cherche connatre l'ordre structural sous-jacent et les
1
2
A. L. Kroeber : History and Science in Anthropology , American Anthropologist, 1935.
C. Lvi-Strauss : Histoire et Ethnologie, Revue de Mtaphysique et de Morale, 1949.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
46
configurations qui, une fois tablies, lui permettront de percevoir l'ensemble comme
la conjugaison d'abstractions interdpendantes.
Une fois qu'il a isol les grandes lignes de la structure dans une socit, l'anthropologue dans une troisime phase va les comparer avec celles d'autres socits. L'tude de chaque nouvelle socit largit sa connaissance des diverses structures sociales
de base et l'aide laborer une typologie de formes et dterminer leurs traits essentiels et les raisons qui provoquent ces variations.
Je ne serais pas tonn que la majorit de mes collgues dsapprouvent cette description des tches de l'anthropologue et, sans doute, choisiraient-ils de les dcrire
dans la terminologie propre la mthodologie des sciences naturelles; tandis que
j'implique, pour ma part, que l'anthropologie sociale traite les socits comme des
systmes symboliques et non comme des systmes organiques, qu'elle s'intresse
moins au procs qu'aux configurations et que, par consquent, elle recherche des
structures et non des lois, qu'elle dmontre la cohrence des phnomnes et non
l'existence de rapports ncessaires entre les activits sociales, qu'elle interprte plus
qu'elle n'explique. Ce sont l des diffrences conceptuelles et pas seulement des
diffrences de formulation.
On voit qu'il subsiste un certain nombre de problmes mthodologiques et, partant
de l, de problmes philosophiques : doit-on chercher donner une interprtation
psychologique aux faits sociaux? La culture et la socit sont-elles deux domaines
distincts? Existe-t-il une relation entre ces abstractions et de quelle nature est-elle?
Quelle signification doit-on donner aux termes structure, systme et fonction? Doiton considrer que l'anthropologie n'est qu'une science naturelle embryonnaire ou
qu'elle court aprs des mirages en voulant tablir des lois sociologiques? Nous
sommes loin d'avoir rsolu ces questions et d'tre d'accord les uns avec les autres;
aucune discussion ne viendra bout de ces divergences. Le seul arbitrage que nous
acceptions est celui du recours aux faits. J'examinerai ce point particulier au cours de
ma prochaine confrence.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
47
4
La recherche sur le terrain
et la tradition empirique
Retour la table des matires
Dans mes deux dernires confrences, j'ai retrac quelque peu l'volution des
thories de l'anthropologie sociale. La thorie, au fur et mesure que s'accroissaient
nos connaissances des socits primitives, changea de direction. C'est de ces connaissances nouvelles que je dsire vous entretenir.
Il semble qu'on ait souvent manifest une certaine mfiance envers la thorie (ce
qui mon sens est plutt une preuve de bonne sant) par opposition l'exprience.
Cependant, une thorie tablie n'est jamais que la gnralisation issue de l'exprience,
et vrifie par elle, une hypothse est seulement l'opinion non confirme selon
laquelle, partant de ce que nous connaissons dj, on peut raisonnablement supposer
que les faits mis au jour par la recherche seront d'une certaine nature. Sans les thories et les hypothses, on ne pourrait pas faire de recherche anthropologique car on ne
trouve (lorsqu'on a la chance de trouver) que ce que l'on recherche. Il arrive souvent
qu'on trouve tout autre chose que ce que l'on recherchait. L'histoire tout entire de la
connaissance, qu'il s'agisse des sciences naturelles ou des humanits, indique clairement que toute collecte de faits est sans valeur si leur recherche n'a pas t guide par
la thorie.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
48
On n'en entend pas moins certains dclarer que les anthropologues vont tudier
les peuples primitifs avec des prjugs thoriques qui faussent leurs conclusions sur
la vie primitive, tandis que de simples hommes d'action, du fait qu'ils sont soi-disant
dpourvus de prjugs, restitueront une version des faits beaucoup plus impartiale.
Ici, la diffrence relve d'un autre facteur. Le chercheur procde des observations
destines rpondre aux questions suscites par la gnralisation de l'opinion des
spcialistes et le profane fait ses observations dans le but de rpondre aux questions
poses par la gnralisation de l'opinion populaire. Ils ont chacun leur thorie, qui
sont respectivement systmatique et populaire.
Au fond, on peut considrer l'histoire de l'anthropologie sociale comme la substitution progressive d'une opinion informe sur les peuples primitifs une opinion non
informe. Le chemin parcouru chaque priode est proportionnel la quantit disponible de connaissances organises. Ce qui compte finalement, c'est le volume, l'exactitude et la varit des faits dment contrls. C'est le rle de la thorie de stimuler et
de guider l'observation et l'accumulation des faits. Je suis, soit dit en passant, moins
intress par l'opinion populaire que par l'opinion des spcialistes des institutions
sociales.
Il semble que les suppositions sur la nature de l'homme primitif aient vari d'un
extrme l'autre. On a d'abord pens qu'il n'tait gure plus qu'un animal, vivant dans
la pauvret, la violence et la crainte; plus tard, on le prsenta comme une douce
crature, vivant dans l'abondance, la paix et la scurit. On a dit qu'il n'avait pas de
lois, puis qu'il tait esclave des lois et des coutumes. On l'a cru dnu de tous sentiments religieux, puis on le reprsenta comme un individu compltement domin par
les rituels et baignant dans le sacr.
On pensa que c'tait un individualiste prompt asservir ses congnres les plus
faibles, puis on le dcrivit comme un communiste dont les terres et les biens appartenaient tous. On dnona la promiscuit sexuelle dans laquelle il vivait, puis on en
fit un modle de vertu domestique. On le dclara paresseux et lymphatique, puis on le
dcouvrit vif et industrieux. Lorsqu'on cherche modifier une opinion reue, je pense
qu'il n'est pas anormal de tomber dans l'excs contraire au cours de la slection et de
l'accumulation des faits destins remodeler cette opinion. En examinant le dveloppement de l'anthropologie sociale, on remarque quel point la thorie dpend des
connaissances disponibles et vice versa. Aux XVIIe et XVIIIe sicles, on pensait que
l'homme primitif vivait une vie solitaire, misrable, dsagrable, bestiale et brve ,
sans qu'on puisse produire la moindre preuve l'appui de cette opinion; mais si l'on
se base sur les dires des voyageurs d'alors, comment aurait-on pu conclure diffremment ! Ils dcrivaient volontiers l'homme primitif qu'ils avaient pu voir en des termes
du genre : S'ils n'avaient pas l'usage de la parole, on pourrait difficilement les rattacher au genre humain. Ainsi s'exprimait Sir John Chardin propos des Circassiens
dont il traversa le pays en 1671 1; quant au Pre Stanislas Arlet, il dcrit les Indiens
du Prou en 1698 2 comme des individus peine distincts des animaux . Ces
anciennes relations de voyage, qu'elles aient dcrit les sauvages comme des brutes ou
1
2
Pinkerton's Voyages, vol. IX, 1811, p. 143.
J. Lockman : Travels of the Jesuits, vol. I, 1743, p. 93.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
49
des individus raffins, sont gnralement fantaisistes, mensongres, superficielles et
tisses d'ides fausses.
Il faut reconnatre qu'elles refltaient en quelque sorte la personnalit de leur
auteur, son caractre et ses gots. A partir du XVIe sicle, il ne manque pas de rcits
donnant une description mesure, scrupuleuse de la vie des primitifs, mme si ces
rcits pchaient par leurs limitations mmes. Je citerai les crits du Britannique
Andrew Battel sur les peuples du Congo, du Pre jsuite portugais, Jerome Lobo, sur
les Abyssins, du Hollandais William Bosman sur les populations de la Cte de l'Or
ou du Capitaine Cook sur les indignes du Pacifique sud. Ils crivaient dans le mme
esprit que le Pre Lobo, dont le docteur Johnson, qui traduisit les Voyages de
Pinkerton, disait : Il semble avoir dcrit avec modestie et sincrit les choses telles
qu'il a pu les observer; il s'est laiss guider plus par ses sens que par son imagination 1. Lorsque les premiers voyageurs europens dpassrent le stade de la
simple description et du jugement personnel, c'tait souvent dans l'intention d'tablir
des parallles entre les peuples au sujet desquels ils crivaient et les anciennes
civilisations qu'ils connaissaient par la littrature, en esprant souvent dmontrer que
les cultures d'essence suprieure avaient exerc une influence sur les cultures moins
volues. Le Pre Lafitau, par exemple, tablit des comparaisons entre les Hurons, les
Iroquois et les Juifs, les premiers chrtiens, les anciens Spartiates, les Crtois, et les
anciens gyptiens. De la mme manire, de la Crquinire, un Franais qui voyagea
dans les Indes Orientales au XVIIe sicle, essaya d'tablir un parallle entre certaines
coutumes indiennes et des coutumes juives afin de nous faire mieux comprendre les
critures et les textes de l'antiquit car, pensait-il, connatre les coutumes des Indiens
ne prsente en soi aucun intrt 2.
Entre la grande poque des moralistes et les premiers crits anthropologiques
dignes de ce nom, c'est--dire entre le XVIIIe sicle et le milieu du XIXe, nos connaissances des peuples primitifs et de ceux de l'Extrme-Orient s'enrichirent normment. La colonisation europenne en Amrique du Nord s'tait considrablement
tendue, les Anglais rgnaient sur l'Inde, l'Australie, la Nouvelle-Zlande, et l'Afrique
du Sud se peuplait d'migrants europens. Les descriptions ethnographiques des
peuples de ces rgions prirent une tout autre allure et les narrations de voyage firent
place des tudes dtailles, crites par les missionnaires et les administrateurs qui
avaient beaucoup plus de facilits pour observer ces peuples mais possdaient en
outre une culture plus solide que les aventuriers d'autrefois.
On s'aperut que la plupart des opinions sur les peuples primitifs qu'on avait
volontiers crues dignes de foi, s'avraient fausses et trahissaient un manque d'objectivit flagrant. L'accumulation de matriaux nouveaux permit, comme je l'ai mentionn antrieurement, par sa qualit et sa quantit, aux Morgan, McLennan et Tylor,
d'laborer une discipline indpendante, consacre l'tude des socits primitives. Il
1
2
Pinkerton's Voyages, vol. XV, 1814, p. 1.
J. F. Lafitau : Moeurs des Sauvages Amriquains, 1724; T. H. Bowdich : Mission from Cape
Coast Castle to Ashantee, 1819; G. Frey : Journals of two Expeditions of Discovery in North-West
and Western Australia, 1841.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
50
existait suffisamment de matriaux pour au moins vrifier les hypothses existantes et
en formuler de nouvelles, fondes sur l'observation de faits ethnographiques solides.
Lorsqu'on dit que ce sont les faits qui, en dernier recours, dcident du sort des
thories, il faut ajouter que ce ne sont pas les faits rduits eux-mmes mais la
dmonstration de leur distribution et de leur signification. Je donnerai un exemple : le
mode de filiation matrilinaire avait t observ dans un certain nombre de socits
primitives, par les historiens de l'antiquit et du Moyen ge, comme par exemple
Hrodote pour les Lyciens et Maqrizi pour les Beja, sans parler des observateurs
modernes : Lafitau pour les Peaux-Rouges d'Amrique du Nord, Bowdich pour les
Ashanti de la Cte de l'Or, Grey pour les Blackfellows d'Australie et ainsi de suite.
On pensait que ces observations n'taient que des phnomnes curieux, jusqu'au jour
o Bachofen et McLennan en soulignrent l'importance capitale pour la thorie
sociologique. Si l'on avait runi ces matriaux et compris leur importance plus tt,
avant que Maine n'crive Ancient Law, celui-ci n'aurait srement pas suivi la mme
voie; ce n'est que plus tard, la lumire de certaines preuves, qu'il modifia ses vues.
On trouve chez McLennan un exemple intressant de ce que pouvait produire la
combinaison d'une somme de connaissances avec des thories bases sur ces connaissances. Il n'entretenait gure d'illusions quant la valeur relle de la plupart de ses
sources; il en critiqua la pauvret et le parti-pris; bien qu'il se soit montr extrmement prudent, il ne pouvait gure viter certaines des erreurs qui l'amenrent
noncer une succession d'hypothses compltement fausses. Vu les matriaux dont il
disposait, il pouvait raisonnablement croire que le systme matrilinaire prdominait
chez les aborignes australiens. Nous savons dsormais qu'il se trompait. Il se trompa
encore sur un autre point : le systme matrilinaire ne prdomine pas dans la majorit
des races actuellement les moins volues.
Il croyait encore que la polyandrie se pratiquait dans un trs grand nombre de
socits, alors qu'en fait le nombre de ces socits est fort limit. Il avait tort lorsqu'il
prtendait que l'infanticide des petites filles est couramment pratiqu par les peuples
primitifs.
Les sources o puisait McLennan le conduisirent une erreur plus srieuse encore
: il prtendit que parmi les peuples les moins volus l'institution du mariage et la
famille ne se trouvent pas ou n'existent que de faon trs rudimentaire. S'il avait su,
comme nous le savons dsormais, qu'on les trouve sans exception aucune, dans toutes
les socits primitives, il n'aurait jamais mis pareille conclusion, mais il tait
persuad qu'elles taient inexistantes dans les socits anciennes. Il a d'ailleurs fallu
attendre Westermarck puis Malinowski pour apprendre quel point cette supposition
tait fausse 1.
On pourrait facilement dmontrer que nombre de thories d'autres auteurs d'alors
taient fausses ou inexactes, et cela toujours cause de l'inexactitude et l'insuffisance
des observations enregistres jusqu'alors.
1
E. A. Westermarck : The History of Human Marriage, 1891; B. Malinowski : The Family among
the Australian Aborigines -A sociological Study, 1913.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
51
Reconnaissons toutefois leurs auteurs, mme s'ils se sont tromps, le mrite
d'avoir avanc des hypothses sur les peuples primitifs qui incitrent ceux qui, par
vocation ou par devoir, rsidaient (parfois durant de longues priodes) parmi des
peuples primitifs, effectuer des enqutes srieuses. On assiste pour la premire fois
des changes d'informations entre les quelques missionnaires et administrateurs qui
vivaient en des coins retirs du monde et les chercheurs en Angleterre.
Ces missionnaires et ces administrateurs avaient autant envie de contribuer l'enrichissement des connaissances que de mettre en pratique ce que l'anthropologie pouvait leur apprendre au sujet des populations dont ils devaient s'occuper. Ils comprirent
en lisant la littrature anthropologique que ces peuples, bien que situs au bas de
l'chelle des cultures matrielles, possdaient des systmes sociaux complexes, des
codes moraux, des religions, des arts, des philosophies, des rudiments de science,
qu'on devait les respecter et mme les admirer lorsqu'on les avait compris.
Les rapports et les crits de ces missionnaires ou administrateurs trahissent l'influence des thories anthropologiques d'alors, influence parfois bnfique, parfois moins
heureuse. Ils connaissaient les problmes thoriques qui se posaient aux chercheurs et
se trouvaient frquemment en contact avec ceux qui les avaient formuls. Les chercheurs vivant en Angleterre prirent l'habitude d'envoyer de longues listes de questions
ceux qui vivaient parmi les peuples primitifs. C'est Morgan qui le premier expdia
ce genre de liste aux diffrents agents amricains envoys l'tranger car il dsirait se
faire communiquer les terminologies de parent. S'inspirant des informations qu'ils
lui envoyrent, il publia en 1871 son clbre ouvrage, Systems of Consanguinity and
Affinity of the Human Family. Sir James Frazer devait plus tard tablir une liste de
questions : Questions sur les manires, les coutumes, la religion, les superstitions,
etc. des peuples non-civiliss ou semi-civiliss 1, liste qu'il expdia dans le monde
entier afin d'obtenir les informations qui devaient tre incorpores aux volumes du
Rameau d'Or . Le questionnaire le plus dtaill fut publi par l'Institut Royal
d'Anthropologie en 1874, et s'intitulait Notes et questions en anthropologie 2 ; ce
questionnaire en est maintenant sa cinquime dition.
Les chercheurs correspondaient parfois rgulirement avec ceux qui avaient lu
leurs uvres, comme par exemple Morgan avec Fison et Howitt en Australie, Frazer
avec Spencer en Australie et Roscoe en Afrique. Depuis une priode relativement
rcente, certains administrateurs suivent des cours d'anthropologie dans les universits anglaises. Je reviendrai sur ce point particulier un autre moment. Le principal
agent de liaison aidant le chercheur tablir un contact avec l'administrateur ou le
missionnaire l'tranger, fut l'Institut Royal d'Anthropologie qui fut fond en 1843,
sous le nom de Socit Ethnologique de Londres, et a toujours offert un excellent lieu
de rencontre ceux qu'intressaient les hommes primitifs.
Bien des profanes rdigrent d'excellents rapports sur les peuples primitifs et,
dans certains cas, les auteurs professionnels n'ont pratiquement pas fait mieux. Ces
1
2
Sans date certaine.
Notes and Queries in Anthropology.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
52
rapports taient tablis par des hommes qui possdaient une grande connaissance de
ces peuples et qui parlaient leur langue. Je pense aux ouvrages de Callaway : The
religious system of the Amazulu (1870), de Codrington : The Melanesians (1891), aux
oeuvres de Spencer et Gillen sur les aborignes d'Australie 1, de Junod : Vie d'une
tribu sud-africaine (1898, traduction anglaise en 1912-13), de Smith et Dale : The
Ila-Speaking Peoples of Northern Rhodesia (1920). Si, pendant toute cette priode,
les rcits de voyageurs apportrent des informations prcieuses rdiges par les
missionnaires et les administrateurs, les tudes dtailles de ces profanes continurent
tre utiles bien aprs que le travail sur le terrain fut devenu une habitude chez les
anthropologues. On n'en comprit pas moins que si l'anthropologie devait progresser,
les anthropologues devaient procder leur propre enqute et faire eux-mmes leurs
observations. On peut s'tonner juste titre qu' l'exception de Morgan pour son
tude sur les Iroquois 2, aucun anthropologue n'avait eu l'ide de faire des observations directement sur le terrain avant la fin du XIXe sicle. Fait encore plus tonnant :
aucun de ces crivains anthropologues ne pensa une seule fois aller observer sur
place un ou deux spcimens de la population sur laquelle il passait sa vie crire.
William James raconte que, lorsqu'il demanda Sir James Frazer des dtails sur les
indignes qu'il avait rencontrs, celui-ci le dtrompa en s'criant : A Dieu ne
plaise! 3.
Si l'on avait pos cette question un chercheur en sciences naturelles, nul doute
qu'il et rpondu de faon fort diffrente. Nous avons dj expliqu que les premiers
auteurs anthropologues, Maine, McLennan, Bachofen et Morgan, taient des juristes.
Fustel de Coulanges tait historien et s'occupait en ralit d'histoire classique et
mdivale; Spencer tait philosophe, Tylor tait secrtaire en langues trangres, PittRivers tait soldat, Lubbock banquier, Robertson Smith, pasteur presbytrien et
exgte de la Bible et Frazer se spcialisait dans les tudes classiques. Ceux qui les
suivirent taient en majorit des naturalistes. Boas tait physicien et gographe,
Seligman pathologiste, Haddon spcialiste de zoologie marine, Rivers physiologiste,
Elliot Smith anatomiste, Balfour zoologue, Malinowski physicien et RadcliffeBrown, bien que diplm en sciences morales, avait aussi suivi des cours de psychologie exprimentale. Ces hommes savaient que dans le domaine de la science, il est
indispensable de vrifier ses hypothses au moyen d'observations directes et qu'on ne
doit pas laisser ce soin aux profanes. Les expditions anthropologiques dbutrent en
Amrique avec Boas qui partit travailler en Terre de Baffin et en Colombie britannique; en Angle terre, c'est Haddon, de Cambridge, qui inaugura ce type d'expdition
en emmenant un groupe de savants dans la rgion du dtroit de Torres, dans le
Pacifique, en 1898 et 1899. Cette expdition marque un tournant dcisif dans l'histoire de l'anthropologie sociale en Grande-Bretagne. A partir de cette poque, deux
dveloppements importants, troitement lis l'un l'autre, se produisirent : l'anthropologie devint de plus en plus une discipline professionnelle indpendante et l'on finit
par comprendre que le travail sur le terrain constituait une partie essentielle de la
formation du chercheur.
1
2
3
B. Spencer & F. J. Gillen : The Native Tribes of Central Australia, 1899; The Northern Tribes of
Central Australia, 1904; The Arunta, 1927.
The League of the Iroquois, 1851.
R. Benedict : Anthropology and the Humanities , American Anthropologist, 1948, p. 587.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
53
Ces premiers travaux sur le terrain avaient des points faibles. Bien que les
hommes qui les effecturent aient pu tre correctement entrans la recherche dans
l'une ou l'autre des sciences naturelles, les rsultats se ressentirent du sjour souvent
trop court qu'ils faisaient chez les peuples qu'ils tudiaient; ils ignoraient la langue
vernaculaire et leurs contacts avec les indignes restaient sur un plan superficiel. On
s'est aperu depuis des nombreuses inexactitudes que contenaient ces tudes et c'est
cela qu'on peut mesurer le chemin parcouru. L'tude des socits primitives prit par la
suite une tournure plus scientifique. Parmi les contributions les plus importantes, il
faut mentionner mon avis celle du professeur Radcliffe-Brown, qui fut l'lve de
Rivers et Haddon. Son tude sur les habitants des Iles Andaman, de 1906 1908,
constitue la premire tentative srieuse de vrification des thories sociologiques
dans une socit primitive; il chercha dcrire la vie sociale d'une population de
faon en dgager les facteurs essentiels cette vrification 1. Sur ce point, cette
tude est peut-tre plus importante dans l'histoire de l'anthropologie sociale, que
l'expdition du dtroit de Torres dont les membres s'intressaient plus aux questions
ethnologiques et psychologiques qu'aux questions purement sociologiques.
Nous avons remarqu que la spculation thorique au sujet des institutions sociales ne se trouve d'abord qu'accidentellement lie aux relations descriptives des
peuples primitifs; on comprend qu'on situe au XIXe sicle la vritable naissance de
l'anthropologie, lorsque ces populations devinrent vritablement l'objet des tudes
portant sur les institutions sociales.
La recherche toutefois restait purement livresque et continuait s'appuyer sur des
observations accumules par d'autres individus. C'est alors que nous avons atteint le
dernier stade du dveloppement, dans lequel les observations et les conclusions sont
tablies par une seule et mme personne et o le chercheur se trouve en contact direct
avec le sujet de son tude. Autrefois l'anthropologue, comme l'historien, considrait
les documents comme la matire brute de son tude; aujourd'hui, la matire brute
d'une tude, c'est la vie sociale elle-mme.
Bronislaw Malinowski, lve de Hobhouse, Westermarck et Seligman, eut l'immense mrite de faire grandement progresser la recherche sur le terrain. Il est vrai que
le Professeur Radcliffe-Brown a toujours eu une connaissance plus vaste de l'anthropologie sociale en gnral et se montra un brillant penseur, mais Malinowski le
surpasse de loin sur le chapitre du travail sur le terrain. D'abord, il passa plus de
temps que personne ne l'avait jamais fait (et, je crois, ne l'a fait depuis), sur une
unique tude, celle des habitants des Iles Trobriand en Mlansie, entre 1914 et 1918;
mais encore il fut le premier anthropologue mener son enqute dans la langue
indigne. Il est vident que dans de telles circonstances, Malinowski russit con-
A. R.-Brown : The Andaman Islanders : A Study in Social Anthropology, 1922.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
54
natre parfaitement la vie des Trobriandais, qu'il dcrivit dans un certain nombre de
monographies, d'ingal volume, jusqu'au moment de sa mort 1.
C'est en 1924, Londres, que Malinowski commena enseigner. Le Professeur
Firth, qui occupe aujourd'hui la chaire de Malinowski Londres, et moi-mme furent
ses deux premiers lves en anthropologie cette anne-l; entre 1924 et 1930, la
plupart des anthropologues qui occupent maintenant la majorit des chaires d'anthropologie en Grande-Bretagne et dans le Commonwealth, suivirent ses cours. On peut
dire juste titre que la plupart des tudes srieuses faites sur le terrain s'inspirent
directement ou indirectement de son enseignement et du principe sur lequel il insistait
particulirement : on ne peut comprendre la vie sociale d'une population qu'en l'tudiant de manire approfondie; l'apprentissage de l'anthropologie doit comprendre au
moins une tude pousse d'une socit primitive. Je reviendrai sur ce point aprs
avoir expliqu plus clairement ce que je considre, quant moi, comme l'un des traits
essentiels des premires enqutes sur le terrain.
Les tudes que j'ai mentionnes plus haut furent effectues dans des communauts
trs rduites au point de vue numrique : les hordes australiennes, les campements
des les Andaman et les villages mlansiens, ce qui fait que certains aspects de la vie
sociale, la parent et les rituels en particulier, furent examins au dtriment des autres, comme les structures politiques auxquelles on n'accordait pas l'attention qu'elles
mritaient, jusqu'au moment o l'on se mit tudier les socits africaines. En
Afrique, les groupes politiques autonomes se montent souvent plusieurs milliers de
membres et leur organisation politique interne, autant que leurs inter-relations, obligrent les chercheurs se pencher sur des problmes politiques spcifiques, ce qui ne
se produisit que rcemment. En effet, la recherche professionnelle en Afrique ne
commena vraiment qu'avec le voyage du Professeur Seligman au Soudan anglogyptien en 1909-1910, et la premire tude pousse faite en Afrique par un anthropologue fut la mienne, chez les Azand du Soudan anglo-gyptien, en 1927. Depuis,
la plupart des tudes dtailles ont t faites en Afrique, notamment dans le domaine
des institutions politiques, comme celle du Professeur Schapera au Bechuanaland,
celle de Fortes chez les Tallensi de la Cte de l'Or, de Nadel chez les Nupe de
Nigeria, de L. Kuper chez les Swazi et la mienne chez les Nuer du Soudan anglogyptien.
Je vais essayer de vous donner une description du travail approfondi sur le terrain
en expliquant ce qu'on demande aujourd'hui l'tudiant qui dsire devenir anthropologue professionnel. Je parlerai plus particulirement d'Oxford. Lorsqu'un tudiant
s'adresse nous, nanti d'une licence ou d'un autre diplme dans une autre discipline,
il doit passer un an prparer le diplme d'anthropologie afin d'acqurir des connaissances gnrales en anthropologie sociale, mais (je l'ai dit dans ma premire confrence) galement des lments d'anthropologie physique, d'ethnologie, de technologie
et d'archologie prhistorique. Il passe une deuxime anne, peut-tre plus, rdiger
une thse d'aprs des matriaux puiss dans la littrature classique de l'anthropologie
sociale. Puis, si son travail rvle des aptitudes suffisantes et s'il a de la chance, il
1
Argonauts of the Western Pacific, 1922; The Sexual Life of Savages, 1929; Coral Gardens and
their Magic, 1935.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
55
obtient une bourse pour faire de la recherche sur le terrain; il se prpare alors en
tudiant soigneusement la littrature consacre aux populations de la rgion o il va
effectuer sa mission, et s'initie galement aux diffrents dialectes.
Il passe gnralement un minimum de deux ans faire cette premire enqute sur
le terrain; c'est--dire qu'il effectue un premier sjour, rentre pour collationner les
matriaux rcolts, puis repart pour un second sjour. L'exprience a dmontr qu'une
coupure de quelques mois entre les deux expditions, priode que le chercheur
passera de prfrence dans un dpartement d'universit, contribue l'laboration de
rsultats srieux. Il ne lui faudra pas moins de cinq autres annes avant de publier ses
rsultats de recherche, s'il veut atteindre le niveau actuel de la discipline anthropologique, et plus longtemps encore s'il n'y consacre pas tout son temps. Ce qui veut
dire qu'on peut difficilement mener une enqute dtaille sur une socit primitive et
en publier les rsultats en moins de dix ans.
Il est toujours souhaitable de procder une tude sur une seconde socit, sinon
l'anthropologue risque, comme le fit Malinowski, de penser toute sa vie en fonction
d'un seul type de socit. La seconde tude prend normalement moins de temps parce
que l'exprience prcdente a enseign l'anthropologue comment mener plus rapidement son enqute et comment rdiger avec sobrit; mais il n'en aura pas moins
besoin de plusieurs annes avant de publier le rsultat de ses recherches. Il faut
beaucoup de patience pour entreprendre et mener bien ce genre d'apprentissage et
de recherche.
Dans ce tableau qui dcrit l'apprentissage de l'anthropologue, j'ai dit qu'il doit
procder une tude pousse des peuples primitifs; je n'ai pas encore expliqu
comment se font ces tudes. Comment tudie-t-on une socit primitive? Je rpondrai
brivement en termes gnraux cette question et ne m'attarderai que sur les rgles
essentielles du travail sur le terrain, vitant toute digression sur les techniques d'enqute. Ces techniques se rduisent d'ailleurs peu de choses : les questionnaires et les
recensements, au surplus, n'ont pas grande valeur si on les pratique auprs d'individus
qui n'ont pas encore atteint un stade d'volution suffisamment avanc, ce qui est assez
rare parmi les peuples dont les coutumes et les traditions n'ont t que peu modifies
par les changes commerciaux, l'ducation et l'administration. Il y aurait beaucoup
dire l'appui de ce que Radin avanait : La plupart des bons enquteurs sont
peine conscients de la manire exacte dont ils rcoltent leurs informations 1.
L'exprience n'en a pas moins montr que certaines conditions sont indispensables
au bon droulement d'une enqute srieuse. L'anthropologue doit tre prt passer
beaucoup de temps sur son enqute; il doit rester en contact troit et permanent avec
les populations sur lesquelles il travaille; il ne doit communiquer avec eux que dans
leur langue et il doit tudier tous les aspects de leur culture et de leur vie sociale.
J'examinerai chacun de ces points sparment, mme s'ils semblent aller de soi. Si
l'anthropologie britannique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est grce un
souci extrme de la prcision dans la recherche; ce sont les qualits de ses mthodes
P. Radin : The Method and Theory of Ethnology, 1933, p. IX.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
56
sur le terrain qui la diffrencient, mon avis, de l'anthropologie qui se pratique en de
nombreux autres pays.
Les enquteurs d'autrefois pchaient toujours par trop de hte. Ils ne passaient
gnralement que quelques jours chez les peuples qu'ils tudiaient et rarement plus de
quelques semaines; de tels sjours peuvent constituer ventuellement les prliminaires fructueux d'tudes approfondies et de classifications ethnologiques lmentaires, mais ne sauraient en aucun cas suffire la comprhension profonde de la vie
sociale d'un groupe. L'optique contemporaine est bien diffrente, comme je l'ai dit,
puisque des sjours d'un trois ans sont ncessaires l'tude d'une seule population.
Ce laps de temps permet d'observer, au cours de toutes les saisons, le droulement de
la vie sociale d'une population qui est destine tre inventorie dans ses moindres
dtails, toutes les conclusions devant tre soigneusement vrifies.
Aurait-il sa disposition un temps illimit pour faire son enqute que l'anthropologue n'obtiendra de rsultats valables qu'en mettant tout en oeuvre pour s'intgrer
au maximum la population quil tudie; il lui faudra tablir des liens troits avec les
individus et il pourra ainsi observer, de l'intrieur en quelque sorte, toutes les activits, tout ce qui se passe dans la vie quotidienne des individus aussi bien que les
vnements moins courants comme les crmonies et les procs, et en participant la
vie de la communaut, il apprendra par l'action comme par l'oreille et l'il ce qui se
passe autour de lui. Il est bien certain que ce ne furent pas les conditions dans lesquelles travaillrent les premiers anthropologues, ni les missionnaires, ni les administrateurs qui, vivant en dehors de la communaut, dans les btiments de la mission ou de
l'administration, devaient perptuellement se fier aux renseignements que leur donnaient leurs informateurs. Lorsqu'ils visitaient par hasard quelque village indigne,
leur visite interrompait et modifiait totalement les activits qu'ils taient venus
observer.
Cela n'est pas seulement une question de proximit physique, il faut penser encore
l'aspect psychologique. En vivant parmi les indignes, et sur le plan matriel dans
un style aussi proche que possible du leur, l'anthropologue se place au mme niveau.
Contrairement aux missionnaires et aux administrateurs, il n'est investi d'aucune
autorit, il n'a pas de rang tenir et il jouit d'une position de neutralit. Il n'est pas l
pour changer leur mode de vie mais pour humblement apprendre vivre comme eux.
Aucun intermdiaire ne fait barrage entre lui et les indignes; aucun policier, aucun
interprte ni aucun catchiste ne fait cran entre eux et lui.
L'un des aspects les plus importants rside sans doute dans le fait qu'il soit seul,
coup de la compagnie des hommes de sa race et de sa culture; il dpend donc des
indignes qui l'entourent quand il a besoin de compagnie, d'amiti et de chaleur humaine. Si, le jour du dpart, au moment des adieux, il n'existe aucune tristesse chez
les indignes et chez l'anthropologue, on peut dire qu'il aura chou. Il est bien
vident qu'il ne peut tablir de liens amicaux qu'en devenant l'un des membres de leur
socit; il faut qu'il vive, pense et ressente comme eux, car c'est lui seul que revient
le rle d'effectuer cette transposition indispensable.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
57
Pour effectuer sa tche dans les conditions que je viens d'noncer, le chercheur
doit ncessairement connatre la langue locale et tout anthropologue digne de ce nom
l'tudiera avant toute autre chose, afin de se dispenser des interprtes. Certains individus n'ont gure de facilits pour les langues trangres, dont certaines prsentent, il
est vrai, des difficults incroyables, mais il est fondamental d'arriver pratiquer la
langue au maximum, pour pouvoir d'abord communiquer avec les indignes - et pour
un certain nombre d'autres raisons. Pour comprendre la pense d'un peuple, il faut
penser selon ses symboles. En apprenant la langue, on apprend la culture et le
systme social qui sont conceptualiss par le langage. Toutes les relations sociales,
toutes les croyances, tous les procds techniques, en fait tous les phnomnes de la
vie sociale des indignes, s'expriment en mots aussi bien qu'en gestes et lorsqu'on a
compris parfaitement le contenu de tous les mots du langage, dans toutes les situations correspondantes, on a termin l'tude de cette socit. J'ajouterai une chose que
savent tous les chercheurs : la tche la plus ardue du travail sur le terrain consiste
dterminer le sens d'un certain nombre de mots-cl, dont dpend tout le succs d'une
enqute donne. Il n'y a que l'anthropologue qui puisse les dterminer au fur et
mesure qu'il apprend utiliser les mots pour communiquer avec les indignes. De
plus, un anthropologue doit apprendre la langue ds le dbut de son enqute afin de
se placer dans un tat de dpendance vis--vis des indignes. Ainsi, il se prsente
eux en lve et non en matre.
Enfin, l'anthropologue doit tudier la totalit de la vie sociale. Il lui sera impossible de comprendre clairement et de faon dtaille une portion de la vie sociale d'un
peuple s'il ne se place pas dans le contexte entier de leur vie sociale en tant que
formant un tout. Tous les dtails enregistrs par l'enquteur ne sont pas ncessairement publis, mais on doit pouvoir trouver dans les carnets de notes d'un anthropologue une description dtaille des activits les plus banales : comment les vaches
sont traites, comment la viande est cuite, etc. Autre chose : mme s'il a choisi d'crire
un livre sur le systme juridique d'une population, sur la religion ou l'conomie, il ne
doit pas dcrire l'aspect qu'il aura retenu sans tenir compte de tout le reste; il travaillera en fonction de toutes les activits sociales et en fonction de la structure sociale
tout entire.
Voil donc en bref les conditions essentielles d'un travail positif sur le terrain. On
peut se demander maintenant quelles sont les qualits requises pour y arriver. Il va de
soi que le chercheur doit avoir reu une formation acadmique en anthropologie
sociale. Il doit possder une connaissance srieuse des diverses thories ainsi que de
l'ethnographie de la rgion dans laquelle il va travailler.
Il est vrai qu'une personne cultive, intelligente et sensible, peut russir bien
connatre une population trangre et, ventuellement, crira une excellente description de leur mode de vie; j'avouerai qu'il arrive souvent qu'une telle personne connaisse bien les indignes et crive sur eux un meilleur ouvrage que ne le font nombre
d'anthropologues professionnels. Beaucoup d'excellents rapports ethnographiques ont
t crits bien avant qu'on entende parler d'anthropologie sociale et je pense aux
Murs, coutumes et crmonies des Indous de Dubois (1816), aux Murs et
coutumes des gyptiens modernes de Lane (1836). On ne saurait le nier; cependant,
mme au niveau de la traduction d'une culture en une autre et sans tenir compte de
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
58
l'analyse structurale, je pense aussi que l'individu qui, en plus de ses autres qualifications, a fait des tudes d'anthropologie, fera une tude plus approfondie et plus
complte que celui qui en est encore chercher et dterminer ce qu'il doit observer
et comment le faire.
Lorsqu'on en vient l'analyse structurale, le profane est perdu parce qu'ici, la
connaissance des thories, l'valuation des problmes, de la mthode, des concepts
techniques restent essentielles. Si je vais me promener, en rentrant chez moi je pourrai dcrire les diverses roches que j'aurai vues. Ma description peut tre excellente
mais ce ne sera pas la description d'un gologue. De la mme faon, le profane peut
rendre compte de la vie sociale d'un peuple primitif mais, quelle que soit l'excellence
de sa description, ce ne sera pas celle d'un sociologue. C'est ce niveau que se situe
la diffrence. Dans le cas des roches qu'tudie un gologue, seule la connaissance
scientifique, une certaine habilet manuelle et de bons outils sont ncessaires, tandis
que dans le domaine de l'anthropologie, il faut toutes sortes de qualits personnelles
et humaines (qualits que le profane possde peut-tre et dont manque peut-tre aussi
l'anthropologue), et si l'on peut se mettre la place d'un individu appartenant une
autre culture, on ne peut se mettre la place d'une roche.
Le travail sur le terrain requiert donc, en plus des connaissances thoriques et d'un
entranement technique, un certain type de caractre et de temprament. Certains
individus sont incapables de supporter l'isolement, surtout s'ils vivent en outre dans
des conditions matrielles inconfortables et malsaines. D'autres sont incapables d'effectuer le transfert intellectuel et affectif indispensable. L'anthropologue doit, en
quelque sorte, contenir en lui-mme le groupement indigne qu'il tudie et ne pas
simplement l'enfermer dans ses carnets de notes, s'il veut le comprendre, pouvoir penser et sentir alternativement comme un sauvage et un europen, aptitude particulirement difficile acqurir.
Pour russir, un individu doit pouvoir se livrer sans restrictions, il doit possder
une intuition qui n'est pas commune tout le monde. Beaucoup de gens savent quoi
et comment observer, mais n'en produiront pas moins une tude assez sommaire;
quand il s'agit de trouver un individu apte produire une tude qui se situera un
niveau de comprhension plus profond, on lui demande plus que de l'agilit intellectuelle et de la technique, car ces qualits rduites elles seules ne peuvent produire
un bon anthropologue, pas plus qu'elles ne produiront un bon historien. Ce qui ressort
d'une tude sur un peuple primitif n'est pas seulement le produit des impressions
intellectuelles de la vie indigne; c'est l'ampleur et l'impact enregistr par l'observateur en tant qu'tre humain complet. Il s'ensuit que le succs du travail sur le terrain
peut dpendre ventuellement de la personnalit d'un enquteur particulier auprs
d'une population particulire. Il peut chouer avec une population et russir chez une
autre. Pour que l'enqute russisse, il faut que son intrt et sa sympathie soient
stimuls. Si le type idal de temprament ne va pas ncessairement de pair avec les
aptitudes et l'ducation approprie, ainsi que le souci de conclusions prudentes, il
s'accompagne plus rarement encore de la vision imaginative propre l'artiste, vision
qui serait souhaitable dans l'interprtation des faits observs; on souhaiterait encore
que ce type idal possde le talent littraire ncessaire pour bien traduire une culture
trangre dans la langue de l'enquteur. Le travail de l'anthropologue n'est pas de
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
59
photographier. Il doit dcider quels faits sont significatifs et seule l'exprience peut
lui apprendre mettre en relief ce qui est significatif. Il lui faut donc, en plus de
vastes connaissances en anthropologie, avoir l'intuition des formes et des structures,
avec, de surcrot, un grain de gnie!
Qu'on ne croie surtout pas que je suis en train d'insinuer que chacun de nous
possde ces qualits qui devraient tre celles du parfait anthropologue! Certains ont
des aptitudes que les autres n'ont pas et vice versa. Chacun utilise au mieux celles
dont il dispose.
Puisque le travail sur le terrain dpend tellement de la personnalit de l'enquteur
(et je pense que nous sommes tous d'accord sur ce point), on peut se demander si,
dans le cas d'une enqute donne, les rsultats seraient les mmes, selon qu'elle est
faite par un individu ou un autre. La question est d'importance. Je rpondrai, et je
crois que les preuves matrielles que nous possdons incitent le penser, que
l'enregistrement des faits en tant que tels serait le mme, bien qu'il faille prvoir
quelques diffrences individuelles se situant au niveau de la perception.
Il est presque impossible l'enquteur qui sait ce qu'il cherche et connat la
meilleure manire de le trouver, de se tromper sur les faits s'il passe deux ans dans
une petite communaut culturellement homogne et s'il consacre vritablement tout
son temps tudier son mode de vie. Une fois que la vie sociale n'a plus de secrets
pour lui, il devinera si bien ce qui sera dit et fait dans telle ou telle situation, qu'il
devient pratiquement superflu de faire d'autres observations ou de poser d'autres
questions. Et quel que soit le caractre particulier d'un anthropologue, il n'en travaille
pas moins dans le cadre de connaissances thoriques qui dterminent largement les
sujets qui l'intressent et la ligne suivre dans l'enqute. Il travaille aussi l'intrieur
de limites imposes par la culture du peuple qu'il tudie. Si ce sont des pasteurs
nomades, il doit tudier le nomadisme pastoral. S'ils pratiquent abondamment la
sorcellerie, il doit tudier la sorcellerie. Il n'a pas d'autre choix que de suivre la
tendance principale de la culture.
Mais si je pense que des anthropologues diffrents, qui tudient les mmes
peuples, enregistreront plus ou moins les mmes faits dans leurs carnets de notes, je
suis persuad qu'ils criront des livres diffrents. A l'intrieur des limites imposes
par leur discipline et la culture tudie, les anthropologues sont guids dans le choix
de leurs thmes, dans la slection des faits destins les illustrer et dans le jugement
de ce qui est ou n'est pas significatif, par leurs intrts diffrents qui sont le reflet de
leurs particularits, de leur personnalit, de leur ducation, de leur statut social, de
leurs opinions politiques, de leurs convictions religieuses et ainsi de suite.
On ne peut interprter ce que l'on voit qu'en fonction de sa propre exprience et de
ce que l'on est, et les anthropologues, tout en ayant une somme de connaissances
communes, diffrent sur d'autres points autant que d'autres individus seront diffrents
de par leurs antcdents, leur exprience et leur nature propre. La personnalit d'un
anthropologue ne saurait pas plus tre dissocie de son travail que l'on ne saurait
dissocier la personnalit d'un historien de son oeuvre. Lorsque l'anthropologue dresse
l'inventaire d'une population primitive, il ne dcrit pas seulement la vie sociale avec
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
60
un maximum de prcision, il exprime aussi sa propre personnalit. C'est dans ce sens
que sa description doit exprimer un jugement moral, surtout lorsqu'il s'attaque des
sujets qui lui tiennent cur. Ce qui ressort alors d'une tude dpend dans une certaine mesure de ce qu'y apporte l'enquteur. Ceux qui connaissent les anthropologues
et leurs crits aussi bien que moi, seront certainement d'accord sur ce point. Je ne
pense pas qu'il faille se proccuper outre mesure de ce problme, une fois que l'on
admet qu'une certaine latitude est laisse la personnalit de l'enquteur et que par
ailleurs ces diffrences personnelles tendent, dans l'ensemble de la littrature anthropologique, se compenser les unes les autres; il convient donc de se fier l'exactitude des observations. Il faut considrer la question sous un aspect beaucoup plus
large. Quelles que soient les diffrences qui existent entre les anthropologues, ils
restent les enfants d'une mme culture et d'une mme socit. En gnral, ils ont tous,
en dehors de leurs tudes et de leurs connaissances spcialises, les mmes catgories
et les mmes valeurs culturelles qui orientent leur attention vers un certain type de
caractristiques dans les socits tudies. La religion, le droit, l'conomie, la
politique, etc. sont des catgories abstraites de notre culture; elles servent formaliser
les phnomnes observs chez les peuples primitifs. Les hommes de notre culture
remarqueront un certain type de phnomne et ils le verront d'une manire particulire. Dans une certaine mesure, les gens de culture diffrente remarqueront d'autres faits et les percevront d'une autre faon. Pour autant que ceci soit vrai, les faits
enregistrs dans nos carnets ne sont pas des faits sociaux mais des faits ethnographiques, la slection et l'interprtation s'tant produite au niveau de l'observation. Je
ne puis m'tendre plus avant sur ce point et je me contenterai d'avoir pos ce
problme de la perception et de l'valuation.
J'ajouterai pour conclure que j'ai envisag la recherche anthropologique sur le
terrain, les qualits et les qualifications souhaitables pour la mener bien, en fonction
de l'opinion que j'ai exprime dans ma dernire confrence, savoir que l'anthropologie devrait tre considre comme un art et non comme une science. Ceux de mes
collgues qui sont de l'avis contraire, auraient srement envisag les questions que
j'aborde ici sous un angle tout fait diffrent.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
61
5
LES TUDES
ANTHROPOLOGIQUES
MODERNES
Retour la table des matires
J'ai essay, dans mes deuxime et troisime confrences, de vous donner un aperu de l'volution thorique de l'anthropologie sociale, c'est--dire sur le plan pratique
de l'volution thorique concernant les peuples primitifs ou de ce qui, au sicle
dernier, se serait appel : les institutions des premiers hommes, et au sicle d'avant:
les socits barbares. Dans ma dernire confrence, j'ai brivement expos la faon
dont se sont accrues nos connaissances sur ces socits primitives; j'ai expliqu comment les rapports descriptifs s'taient amliors en qualit et en quantit depuis les
observations superficielles des explorateurs, suivies par les rapports dtaills des
missionnaires et des administrateurs, jusqu'aux tudes pousses de la recherche professionnelle contemporaine. L'accumulation des connaissances a donn lieu des
thories successives, les unes dtrnant les autres, et elles ont pour elles qu' chaque
nouvelle formulation, l'observation est dirige vers des couches plus profondes et des
domaines nouveaux de la vie sociale des socits primitives, en provoquant par consquent un nouvel enrichissement de nos connaissances.
Le grand essor de la recherche a favoris une nouvelle orientation des buts et des
mthodes de l'anthropologie sociale. Je ferai ici un bref inventaire des tendances
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
62
nouvelles, puis j'examinerai un certain nombre de monographies anthropologiques o
l'on verra de quelle faon les chercheurs groupent les phnomnes qu'ils ont observs,
et qui illustreront le type de recherche que pratiquent les anthropologues d'aujourd'hui. Nous avons vu comment ils procdaient pour faire ces observations. Nous
verrons maintenant la faon dont ils les organisent et le sens qu'ils leur attribuent.
Avant toute chose, il faut se souvenir que l'anthropologue travaille sur la base de
connaissances thoriques et que ses observations sont destines rsoudre les problmes qu'elles font surgir. L'importance attribue aux problmes est par ailleurs la
caractristique fondamentale de n'importe quelle autre discipline. Lord Acton conseillait toujours ses tudiants d'tudier les problmes et non les priodes historiques.
Collington disait ses tudiants en archologie de s'attacher aux problmes et non
aux sites. Quant nous, nous recommandons aux tudiants d'tudier les problmes et
non les peuples.
Les premires monographies furent surtout des ouvrages descriptifs, sans grande
proccupation d'analyse systmatique, bien que les spculations pseudo-historiques
fussent parfois considres comme telles. Ces tudes consistaient en une succession
de chapitres traitant au fur et mesure et avec force dtails des diffrents aspects de
la vie sociale : l'environnement, les caractristiques raciales, la dmographie, les statistiques dmographiques, la technologie, l'conomie, l'organisation sociale, les rites
de passage, la loi, la religion, la magie, la mythologie, le folklore, les distractions, etc.
Les monographies modernes visent en gnral donner plus qu'une description de la
vie sociale d'un peuple, avec l'interprtation des plus fantaisistes qu'engendre immanquablement toute description d'une culture selon les termes d'une autre! Elles s'efforcent de faire une description analytique aussi complte que possible, en mettant
l'accent sur les lments les plus significatifs de la vie sociale, indispensables la
comprhension de ses structures et l'laboration de thories gnrales.
Ceci se produisit ncessairement lorsque l'anthropologue quitta le domaine de la
pure thorie pour faire sa propre tude sur le terrain. C'est--dire que les faits, donc
les observations consignes dans les carnets de l'anthropologue, ne sont pas prsents
dans l'ouvrage final comme la description de ce que les indignes disent et font : ils
visent montrer que ce que les indignes disent et font, en dehors de son intrt en
soi, met en lumire tel ou tel aspect important de la culture ou des institutions. En
d'autres termes, lorsque le chercheur veut dcider de ce qu'il introduira dans son livre
et de ce qu'il laissera de ct, il va considrer la pertinence des informations en fonction d'un thme destin clairer la signification de tel systme d'activits sociales.
Je dois prciser ici que la rdaction des rsultats de mission pose de srieux problmes l'anthropologue. J'ai dj not qu'il tudie tous les aspects de la vie sociale
d'une population. Doit-il publier tous les matriaux qu'il a pu accumuler sur toutes les
manifestations de celle-ci. L'historien n'prouve pas la mme difficult. Il peut
slectionner parmi les matriaux dont il dispose ceux qui importent essentiellement
la thse qu'il veut exposer et ngliger le reste. Ce qu'il n'inclut pas dans son livre n'est
pas perdu. L'anthropologue, et dans une large mesure l'archologue aussi, se trouvent
dans une position trs diffrente car ce qu'ils n'enregistrent pas, peut fort bien tre
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
63
perdu tout jamais - ce qui arrive en fait trs souvent. L'anthropologue n'est pas
seulement le collationneur et l'interprte des sources. Il en est le crateur.
C'est pourquoi, de l'avis mme de nombreux spcialistes, l'enquteur doit non
seulement enregistrer mais aussi publier tout ce qu'il a observ, quel que soit l'intrt
pour sa propre recherche, parce que c'est la tche de l'anthropologue de rassembler le
maximum de faits sur les socits primitives pendant qu'elles le sont encore.
L'anthropologue enregistre, il n'arbitre pas. Pour lui, dcider si tel ou tel fait est plus
important que tel autre, serait prjuger de l'avenir et des proccupations des gnrations futures. Nous essayons de pallier cette difficult de plusieurs faons. On a pris
l'habitude de publier des monographies sur l'un ou l'autre aspect de la vie des populations primitives qui semble revtir aux yeux de l'enquteur une importance particulire. L'enquteur n'utilise alors que les faits essentiels la thse qu'il a choisi de
traiter et qui suffisent l'illustrer. Le reste est publi dans des revues spcialises ou
est enregistr sur microfilm, ou encore polycopi.
L'norme quantit d'informations qu'un enquteur peut rapporter aprs deux ans
de sjour au milieu d'un peuple primitif contribue, mme si cette dernire solution est
adopte, introduire des changements importants dans la mthode anthropologique.
Nous avons vu que les anthropologues d'autrefois taient partisans de la mthode
comparative. Que le but recherch ait t la reconstruction de l'histoire ou l'laboration de formules descriptives gnrales, la procdure restait la mme. On lisait un
grand nombre d'ouvrages et l'information qui convenait au sujet tudi tait extraite
de ces livres, mise bout bout pour constituer un nouvel ouvrage.
Nous n'allons pas revenir sur la question de savoir si ce genre de compilation
comparative tait valable ou non. Il est clair en tout cas que ces travaux comparatifs
sont dsormais hors de porte pour un homme soumis l'obligation de publier les
rsultats des deux ou trois enqutes qu'il a pu faire sur le terrain, puisqu'il lui faudra y
consacrer le reste de sa vie s'il est accapar par l'enseignement et les tches administratives. Comme la plupart des anthropologues d'aujourd'hui effectuent des missions
sur le terrain, la situation est donc gnrale.
Il est bien vident que dans ces circonstances, l'anthropologie sociale se dsintgrerait rapidement en une succession d'tudes sans rapport les unes avec les autres,
s'il n'existait pas une mthode de recherche commune destine remplacer la vieille
mthode comparative. Du fait que l'anthropologie est dsormais une discipline fonde
sur l'observation, cette mthode commune lui est fournie par ce qui serait l'exprimentation dans les sciences naturelles. Je me ferai mieux comprendre en donnant un
exemple.
Prenons le cas d'un anthropologue ayant procd une tude des cultes religieux
dans une socit primitive donne, et arriv un certain nombre de conclusions sur le
rle de ces cultes dans la vie sociale. S'il les formule clairement et en termes tels
qu'ils puissent se subdiviser en un certain nombre d'autres sujets de recherche, il est
dornavant possible un autre anthropologue, ou au mme, de faire auprs d'une
seconde population des observations qui dmontreront si ces conclusions sont gnralisables ou non. Il s'apercevra que certaines sont vrifies, d'autres non et que les
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
64
autres ncessitent des modifications. En partant du point atteint par la premire tude,
la seconde sera vraisemblablement plus pousse et apportera de nouvelles confirmations aux conclusions de la premire. Nous voici donc en possession d'une hypothse concernant les cultes des peuples primitifs, fonde sur une enqute faite dans
deux groupements indignes. On fait alors une troisime tude, puis une quatrime,
puis une cinquime. On peut continuer indfiniment. Si les tudes sont systmatiques
et qu'on les utilise pour vrifier les conclusions avances jusque-l et formuler de
nouvelles hypothses qui peuvent tre vrifies, chacune de ces tudes parviendra au
fur et mesure de l'accumulation des connaissances et de l'mergence de nouveaux
problmes, un stade d'investigation beaucoup plus pouss, et son tour conduira
une meilleure dfinition des concepts. Chaque nouvelle tude, en admettant qu'elle
soit valable, non seulement enrichit nos connaissances sur une certaine institution
dans une socit primitive donne, mais elle met en relief les traits significatifs de
cette institution dans d'autres socits, y compris celles pour lesquelles les premiers
enquteurs n'ont peut-tre pas saisi toute l'importance de ces caractristiques.
C'est dans ce sens que la recherche actuelle est exprimentale. Elle est aussi, dans
un sens diffrent, comparative, mais elle ne l'est plus au sens qu'on attribuait autrefois
ce mot. Cette mthode dite comparative a t abandonne en partie pour les raisons
que j'ai exposes et en partie parce qu'elle rpond rarement aux questions poses.
Il s'ensuit qu'une nouvelle orientation s'est dessine, rorientation des mthodes
mais aussi rorientation du but mme de la recherche. Il est bien vident que la
recherche sur le terrain est incompatible avec les schmas sur le dveloppement
social que le XIXe sicle avait conus et proposs. Comment pourrait-on observer
des vnements qui se sont passs et ont cess depuis longtemps et dont personne ne
se souvient? Lorsqu'on se trouve en face d'une socit primitive, comment peut-on
suggrer ou mme affirmer si, oui ou non, cette socit a t autrefois matrilinaire
ou a vcu dans l'tat dit de promiscuit sexuelle.
Ceci mis part, l'envergure de l'enqute se voit ncessairement ramene aux
dimensions de petits problmes l'intrieur desquels il est possible de procder une
tude positive et donc d'aboutir des conclusions valables. On se contente dsormais
d'efforts plus modestes et moins spectaculaires. Tandis qu'au XIXe sicle, les anthropologues cherchaient rpondre des questions du genre : Quelle est la signification sociologique de la religion? quel anthropologue, jouissant de tout son bon sens,
songerait une minute rpondre aujourd'hui une question aussi ambitieuse! Il cherchera plutt dterminer par exemple le rle que joue le culte des anctres l'intrieur d'un systme social du type appel aujourd'hui lignage segmentaire, chez
certains peuples africains. Au lieu d'essayer de brosser un vaste tableau de l'volution
de la notion de responsabilit ou de l'volution de l'tat et ses consquences pour le
genre humain tout entier, l'anthropologue d'aujourd'hui se limite des problmes plus
circonscrits et qu'il peut tudier directement sur le vif, comme par exemple le rle des
conflits ou la position d'un certain type de chefferie dans des socits o les activits
sociales centres autour de ces institutions peuvent tre observes de prs. Au lieu de
se demander si les socits primitives sont de type communiste ou individualiste,
l'anthropologue contemporain s'attache l'tude dtaille du complexe des droits
collectifs et des droits individuels dont la proprit est l'objet, qui consiste parfois en
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
65
terres, parfois en btail, selon les types de socit, afin de dcouvrir les rapports qui
rgissent ces droits entre eux, comment ils s'insrent dans les systmes sociaux dans
lesquels on les trouve, et quelle est leur relation avec les systmes de parent, les
systmes politiques, les systmes religieux, etc.
On peut rsumer le point de vue de l'anthropologie contemporaine en disant que
nous pensons maintenant pouvoir apprendre sur la nature de la socit humaine, au
moyen d'tudes dtailles et intensives, effectues dans une srie de quelques socits
slectionnes dans le but de rsoudre des problmes limits, beaucoup plus qu'en
essayant dchafauder des gnralisations base de documents et de relations crites.
Il en rsulte que nous commenons tout juste saisir quelque peu la nature relle de
la vie des peuples primitifs.
L'importance accorde par les anthropologues d'aujourd'hui au travail approfondi
sur le terrain, au cours duquel on se borne tudier des problmes limits, a produit
une autre consquence, sur laquelle je voudrais attirer l'attention avant d'aborder quelques exemples de monographies modernes. J'ai soulign dans une confrence prcdente que les anthropologues du XIXe sicle rifiaient la culture. Ils s'intressaient
aux coutumes et considraient celles-ci comme des entits indpendantes. Elles existaient dans une socit et pas dans une autre. Mme un homme d'orientation aussi
nettement sociologique que McLennan considrait l'exogamie, le totmisme, la
filiation matri-linaire, etc. comme des lments isols qui, ajouts les uns aux autres,
constituaient une culture.
Par consquent, un peuple pratiquait ou ne pratiquait pas l'exogamie; il tait
totmiste ou ne l'tait pas; il tait patrilinaire ou matrilinaire.
Les anthropologues contemporains en Grande-Bretagne tendent abandonner
progressivement ce type de taxonomie. Il y aurait beaucoup dire sur cette question,
mais nous nous bornerons prciser que maintenant, l'anthropologue tend penser
plus en termes de socit que de culture, de systmes sociaux, de valeurs et de leurs
incidences. Il cherche moins savoir si l'exogamie est pratique par un peuple, qu'
dcouvrir la signification de ces rgles par rapport aux relations inter-communautaires. Il ne se contente pas de savoir que les peuples ont des croyances totmistes,
mais il cherche dcouvrir comment ces croyances peuvent reflter l'importance de
la filiation et la solidarit des groupes fonds sur la filiation. Il ne pense pas que le
fait de savoir que la filiation est dtermine en ligne fminine et non masculine est
primordial en soi. Il recherchera plutt comment, par exemple, le systme matrilinaire affecte la relation frre-sur ou celle de l'oncle maternel avec les fils de sa
sur.
On verra bientt que certaines de ces tudes contemporaines sont plus abstraites et
structurales que d'autres; il subsiste encore des diffrences d'opinion sur le choix des
mthodes analytiques, mais si on les compare aux travaux antrieurs on s'aperoit
qu'elles ont tendance tre sociologiques et fonctionnelles. Je vais donc donner quelques exemples.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
66
Je commencerai par rsumer l'un des ouvrages de Malinowski, parce qu'il fut le
premier anthropologue professionnel faire de l'observation directe en utilisant la
langue indigne. Bien qu'il ait amass une norme quantit de documents sur les
Trobriandais et publi plusieurs volumes leur sujet avant sa mort, il n'a donn qu'un
rapport partiel sur cette population et nous sommes encore dans l'ignorance de
certaines de leurs activits essentielles, en particulier leur organisation politique et
leur systme de parent. Le livre dont je vais parler, Les Argonautes du Pacifique
Occidental (1922), bien qu'il y ait des longueurs et qu'il soit crit dans un style plutt
journalistique, peut tre considr, cause de son antriorit tout autant que par sa
qualit, comme un classique de l'ethnographie descriptive.
Dans cet ouvrage, l'auteur tudie un type d'activit trobriandais dnomm kula.
Les Trobriandais et certains de leurs voisins des les environnantes forment une sorte
de ligue dont le but est d'organiser l'change de certains objets, comme de longs
colliers de coquillages rouges et des bracelets de coquillages blancs. Dans le systme
d'change, les colliers font le tour des les suivant un circuit dtermin et les bracelets
empruntent le circuit contraire. Ces objets n'ont pas de valeur commerciale; leur
valeur est uniquement rituelle et de prestige, le prestige rsidant dans le renom qu'un
homme acquiert en recevant, possdant, puis offrant des objets particulirement
priss. Les individus qui se livrent ces changes ont des partenaires attitrs dans
chaque le qu'ils visitent. Les changes s'effectuent avec une grande solennit et un
certain dcorum et le marchandage est interdit; lorsque la phase des changes rituels
est termine, on se met traiter des oprations commerciales ordinaires et le marchandage intervient alors au sujet de comestibles et d'articles d'utilit courante. Mais
le kula proprement dit est le systme d'change rituel dans lequel les colliers et les
bracelets font le tour des les, chacun dans le sens contraire; ils repassent obligatoirement par leur lieu d'origine et continuent leur circuit indfiniment.
Pour que ces changes aient lieu, les chefs des villages et des hameaux environnants mettent sur pied de vastes expditions commerciales pour lesquelles ils doivent
fabriquer des pirogues; les chefs doivent possder des connaissances maritimes,
connatre les formules magiques destines conjurer les dangers et les prils d'une
telle aventure, connatre les traditions et les mythes qui doivent guider les Argonautes
dans leurs prgrinations et leurs ngociations. C'est pourquoi Malinowski pensa qu'il
fallait, dans le cadre d'un seul ouvrage, en dresser l'inventaire, auquel vinrent s'ajouter
un certain nombre d'autres sujets. Il a voulu faire un rapport dtaill de la magie et
des mythes; il a dcrit le cadre, expliqu comment les indignes cultivaient leur
jardin, quelle tait la position sociale de leurs femmes, comment ils construisaient
leurs embarcations et ainsi de suite; il a mme dcrit ses propres ractions lorsqu'il
prit part ces expditions, plusieurs reprises. Il a donn une peinture de la ralit
vivante des Trobriandais avec la verve et la prcision des romans d'mile Zola.
Ce premier livre, et je dirai son meilleur sur les Trobriandais, illustre assez clairement la conception que Malinowski avait d'un systme social et de l'analyse fonctionnelle qu'on doit en faire. Pour lui, un systme social est une succession d'activits
ou d'vnements et non pas un faisceau d'abstractions. Pour partir en expdition, les
Trobriandais ont besoin de pirogues. Pour fabriquer ces pirogues, ils ont recours des
incantations magiques. Ces formules magiques existent sous forme d'histoires ou de
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
67
mythes qui nous renseignent sur leur origine. Elles sont aussi la proprit d'un individu qui les a hrites de son oncle maternel. Ce sont les chefs qui dirigent la
fabrication des pirogues et organisent les expditions. Si les chefs sont les dtenteurs
de l'autorit, c'est surtout parce qu'ils sont plus riches que les autres individus. Ils sont
plus riches parce qu'ils possdent des jardins plus vastes. Leurs jardins sont plus
vastes parce qu'ils ont plusieurs femmes pour les cultiver. Aux yeux de Malinowski,
toutes ces diffrentes activits constituent un systme, du fait que chaque phnomne
en engendre un autre et que la fonction de chacun est dtermine par le rle qu'il joue
au sein de l'ensemble des activits, celles-ci exerant une influence directe ou indirecte sur l'change des objets rituels du kula.
Il est vrai que, d'une certaine faon, ces phnomnes forment un systme d'activits et ce mode de prsentation impressionniste de la vie sociale est trs vocateur;
nous devons cependant reconnatre que le thme n'est rien d'autre que la synthse
descriptive des vnements. Ce n'est pas une intgration thorique bien que les problmes thoriques y soient envisags en intermdes au cours de l'ouvrage. On
s'aperoit qu'il est malais de dcider de la pertinence d'un fait plutt que d'un autre,
puisqu'ils ont tous une relation de temps et d'espace dans la ralit culturelle; quel que
soit le point de dpart, on parvient ncessairement au mme endroit aprs avoir couvert le mme terrain.
Dcrire la vie sociale en fonction de ses divers aspects au niveau de l'vnement
mne invitablement des rptitions sans fin et de soi-disant conclusions thoriques qui ne sont autre chose que des re-descriptions en langage plus technique, du fait
qu'on s'aperoit peine des corrlations discrtes si l'on ne s'arrache pas la ralit
concrte. Malinowski aurait pu partir de l'tude de la chefferie et traiter le kula en
fonction de cette institution; il aurait pu crire un livre sur la magie et dcrire le kula
et la chefferie en fonction de la magie.
C'est parce qu'il ne fait pas d'abstractions que Malinowski n'a pas russi voir
clairement ce qui constitue sans doute le trait le plus significatif du kula, c'est--dire
le rle de lien jou par le kula en ce qu'il rassemble des communauts politiquement
autonomes sur la base d'une acceptation commune de certaines valeurs rituelles.
On voit aussi que la comparaison entre la vie sociale d'un peuple ainsi dcrit et la
vie sociale d'autres peuples dcrits selon la mme mthode, se limite l'valuation de
similitudes et de divergences culturelles et ne peut avoir de valeur structurale pour
laquelle l'abstraction est indispensable. Les lves de Malinowski ont cependant
contribu l'enrichissement de la littrature anthropologique avec un certain nombre
d'excellentes et importantes tudes ethnographiques portant sur des peuples primitifs,
labores au niveau du ralisme culturel. Je citerai par exemple : We, the Tikopia
(1936) du professeur Firth, Reaction to Conquest (1936) de Mlle Hunter, A
Handbook to Tswana Law and Custom (1938) du professeur Schapera et Land,
Labour and Diet in Northern Rhodesia (1939) du Dr Richards.
Par abstraction, on entend plusieurs choses. On ne traitera par exemple qu'une
partie de la vie sociale afin de rsoudre des problmes limits et on ne prendra le
reste en considration que dans la mesure o il a un rapport avec le sujet ou bien ce
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
68
peut tre une analyse structurale partir de l'intgration des abstractions de la vie
sociale. Pour illustrer la premire dmarche, je citerai l'ouvrage du Dr M. Mead :
Coming of Age in Samoa (1929).
Nous avons l un livre agrable lire et on me permettra d'ajouter : trs fminin
par le ton et une certaine tendance au pittoresque, avec ce que j'appelle le ct ventdans-les-palmes-de-cocotier de certains crits anthropologiques dont Malinowski a
inaugur le genre.
Le but de cet ouvrage est de montrer que les difficults qu'prouvent les adolescents et les jeunes filles en particulier, ces difficults qui sont si frquentes dans la
socit amricaine, n'existent pas Samoa et l'on peut donc en dduire qu'elles sont le
produit d'un type particulier d'environnement social et qu'elles sont imputables aux
contraintes inhrentes la civilisation et non la nature. Le Dr Mead s'efforce de
nous montrer de quelle faon les conditions de vie des adolescents Samoa diffrent
de celles des adolescents amricains. C'est dans cette optique qu'elle relate tous les
faits qu'elle a observs, relatifs l'environnement social d'une jeune fille de Samoa;
comment elle est duque, comment se droule son enfance, quelle est sa place au
sein du foyer familial, du village et plus gnralement de la communaut et quelles
sont encore ses diverses expriences sexuelles avec les garons. La description est
toujours fonction d'une rfrence particulire au problme de l'enqute, la faon dont
les conditions sociales modlent la personnalit de la jeune fille grandissante et de
quelle nature sont les ractions de sa personnalit aux modifications physiologiques
provoques par la pubert.
La conclusion de cette tude est la suivante : il n'y a pas de diffrence entre les
jeunes filles samoanes et les jeunes filles amricaines quant au processus de l'adolescence mme. La diffrence apparat dans leurs ractions respectives. A Samoa les
tensions n'existent pas plus que les crises; bien au contraire, l'veil des intrts
individuels volue de faon ordonne, ainsi que le choix ou l'attribution des activits.
Le Dr Mead dit encore : Il n'y a pas de conflits dans l'esprit des filles; elles ne se
posent pas de questions philosophiques et ne sont pas obsdes par des rves lointains. Une fille aura des amants le plus longtemps possible avant d'pouser un homme
de son propre village; aprs quoi, elle s'tablira prs de sa famille et aura beaucoup
d'enfants; telle est la sage ambition de toutes les filles de Samoa 1.
L'Amricaine, au mme ge, est la proie de diverses angoisses et de tensions multiples parce que son environnement social est diffrent. O se situent ces diffrences?
Le Dr Mead pense que les plus importantes tiennent ce que les Samoanes n'prouvent pas de sentiments personnels violents et n'ont pas faire face des valeurs
contradictoires.
La Samoane n'attache pas une importance trs grande aux individus ou aux choses; lorsqu'elle rencontre un homme, elle ne fait ni projets d'avenir ni rves insenss.
p. 157.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
69
Cette attitude est due partiellement la composition du cercle familial au sein
duquel elles grandissent; elles vivent parmi une large assemble de parents et l'affection et l'autorit ne sont pas l'apanage d'un nombre limit d'individus. Le fait que la
culture des Samoans est trs homogne est galement trs important. Ils ont tous les
mmes modles de comportement. Il n'y a qu'une sorte de religion et un seul code
moral, de sorte que les adolescentes samoanes ne connaissent pas le dilemme du
choix : choix qui implique ncessairement une modification des relations avec l'entourage. Elles ignorent donc les conflits qui dcoulent du choix faire entre plusieurs
chelles de valeurs; n'ayant pas de conflits, elles ne sont ni nvroses ni inadaptes.
L'adolescente amricaine, au contraire, se trouve confronte avec une telle quantit de
valeurs contradictoires qu'elle ne peut esquiver le choix invariablement gnrateur de
conflits.
Cet ouvrage de Margaret Mead est diffrent de la plupart des monographies modernes en ce qu'elle ne prsente pas une analyse des structures sociales, mme esquisses, de sorte qu'il est difficile de situer dans une quelconque perspective les faits
qui nous sont proposs. C'est nanmoins un bon exemple d'tude portant sur un
problme unique; de plus l'ouvrage est crit par une femme d'une grande intelligence.
Je vais maintenant aborder deux de mes ouvrages. Qu'on m'en excuse, mais il
m'est plus facile de prsenter une analyse faite dans une culture qui m'est familire
que dans une autre qui m'est inconnue. Les deux ouvrages illustrent une autre mthode d'utilisation de l'abstraction. Le premier est l'tude d'un systme conceptuel et le
second, l'tude du systme politique de divers groupes.
Mon premier livre, Witchcraft, Oracles et Magic Among the Azande, a pour sujet
une population d'Afrique centrale. J'essaie d'expliquer un certain nombre de croyances qui sont toutes trangres la mentalit d'un Anglais moderne, en montrant
comment elles forment un systme de pense intelligible et comment ce mode de
pense est li aux activits sociales, la structure sociale et la vie de l'individu.
Chez les Azande, tous les malheurs peuvent tre attribus (et le sont gnralement) la sorcellerie, considre par les Azande comme une condition organique
interne, bien qu'ils estiment que son action soit psychique. Le sorcier envoie ce qu'il
appelle l'me, ou l'esprit, de sa sorcellerie pour faire du mal aux autres. La victime
consulte alors des oracles et les Azande en ont de plusieurs sortes, ou bien il va
interroger un devin pour dcouvrir d'o viennent ses msaventures. Cette consultation
peut tre trs longue et trs complique. Lorsque le coupable est dcouvert, on lui
demande de faire cesser ces agissements hostiles.
Si, dans un cas de maladie, il refuse et que le malade finisse par mourir, les parents du dfunt pouvaient autrefois en appeler la juridiction du prince et demander
vengeance ou compensation, ou bien ils pouvaient recourir au procd qui est
invariablement adopt aujourd'hui, en l'occurrence la magie, pour faire mourir le
sorcier. En plus de cette magie mortelle, les Azande possdent tout un corpus de
procds et de techniques magiques, pour lesquels il est parfois besoin d'tre membre
de socits secrtes particulires, dont le but essentiel est la protection des membres
de cette association contre les sorciers et leurs agissements.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
70
La sorcellerie, les oracles et la magie forment donc un systme complexe de
croyances et de rites, qui n'a de sens que lorsqu'on les considre comme parties interdpendantes d'un tout.
Ce systme a une structure logique. Une fois qu'on accepte certains postulats, les
conclusions et les actions sont trs comprhensibles. La magie est prvue pour se
venger d'une mort. Un voisin meurt-il, peu aprs l'oracle annonce qu'il est mort
victime de la magie vengeresse. Chaque fraction de croyance s'insre parfaitement
l'intrieur d'une mosaque constitue par la pense mystique. Si dans un tel systme
clos, une croyance se trouve contredite par une exprience particulire, cela prouve
seulement que l'exprience est rate, qu'on s'est tromp; ou bien on expliquera cette
contradiction apparente en rvisant la croyance de faon fournir des explications
pleinement satisfaisantes. Mme le scepticisme corrobore en quelque sorte les
croyances qu'il met en doute. Le fait de critiquer un devin particulier, par exemple, ou
de douter d'un certain oracle ou d'une forme de magie, renforce la foi qu'on a dans les
autres et le systme en gnral.
Lorsqu'on analyse les nombreux cas o les Azande discutent de la sorcellerie et
expriment leurs convictions, on s'aperoit souvent qu'elle leur fournit une philosophie
des vnements qui les satisfait intellectuellement. A premire vue, il parat absurde
de prtendre, si les termites ont rong les piliers d'un grenier grains et qu'il s'croule
sur un homme assis l'ombre de ce grenier et le tue, que cet vnement soit une
manifestation de sorcellerie; les Azande ont compris aussi bien que nous, que c'est
l'croulement du grenier qui a vraiment caus la mort de l'homme. Ce qu'ils disent,
c'est que le grenier ne se serait pas croul prcisment ce moment-l, si l'individu
qui tait assis dessous n'avait pas t ensorcel. Sinon, pourquoi le grenier se serait-il
croul ce moment-l, et justement lorsque cet individu-l se trouvait assis dessous?
Il est facile d'expliquer pourquoi le grenier s'est effondr. L'accident s'est produit
parce que les termites avaient rong les piliers et le poids du grain a fait le reste. On
peut expliquer la prsence de l'homme avec la mme facilit : il se trouvait l parce
qu'il faisait chaud et que le grenier lui offrait de l'ombre. Mais comment ces deux
ensembles de faits se trouvent-ils concider un point prcis du temps et de l'espace?
Nous disons que cette concidence n'tait que l'effet du hasard. Les Azande l'expliquent par la sorcellerie. C'est l'action conjugue de la sorcellerie et du grenier qui ont
caus la mort de l'homme.
La notion de sorcellerie donne aux Azande non seulement une philosophie naturelle mais une philosophie morale qui elle-mme contient une thorie psychologique.
Un homme peut fort bien tre sorcier, mais pour que sa sorcellerie opre et soit
efficace, il faut qu'elle soit un acte dlibr et volontaire. Il faut qu'il y ait une raison
et on peut toujours en trouver dans les mauvaises passions des hommes : la haine,
l'envie, la jalousie, l'esprit de vengeance. La sorcellerie engendre les malheurs et la
sorcellerie est motive par de mauvaises intentions. Les Azande ne reprochent pas
un homme d'tre sorcier. Il ne peut rien son tat de sorcier. C'est le mal qui est en
lui qui lui fait accomplir des actions prjudiciables aux autres individus et c'est ce mal
qu'ils accusent. J'ajouterai que les Azande sont parfaitement conscients de ce que les
psychologues appellent la projection : lorsqu'un homme dclare qu'un autre le hait et
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
71
lui a jet un sort, c'est justement lui qui hait le second et lui qui est le sorcier; ils
comprennent fort bien le rle significatif que jouent les rves, ou ce que nous
appelons maintenant le subconscient, dans les passions mauvaises des individus. Il
faut encore souligner que le dogme selon lequel c'est le mal qui, par le biais de la
sorcellerie, cause les malheurs, ne saurait en aucun cas excuser les actions qui rsultent du vice ou de l'ignorance. La sorcellerie ne cause que des malheurs immrits.
Un homme qui a commis l'adultre, qui agit de faon dloyale envers son roi ou qui
choue par incapacit dans certaines entreprises, comme l'art de fabriquer des poteries, est pleinement responsable des sanctions ou des dboires que lui vaudront ses
actes.
Comme le sorcier ne s'attaque qu' celui qui il veut du mal, celui qui souffre de
maladie ou d'autres infortunes, placera le nom de ses ennemis au pied des oracles et
par consquent, c'est un ennemi que l'oracle dclarera coupable de l'ensorcellement.
On ne peut accuser de sorcellerie que des personnes qui entretiennent un minimum de
relations sociales de nature ventuellement permettre qu'un tat de haine s'installe
entre elles. C'est la structure sociale qui dtermine ces situations. Par exemple, les
relations entre enfants et adultes ne sont pas de nature engendrer l'hostilit et c'est
pourquoi les enfants ne sont jamais accuss d'avoir ensorcel les adultes. Pour des
raisons semblables, les nobles ne sont jamais accuss d'ensorceler les roturiers, bien
qu'en ce cas il existe aussi la raison qu'un homme du commun n'osera jamais accuser
un noble de l'avoir ensorcel. De mme, il se trouve que dans la socit Azande, les
femmes n'ont pas de relations sociales avec les hommes, en dehors des hommes de
leur famille ou de leurs maris - et comment pourraient-elles faire du mal leur propre
parent? Elles ne peuvent tre accuses d'ensorceler que leurs voisines et leurs maris,
et point les autres hommes.
Les oracles ont un ordre d'importance. Certains sont moins srs que d'autres et on
ne saurait entreprendre quoi que ce soit avant d'avoir eu confirmation de l'autorit
suprme, l'oracle du poison. L'oracle du poison son tour est considr n'avoir de
poids qu'en fonction du rang social du propritaire de l'oracle. On peut soumettre un
cas plusieurs oracles du poison successivement (de mme que dans nos civilisations
un procs peut aller d'une juridiction une autre), jusqu'au verdict final de l'oracle
royal, au-del duquel il n'y a point de recours. Le mcanisme juridique qui agit dans
les cas de sorcellerie se trouve donc en dernier recours aux mains d'un roi et de ses
reprsentants, ce qui fait que l'action sociale qu'entrane une croyance reste l'un des
atouts majeurs de l'autorit royale. Les croyances de sorcellerie dans la vie sociale
sont troitement lies au systme de parent, en particulier par l'intermdiaire des
coutumes de vengeance, mais j'en ai dit suffisamment pour montrer que ce qui,
premire vue, ne semble tre qu'une superstition ridicule, une fois soumis l'analyse
anthropologique, se rvle comme le principe intgrateur d'un systme de pense et
de morale jouant un rle trs important dans la structure sociale.
Mon second ouvrage, The Nuer. A Description of the Modes of Livelihood and
Political Institutions of a Nilotic People (1940), a pour sujet une population et un
type de socit trs diffrents et s'attaque des problmes trs diffrents. Les Nuer
sont des pasteurs semi-nomades qui vivent dans des rgions de savanes marcageuses
situes dans le sud du Soudan anglo-gyptien. Ils constituent un agrgat de tribus
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
72
dpourvues de chefs ou d'institutions juridiques ; il semblait essentiel de chercher
dcouvrir le principe de leur intgration tribale ou politique. Il est vident que les
Nuer, qui n'ont qu'une forme de culture matrielle trs simplifie, dpendent strictement de leur environnement; j'ai pens, aprs avoir examin leur cologie, que la
poursuite d'une vie pastorale dans des conditions aussi difficiles exigeait que leur
ordre politique soit assez lche s'ils voulaient maintenir leur faon de vivre. C'est la
structure tribale qui engendre l'ordre politique. On s'aperoit en tudiant les diverses
communauts locales au sein d'une tribu Nuer que chacune de ces communauts
s'identifie politiquement un lignage, bien que la plupart de ses membres n'appartiennent pas ce lignage, et aussi que tous ces lignages sont des branches d'un seul et
unique clan. Chacune de ces divisions territoriales d'une tribu se trouve ainsi coordonne avec une branche correspondante de ce clan dominant, de sorte que les relations entre les diverses parties d'une tribu, qu'elles soient spares ou qu'elles soient
unies, sont conceptualises et exprimes au sein d'un systme de valeurs bas sur la
filiation.
Je laisserai de ct un certain nombre des sujets tudis dans cet ouvrage pour
examiner brivement le concept de temps chez les Nuer, pour que vous trouviez un
exemple du genre de problme que nous tudions et du genre d'analyse structurale
que nous faisons.
Je me bornerai esquisser le sujet grands traits et l'on verra d'un ct, comment
la conceptualisation des changements naturels en tant que points de repre servant
l'estimation du temps, est dtermine par le rythme des activits sociales et, de l'autre,
comment les repres sont le reflet des relations structurales entre diffrents groupes
sociaux. Les tches quotidiennes au kraal sont les points de repre pour chaque jour
et, pour des priodes plus longues qu'un jour, les repres sont les diverses phases
d'autres activits rcurrentes comme le dsherbage ou les prgrinations saisonnires
des hommes avec les troupeaux. Le passage du temps est la succession des activits
et leurs relations les unes avec les autres. Il en dcoule des conclusions fort intressantes. Le temps n'a pas la mme valeur selon les saisons. Et comme ils n'ont,
proprement parler, aucun systme abstrait d'estimation du temps, ils ne pensent pas
au temps comme nous le faisons, c'est--dire comme une chose qui est l, qui passe,
qu'on peut gaspiller, qu'on peut conomiser, etc. Ils n'ont pas coordonner leurs activits avec un coulement abstrait du temps, car leurs points de repre sont prcisment ces activits elles-mmes.
Ainsi, au cours d'un certain mois, ils fabriqueront les premiers barrages destins
fermer les cours d'eau o ils iront pcher; ils amnageront les premiers enclos pour le
btail; puisque les Nuer s'adonnent ces activits, c'est qu'on doit se trouver pendant
tel ou tel mois, ou tout prs. On ne fabrique pas les barrages parce que c'est le mois
de novembre, c'est parce qu'on fabrique les barrages que c'est le mois de novembre.
Les longs laps de temps sont presque entirement structuraux. Les vnements
qu'ils relient sont diffrents selon les diffrents groupes d'individus, de sorte que
chaque groupe a son propre systme d'estimation du temps en plus d'un systme
commun qui se rapporte aux vnements de grande importance pour tous les groupes.
D'autre part, les Nuer mles sont stratifis par ge, en divisions ou en classes, une
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
73
nouvelle classe d'ge commenant tous les dix ans approximativement. Je n'entrerai
pas dans les dtails de ce systme et je me contenterai de dire que le moment, le
temps o se produisent les vnements est souvent dtermin par rfrence ces
divisions. C'est pourquoi les intervalles entre les vnements ne sont pas valus
selon des concepts de temps, comme nous le faisons, mais en termes de distance
structurale, de diffrence sociale entre groupes d'individus. Les Nuer dterminent
galement l'histoire en fonction de leurs gnalogies familiales. Or on peut dmontrer
que la profondeur gnalogique dans une situation donne correspond la taille du
groupe de parent considr, de sorte que le temps, dans ce cas, est une image des
units de la structure sociale. Les vnements ont une position dans la structure, mais
pas de position dfinie dans le temps historique tel que nous l'entendons. On peut
donc dire que chez les Nuer, le temps est la conceptualisation de la structure sociale
et que les points de repre du systme d'estimation du temps constituent la projection
dans le pass des relations existant entre divers groupes d'individus. Il coordonne les
relations plutt que les vnements. Tous ces principes exposs en si peu de mots
doivent vous sembler obscurs, ce qui n'a qu'une importance relative, car mon but n'est
pas de dmontrer le bien-fond de ma thse, mais d'illustrer le type d'analyse que j'ai
appliqu dans ce cas. Vous avez pu voir propos du second ouvrage que la mthode
vise surtout rendre intelligibles certaines portions de la vie sociale, en expliquant
comment elles s'intgrent aux autres portions. On ne russira le faire qu'en
tablissant des abstractions et en dterminant la relation logique qui existe entre elles.
J'ai dit dans ma premire confrence que l'anthropologie sociale, bien qu'elle ait
par le pass limit son champ d'action l'tude des socits primitives, dpasse
parfois cette limite; en fait, nous ne la considrons pas comme l'tude des socits
primitives mais comme l'tude de toutes les socits humaines. Pour vous montrer
que nous avons galement tudi des socits civilises, je donnerai comme dernier
exemple une monographie anthropologique du Professeur Arensberg : The Irish
Countryman (Le paysan irlandais) (1937). C'est un excellent exemple d'analyse structurale o l'auteur formule avec beaucoup de simplicit et de concision, les conclusions auxquelles il est arriv aprs une tude sur le terrain, dans le Comt de Clare,
o il tait accompagn et second par le professeur Kimball.
L'Irlande du sud est une rgion de petites fermes et la majorit des familles de
fermiers vivent du produit de quinze trente arpents, dont ils vendent les produits
excdentaires pour acheter des produits de premire ncessit tels que la farine, le
th, etc. Tous les membres de la famille travaillent la ferme, mais ils se font parfois
aider par des parents loigns. Le rseau des liens de parent qui unit les membres
d'un village et ceux des villages avoisinants joue un rle dterminant dans l'organisation de la vie paysanne irlandaise. L'auteur tudie donc cette question prcise, ainsi
que beaucoup d'autres. Je rsumerai brivement deux des questions qu'il a traites
dans cet ouvrage : le mariage et les relations entre paysans et citadins.
Il dclare que le mariage est le pivot autour duquel tourne la vie rurale. C'est en
fait le centre structurel 1. Les plus petits fermiers ont les plus grandes familles; le
p. 93.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
74
mariage se produit, pour les deux sexes, un ge beaucoup plus tardif que dans tous
les autres pays, pour lesquels nous possdons des documents d'tat civil.
Vu la petite taille des fermes, on ne marie gnralement qu'un seul fils et une
seule fille. Lorsque le fils qui doit hriter de la ferme se marie, son pouse lui apporte
une dot d'environ 250 350 livres, somme qui doit plus ou moins reprsenter
l'quivalent de la valeur de la ferme; c'est donc l'valuation et la reconnaissance du
statut social de la famille. Une partie de cet argent va au fils et ses parents qui, aprs
le mariage, quittent la ferme; le reste est destin aider les autres fils qui, du fait que
les fermes ne sont jamais morceles entre les enfants, doivent migrer en ville pour
gagner leur vie soit dans le commerce, soit en apprenant un mtier, soit en entrant
dans les ordres, soit enfin en migrant l'tranger. De cette faon, on assure la
continuit familiale la ferme, sang et terre tant troitement lis, mais cela au
dtriment des autres fils plus jeunes. L'auteur montre comment le mariage, l'hritage,
les contraintes sociales, les migrations et l'migration forment tous ensemble le
systme social des petits fermiers.
Le systme familial de la ferme a sa contrepartie dans les villes-marchs des
environs et ceci, comme on le verra, explique la disparition progressive des familles
citadines. Les plus jeunes fils des fermiers vont la ville pour devenir apprentis et
leurs filles pour trouver un mari. Un commerant vit de la clientle paysanne et cette
clientle lui est fournie par les gens de sa parent : le commerant ou l'aubergiste
marie donc le fils qui doit lui succder une fille de la campagne, qui apportera non
seulement sa dot, mais aussi la clientle de la rgion dont elle vient. La ville et la
campagne, l'unit distributrice et l'unit productrice, se trouvent ainsi troitement
lies, non seulement sur le plan conomique mais encore par des liens de parent. La
vie dans les villes cependant modifie l'optique des hommes qui, peu peu, finissent
par ne plus comprendre les gens de la campagne. Ils perdent les us et coutumes de la
campagne et s'en dsintressent; cette situation est plus nette encore dans le cas de
ceux qui naissent en ville, les migrants de la seconde gnration. Alors la famille des
commerants et des aubergistes s'en va dans une ville plus grande et change de
profession. Ils font alors partie d'un milieu social dans lequel la campagne ne joue
plus aucun rle; leur ancienne place dans les petites villes-marchs est prise par
d'autres individus qui, force de persvrance, finissent par russir grce leurs liens
avec la campagne, en mme temps qu'ils tablissent de nouveaux liens de parent.
Nous voyons comment le systme conomique, grce aux changes de produits
fermiers contre des articles commerciaux, et le systme de parent, travers les
mariages campagne-ville, sont troitement lis au sein du systme social gnral de la
campagne irlandaise.
L'un des facteurs du maintien des liens entre gens des campagnes et gens des
villes est incarn par l'endettement. Le campagnard a toujours des dettes chez son
parent commerant et cette dette chronique fait partie de leur relation sociale.
D'ailleurs, lorsqu'un paysan se fche avec un commerant, il exprime son mcontentement en payant sa dette, puis il lui retire sa clientle et cesse toute relation avec
lui. La dette, comme la dot, est une mesure du statut, puisqu'elle est le signe de l'aptitude et du bon vouloir maintenir ce rseau d'obligations sociales qui donne l'individu et sa famille, une place au sein de la vie sociale. Les dettes se transmettent de
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
75
parents enfants. Elles constituent le lien entre la famille et la parent du paysan et la
famille et la parent du citadin, par lequel ils expriment mutuellement leur confiance
et leurs obligations sociales. La dette apparat donc sous un jour nouveau; c'est l'un
des rouages essentiels du systme social. On ne doit pas la considrer seulement
comme un fait conomique, ou selon des termes juridiques, mais aussi en termes de
parent et autres traits de la structure sociale tout entire; il est impossible d'mettre
un jugement moral son sujet si l'on ne prend pas tous ces facteurs en considration.
Ces quelques exemples - je ne puis en donner plus, vu le temps qui m'est imparti ont montr le genre et la diversit des problmes auxquels fait face l'anthropologie
sociale telle que nous la concevons aujourd'hui. Une fois de plus, vous noterez que ce
n'est aucunement une exploration du pittoresque ou du romanesque, mais l'tude
prosaque de problmes sociologiques, et (j'aurai l'occasion de le souligner au cours
de ma prochaine et dernire confrence) de problmes qui ont une porte gnrale,
dont l'importance ne se limite pas un cadre gographique ou ethnique particulier. Il
est extrmement intressant pour nous de savoir que les Trobriandais dpensent la
majeure partie de leur nergie dans la poursuite de l'honneur et non de biens
matriels; que, si les Samoanes n'ont gure de latitude de choix entre les buts qu'elles
peuvent donner leur vie, et par consquent n'ont pas souvent des personnalits trs
originales, elles jouissent de la scurit et du bonheur que ces conditions engendrent;
que, si la science moderne rejette les hypothses sur lesquelles repose le systme
religieux des Azande, ce systme n'en a pas moins une valeur philosophique et
l'influence d'un code moral; que, pour comprendre le concept de temps des Nuer,
nous devons d'abord nous pencher sur leur structure sociale; enfin, qu'en Irlande du
Sud, la dette sert maintenir des relations harmonieuses entre paysans et citadins.
Toutes ces conclusions, et bien d'autres encore (mme si certaines ne dpassent pas le
stade des hypothses), ont une signification vidente si l'on veut comprendre les
socits particulires o ces conclusions et ces hypothses ont t labores, mais
elles sont tout aussi utiles la comprhension de n'importe quelle socit, la ntre y
compris.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
76
6
L'ANTHROPOLOGIE
APPLIQUE
Retour la table des matires
Dans mes confrences prcdentes, j'ai essay de vous donner une ide gnrale
de ce qu'est l'anthropologie sociale au niveau des tudes universitaires; j'ai expliqu
comment elle est devenue une discipline autonome et j'ai expos les problmes et la
faon de les aborder. Dans cette dernire confrence, je vais examiner une question
que tous les anthropologues ont d entendre une fois ou l'autre. Pourquoi tudier
l'anthropologie sociale?
On peut interprter cette question et y rpondre de plusieurs faons. On peut
l'interprter comme une question sur les motivations qui poussent un individu devenir anthropologue. Chacun de nous donnerait sans doute une rponse diffrente. Pour
beaucoup, moi y compris, je crois que la rponse serait la suivante : Je n'en sais rien
ou, pour s'exprimer comme l'un de mes collgues amricains : Bah! je crois que
j'aime bien les voyages!
Toutefois, la question a gnralement un autre sens. A quoi sert de connatre les
socits primitives? Y rpondre suppose une subdivision de la rponse en deux discussions: l'une sur l'utilit de l'anthropologie pour ces peuples primitifs eux-mmes et
pour ceux qui sont responsables de leur bien-tre, l'autre sur l'intrt de cette science
pour ceux qui l'tudient, c'est--dire nous les anthropologues.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
77
Il se trouve que les anthropologues tudient surtout des socits primitives et les
informations qu'ils amassent et les conclusions auxquelles ils arrivent ont videmment quelque rapport avec les problmes que posent l'administration et l'ducation
des peuples primitifs.
Si la politique coloniale d'un gouvernement (et on le comprendra aisment)
consiste administrer un peuple par l'intermdiaire de ses chefs, il est utile de savoir
qui sont les chefs, quelles sont leurs fonctions, leur autorit, leurs privilges et leurs
obligations 1. Si l'on convient d'administrer une population selon ses propres lois et
ses propres coutumes, il faut d'abord dcouvrir celles-ci. Il est vident que, si le but
recherch est par exemple de changer l'conomie d'une population, en modifiant son
systme foncier, en l'encourageant cultiver des produits d'exportation, en instituant
des marchs et en crant une conomie d'change, il est prfrable de pouvoir valuer, au moins approximativement, quelles incidences sociales ces modifications vont
peut-tre dclencher. Si, par exemple, on change le systme foncier, il peut se produire un bouleversement dans les structures familiales et claniques, ainsi que dans les
structures religieuses, car la famille, les liens de parent, les croyances religieuses et
les cultes peuvent tre troitement lis au systme foncier. Il est vident aussi qu'un
missionnaire dsireux de convertir des indignes au christianisme doit avoir quelques
connaissances de leurs propres croyances et pratiques religieuses, sinon l'enseignement apostolique est impossible puisqu'il doit tre fait dans la langue indigne,
c'est--dire l'aide des concepts religieux des indignes.
Depuis le dbut du sicle on s'accorde gnralement reconnatre que l'anthropologie sociale est utile l'administration; les Ministres des Colonies ainsi que les
gouvernements coloniaux ont manifest un intrt croissant pour l'enseignement et la
recherche anthropologiques. Depuis nombre d'annes, les fonctionnaires coloniaux,
avant de partir rejoindre leur poste, ont suivi entre autres des cours d'anthropologie
sociale Oxford et Cambridge et, plus rcemment, Londres. Depuis la dernire
guerre, beaucoup d'administrateurs coloniaux sont revenus en Grande-Bretagne
rafrachir leurs connaissances et suivre des cours de perfectionnement dans ces trois
universits; beaucoup choisirent de suivre un cours d'anthropologie sociale. Les
administrateurs ont souvent tudi l'anthropologie Cambridge et certains ont pass
le Diplme d'anthropologie ou un examen postrieur la licence Oxford et beaucoup d'entre eux sont rests au courant de l'volution de l'anthropologie en tant
membres de l'Institut Royal d'Anthropologie.
Les gouvernements coloniaux reconnurent que tout en tant utile ses fonctionnaires, une connaissance gnrale et lmentaire de l'anthropologie ne suffisait pas
leur permettre d'effectuer des recherches au cas o ils en auraient eu le temps et
l'occasion; les gouvernements ont occasionnellement dtach des administrateurs
possdant des connaissances assez srieuses en anthropologie et ayant manifest
certaines aptitudes la recherche; ceux-ci se livraient donc certaines tudes dans
leurs territoires. C'est ainsi qu'on a pu faire quelques tudes importantes et fort
valables. La plus remarquable de ces tudes est certainement celle de Rattray sur les
Ashanti de la Cte de l'Or, en plusieurs volumes. Le docteur Meek a fait de remar1
crit avant la dcolonisation (N. d. T.).
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
78
quables travaux en Nigeria, ainsi que F. E. Williams et E. W. Pearson Chinnery en
Nouvelle-Guine. Il faut toutefois souligner que mme les meilleurs de ces crits ne
sauraient satisfaire compltement l'anthropologue professionnel. Il n'est pas impossible que, du point de vue administratif, ces travaux n'aient pas t absolument satisfaisants non plus, puisque ce type de recherche a t abandonn par les gouvernements coloniaux, l'exception du territoire du Tanganyika.
Le gouvernement du Soudan anglo-gyptien a toujours prfr, avec sagesse
mon avis, financer des expditions faites par des anthropologues professionnels et
destines tudier des sujets particuliers; il leur octroyait un contrat pour travailler
pendant un temps limit, et la recherche dans ce pays a t de faon intermittente
assure successivement par le professeur Seligman et sa femme, moi-mme, le docteur Nadel et M. Lienhardt, depuis 1909 jusqu' aujourd'hui. Cette mthode prsente
certains avantages : pendant que l'anthropologue acquiert l'exprience qui plus tard
lui permettra d'accder un poste universitaire, le gouvernement obtient des renseignements prcieux, collects par un professionnel au courant des rcents dveloppements sur la question qu'il tudie.
Depuis la dernire guerre, le Colonial Office a manifest un intrt croissant pour
l'anthropologie sociale. Il a organis et financ des recherches anthropologiques dans
plusieurs territoires coloniaux. Cette faon d'organiser la recherche n'a pas donn,
mon avis, les rsultats qu'on aurait pu en escompter. Je suis persuad, comme certains
de mes collgues, qu'il et mieux valu entreprendre ces recherches dans le cadre de
l'Universit, donc d'un systme responsable de la slection et de la formation des
tudiants, supervisant leurs travaux et assurant la rdaction et la publication des
rsultats. La politique actuelle du Colonial Office consiste organiser la recherche
par l'intermdiaire des instituts de recherche locaux. L'un de ceux-ci, l'Institut
Rhodes-Livingstone en Rhodsie du Nord, fonctionne depuis 1938 et trois autres
instituts de recherche sociale ont t ouverts rcemment Makerere en Ouganda,
Ibadan au Nigeria, et Kingston la Jamaque. Je pense, quant moi, qu'ils ne
sauraient se substituer l'organisation de la recherche par les dpartements universitaires, bien que les instituts locaux soient certainement d'une grande utilit en tant que
centres capables d'accueillir des chercheurs.
La cration des bourses d'tude du Trsor (Treasury Studentships) a t trs
importante pour l'avenir de la recherche anthropologique dans le domaine des langues
et des cultures en Extrme-Orient, au Proche-Orient, en Europe de l'Est et en Afrique.
L'exprience de la dernire guerre a montr qu'il existait une lamentable ignorance
quant ces parties du monde et une Commission Royale, sous la prsidence du comte
de Scarbrough, dcida que cet tat de choses ne pouvait durer plus longtemps et qu'il
fallait instituer une tradition de la recherche dans ces langues et ces cultures. L'admirable projet qu'ils laborrent comprenait le renforcement de dpartements universitaires et la cration de nouveaux dpartements, l'allocation de bourses de recherche
dans le cadre universitaire; le projet prvoyait aussi la fondation d'instituts tenant lieu
de centres de recherche dans les parties du monde o ces recherches pouvaient tre
effectues. De cette faon, on tait sr que des recherches se feraient, mais encore
qu'une tradition d'rudition serait cre et maintenue.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
79
Ces bourses accordes par le Trsor ont permis un certain nombre d'anthropologues de procder dans plusieurs rgions des tudes anthropologiques qu'ils
n'auraient peut-tre pas pu faire autrement. La recherche anthropologique dans les
pays lointains exige beaucoup d'argent et les diverses Fondations qui normalement
nous aident ne peuvent alimenter qu'une trs petite partie de la recherche.
Les organisations missionnaires britanniques ne semblent pas avoir saisi l'intrt
que reprsentaient les tudes d'anthropologie pour ceux de leurs membres destins
travailler dans les missions tablies dans des socits indignes. Ce manque d'intrt
est peut-tre partiellement d la pauvret des missions qui ne peuvent financer
l'envoi de leurs volontaires dans les universits o l'anthropologie est enseigne. On
peut l'attribuer aussi au fait que les cercles missionnaires ont toujours considr l'anthropologie avec mfiance, mfiance peut-tre justifie car l'anthropologie a souvent
t mle la libre pense; on l'a donc, non sans raison, considre comme antireligieuse par son ton et mme dans ses objectifs. Les missionnaires sont sans doute
de l'avis de Gabriel Sagard, qui dclare dans son ouvrage sur les Hurons (1632): La
perfection pour les hommes ne consiste pas voir beaucoup, ni savoir beaucoup,
mais mettre excution la volont et le bon plaisir de Dieu. Nanmoins, beaucoup
de missionnaires se sont individuellement intresss l'anthropologie, comprenant
toute l'utilit qu'elle pouvait reprsenter pour leur travail. Le pasteur Junod a bien
exprim l'attitude de la Mission de la Suisse Romande; il est l'auteur d'une des meilleures monographies anthropologiques jamais crites. Il explique qu'en accumulant
les informations contenues dans ce livre, il voulait la fois apporter une contribution
scientifique, aider les administrateurs coloniaux et les missionnaires, et encore ouvrir
les yeux des blancs d'Afrique du Sud sur le problme indigne: Travailler pour la
science est une chose noble ; mais aider nos frres humains est encore plus noble 1.
Un autre missionnaire, le Dr Edwin Smith, auteur d'un excellent rapport sur les Ba-ila
de Rhodsie du Nord, a t lu au poste de Prsident de l'Institut Royal d'Anthropologie.
Autrefois, ce furent surtout les administrateurs et les missionnaires qui comprirent
qu'un certain bagage anthropologique ne pouvait que les servir dans leur travail et
rendre leur tche plus agrable et plus efficace. La situation est autre aujourd'hui et
les experts techniques ont pris une importance croissante en territoire colonial : le
mdecin, l'expert agronome, l'expert forestier, le vtrinaire, l'ingnieur, le commerant et tous les reprsentants des intrts miniers et les agents des grosses compagnies
commerciales. Or il se trouve que tous ces individus sont censs effectuer un travail
parmi des peuples dont ils ignorent presque totalement les murs et les coutumes.
On demandera peut-tre comment certaines connaissances anthropologiques peuvent aider des Europens dans leurs transactions avec les indignes. Pendant longtemps, beaucoup d'anthropologues ont parl d'anthropologie applique, comme on
parle par exemple de mdecine applique. Ceux qui en parlaient ainsi considraient
que l'anthropologie tait une science naturelle dont l'objectif tait de formuler les lois
de la vie sociale; lorsqu'on peut tablir des gnralisations thoriques, la science
applique devient chose possible. Nous avons vu comment cet lment normatif de
1
The Life of a South African Tribe, 1913, p. 10.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
80
l'anthropologie fait partie de son hritage philosophique, comme le concept de loi
naturelle et de progrs dont il drive. Comme je l'ai dj dit, les philosophes du
XVIIIe sicle, les ethnologues du XIXe et la majorit des anthropologues d'aujourd'hui ont, implicitement ou explicitement, pris les sciences naturelles comme modle,
dfinissant le but de l'anthropologie comme le contrle des changements sociaux en
les prvoyant et en les organisant. On a donc parl ce sujet d' un art de l'ingnieur
appliqu aux socits .
Il n'est pas surprenant que, dans ses jeunes annes, l'anthropologie thorique ait si
souvent t teinte de socialisme, surtout en France o Saint-Simon et Auguste
Comte essayaient d'tablir les religions positivistes. C'est, je pense, certainement
l'intention dominante dans les travaux de Durkheim et de ses collgues. C'est LvyBruhl qui a exprim l'opinion gnrale dans un court essai, La Morale et la Science
des Murs (1903). Selon lui, les systmes thiques n'ont et ne peuvent avoir aucun
effet sur la conduite relle des hommes, car ils ne sont que des rationalisations de la
coutume. Si un peuple, par exemple, tue tous les jumeaux la naissance, cette
pratique est morale pour le peuple en question. La morale n'est que l'ensemble des
rgles qui dterminent le comportement dans n'importe quelle socit et, par consquent, suit les variations de la structure sociale; la morale, c'est ce qui parat normal
un type social donn, un stade donn de son volution. La tche de la raison, c'est
donc de faonner le comportement par une morale pratique drive d'une tude
scientifique de la vie sociale. C'est le point de vue gnralement admis par la majorit
des auteurs de cette poque et il tait normal qu'il ft galement partag par nombre
d'anthropologues.
Ces anthropologues se sont efforcs, par tous les moyens, de faire comprendre les
multiples champs d'application de l'anthropologie sociale; en Angleterre, il s'agissait
des problmes coloniaux et en Amrique des problmes industriels et politiques. Ses
partisans les plus prudents ont, il est vrai, maintenu qu'il ne peut y avoir d'anthropologie applique que lorsque les sciences humaines auront atteint un stade beaucoup
plus avanc; mais mme un spcialiste aussi avis et aussi prudent que le professeur
Radcliffe-Brown a dit : Avec l'avance plus rapide de la science pure, et avec la
coopration des administrations coloniales, on peut envisager le moment o le
gouvernement et l'ducation des divers peuples indignes dans le monde deviendront
un art fond sur les lois dcouvertes par la science anthropologique 1. Des auteurs
moins prudents et plus connus, surtout en Amrique, voudraient voir les connaissances acquises par l'anthropologie appliques au plus vite la planification sociale.
Si l'on accepte de mettre l'anthropologie au rang d'une science naturelle, il est
logique de prtendre que les lois sociologiques tant applicables n'importe quelle
socit, devraient tre utilises la planification de notre socit, plutt qu' la rgulation des socits primitives que certains ne manquent pas de considrer comme les
cobayes de la recherche sociologique. Aprs tout, il n'y a pas qu'en Afrique que se
posent des problmes de gouvernement, de proprit, de migration de travailleurs, de
divorce et combien d'autres! Il arrive que devant le problme pos par l'effondrement
1
A. R. Radcliffe-Brown : Applied Anthropology , Report of Australian and New Zealand
Association for the Advancement of Science, Section F., 1930, p. 3.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
81
de la vie familiale des peuples des territoires coloniss, nous finissions par formuler
certaines conclusions. Pourquoi, si ces dcouvertes sont gnralisables, ne pas les
appliquer l'effondrement de la vie familiale en Angleterre et en Amrique? Le
professeur Herskovits pense que la dette dont nous sommes redevables la socit
qui nous fait vivre doit tre rgle en paiements long terme; nous ne pouvons pas
mieux contribuer une meilleure comprhension de la nature et du processus de la
culture, et ce faisant, nous arriverons peut-tre la solution de certains de nos problmes les plus aigus 1. Ce que nous apprenons en tudiant le Noir et le Jaune, pour
reprendre les paroles de Kipling sur un tout autre sujet, doit nous aider considrablement comprendre le Blanc.
J'ai, il me semble, expliqu assez clairement au cours de ces confrences que je ne
croyais pas l'existence future d'une science de la socit qui puisse tre compare aux sciences naturelles. Il n'est pas ncessaire de revenir sur cette question car je
ne pense pas qu'il se trouve un seul anthropologue digne de ce nom, pour prtendre
qu'on a dcouvert jusqu'ici des lois sociologiques; s'il n'existe pas de lois, comment
les appliquerait-on?
Ceci ne veut pas dire que l'anthropologie sociale n'ait, mme dans un sens troitement technique, aucune sorte d'application pratique. Simplement, on ne peut pas l'appliquer comme on le fait pour la mdecine ou les techniques de l'ingnieur. L'anthropologie n'en est pas moins un ensemble de connaissances sur les socits primitives
et comme toute somme de connaissances de ce type, elle peut tre d'un grand secours
dans la pratique courante. L'administration et l'ducation des populations arrires
posent des problmes constants et ceux qui doivent rsoudre ces problmes ne
peuvent que bnficier d'une connaissance des facteurs en prsence. Une telle connaissance leur pargnera de srieuses erreurs. Deux guerres furent menes contre les
Ashanti de la Cte de l'Or, avant que l'on apprenne que le Tabouret d'Or dont le
gouvernement avait demand la reddition tait cens, selon la croyance ashanti,
contenir l'me de leur peuple et qu'ils ne devaient s'en sparer sous aucun prtexte.
Les connaissances anthropologiques sont prcisment de nature fournir, dans ce
genre de cas, la cl du problme; on comprend immdiatement quelle assistance elle
peut apporter l'administration. Cette position est fort bien rsume dans ce
qu'crivait, en 1884, le professeur W. H. Flower : Il est indispensable pour les
hommes d'tat qui veulent gouverner avec succs, non de considrer la nature
humaine comme une abstraction et d'essayer de la plier des rgles universelles, mais
de dterminer quels sont le code moral, les capacits intellectuelles et sociales, les
besoins et les aspirations de chaque race particulire dont ils doivent s'occuper 2.
Aussi videntes que ces observations puissent tre, je crois ncessaire d'insister
sur ces diffrents facteurs : le code moral, les capacits intellectuelles et sociales, les
besoins et les aspirations qui doivent tre dtermins avec prcision : l'exprience a
prouv que les anthropologues sont les mieux qualifis, car ils s'acquitteront de leur
1
2
M. J. Herskovits : Applied Anthropology and the American Anthropologist , Science, 6 mars
1936, p. 7.
W. H. Flower : Texte de la Confrence prsidentielle, Journal of the Anthropological Institute,
1884, p. 493.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
82
tche avec un maximum de prcision et de rapidit. Eux seuls savent quoi et o
chercher. Je me bornerai vous donner un dernier exemple pour illustrer comment la
recherche spcialise a pu aider l'administration et les missions. Chez de nombreux
peuples africains, l'un des modes du mariage consiste en la donation par la famille et
les proches du futur poux, la famille de la future pouse, d'un certain nombre de
btes cornes. Pendant trs longtemps on a interprt cette coutume comme une
transaction commerciale : on vendait les filles contre du btail. Du coup, les missionnaires dnoncrent ce marchandage et les gouvernements coloniaux l'interdirent.
Lorsque la recherche anthropologique expliqua que le transfert du btail d'une famille
l'autre quivalait, ni plus ni moins, au transfert de la dot, en vigueur en Europe (ce
qu'on n'aurait jamais song interprter comme l'achat d'un mari) et qu'en condamnant et en interdisant cette pratique, on affaiblissait les liens du mariage et de la
famille, on prcipitait en quelque sorte la dgradation et la dprciation des femmes
(ce que justement on cherchait viter), on adopta alors une tout autre attitude. Voil
le genre de problme o l'aide des anthropologues aux profanes peut tre positive. Il
est bien vident que seule la recherche anthropologique tait capable de dterminer la
fonction et la nature de cette forme de dot.
Outre que les anthropologues sont plus qualifis que les profanes pour dcouvrir
la nature des faits, ils sont aussi plus mme d'valuer correctement les consquences
d'une politique administrative parce que leur formation les a habitus chercher les
rpercussions qui demeurent caches aux profanes. On pourrait donc en toute logique
leur demander d'assister les gouvernements coloniaux; ils expliqueraient les phnomnes de sorte que les dcisions seraient prises en connaissance de cause; de plus ils
seraient beaucoup plus qualifis pour prvoir les consquences possibles de telle ou
telle politique. Ce n'est pas le rle de l'anthropologue toutefois de dterminer quelle
politique on doit suivre. Il peut, en fonction de ses dcouvertes, influencer les moyens
employs pour appliquer telle ou telle politique; il peut modifier l'optique de ceux qui
prennent des dcisions politiques; mais en aucun cas, il ne saurait, de par la nature
mme de sa recherche, dterminer quelle politique doit tre adopte. La politique est
dtermine par des considrations qui priment toutes les autres. Il n'est nul besoin
d'anthropologue pour savoir que les gens de Bikini seraient beaucoup plus heureux si
l'on n'avait pas utilis leur pays comme terrain d'exprience atomique. Il serait
galement vain que les anthropologues expliquent aux gouvernements, comme ils ont
tent de le faire, qu'en interdisant aux chasseurs de ttes des les du Pacifique de se
livrer ce type de chasse, les populations de ces les finiraient par s'teindre compltement. Les gouvernements rpondront que cette pratique doit tre interdite quelles
qu'en soient les consquences, parce qu'elle est rvoltante aux yeux de la justice
naturelle, de l'quit et de la bonne administration . Je pense que ceci est un bon
exemple ; on voit comment les buts se trouvent dtermins par des valeurs axiomatiques qui ne dcoulent pas d'une connaissance relle des conditions existantes. Si ceux
qui contrlent la politique croient vraiment la prosprit matrielle, l'instruction
publique, aux institutions dmocratiques, ils voudront les donner aux peuples
coloniaux qu'ils gouvernent. Quant savoir si ce qu'ils font est bien ou mal, c'est la
philosophie morale d'en dcider et non l'anthropologie.
Afin de ne pas compromettre leur recherche, les anthropologues doivent viter
toute question politique; je pense qu'il faut souligner aussi que l'obligation pour les
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
83
anthropologues de dpendre financirement d'un gouvernement comporte un certain
danger; c'est ventuellement une source de conflits quand il s'agit de dfinir les buts
et les mthodes de la recherche anthropologique. Il peut arriver, par exemple, qu'un
chercheur s'intresse particulirement au problme de la religion primitive et il devra
donc y consacrer beaucoup de temps; la plupart des gouvernements ne s'intressent
gnralement pas ce type de question et prfreront voir un spcialiste s'attacher
l'tude des problmes de migration des travailleurs. Ou encore, un gouvernement ne
s'intressera qu'au rgime foncier alors que, bien souvent, on ne peut comprendre la
nature du rgime foncier qu'en fonction de la vie sociale tout entire. L'anthropologue
s'intresse aux questions purement anthropologiques, qu'elles aient une importance
pratique ou non. De la mme faon, un gouvernement s'intresse aux questions pratiques, qu'elles aient une signification thorique ou non. On pourrait citer nombre de
situations embarrassantes causes par ces objectifs opposs. Je pense, quant moi,
que la meilleure solution pour un gouvernement colonial consisterait crer des
postes d'anthropologie de la mme faon qu'il cre des postes destins des ducateurs, des gologues, des botanistes, des parasitologues et autres experts. De cette
faon, certains anthropologues pourront choisir une carrire administrative comme
d'autres choisissent une carrire universitaire.
J'ai, pour ma part, effectu une quantit considrable de recherches pour le compte du gouvernement du Soudan anglo-gyptien. Il se trouve que les vues de ce
gouvernement concidaient (du moins c'est ainsi que je l'ai compris) avec les miennes
et je puis donc exposer ici mon opinion sur la valeur de l'apport de l'anthropologie
l'administration. Le gouvernement du Soudan a, pendant fort longtemps ainsi que je
l'ai dit, financ trs gnreusement la recherche anthropologique, ce qui a permis
des chercheurs de faire de fructueuses tudes sur le terrain et (fait souligner) de
faire ces tudes de la faon dont ils l'entendaient. Le gouvernement s'est born
choisir des individus et ceux-ci ont eu la libert de choisir leur sujet. Je pense que
cette dmarche dnote beaucoup de sagesse, parce qu'il n'a jamais entretenu l'illusion
que les lments accumuls par l'anthropologue lui seraient d'aucune utilit pratique,
mais il semblait penser qu'il tait du devoir du gouvernement d'encourager la recherche; le gouvernement du Soudan anglo-gyptien pensait encore (et je tiens insister
sur ce point) que l'tude des langues, des cultures et de la vie sociale des populations
soudanaises avait une trs grande importance pour les fonctionnaires de l'administration, sans considrer si de telles connaissances pouvaient rsoudre les problmes
pratiques dans l'immdiat.
Je pense qu'on peut considrer la question sous cet angle. Supposons qu'un tranger doive rejoindre un poste diplomatique ou commercial en France : il est certain
que sa vie serait beaucoup plus agrable, sans parler de celle des Franais eux-mmes, et il ferait un meilleur diplomate ou un meilleur homme d'affaires s'il apprnait la
langue franaise et s'intressait la vie sociale franaise et la faon dont fonctionnent les institutions. C'est la mme chose s'il doit vivre parmi des primitifs. S'il sait ce
qu'ils disent et ce qu'ils font, s'il assimile leurs ides et leurs valeurs, il les comprendra mieux et il les administrera sans doute beaucoup plus quitablement et efficacement.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
84
Un explorateur du XVIIe sicle, La Crequinire, dont j'ai parl dans une prcdente confrence, a exprim succinctement ce point de vue. Aprs avoir donn
conseil aux explorateurs, en s'inspirant de ses propres expriences dans les Indes
Orientales, de garder un esprit ouvert mais de rester fermes en leurs convictions
religieuses, de se montrer tolrants et d'essayer de comprendre des coutumes qui leur
paraissent bizarres, de bien se conduire dans les pays trangers, d'viter de tomber
amoureux, ce qui les dtournerait de leur dessein, d'viter de jouer et de frquenter
des joueurs, d'tudier l'histoire, les langues, la gographie, il termine en disant :
Celui qui sait comment voyager en retirera d'immenses avantages; il amliorera son
esprit grce ses observations ; son cur sera gouvern par ses rflexions et son
comportement se raffinera au contact des personnalits distingues de nombreux
pays; aprs cela, il sera beaucoup plus qualifi pour vivre dcemment, car il devra
s'accommoder des coutumes de peuples diffrents et, selon toutes probabilits,
s'adaptera plus facilement aux humeurs de ceux qu'il visitera : de cette faon, il ne
fera personne ce qu'il sait tre contraire leurs gots, ce qui, selon nous, constitue
l'essentiel de ce que nous appellerons l'Art de vivre 1.
Je ne pense pas que la connaissance anthropologique puisse tre applique d'une
faon ou d'une autre la pratique de l'administration et de l'ducation chez les
peuples primitifs dans un sens autre qu'un sens de culture gnrale, par l'influence
qu'elle exerce sur l'attitude des Europens envers les indignes. Le fait de comprendre
la mentalit d'une population ne peut qu'engendrer de la sympathie son gard et
parfois dclenchera un dvouement certain au service de leur cause et de leur intrt.
Les indignes comme les Europens ne peuvent qu'en bnficier. Je mentionnerai
brivement ce que je considre pouvoir tre un apport supplmentaire de l'anthropologie ces populations dont nous tudions la vie et les coutumes. Nous aurions t
fort reconnaissants de trouver une description dtaille de la vie sociale de nos
anctres celtes et anglo-saxons lgue par quelque anthropologue romain. Je crois
qu'un jour les peuples primitifs que nous avons jusqu'ici tudis seront heureux de
trouver des archives dcrivant la vie de leurs anctres, archives tablies impartialement par des chercheurs dont la seule ambition a t de dresser un inventaire aussi
proche de la ralit que prcis.
Il arrive que les anthropologues puissent rsoudre des problmes d'administration,
ce qui contribue une meilleure comprhension des autres populations et favorise
l'accumulation de documents prcieux pour les futurs historiens. Je n'attache pas,
quant moi, une grande importance aux ventuels services que nous pouvons rendre;
je trouve beaucoup plus prcieuses les dispositions d'esprit et les habitudes de penser
que nous acqurons en tudiant la nature de la vie sociale. L'anthropologie nous
habitue considrer les activits sociales dans le contexte tout entier de la vie sociale
et nous apprend discerner le particulier la lumire du gnral.
L'anthropologue cherche mettre en vidence les formes structurales qui se
cachent derrire les complexits et l'apparente confusion des ralits dans la socit
qu'il tudie; il le fait en faisant des abstractions bases sur le comportement social et
en tablissant les rapports qui peuvent exister entre elles, de sorte que la vie sociale
1
Conformit des Coutumes des Indiens Orientaux, 1704, p. 251-252.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
85
est perue comme un ensemble de parties interdpendantes, comme un tout. On ne
peut videmment le faire qu'au moyen de l'analyse; mais l'analyse n'est pas une fin en
soi, elle est seulement un moyen qui prpare l'intgration ultrieure des lments en
une unit dote de signification. C'est pourquoi, je rpte qu' mon avis on devrait
considrer l'anthropologie comme un art.
L'anthropologue vise souligner, en comparant une socit une autre, les traits
communs des institutions aussi bien que les phnomnes particuliers chaque
socit. Il cherche dmontrer comment les caractristiques d'une institution ou d'un
ensemble d'ides sont particulires une socit donne, comment d'autres sont communes toutes les socits d'un certain type et comment d'autres se retrouvent dans
toutes les socits humaines - donc qu'elles sont universelles. Les caractristiques
qu'il recherche sont d'ordre fonctionnel; il se retrouve donc, quoique un niveau
d'abstraction suprieur, en qute d'un ordre dynamique de la vie sociale, de configurations qui soient communes toutes les socits du mme type et de configurations
qui soient universelles. Sa manire de procder sera la mme, que les conclusions
recherches s'appliquent une socit ou plusieurs; il doit trouver, au moyen de
l'analyse, des abstractions bases sur les phnomnes sociaux complexes, puis les
rattacher les unes aux autres de telle faon que toutes les relations sociales puissent
revtir l'aspect d'un dessin pouvant tre peru par l'esprit dans une juste perspective,
comme un ensemble de faits intimement lis, dont les traits significatifs sont mis en
relief. Il sera jug sur la faon dont il russit dans cette tche et non sur l'ventuelle
utilit immdiate de ce qu'il crit.
C'est la lumire de cette conception des buts de l'anthropologie sociale que je
vous demanderai de considrer sa signification pour nous en tant qu'individus et sa
valeur comme lment de notre propre tradition intellectuelle.
Vu ma conception particulire des buts de l'anthropologie, vous comprendrez
pourquoi j'ai insist, au cours de ces confrences, sur le fait que l'tude d'une socit
primitive vaut la peine d'tre poursuivie pour son seul intrt, quelles que soient son
application future et son utilit. Je suis certain que personne n'estime que la connaissance de l'Athnes antique, de la France mdivale ou de la Renaissance italienne ne
prsente aucun intrt puisqu'elle est, sur le plan pratique, impuissante rsoudre les
problmes de notre socit ou nous aider formuler des lois sociologiques. Je
n'essaierai donc pas de vous convaincre que la connaissance qui ne fournit pas
d'applications immdiates, ou qu'on ne peut rduire des formules scientifiques, n'en
comporte pas moins une valeur considrable pour l'individu dans sa propre vie, ainsi
que pour la socit tout entire.
Il est possible que certains d'entre vous pensent ou aient entendu dire, qu'il est fort
bien de lire des ouvrages sur Athnes, le Moyen ge en France et la Renaissance
italienne - mais qui donc peut avoir envie de lire un ouvrage consacr un ramassis
de sauvages ? Ceux qui posent gnralement cette question nous appellent des
barbarologues . Je ne comprends gure leur attitude, qui n'a heureusement pas t
celle des esprits srieux depuis le moment o nous avons pu avoir certaines
informations sur les peuples trangers, et en particulier sur les peuples primitifs. J'ai
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
86
dit comment, ds le XVIe sicle, les hommes de culture se sont intresss aux rcits
des voyageurs, revenus de chez les peuplades sauvages, comment ils ont saisi les
similitudes de pense et de comportement en mme temps qu'ils prenaient conscience
des divergences culturelles profondes que ces rcits rvlaient. On sait combien les
philosophes furent particulirement sduits par ces rcits dcrivant les institutions
primitives et je ne crois pas me tromper en disant qu'ils trouvaient les institutions des
Carabes et des Iroquois plus passionnantes que celles de l'Angleterre mdivale.
On comprend leur curiosit car les peuples primitifs prsentent un intrt certain
pour tous ceux qui tudient la nature de l'homme et de la socit. On se trouve devant
des individus qui n'ont pas de religion rvle, qui n'ont pas de langue crite, qui ne
possdent aucune connaissance scientifique, qui vivent dans une certaine nudit, ne
possdent que des outils et des habitations extrmement sommaires, des hommes qui
cependant subsistent et en majorit vivent heureux au sein de communauts leur
image. On s'imagine difficilement vivre dans de telles conditions et surtout vivre
content, et l'on se demande (et je crois qu'il faut se demander) ce qui leur permet de
vivre ensemble harmonieusement, d'affronter les vicissitudes de la vie avec si peu
d'armes pour combattre la nature et le sort. Le simple fait que les primitifs ne possdent pas de voitures automobiles, ne lisent pas de journaux, n'achtent ni ne vendent,
loin de les amoindrir, les rend plus intressants, puisque dans ce cas on voit l'homme
affronter le destin dans toute sa brutalit et toute sa violence, sans aucun des secours
de la civilisation, aucun de ses remdes et de ses consolations. Quoi d'tonnant ce
que les philosophes aient cru que ces peuples vivaient dans un tat de crainte et de
misre perptuel! Ce n'est pourtant pas le cas; ils vivent selon un code moral qui leur
apporte un sentiment de scurit et ils professent un ensemble de valeurs qui leur
rendent la vie supportable. Quand on y regarde de plus prs, on s'aperoit que sous
l'apparente simplicit de leur vie, se trouvent des structures sociales trs complexes et
des cultures infiniment riches. Nous sommes tellement habitus penser la culture
et aux institutions sociales en termes de civilisation matrielle et de dimensions, qu'
moins de les chercher vraiment, nous ne les voyons pas chez les primitifs. Nous
dcouvrons alors qu'ils ont une religion qui s'exprime sous forme de dogmes et de
rituels; leur mariage se fait selon un crmonial et des rituels prcis et la vie familiale
se droule au foyer; ils ont un systme de parent, souvent trs compliqu et de
nature plus vaste que dans nos socits; ils ont des associations et des clubs buts
dtermins; ils ont des rgles, souvent trs labores, qui gouvernent l'tiquette et les
manires; ils ont des interdits, que des tribunaux font respecter; ils possdent des
codes de lois civiles et criminelles; leur langue est frquemment complexe sur le plan
de la grammaire et de la phontique; ils ont un immense vocabulaire; ils ont une
posie en langue vernaculaire, riche en symboles, toute une littrature de chroniques,
de mythes, de contes folkloriques et de proverbes; ils ont des arts plastiques; ils ont
un systme d'conomie rurale qui exige une connaissance profonde des saisons, des
sols, des animaux et des plantes; ils sont d'tonnants pcheurs et d'mrites chasseurs
et n'hsitent pas s'aventurer sur mer et sur terre; ils possdent encore des
connaissances multiples dans des matires qui nous sont totalement trangres : la
magie, la sorcellerie, les oracles et la divination. Quel prjug et quelle mode ridicule
de prtendre que ces cultures et ces socits n'ont pas d'intrt, qu'un homme cultiv
doit connatre l'histoire et les coutumes de Rome, de l'gypte et de la Grce antique,
mais qu'il n'a nul besoin de connatre les Eskimos, les Maoris et les Bantous! Une
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
87
telle attitude ne peut que rappeler celle de ceux qui pendant longtemps prtendirent
que le monde n'avait pris son vritable essor qu'au lendemain de la Renaissance et de
la Rformation; ils en fixaient les limites gographiques au bassin mditerranen et
l'Europe du nord et trouvaient, pour ne prendre que cet exemple, que l'art, la
littrature, l'histoire et la philosophie de l'Inde taient dpourvus de tout intrt. Il
faut abandonner ce genre d'ethnocentrisme si l'on veut apprcier l'immense varit de
la culture humaine et de la vie sociale dans le monde. Il n'est pas question d'valuer
les sculptures de l'Afrique occidentale selon les canons de la sculpture grecque. Les
langues mlansiennes ne sauraient tre dprcies sous prtexte qu'elles ne se
conforment pas aux rgles de la grammaire latine et l'on ne doit pas appliquer aux
pratiques et aux dogmes de la magie, les principes de la science occidentale. Les tribus d'aborignes australiens ne sauraient tre compares aux habitants de Birmingham ou de Manchester. Chaque peuple rsout sa faon les problmes qui se posent
lui lorsque des hommes vivent ensemble et veulent sauvegarder leur hritage
culturel et le lguer leurs enfants; leurs solutions sont aussi valables que celles de
n'importe quel autre peuple. Une socit primitive est peut-tre numriquement
limite, mais va-t-on dire qu'un scarabe ou un papillon sont moins intressants qu'un
buf?
Tout ceci m'amne un aspect plus gnral de l'anthropologie sociale : ce qu'elle
nous apprend non sur les socits primitives en tant que telles, mais sur la nature de la
socit humaine en gnral. Ce que nous apprenons sur une socit peut s'appliquer
une autre, donc ventuellement toutes les socits, qu'elles aient exist il y a
longtemps ou qu'elles existent aujourd'hui.
Je prendrai quelques courts exemples historiques. On a beaucoup crit sur les
Bdouins pr-islamiques en Arabie, mais bien des questions sur leur structure sociale
sont restes pratiquement sans rponse faute de preuves historiques. On peut s'aider
en tudiant la structure sociale des Bdouins aujourd'hui, puisque bien des gards
ils mnent plus ou moins le mme genre de vie que leurs lointains anctres; on a
beaucoup dcrit aussi la vendetta aux premiers ges de l'histoire anglaise, mais l
encore, nous devons recourir des documents qui analysent la vendetta dans les
socits barbares contemporaines, pour clairer notre lanterne. Nous avons certaines
difficults comprendre la raison des procs de sorcires de l'Angleterre du XVIIe
sicle. Nous la comprendrons beaucoup mieux en tudiant la sorcellerie des socits
centrafricaines, o les gens continuent croire aux sorcires et les tiennent pour
responsables des malheurs qui arrivent leurs voisins. On ne saurait bien entendu se
risquer qu'avec la plus grande circonspection, chercher dans l'tude d'un phnomne
social, dans une socit donne, l'interprtation d'un phnomne identique, observ
dans une autre socit; ceci tant dit, on s'apercevra que ces phnomnes, s'ils sont
trs diffrents sur un certain plan, se ressemblent normment sur d'autres.
Ce que je suis en train de dire est en ralit trs vident. Dans toute socit, si
simple soit-elle, nous trouvons un type de vie familiale, la reconnaissance des liens de
parent, un systme conomique, un systme politique, un statut social, une religion,
des modes de conciliation des conflits, des sanctions criminelles, des loisirs organiss
et ainsi de suite, ct d'une culture matrielle, d'un ensemble de connaissances sur
la nature et les techniques, et de traditions. Lorsque nous cherchons comprendre les
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
88
traits communs de n'importe quelle institution des socits humaines en gnral,
comprendre aussi les diverses formes qu'elle adopte, les diffrents rles qu'elle joue
dans des socits diffrentes, ils faut admettre que l'tude de socits moins complexes nous aide considrablement, aussi bien que celle de socits plus complexes.
Ce que nous dcouvrons dans l'tude d'une socit primitive quant la nature de l'une
de ses institutions nous rend cette institution plus intelligible, qu'elle se trouve dans
notre socit ou dans n'importe quelle autre.
Nous serons beaucoup plus mme de comprendre l'Islam, par exemple, ou le
Christianisme, ou l'Hindouisme, si nous savons que certains traits sont universels;
toutes les religions ont des traits communs, y compris celles des peuples primitifs ;
certains sont spcifiques certaines religions et d'autres particuliers une seule. Je
suivrai la mme dmarche pour ce qui est de l'anthropologie. Elle nous permet,
partant d'un seul angle, de voir l'humanit en sa totalit. Une fois que l'on a pris
l'habitude de considrer anthropologiquement les cultures et les socits humaines, on se meut facilement du particulier au gnral et vice versa. Si l'on parle de la
famille, on ne fait pas seulement allusion la famille d'Europe occidentale contemporaine, mais une institution universelle, dont la famille europenne ne reprsente
qu'un chantillon, avec un grand nombre de caractristiques particulires. Lorsqu'on
parle de la religion, on ne pense pas seulement au christianisme, mais une quantit
de cultes existant et d'autres disparus, de par le monde entier. Ce n'est qu'en
comprenant les autres cultures et les autres socits qu'on arrive voir la sienne dans
une juste perspective - et on la comprendra donc par rapport la totalit des expriences humaines.
Qu'on me permette de rappeler ma dernire confrence; j'ai expliqu que le Dr
Mead a compris Samoa les problmes des adolescents amricains; Malinowski, en
tudiant l'change d'objets rituels chez les Trobriandais, a clair certains problmes
des motivations de l'industrie britannique et je crois, pour ma part, avoir russi
comprendre quelque peu la Russie Sovitique en tudiant la sorcellerie chez les
Azande.
Pour conclure, j'ajouterai que je suis persuad que l'anthropologie sociale nous
aide mieux comprendre, quel que soit le moment ou l'endroit, cette tonnante crature qu'est l'tre humain.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
89
BIBLIOGRAPHIE
Retour la table des matires
GNRALITS
BRYSON, Gladys, Man and Society, Princeton, 1945.
FIRTH, Raymond, Human Types, Londres, 1938.
FORDE, C. D., Habitat, Economy and Society, Londres, 1934.
HADDON, A. C., History of anthropology, Londres, 1934.
HODGEN, M. T., The Doctrine of Survivals, Londres, 1936.
KROEBER, A. L., Anthropology, New York, 1923.
LOWIE, R. H., The History of Ethnological Theory, Londres, 1937. Notes and
Queries in Anthropology, Londres, 1874.
PENNIMAN, T. K., A Hundred Years of Anthropology, Londres, 1935.
RADIN, Paul, The Method and Theory of Ethnology, New York, Londres, 1933.
OEUVRES THORIQUES
XVIIIe sicle
DUNBAR, James, Essays on the History of Mankind in Rude and
Cultivated Ages, Londres, 1780.
FURGUSON, Adam, An Essay on the History of Civil Society, Edimbourg, 1767.
HUME, David, A Treatise of Human Nature, Londres, 1739-40.
KAMES, Lord, Historical Law-Tracts, Edimbourg, 1758.
MONBODDO, Lord, Of the Origin and Progress of Language, Edimbourg, 1773-92.
MONTESQUIEU, De l'Esprit des Lois, Genve, 1748.
SAIN-SIMON, Oeuvres de Saint-Simon et dEnfantin, Paris, 1865.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
90
XIXe sicle
BACHOFEN, J. J., Das Mutterrecht, Stuttgart, 1861.
BASTIAN, Adolf, Der Mensch in der Geschichte, Leipzig, 1860.
COMTE, Auguste, Cours de Philosophie Positive, Paris, 1830.
COULANGES Fustel de, La Cit Antique, Paris, 1864.
DURKHEIM, mile, De la Division du Travail Social, Paris, 1893. Les Rgles de la
Mthode Sociologique, Paris, 1895.
FRAZER, Sir James, The Golden Bough, Londres, 1890. Trad. fran. Le Rameau
d'Or, P. Geuthner, 1924.
HUBERT, H. et MAUSS, M., Essai sur la Nature et la Fonction du Sacrifice, l'
Anne Sociologique , T. II, Paris, 1897-98.
MAINE, Sir Henry, Ancient Law, Londres, 1861. Village-Communities in the East
and West, Londres, 1871,
McLENNAN, J. F., Primitive Marriage, Londres, 1865. Studies in Ancient History,
Londres, 1886 et 1896.
MORGAN, Lewis H., Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family,
Washington, 1871. Ancient Society, Londres, 1877.
SMITH, W. Robertson, Kinship and Marriage in Early Arabia, Londres, 1885.
Lectures on the Religion of the Semites, Londres, 1889.
SPENCER, Herbert, The Study of Sociology, London, 1872. The Principles of
Sociology, New York, 1882-83.
STEINMETZ, S. R., Ethnologische Studien zur ertsen Entwicklung der Strafe,
Leiden et Leipzig, 1894.
TAYLOR Sir Edward, Researches into the Early History of Mankind, Londres, 1865.
Primitive Culture, Londres, 1871.
WESTERMARCK, Edward, The History of Human Marriage, Londres, 1891.
XXe sicle
BENEDICT, Ruth, Patterns of Culture, Boston et New York, 1934.
CASSIRER, Ernst, An Essay on Man, New Haven, 1944.
COLLINGWOOD, R. G., The Idea of History, Oxford, 1946.
DURKHEIM, mile, Les Formes lmentaires de la Vie Religieuse, Paris, 1912.
GINSBERG, M., Reason and Unreason In Society, Londres, 1947.
GRNBECH, V., The Culture of the Teutons, 2 vols, Copenhague et Londres, 1931.
HOBHOUSE, L. T., Morals in Evolution, Londres, 1906.
HUBERT, H. et MAUSS, M., Esquisse d'une thorie gnral- de la Magie, l' Anne
Sociologique , T. VII, Paris, 1902-3.
LVY-BRUHL, Les fonctions mentales dans les Socits infrieures, Paris, 1912. La
mentalit primitive, Paris, 1922.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
91
LVI-STRAUSS, C., Les Structures lmentaires de la Parent, Paris 1949.
LOWIE, R. H., Primitive Society, Londres, 1920. Trait de Sociologie Primitive,
Payot, Ire dit., 1935, rdition 1969.
MACIVER, R. M., Society, Londres, 1937.
MALINOWSKI, B., Magic, Science and Religion and other Essays, Glencoe
(Illinois), 1948.
MARETT, R. R., The Threshold of Religion, Londres, 1909.
MAUSS, M., Essai sur le Don, L'Anne Sociologique , N. S. 1, Paris, 1923-4.
NIEBOER, H. J., Slavery as an Industrial System, La Haye, 1900.
RADCLIFFE-BROWN, A. R., The Social Organization of Australian Tribes (
Oceania Monographs , No. 1), Melbourne, 1931. Structure and Function in
Primitive Society - Essays and Addresses, Londres.
RIVERS, W. H. R., Kinship and Social Organization, Londres, 1914. Social
Organization, Londres, 1926.
SIMMEL, Georg, Soziologie, Leipzig, 1908.
TAWNEY, R. H., Religion and the Rise of Capitalism, Londres, 1926.
TEGGART, F. J., Theory of History, New Haven, 1925.
VAN GENNEP, A., Les Rites de Passage, Paris, 1909.
VINEGRADOFF, Sir Paul, English Society in the Eleventh Century, Oxford, 1908.
Outlines of Historical Jurisprudence, Oxford, 1920.
WEBER, Max, Wirtschaft und Gesellschaft, 1921-23.
WIESE, Leopold von, Allgemeine Soziologie, Munich et Leipzig, 1924.
MONOGRAPHIES
ARENSBERG, Conrad M., et KIMBALL, Solon T., Family and Community in
Ireland, Cambridge, Mass., 1940.
BROWN, A. R., The Andaman Islanders, Cambridge, 1922.
DRAKE, St Clair, et CAYTON, Horace R., Black Metropolis, New York, 1945.
EVANS-PRITCHARD, E. E., Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande,
Oxford, 1937. The Nuer, Oxford, 1940.
FIRTH, Raymond, We, the Tikopia, Londres, 1936.
FORTES, M. The Dynamics of Clanship among the Tallensi, Oxford, 1945. The Web
of Kinship among the Tallensi, Oxford, 1949.
FORTUNE, R. F., Sorcerers of Dobu, Londres, 1932.
HUNTER, Monica, Reaction to Conquest, Londres, 1936.
JUNOD, H. A., The Life of a South African Tribe, 2 vol, Neuchtel et Londres, 191213.
KUPER, Hilda, An African Aristocracy : Rank among the Swazi, Oxford, 1947.
LAFITAU, Joseph Franois, Murs des Sauvages Ameriquains, Paris, 1724.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
92
MALINOWSKI, B., Argonauts of the Western Pacifi, Londres, 1922; Crime and
Custom in Savage Society, Londres, 1926; Coral Gardens and their Magic,
Londres, 1935. Trad. fran. Les Argonautes du Pacifique occidental,
Gallimard, 1963. Trois Essais sur la vie sociale des primitifs. Payot, Paris,
1968.
MEAD, Margaret, Coming of Age in Samoa, Londres, 1929. Growing up in New
Guinea, Londres, 1935.
NADEL, S. F., A Black Byzantium, Oxford, 1942.
PERISTIANY, H. G., The Social Institution of the Kipsigis, 1939.
RATTRAY, R. S., Ashanti Law and Constitution, Oxford, 1929.
REDFIELD, Robert, The Folk Culture of Yucatan, 1941.
RIVERS, W. H. R., The Todas, Londres, 1906.
SCHAPERA, I., A Handbook of Tswana Law and Custom, Oxford, 1938. Married
Life in an African Tribe, Oxford, 1940.
SELIGMAN, C. G. et B. Z., The Veddas, Cambridge, 1911.
SMITH, E. W., et DALE, A. M., The Lila-Speaking Peoples of Northern Rhodesia,
Londres, 1920.
SPENCER, Sir Baldwin, et GILLEN, F. J., The Arunta, 2 vols, Londres, 1927.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
93
POSTFACE
par Michel PANOFF
Retour la table des matires
Probablement Evans-Pritchard est-il seulement, pour de nombreux ethnologues
franais, l'auteur d'un admirable livre, The Nuer (Oxford 1940) 1. Renomme non
point injuste, mais si haute qu'elle projette une ombre sur ses autres crits, et notamment cette Anthropologie sociale qui expose, l'intention d'un large public, ses vues
sur l'objet, l'histoire et les exigences scientifiques d'une discipline devenue fort la
mode.
Ce qui frappe d'abord dans le petit livre prsent ici, c'est l'extrme simplicit de
ton. A une poque o les ouvrages de sciences humaines se distinguent volontiers, en
France surtout, par la prciosit ou le penchant l'occultation, il y a l de quoi surprendre le lecteur, et peut-tre mme de le choquer s'il est press. Un public qui a pris
l'habitude de lectures difficiles se gardera mal d'une certaine dsinvolture en face d'un
texte qui n'exige pas d'effort particulier. Or c'est prcisment ici qu'il faut ouvrir lil.
On se tromperait, en tout cas, si l'on croyait que la radio a fait d'une ncessit
vertu : d'abord, parce que plusieurs des textes rassembls dans ce volume avaient t
publis dans des revues scientifiques avant d'tre repris sous la forme de causeries, et
en second lieu, parce que diverses missions culturelles de l'O.R.T.F. ont dmontr
que la simplicit n'est pas une consquence ncessaire du recours ce moyen
d'expression. Il faut donc admettre que le style d'Anthropologie sociale ne rsulte ni
d'un calcul ni d'un accident, mais exprime quelque chose de plus profond - une manire directe et grave d'affronter un grand sujet, comme celle qui caractrisait l'enseignement de Jacob Burckhardt Ble.
1
Traduction franaise Les Nuer, Gallimard, 1969.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
94
Dlimitant dans le premier chapitre le champ de recherches propre l'anthropologie sociale, Evans-Pritchard examine les relations de cette discipline avec ses voisines (linguistique, archologie, gographie humaine, etc.). Mais c'est la distinction
entre ethnologie et anthropologie sociale qui retient surtout son attention. Habitu
entendre ces deux appellations utilises couramment l'une pour l'autre, le lecteur
franais risque d'tre quelque peu drout. Il faut donc prciser que l'usage s'est
fermement tabli en Grande-Bretagne de rserver une acception diffrente chacune
des deux, l'ethnologie s'occupant de classer historiquement les peuples sur la base de
leurs traits raciaux et culturels, tandis que l'anthropologie sociale tudie les comportements sociaux ainsi que les relations entre les diverses institutions travers
lesquelles ils se manifestent.
Un semblable problme apparat encore dans le mme chapitre avec l'opposition
entre culture et socit, thme qui a fait l'objet de trs vives controverses et qui se
trouve ainsi introduit sans tapage ni clins dil entendus. Au vrai, il ne s'agit plus
d'une question de dnominations comme dans le cas prcdent, mais d'un choix
faire entre deux orientations distinctes et dont les implications thoriques ne sont pas
ngligeables. Les socits qui relvent de la recherche anthropologique peuvent tre
tudies, en effet, de deux manires diffrentes : soit dans leurs uvres (outils, techniques, rites, etc.) dont l'ensemble constitue leur culture propre, soit dans leur
organisation et leur fonctionnement, et c'est ds lors la socit, en tant que telle, qui
vient au premier plan. Pendant plusieurs dcennies la premire dmarche a t
associe une vision statique et un certain atomisme , tandis que la seconde
insistait sur le dynamisme et l'inter-dpendance des phnomnes tudis. Toutefois le
dbat a perdu de son acuit depuis que ceux qui donnent la culture une place
privilgie dans leurs recherches ont cess de s'intresser une institution, la couvade
ou la sorcellerie par exemple, indpendamment de la socit qui l'a produite. A cet
gard, la comparaison, tablie par l'auteur au chapitre 4, entre l'expdition Haddon de
1898 et le travail de Malinowski sur le terrain fait voir, de manire saisissante, le
changement de perspective intervenu en l'espace de vingt ans. D'une collecte hautement slective des faits, tributaire de la tradition du cabinet de curiosits , on en
est venu une exigence de totalit qui s'impose galement aux deux tendances de
l'anthropologie. De nos jours, le primat culturel et le primat sociologique refltent
surtout des prfrences personnelles : non seulement les deux points de vue qui leur
correspondent sont ncessairement complmentaires, mais les travaux qui se
rclament de l'un ou de l'autre se ressemblent comme les versions d'une mme mlodie crite dans deux registres diffrents. Il reste cependant que des traditions nationales perptuent cette ligne de clivage dans les pays o l'anthropologie a atteint son
plus grand dveloppement. Ainsi les Amricains sont-ils volontiers culturalistes
alors que l'orientation sociologique jouit au contraire d'une grande faveur en
Angleterre et dans les pays d'influence britannique. Evans-Pritchard, pour sa part,
dfend cette dernire tendance, mais on notera avec quelle retenue il exprime ses
prfrences, et combien sont pratiques, et modestes en dfinitive, les raisons qui les
fondent.
Hritier des grands fondateurs de l'cole anglaise, Evans-Pritchard doit tre situ
par rapport la tradition naturaliste qui a exerc une influence si profonde dans son
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
95
pays. Ce qu'il dit, au chapitre 3, des notions de structure et de fonction permettra
notamment d'apprcier son originalit vis--vis de ses devanciers et de certains de ses
contemporains. Longtemps les anthropologues britanniques ont revendiqu pour leur
discipline une place parmi les sciences naturelles, nombre d'entre eux ayant d'ailleurs
reu, au dbut, une formation de naturaliste. A l'origine de cette attitude qui apparat
comme trs voulue, il y a eu une raction saine la fois contre l' atomisme des
premiers partisans de l'anthropologie culturelle et contre les rationalisations a priori
de la philosophie sociale. Ainsi l'ide s'est-elle impose de traiter socits et cultures
comme des organismes vivants, c'est--dire comme une ralit dont l'tude ne saurait
tre entreprise que par les mthodes propres aux sciences naturelles, l'observation et
la dmarche inductive en particulier. Or, si Evans-Pritchard reconnat pleinement la
dette de l'anthropologie moderne l'gard du fonctionalisme, il n'en dnonce pas
moins ses travers avec une clart qui ne passera pas inaperue. Critiquant les navets
thoriques du fonctionnalisme, Lvi-Strauss crivait en 1949 : Dire qu'une socit
fonctionne est un truisme, mais dire que tout, dans une socit, fonctionne est une
absurdit 1. On notera que c'est en des termes semblables et peu prs au mme
moment qu'Evans-Pritchard parlait des platitudes et des tautologies quoi se
rduisent les gnralisations thoriques tentes par le fonctionnalisme. Les
fonctionnalistes n'ayant pas russi davantage dmontrer qu'un systme social est
effectivement comparable un systme physiologique, notre auteur conclut que
l'anthropologie sociale doit prendre ses distances vis---vis des sciences naturelles et
se tracer une voie indpendante.
Malgr son invitable brivet, la discussion de la notion de structure est tout
aussi instructive. Certes, on y chercherait en vain une rponse anticipe au problme
pos, deux ans plus tard, par l'ide lvi-straussienne d' ordre des ordres 2, et il
faudrait avoir perdu de vue le propos de ce petit livre pour s'en tonner. Fidle aux
objectifs qu'il s'est assigns en commenant ses confrences la radio, EvansPritchard prsente la fin du premier chapitre une dfinition prliminaire de la notion
de structure. Ce qu'il faut souligner ici, c'est qu'il s'agit d'une dfinition minimum,
dont les termes, volontairement gnraux, devraient rencontrer l'agrment de tous les
anthropologues. De fait, on ne voit gure, malgr les divergences d'opinions qui se
doublent trop souvent de conflits de personnes, comment elle pourrait tre srieusement rejete. Il s'y trouve pourtant une affirmation trs nette - la structure est une
abstraction - dont l'importance thorique n'apparatra pleinement qu'une trentaine de
pages plus loin. On devra attendre en effet que l'auteur dcrive, au chapitre 3, les
conceptions anthropologiques de ces cinquante dernires annes pour voir ce qui le
spare de ses prdcesseurs et mme de quelques contemporains. Il suffit de rappeler,
par exemple, que pour Radcliffe-Brown, qui fut l'un des matres d'Evans-Pritchard, la
structure sociale n'est nullement une abstraction mais possde, au contraire, une
existence empirique au sein mme de la ralit sociale. A l'oppos, on peut citer,
l'intention du lecteur franais, le sociologue Gurvitch, plus l'aise dans l'abstraction
que dans l'examen des faits, qui soutenait nagure que la ralit concrte des socits
tudies par l'anthropologue se rduit leur structure. Entre ces deux imprialismes
intellectuels qui, par des voies inverses, se refusent galement distinguer entre
1
2
C. Lvi-Strauss, Anthropologie structurale, p. 17.
C. Lvi-Strauss, op. cit., pp. 347-349.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
96
ralit empirique et concepts, la position d'Evans-Pritchard frappera par sa rigueur.
On remarquera notamment qu' l'encontre de certains thoriciens tels que Gurvitch, il
a constamment en vue une pluralit de structures dans chaque cas de socit tudie,
point qu'il mentionne expressment en plusieurs passages de ce livre.
Cette double discussion des notions de fonction et de structure permet finalement
l'auteur d'exposer avec la plus grande fermet ce qu'est, selon lui, la vise spcifique
de l'anthropologie sociale : L'anthropologie sociale traite les socits comme des
systmes symboliques et non comme des systmes organiques, elle s'occupe moins
du procs des phnomnes que de leur configuration et, par consquent, ce qu'elle
s'efforce de dcouvrir, ce sont des structures et non des lois (...), elle interprte plutt
qu'elle n'explique (p. 82). Il n'est pas, de par le monde, un seul structuraliste,
quelque cole qu'il appartienne, qui hsiterait se rallier un tel programme. Et
propos de ralliements justement, ne doit-on pas signaler ceux qui sont monts dans
le train ces dernires annes qu'il y a l une source rarement cite de la thorie mme
dont ils se font dsormais les champions? Mais cette citation d'Evans-Pritchard doit
aussi retenir notre attention pour une seconde raison. Comme il est invitable dans
tout phnomne de cette ampleur, l'engouement extraordinaire dont bnficie - ou
souffre? - le structuralisme en France a dj provoqu plusieurs malentendus sur des
concepts fondamentaux et rien ne garantit que de semblables erreurs d'interprtation
ne viendront pas s'interposer, leur tour, entre le lecteur et le texte prsent ici. C'est
surtout, semble-t-il, le mot lois , utilis par Evans-Pritchard, qui risque de prter
confusion dans un rapprochement ventuel avec les ides de Lvi-Strauss. Il importe
donc de rappeler que Lvi-Strauss, quand il lui arrive de parler de lois, se rfre
toujours aux lois de transformation logique d'un systme en un autre, ou encore,
comme il a pu le dire d'une manire plus relche, aux lois de fonctionnement de
l'esprit humain . Et on se souviendra, cet gard, qu'il a accept de voir sa conception qualifie de no-kantisme . Or il s'agit de tout autre chose lorsque EvansPritchard nie que l'anthropologie puisse ou doive dcouvrir des lois. La tentation qu'il
repousse ici est celle du fonctionnalisme : chercher formuler des lois au sens o
l'entendent biologistes et physiciens. C'est d'ailleurs ce que confirme et illustre
l'apprciation porte sur le rle et les limites de l'anthropologie applique (chapitre
6). Allant au cur du dbat, l'auteur se demande en effet s'il est possible de mettre
l'anthropologie au service de l'art de gouverner et d'duquer, de la mme manire que
le mdecin et l'ingnieur utilisent les acquisitions de la biologie et de la physique la
solution de problmes pratiques. Et sa rponse est rsolument ngative, car, prcise-til, l'anthropologie est incapable de nous fournir les lois qui, seules, permettraient
l'laboration des techniques appropries.
En marquant toute l'actualit de ces aperus thoriques, comme la modestie
d'Evans-Pritchard obligeait le faire, on est assurment fort loin d'avoir puis la
richesse d'Anthropologie sociale. On en donnera seulement deux exemples.
C'est l'honneur de la tradition britannique d'avoir mis l'enqute sur le terrain
au premier plan de la recherche anthropologique et on ne s'tonnera donc pas de
l'autorit avec laquelle l'auteur en parle au chapitre 4. On sera peut-tre surpris, par
contre, de le voir conclure en affirmant que l'anthropologue doit exprimer un jugement moral dans l'image qu'il donne de la socit tudie, et, un peu plus loin, qu'il
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
97
convient de considrer l'anthropologie comme un art. Voil une opinion, prvoit
Evans-Pritchard, qui ne sera pas partage par tous les membres de la profession. De
fait, il est naturel que l'anthropologie, science encore trs jeune, soit impatiente d'tre
prise au srieux par les reprsentants de disciplines plus anciennes, et qu'elle dtourne
les yeux de tous les signes qui pourraient dnoncer son manque de maturit. Aussi
des mots comme jugements de valeur et art passent-ils souvent pour dsobligeants. Je ne pense pas pourtant que ce soit renoncer aux exigences de rigueur
scientifique que de reconnatre franchement la part d'aventure personnelle qui entre
dans toute enqute sur le terrain, bien au contraire. Et il faut mme aller plus loin : si,
comme le dit Lvi-Strauss 1, l'objet propre de l'anthropologie consiste rechercher les
carts diffrentiels entre la civilisation de l'observateur et la civilisation de l'observ, on ne voit pas au nom de quoi les valeurs devraient tre tenues l'cart d'une
telle confrontation. Certes, les anthropologues ne sauraient tre rendus seuls responsables de cette autocensure trs particulire; le nihilisme qui domine la civilisation
laquelle ils appartiennent n'y est pas tranger. Mais il faut bien voir que ce qui fait
l'originalit de l'anthropologie, ce n'est nullement la rcusation du point de vue de
l'observateur par lui-mme, mais l'expression du point de vue de l'observ en face de
celui de l'observateur. A condition que ses attendus soient clairement avous et
soumis une autocritique, un jugement de valeur ne recle rien qui puisse effaroucher un esprit scientifique.
Le second exemple se rapporte au thme de l'anthropologie applique. Qu'est-ce
que l'anthropologie applique? Un centaure , comme Jacob Burckhardt le disait de
la philosophie de l'histoire, c'est--dire une contradiction dans les termes : telle est,
me semble-t-il, la rponse la plus raisonnable. Mais voyons plutt comment EvansPritchard dfinit sa position en face de ce sujet. Le chapitre 6 rserve au lecteur trois
impressions distinctes dont la succession ne manquera pas de le frapper fortement. Il
sera sensible d'abord un ton mesur, non point indiffrent mais serein, qui contraste
avec le fracas de certains plaidoyers pour l'anthropologie applique. En second lieu, il
sera confront l'exprience d'un homme dont les recherches ont t, plusieurs fois,
commandites par les autorits coloniales, et qui se flicite de cette forme de collaboration dans la mesure o il avait entirement carte blanche. Enfin, le jugement au
fond : aux Europens qui vivent parmi les peuples coloniaux et y exercent des fonctions de responsabilit l'anthropologie est incapable de donner quelque recette que ce
soit; elle peut tout juste leur faire prendre conscience de certains problmes et, par l,
leur viter de commettre des erreurs grossires. A quoi l'auteur ajoute : comme un
anthropologue digne de ce nom ne russira jamais s'intresser srieusement aux
problmes pratiques qui proccupent le missionnaire ou l'administrateur, il faut que
les pouvoirs publics acceptent d'encourager la recherche fondamentale avec le simple
espoir d'en tirer profit indirectement, grce une meilleure connaissance des phnomnes. Ainsi les trois impressions qui viennent d'tre distingues se combinent-elles
pour emporter la conviction du lecteur : c'est son exprience personnelle, pourtant
effectue dans des conditions meilleures que ce n'est souvent le cm, qui permet
Evans-Pritchard de dire non, avec tant de calme, aux chants de sirnes de l'anthropologie applique. Si l'on se rappelle que ce chapitre sans complaisance ni dsir de
provocation reprend le texte d'une confrence adresse un auditoire qui comprenait
1
C. Lvi-Strauss, op. cit., p. 358.
E. E. Evans-Pritchard (1950) Anthropologie sociale
98
des lves-administrateurs du Colonial Office, on aura un exemple de ce qu'est la
rectitude d'esprit. Et probablement enviera-t-on les tudiants et les jeunes chercheurs
qui ont ou la chance d'tre guids par un tel matre.
Il existe sur les instruments topographiques un trait de repre appel ligne de
foi et qui permet l'oprateur de trouver, malgr les conditions les plus dfavorables, la position requise pour effectuer ses vises correctement. C'est vers EvansPritchard que l'esprit la recherche d'une ligne de foi devra se tourner s'il entend
chapper au tumulte qui entoure l'anthropologie aujourd'hui.
Michel PANOFF.
Vous aimerez peut-être aussi
- Eschyle Les 4 Elements Dans Les PersesDocument15 pagesEschyle Les 4 Elements Dans Les PersesmosesmendelssohnPas encore d'évaluation
- RESSOURCE L Oeil Du LoupDocument22 pagesRESSOURCE L Oeil Du LoupAurore Letellier100% (1)
- Beaux ArtDocument156 pagesBeaux ArtAnonymous Uxt2SWOHA5100% (2)
- EE. Evans Pritchard, La Femme Dans Les Sociétés PrimitivesDocument191 pagesEE. Evans Pritchard, La Femme Dans Les Sociétés PrimitivesMari-Sol García SomozaPas encore d'évaluation
- Comment Philosopher en Afrique Aujourd'Hui (PDFDrive)Document126 pagesComment Philosopher en Afrique Aujourd'Hui (PDFDrive)Raïs MahoungouPas encore d'évaluation
- Michel Foucault Préface Histoire de La Folie 1961Document9 pagesMichel Foucault Préface Histoire de La Folie 1961Michel GalabruPas encore d'évaluation
- Joris-Karl Huysmans - A ReboursDocument166 pagesJoris-Karl Huysmans - A Reboursbublik_fedeaPas encore d'évaluation
- Jean Delumeau Entretiens PDFDocument18 pagesJean Delumeau Entretiens PDFthiagoPas encore d'évaluation
- Kant Dessin PDFDocument20 pagesKant Dessin PDFTête de GirafePas encore d'évaluation
- Bernard Sichere Cinquante Ans de Phi Lo Sophie FrancaiseDocument31 pagesBernard Sichere Cinquante Ans de Phi Lo Sophie FrancaisemarxpauloPas encore d'évaluation
- EVANS-PRITCHARD, Edward Evans. La Femme Dans Le PrimitivesDocument191 pagesEVANS-PRITCHARD, Edward Evans. La Femme Dans Le PrimitivesJefferson Virgílio100% (1)
- Latin, Grec Et SociolinguistiqueDocument6 pagesLatin, Grec Et SociolinguistiquearthrakiaPas encore d'évaluation
- Chrysippe À L'académieDocument21 pagesChrysippe À L'académieMaxime PorcoPas encore d'évaluation
- Philosophie A GregDocument44 pagesPhilosophie A GregعبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- Il Cern Cce:: D'Oue Signifie S'orienterDocument228 pagesIl Cern Cce:: D'Oue Signifie S'orienterRomain BernardPas encore d'évaluation
- Semiologie Picturale Marin PDFDocument11 pagesSemiologie Picturale Marin PDFjanfalPas encore d'évaluation
- Vernant Les Origines de La Pensee GrecqueDocument10 pagesVernant Les Origines de La Pensee GrecqueAblaye100% (2)
- Raymond Bayer - Esthétique Et DialectiqueDocument6 pagesRaymond Bayer - Esthétique Et DialectiquethalesleloPas encore d'évaluation
- Cours Sur AuschwitzDocument3 pagesCours Sur AuschwitzMorteza KhakshoorPas encore d'évaluation
- La Théorie de La Justice Selon Hume, Bentham Et Rawls (PDFDrive)Document28 pagesLa Théorie de La Justice Selon Hume, Bentham Et Rawls (PDFDrive)MounirPas encore d'évaluation
- Esthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Document661 pagesEsthétique Propre. La Mise en Administration Des Graffitis À Paris de 1977 À 2017Paris Tonkar magazinePas encore d'évaluation
- Yvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementDocument24 pagesYvon Belaval (25 Novembre 1961) L'Histoire de La Phi Lo Sophie Et Son EnseignementALBERTO PAULO NETOPas encore d'évaluation
- Texte Reçu GrecDocument498 pagesTexte Reçu GrecJean leDucPas encore d'évaluation
- AGAMBEN, La Communauté Qui Vient, Théorie de La Singularité Quelconque, PDFDocument3 pagesAGAMBEN, La Communauté Qui Vient, Théorie de La Singularité Quelconque, PDFHammadi Abid100% (1)
- Esthetique de La Vie OrdinaireDocument269 pagesEsthetique de La Vie OrdinaireNadjaPas encore d'évaluation
- Philosophes Contemporains - Gabriel Marcel, Maurice - Tilliette, Xavier - 1962 - Paris, Desclée de Brouwer - Anna's ArchiveDocument120 pagesPhilosophes Contemporains - Gabriel Marcel, Maurice - Tilliette, Xavier - 1962 - Paris, Desclée de Brouwer - Anna's ArchiveRebèl Jan Batis ViksamaPas encore d'évaluation
- Cl. Burgelin, Lire L'idiot de La FamilleDocument11 pagesCl. Burgelin, Lire L'idiot de La FamilleAnonymous va7umdWyhPas encore d'évaluation
- Les Premiers PhilosophesDocument373 pagesLes Premiers PhilosophesjeanmariepaulPas encore d'évaluation
- La Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Document166 pagesLa Revue Socialiste N°57 - Mars 2015Parti socialistePas encore d'évaluation
- Lectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFDocument1 pageLectures de La République de Platon 3-4 - Le Philosophe-Roi PDFjose fernandezPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs. EichendorffDocument35 pagesGeorg Lukacs. EichendorffJean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- Pourquoi Michel Foucault Est PartoutDocument5 pagesPourquoi Michel Foucault Est PartoutDoriana VictoriaPas encore d'évaluation
- Anthropo Et Lumières PDFDocument232 pagesAnthropo Et Lumières PDFduel9Pas encore d'évaluation
- Colas Duflo-Jouer Et PhilosopherDocument269 pagesColas Duflo-Jouer Et PhilosopherFeker YoussefPas encore d'évaluation
- (Szilasi) Philo Allemande ActuelleDocument10 pages(Szilasi) Philo Allemande Actuellefoutre21Pas encore d'évaluation
- Philosophie Des Formes SymboliquesDocument14 pagesPhilosophie Des Formes SymboliquesMohamed GuersPas encore d'évaluation
- Géographie Et Littérature. Une Synthèse HistoriqueDocument31 pagesGéographie Et Littérature. Une Synthèse HistoriqueThaís Arruda FerreiraPas encore d'évaluation
- Mythe de LetheDocument15 pagesMythe de Lethesenhorcao100% (1)
- Mythe, Symbole, MythanalyseDocument8 pagesMythe, Symbole, Mythanalysesalim bachiPas encore d'évaluation
- Du Mythe A La Raison J.P.vernantDocument25 pagesDu Mythe A La Raison J.P.vernantJorge Carrillo100% (1)
- Bouveresse - Cours Systemes PhilosophiquesDocument319 pagesBouveresse - Cours Systemes PhilosophiquesTiffany Davis100% (1)
- Proc 12 Kha TibiDocument33 pagesProc 12 Kha TibiAdil KorchiPas encore d'évaluation
- Paradoxe Socratique Et Anti-Intellectualisme de Platon Par LaetitiaDocument13 pagesParadoxe Socratique Et Anti-Intellectualisme de Platon Par LaetitiaUgo BatiniPas encore d'évaluation
- Recueil Des Sujets PhilosophieDocument919 pagesRecueil Des Sujets PhilosophieRodrigo Carneiro Da SilvaPas encore d'évaluation
- Barthes 1968 Lecon D'ecriture (34 Tel Quel 28)Document6 pagesBarthes 1968 Lecon D'ecriture (34 Tel Quel 28)Dre LockhartPas encore d'évaluation
- Recueildetextesl00ernouoft PDFDocument316 pagesRecueildetextesl00ernouoft PDFMllzPas encore d'évaluation
- De Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieDocument33 pagesDe Rousseau À Annie Ernaux: Mobiles, Modèles Et Mutations de L'autobiographieTiti SuruPas encore d'évaluation
- Pirenne Melanges BorgeaudDocument24 pagesPirenne Melanges Borgeaudguynahas3845Pas encore d'évaluation
- Programme Du Colloque Philosophie Et LangagesDocument2 pagesProgramme Du Colloque Philosophie Et LangagesMariyem BenjarfiPas encore d'évaluation
- Georges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)Document40 pagesGeorges Balandier - La Situation Coloniale-Approche Théorique (1951)odradeck76100% (1)
- Michel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Document17 pagesMichel Foucault. La Peinture de Manet. Conférence À Tunis, Le 20 Mai 1971. Résumé Avec Illustrations.Veronikaoltre100% (1)
- Pour Une Topologie Sociale (Bonnin) (Communications) PDFDocument22 pagesPour Une Topologie Sociale (Bonnin) (Communications) PDFRodrigo BuenaventuraPas encore d'évaluation
- Henri Lefebvre - Sociologie de Marx (1974, Presses Universitaires de France PUF)Document174 pagesHenri Lefebvre - Sociologie de Marx (1974, Presses Universitaires de France PUF)AhmedZaidiPas encore d'évaluation
- Aby Warburg - Production Symbolique PDFDocument16 pagesAby Warburg - Production Symbolique PDFMuro CasteloPas encore d'évaluation
- Pierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesDocument32 pagesPierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesPierrePachetPas encore d'évaluation
- Ironies Entre Dualite Et Duplicite Ed. P PDFDocument313 pagesIronies Entre Dualite Et Duplicite Ed. P PDFNaty JaraPas encore d'évaluation
- L.-F. Schön, Philosophie Transcendantale Ou Système D'emmanuel Kant, Abel Ledoux, Paris, 1831Document405 pagesL.-F. Schön, Philosophie Transcendantale Ou Système D'emmanuel Kant, Abel Ledoux, Paris, 1831Portail philosophiquePas encore d'évaluation
- Ecrire L'histoireDocument14 pagesEcrire L'histoireZobel ClemensPas encore d'évaluation
- Regard, espaces, signes - Victor Segalen: Actes du colloqueD'EverandRegard, espaces, signes - Victor Segalen: Actes du colloquePas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Catalogue Formations Burkina Mali - Aout 2014Document124 pagesCatalogue Formations Burkina Mali - Aout 2014Alfred OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- Thébert Yvon. A.-G. Hamman, La Vie Quotidienne en Afrique Du Nord Au Temps de Saint AugustinDocument4 pagesThébert Yvon. A.-G. Hamman, La Vie Quotidienne en Afrique Du Nord Au Temps de Saint Augustinfouzia messaiPas encore d'évaluation
- CharlotteDocument5 pagesCharlotteMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Thèse Sur LotissementDocument262 pagesThèse Sur LotissementMariyon AKOZEPas encore d'évaluation
- Galland - Enrichissements A YaoundeDocument219 pagesGalland - Enrichissements A YaoundeChristian Nelson EyoumPas encore d'évaluation
- Cours Sur La ColonisationDocument14 pagesCours Sur La ColonisationOlivier MonnotPas encore d'évaluation
- Burkina Faso Stratégie Secteur-ÉnergieDocument71 pagesBurkina Faso Stratégie Secteur-ÉnergieSiaka Emmanuel Isaac KONEPas encore d'évaluation
- Revue Approfondie Du Secteur Horticole de Côte D'ivoireDocument90 pagesRevue Approfondie Du Secteur Horticole de Côte D'ivoireNBanan OUATTARAPas encore d'évaluation
- Rir 2022Document121 pagesRir 2022marcel weussouabePas encore d'évaluation
- Snake Bite GuideDocument1 pageSnake Bite GuideDjoufackPas encore d'évaluation
- Architecture Domestique Et Vie PrivéeDocument16 pagesArchitecture Domestique Et Vie PrivéeZeineb MahfoudhiPas encore d'évaluation
- Des Usages Du Soft Power Religieux Du MaDocument11 pagesDes Usages Du Soft Power Religieux Du MaTariq KiassiPas encore d'évaluation
- API IC - IMP.CSBC - CD DS2 FR Excel v2 729131Document33 pagesAPI IC - IMP.CSBC - CD DS2 FR Excel v2 729131EL MAOULI ZAKARIAPas encore d'évaluation
- كتاب فرنسية مقرر جزائريDocument228 pagesكتاب فرنسية مقرر جزائريcherazer88% (8)
- Aufait 20100729Document20 pagesAufait 20100729Yassine TâalibiPas encore d'évaluation
- 1045 Mars 2022 LogistiqueDocument48 pages1045 Mars 2022 LogistiqueHanane AitPas encore d'évaluation
- Tycoon-N 3Document51 pagesTycoon-N 3Abdoulaye BakayokoPas encore d'évaluation
- Déc - 2022 - PRESENTATION - MONSIEUR - Vincent de Paul KABORE-1Document15 pagesDéc - 2022 - PRESENTATION - MONSIEUR - Vincent de Paul KABORE-1oumarouPas encore d'évaluation
- Bac A HG 2024. Aeemb.Document2 pagesBac A HG 2024. Aeemb.Jean Oscar BadoPas encore d'évaluation
- Pre HistoireDocument54 pagesPre HistoireVlad Florin TudosăPas encore d'évaluation
- Histoire Ancienne de L'afrique Du Nord (Volume 1) - Gsell, Stéphane, 1864-1932Document556 pagesHistoire Ancienne de L'afrique Du Nord (Volume 1) - Gsell, Stéphane, 1864-1932Ahmed BerrouhoPas encore d'évaluation
- La Palabre Et Les Mécanismes Connexes Contribution À L'enracinement de La Paix Dans L'afrique ActuelleDocument16 pagesLa Palabre Et Les Mécanismes Connexes Contribution À L'enracinement de La Paix Dans L'afrique ActuellePAMPas encore d'évaluation
- Evans-Pritchard Antropologie SocialeDocument98 pagesEvans-Pritchard Antropologie SocialeRoxyNicPas encore d'évaluation
- Etudes Et Travaux N° 76: La Chefferie Au Niger Et Ses TransformationsDocument27 pagesEtudes Et Travaux N° 76: La Chefferie Au Niger Et Ses TransformationsGustavoVargasMonteroPas encore d'évaluation
- Tipa-Chap2 FRDocument22 pagesTipa-Chap2 FRnovobanco2023Pas encore d'évaluation
- R20 2008 Commercialisation Manioc Vers Pays Limitrophe 2Document78 pagesR20 2008 Commercialisation Manioc Vers Pays Limitrophe 2Karel MontchoPas encore d'évaluation
- Module 2 NAPA 50 FR PDFDocument9 pagesModule 2 NAPA 50 FR PDFDiafarou MahamadouPas encore d'évaluation
- Orange Money DP BDDocument9 pagesOrange Money DP BDbandie.fofana9764Pas encore d'évaluation