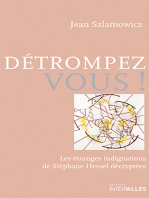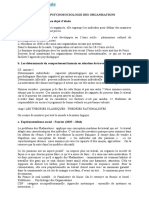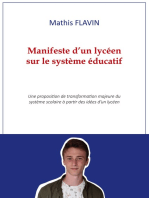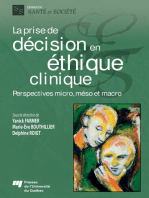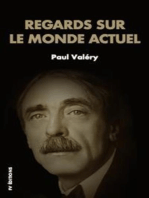Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Division Sexuelle Du Travail Et Rapports Sociaux de Sexe
Transféré par
31071978Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Division Sexuelle Du Travail Et Rapports Sociaux de Sexe
Transféré par
31071978Droits d'auteur :
Formats disponibles
DIVISION SEXUELLE DU TRAVAIL ET RAPPORTS SOCIAUX DE SEXE
Article du Dictionnaire critique du féminisme, Paris, PUF, 2000, p.35-44.
Les situations des hommes et des femmes ne sont pas le produit d’un destin biologique, mais sont d’abord des
construits sociaux. Hommes et femmes sont bien autre chose qu’une collection – ou que deux collections –
d’individus biologiquement distincts. Ils forment deux groupes sociaux qui sont engagés dans un rapport social
spécifique : les rapports sociaux de sexe. Ces derniers, comme tous les rapports sociaux, ont une base
matérielle, en l’occurrence le travail, et s’expriment à travers la division sociale du travail entre les sexes,
nommée, de façon plus concise :division sexuelle du travail.
La division sexuelle du travail
Cette notion a été d’abord utilisée par les ethnologues pour désigner une répartition « complémentaire » des
tâches entre les hommes et les femmes dans les sociétés qu’ils étudiaient ; ainsi, Lévi-Strauss en a fait le
mécanisme explicatif de la structuration de la société en famille. Mais ce sont des anthropologues femmes qui,
les premières, lui ont donné un contenu nouveau en démontrant qu’elle traduisait non une complémentarité des
tâches mais bien la relation de pouvoir des hommes sur les femmes (Mathieu, 1991a ; Tabet, 1998). Façonnée
dans d’autres disciplines comme l’histoire ou la sociologique, la division sexuelle du travail a pris, au fil des
travaux, valeur de concept analytique.
La division sexuelle du travail est la forme de division du travail social découlant des rapports sociaux de sexe ;
cette forme est modulée historiquement et sociétalement. Elle a pour caractéristiques l’assignation prioritaire
des hommes à la sphère productive et des femmes à la sphère reproductive ainsi que, simultanément, la
captation par les hommes des fonctions à forte valeur sociale ajoutée (politiques, religieuses, militaires, etc.).
Cette forme de division sociale du travail a deux principes organisateurs : le principe de séparation (il y a des
travaux d’hommes et des travaux de femmes) et le principe hiérarchique (un travail d’homme « vaut » plus
qu’un travail de femme). Ils sont valables pour toutes les sociétés connues, dans le temps et dans l’espace – ce
qui permet selon les un(e)s (Héritier-Augé, 1984), mais non selon d’autres (Peyre et Wiels, 1997), d’affirmer
qu’ils existent sous cette forme depuis le début de l’humanité. Ils peuvent être appliqués grâce à un procès
spécifique de légitimation, l’idéologique naturaliste. Celle-ci rabat le genre sur le sexe biologique, réduit les
pratiques sociales à des « rôles sociaux » sexués, lesquels renverraient au destin naturel de l’espèce.
Contradictoirement, la théorisation en termes de division sexuelle du travail affirme que les pratiques sexuées
sont des construits sociaux, eux-mêmes résultats des rapports sociaux.
Pour autant, pas plus que les autres formes de division du travail, la division sexuelle du travail n’est un donné
rigide et immuable. Si ses principes organisateurs restent les mêmes, ses modalités (conception du travail
reproductif, place des femmes dans le travail marchand, etc.) varient fortement dans le temps et l’espace. Les
apports de l’histoire et de l’anthropologie l’ont amplement démontré : une même tâche, spécifiquement
féminine dans une société ou dans une branche industrielle, peut être considérée typiquement masculine dans
d’autres (Milkman, 1987). Problématiser en termes de division sexuelle du travail ne renvoie donc pas à une
pensée déterministe ; au contraire, il s’agit de penser la dialectique entre invariants et variations, car si cette
démarche suppose de débusquer les phénomènes de reproduction sociale, elle implique simultanément d’étudier
les déplacements et ruptures de celle-ci ainsi que l’émergence de nouvelles configurations pouvant
tendanciellement remettre en cause l’existence même de cette division.
De l’oppression aux rapports sociaux de sexe
Si la division sexuelle du travail a fait l’objet de travaux précurseurs dans de multiples pays (Madeleine
Guilbert, Andrée Michel, Viviane Isambert-Jamati…), c’est au début des années 1970 qu’il y eut en France,
sous l’impulsion du mouvement féministe, une vague de travaux qui allaient rapidement donner des assises
théoriques à ce concept.
Rappelons d’abord quelques faits : ce n’est pas sur l’avortement, comme on le dit trop souvent, qu’a démarré le
mouvement des femmes. C’est sur la prise de conscience d’une oppression spécifique : il devint alors
collectivement « évident » qu’une énorme masse de travail est effectuée gratuitement par les femmes, que ce
travail est invisible, qu’il est réalisé non pas pour soi mais pour d’autres et toujours au nom de l’a nature, de
l’amour ou du devoir maternel. Et la dénonciation (pensons au titre d’un des premiers journaux féministes
français : Le torchon brûle) se déploya sur une double dimension : « ras-le-bol » (c’était l’expression
consacrée) d’effectuer ce qu’il convenait bien d’appeler un « travail », que tout se passe comme sis on
imputation aux femmes, et à elles seules, aille de soi et qu’il ne soit ni vu, ni reconnu.
Très rapidement, les premières analyses de cette forme de travail apparurent dans les sciences sociales. Ce fut,
pour ne citer que deux corpus théoriques, le « mode de production domestique » (Delphy, 1974-1998à et le
« travail domestique » (Chabaud-Rychter et al., 1984). La conceptualisation marxiste – rapports de production,
classes sociales définies par l’antagonisme capital/travail, mode de production – était à l’époque prépondérante
dès lors que l’on se situait dans une mouvance de gauche ) et l’on sait que les féministes en faisaient partie dans
leur grande majorité (Picq, 1993).
Mais, peu à peu, les recherches se sont détachées de cette référence obligée pour analyser le travail domestique
comme activité de travail au même titre que le travail professionnel. Cela a permis de prendre en compte
simultanément l’activité déployée dans la sphère domestique et dans la sphère professionnelle, et l’on a pu
raisonner en termes de division sexuelle du travail.
Par une sorte d’effet boomerang, après que la « famille », sous la forme d’entité naturelle, biologique…, eut
volé en éclats pour apparaître prioritairement comme lieu d’exercice d’un travail, ce fut ensuite la sphère du
travail salarié, pensée jusqu’ici autour du seul travail productif et de la figure du travailleur mâle, qualifié,
blanc, qui implosa (Delphy et Kergoat, 1984).
Ce double mouvement donna lieu, dans de très nombreux pays, à une floraison de travaux qui utilisèrent
l’approche en termes de division sexuelle du travail pour repenser le travail et ses catégories, ses formes
historiques et géographiques, l’interrelation des multiples divisions du travail socialement produit. Ces
réflexions ont permis de remettre en chantier des concepts comme ceux de temps social (Langevin, 1997), de
qualification (Kergoat, 1982), de productivité (Hiarata et Kergoat, 1988) ou, plus récemment, de compétence.
La division sexuelle du travail eut donc, au départ, le statut d’articulation de deux sphères, comme l’indique le
sous—titre Structures familiales et système productif du Sexe du travail paru en 1984. Mais cette notion
d’articulation apparut vite insuffisante : les deux principes – séparation et hiérarchie – se retrouvant partout et
s’appliquant toujours dans le même sens, il fallut passer à un second niveau d’analyse : la conceptualisation de
ce rapport social récurrent entre le groupe des hommes et celui des femmes. Un atelier, l’APRE (Atelier
production reproduction), se tint régulièrement à partir de 1985 pour déboucher sur une table ronde
internationale : Les rapports sociaux de sexe : problématiques, méthodologies, champs d’analyse (Paris, 1987) ;
parallèlement, certaines des participantes publièrent en 1986 À propos des rapports sociaux de sexe. Parcours
épistémologiques, dans le cadre de l’ATEP du CNRS « Recherches féministes et recherches sur les femmes »
(Battagliola et al.).
Cependant, simultanément à ce travail de construction théorique, s’amorçait un déclin de la force subversive du
concept de division sexuelle du travail. Le terme est maintenant usuel dans le discours académique des sciences
humaines, et particulièrement en sociologie. Mais, la plupart du temps, il reste dépouillé de toute connotation
conceptuelle et ne fait que renvoyer à une approche sociographique qui décrit les faits, constate les inégalités,
mais n’organise pas ces données de façon cohérente. Enfin, le travail domestique, qui avait fait l’objet de
nombreuses études, n’est plus que rarement analysé : plus précisément, au lieu de se servir de ce concept pour
réinterroger la société salariale (Fougeyrollas-Schwebel, 1998), on en parle en termes de « double journée, de
« cumul » ou de « conciliation des tâches », comme s’il n’était qu’un appendice du travail salarié. D’où un
mouvement de déplacement et de focalisation sur ce dernier (les inégalités dans le travail, dans le salaire, le
travail à temps partiel…) et sur l’accès au politique (citoyenneté, revendication de parité…). Quant au débat en
termes de rapports sociaux (de sexe), il est assez largement délaissé.
On peut voir là les effets conjugués du chômage de masse et des « nouvelles formes d’emploi », de la poussée
du néo-libéralisme, du déclin numérique de la classe ouvrière traditionnelle, de la chute du mur de Berlin avec
ses conséquences politiques et idéologiques : le rabattement de l’analyse en termes de rapports sociaux sur la
seule logique économiques n’a épargné aucun secteur des sciences sociales.
Les rapports sociaux de sexe
La notion de rapport social a été, sauf exceptions notables (Godelier, 1984 ; Zarifian, 1997), peu travaillée en
tant que telle par les sciences sociales en France.
Le rapport social est, au départ, une tension qui traverse le champ social. Ce n’est donc pas quelque chose de
réifiable. Cette tension érige certains phénomènes sociaux en enjeux autour desquels se constituent des groupes
aux intérêts antagoniques. En l’occurrence, il s’agit ici du groupe social hommes et du groupe social femmes –
lesquels ne sont en rien confondables avec la bicatégorisation biologisante mâles/femelles.
Ces groupes sont donc en tension permanente autour d’un enjeu, ici le travail et ses divisions. C’est pourquoi
l’on peut avancer les propositions suivantes : rapports sociaux de sexe et division sexuelle du travail sont deux
termes indissociables et qui forment épistémologiquement système ; la division sexuelle du travail a le statut
d’enjeu des rapports sociaux de sexe.
Ces derniers sont caractérisés par les dimensions suivantes :
- la relation entre les groupes ainsi définis est antagoniques ;
- les différences constatées entre les pratiques des hommes et des femmes sont des construits sociaux, et
ne relèvent pas d’une causalité biologique ;
- ce construit social a une base matérielle et pas seulement idéologique – en d’autres termes, le
« changement des mentalités » ne se fera jamais spontanément s’il reste déconnecté de la division du
travail concrète –, on peut donc en faire un approche historique et le périodiser ;
- ces rapports sociaux reposent d’abord et avant tout sur un rapport hiérarchique entre les sexes ; il s’agit
là d’un rapport de pouvoir, de domination.
Ce rapport social a, par ailleurs, des caractéristiques singulières : il se retrouve, on l’a vu, dans toutes les
sociétés connues ; de plus, il es structurant pour l’ensemble du champ social et transversal à la totalité de ce
champ – ce qui n’est pas le cas, loin d’en faut, de l’ensemble des rapports sociaux. On peut donc le considérer
comme le paradigme des rapports de domination.
Du champ épistémologique à l’espace du politique
Nous l’avons vu, l’expression « division sexuelle du travail a des acceptions très différentes et ne fait que
renvoyer trop souvent à une approche descriptive. Certes, celle-ci a été et reste indispensable (par exemple, la
construction d’indicateurs fiables pour mesurer l’(in)égalité professionnelle hommes/femmes est un véritable
enjeu politique en France). Mais parler en termes de division sexuelle du travail, c’est aller bien au-delà du
simple constat d’inégalités : c’est articuler cette description du réel avec une réflexion sur les processus par
lesquels la société utilise cette différenciation pour hiérarchiser les activités.
Il y a débat sur le contenue de l’expression « rapports sociaux de sexe ». Pour en préciser les termes, rappelons
d’abord que la langue française a cet avantage de proposer deux mots : « rapport » et « relation ». L’un et
l’autre recouvrent deux niveaux d’appréhension de la sexuation du social. La notion de rapport social rend
compte de la tension antagonique se nouant en particulier autour de l’enjeu de la division du travail et qui
aboutit à la création de groupes sociaux ayant des intérêts contradictoires. La dénomination « relations
sociales » renvoie, elle, aux relations concrètes qu’entretiennent les groupes et les individus. Ainsi les formes
sociales « couple » ou « famille » telles qu’on peut les observer dans nos sociétés sont à la fois l’expression des
rapports sociaux de sexe configurés ici par le système patriarcal, dans le même temps qu’elles peuvent être
considérées comme des espaces d’interaction sociale qui vont eux-mêmes recréer du social et dynamiser
partiellement le procès de sexuation du social.
Insister sur l’antagonisme ou sur le lien correspond donc à deux postures de recherche qui deviennent
contradictoires quand on quitte le plan de l’observation pour passer à celui de l’épistémologie : ce sont les
rapports sociaux qui pré-configurent la société. Versus : c’est la multitude d’interactions qui, au sein d’un
univers brownien, crée, petit à petit, les normes, les règles… que l’on peut observer dans une société donnée. Et
c’est dans cette dernière perspective, relativement hégémonique dans les sciences sociales actuellement, que
l’on est amené à parler, par exemple, de complémentarité des tâches et, par voie de conséquence, à assigner
prioritairement aux femmes – et en toute « légitimité » - le travail à temps partiel.
On le voit, l’enjeu de ce débat n’est pas uniquement d’ordre épistémologique. Il est aussi d’ordre politique. Car
il s’agit bien : 1) de comprendre historiquement comment les rapports sociaux ont pris corps dans des
institutions et législations (le couple, la famille, la filiation, le travail, le Code civil, etc.) ayant pour fonction de
cristalliser tout en le légitimant l’état du rapport de force entre groupes à un moment donné (Scott, 1990) ; 2) de
déceler les nouvelles tensions générées dans la société et de chercher à comprendre comment elles déplacent les
enjeux et permettent donc potentiellement de délégitimer ces règles, normes et représentations qui présentent
les groupes sociaux constitués autour de ces enjeux comme des groupes « naturels ». Bref, c’est de pouvoir
penser l’utopie dans le même temps que l’on analyse le fonctionnement du social.
Dès lors, les groupes de sexe n’étant plus des « catégories » immuables, fixistes, a-historiques et a-sociales, on
peut périodiser le rapport qui les constitue l’un par l’autre (grâce à l’analyse de l’évolution des modalités des
enjeux sociaux), et l’on peut donc aborder le problème du changement) et non plus seulement de
l’aménagement – du social.
Ce point de vue, minoritaire dans les sciences sociales, reste cependant assez largement partagé par celles et
ceux qui travaillent sur la sexuation du social tout en reconnaissant l’oppression d’un sexe par un autre. Et cela,
depuis le début des années 1970 en France. Cependant, deux questions restent en débat :
- Faut-il centrer la réflexion sur les seuls rapports sociaux de sexe ou faut-il, au contraire, tenter de pense
l’ensemble des rapports sociaux dans leur simultanéité ? La tentation d’hégémoniser un seul rapport –
en l’occurrence le rapport social de sexe – est grande, ne serait-ce que pour tenter de combler le vide
quasi total en la matière. Et ces travaux, souvent brillants (pensons par exemple à ceux de Delphy,
Guillaumin, Mathieu…à, offrent de fait de puissants outils, nouveaux et explicatifs. Mais il reste
cependant certain que la seule prise en compte du rapport de domination hommes/femmes, et des luttes
contre celui-ci, reste insuffisante pour rendre intelligibles la diversité et la complexité des pratiques
sociales masculines et féminines.
- Le second débat – et l’on passe là de la construction de l’objet de recherche à l’interprétation des faits
observés – renvoie à la caractérisation du rapport social de sexe. Dans Le sexe du travail et dans les
travaux collectifs et individuels qui l’ont suivi, un large consensus s’exprime sur la transversalité des
rapports sociaux de sexe. Mais cette caractérisation est insuffisante si l’on n’y adjoint pas une autre
dimension : il y a interpénétration constante des rapports sociaux. Prenons l’exemple du mode de
production capitaliste : il s’est bâti sur la séparation des lieux et temps de la production et de la
reproduction ; quant à ce que nous appelons le « travail domestique », il est une forme historique
particulière du travail reproductif, forme inséparable de la société salariale. En d’autres termes, les
rapports sociaux sont consubstantiels.
Ce débat n’est pas réductible à une querelle scolastique : il renvoie à des positions analytiques fort
différentes tant d’un point de vue scientifique que d’un point de vue politique. Il devient ainsi impossible
d’isoler le travail ou l’emploi des femmes, il s’agit au contraire de convoquer simultanément, comme
éléments centraux explicatifs, l’évolution des rapports de sexe, de classe, et Nord/Sud : il en va de même
pour la famille, l’éclatement de ses formes sociales et les tentatives d’encadrement juridique ; ou de
l’évolution des formes de la virilité, de la parentalité ou des débats actuels sur l’immigration et le
regroupement familial.
C’est la consubstantialité des rapports sociaux qui permet de comprendre la nature des fortes turbulences
que traverse actuellement la division sexuelle du travail. Deux exemples :
- L’apparition et le développement, avec la précarisation et la flexibilisation de l’emploi, des
« nomadismes sexués » (Kergoat, 1998) : nomadisme dans le temps pour les femmes (c’est l’explosion
du travail à temps partiel associé trop souvent à des plages de travail éparpillées dans la journée et dans
la semaine) ; nomadisme dans l’espace pour les hommes (intérim, chantiers du BTP et du nucléaire pour
les ouvriers, banalisation et multiplication des déplacements professionnels en Europe et dans le monde
pour les cadres supérieurs). On voit bien là comment la division sexuelle du travail modèle les formes
du travail et de l’emploi et, réciproquement, comment la flexibilisation peut renforcer les formes les
plus stéréotypées des rapports sociaux.
- Le second exemple est celui de la dualisation de l’emploi féminin, qui illustre bien le croisement des
rapports sociaux. Depuis le début des années 1980, le nombre de femmes comptabilisées par l’INSEE
(enquêtes Emploi) comme « cadres et professions intellectuelles supérieures » a plus que doublé ; 10 %
environ des femmes actives sont actuellement classées dans cette catégorie. Simultanément à la
précarisation et à la pauvreté d’un nombre croissant de femmes (elles représentent 46 % de la
population active mais 52 % des chômeurs et 79 % des bas salaires), on assiste donc à l’augmentation
des capitaux économiques, culturels et sociaux d’une proportion non négligeable des femmes actives.
On voit ainsi apparaître, pour la première fois dans l’histoire du capitalisme, une couche de femmes
dont les intérêts directs (non médiés comme auparavant par les hommes : pères, époux, amants…)
s’opposent frontalement à celles touchées par la généralisation du temps partiel, les emplois de service
très mal rétribués et non reconnus socialement, et plus généralement par la précarité.
On peut ainsi travailler d’emblée sur la totalité du social sans s’essouffler à rechercher le « bon » rapport
social ou la « bonne » identité – individuelle ou collective : prendre en compte le fait que ces rapports
sociaux n’évoluent pas au même rythme dans le temps et dans l’espace permet de s’installer d’emblée dans
la complexité et le changement ; enfin, les catégories sociales – évidemment toujours définies par les
dominants – vont voler en éclats pour laisser place à un ensemble mouvant de configurations dans
lesquelles les groupes sociaux se font et se défont, les individus construisant leur vie à travers des pratiques
sociales souvent ambiguës et contradictoires.
→ Chômage – Éducation et socialisation – Famille – Mixité – Mouvements féministes – Précarisation sociale –
Travail (le concept de) – Travail domestique
Collectif, Le sexe du travail. Structures familiales et système productif, Grenoble, PUG, 1984, 320 p.
Daune-Richard Anne-Marie et Devreux Anne-Marie, « Rapports sociaux de sexe et conceptualisation
sociologique », in Recherches féministes, 1992, vol.5, n°2, p.7-30.
Kergoat Danièle, « À propos des rapports sociaux de sexe », in Revue M, avril-mai 1992, n°53-54, p.16-20.
Kergoat Danièle, « La division du travail entre les sexes », in Kergoat Jacques et al., Le monde du travail,
Paris, La Découverte, 1998, p.319-329.
Mathieu Nicole-Claude, « Critiques épistémologiques de la problématique des sexes dans le discours ethno-
anthropologique [1985a], in Mathieu Nicole-Claude, L’anatomie politique. Catégorisations et idéologies du
sexe, Paris, Côté femmes « Recherches », 1991a, p.75-127.
Scott Joan, « Genre : une catégorie utile d’analyse historique », in Les Cahiers du GRIF : « Le Genre de
l’histoire », 1998, n°37-38, p.125-153.
Tabet Paola, La construction sociale de l’inégalité des sexes : des outils et des corps, Paris, L’Harmattan
« Bibliothèque du féminisme », 1998, 206 p. [Textes de 1979 et 1985],
Danièle Kergoat
Vous aimerez peut-être aussi
- Violences envers les femmes: Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformationD'EverandViolences envers les femmes: Réalités complexes et nouveaux enjeux dans un monde en transformationPas encore d'évaluation
- BOURDIEU - Une Classe Objet (Artigo)Document5 pagesBOURDIEU - Une Classe Objet (Artigo)ultimaflordolacio9019Pas encore d'évaluation
- 1 - La SociologieDocument6 pages1 - La SociologieAmine BenslimanePas encore d'évaluation
- Sociologie Du GenreDocument38 pagesSociologie Du GenreSacha C100% (1)
- Le Créatorat: Un nouveau paradigme pour la vie en sociétéD'EverandLe Créatorat: Un nouveau paradigme pour la vie en sociétéPas encore d'évaluation
- Le droit à la paresse - Réfutation du «droit au travail» de 1848D'EverandLe droit à la paresse - Réfutation du «droit au travail» de 1848Pas encore d'évaluation
- Le travail et nous: Historiette et textes courts pour relativiser la valeur "Travail"D'EverandLe travail et nous: Historiette et textes courts pour relativiser la valeur "Travail"Pas encore d'évaluation
- Le travail à l'épreuve des nouvelles temporalitésD'EverandLe travail à l'épreuve des nouvelles temporalitésPas encore d'évaluation
- BOURDIEU. Domination Masculiner ResumeDocument11 pagesBOURDIEU. Domination Masculiner ResumefpadrianPas encore d'évaluation
- Profil ProfessionnelDocument8 pagesProfil ProfessionnelJoan ▲ Déborah LesturgiePas encore d'évaluation
- Voitures de société et mobilité durable: Diagnostic et enjeuxD'EverandVoitures de société et mobilité durable: Diagnostic et enjeuxPas encore d'évaluation
- L’avenir du travail en Afrique: Exploiter le potentiel des technologies numériques pour un monde du travail plus inclusifD'EverandL’avenir du travail en Afrique: Exploiter le potentiel des technologies numériques pour un monde du travail plus inclusifPas encore d'évaluation
- Référentiel du travail social hors murs: Dire les pratiques pour mettre en lumière collectivement un savoir-faire professionnelD'EverandRéférentiel du travail social hors murs: Dire les pratiques pour mettre en lumière collectivement un savoir-faire professionnelPas encore d'évaluation
- Détrompez-vous!: Les étranges indignations de Stéphane Hessel décryptéesD'EverandDétrompez-vous!: Les étranges indignations de Stéphane Hessel décryptéesPas encore d'évaluation
- Psychologie SocialeDocument12 pagesPsychologie SocialeBRAKNESSPas encore d'évaluation
- 4) La Violence Dans La Societe ModerneDocument2 pages4) La Violence Dans La Societe ModerneCristinaDragomirPas encore d'évaluation
- Projet Miriam Cpas de La LouviereDocument31 pagesProjet Miriam Cpas de La LouviereJaphet AnafakPas encore d'évaluation
- Enjeux Du Travail Des FemmesDocument13 pagesEnjeux Du Travail Des Femmes31071978Pas encore d'évaluation
- IDENTITEDocument6 pagesIDENTITEMelody NsimbaPas encore d'évaluation
- Crise d'identité professionnelle et professionnalismeD'EverandCrise d'identité professionnelle et professionnalismePas encore d'évaluation
- Fiche Cours JohannDocument22 pagesFiche Cours Johanntom renPas encore d'évaluation
- De l'égalité à la pauvreté: Une socio-histoire de l'assistance en Belgique (1895-2015)D'EverandDe l'égalité à la pauvreté: Une socio-histoire de l'assistance en Belgique (1895-2015)Pas encore d'évaluation
- Guide Dissertation Septembre 2018Document44 pagesGuide Dissertation Septembre 2018KyoPas encore d'évaluation
- Questions actuelles en droit des étrangers: Droit belgeD'EverandQuestions actuelles en droit des étrangers: Droit belgePas encore d'évaluation
- AcculturationDocument5 pagesAcculturationArno PatyPas encore d'évaluation
- BOURDIEU 1977 Remarques Provisoires Sur La Perception Sociale Du CorpsDocument5 pagesBOURDIEU 1977 Remarques Provisoires Sur La Perception Sociale Du CorpsJulianaPas encore d'évaluation
- La prise de décision en éthique clinique: Perspectives micro, méso et macroD'EverandLa prise de décision en éthique clinique: Perspectives micro, méso et macroPas encore d'évaluation
- (Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justiceD'Everand(Dés)équilibres: L'informatisation du travail social en justicePas encore d'évaluation
- L' AGIR ETHIQUE DE LA DIRECTION D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE: Fondements et résolution de problèmesD'EverandL' AGIR ETHIQUE DE LA DIRECTION D'ETABLISSEMENT SCOLAIRE: Fondements et résolution de problèmesPas encore d'évaluation
- Écosystème de la transformation de l'administration publique vers le numériqueD'EverandÉcosystème de la transformation de l'administration publique vers le numériquePas encore d'évaluation
- Entretiens avec le Professeur Y: Analyse complète de l'oeuvreD'EverandEntretiens avec le Professeur Y: Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- L'entreprise délibérée: Refonder le management par le dialogueD'EverandL'entreprise délibérée: Refonder le management par le dialoguePas encore d'évaluation
- Blessures Invisibles: Le guide complet pour prévenir et traiter l'intimidation et la cyberintimidationD'EverandBlessures Invisibles: Le guide complet pour prévenir et traiter l'intimidation et la cyberintimidationPas encore d'évaluation
- La Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLa Condition humaine d'André Malraux: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Individus Et Culture - Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxDocument2 pagesIndividus Et Culture - Comment Devenons-Nous Des Acteurs SociauxMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- La Notion de Représentation Pour Les SociologuesDocument4 pagesLa Notion de Représentation Pour Les Sociologueszaoui22100% (1)
- Anthropologie de DeveloppementDocument2 pagesAnthropologie de DeveloppementRanto Andriampenitra RasoamanambolaPas encore d'évaluation
- Les Pricipales Critiques de La Théorie Du Choix Rationnel PDFDocument10 pagesLes Pricipales Critiques de La Théorie Du Choix Rationnel PDFSoukaina OuPas encore d'évaluation
- L'interactionnisme Symbolique - David Le BretonDocument229 pagesL'interactionnisme Symbolique - David Le BretonIsabel Carvalheira33% (3)
- Les flux migratoires au sein de l'Union européenneD'EverandLes flux migratoires au sein de l'Union européennePas encore d'évaluation
- Zaina Myriam UccDocument67 pagesZaina Myriam UccEmmanuel100% (1)
- Duel avec un séducteur: Histoire d'un harcèlement au travailD'EverandDuel avec un séducteur: Histoire d'un harcèlement au travailPas encore d'évaluation
- Cours de Sociologiue: Inégalités, Familles, GenreDocument17 pagesCours de Sociologiue: Inégalités, Familles, GenreSacha CPas encore d'évaluation
- Pratiques et recherches féministes en matière de violence conjugale: Coconstruction des connaissances et expertisesD'EverandPratiques et recherches féministes en matière de violence conjugale: Coconstruction des connaissances et expertisesPas encore d'évaluation
- Conceptions de l'intelligence et pratiques éducatives: Quelle est l'influence du constructivisme?D'EverandConceptions de l'intelligence et pratiques éducatives: Quelle est l'influence du constructivisme?Pas encore d'évaluation
- Enfants fragilisés: Stratégies de planning personnel et patrimonialD'EverandEnfants fragilisés: Stratégies de planning personnel et patrimonialPas encore d'évaluation
- Le Developpement Conscient: Un Autre Regard Du DeveloppementD'EverandLe Developpement Conscient: Un Autre Regard Du DeveloppementPas encore d'évaluation
- Le Pouvoir de L'identitéDocument19 pagesLe Pouvoir de L'identitéJuidette El MehdiPas encore d'évaluation
- 8 MarsDocument10 pages8 Mars31071978Pas encore d'évaluation
- Co 1 PDFDocument26 pagesCo 1 PDF31071978Pas encore d'évaluation
- Séance 5Document26 pagesSéance 531071978Pas encore d'évaluation
- S3Document24 pagesS331071978Pas encore d'évaluation
- Documents S1 PDFDocument4 pagesDocuments S1 PDF31071978Pas encore d'évaluation
- ProgrammeDocument1 pageProgramme31071978Pas encore d'évaluation
- CO - Genre, Sexe Et PolitiqueDocument15 pagesCO - Genre, Sexe Et Politique31071978Pas encore d'évaluation
- Doc. S2 PDFDocument3 pagesDoc. S2 PDF31071978100% (1)
- Féminisme MondialisationDocument24 pagesFéminisme Mondialisation31071978Pas encore d'évaluation
- Sexisme Et Estime de SoiDocument21 pagesSexisme Et Estime de Soi31071978Pas encore d'évaluation
- Séance 4Document33 pagesSéance 431071978Pas encore d'évaluation
- CO - Genre, Sexe Et PolitiqueDocument15 pagesCO - Genre, Sexe Et Politique31071978Pas encore d'évaluation
- Co Iep S3Document22 pagesCo Iep S331071978Pas encore d'évaluation
- Séance 9Document38 pagesSéance 931071978Pas encore d'évaluation
- Vendre Son CorpsDocument14 pagesVendre Son Corps31071978Pas encore d'évaluation
- Séance 8Document23 pagesSéance 831071978Pas encore d'évaluation
- Bulletin Adhésion ARGEFDocument1 pageBulletin Adhésion ARGEF31071978Pas encore d'évaluation
- Séance N°7Document20 pagesSéance N°731071978Pas encore d'évaluation
- Violence Contre Les FemmesDocument1 pageViolence Contre Les Femmes31071978Pas encore d'évaluation
- IRM HypothèsesDocument6 pagesIRM HypothèsesMuriel SALLEPas encore d'évaluation
- Séance 6Document26 pagesSéance 631071978Pas encore d'évaluation
- Doc. S2Document2 pagesDoc. S231071978Pas encore d'évaluation
- Séance 5Document26 pagesSéance 531071978Pas encore d'évaluation
- Féminisme IslamiqueDocument19 pagesFéminisme Islamique31071978Pas encore d'évaluation
- 1 - Définition Des Concepts-Clés Relatifs Au GenreDocument4 pages1 - Définition Des Concepts-Clés Relatifs Au Genre31071978100% (2)
- Séance 4Document33 pagesSéance 431071978Pas encore d'évaluation
- Comment Peut-On Être FéministeDocument31 pagesComment Peut-On Être Féministe31071978Pas encore d'évaluation
- Présentation 24 - 01 - 2021Document14 pagesPrésentation 24 - 01 - 202131071978Pas encore d'évaluation
- Intersection Article DorlinDocument12 pagesIntersection Article Dorlin31071978Pas encore d'évaluation
- kpg fr C epr2 2023Α 121856Document2 pageskpg fr C epr2 2023Α 121856Kostas AmanatidisPas encore d'évaluation
- VinyleDocument3 pagesVinylechristophePas encore d'évaluation
- 34 ElectromecaniqueDocument51 pages34 ElectromecaniqueStairway To Heaven MorePas encore d'évaluation
- Pathologie Et Renovation 1Document38 pagesPathologie Et Renovation 1Zalvet ChristianPas encore d'évaluation
- HG EMC Serie Generale 1Document8 pagesHG EMC Serie Generale 1Arthur CrierePas encore d'évaluation
- Developpement LmitesDocument12 pagesDeveloppement LmitesJadli AissamPas encore d'évaluation
- Planification Reseau MobileDocument3 pagesPlanification Reseau MobileAnonymous xQL931pvTvPas encore d'évaluation
- Fiche Aquaponie 2013 CoursDocument9 pagesFiche Aquaponie 2013 Coursresearchfr100% (2)
- KRUPS EA8010 User GuideDocument144 pagesKRUPS EA8010 User Guide79andiPas encore d'évaluation
- Audit Comptable Et FinancierDocument95 pagesAudit Comptable Et FinancierHicham Messid0% (1)
- Corrigé Fiche RecursivitéDocument5 pagesCorrigé Fiche Recursivitébassirou kanePas encore d'évaluation
- Le Mandala de L'être, Par Richard MossDocument2 pagesLe Mandala de L'être, Par Richard MossJoop-le-philosophe100% (1)
- Machine Thermique ExamDocument4 pagesMachine Thermique ExamYassineHijazi100% (3)
- Comment Bien Travailler en Équipe Et Améliorer Radicalement Vos RésultatsDocument6 pagesComment Bien Travailler en Équipe Et Améliorer Radicalement Vos RésultatsTETRACONE GEOTECHNIQUEPas encore d'évaluation
- Bindjeme EllaDocument5 pagesBindjeme EllaCrystal BskPas encore d'évaluation
- AwoumouDocument15 pagesAwoumouresinePas encore d'évaluation
- Capital RisqueDocument40 pagesCapital RisqueMustapha Elmoadin100% (1)
- Exam S6 1 Eco Gest 18 19Document1 pageExam S6 1 Eco Gest 18 19Amine StiouniPas encore d'évaluation
- Documents SVT .PC .MathDocument152 pagesDocuments SVT .PC .MathTrésor KoffiPas encore d'évaluation
- Cours Complet de Stratif 2Document109 pagesCours Complet de Stratif 2woodruff1986Pas encore d'évaluation
- Memoire ERPDocument78 pagesMemoire ERPmacao100100% (2)
- Sisr4 05 tp1 Pws Niveau 2Document12 pagesSisr4 05 tp1 Pws Niveau 2api-296100887Pas encore d'évaluation
- ISO 14001 Guide de TransitionDocument12 pagesISO 14001 Guide de TransitionBadr BouslamaPas encore d'évaluation
- U Rythme Des Mots 2 PDFDocument160 pagesU Rythme Des Mots 2 PDFJade Zapata50% (2)
- I-II Lois de L'optique GéométriqueDocument7 pagesI-II Lois de L'optique Géométriquenakaruru55Pas encore d'évaluation
- GELE5340 Notes5Document32 pagesGELE5340 Notes5Theo WanPas encore d'évaluation
- Guide Rédaction PFE, Mr. Abdellatif AbbesDocument6 pagesGuide Rédaction PFE, Mr. Abdellatif AbbesAllani Ahmed Riadh100% (11)
- Ed 1476Document2 pagesEd 1476Nabil SouissiPas encore d'évaluation
- NF En12464-1Document57 pagesNF En12464-1Hugo DEVIGEPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Généralité Sur Les Machines AsynchronesDocument23 pagesChapitre 1 Généralité Sur Les Machines AsynchronesFiroDjinsoNano0% (1)