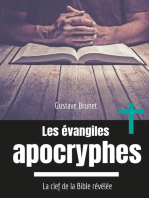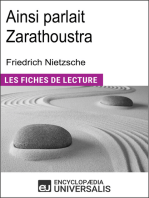Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
CRM 12703 PDF
CRM 12703 PDF
Transféré par
keita aboubakarTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
CRM 12703 PDF
CRM 12703 PDF
Transféré par
keita aboubakarDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cahiers de recherches médiévales et
humanistes
Journal of medieval and humanistic studies
2011
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd.
Jean-Patrice Boudet, Anna Caiozzo, Nicolas Weill-
Parot
Max Lejbowicz
Édition électronique
URL : http://journals.openedition.org/crm/12703
ISSN : 2273-0893
Éditeur
Classiques Garnier
Référence électronique
Max Lejbowicz, « Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, Anna
Caiozzo, Nicolas Weill-Parot », Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], 2011, mis en
ligne le 28 mai 2012, consulté le 30 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/crm/12703
Ce document a été généré automatiquement le 30 avril 2019.
© Cahiers de recherches médiévales et humanistes
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 1
Images et magie. Picatrix entre
Orient et Occident, éd. Jean-Patrice
Boudet, Anna Caiozzo, Nicolas Weill-
Parot
Max Lejbowicz
RÉFÉRENCE
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, Anna Caiozzo,
Nicolas Weill-Parot, Paris, Champion (« Sciences, techniques et civilisations du Moyen
Âge à l’aube des Lumières » 13) 2011, 390p.
ISBN 978-2-7453-2163-3
1 Le Picatrix est un livre singulier, sinon paradoxal. Le premier paragraphe de son prologue
le présente comme la compilation de plus de deux cents livres arabes de philosophie,
philosophia, que l’auteur, un sapiens philosophus comme il se doit, a titré par éponymie 1. Il
évoque aussi « Alphonse, roi très illustre d’Espagne et de toute l’Andalousie », qui a fait
traduire en castillan l’original arabe de cette śuvre, en 1256 (la date est également donnée
dans trois autres ères, soit, dans l’ordre de l’énoncé, celles d’Alexandrie, de Jules César et
de l’Hégire). Le même roi souhaite maintenant éclairer « les docteurs latins chez qui il y a
indigence, est inopia, de livres publiés par les anciens philosophes ». Le deuxième
paragraphe surenchérit sur l’auteur, dont il cerne plus précisément les centres d’intérêt :
si Picatrix est un sapientissimus philosophus, le Picatrix est un liber in nigromanticis artibus –
des artes placées sous la protection de Dieu, dont la lumière révèle les secrets et dévoile ce
qui est caché, dont la puissance accomplit tous les miracles, etc. Le paragraphe suivant
met en avant la sciencia nigromancia, étant entendu que les philosophes, toujours présents,
l’ont cachée, celaverunt, voilée de toutes leurs forces, pro viribus velarunt ; car, si elle « était
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 2
révélée aux hommes, ceux-ci rendraient l’univers méconnaissable », confunderent
universum. Il reste au quatrième paragraphe à former le souhait que les lecteurs du
Picatrix agissent « pour le bien et le service de Dieu ». Quant au cinquième et dernier, il
donne le plan de l’ouvrage. Les généralités sur la nature et la configuration du ciel sont
abordées dans les deux premières parties, alors que les deux suivantes et dernières
traitent des esprits des planètes et de la manière de s’adresser à eux en s’aidant de
talismans, de fumigations et d’autres procédés, qualiter cum ymaginibus et suffumigacionibus
et eciam cum aliis adiuvatur2. En fait, la composition de ce livre est beaucoup moins
ordonnée. Pour ajouter au mystère, et en dépit du patronage qui a veillé à sa double
diffusion linguistique en Europe, la plus ancienne mention du Picatrix ne date que de 1456
(Johannes Hartlieb, Das Buch aller verboten Künste) et le plus ancien manuscrit latin qui
aujourd’hui en conserve une large partie a deux ans de moins (Cracovie, Bibliothèque
Jagellonne, ms. 793, sur lequel je reviens plus bas à la faveur d’une des communications
du volume sous recension) ; mais le scribe d’un manuscrit du XVIIIe siècle prétend en
copier un daté de 13863. Quant à la version castillanne, elle ne subsiste plus que dans de
brefs fragments. Pendant deux cents ans, ce liber in nigromanticis artibus n’a laissé pas
laissé de traces très tangibles, alors qu’à partir du XIIIe siècle la nigromancie a suscité une
faveur croissante sur tout le continent européen.
2 Comme l’indique le sous-titre retenu, les éditeurs n’ont pas craint d’ajouter à la
complexité du Picatrix celle de l’original arabe, dont le titre s’avère différent de celui
mentionné dans le prologue : Ghāyat al-ḥakīm (Le but du sage), qui est « l’ouvrage le plus
célèbre de magie dans le monde islamique » (p. 80). L’histoire de la découverte et de
l’exploitation de ces deux textes, arabe et latin, par la recherche contemporaine est
retracée dans l’introduction par Charles Burnett, à partir des archives de l’Institut
Warburg. Aux prises avec les énigmes de la Melancolia I d’Albert Dürer, Aby Warburg
(† 1929) a joué un rôle décisif, et parfois ambigu, dans cette résurrection littéraire, que ses
assistants, correspondants, héritiers et successeurs ont prolongée jusqu’à nos jours, avec
quelques moments clés : l’édition du texte arabe par Hellmut Ritter en 1933 et celle du
texte latin par David Pingree en 1986 (préparée et suivie par une série d’articles
fondamentaux du même historien sur ces textes). Il n’aurait pas été inutile de signaler les
traductions du Picatrix dans certaines langues contemporaines, fût-ce pour en indiquer
les limites éventuelles : à partir du texte arabe, en allemand (1962), espagnol (1982) et
anglais (2002 et 2008) ; à partir du texte latin, en italien (1999), français (2003) et anglais
(2010).
3 Sous le titre général Origines et transmission d’une compilation obscure, quatre
communications exploitent les sources orientales de ce Liber in nigromanticis artibus.
Godefroid de Callataÿ interroge la pertinence d’un article, paru en 1966, d’Yves Marquet.
Ce dernier, à la faveur d’une analyse de la cinquante-deuxième et dernière épître des
Ikhwān al-Safā’, essayait de préciser la nature du sabéisme ḥarrānien, qui, faute de
témoignages directs, est difficilement accessible. En utilisant deux manuscrits inconnus
de son prédécesseur, et en se concentrant sur quelques points (la tradition talismanique,
les doctrines philosophiques, les 87 temples, le temple de Jurjās, le rituel d’initiation), il
nuance les analyses proposées il y a maintenant près d’un demi-siècle, sans les remettre
substantiellement en cause. Le sabéisme ḥarrānien est confirmé dans sa consistance
propre et, par ricochet, la Ghāyat al-ḥakīm s’enracine sans conteste dans le Proche-Orient.
4 Anna Caiozzo se concentre sur les enluminures de quelques manuscrits orientaux de
cosmographie, d’astrologie, de magie et d’anthologies scientifiques. Elle s’attarde plus
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 3
particulièrement sur les liturgies planétaires, les rituels angélologiques et l’élaboration
des talismans pour tenter de reconstituer visuellement les rites de magie astrale dont la
Ghāyat al- ḥakīm est un témoin majeur.
5 Živa Vesel s’intéresse au al-Sirr al-maktūm fī mukhāṭabat ( Le secret invisible au sujet de
l’invocation des étoiles), de Fakhr al-Dīn Rāzī († 1210), proche des cours de l’Iran oriental. Sa
communication privilégie quelques aspects de ce traité (les planètes, les décans et les
degrés de l’écliptique), qui éclairent à leur tour les pratiques ḥarrāniennes.
6 Alejandro García Avilés assure la jonction entre l’Orient et l’Occident. Il part de la césure
qui s’est produite au XIIe siècle latin dans le monde du savoir – « La contemplation de la
nature comme śuvre de la Création divine cède progressivement la place à son
observation comme moyen de dévoiler ses secrets occultes » (p. 102) – et documente un
tel changement en recourant principalement à certains travaux patronnés par
Alphonse X (les Cantigas de Santa Maria, le Libro de astromagia, le Lapidario alphonsin, le
Liber Razielis et évidemment le Picatrix). Fidèle à l’une des recommandations énoncées
dans l’Astromagia – « J’ai déjà tout dit et tout expliqué. Maintenant comprends-le grâce
aux images » –, il argumente pour l’essentiel à partir de l’iconographie des manuscrits. La
diffusion des écrits retenus relance une interrogation présente tout au long de la
chrétienté, avec une intensité variable : quelle est la légitimité de la connaissance, et plus
spécialement de la connaissance magique ? Pareille question revient en force aux XII e et
XIIIe siècles. La réponse consiste à différencier les savoirs selon qu’ils sont jugés se
réclamer soit des anges, soit des démons, ou soit de la nature, soit des artifices…
7 La deuxième partie, Rituels et images, traite en cinq communications du seul Picatrix.
Nicolas Weill-Parot s’interroge sur le substrat théorique d’une telle compilation ; à ce
titre, sa contribution mérite un résumé moins succinct que les autres. L’historien
construit son analyse en trois étapes, en puisant largement dans le Picatrix pour les deux
premières. Il commence par dresser une typologie des talismans : il distingue ceux qui
représentent des figures géométriques de ceux qui représentent des formes naturelles
(qualifiés de « corporéiformes » ; le couple usuel d’antonymes « abstrait / figuratif »
serait peut-être moins lourd) ; et, parmi ces derniers, ceux qui ont deux dimensions
(figures peintes) de ceux qui en ont trois (statuettes), sans compter les sceaux, qui
occupent une position médiane. Un nouveau critère différencie les talismans
corporéiformes : les uns sont de source (ils sont à la ressemblance de la source d’où
émane la force que la séance talismanique cherche à canaliser), les autres, de cible (ils
sont à la ressemblance de l’objet sur lequel cette séance cherche à agir). L’efficacité
talismanique nécessite dans le premier cas le contact entre le talisman et la cible, dans le
second une similitude entre eux. Sans entrer davantage dans les ramifications de cette
typologie, j’en viens à la deuxième étape. Elle essaie de justifier par un principe unique les
images corporéiformes, qu’elles soient de cible ou de source. Elle le trouve dans une
similitudo qui, associée à la virtus censée être transmise par le talisman, subsume un
ensemble de considérations dispersées dans plusieurs chapitres du Picatrix. Il faut
entendre par ce trait distinctif « un accord harmonique, une correspondance adaptée, un
appariement, un lien d’appropriation, entre tous les constituants du talisman (matière,
forme) et tous les procédés (choix du moment astrologiques, choix du lieu, rituels) avec
l’astre ou la constellation et leur influx » (p. 129). Cet acquis conceptuel permet d’aborder
la troisième étape, consacrée à la réception de la magie talismanique par les scolastiques.
L’auteur anonyme du Speculum astronomiae est en la matière l’autorité. Il a imposé la
légitimité du talisman astrologique, strictement naturaliste, « où donc n’est présent
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 4
aucun élément ‘destinatif’, c’est-à-dire aucun rituel, aucune invocation, aucune
inscription destinés à une intelligence supérieure pour solliciter son aide de façon
soumise ou comminatoire » (p. 130). Albert le Grand, dans son De mineralibus, apporte sa
caution à cette différenciation en faisant « des figures imprimées naturellement dans les
pierres par les influx astraux » (p. 130) le modèle que l’artisan doit suivre : ce dernier
choisit le moment astrologiquement propice à la fabrication d’un talisman en se
contentant d’« orienter le cours de la nature » (p. 132). Ainsi, « à l’étiologie naturaliste
possible de l’image corporéiforme s’oppose la nécessaire sémiologie démoniaque de la
figure non corporéiforme » (p. 131). À la fin du XVe siècle, le médecin Jérôme Torrella
argumente longuement cette similitudo naturelle, qui fonde le « talisman scientifiquement
explicable et donc licite pour le chrétien » (p. 132), « en réfléchissant sur le couple
fondamental matière et forme » (p. 134) : son explication repose « sur une tentative
d’assimiler la figure artificielle [que l’artisan réalise] à la forme spécifique
[aristotélicienne] » (p. 135)4. Les scolastiques ont donc défini le bon usage du Picatrix : en
restreignant la similitudo au domaine de la nature, ils en ont rejeté les parties qui relèvent
de la magie destinative.
8 Benedek Láng confirme l’analyse précédente en cherchant à expliquer une particularité
du fameux manuscrit cracovien déjà abordé : le scribe a interrompu son travail en II, 10.
En agissant de la sorte, il n’a fait qu’appliquer, à l’intérieur d’un même ensemble, la
classification des traités de magie mise au point par l’Anonyme du Speculum astronomiae et
reprise par un étudiant de Cracovie, Egidius de Corinthe, dans le manuscrit de Dresde,
Sächsischen Landesbibliothek, N. 100 : oui au talisman astrologique, non à la magie
destinative.
9 Jean-Patrice Boudet voit dans les pratiques magiques une « manipulation des signes »
inspirée par « l’importance cruciale du désir », où « les motivations relatives à l’amour, au
sexe et à la haine occupent donc une place importante » (p. 150). Il limite sa contribution
à l’amour, dont la présence dans le Picatrix se repère à trois niveaux : sur le plan du
lexique, sur celui des finalités et sur le plan qualitatif et théorique. Il note une grande
différence de conception entre le texte arabe, où « il n’y a pas de différence profonde de
nature entre l’amour spirituel et l’amour charnel » (p. 151), et le texte latin, « où il n’est
pas question explicitement du désir » et qui adopte « un point de vue moralisateur » (p.
152). Il reste que, dans le Picatrix, « il existe un écart important » entre la « belle théorie
de l’amour comme art suprême » et « les pratiques préconisées dans les recettes de magie
amoureuse » (p. 153). Il en donne des exemples particulièrement significatifs. Il en
conclut que le Picatrix juxtapose différents types de magie et que, moins transgressif que
l’original arabe, il l’est plus que la plupart des autres traités de magie disponibles au
moment de sa traduction arabo-latine.
10 Julien Véronèse se met en quête du fondement de la virtus que le Picatrix attribue aux sons
vocaux et aux signes graphiques. Son examen est méthodique et minutieux, et s’appuie
avec maestria sur les classiques du genre. Au final, il avoue l’impossibilité de dégager de
ces pages une conception ferme : les astres y « sont à la fois des entités naturelles et
spirituelles » (p. 186) ; d’un chapitre à l’autre, le Picatrix penche en faveur d’une magie
naturelle ou d’une magie destinative.
11 Sophie Page termine cette deuxième partie en étudiant les sacrifices des animaux dans le
Picatrix latin et dans d’autres textes apparentés. Si ces sacrifices interviennent dans des
contextes rituels différents, ils ont des traits communs. Ils sont destinés aux esprits plutôt
qu’à Dieu et utilisent des animaux domestiques, censés être de meilleurs intercesseurs
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 5
entre les hommes et l’ordre céleste. En les accomplissant, le magicien s’humilie, puisqu’il
a besoin de recourir à des intermédiaires, et en même temps exalte sa propre puissance,
puisqu’il est apte à « communiquer avec quelques-uns des millions d’esprits invisibles qui
peuplaient l’univers médiéval » (p. 211).
12 Le titre de la troisième et dernière partie, Postérité et parenté, est explicite. Elle commence
par la communication de Constant Hamès, singulière par la forme et par le fond : ses
quatre parties se présentent sous l’aspect de monographie. La première, qui joue le rôle
d’introduction, réduit « la pensée fondamentale » de la Ghāya « à celle d’Aristote » (p.
216). La deuxième oppose les Épîtres des Ikhwān al-Safā’, parfaitement intégrées au monde
arabo-musulman, à la Ghāya, quelque peu étrangère à l’islam. La troisième décrit « un
phénomène surprenant de résurgence » (p. 225) de la Ghāya au XVIII e siècle à partir d’une
présentation succincte, en deux pages, de Muḥammad al-Fulānī († 1746 ?) et de son traité,
La perle enfilée ou la quintessence du Secret caché au sujet du la magie, des talismans et des étoiles
. La quatrième s’attache au Soleil des connaissances d’al-Būnī († vers 1225), qui « participe
de manière décisive à l’entreprise d’islamisation de la magie » (p. 228), étant entendu que
ce traité s’inscrit dans la continuité de la restauration de « l’édifice prophétique de
l’islam » (p. 228) promue par al-Ghazāli († 1111). Il en conclut : « L’incertitude subsiste,
jusqu’à nos jours, sur son abandon [celui de l’astrologie] ou non, notamment suivant les
temps, les lieux et les personnes, dans les pratiques magiques et divinatoires des
populations musulmanes » (p. 232).
13 Emilie Savage-Smith présente un traité d’astrologie acquis par la Bodleian Library en
2002, qu’elle a édité, traduit et commenté avec Yossef Rapoport (ce travail est accessible
sur le site web de la bibliothèque). Il s’agit du Livre des curiosités des sciences et des merveilles
pour les yeux, écrit par un anonyme égyptien entre 1020 et 1050. Elle termine son étude en
voyant dans ce traité « une bonne vision de l’astrologie en Égypte au XIe siècle – celle qui
était dominée par l’utilisation non mathématique des astérismes non-ptoléméens,
l’observation des comètes, la présence de vent les jours propices et une myriade
d’attributs assignés à chaque planète et à chaque signe du zodiaque » (p. 251).
14 À partir d’un manuscrit daté du tournant des XVIIIe et XIXe siècles, Anne Regourd étudie,
édite et traduit un bref traité yéménite anonyme d’exorcismes, qu’elle estime postérieur
au XIe siècle, le Kitāb al-Mandal al-Sulaymānī ; dans un article précédent, elle proposait de
rendre provisoirement le titre par le Livre des formules magiques de Salomon pour entrer en
relation avec les djinns5. Les prescriptions y sont communiquées à Salomon par le démon
Ṣakhr, au terme d’un affrontement entre eux, riche en rebondissements.
15 Reimund Leicht axe sa communication sur le texte hébraďque d’une interpolation au
Picatrix latin, II, 12, le De duodecim imaginibus attribué à Hermès. Il en existe deux versions,
qu’il édite. Il montre que la première est sous la dépendance du De duodecim et qu’elle a
été réalisée au début du XIVe siècle, à un moment où, dans la communauté juive du Sud de
la France et de l’Espagne, une violente controverse sur les vertus thérapeutiques des
sceaux astrologiques opposait les juristes et les théologiens aux médecins. Il montre aussi
que la seconde version a influencé le Tractatus ad faciendum sigilla et ymagines du pseudo-
Bernard de Gordon.
16 Kocku von Stuckrad part du résultat des recherches menées sur certaines sources de
Marsile Ficin, le Picatrix et le De radiis d’al-Kindī, pour se livrer à une « excursion parmi les
contributions récentes des historiens des religions et de la culture » (p. 339). Celles qu’il a
retenues mettent en lumière la notion de transfert culturel. Il passe ainsi de Robert
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 6
Bonfil, pour qui « Messer Leon, Elijah del Medigo ou Johannan Alemanno étaient autant
des hommes de la Renaissance que leur contemporains chrétiens » (p. 336), à Moshe Idel,
pour qui « les principaux sujets du début de la Renaissance florentine doivent avoir été
influencés par les textes juifs et judéo-arabes disponibles alors à Florence » (p. 336), puis à
Steven M. Wasserstrom, qui a mis en lumière l’existence, dans l’Andalousie médiévale, de
« cercles interconfessionnels » dont les participants étaient « interconfessionnels malgré
eux » (p. 336-337), ensuite à Michael Borgolte : « Si nous voulons comprendre
historiquement l’Europe, nous devrons accepter l’idée que sa diversité n’a pas abouti à un
pluralisme d’indifférence, mais que sa formation culturelle fut ajustée, modifiée et rejetée
lors d’échanges permanents » (p. 337). Il conclut sur une longue citation d’Anthony
Grafton sur la République des Lettres humaniste.
17 Luisa Capodieci dépouille la littérature, plus pittoresque que savante, plus passionnée que
rationnelle, relative à l’un des plus fameux talismans de l’histoire de la magie
européenne : celui, jupitéro-vénusien, qui aurait été commandité par Catherine de
Médicis. Il en existe quatre exemplaires, qui ne sont pas exactement identiques. Trois
sont conservés à la Bibliothèque nationale de France, le dernier l’est au Kunsthistorisches
Museum de Vienne. Seul celui qui a appartenu à Henri de Mesmes (BnF, départ. des
médailles, médailles magiques, plateau 91, 4e ligne, n° 3) obéit aux règles relatives à la
fabrication d’un talisman jupitéro-vénusien, telles qu’elles sont édictées dans le De occulta
philosophia de Cornelius Agrippa (1 ère éd : 1525), qui lui-même reprend celles du Picatrix.
Malgré ses propres efforts, l’historienne n’en retrouve pas de trace écrites avant
l’anonyme Art d’assassiner les rois enseigné par les Jésuites à Louis XIV et à Jacques II, daté de
1696, soit plus d’un siècle après la mort de la reine. Elle en conclut qu’en l’état actuel des
recherches, il convient d’attribuer l’exemplaire de Mesmes à un anonyme qui
« connaissait le protocole nécessaire à la fabrication d’un talisman », même s’« il ignorait
certainement la célébrité à laquelle cet objet aurait été destiné » (p. 358).
18 Le volume se termine par une communication de Vittoria Perrone Compagni : « Picatrix :
une philosophie pour la pratique ». Ce texte de haute tenue philosophique propose une
lecture en quelque sorte épurée du Picatrix. Il s’inscrit dans la continuité des conseils
dispensés par Marsile Ficin à un de ses amis, comme le reconnaît l’historienne : « Marsile
Ficin conseillait à son ami Filippo Valori de ne pas se donner la peine de chercher une
copie du librum Picatrix, parce que tout ce que le livre contenait de valable et d’utile avait
été scrupuleusement consigné dans les pages du De vita qui venait d’être achevé, tandis
que tout ce qui était futile avait été écarté et condamné par la religion chrétienne » (p.
367). La conclusion s’impose : « De la théorie renouvelée de la magie qui voit le jour à la
Renaissance, Picatrix (…) est à la fois très proche et très éloigné » (p. 372). Très
satisfaisante pour le seiziémiste, la leçon l’est moins pour le médiéviste en quête d’une
vision générale du traité, sauf à noter qu’une lecture sélective faite à des fins personnelles
peut avantageusement remplacer un acte de censure prononcé ès-qualité.
19 On le voit : le volume couvre un large éventail de points de vue, sans donner l’impression
d’épuiser le sujet. De menues erreurs le déparent. P. 108, il est question des « douze
degrés du zodiaque » ; c’est les « douze signes du zodiaque » qu’il faut lire. P. 155, une
recette est expliquée par les positions zodiacales de Mars et de Vénus, au prétexte que ces
planètes ont leur « domicile nocturne » dans le signe du Bélier pour la première, dans
celui de la Balance pour la seconde. Le problème : Picatrix attribue bien des domiciles
zodiacaux aux planètes, mais sans différencier les domiciles en diurnes et nocturnes. Il est
question, à la p. 341, d’« une médaille ovale », avec un renvoi à la figure 12, où est
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Images et magie. Picatrix entre Orient et Occident, éd. Jean-Patrice Boudet, ... 7
reproduite une médaille circulaire. Pour autant que la qualité médiocre de la
reproduction permette une identification, il semble qu’il y ait une confusion avec les
médailles décrites aux p. 353-354. Ces quelques défaillances ne portent pas atteinte à la
qualité de l’ensemble.
NOTES
1. Sur les problèmes posés par ce 1 er §, voir David Pingree, « Between the Ghāya and Picatrix. I.
The Spanish Version », Journal for the Warburg and Courtauld Institutes, 44 (1981), p. 27-56 (27-28).
2. D’après David Pingree,Picatrix. The Latin version of the Ghāyat al-ḥakīm, Londres, The Warburg
Institute, 1986, p. 1-2 ; ymago traduit le mot qui, en arabe, désigne le talisman.
3. Ibid., p. XXIII.
4. Hieronymus Torrella, Opus praeclarum de imaginibus astrologicis, éd. Nicolas Weill-Parot,
Florence, Edizioni del Galluzzo, 2008.
5. Anne Regourd, « Le Kitāb al-Mandal al-Sulaymānī, un ouvrage d’exorcisme yéménite postérieur
au V/XIe s. ? », Res orientales, 13 (2001), p. 123-138 (123). Une version de ce traité a été traduite en
latin au XIIe siècle : L’Almandal et l’Almandel latins au Moyen Âge, éd. Julien Véronèse, Florence,
Edizioni del Galluzzo, 2012.
Cahiers de recherches médiévales et humanistes , 2011 | 2012
Vous aimerez peut-être aussi
- Ambelain - SacramentaireDocument146 pagesAmbelain - Sacramentaireelcaminosagrado5912100% (11)
- 1941 Adam Dieu RougeDocument249 pages1941 Adam Dieu Rougevlkeiuda100% (10)
- Les évangiles apocryphes: La clef de la Bible révéléeD'EverandLes évangiles apocryphes: La clef de la Bible révéléeÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Cahiers de L'hermetisme - L'astrologieDocument30 pagesCahiers de L'hermetisme - L'astrologiewebinato100% (1)
- Anthologie de L EsoterismeDocument426 pagesAnthologie de L EsoterismeHIERONYMUS314100% (3)
- Blavatsky La Doctrine Secrete - Tome 4Document515 pagesBlavatsky La Doctrine Secrete - Tome 4CharlesHannaBaram100% (4)
- 365 Eclairs de Transformation PDFDocument132 pages365 Eclairs de Transformation PDFpapi moussPas encore d'évaluation
- Origines Alchimiques Du Cabinet de RéflexionDocument12 pagesOrigines Alchimiques Du Cabinet de Réflexionaprendiz25100% (1)
- Symbolisme AlchimiqueDocument116 pagesSymbolisme AlchimiqueSheepo Dé la Vega100% (5)
- Talismans SigilsDocument12 pagesTalismans SigilsSpartakus FreeMann86% (7)
- PDF Kabbale Chretienne2Document46 pagesPDF Kabbale Chretienne2Pikolechat100% (3)
- Papyrus Magiques Grecs Le Mot Et Le RiteDocument160 pagesPapyrus Magiques Grecs Le Mot Et Le RiteCRYPOFANE100% (1)
- Alchimie - Le Grand OeuvreDocument8 pagesAlchimie - Le Grand Oeuvrearamnil100% (10)
- Dans Lombre Des Cathédrales by Robert Ambelain (Ambelain, Robert)Document342 pagesDans Lombre Des Cathédrales by Robert Ambelain (Ambelain, Robert)papouille100% (1)
- Les Grimoires Et Leurs AncetresDocument14 pagesLes Grimoires Et Leurs AncetresCRYPOFANE100% (1)
- Le Septénaire Dans L'apocalypse, Lestamp 2017Document22 pagesLe Septénaire Dans L'apocalypse, Lestamp 2017Georges J-f BertinPas encore d'évaluation
- FreeMann Spartakus - La Cabale Magique ChrétienneDocument41 pagesFreeMann Spartakus - La Cabale Magique ChrétienneCynthia CivetPas encore d'évaluation
- RENE GUENON Et La Crise Du Monde ModerneDocument8 pagesRENE GUENON Et La Crise Du Monde ModerneBelhamissi100% (1)
- Dictionnaire Raisonné de l'Architecture Française du XIe au XVIe siècle Tome II: Tome 2D'EverandDictionnaire Raisonné de l'Architecture Française du XIe au XVIe siècle Tome II: Tome 2Pas encore d'évaluation
- Dumézil Georges - Mythe Et Épopée Tome 2Document414 pagesDumézil Georges - Mythe Et Épopée Tome 2Carole Moustafa Itani100% (1)
- Manoury - Entrainement Pratique de L Adepte Vol2Document45 pagesManoury - Entrainement Pratique de L Adepte Vol2Carmen100% (1)
- Alchimie Et Astrologie PDFDocument18 pagesAlchimie Et Astrologie PDFjoel_tetardPas encore d'évaluation
- FLEURY Les Allégories Des Arts Libéraux RDocument33 pagesFLEURY Les Allégories Des Arts Libéraux RAmisQdTPas encore d'évaluation
- La matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome XI. Le pouvoir de l'intelligence intuitive et le mirage du matérialisme.- Le Silence de la Danse de l'Horloge galactique.D'EverandLa matrice de l'âme : Le siège des antennes psychiques. Tome XI. Le pouvoir de l'intelligence intuitive et le mirage du matérialisme.- Le Silence de la Danse de l'Horloge galactique.Pas encore d'évaluation
- Biblioteca de KoiréDocument264 pagesBiblioteca de Koiréexxonre100% (1)
- Humanisme, Renaissance Et ReformeDocument22 pagesHumanisme, Renaissance Et Reformekobeissileila22790% (1)
- Guide de PhilosophieDocument86 pagesGuide de Philosophienguettaolivier1100% (1)
- Paul Sedir - Le Fakirisme Hindou Et Les Yogas (1911)Document111 pagesPaul Sedir - Le Fakirisme Hindou Et Les Yogas (1911)Eau ErrantePas encore d'évaluation
- Le Lotus BleuDocument72 pagesLe Lotus BleuAlapini RenaudPas encore d'évaluation
- Ries Julien. Mircea Eliade, Histoire Des Idées Religieuses, T1. de L'âge de La Pierre, Rev Théol de Louvain, 1976Document7 pagesRies Julien. Mircea Eliade, Histoire Des Idées Religieuses, T1. de L'âge de La Pierre, Rev Théol de Louvain, 1976Emmanuel Manolis KosadinosPas encore d'évaluation
- Practicalkabbalah Part1Document85 pagesPracticalkabbalah Part1milithebilly100% (5)
- Les Anges Dans L'ars Notoria Révélation, Processus Visionnaire Et Angélologie PDFDocument38 pagesLes Anges Dans L'ars Notoria Révélation, Processus Visionnaire Et Angélologie PDFAlessandro MazzucchelliPas encore d'évaluation
- Claude Payan - Apprendre À Écouter Dieu 2Document8 pagesClaude Payan - Apprendre À Écouter Dieu 2Ludovic Bourgeois100% (2)
- DocumentDocument7 pagesDocumentwalyPas encore d'évaluation
- PIHANS007Document74 pagesPIHANS007Dr.Mohammed El-ShafeyPas encore d'évaluation
- Corbin - en Islam Iranien IVDocument240 pagesCorbin - en Islam Iranien IVvlad-b100% (3)
- La Cabbale PapusDocument371 pagesLa Cabbale Papusbamboo1384100% (1)
- Les Grimoires Et Leurs AncetresDocument14 pagesLes Grimoires Et Leurs AncetresFernando Montalvo100% (1)
- Et Si Je Ne Gâchais Pas Ma Vie-John PiperDocument482 pagesEt Si Je Ne Gâchais Pas Ma Vie-John PiperReddy MoksPas encore d'évaluation
- La ChevalerieDocument8 pagesLa ChevalerieZENON.D'OLBIAPas encore d'évaluation
- Secret, François - Du de Occulta Philosophia À L'occultisme Du XIXe Siècle PDFDocument28 pagesSecret, François - Du de Occulta Philosophia À L'occultisme Du XIXe Siècle PDFAnonymous 8VbEv5tA3Pas encore d'évaluation
- John Lash - Origines GnostiquesDocument8 pagesJohn Lash - Origines GnostiquesRoger Mayen100% (1)
- Bouveresse - Essais I PDFDocument388 pagesBouveresse - Essais I PDFAsher GutkindPas encore d'évaluation
- La Transmission Groupee Des Textes de Ma PDFDocument32 pagesLa Transmission Groupee Des Textes de Ma PDFmysticmdPas encore d'évaluation
- PFE 003 034 WDocument56 pagesPFE 003 034 WreussavelPas encore d'évaluation
- Card. Désiré-Joseph Mercier - Cours de Philosophie, Vol 2. Ontologie, Ou, Métaphysique GénéraleDocument612 pagesCard. Désiré-Joseph Mercier - Cours de Philosophie, Vol 2. Ontologie, Ou, Métaphysique GénéraleCarlosJesus100% (1)
- La Notion Gnostique de DémiurgeDocument69 pagesLa Notion Gnostique de DémiurgeOmar AfafPas encore d'évaluation
- Falconnier - Tarot FRDocument119 pagesFalconnier - Tarot FRMarcela Lilian Faccio GirardPas encore d'évaluation
- Kahn, Didier - Présence Et Absence de L'alchimie Dans La Littérature Romanesque Médiévale, de La Renaissance Et de L'âge BaroqueDocument35 pagesKahn, Didier - Présence Et Absence de L'alchimie Dans La Littérature Romanesque Médiévale, de La Renaissance Et de L'âge BaroqueAnonymous 8VbEv5tA3Pas encore d'évaluation
- En Faveur Des Enseignements Rosicruciens...Document90 pagesEn Faveur Des Enseignements Rosicruciens...merlinout100% (1)
- Cumont, F. 'Les Enfers Selon L'axiochos' CRAI 64.3 (1920) 272-85Document15 pagesCumont, F. 'Les Enfers Selon L'axiochos' CRAI 64.3 (1920) 272-85Mr. PaikPas encore d'évaluation
- Véronèse, Julien - L'Ermite Pelagius de MajorqueDocument16 pagesVéronèse, Julien - L'Ermite Pelagius de MajorqueAnonymous 8VbEv5tA3Pas encore d'évaluation
- Demiurge: Notion Gnostique DUDocument69 pagesDemiurge: Notion Gnostique DURafamatanantsoa RafamatanantsoaPas encore d'évaluation
- CAMENIETZKI, Carlos Ziller. L'Extase Interplanetaire D'athanasius Kircher: Philosophie, Cosmologie Et Discipline Dans La Compagnie de Jesus Au XVIIe SiècleDocument17 pagesCAMENIETZKI, Carlos Ziller. L'Extase Interplanetaire D'athanasius Kircher: Philosophie, Cosmologie Et Discipline Dans La Compagnie de Jesus Au XVIIe SiècleMichael Floro100% (2)
- HOPKINS MétempsychosesDocument19 pagesHOPKINS MétempsychosesBen FPas encore d'évaluation
- Le Chaman AltaiqueDocument22 pagesLe Chaman AltaiqueVALENTIN ROMEROPas encore d'évaluation
- Les Néo-Platoniciens Et Les Oracles ChaldaïquesDocument17 pagesLes Néo-Platoniciens Et Les Oracles ChaldaïquesKlodio Gui-ChênePas encore d'évaluation
- BouchardDocument113 pagesBouchardNTMPas encore d'évaluation
- Sur Images Du Ciel Et D Orient-208 PDFDocument4 pagesSur Images Du Ciel Et D Orient-208 PDFlukasesanePas encore d'évaluation
- SMITH LACROIX Louis - Pierre - Mythologie de LovecraftDocument132 pagesSMITH LACROIX Louis - Pierre - Mythologie de LovecraftBenjaminPas encore d'évaluation
- Fabiano - Nympholepsie Entre Religione T Paysage SCAN-libreDocument16 pagesFabiano - Nympholepsie Entre Religione T Paysage SCAN-libreNorthman57Pas encore d'évaluation
- Carrie Didier - Ludwig Brigitte - La Symbolique Des CathçdralesDocument42 pagesCarrie Didier - Ludwig Brigitte - La Symbolique Des CathçdralesMichael Roman100% (1)
- Crahay Roland. Jean Richer, Géographie Sacrée Du Monde Grec. Croyances Astrales Des Anciens Grecs. in L'antiquitéDocument3 pagesCrahay Roland. Jean Richer, Géographie Sacrée Du Monde Grec. Croyances Astrales Des Anciens Grecs. in L'antiquitéAlessandro MazzucchelliPas encore d'évaluation
- Asr 1460Document11 pagesAsr 1460mouhamed djeriPas encore d'évaluation
- Tema 6. Part 2Document19 pagesTema 6. Part 2Xenia CostaPas encore d'évaluation
- HOPKINS RétrofictionsDocument4 pagesHOPKINS RétrofictionsBen FPas encore d'évaluation
- Le Savant Fou - La Figure de L'alchimiste Dans La Littérature Du XIXe Et Du XXeDocument24 pagesLe Savant Fou - La Figure de L'alchimiste Dans La Littérature Du XIXe Et Du XXebenyellesPas encore d'évaluation
- Ainsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche: (Les Fiches de Lecture d'Universalis)D'EverandAinsi parlait Zarathoustra de Friedrich Nietzsche: (Les Fiches de Lecture d'Universalis)Pas encore d'évaluation
- Tradition Neo Platonicienne Et HermetiquDocument7 pagesTradition Neo Platonicienne Et HermetiquAlexandre JeanPas encore d'évaluation
- Article ApocalypseDocument10 pagesArticle ApocalypseKouassi Abraham PalanguePas encore d'évaluation
- Un critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son écoleD'EverandUn critique d'art dans l'antiquité - Philostrate et son écolePas encore d'évaluation
- L'athéisme Ou Le Refus de La CroyanceDocument11 pagesL'athéisme Ou Le Refus de La CroyancePhilippe RiouxPas encore d'évaluation
- Breve Histoire Des Idees Linguistiques PDFDocument16 pagesBreve Histoire Des Idees Linguistiques PDFJean-Philippe BABUPas encore d'évaluation
- Document Sans TitreDocument7 pagesDocument Sans TitreSawsan EL GharbiPas encore d'évaluation
- Sermon Sur L Unite Chretienne 2Document7 pagesSermon Sur L Unite Chretienne 2YvesPas encore d'évaluation
- Le Sens Légal Du Terme Coranique '' Taghoût '' Et Sa Comparaison Avec Les Mourji Contemporains .Document3 pagesLe Sens Légal Du Terme Coranique '' Taghoût '' Et Sa Comparaison Avec Les Mourji Contemporains .AhadouneAahadePas encore d'évaluation
- ManagementDocument34 pagesManagementHiba jerraPas encore d'évaluation
- Bachelard Et de BroglieDocument43 pagesBachelard Et de BroglieGabriel Kafure da RochaPas encore d'évaluation
- Animal, Animalité, Devenir Animal PDFDocument12 pagesAnimal, Animalité, Devenir Animal PDFSarah CarmoPas encore d'évaluation
- Lesoriginesdelal00bertuoft PDFDocument488 pagesLesoriginesdelal00bertuoft PDFAllana Duarte100% (1)
- Pierre Andre Julien 2012Document23 pagesPierre Andre Julien 2012SaidEtebbaiPas encore d'évaluation
- Tozzi Comparaison Des Méthodes de Philosophie Pour Enfants PDFDocument24 pagesTozzi Comparaison Des Méthodes de Philosophie Pour Enfants PDFjbrbooksPas encore d'évaluation
- Lec2-Connaissance ScientifiqueDocument27 pagesLec2-Connaissance ScientifiqueDiego ParraPas encore d'évaluation
- UE 1.3 L'Homme en QuestionDocument7 pagesUE 1.3 L'Homme en QuestionElisa Di GregorioPas encore d'évaluation
- Ethique Et FinanceDocument28 pagesEthique Et FinanceSmimi HakimPas encore d'évaluation
- Déterminisme Historique PDFDocument14 pagesDéterminisme Historique PDFAdministration IHETPas encore d'évaluation