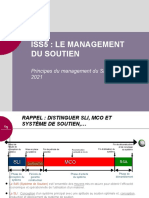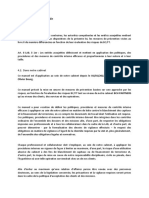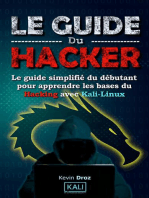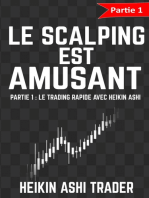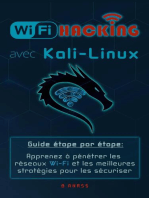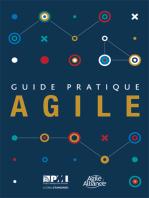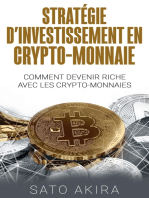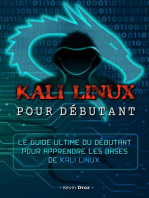Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cas Concret 1 - Zurbuch
Transféré par
AITTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cas Concret 1 - Zurbuch
Transféré par
AITDroits d'auteur :
Formats disponibles
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Spécification ASD S3000L : quels liens avec la sûreté de fonctionnement ?
ASD S3000L specification: Interaction with the RAMS activities
Kevin ZURBUCH et Olivier HURAULT
LGM
1 rue Emmanuel Arin
31300 Toulouse
kevin.zurbuch@lgm.fr
Résumé
Le standard S3000L propose une structuration du métier de l’Analyse du Soutien Logistique (ASL) intégrant de nombreux liens
avec le métier de la Sûreté de Fonctionnement à la fois dans les processus et activités mais également dans les échanges de
données. Au niveau ASL, les analyses SdF influencent la sélection des candidats et des tâches d’analyses associées. Par
ailleurs, elles justifient les besoins en tâches de maintenance au travers de l’analyse d’évènements déclencheurs au même titre
que d’autres justifications provenant d’autres domaines. Enfin, les données de Sûreté de Fonctionnement étant intégrées dans la
base de données ASL (BASL), cela permet de garantir la cohérence des analyses et des données manipulées par des métiers
différents.
Summary
S3000L specification gives a structure for the Logistic Support Analysis (LSA) including many interfaces with RAMS analysis
either in the process and activities than in data exchange. At LSA level, candidates and the associated analysis tasks are driven
by RAMS analysis. Moreover, the results of these analyses participate in justifying the need of maintenance tasks. At last, RAMS
data are integrated into the LSA database (LSAR) and provide the coherence between the analysis and the data processed by
other parts of the organization.
Introduction
Le standard S3000L fait partie d’une série de spécifications promues par l’ASD (AeroSpace and Defence Industries). Ces
spécifications concernent la conception du système et des produits du soutien (documentation opérationnelle, formation aux
opérateurs, plan de maintenance, outillages, etc.) jusqu’à la phase d’utilisation opérationnelle. Le standard S3000L concerne
plus particulièrement la structuration du métier de l’Analyse de Soutien Logistique (ASL), L’ASL à de nombreuses interactions
avec les métiers de la sûreté de fonctionnement, il est donc naturel que le standard S3000L les formalise à la fois en terme de
liens entre processus et activités (voir §1/), mais également en termes d’échanges de données (voir §2/).
1/ La Sûreté de Fonctionnement comme outil de construction et de justification du plan de maintenance
Un des enjeux principal de l’ASL est la construction du plan de maintenance, élément fondateur qui va ensuite orienter la
réalisation des éléments de soutien : documentation technique, besoin en formation, approvisionnement des rechanges, etc. Au
sens du standard S3000L (standard qui structure la démarche d’ASL), la construction du plan de maintenance repose sur une
règle d’or de justification des tâches de maintenance qui le compose. Cette justification est formalisée sous forme d’analyse des
évènements déclencheurs qui s’appliquent à chaque entité du système étudié (équipement, matériel, logiciel, sous-ensemble
etc.).
L’identification de ces éléments déclencheurs (générant donc des besoins en tâche de maintenance à formaliser dans le plan de
maintenance) relève, pour la plupart d’entre eux, des activités de sûreté de fonctionnement. Justification du plan de
maintenance et activité de sûreté de fonctionnement sont donc fortement liées dans le standard S3000L.
2/ La Sûreté de Fonctionnement et l’ASL partageant un référentiel de données commun pour des visions distinctes du système
Un apport majeur du standard S3000L est la définition d’un modèle de données qui permet de décrire toutes les vues métiers
d’un même produit (vue SLI, vue Design, vue Achat, vue SDF). Ce modèle de données permet ainsi d’apporter une cohérence
forte sur les analyses (AMDEC, LCC, arborescence fonctionnelle etc.) et les données manipulées par des métiers différents
(MTBF/MTTR, prix etc.).
3/ Plan de la communication
Cette communication resitue dans un premier paragraphe le standard S3000L dans le contexte des spécifications S. Ensuite,
une brève présentation du standard est réalisée avec un focus sur le cœur de l’activité : le processus ASL et la constitution du
plan de maintenance. Une fois ce contexte métier mis en lumière, il sera possible d’aborder les liens du référentiel ASL au sens
S30000L avec les activités de sureté de fonctionnement :
• Comment la Sûreté de Fonctionnement influence le processus ASL notamment sur la sélection des candidats ASL et
les tâches d’analyse associées,
• Comment la Sûreté de Fonctionnement permet via l’analyse d’évènement d’déclencheur de déterminer des besoins en
tâches de maintenance.
Enfin, le dernier paragraphe présentera l’apport du modèle de données du standard S3000L pour plus de cohérence avec les
activités de la sûreté de fonctionnement.
Communication 4C /4 page 1/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Les spécifications S
Les spécifications « S » sont nées de la volonté des organismes de normalisation d’établir des spécifications du Soutien
Logistique Intégré internationales. C’est dans ce cadre que l’Aerospace Industries Association (AIA) americaine et l’AeroSpace
and Defence Industries Association of Europe (ASD) dirigent conjointement l’établissement des spécifications S à partir des
normes MIL-HDBK-502, MIL-PRF-49506 et JSP 886 qui ont remplacé les anciens standards MIL-STD et DEF-STAN.
Cancelled 1997-05-30
US US
MIL-STD-1388 1A notice 4 MIL-HDBK-502
US US
MIL-STD-1388 2B notice 1 MIL-PRF-49506
Memorandum of understanding
Superseded 2010-04-16 Janvier 1995 (initial)
Standardisation des Electronic Data
UK UK
Def-Stan 00-60 Part 0 Issue 6 JSP 886 Interchange (EDI)
Figure 1. Convergence des standards SLI
L’ASD/AIA ont défini 5 spécifications principales définissant les activités principales du SLI :
• S1000D : Spécification des publications techniques
• S2000M : Spécification de gestion des matériels (approvisionnement, gestion des commandes)
• S3000L : Spécification de l’analyse du soutien logistique
• S4000P : Spécification de développement et d’amélioration continue de la maintenance préventive
• S5000F : Spécification des données du retour d’expérience opérationnel
Données de retour d‘expérience opérationnel S5000F
S2000M
Donnnées
opérations Données Matériels
d‘appro. Gestion
Conception du système et
et données
Analyse Des
Approv.
Utilisation opérationelle
Données ASL
des produits du soutien
du commandes
Soutien
Données Logistique
d’identification
conception
Données
Données tâches CI
S3000L IETM,
autres
media
Données Analyse de la Publication
d’identification Maintenance technique
conception programmée REX
Données
tâches
S4000P & S1000D
Planning Mtce
Données de conception
Figure 2. Spécifications SLI selon l’ASD/AIA
Le standard S3000L s’applique au métier du Soutien Logistique Intégré (SLI) et plus particulièrement aux Analyses de Soutien
Logistique (ASL). Il vise à :
• Expliquer la mission, la vision, les buts et les objectifs fixés des spécifications SLI et leur traduction en analyses ASL,
• Fournir un cadre qui documente le processus global de l’ASL et les interactions entre les différentes activités, les
processus et les échange de données,
• Expliquer comment s'interface les activités de l’ASL avec les autres domaines de l’entreprise : la conception,
l'ingénierie, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, la Sûreté de Fonctionnement, etc.
• Fournir des orientations concrètes sur la façon de satisfaire les exigences SLI/ASL (via exemples de mise en œuvre).
A noter les interfaces fortes du standards S3000L avec les autres domaines :
• Certaines données de l’analyse de la maintenance programmée définit par le standard S4000P sont traitées dans
l’analyse du soutien logistique (S3000L).
• l’ASL fournit des données sur les rechanges et approvisionnements pour la gestion des matériels (S2000M) et des
données de tâches de maintenance pour la construction de la documentation de maintenance (S1000D).
Communication 4C /4 page 2/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Constitution du standard S3000L
1. Les chapitres et auteurs
Le standard S3000L est divisé en 22 chapitres. De nombreux grands industriels de l’aéronautique ont participé à l’élaboration de
ces chapitres. La table 1 indique le nom du principal acteur industriel pour chaque chapitre.
N° Chapitre Auteur version 1.0 N° Chapitre Auteur version 1.0
01 Introduction EADS MAS 13 Analyse du soutien logiciel EADS MAS
02 Exigences générales BOEING
14 Prise en compte du Coût Global de Possession EADS CASA
03 Processus ASL EADS MAS
04 Management de la configuration EADS CASA
15 Analyse des obsolescences OCCAR
05 Influence sur la conception SAAB 16 Retour d’expérience opérationnel BOEING
06 Analyse des facteurs humains BOEING / EADS MAS 17 Démantèlement DASSAULT
07 AMDE ASL EUROCOPTER
18 Interrelation avec les autres spécifications ASD EADS-MAS / MTDTT
08 Analyse des dommages et évènements particuliers DASSAULT
09 Analyse des opérations connexes EADS MAS
19 Modèle de données SAAB
10 Analyse de la Maintenance Programmée EADS MAS 20 Echanges de données SAAB
11 Analyse des niveaux de réparation LOGSA 21 Termes, définitions et abréviations AGUSTA WESTLAND
12 Analyse des tâches de maintenance EADS MAS 22 Dictionnaire des données AGUSTA WESTLAND
Table 1. Les chapitres S3000L et leurs auteurs
2. Résumé du contenu du standard S3000L
• Chapitres 2, 3, 4, 5 : Ces chapitres donnent des informations générales pour le management du programme ASL
o Notamment par la description du plan de développement de l’activité ASL (chapitre 2) et par la formalisation
du processus général de l’ASL (chapitre 3) qui sera détaillé plus loin dans la présente communication.
o Le standard S3000L donne un aspect majeur à la gestion de configuration du référentiel de soutien produit
par l’ASL, et de sa cohérence avec le système principal (Chapitre 4).
• Chapitres 6 à 17: Ces chapitres décrivent les analyses du soutien logistique :
o D’abord par des analyses permettant de déterminer des besoins en tâches de maintenance (chapitre 6 à 10)
o Ensuite par des analyses de type optimisation ou caractérisation des tâches de maintenance (chapitre 11 à
15)
o Enfin des processus complémentaires en lien avec l’ASL (chapitre 15 à 17)
• Chapitres 18, 19, 20 et 22 : l’ensemble des analyses décrites aux chapitres 6 à 17 produisent des données
logistiques qui doivent être échangées avec d’autres métiers ou enregistrées dans une base de données (BASL).
Les activités de sûreté de fonctionnement étant étroitement liées à l’ASL, elles apparaissent dans de nombreux chapitres du
standard S3000L. La présente communication s’intéressera essentiellement au lien entre processus ASL et sûreté de
fonctionnement (chapitre 3) et aux activités de sûreté de fonctionnement qui permettent d’identifier des besoins en tâches de
maintenance (chapitre 07 et 08). Pour information, le chapitre 6 sur le facteur humain s’attache principalement à rappeler les
règles importantes en matière de HSE, comme par exemple des contraintes quant à la manipulation de charges lourdes ou de
travail en hauteur.
Implication de la SDF dans le processus ASL S3000L
1. Impact de la SdF dans la sélection des candidats ASL et tâches d’analyse
Le processus ASL S3000L peut être traduit et représenté par une succession d’analyses (voir figure 3) ayant principalement
pour données d’entrée :
• Les exigences d’utilisation et de soutien,
• Les documents supports nécessaires pour le pilotage de l’ASL (notamment les règles de gestion de configuration),
• Les informations du produit nécessaires pour le soutien (arborescence produit provenant du design).
La première étape dans le cycle d’analyse est de dresser l’arborescence logistique du produit à partir de la définition du produit
(arborescence produit). Cette étape consiste à traduire l’arborescence produit (souvent fonctionnel) sous un angle pertinent pour
la maintenance (souvent proche de l’arborescence de déploiement).
Le leitmotiv du processus l’ASL est de rationnaliser l’effort d’analyse. Il est donc nécessaire de classer les éléments de
l’arborescence (systèmes, matériels ou logiciels) en fonction de l’effort d’analyse qu’il est pertinent d’allouer. La sélection des
candidats ASL est donc une allocation de l’effort à chaque élément de l’arborescence logistique en fonction du type d’élément :
un vérin d’une chaine mécanique critique ne subira pas le même effort d’analyse que l’écran redondé d’une fonction support.
Une fois cette allocation d’effort effectué, qui constitue la « liste de candidats ASL » (CIL), le processus prévoit de sélectionner le
type d’analyses à mener (parmi un catalogue existant dans la S3000L ou adapté du retour d’expérience) toujours dans une
logique de rationalisation des efforts : le vérin précédemment cité sera la cible d’une AMDEC et d’une analyse de tâches de
maintenance détaillée alors que l’écran sera directement intégré dans le plan de maintenance sans aucune analyse amont.
Communication 4C /4 page 3/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
§2 §4 Documents supports au §3 Données produit importantes
Données d’usage et de soutien
comité de pilotage ASL pour le soutien
§5 Arborescence (logistique)
Sélection des candidats ASL
§5
Sélection des tâches d’analyse §6
Réalisation des tâches d’analyse
Accord sur la Accord sur les Accord sur les
CIL tâches résultats
Démarrage du §9
§7&8 développement des
Implication du client / revues logistiques produits logistiques
Figure 3. Processus ASL S3000L
Prenons un cas concret afin d’illustrer le déroulement du processus ASL et des choix à réaliser : un système sol de
communication satellite (figure 4). On considère les éléments suivants :
• Le système est constitué d’une antenne terrestre de communication et d’un shelter de gestion de la communication
et de contrôle-commande incluant des baies réalisant chacune une fonction spécifique (RF émission/réception,
Modem, contrôle, test, optique,…).
• La fonction RF émission/réception (baie communication) comme fonction principale et critique vis-à-vis de du
niveau élevé de disponibilité attendu pour le système.
• Au niveau conception, des redondances matérielles pour tenir l’objectif de disponibilité.
• Un diagnostic et obligation de réparation dans un délai d’1h maximum.
Figure 4. Exemple : Système sol de communication satellite
Communication 4C /4 page 4/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Dans ce système, la disponibilité est une exigence forte et oriente en partie la stratégie du soutien à adopter. Dans un premier
temps, il faut sélectionner les candidats ASL. Comme il n’est pas toujours simple de catégoriser les candidats pour déterminer
les efforts d’analyse à fournir (voir le cas vérin / écran précédent) le standard S3000L propose un guide de sélection des
candidats sous forme de logigramme avec des questions issues du retour d’expérience (voir figure 5).
Dans la baie de communication sol, la conversion en fréquence du signal à envoyer vers le satellite est assurée par deux
convertisseurs en redondance. Ces modules étant déposables, ils seront sélectionnés candidat ASL en respectant la logique de
sélection (figure 5). Les performances SdF (fiabilité) interviennent dans la sélection de ces candidats aux étapes Q4 et Q8 et
vont donc le catégoriser en « candidat complet », c’est-à-dire qu’il subira les analyses ASL l sélectionnées les plus lourdes.
Un rack déposable dans une baie participant à une fonction non critique pour la disponibilité pourra lui être catégorisé « candidat
non critique pour la chaine fonctionnelle, mais significatif en maintenance » et ainsi ne subir que certaines tâches d’analyse
orientées sur les besoins en logistique de maintenance.
Ainsi, la sélection des candidats ASL (et des efforts d’analyse associés) est basée sur les performances de sûreté de
fonctionnement que doivent atteindre ces candidats. Plus un candidat sera soumis à des contraintes de performance SDF fortes,
plus la profondeur des analyses ASL sera importante.
Non
Q6
Est-ce un article
Oui qui fait appel à des tâches de maintenance
complexes, prenant beaucoup de temps ou de
personnel et cela de manière
intensif ?
Non
Q7
Est-ce un
Oui équipement de soutien requis pour les tâches
de maintenance dédiés non-standard ou un
objet qui n'existe pas ?
Non
Q8
Est-ce un article
Oui qui a besoin de maintenance planifiée ou Non
préventive identifié dans le Scheduled Maintenance
Analysis (SMA) ?
CANDIDAT COMPLET
Figure 5. Logigramme de sélection d’un candidat ASL
La sélection des tâches d’analyse est proposée sous forme de matrice dans la spécification S3000L (voir figure 6). Les colonnes
de gauche représentent l’arborescence logistique avec la liste des candidats ASL sélectionnés (CIL) et les colonnes de droite
une proposition d’analyses à réaliser pour chaque candidat.
Dans l’exemple de station sol, les convertisseurs de la baie de communication peuvent directement impacter la disponibilité en
cas de défaillance commune, ils doivent donc être monitorés pour qu’un diagnostic de panne soit réalisé dès l’apparition d’un
symptôme. Des analyses détaillées de maintenabilité, testabilité, AMDE ASL… seront identifiées dans la matrice de sélection
des analyses pour ces « candidats complets ». Le rack déposable participant à une fonction « non critique » sera candidat « ASL
partielle » et pourrait ne pas nécessiter d’analyse.
Nota : Si dans les exigences du système l’aspect sécuritaire avait été défini prépondérant sur la disponibilité, les analyses à
sélectionner pour les candidats ASL auraient été : les analyses de fiabilité (Safety et AMDEC), AMDE ASL, facteurs humains et
APR (analyses des dommages et évènements spéciaux).
Communication 4C /4 page 5/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Figure 6. Exemple de matrice de sélection des analyses pour les candidats ASL.
2. La SdF pour la justification des tâches de maintenance
Dans le processus des analyses du soutien logistique, chaque tâche de maintenance constituant le plan de maintenance répond
à un besoin précis et doit être justifié. Il est nécessaire de formaliser cette justification en identifiant les évènements
déclencheurs. Les évènements déclencheurs sont principalement définis par les analyses suivantes :
• Analyse des modes de défaillances (AMDE/AMDEC) qui définit des tâches de maintenance correctives,
• Analyse de la maintenance programmée (MSG-3, RCM) qui définit des tâches de maintenance préventives,
• Analyse des dommages et évènements spéciaux (APR) qui définissent des tâches de maintenance corrective
(inspections et procédures de réparation),
Le standard S3000L propose des méthodes pour identifier à partir des différentes analyses (AMDEC, MSG3 etc.) les besoins en
tâches de maintenance programmée et non programmées (défaillances à réparer) :
• Pour les tâches non programmées :
o Dans la S3000L, les défaillances documentées dans l’AMDE/AMDEC produit sont traduites dans une AMDE
logistique (ASL) où les défaillances sont regroupées en fonction du type de réparation et de diagnostic. A
une défaillance doit être associée une tâche de réparation et une tâche de diagnostic. L’identification de ces
tâches de maintenance consolidées par l’analyse des tâches de maintenance permettent de répondre aux
évènements déclencheurs.
Resultat du regroupement de
Mode de défaillance 1
l‘AMDE ASL
Mode de défaillance 2
Mode de défaillance 3
Mode de Procédure de réparation 1
Mode de défaillance 4 défaillance ASL 1 Procédure de diagnostic 1
Mode de défaillance..
Mode de défaillance..
Mode de défaillance ..
Mode de défaillance ..
Résultat de Mode de défaillance ..
Mode de Procédure de réparation 1
l‘AMDE/ Mode de défaillance .. défaillance ASL 2 Procédure de diagnostic 2
AMDEC Mode de défaillance ..
produit Mode de défaillance ..
Mode de défaillance ..
Mode de défaillance ..
Mode de défaillance .. Mode de Procédure de réparation 2
Mode de défaillance .. défaillance ASL 3 Procédure de diagnostic 1
Mode de défaillance ..
Mode de défaillance ..
Figure 7. Lien entre l’AMDE/AMDEC produit et l’AMDE ASL.
Communication 4C /4 page 6/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Exemple avec les convertisseurs de la baie communication de la station sol:
Modes de défaillances issues de l’AMDEC produit : conversion de fréquence erronée due à une élévation de
température interne, conversion de fréquence instable due à une variation de température interne seront
consolidé dans l’AMDE ASL avec une inspection de l’état général du boitier convertisseur, des voyants d’état
et de la ventilation pour détecter un dysfonctionnement de la ventilation. La tâche de maintenance associée
sera le remplacement du module convertisseur.
o L’analyse des dommages et des évènements spéciaux (non liés au fonctionnement normal ou de nature
externe, interne) est une analyse de type APR comportant une double approche usage et technologique.
Elle identifie et liste les évènements ou dommages à considérer sur un élément ou une pièce du produit.
Une analyse de criticité (impact sécurité, fiabilité, disponibilité…) est réalisée à partir d’éléments
sélectionnés dans cette liste et abouti sur l’identification des besoins en tâches de maintenance.
Les deux principales étapes sont :
Identifier les évènements spéciaux dans les différentes phases du produit (APR) avec critère
d’occurrence,
Identifier les potentiels dommages sur le produit (technologie mature ? sensible ou résistante à un
dommage considéré ?
Figure 8. Approche usage et technologique pour l’analyse des risques.
Exemple avec les convertisseurs de la baie communication de la station sol:
Evènement spécial : Disfonctionnement interne due à un dommage sur la face de ventilation de
l’équipement après intervention de maintenance (Evènement probable)
Elément de faiblesse : Le boitier du convertisseur présente une face arrière de ventilation sensible
aux chocs car la structure est dépourvue de protection contre ce type de dommage.
Criticité : Ce problème peut générer l’arrêt de la ventilation et à terme la panne de l’équipement.
Identification de la tâche de maintenance : Inspection visuelle de l’état du boitier après chaque
intervention de maintenance et test de bon fonctionnement de l’équipement.
• Pour les tâches programmées :
La S3000L vient compléter le processus d’analyse de la S4000P dédié à la maintenance programmée qui ne réalise que
l’identification des tâches de maintenance, intervalles et seuils. Elle définit la sélection des candidats à la maintenance
programmée, la caractérisation des tâches élémentaires et la consolidation du plan de maintenance programmée.
Le standard S4000P n’est pas l’objet de cette communication mais intègre des notions très liées à sûreté de fonctionnement et
particulièrement dans les analyses Système (ex.: MSG-3). Elles caractérisent les défaillances fonctionnelles du système basé
sur les AMDEC produits et système afin de caractériser l’impact opérationnel des défaillances (impact sur la mission
opérationnel, impact safety, impact économique). Elles permettent aussi grâce aux données de fiabilité de déterminer la
périodicité des tâches de maintenance préventive.
3. Les modèles de données et intérêt pour la Sûreté de Fonctionnement
La standardisation des informations relatives au données du soutien logistique, et donc au référentiel de maintenance, tient son
origine dans les travaux de normalisation du ministère de la défense américaine (US DOD1). La norme MIL-STD-1388 2A en
1984 (remplacée par la révision B en 1991) est la première à proposer une représentation formalisée des données logistiques.
Encore utilisée de nos jours sur certains programmes de défense, elle est à l’origine de nombreuses déclinaisons dans les
systèmes d’information industriels. Malgré une certaine lourdeur de codification, elle constitue en effet une excellente base à
l’époque pour structurer l’information de maintenance. Les industriels ont donc été très nombreux à s’inspirer de ce modèle pour
définir des structurations plus proches de leurs besoins y compris dans les applications civiles du transport ferroviaire ou de
l’aéronautique.
30 ans d’expériences de ce standard ont progressivement fait apparaître certaines faiblesses dans son application. Le standard
S3000L vise à s’affranchir de ces faiblesses et propose une nouvelle structuration de l’information :
• gestion de configuration plus complète,
• gestion des variantes de plan de maintenance alignées sur les principes de l’ASD S1000D pour la gestion des data
modules documentaires,
• multi-identification des objets et désignations multi-langues,
• approche modulaire autorisant une réutilisation massive des informations.
1
United States Department of Defense
Communication 4C /4 page 7/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Figure 9. Extrait de la représentation S3000L
Outre ces compléments visant à compenser des manques dans la gestion de l’information logistique, la spécification S3000L
constitue la première spécification à s’appuyer explicitement sur la norme ISO 10303 AP239 plus connu sous le nom de PLCS2.
Cette normalisation constitue un « fond de panier » standard dans la manière dont les données doivent être codifiées. Une tâche
de maintenance par exemple exprimée dans la S3000L comme un ensemble d’objets « Task » et « TaskRevision » s’appuie sur
un objet standard « activity_method » dans PLCS. L’utilisation de cette codification ISO autorise une plus grande interopérabilité
entre partenaires et services souhaitant échanger de l’information. Elle constitue en effet un référentiel indépendant de tout
secteur d’activité, industriels ou éditeur de logiciel. PLCS fournit en quelque sorte un format pivot neutre par lequel peut transiter
des informations de maintenance échangée entre un industriel fournisseur de système et un exploitant opérateur de ce même
système.
Ces apports permettent logiquement un meilleur interfaçage entre les différents métiers pour un projet donné. Ainsi, un article
peut avoir 1 ou plusieurs identifiants. Chaque identifiant est distingué par sa classe. Ainsi, chaque métier peut nommer une pièce
avec sa propre dénomination, ou la référence d’un article peut être multiple (Exemple : Référence fournisseur, référence OTAN,
référence intégrateur, référence interne industriel, référence bibliothèque de composant etc.). Ce principe est valable également
pour d’autres caractéristiques telles que les appellations, les versions, …
Un autre atout du modèle de donnée proposé dans la S3000L est de présenter l’arborescence comme une vue particulière du
système selon les besoins inhérents au métier (Arborescence fonctionnelle, arborescence organique, arborescence mixte,
arborescence de zone,…) tout en gardant la cohérence entre les différentes vues. Ce modèle de données permet ainsi
d’apporter une cohérence forte sur les données manipulées par des métiers différents (MTBF/MTTR, arborescence logistique
etc.).
2
Product Life Cycle Support
Communication 4C /4 page 8/9
e
20 Congrès de maîtrise des risques et de sûreté de fonctionnement - Saint-Malo 11-13 octobre 2016
Figure 10. Exemple de représentation multiple dans le standard S3000L
Conclusion
La S3000L présente quelques améliorations notables d’intégration/interface métier entre le Soutien Logistique Intégré et la
Sûreté de Fonctionnement :
• L’exploitation du plein potentiel de l’AMDEC pour le Soutien Logistique Intégré permet :
• Une recherche de traçabilité forte entre besoin en tâche de maintenance et études de sûreté de fonctionnement
(AMDEC, évènements spéciaux, etc.)
• Un modèle de données qui permet l’alignement des baselines d’arborescence techniques du produit cohérente
entre soutien logistique intégré et sûreté de fonctionnement pour des interfaces d’outils facilitées.
Ce standard est actuellement mis en œuvre sur un programme satellite institutionnel, mais au stade actuel de la production
de la présente communication, les résultats ne sont pas encore disponibles. Pour
8 Références
ASD S3000L V1.1
ISO 10303 AP239
Communication 4C /4 page 9/9
Vous aimerez peut-être aussi
- ISS5 Day 1 PM Principes de Management Au Soutien 2020Document23 pagesISS5 Day 1 PM Principes de Management Au Soutien 2020Matthieu MalecoupPas encore d'évaluation
- Évaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesD'EverandÉvaluations nationales des acquis scolaires, Volume 3: Mettre en oeuvre une évaluation nationale des acquis scolairesÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Perfomrance MaintenanceDocument15 pagesPerfomrance MaintenanceOussama LSPas encore d'évaluation
- 3 A 9 IlDocument121 pages3 A 9 IlOtman AmmiPas encore d'évaluation
- Gestion Des Flux Chap1Document25 pagesGestion Des Flux Chap1rida fargaliPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Service MaintenanceDocument59 pagesChapitre 4 Service Maintenancenassima azegrar100% (1)
- 533 D 1159 DaacfDocument3 pages533 D 1159 DaacfMoncef ChaouiPas encore d'évaluation
- Referentiel SupplyChainPlus Version2023 V1 7septembre2023Document14 pagesReferentiel SupplyChainPlus Version2023 V1 7septembre2023guyotjeanmi52100% (1)
- Supply ChainDocument18 pagesSupply ChainsyPas encore d'évaluation
- Management Des Ressources de La ProductionDocument4 pagesManagement Des Ressources de La ProductionAhlam AbadiPas encore d'évaluation
- N1201 - Affrètement Transport: EmploisDocument3 pagesN1201 - Affrètement Transport: EmploisStudioWaouw Training Channel100% (1)
- Performance Logistique PMEDocument20 pagesPerformance Logistique PMEmekkaouiPas encore d'évaluation
- SCM Serie 2 Stock ApproDocument4 pagesSCM Serie 2 Stock ApprorthtrhPas encore d'évaluation
- Décarbonées Mobilités: Un Défi GlobalDocument81 pagesDécarbonées Mobilités: Un Défi GlobalGrégoireSansonPas encore d'évaluation
- KPI AmontDocument2 pagesKPI AmontSlamo lafraitissPas encore d'évaluation
- TP 1: Introduction À La Simulation: Matiere: Conception Des Systemes de ProductionDocument6 pagesTP 1: Introduction À La Simulation: Matiere: Conception Des Systemes de ProductionEntissar BoukhariPas encore d'évaluation
- Lexique LogistiqueDocument5 pagesLexique LogistiqueMaryse DechozPas encore d'évaluation
- Contraintes Des Services Logistiques - LOGIN Janv 2021Document100 pagesContraintes Des Services Logistiques - LOGIN Janv 2021triplej189100% (1)
- Le Cas Picaso: Utilisation de PréludeDocument8 pagesLe Cas Picaso: Utilisation de PréludeAyoub RiahiPas encore d'évaluation
- Memoire Master en Cours 2017.2018.maisson - Alt Plan 2 1.finalDocument111 pagesMemoire Master en Cours 2017.2018.maisson - Alt Plan 2 1.finalpaulin maissonPas encore d'évaluation
- Lexique Franco Anglais Du Transport Et de La Logistique - 1 PDFDocument5 pagesLexique Franco Anglais Du Transport Et de La Logistique - 1 PDFasa25asab100% (1)
- Chapitre 02-MRP2 (Mode de Compatibilité)Document25 pagesChapitre 02-MRP2 (Mode de Compatibilité)fhfhbfhgcbfghdh100% (1)
- Maintenance AERO GabonDocument66 pagesMaintenance AERO GabonedggyPas encore d'évaluation
- Muda, Muri, Mura Pour Éliminer Le GaspillageDocument4 pagesMuda, Muri, Mura Pour Éliminer Le Gaspillagemed amine mnasserPas encore d'évaluation
- Gestion Des Stocks Notions de BaseDocument33 pagesGestion Des Stocks Notions de BaseMIANOPas encore d'évaluation
- Diaporama Gipsi M2 FLUXDocument43 pagesDiaporama Gipsi M2 FLUXMed Aymen SalemPas encore d'évaluation
- Cahier Du Charge GMAODocument3 pagesCahier Du Charge GMAOabdouPas encore d'évaluation
- Transactions SAP SD PDFDocument2 pagesTransactions SAP SD PDFBeniche SidahmedPas encore d'évaluation
- Chap 1Document16 pagesChap 1Abdessamad BelabyadPas encore d'évaluation
- Securite D'entrepôtDocument15 pagesSecurite D'entrepôtJean Jacques BabouPas encore d'évaluation
- Manuel 20GSE 201 5 2 20 28r C3 A9vision 201 5 3 29Document105 pagesManuel 20GSE 201 5 2 20 28r C3 A9vision 201 5 3 29Rick AgbaPas encore d'évaluation
- Chap 3 - La Logistique IndustrielleDocument4 pagesChap 3 - La Logistique IndustrielleMoussodou Aurlane caramelPas encore d'évaluation
- Manuel D Utilisation PRELUDEDocument47 pagesManuel D Utilisation PRELUDErezgfhPas encore d'évaluation
- Examen DS MO1 - Octobre 2014Document3 pagesExamen DS MO1 - Octobre 2014eyasayari216100% (1)
- Support de Cours Logistique Industrielle Partie I&II-1Document310 pagesSupport de Cours Logistique Industrielle Partie I&II-1anouar goutouPas encore d'évaluation
- Contribution À L'optimisation D'un Processus de Production Par Le Diagramme D'ishikawa.Document14 pagesContribution À L'optimisation D'un Processus de Production Par Le Diagramme D'ishikawa.s cherguiPas encore d'évaluation
- Chap 3 Logistique IndustrielleDocument11 pagesChap 3 Logistique IndustrielleGomairi Safae100% (1)
- Mémoire de Stage ENSI 2019Document84 pagesMémoire de Stage ENSI 2019Mohamed Elghazi100% (1)
- Corrigé DS 2017Document5 pagesCorrigé DS 2017thouraya hadj hassenPas encore d'évaluation
- Gmao EnitDocument4 788 pagesGmao Enitaboustif maslouhiPas encore d'évaluation
- Présentation Fleet Tracking - IT SERVICES PDFDocument11 pagesPrésentation Fleet Tracking - IT SERVICES PDFArnaud KouamPas encore d'évaluation
- Chapitre 7 - AM - 2Document44 pagesChapitre 7 - AM - 2leePas encore d'évaluation
- Les Leviers de La Réduction Des CoûtsDocument16 pagesLes Leviers de La Réduction Des CoûtsYoussef El OualiPas encore d'évaluation
- 2 PDFDocument62 pages2 PDFAbdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- EvologDocument4 pagesEvologSoufiane ZaroukPas encore d'évaluation
- Tableau Synthese - E6 2016 - Mousavizadeh AlexandreDocument1 pageTableau Synthese - E6 2016 - Mousavizadeh Alexandreapi-286563396Pas encore d'évaluation
- Reception Marchandises PDFDocument45 pagesReception Marchandises PDFaneflous khadijaPas encore d'évaluation
- Cours - Partie1Document27 pagesCours - Partie1simo jinPas encore d'évaluation
- Gestion Des Moyens HumainsDocument76 pagesGestion Des Moyens HumainsMohamed El Omrani100% (1)
- CHap I Maintenance PDFDocument9 pagesCHap I Maintenance PDFmohameddPas encore d'évaluation
- KPI: Indicateurs de Performance Dans Les TransportsDocument2 pagesKPI: Indicateurs de Performance Dans Les Transportsabdou100% (1)
- MemoireDocument57 pagesMemoireYacoub CheikhPas encore d'évaluation
- Check - List Audit Commandes.Document2 pagesCheck - List Audit Commandes.Sarah ADNANEPas encore d'évaluation
- 07 - MRP - Plannification Des BesoinsDocument37 pages07 - MRP - Plannification Des Besoinsyanis sellamPas encore d'évaluation
- M0084DESAG09Document119 pagesM0084DESAG09constantPas encore d'évaluation
- 02-81 Cas LazurexDocument16 pages02-81 Cas LazurexKOUAMI DONKEE GBOLOHAPas encore d'évaluation
- Le Christ Est La Vraie VieDocument1 pageLe Christ Est La Vraie VieElisabethPas encore d'évaluation
- M01 RSMDocument35 pagesM01 RSMHAMZA ED-DAHMANIPas encore d'évaluation
- Cas YohannDocument11 pagesCas YohannAndrianarivonyPas encore d'évaluation
- 0 - Pilotage Du Changement - Approche GlobaleDocument89 pages0 - Pilotage Du Changement - Approche GlobaleAITPas encore d'évaluation
- 1 - La Résistance Au ChangementDocument18 pages1 - La Résistance Au ChangementAITPas encore d'évaluation
- 4 - Énergie de PilotageDocument4 pages4 - Énergie de PilotageAITPas encore d'évaluation
- 3 - Processus de DeuilDocument13 pages3 - Processus de DeuilAITPas encore d'évaluation
- Cas 2 ZaraDocument10 pagesCas 2 ZaraAITPas encore d'évaluation
- ZARADocument8 pagesZARAAITPas encore d'évaluation
- Exemple Projet LeanDocument5 pagesExemple Projet LeanAITPas encore d'évaluation
- T01 - Registre Des Parties PrenantesDocument1 pageT01 - Registre Des Parties PrenantesAIT100% (1)
- T11 - Guide - Plan de ManagementDocument17 pagesT11 - Guide - Plan de ManagementAITPas encore d'évaluation
- 00 - Matrice Des AttendusDocument1 page00 - Matrice Des AttendusAITPas encore d'évaluation
- 02 - Planifier Un Projet 2020 (J2)Document56 pages02 - Planifier Un Projet 2020 (J2)AITPas encore d'évaluation
- Dossier Management de Projet1Document12 pagesDossier Management de Projet1AITPas encore d'évaluation
- T05 - RACI Et ChargesDocument3 pagesT05 - RACI Et ChargesAITPas encore d'évaluation
- 03 - Realiser Un Projet 2020 (J3)Document25 pages03 - Realiser Un Projet 2020 (J3)AITPas encore d'évaluation
- T00 - Recueil Des ExigencesDocument1 pageT00 - Recueil Des ExigencesAITPas encore d'évaluation
- 01 - Demarrer Un Projet 2020 (J1)Document20 pages01 - Demarrer Un Projet 2020 (J1)AITPas encore d'évaluation
- 01 - Sujet 0 E2 Sen ElectrodomDocument24 pages01 - Sujet 0 E2 Sen ElectrodomFantomasPas encore d'évaluation
- 10.4.4 Lab - Build A Switch and Router NetworkDocument7 pages10.4.4 Lab - Build A Switch and Router NetworkPape FayePas encore d'évaluation
- Examen Productique1-TF 2021Document2 pagesExamen Productique1-TF 2021Oumayma BoudaboussPas encore d'évaluation
- GERE02 Plan de Formation (Novembre 2020) PDFDocument4 pagesGERE02 Plan de Formation (Novembre 2020) PDFTeslem MbPas encore d'évaluation
- Help SystemeDocument9 pagesHelp SystemeMoad TarifiPas encore d'évaluation
- Rapport Organisé PDFDocument59 pagesRapport Organisé PDFAmira BedhiafiPas encore d'évaluation
- CCTP Etude L342-2Document55 pagesCCTP Etude L342-2Eric AGBANGBATINPas encore d'évaluation
- Controle 3 - 1 S2 PC TC FRDocument5 pagesControle 3 - 1 S2 PC TC FRChaoui YoussefPas encore d'évaluation
- La Guerre Des Mã©taux Rares La Face Cachã©e de La Transition énergétique Et Numã©rique by Guillaume PitronDocument201 pagesLa Guerre Des Mã©taux Rares La Face Cachã©e de La Transition énergétique Et Numã©rique by Guillaume PitronMadeleine NdioroPas encore d'évaluation
- Manuel Lab - BCHDocument21 pagesManuel Lab - BCHGiuffridaPas encore d'évaluation
- RapportDocument53 pagesRapportmarcel kouassiPas encore d'évaluation
- Gianlea 375Document3 pagesGianlea 375Andry Ny Aina LightPas encore d'évaluation
- DGEA Burkina Faso 2016 2030Document127 pagesDGEA Burkina Faso 2016 2030Liliou ArthurPas encore d'évaluation
- OrigalysDocument4 pagesOrigalysfatima azalmadPas encore d'évaluation
- Résumé Descriptif de La Certification: Le Répertoire National Des Certifications Professionnelles (RNCP)Document10 pagesRésumé Descriptif de La Certification: Le Répertoire National Des Certifications Professionnelles (RNCP)Kolia PerdrixPas encore d'évaluation
- Catalogue Maintenance PreventiveDocument112 pagesCatalogue Maintenance PreventiveFadhel GuesmiPas encore d'évaluation
- C'est Quoi Une Fintech ?: Néobanques, Crowdfunding, Robo-AdvisorsDocument2 pagesC'est Quoi Une Fintech ?: Néobanques, Crowdfunding, Robo-AdvisorsṦAi DįPas encore d'évaluation
- Plaquette CRPDocument21 pagesPlaquette CRPLucien LOPas encore d'évaluation
- Panneaux Et Autocollants Sécurité Incendie - SignalsDocument7 pagesPanneaux Et Autocollants Sécurité Incendie - SignalsArielPas encore d'évaluation
- GrafcetDocument70 pagesGrafcetMajda MajdaPas encore d'évaluation
- Citroën Berlingo 2015 - Communiqué de PresseDocument13 pagesCitroën Berlingo 2015 - Communiqué de PressegiugiuPas encore d'évaluation
- 03-Terminaux Et Commandes de Base PDFDocument40 pages03-Terminaux Et Commandes de Base PDFkhaledPas encore d'évaluation
- 29-Déploiement Des Serveurs Et Postes de Travail-Créer Et DéployerDocument15 pages29-Déploiement Des Serveurs Et Postes de Travail-Créer Et DéployerYoussef AddiPas encore d'évaluation
- Plan EtabliDocument6 pagesPlan EtabliSamantha EricksonPas encore d'évaluation
- MCFR 01213 - Catalogue Volets Roulants 16p - WEBDocument16 pagesMCFR 01213 - Catalogue Volets Roulants 16p - WEByoyo173frPas encore d'évaluation
- 23-Géométrie-Des-Trains-Roulants - CopieDocument18 pages23-Géométrie-Des-Trains-Roulants - CopieClément GuérinPas encore d'évaluation
- GPME Communication Chap02 CorrigeDocument8 pagesGPME Communication Chap02 CorrigeThomBlioPas encore d'évaluation
- Management (2) 1Document13 pagesManagement (2) 1HAKĪ MAPas encore d'évaluation
- TD4 EtuDocument20 pagesTD4 EtuNada RafikPas encore d'évaluation
- TD4 CorrigéDocument2 pagesTD4 CorrigéyouknotPas encore d'évaluation
- Apprendre Python rapidement: Le guide du débutant pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur Python, même si vous êtes nouveau dans la programmationD'EverandApprendre Python rapidement: Le guide du débutant pour apprendre tout ce que vous devez savoir sur Python, même si vous êtes nouveau dans la programmationPas encore d'évaluation
- La comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreD'EverandLa comptabilité facile et ludique: Il n'a jamais été aussi simple de l'apprendreÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- L'analyse fondamentale facile à apprendre: Le guide d'introduction aux techniques et stratégies d'analyse fondamentale pour anticiper les événements qui font bouger les marchésD'EverandL'analyse fondamentale facile à apprendre: Le guide d'introduction aux techniques et stratégies d'analyse fondamentale pour anticiper les événements qui font bouger les marchésÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (4)
- Le guide du hacker : le guide simplifié du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxD'EverandLe guide du hacker : le guide simplifié du débutant pour apprendre les bases du hacking avec Kali LinuxÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Le Scalping est Amusant!: Partie 1: Le trading rapide avec Heikin AshiD'EverandLe Scalping est Amusant!: Partie 1: Le trading rapide avec Heikin AshiÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Revue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteD'EverandRevue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (3)
- Dark Python : Apprenez à créer vos outils de hacking.D'EverandDark Python : Apprenez à créer vos outils de hacking.Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Ce que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millionsD'EverandCe que vos commerciaux ne font pas et qui vous coûte des millionsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Wireshark pour les débutants : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de l’analyse réseau avec Wireshark.D'EverandWireshark pour les débutants : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de l’analyse réseau avec Wireshark.Pas encore d'évaluation
- Python | Programmer pas à pas: Le guide du débutant pour une initiation simple & rapide à la programmationD'EverandPython | Programmer pas à pas: Le guide du débutant pour une initiation simple & rapide à la programmationPas encore d'évaluation
- Le Guide Rapide Du Cloud Computing Et De La CybersécuritéD'EverandLe Guide Rapide Du Cloud Computing Et De La CybersécuritéPas encore d'évaluation
- Secrets du Marketing des Médias Sociaux 2021: Conseils et Stratégies Extrêmement Efficaces votre Facebook (Stimulez votre Engagement et Gagnez des Clients Fidèles)D'EverandSecrets du Marketing des Médias Sociaux 2021: Conseils et Stratégies Extrêmement Efficaces votre Facebook (Stimulez votre Engagement et Gagnez des Clients Fidèles)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- 7 Techniques Pour Augmenter Vos Revenus: Rentabilisez vos passions, Testez vos idées et Lancez votre business sans risqueD'Everand7 Techniques Pour Augmenter Vos Revenus: Rentabilisez vos passions, Testez vos idées et Lancez votre business sans risqueÉvaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (3)
- Technologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandTechnologie automobile: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Guide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsablesD'EverandGuide OCDE-FAO pour des filières agricoles responsablesPas encore d'évaluation
- Wi-Fi Hacking avec kali linux Guide étape par étape : apprenez à pénétrer les réseaux Wifi et les meilleures stratégies pour les sécuriserD'EverandWi-Fi Hacking avec kali linux Guide étape par étape : apprenez à pénétrer les réseaux Wifi et les meilleures stratégies pour les sécuriserPas encore d'évaluation
- L'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.D'EverandL'analyse technique facile à apprendre: Comment construire et interpréter des graphiques d'analyse technique pour améliorer votre activité de trading en ligne.Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (6)
- Guide Pour Les Débutants En Matière De Piratage Informatique: Comment Pirater Un Réseau Sans Fil, Sécurité De Base Et Test De Pénétration, Kali LinuxD'EverandGuide Pour Les Débutants En Matière De Piratage Informatique: Comment Pirater Un Réseau Sans Fil, Sécurité De Base Et Test De Pénétration, Kali LinuxÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Investir pour les débutants - Démarrer en 10 étapes facilesD'EverandInvestir pour les débutants - Démarrer en 10 étapes facilesÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)
- WiFi Hacking : Le guide simplifié du débutant pour apprendre le hacking des réseaux WiFi avec Kali LinuxD'EverandWiFi Hacking : Le guide simplifié du débutant pour apprendre le hacking des réseaux WiFi avec Kali LinuxÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (1)
- Agile Practice Guide (French)D'EverandAgile Practice Guide (French)Évaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Stratégie d'Investissement en Crypto-monnaie: Comment Devenir Riche Avec les Crypto-monnaiesD'EverandStratégie d'Investissement en Crypto-monnaie: Comment Devenir Riche Avec les Crypto-monnaiesÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (11)
- Kali Linux pour débutant : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de Kali Linux.D'EverandKali Linux pour débutant : Le guide ultime du débutant pour apprendre les bases de Kali Linux.Évaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le dropshipping pour les débutants: Comment vivre de sa boutique E-commerce sans stock, sans investissement et sans expérience.D'EverandLe dropshipping pour les débutants: Comment vivre de sa boutique E-commerce sans stock, sans investissement et sans expérience.Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (5)