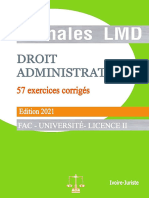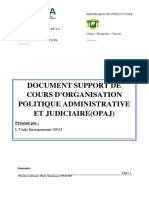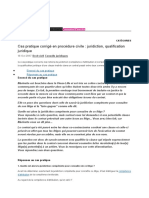Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Dissertation Juridique (Methodologie)
La Dissertation Juridique (Methodologie)
Transféré par
ODILE TAIKAO MANDANDYTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Dissertation Juridique (Methodologie)
La Dissertation Juridique (Methodologie)
Transféré par
ODILE TAIKAO MANDANDYDroits d'auteur :
Formats disponibles
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.
LA DISSERTATION JURIDIQUE
(METHODOLOGIE)
La dissertation fait appel aux qualités d’expression, de réflexion et
d’exposition du candidat. Elle n’est pas normalement une question de cours
laquelle à la limite révèle une capacité de mémoire.
Tout travail de dissertation se déroule en deux phases successives :
l’analyse du sujet et l’exposition du sujet.
I – Méthode d’analyse du sujet.
Cette partie du travail comprend 3 étapes :
- La définition des termes du sujet.
- Le recensement des connaissances
- La mise en ordre des connaissances ou plan
A – La définition des termes du sujet
Tous les mots constituant le libellé du sujet et ayant une signification
propre doivent faire l’objet d’une réflexion approfondie. Il s’agit d’en préciser
les différentes significations et d’apprécier ainsi avec le maximum de certitude
la portée et le sens. C’est le seul moyen d’éviter les oublis ou les contresens dans
la compréhension du sujet.
B – Le recensement des connaissances
Le candidat doit recenser dans l’ordre où ceux-ci se présentent à son esprit
tous les éléments concernés par le sujet. Il faut rechercher ceux-ci dans les
cours, dans l’actualité ou dans une réflexion personnelle.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 1
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
C – La mise en ordre des connaissances (plan)
Le plan doit toujours introduire la clarté dans le travail. Il comporte en
général deux parties. Les deux parties doivent être intitulées, ce qui permet de
vérifier l’homogénéité et la cohésion des divisions envisagées.
NB : A ce stade, le candidat connaît exactement :
- Le sens du sujet qui lui est proposé (définition des termes du sujet).
- Le contenu du sujet qui lui est proposé (recensement des connaissances)
- la démarche d’exposition du sujet (plan)
Tout ce travail préliminaire doit se faire au brouillon avant l’exposition
proprement dite du sujet.
II – L’EXPOSITION DU SUJET
En général l’exposition du sujet comprend trois parties :
- L’introduction
- Le corps du sujet
- La conclusion.
A – L’Introduction
Elle peut être assez longue et comprend nécessairement les éléments
suivants :
- Définition du sujet et délimitation justifiée.
- Importance du sujet et actualité du sujet (ici prennent place si nécessaire
l’historique du sujet ou des éléments de droit comparé).
- Justification et annonce du plan.
B - Le corps du sujet
C’est l’exposé suivant le plan annoncé des connaissances et des
réflexions recensées. Il faut éviter les répétitions. Ne passer à une question
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 2
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
qu’après avoir épuisé la précédente. Adopter une présentation aérée qui traduit
matériellement la progression.
C – La conclusion
Elle est facultative. Mais si elle existe ou même est nécessaire, elle ne doit
être :
- Ni un ‘ ‘ fourre- tout ’’ où prend place ce qui a été oublié ailleurs.
- Ni un résumé.
Elle peut attirer l’attention sur un problème nouveau non examiné dans le
cadre du sujet mais lié à celui-ci.
Remarques Générales.
- Eviter les fausses introductions c’est- à - dire les éléments hors du sujet ou les
banalités du genre ‘’de tout temps les hommes ; il était une fois ; depuis l’aube
des temps, etc.’’
- Ne pas craindre d’exprimer des remarques personnelles si elles sont motivées
et ont un rapport avec le sujet. Eviter en revanche de se montrer gratuitement
polémique.
- Bien comprendre que sont appréciées sans doute des connaissances exactes et
complètes mais aussi et d’abord la clarté d’expression et de pensée et
l’intelligence du sujet.
- Eviter absolument les contradictions entre deux phrases et les illogismes.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 3
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
INTRODUCTION GENERALE
Le droit administratif est une branche du droit public interne. Il peut se
définir comme le droit applicable à l’administration. Mais pour mieux le cerner,
il convient d’abord de l’examiner au regard de sa définition exhaustive et de ses
caractères avant d’aborder son objet.
I – DEFINITION ET CARACTERES DU DROIT ADMINISTRATIF
A - Définition
La définition du droit administratif diffère selon qu’on se réfère au critère
organique ou au critère matériel ; le premier est extensif et le second restrictif.
1- La définition organique extensive
Suivant ce critère qui se réfère à l’organe auquel il s’applique, le droit
administratif est celui applicable à l’administration ; c’est le droit de
l’administration. C’est un corps de règles applicables à l’administration. Cette
définition est extensive car elle vise toutes les règles applicables à
l’administration (les règles de droit public et les règles de droit privé).
2- La définition matérielle restrictive
Suivant ce critère qui se réfère à son contenu, le droit administratif est un
droit spécial. Il se compose uniquement de règles foncièrement différentes du
droit commun (droit privé) et y dérogent. C’est donc un ensemble de règles
spéciales particulières dérogatoires au droit commun et applicables à
l’administration. Cette définition est restrictive car elle limite le droit
administratif aux seules règles spéciales applicables à l’administration à
l’exclusion des normes de droit privé.
B – Les caractères du droit administratif
Le droit administratif à trois caractères : c’est un droit essentiellement
jurisprudentiel, un droit autonome et un droit exorbitant.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 4
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
1- Un droit essentiellement jurisprudentiel
Le droit administratif contrairement au droit civil n’est pas un droit
codifié mais un droit qui a été progressivement élaboré par le juge.
La jurisprudence est en effet créatrice de normes juridiques et base
principale du droit administratif.
La jurisprudence en tant que créatrice de normes juridiques a contribué
pour une très large part à l’élaboration des règles du droit administratif. Ce droit,
ainsi qu’il a déjà été indiqué, est un droit non codifié ou insuffisamment codifié
contrairement au droit civil. Ainsi, devant l’imprécision des textes, leur
insuffisance ou même leur absence, c’est au juge qu’il appartient d’élaborer
progressivement le droit administratif.
La jurisprudence en tant que base principale du droit administratif vient
combler les lacunes législatives. Certes, il y a quelques textes en droit
administratif (les dispositions de la constitution sur l’administration, le statut
général de la fonction publique), mais ces textes sont peu abondants. La
jurisprudence constitue donc la base même du droit administratif car c’est elle
qui porte les grandes théories et les grands principes qui confèrent à ce droit son
originalité. En effet, c’est la jurisprudence qui a par exemple dégagé le régime
applicable à la responsabilité de la puissance publique, à l’exécution des actes
administratifs unilatéraux et des contrats administratifs, au domaine public, au
recours contentieux etc.
2- Un droit autonome
L’autonomie du droit administratif s’affirme par rapport au droit privé.
Cette autonomie a été consacrée par l’arrêt Blanco en 1873 en France et par
l’arrêt société des centaures routiers en 1970 en Côte d’Ivoire. Ainsi, seul le
droit administratif qui est un droit exorbitant de droit commun reste applicable à
l’administration qui ne vise que la satisfaction des besoins collectifs de la
collectivité.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 5
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
3- Un droit exorbitant du droit commun par son contenu
Le droit administratif est un droit spécial en ce que ses règles sont
différentes du droit commun. Ceci procède de la puissance publique dont est
investie l’administration et qui revêt une double dimension s’exprimant tantôt en
prérogatives tantôt en sujétions.
Relativement aux prérogatives de puissance publique, le droit
administratif reconnaît à l’administration des prérogatives qui s’analysent en des
dérogations au régime juridique des particuliers et jouent dans le sens de la
majoration de ses droits. Ainsi, a-t-elle le droit de réquisitionner, d’exproprier,
de modifier ou résilier unilatéralement des contrats, d’édicter des actes
unilatéraux, de prendre des règlements de police voire d’utiliser la force
publique. Les prérogatives de puissance publique font du droit administratif un
droit inégalitaire et le différencient de la sorte du droit commun. En effet, alors
que les rapports entre les particuliers reposent sur le principe de l’égalité, les
rapports entre l’administration et les administrés sont des rapports d’inégalité,
l’administration se trouvant dans une position de supériorité par rapport aux
particuliers.
Par rapport aux sujétions de puissance publique, le droit administratif
soumet l’administration à des sujétions qui, elles, s’analysent au contraire en des
prérogatives en moins c’est- à- dire en une réduction de ses droits. Ainsi, à la
différence des particuliers qui disposent du libre choix de leur but, de leurs
employés et de leurs cocontractants, l’administration a à sa charge l’obligation
de ne poursuivre qu’un seul but, de ne contracter que selon les conditions et
procédures imposées par la loi. Ainsi, l’absence de liberté qui caractérise la
situation juridique de l’administration fait de celle-ci non plus une
administration impérieuse mais plutôt une administration ligotée.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 6
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
II – L’OBJET DU DROIT ADMINISTRATIF : L’ADMINISTRATION
Le droit administratif comprend l’ensemble des règles applicables à
l’administration ; son objet est donc l’administration. Celle-ci peut être définie
selon deux conceptions, l’une est organique et l’autre matérielle.
A – La conception organique de l’administration
Cette conception voit l’administration en tant qu’un ensemble d’organes
(exemple : Ministère de la Fonction Publique, ENA). Ainsi l’administration est
comparée à un certain nombre de structures chargées de gérer des services.
Parce qu’elle s’appuie sur des organes, cette conception est dite organique.
B – La conception matérielle de l’administration
Cette seconde conception voit l’administration comme une activité,
l’activité même qu’assurent les organes qu’on vient d’évoquer. L’activité
administrative est la satisfaction des besoins collectifs de la communauté. Cette
conception est dite matérielle car à la différence de la première qui se réfère à
l’ensemble du personnel accomplissant des tâches administratives, celle-ci se
fonde sur l’activité, les tâches exercées entre autres le maintien de l’ordre public,
la sécurité, la santé, l’éducation, etc. Sous l’angle des activités, l’administration
se distingue des organes privés c’est - à - dire des organes gérés par des
particuliers. Contrairement à ceux – ci qui agissent toujours dans un but
particulier (recherche du profit, du bénéfice), l’administration n’a qu’un seul
but : l’intérêt général.
Des deux conceptions laquelle faut-il retenir ? En réalité, aucune de ces
deux conceptions ne rend réellement compte de la notion de l’administration car
elles sont complémentaires. C’est la raison pour laquelle on définira
l’administration comme un ensemble organisé de services (définition organique)
destiné à satisfaire les besoins collectifs de la communauté (définition
matérielle).
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 7
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
TITRE I : L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’organisation de l’Administration repose sur des principes de base qui,
s’ils sont mis en œuvre, donnent naissance à des structures administratives.
Il s’agira donc pour nous d’examiner de prime abord ces principes de
base ; après quoi, nous étudierons les structures de l’Administration.
CHAPITRE I : LES PRINCIPES DE BASE DE L’ORGANISATION
ADMINISTRATIVE
Les principes de base de l’organisation administrative comprennent aussi
bien les procédés techniques que les techniques de contrôle. Mais dans le cadre
de cette étude, nous examinerons simultanément les procédés techniques avec
les techniques de contrôle y afférant.
Les procédés techniques de l’organisation administrative se distribuent en
procédés autoritaires et en procédé non autoritaire.
SECTION I : LES PROCEDES AUTORITAIRES
Les procédés autoritaires de l’organisation administrative sont constitués
par la centralisation et la déconcentration.
PARAGRAPHE I : LA CENTRALISATION
C’est un procédé technique de l’organisation administrative de type
autoritaire, non démocratique car, ici, l’autorité centrale règle seule les affaires
de l’Etat.
A- La notion de centralisation
Après avoir défini la centralisation, il conviendra d’en donner les raisons ou les
causes.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 8
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
1- Définition de la centralisation
La centralisation est un système dans lequel l’Administration est soumise
dans sa totalité au pouvoir central de l’Etat. Ici, toutes les décisions
administratives émanent directement des organes centraux de l’Etat.
L’Etat est, de ce fait, la seule personne publique pouvant régler tous les
problèmes de la nation.
Le centre de décision est unique. Les ordres sont émis depuis la capitale ;
et c’est dans la capitale que se coordonnent touts les activités administratives. La
centralisation a existé en France au début du 19ème siècle sous NAPOLEON
BONAPARTE.
2- Les causes de la centralisation
La centralisation a des causes politiques et des causes techniques.
a- Au plan politique
La centralisation est perçue comme une nécessité car elle renforce la
puissance externe de l’Etat. L’Etat, de ce fait, a tous les moyens nécessaires pour
le maintien ou le rétablissement de l’ordre public.
Il faut aussi ajouter que la centralisation lutte contre tous les facteurs et
éléments qui viseraient à mettre en péril l’unité de l’Etat.
b- Au plan technique
Ici, la centralisation engendre le bon fonctionnement des services publics ;
car une Administration centralisée est à l’abri des querelles et des passions
locales. La centralisation doit également permettre de mieux connaître
l’ensemble des besoins de la collectivité et d’y apporter des solutions idoines.
Quels sont donc les avantages et les inconvénients de la centralisation ?
B- Les avantages et les inconvénients de la centralisation
La centralisation est un procédé technique qui présente des vertus mais
aussi des tares.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 9
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
1- Les avantages
Les avantages de ce système administratif peuvent s’analyser à trois
niveaux : politique, administratif et financier.
Au plan politique, la centralisation favorise l’unité nationale comme cela
est affirmé par la constitution ivoirienne.
Au niveau administratif, l’unité d’action de la centralisation lui permet
d’être efficace, productif et rentable.
Enfin au niveau financier, la centralisation est un système économique,
peu coûteux. Il favorise l’économie de fonctionnaires et de bâtiments.
2- Les inconvénients
Au plan politique, la centralisation est vue comme un système autoritaire,
non démocratique et qui écarte les administrés de la gestion du pouvoir local.
Au plan administratif, la centralisation éloigne les administrés de
l’Administration. C’est un système lourd et lent car toute décision émane de la
capitale. Cela remet en cause l’efficacité de ce système autoritaire.
PARAGRAPHE II : LA DECONCENTRATION
C’est également un procédé technique de l’organisation administrative de
type autoritaire ; mais qui constitue un correctif de la centralisation en ceci
qu’elle se donne comme un assouplissement de la centralisation.
A- La notion de déconcentration
Ici également, nous définirons la déconcentration avant de déterminer son
objet.
1- Définition de la déconcentration
La déconcentration se caractérise par le fait que l’Etat central reconnaît un
certain nombre de décisions à des agents locaux. Il y a une distribution du
pouvoir au sein de l’appareil de l’Etat. Il y a même une délégation du pouvoir de
décisions au profit des organes locaux agissant au nom de l’Etat.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 10
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Ainsi donc, les décisions sont imputées à l’Etat ; toutefois, elles sont
seulement prises par des agents subordonnés hiérarchiquement au pouvoir
central.
En résumé, la déconcentration apparaît comme un simple aménagement
technique de la prise de décision, confiée à des représentants locaux du pouvoir
central.
2- L’objet de la déconcentration
La déconcentration a pour objet de rapprocher l’administré du pouvoir de
décision. Elle assouplit également la centralisation et elle diminue les
inconvénients de celle-ci. Elle réalise aussi l’unité complète de vues dans la
gestion administrative. Elle permet la soumission des intérêts locaux à l’intérêt
national.
Elle est susceptible de plusieurs modalités.
B- Les modalités de la déconcentration
La déconcentration peut se faire de façon territoriale ou horizontale ou de
façon technique ou verticale.
1- La déconcentration territoriale ou horizontale
Ici, le pouvoir de décision appartient à une autorité ou même à un organe
dont la compétence s’étend sur une circonscription administrative. Cette
circonscription administrative n’a pas de personnalité morale. Ici, le Préfet et le
Sous- préfet agissent au nom de l’Etat en tant qu’agents de l’Etat dans le
département et la sous-préfecture.
2- La déconcentration technique ou verticale
Elle est dite aussi déconcentration verticale ou déconcentration par
service. Ici l’on confie le pouvoir décisionnel à une autorité, à un organe
spécialisé techniquement.
C’est le cas du ministre ou du directeur de cabinet d’un ministère. C’est
également le cas des directeurs ou chefs de services extérieurs.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 11
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Que ce soit dans l’un ou dans l’autre cas, l’Administration centrale exerce
un contrôle sur les entités déconcentrées.
C- Le contrôle par l’administration centrale
C’est le contrôle administratif exercé par les autorités administratives sur
l’administration déconcentrée. Ici, c’est le contrôle hiérarchique. Ce contrôle
permet à l’autorité supérieure de faire prévaloir sa volonté sur celle de l’agent
subordonné. Ce contrôle s’exerce aussi sur les actes des subordonnés. Nous
avons :
- le pouvoir d’instruction : ce pouvoir permet au supérieur hiérarchique de
donner des ordres ou instructions de service ;
- le pouvoir d’approbation préalable : ici, le supérieur donne son accord avant
que l’acte du subordonné ne soit valide ;
- le pouvoir de réformation : ce pouvoir permet au supérieur de modifier la
décision du subordonné ;
-le pouvoir d’annulation : ici, le supérieur met fin à l’acte illégal du
subordonné.
SECTION II : LE PROCEDE NON AUTORITAIRE :
LA DECENTRALISATION
C’est un procédé technique de l’organisation administrative de type non
autoritaire, c’est-à-dire un procédé démocratique. Ce procédé est fondé sur le
principe de la liberté dans le choix des autorités décentralisées.
PARAGRAPHE I : LA NOTION DE DECENTRALISATION
Après l’avoir définie, nous dégagerons les critères de la décentralisation.
A- Définition de la décentralisation
La décentralisation est un procédé de l’organisation administrative qui
donne la liberté à des collectivités locales pour régler leurs affaires considérées
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 12
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
comme locale. C’est donc un procédé qui confère des pouvoirs de décisions à
des organes locaux autonomes, distincts de ceux de l’Etat.
Il y a donc ici transfert d’attributions à des personnes publiques
autonomes mais qui agissent sous le contrôle de l’Etat.
Quels sont donc les critères de la décentralisation ?
B- Les critères de la décentralisation
Une collectivité décentralisée se définit par l’existence de trois critères
cumulatifs.
1- La personnalité juridique
Toute collectivité décentralisée a la personnalité juridique ; ce qui n’est
pas le cas pour les circonscriptions administratives dans le cadre de la
déconcentration. La collectivité locale reçoit alors les moyens juridiques de se
comporter de manière autonome. Elle devient sujet de droit et elle a la plénitude
de la capacité juridique. Elle est donc titulaire de droits et d’obligations ; elle a
un budget, un personnel et un patrimoine.
2- Les organes locaux
Des personnes physiques parlent au nom de cette personne morale. Il ne
s’agit pas de représentants du pouvoir central, mais de représentants de la
collectivité qui sont des élus de la circonscription locale. Les organes locaux
sont des organes propres. Exemple : le maire et les conseillers municipaux sont
élus dans la circonscription de la commune.
3- Les affaires propres à gérer
Les collectivités locales ont des compétences propres, distinctes de celles
de l’Etat. Il est question ici des affaires locales dont la compétence revient ou est
dévolue à la collectivité décentralisée en question. Les collectivités locales ont
donc des intérêts propres correspondant aux besoins différents de ceux de l’Etat.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 13
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Par ailleurs, il convient de noter que la décentralisation peut s’opérer de
diverses manières.
PARAGRAPHE II : LES MODALITES DE LA DECENTRALISATION
La décentralisation est susceptible de deux modalités : la décentralisation
territoriale et la décentralisation technique.
A- La décentralisation territoriale
C’est aussi la décentralisation horizontale. L’autonomie administrative est
conférée à une collectivité territoriale ou locale jouissant de la personnalité
juridique. C’est dans cette collectivité territoriale que la personne morale en
question va exercer ses compétences.
Ainsi donc, dans la décentralisation territoriale, l’on transforme en centres
autonomes des groupements d’intérêts définis géographiquement (par exemple
les départements, les communes).
B- La décentralisation technique ou verticale
Ici, l’on donne l’autonomie administrative à une catégorie particulière de
services (par exemple, on peut citer l’Université de Cocody et le C.H.U. de
Yopougon).
Le service public, ici, a un intérêt déterminé, spécial qui peut être ressenti
à des endroits très différents du territoire et qui n’est pas lié à une portion
déterminée du territoire.
Mais, il est important de souligner que l’autonomie octroyée aux entités
décentralisées ne signifie pas indépendance. C’est la raison pour laquelle le
pouvoir exerce un contrôle sur leurs activités.
PARAGRAPHE III : LE CONTROLE SUR L’ACTIVITE
DECENTRALISEE
Ce contrôle est exercé par les représentants de l’Etat sur la collectivité
décentralisée : c’est la tutelle administrative. Les représentants de l’Etat sont le
Préfet et le Ministre de l’Intérieur. La tutelle peut porter sur les organes
décentralisés ou sur leurs actes.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 14
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
A- La tutelle sur les organes
Nous avons :
- la suspension d’une autorité décentralisée ;
- la révocation d’un maire ;
- la dissolution d’un conseil municipal par décret.
B- La tutelle sur les actes
Nous avons :
- l’approbation tacite ou expresse de l’autorité de tutelle ;
- l’annulation des actes illégaux par l’autorité de tutelle ;
- la substitution d’office : si l’organe de la collectivité décentralisée n’agit pas
conformément à la légalité, l’autorité de tutelle peut être autorisée à agir à sa
place après une mise en demeure.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 15
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE II : LES STRUCTURES ADMINISTRATIVES
Les structures administratives sont de deux ordres : les structures de
l’administration centrale et les structures de l’administration locale.
SOUS- CHAPITRE I : L’ADMINISTRATION CENTRALE
L’Administration centrale ivoirienne est marquée par la concentration du
pouvoir administratif entre les mains des organes étatiques que sont la
Présidence de la République, la Primature et les départements ministériels.
L’Administration centrale ivoirienne met en relief une centralisation des
décisions dans la capitale. Ce centre unique de décision coordonne également
toutes les activités administratives.
SECTION I : LES SERVICES DE LA PRESIDENCE
Nous avons le cabinet présidentiel, l’Inspection Générale d’Etat, et le
Secrétariat Général de la Présidence de la République.
PARAGRAPHE I : LE CABINET PRESIDENTIEL
On y trouve les collaborateurs du Chef de l’Etat, ses hommes de
confiance. On a ainsi :
- un Directeur de cabinet ;
- les conseillers techniques ;
- l’Etat-Major particulier ;
- les chargés de mission ;
- un Directeur du Protocole d’Etat.
Ce service s’occupe des audiences du Président de la République, de son
courrier et prépare les décisions présidentielles. Il entretient aussi les contacts
politiques et contrôle l’exécution des instructions du Chef de l’Etat.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 16
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II : L’INSPECTION GENERALE D’ETAT
Ce service a pour mission de contrôler et d’inspecter le fonctionnement
normal et régulier des services publics. Le contrôle porte sur la légalité de
l’action de l’Administration. Il y a aussi le contrôle technique portant sur les
finances et la gestion administrative.
Les Inspecteurs d’Etat ont donc le pouvoir d’investigation et
d’information. Ils sont nommés par le Président de la République. Ce service
comprend l’Inspecteur Général et les Inspecteurs d’Etat.
PARAGRAPHE III : LE SECRETARIAT GENERAL
Ce service gère au plan administratif les dossiers de la Présidence de la
République. C’est également lui qui prépare et exécute les différentes tâches et
missions du Président de la République. Il comprend :
- un Secrétaire Général qui dirige ce service et siège aux conseils des ministres
et de gouvernement ;
- un conseiller juridique ;
- plusieurs responsables de services (administratifs, financiers, techniques et
sociaux).
SECTION II : LES SERVICES DE LA PRIMATURE
Les services de la Primature comprennent le Cabinet du Premier ministre,
le Secrétariat Général du gouvernement, et les Directions Centrales.
PARAGRAPHE I : LE CABINET DE LA PRIMATURE
On y trouve les collaborateurs personnels du Premier Ministre parmi
lesquels le Directeur de cabinet secondé par un adjoint. On y rencontre aussi les
conseillers techniques.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 17
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II : LE SECRETARIAT GENERAL DU
GOUVERNEMENT
Il fait office de secrétariat du Conseil des ministres. Il prépare et assure le
secrétariat des séances des Conseil des ministres et des conseils de
gouvernement. Il publie les lois et les décrets au Journal Officiel. Il suit aussi
l’exécution des décisions des Conseils des ministres. Il se compose :
- d’un Secrétaire Général ;
- d’un Secrétaire Général Adjoint ;
- de conseillers ;
- de chefs de quelques services (administratifs, financiers et du personnel).
PARAGRAPHE III : LES DIRECTIONS CENTRALES
Ce sont des services constituant des directions centrales qui sont
spécialisées dans une tâche technique précise et qui sont rattachés à la
Primature. On a trois directions centrales, ce sont :
- la direction du Centre de Promotion des Investissements en Côte d’Ivoire
(CEPICI) ;
- la direction du contrôle financier ;
- la direction de contrôle et des grands travaux.
SECTION III : LES MINISTERES
Le ministère, en tant que structure administre, est composé du Ministre
lui-même, de son Cabinet, des services centraux, des organismes de consultation
et d’inspection et des services extérieurs.
PARAGRAPHE I : LE MINISTRE
Au sein du ministère, le Ministre est le supérieur hiérarchique de
l’ensemble des services. Il est une autorité politique et une autorité
administrative.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 18
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II : LE CABINET MINISTERIEL
C’est un groupe de collaborateurs du ministre. Ce groupe restreint est lié
personnellement au ministre. Le cabinet conseille le ministre par l’étude des
différentes questions ou affaires à lui soumises. Il contrôle également
l’exécution des décisions prises par le ministre dans les différents services. Le
cabinet comprend :
- un directeur de cabinet qui est le collaborateur direct du ministre. Il a la
délégation de signature et représente quelques fois le ministre ;
- un chef de cabinet qui s’occupe de la gestion du cabinet. La gestion, ici, porte
sur le personnel, le matériel, le crédit etc. ;
- un attaché de cabinet ou chargé de mission qui s’occupe des tâches et missions
diverses ; exemple : il s’occupe des relations avec la presse ;
- un chef de secrétariat particulier qui est responsable des audiences et des
courriers du ministère.
PARAGRAPHE III : LES SERVICES CENTRAUX
Les services centraux sont les directions générales. A la tête de ces
services, se trouvent les directeurs généraux, coordonnateurs des activités des
directions. On a ensuite les directeurs généraux adjoints, puis les directeurs qui
conçoivent, réfléchissent et harmonisent les services. Après, on a les sous-
directeurs, les chefs de service, les chefs de bureau et enfin le personnel
subalterne.
Les services centraux assurent les contacts avec les administrés, préparent
et exécutent les décisions prises par le ministre
PARAGRAPHE IV : LES ORGANISMES DE CONSULTATION ET
D’INSPECTION
Les organismes de consultation donnent un avis consultatif et non
obligatoire au ministre. Comme organisme consultatif, on peut retenir le Conseil
de discipline qui est obligatoirement consulté avant le prononcé d’une sanction
du second degré.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 19
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Les corps d’inspection recherchent les irrégularités et les abus au sein des
services. Ils exercent aussi un contrôle technique sur les services ministériels.
On peut citer par exemple l’inspection générale de la santé, l’inspection générale
des services de l’administration territoriale.
PARAGRAPHE V : LES SERVICES EXTERIEURS
Ces services constituent le prolongement de l’administration centrale. Ils
exécutent les décisions prises par les services centraux.
On a aussi les directions départementales ou régionales qui sont chargées
de l’exécution des décisions du ministre.
PARAGRAPHE VI : LA HIERARCHIE MINISTERIELLE
Dans cette hiérarchie, on part du Premier Ministre au Secrétaire d’Etat en
passant par le Ministre d’Etat, le Ministre et le Ministre délégué auprès du
Président de la République ou du Premier Ministre.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 20
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
SOUS-CHAPITRE II : LA REGION
La Région a une double nature juridique. En tant que circonscription
administrative, elle est l’échelon intermédiaire entre le District et le
Département. Elle constitue, de ce fait, le niveau de conception, de
programmation, d’harmonisation, de soutien, de coordination et de contrôle des
actions et des opérations de développement économique, social et culturel qui
s’y réalisent à l’intervention de l’ensemble des services des Administrations
civiles de l’Etat.
En tant que collectivité territoriale, la région est composée d’au moins
deux départements et dispose d’organes propres.
De 10 régions en 1991, nous sommes aujourd’hui à 31 régions.
L’étude de la région s’articulera donc autour de deux axes qui sont d’une
part l’étude de l’organe déconcentré et, d’autre part, l’étude des organes
décentralisés.
SECTION I : L’ORGANE DECONCENTRE : LE PREFET DE REGION
La région en tant que circonscription administrative est animée par un
Préfet de région. Quel est son statut et quelles sont ses attributions ?
PARAGRAPHE I : LE STATUT DU PREFET DE REGION
Le Préfet de région est nommé par décret pris en Conseil des ministres et
après proposition du ministre de l’Intérieur. Il est choisi parmi les Préfets de
département qui ont pour la plupart le grade d’administrateur civil de classe
principale. Il faut souligner qu’avec le décret du 16 janvier 1991, il n’existe pas
de lien hiérarchique entre le Préfet de région et les Préfets des départements
constituant la région.
PARAGRAPHE II: LES MISSIONS DU PREFET DE REGION
Représentant le pouvoir exécutif dans sa région, le Préfet de région dirige
les services extérieurs de l’Administration dans son espace géographique.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 21
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Il a une mission générale d’animateur de développement et de
coordonnateur des actions des services extérieurs régionaux.
A- Le Préfet de région, animateur de développement
Il faut noter ici que le Préfet de région assure l’exécution des FRAR
(Fonds Régionaux d’Aménagement Rural). Il encadre les structures et les
activités de développement de la région. Il harmonise les programmes triennaux
établis par les collectivités appartenant à la région.
B- Le Préfet de région, coordonnateur des actions des
Services extérieurs régionaux
Il faut signaler ici que le Préfet de région est celui qui veille à l’exécution
des décisions du pouvoir central. Il a un droit de regard sur les activités des
services publics de sa région. La mise sur pied du programme régional de
développement lui incombe. Il élabore également le projet régional
d’aménagement du territoire. Enfin, il suit la mission de protection des biens,
des personnes, de maintien de l’ordre public dans sa sphère administrative.
SECTION II : L’ORGANE DECENTRALISE : LE CONSEIL
REGIONAL
La région, en tant que collectivité territoriale, est animée par le Conseil
régional, terme générique, qui regroupe en fait plusieurs structures. Ainsi, après
avoir examiné ces structures, nous nous pencherons sur leurs attributions.
PARAGRAPHE I : LES STRUCTURES DU CONSEIL REGIONAL
Les structures de la région, collectivité décentralisée, sont le Conseil
régional, le Président du conseil régional, le Bureau du conseil général et le
comité économique et social régional.
A- Le Conseil Régional
C’est l’organe délibérant de la région. Il regroupe l’ensemble des élus
appelés conseillers régionaux. Leur nombre varie proportionnellement à
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 22
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
l’importance démographique du département ; et le nombre varie entre 25, le
minimum et 60, le maximum.
Les conseillers régionaux sont élus pour 5 ans au suffrage universel direct
et au scrutin de liste proportionnel et majoritaire à un tour sur les listes
complètes sans vote préférentiel ni panachage.
B- Le Président du conseil régional
C’est l’organe exécutif du conseil régional. En général, il est la « tête de
liste » de la liste déclarée vainqueur.
C- Le Bureau du conseil régional
Le bureau est un organe de concertation qui aide le Président du conseil
dans sa tâche. Le Bureau se compose comme suit :
- 01 Président qui est également Président du Conseil Régional ;
- 03 Vice-Présidents pour les Régions de 300 000 habitants et en dessous ;
- 04 Vice-Présidents pour les Régions de 300 001 à 500000 habitants ;
- 05 Vice-Présidents pour les Régions de 500 001 à 1 000 000 d'habitants.
Pour les Régions dont la population est supérieure à 1 000 000 d'habitants, le
nombre de Vice- Présidents est porté à 06.
Les Vice-Présidents sont classés dans l'ordre des nominations.
D- Le Comité Economique et Social
C’est l’organe consultatif du conseil régional. Le nombre de ses membres
varie également en fonction de l’importance démographique de la région, avec
un minimum de 30 et un maximum de 50.
La composition du comité économique et social n’est pas homogène car il
comprend aussi bien les représentants des différents secteurs d’activité de la
région, ceux des associations de développement que des élus locaux et des
personnalités reconnues pour leurs compétences.
PARAGRAPHE II : LES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL REGIONAL
Ces attributions concernent tous les organes sus-indiqués.
A- Le Conseil Régional
Les attributions du Conseil Régional sont diverses. Ainsi, il a compétence
pour délibérer sur toutes les affaires qui intéressent la région. Outre ses
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 23
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
attributions en matière de développement économique de la région
(planification et promotion du développement économique) ; en matière de santé
et d’hygiène publique (construction, gestion et entretien des hôpitaux généraux)
et en matière d’enseignement et de formation professionnelle (construction et
gestion des lycées et collèges d’enseignement général et d’enseignement
technique ainsi que des centres de formation professionnelle) ; le Conseil
régional est compétent pour créer, gérer et supprimer des services publics
régionaux ; gérer les biens et opérations immobilières de la région ; voter le
budget régional.
B- Le Président du conseil régional
En sa qualité d’organe exécutif de la région, le Président du conseil
régional est chargé de préparer et d’exécuter les délibérations du conseil
régional ; d’ordonnancer les dépenses et les recettes de la région ; d’assurer
l’administration de la région ; de gérer le domaine régional ; de représenter la
région.
C- Le Bureau du conseil régional
Le Bureau dispose de compétences propres distinctes de celles du
Président. En tant qu’organe collégial d’exécution, il est chargé de préparer
certaines activités régionales (ordre du jour des séances du conseil, programme
des opérations et actions de développement, budget régional) ; d’assurer leur
suivi (exécution du budget et recouvrement des recettes régionales) ; d’émettre
un avis avant l’engagement par le Président du conseil régional, en matière
financière.
D- Le Comité Economique et Social régional
En sa qualité d’organe consultatif, le comité est essentiellement chargé
d’émettre des avis qui sont soient facultatifs, soient obligatoires.
L’avis facultatif porte sur toutes les matières et donc illimité. Cet avis peut
être émis à l’initiative du conseil régional, de son Président ou du comité lui-
même.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 24
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Quant à l’avis obligatoire, il est limité à certaines matières jugées
importantes : budget annuel, plans de développement et d’aménagement de la
région, projets d’entente interrégionale.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 25
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
SOUS-CHAPITRE III : LE DEPARTEMENT
Le département a son origine dans la loi du 10avril 1961 reprenant la loi
française du 10 août 1871 sur le département. Les départements, au nombre de 4
en 1959, se sont multipliés pour aboutir aujourd’hui à 107 départements.
Le département se présente comme une entité déconcentrée rapprochant
l’administré de l’administration dans le cadre de la déconcentration.
Le préfet de département est le principal organe du département ; d’autres
organes lui sont subordonnés.
SECTION I : LE PREFET DE DEPARTEMENT
Le département en tant que circonscription administrative est animé par
un Préfet auquel d’autres autorités sont subordonnées.
PARAGRAPHE I : LE PREFET
Ici également, nous analyserons le statut du Préfet et son rôle.
A- Le statut du Préfet
Le Préfet est l’autorité administrative la plus élevée dans la
circonscription administrative départementale. Son choix s’opère par décret pris
en Conseil des ministres et cela, sur proposition du ministre de l’Intérieur.
Pour être nommé Préfet, il faut appartenir au corps des administrateurs
civils formés à l’Ecole Nationale d’Administration. La fonction préfectorale
peut prendre fin selon le bon vouloir du Président de la République. Dans ce cas,
l’on mettra le Préfet à la disposition du ministère de l’Intérieur.
B- Le rôle du Préfet
En tant que représentant de l’Etat dans le département, le Préfet joue
plusieurs rôles :
1- Le Préfet, représentant de l’exécutif
Le Préfet agit ici au nom du pouvoir exécutif. Il est le délégué du
gouvernement car il représente chaque ministre dans sa localité. Par ailleurs, il
doit surveiller la bonne exécution des lois et des décisions du gouvernement.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 26
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
2- Le Préfet, coordinateur des services étatiques
Ici, le Préfet coordonne les services de l’Etat dans son département. Cette
coordination doit intervenir notamment dans les domaines administratif,
économique et social.
Le Préfet dirige donc tous les services de l’Etat qui se trouvent dans son
département. A cet effet, il possède le pouvoir réglementaire, le pouvoir
hiérarchique et même un pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires qui sont en
service dans son département. Il peut même prendre des mesures individuelles.
Toutefois, il faut relever les difficultés que rencontre le Préfet dans son
rôle de coordinateur des services étatiques. Ici, la difficulté est que certains
services telles la justice, l’armée et les finances échappent à la coordination car
les ministres respectifs de ces services refusent de déléguer leur pouvoir au
Préfet.
3- Le Préfet, une autorité policière
Le Préfet possède des pouvoirs de police. Il peut intervenir en tant
qu’autorité de police dans le domaine administratif. Comme autorité de police
administrative, le Préfet prendra les mesures idoines intéressant la sécurité de
l’Etat et des particuliers, la salubrité et la tranquillité publique, la sauvegarde du
patrimoine national. Dans son action, le Préfet peut requérir la force publique.
SECTION II : LES ORGANES SUBORDONNES
AU PREFET
Ces organes sont au nombre de trois. Nous avons le Secrétaire Général de
préfecture, le Chef de cabinet et le Sous- préfet.
PARAGRAPHE 1- LE SG DE PREFECTURE
Sa nomination intervient dans les mêmes conditions que celle du Préfet.
Le S.G. de préfecture n’a pas de pouvoirs spécifiques à sa fonction. Il est
nommé par décret présidentiel après l’avis du Préfet et sur proposition du
ministre de l’Intérieur. Il est généralement choisi parmi les Sous-préfets suivant
leur ancienneté.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 27
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Deux fonctions essentielles sont dévolues au S.G. de préfecture. Il s’agit
en l’occurrence de la fonction de suppléant du Préfet et de délégataire de
signature du Préfet.
A- Le S.G., suppléant du Préfet
Le S.G. de Préfecture fait office de Préfet en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier. Dans ce cas, c’est lui qui administre le
département. Il assiste également le Préfet dans sa tâche et l’aide à préparer sa
prise de décision. En outre, il est l’informateur privilégié du Préfet ; à ce titre, il
doit centraliser l’information. Enfin, il œuvre pour l’harmonisation de l’action
de l’Administration au sein du département.
B- Le S.G., délégataire de signature du Préfet
Le S.G. reçoit une délégation de signature de la part du Préfet. De ce fait,
il peut signer les actes administratifs au nom et pour le compte du Préfet. Cette
délégation de signature s’attache à la personne du S.G. de préfecture.
PARAGRAPHE 2- LE CHEF DE CABINET
Le Chef de cabinet est une autorité nommée par décret présidentiel après
avis du Préfet. Il peut comme le S.G. de préfecture recevoir délégation de
signature du Préfet.
C’est le Chef de cabinet qui s’occupe du courrier au sein du cabinet. Il
s’occupe aussi des audiences du Préfet, de l’organisation des visites et des
tournées. Il s’occupe également des relations avec le personnel et avec le
gouvernement. Il veille enfin à la bonne application des décisions du
gouvernement.
PARAGRAPHE 3- LE SOUS- PREFET
Quel est le statut du Sous-préfet et quel rôle joue-t-il dans la
circonscription administrative départementale ?
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 28
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
A- Le statut du Sous- préfet
Il est nommé dans les mêmes conditions que le Préfet, c’est-à-dire par
décret présidentiel et cela sur proposition du ministre de l’Intérieur. Ils sont
choisis parmi les Chefs de cabinet du Préfet et dépendent du Préfet.
B- Le rôle du Sous-préfet
Il a des pouvoirs autonomes et des pouvoirs délégués
1- Les pouvoirs autonomes du Sous-préfet
- Il veille à la mise en œuvre des mesures administratives dans sa
circonscription ;
- il est le responsable du maintien de l’ordre public dans sa circonscription. Il
appuie son action sur la force publique ;
- il dirige et contrôle l’action des chefs traditionnels (cantons, villages) dans sa
circonscription ;
- il est officier d’état civil et accomplit à cet effet toutes les tâches relevant de la
compétence d’un officier d’état civil.
2- Les pouvoirs du Sous-préfet en tant que délégué
du Préfet
- Agissant sur délégation préfectorale, il est le représentant du Préfet dans sa
localité ;
- il renseigne le Préfet sur tout ce qui se passe dans sa circonscription ;
- il représente les intérêts de la sous-préfecture auprès du Préfet ;
- il communique également avec les fonctionnaires de sa localité ;
- il est aussi agent de développement économique, social, culturel etc.
3- Le Conseil de Sous-préfecture
C’est un organe qui apporte son concours et soutien au Sous-préfet dans
l’exécution de sa mission. Créé le 2 juin 1967 par décret, le Conseil de Sous-
préfecture comprend des membres de droit et des membres nommés.
Les membres de droit sont le Sous-préfet, les chefs de services
administratifs de la localité, le député de la localité, le ou les conseillers
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 29
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
économiques de la localité. Les membres nommés sont ceux nommés par le
Préfet sur proposition du Sous-préfet et cela pour une durée de trois ans.
Le Conseil de Sous-préfecture a essentiellement des attributions
consultatives. Chaque année, il tient trois sessions ordinaires. Il émet des avis
sur toutes les affaires à lui soumises par le Préfet. Il se prononce sur le
programme d’emploi des crédits et des fonds octroyés à la Sous-préfecture. Il
rend compte à cette assemblée des dépenses et recettes de chaque année.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 30
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
SOUS-CHAPITRE IV : LA COMMUNE
Le phénomène communal en Côte d’Ivoire date de l’époque coloniale.
Elle a été marquée par la création de la commune mixte de Grand-Bassam en
1914.
Après l’indépendance, l’Etat ivoirien a fait sienne la même politique de
communalisation qui a connu un véritable essor dans les années 80.
Aujourd’hui, l’on dénombre en Côte d’Ivoire 715 communes. La
commune, division territoriale autonome se compose du conseil municipal et de
la municipalité. Par ailleurs, une nouvelle forme d’organisation administrative
territoriale a vu le jour avec la loi d’orientation de 2001 : le district.
SECTION I : LE CONSEIL MUNICIPAL
L’étude du Conseil municipal sera essentiellement consacrée à son statut
et à ses attributions.
PARAGRAPHE I : ORGANISATION, COMPOSITION ET
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Nous verrons d’abord l’organisation et la composition du Conseil
municipal et, ensuite, son fonctionnement.
A- L’organisation et la composition du Conseil municipal
Le conseil municipal est l’assemblée délibérante de la commune. Il
regroupe tous les élus communaux.
Le nombre de conseillers varie d’une commune à une autre en fonction de
la démographie de la commune. Le conseil municipal peut être composé au
minimum de 25 personnes pour les communes de 10 000 habitants ; et de 50
membres au maximum pour les communes ayant plus de 100 000 habitants.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 31
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Les conseillers municipaux sont élus pour 5 ans. Leur élection se fait au
suffrage universel direct et au scrutin de liste proportionnel à un tour sans vote
préférentiel ni panachage.
Tout ivoirien majeur, jouissant de ses droits civiques et politiques et
inscrit sur la liste électorale de son domicile peut être électeur. Ne peuvent être
élus les préfets, les sous-préfets, les militaires.
B- Le fonctionnement du conseil municipal
Chaque année, le conseil municipal se réunit en session ordinaire trois
fois. Chaque session ordinaire dure au plus 15 jours.
Les sessions extraordinaires peuvent intervenir à la demande motivée de
la moitié des conseillers et sur convocation du maire. Le quorum requis pour le
fonctionnement du conseil municipal est la majorité de ses membres en exercice.
Les séances du conseil municipal sont en principe publiques. Mais à la
demande de l’autorité municipale ou du tiers des membres du conseil municipal,
celui-ci peut se réunir en comité secret ou à huit-clos.
PARAGRAPHE II : LES MISSIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal est la structure qui gère les affaires de la commune,
qui vote le budget et enfin qui peut être consulté pour avis sur les problèmes
communaux.
A- La gestion des affaires communales
Le conseil municipal s’occupe des opérations et actions de développement
de la commune. Cela améliore les conditions de vie des populations
communales.
Le conseil municipal gère aussi les biens de la commune. Il crée les
services publics municipaux et les organise. On peut citer par exemple le service
des pompes funèbres, de l’hygiène municipale, de la police municipale, de lutte
contre les incendies etc.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 32
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
B- Le vote du budget communal
C’est le conseil municipal qui vote le budget communal. Ce budget se
subdivise en budget de fonctionnement et en budget d’investissement.
C- La fonction consultative
Le conseil municipal peut être consulté par l’autorité de tutelle. Dans ce
cas, il donne son avis ; il donne également son avis sur les questions ayant un
intérêt local. Cet intérêt peut être économique, social, culturel, etc.
SECTION II : LA MUNICIPALITE
La municipalité est un organe constitué du maire et de ses adjoints. Leur
statut est identique même si le maire demeure l’organe exécutif de la commune.
PARAGRAPHE I : LE STATUT DU MAIRE ET DE SES ADJOINTS
Seront successivement examinées ici, l’élection du maire et de ses
adjoints et la cessation des fonctions du maire.
A- L’élection du maire et de ses adjoints
Le maire et ses adjoints sont des conseillers municipaux. Ils sont élus par
le conseil municipal pour une durée de 5 ans ; et cela, lors de la première séance
du conseil municipal. Le mode de scrutin adopté est le scrutin uninominal
majoritaire.
Le nombre d’adjoints au maire est fonction de l’importance
démographique de la commune. Ainsi, le minimum est de deux adjoints au
maire et le maximum est de six.
B- La cessation des fonctions du maire
Le maire peut cesser d’exercer sa fonction pour des raisons diverses. Il
peut s’agir des cas où il est fautif ; il peut s’agir également des cas où il y a
décès ou démission.
Lorsque le maire commet une faute dans la mission à lui assignée, il peut
faire l’objet d’une suspension ou d’une révocation.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 33
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Lorsque le maire décède, le poste de maire est vacant. Dans ce cas, l’on
procède au renouvellement de la municipalité par élection. Il en est de même en
cas de démission du maire.
PARAGRAPHE II : LES ATTRIBUTIONS DU MAIRE
Le maire, dans son action, possède une double casquette. Par le biais du
mécanisme du dédoublement fonctionnel, il est en même temps agent de la
commune et agent de l’Etat.
A- Le maire, agent de la commune
En tant qu’autorité de la commune, le maire est l’autorité exécutive
communale et le chef de l’administration communale.
1- L’autorité exécutive communale
Le maire prend des décisions au nom de la commune, l’on parle d’arrêtés
municipaux. Il est également l’ordonnateur des dépenses ; il passe des contrats
et représente la commune en justice ; c’est aussi lui qui prépare et exécute le
budget communal ; enfin, il veille à l’exécution des programmes de
développement.
2- Le chef de l’administration communale
Le maire, en sa qualité d’autorité hiérarchique communale, administre les
biens communaux. C’est lui qui s’occupe du personnel de la commune, du
domaine communal, des biens, des dons et legs de la commune. Il est également
responsable des travaux communaux. Il est donc l’autorité qui dirige les services
administratifs de la commune. Il a un pouvoir disciplinaire sur son personnel.
B- Le maire, agent de l’Etat
En cette qualité, il est un officier de l’état civil, il est chargé de la
publication et de l’exécution des lois et règlements et de la mise en application
de la politique de développement du gouvernement et enfin, il est une autorité de
police.
1- Le maire, officier d’état civil
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 34
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
C’est le maire qui légalise de par sa signature les documents
administratifs. C’est également l’autorité municipale qui reçoit les déclarations
de naissance, de décès etc. Il dresse aussi les actes relatifs aux situations des
personnes (mariage, divorce) ; et il gère les registres d’état civil.
2- Le maire publie et exécute les lois et règlements
Dans sa commune, le maire veille à la publication et à l’exécution des lois
et règlements ainsi qu’à l’exécution des décisions gouvernementales.
3- Le maire met en œuvre la politique de développement
du gouvernement
Le maire est l’autorité municipale qui met en œuvre dans sa commune la
politique de développement économique, social et culturel défini par le
gouvernement ivoirien.
4- Le maire, autorité de police
Le maire, en sa qualité d’autorité de police administrative, est responsable
du maintien de l’ordre public dans sa localité. Il est également chargé de
l’exécution des règlements de police municipale dans sa commune. Les
règlements de police sont pris par le conseil municipal mais le maire est habilité
à édicter des mesures de police spéciales portant sur des domaines spécifiques
telles que la police de la route, la police des cimetières, la police des débits de
boisson etc.
PARAGRAPHE III : LE CONTROLE DE L’ETAT SUR LA
MUNICIPALITE
Ce contrôle s’effectue par le représentant de l’Etat sur la municipalité
composée du maire et de ses adjoints. Il se fait par l’autorité de tutelle, soit le
ministre de l’Intérieur, soit le Préfet ; et revêt deux formes : le contrôle sur les
organes municipaux et le contrôle sur les actes des organes municipaux.
A- Le contrôle sur les organes municipaux
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 35
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
L’autorité de tutelle peut contrôler le maire et ses adjoints en ce qui
concerne leur gestion. Si l’autorité de tutelle constate des défaillances, elle peut
prendre des sanctions disciplinaires ; elle peut suspendre le maire et ses adjoints
par arrêté. Mais cette suspension ne doit pas excéder trois mois. En ce qui
concerne la révocation du maire et de ses adjoints ainsi que la dissolution du
conseil municipal, cela ne peut se faire que par décret pris en Conseil des
ministres.
B- Le contrôle sur les actes des organes municipaux
L’autorité de tutelle peut agir sur les actes du maire, agent de l’Etat. Ici,
elle peut annuler ses actes, peut les réformer, peut même lui donner des
instructions.
L’autorité de tutelle peut également agir sur les actes du maire, agent de la
commune. Dans ce cas, elle dispose d’un pouvoir de substitution, d’annulation
et de suspension.
SECTION III : LES DISTRICTS
L’avènement des districts s’inscrit dans le cadre de la nouvelle politique
de décentralisation menée par le gouvernement de la deuxième République.
Ainsi, les lois 2001-478 du 9 août 2001 et 2002-44 du 21 janvier 2002
portent respectivement statut du District d’Abidjan et statut du District de
Yamoussoukro. Aux termes de l’article 44 de la loi d’orientation de 2001, « le
district est une collectivité territoriale qui regroupe un ensemble de communes et
de sous-préfectures ».
Aussi convient-il d’examiner de prime abord le statut des organes
districaux avant d’aborder leurs attributions.
PARAGRAPHE I : LE STATUT DES ORGANES
Les organes du district sont le Conseil du district, le Gouverneur, le
Bureau du district et le Comité consultatif.
A- Le Conseil du district : l’assemblée délibérante
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 36
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Il a une composition hétérogène et est composé de conseillers désignés
soit au sein des communes, soit élus au suffrage universel direct. Ainsi, le
Conseil du district d’Abidjan est composé de 78 conseillers répartis comme
suit : 26 désignés au sein des communes et sous-préfectures à raison de 2 par
entité et 52 élus au suffrage universel direct. Quant au Conseil du district de
Yamoussoukro, il comprend 45 conseillers dont 15 désignés au sein des conseils
municipaux et 30 élus au suffrage universel direct.
Le Conseil du district est l’organe délibérant du district, c’est-à-dire que
c’est l’organe qui prend les décisions engageant la collectivité territoriale.
B- Le Bureau du district : l’organe exécutif
Le Bureau du district est l’organe exécutif du district ; en d’autres termes,
c’est lui qui exécute les décisions prises par le Conseil du district. Il est composé
du Gouverneur et des Vice-gouverneurs.
1- Le Gouverneur du district
Il est le chef de l’exécutif districal ; il est nommé pour 5 ans par décret du
Président de la République.
2- Les Vice-gouverneurs
Au nombre de cinq (5), ils sont également nommés par décret présidentiel
sur proposition du Gouverneur pour un an. Ils sont choisis au sein de
l’assemblée délibérante parmi les conseillers et sont les adjoints du Gouverneur.
C- Le Comité consultatif
C’est l’organe consultatif du district. Il est composé de conseillers
districaux et émet des avis sur les projets du district à caractère économique et
social.
PARAGRAPHE II : LES ATTRIBUTIONS DU DISTRICT
Les attributions du district relèvent de la compétence de l’assemblée
délibérante. Aussi, le district a-t-il reçu des compétences spécifiques renforcées
par le transfert des compétences.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 37
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
A- Les compétences spécifiques du district
Au titre des attributions spécifiques, le district est compétent pour
promouvoir et réaliser des actions de développement à la fois économique,
social et culturel ; planifier et aménager le territoire districal ; effectuer des
travaux d’équipement rural ; protéger l’environnement ; gérer les ordures et
autres déchets ; lutter contre les effets néfastes de l’urbanisation ; lutter contre
l’insécurité ; promouvoir et protéger nos coutumes et traditions.
B- Les attributions dans le cadre du transfert des compétences
Ces attributions concernent l’urbanisation, le développement, la protection
de l’environnement, l’enseignement et la formation professionnelle.
En ce qui concerne l’urbanisation, la loi reconnaît aux districts la
compétence de l’aménagement du territoire districal en mettant en œuvre des
schémas directeurs d’aménagement du territoire du district. Par ailleurs, les deux
collectivités sont chargées, en matière d’urbanisme et d’habitat, de créer et
d’entretenir des espaces verts ; de gérer le patrimoine foncier ; d’initier et de
réaliser certains plans directeurs.
En ce qui regarde le développement, le district a en charge la planification
du développement et la promotion du développement économique.
Quant à la protection de l’environnement, le district est chargé de soutenir
et d’appuyer la lutte contre l’insalubrité, la pollution et les nuisances. En outre, il
doit réaliser et gérer les postes de groupages des déchets ; transporter les ordures
de ces postes au centre d’enfouissement technique et réaliser puis gérer des
centres d’enfouissement mixtes.
En ce qui concerne enfin l’enseignement et la formation professionnelle,
le district a en charge les universités ; en d’autres termes, la loi attribue les
compétences au district pour construire et gérer les universités et les grandes
écoles. Il est également habilité à construire et à gérer des lycées
d’enseignement général et d’enseignement technique, ainsi que des centres de
formation professionnelle en harmonie avec la carte scolaire.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 38
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
TITRE II : LE PRINCIPE DE LA LEGALITE
La légalité est la qualité de ce qui est conforme à la loi, la loi
s’appréhendant ici au sens large c’est-à-dire comme l’ensemble des normes
juridiques. Le principe de la légalité exprime la règle selon laquelle
l’administration doit agir conformément au droit.
Quel est donc le contenu du principe et quelle en est la portée ?
CHAPITRE I : LE CONTENU DU PRINCIPE DE LA LEGALITE
Le contenu du principe de la légalité conduit à s’interroger à la fois sur sa
signification et sur les règles formant le bloc légal.
SECTION I : LA SIGNIFICATION DU PRINCIPE
Le principe signifie que dans son action, l’administration doit respecter la
loi et doit faire respecter la loi.
L’obligation pour l’administration de respecter la loi se traduit dans le fait
qu’elle doit respecter ses propres règles et les règles supra administratives c’est-
à – dire les règles émanant de l’autorité supérieure.
Quant à l’obligation pour elle de faire respecter la loi, elle se traduit dans
le fait qu’elle doit assurer l’exécution de la loi et du règlement, des décisions de
justice et mettre fin aux situations illégales.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 39
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Le principe de la légalité se traduit par deux types de contraintes pour
l’administration : le respect de la hiérarchie des normes juridiques et la
limitation de sa liberté d’action ou d’abstention.
PARAGRAPHE I : LE RESPECT DE LA HIERARCHIE DES NORMES
En principe, la norme inférieure doit être conforme à la norme supérieure ;
ce qui signifie qu’elle ne doit pas la contredire. Les règles étant hiérarchisées, il
importe de déterminer à quel niveau elles se situent et faire respecter leur
hiérarchie.
A- Hiérarchie des normes et hiérarchie des autorités
En principe, l’autorité d’une règle juridique dépend de la place de son
auteur dans la hiérarchie des autorités publiques et subsidiairement de la plus ou
moins solennité présidant à son élaboration. Les autorités inférieures ne peuvent
contredire les actes des autorités qui leur sont supérieures.
1- Hiérarchie des actes administratifs unilatéraux
Les actes administratifs unilatéraux, notamment, les décisions exécutoires
sont revêtues de l’autorité de la chose décidée. L’administration doit les
respecter mais, œuvre de l’administration, ces actes sont soumis à toutes les
sources de la légalité et hiérarchisés entre eux en raison du jeu de la hiérarchie
administrative.
La hiérarchie formelle des actes, détermine les conditions dans lesquelles
le respect des actes administratifs s’impose. Normalement, le supérieur
hiérarchique n’est pas lié par les actes de ses subordonnés. Il peut réformer ou
annuler leurs décisions ; il a même l’obligation d’examiner les requêtes dans ce
sens. (Conseil d’Etat (C.E), 30 Juin 1950, Quéralt).
Lorsque des autorités ont des compétences concurrentes dans une
matière, l’autorité inférieure ne peut contredire les décisions de l’autorité
supérieure mais peut y ajouter dans les limites de ses pouvoirs ce qu’exigent les
circonstances locales.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 40
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Dans le cadre des relations de tutelle et de contrôle, l’autorité de tutelle ne
peut annuler ou faire annuler par le juge les actes de l’organe décentralisé ou se
substituer à lui qu’autant que la loi le permet expressément.
2- Hiérarchie des normes et décisions individuelles
Les décisions individuelles doivent respecter les règlements, normes
générales et impersonnelles. La solution semble évidente lorsque le règlement
émane d’une autorité supérieure à celle chargée de prendre des décisions
individuelles d’application.
Lorsque l’autorité qui a pris la règle générale doit aussi prendre les
mesures individuelles d’application, elle doit, ce faisant, respecter les règles
générales qu’elle a posées tant qu’elles existent. C’est le sens de l’adage : « tu
patere legem quam fecisti » (tu dois supporter les conséquences des lois que tu
as faites toi même).
L’autorité supérieure doit respecter lors de la prise d’actes individuels le
règlement légalement fait par une autorité inférieure, le règlement l’emportant
sur les actes individuels.
PARAGRAPHE II : LES LIMITES A LA LIBERTE D’ACTION OU
D’ABSTENTION DE L’ADMINISTRATION
L’abstention ou la carence de l’administration constitue une illégalité
lorsque son intervention est prescrite par les règles générales applicables à une
matière ou à une situation donnée.
A- L’obligation de prendre des règlements
L’exercice du pouvoir réglementaire est un devoir pour ses détenteurs. Le
gouvernement doit prendre les règlements d’application des lois.
L’administration doit abroger les règlements illégaux.
B- L’obligation de prendre des actes individuels
En général, l’administration est juge de l’opportunité d’agir ou non mais
les autorités administratives sont investies de certaines compétences dans un but
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 41
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
d’intérêt général. L’abstention ou le refus d’agir peut nuire à cet intérêt général
et s’analyse comme un refus de l’administration d’exercer ses compétences.
De plus, l’administration doit faire respecter la légalité donc doit faire
cesser les situations illégales. Ainsi, le retrait d’un acte illégal dans le délai du
recours contentieux est pour l’administration une obligation. Il en est de même
de l’abrogation des décisions individuelles non créatrices de droit devenues
illégales par l’effet d’un changement de circonstance. C’est également le cas du
retrait des décisions individuelles prises sur le fondement d’un règlement déclaré
illégal par le juge administratif.
SECTION II : LES SOURCES DE LA LEGALITE
L’administration est soumise au droit. C’est le principe de la légalité,
principe fondamental selon lequel les actes de l’administration doivent respecter
toutes les normes qui lui sont supérieures.
Les règles qui s’imposent à elle découlent des sources du droit
administratif groupées en un ensemble hiérarchisé (le bloc légal). Certaines
règles sont externes à l’Administration, d’autres internes ; sous certaines
conditions, elle doit toutes les respecter.
Dans tous les cas, ces sources se distribuent en sources écrites et en
sources non écrites.
PARAGRAPHE I : LES SOURCES ECRITES
Elles sont constituées par la constitution ; les traités internationaux, la loi
et le règlement.
A- La constitution.
La constitution dite encore loi fondamentale est la norme suprême de
l’Etat. Elle a un contenu principalement politique : elle organise les pouvoirs
publics et règle leurs rapports avec les citoyens.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 42
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Mais certaines de ses dispositions concernent l’action administrative.
Ainsi la détermination des compétences des autorités administratives est réglée
par certains articles notamment les articles 41, 44, 46 et 72. L’auto
administration des collectivités est prévue par l’article 119.
La constitution en sa qualité de norme suprême, prévaut sur toutes les
autres règles de droit. A cet effet, l’administration est tenue de s’y conformer
absolument dans son action.
B- Les traités internationaux
Le traité est défini comme un accord international par écrit entre sujets de
droit international, destiné à produire des effets juridiques et régi par le droit
international. Les termes traités, conventions, pactes, chartes, accords,
protocoles sont employés comme synonymes.
Le constituant ayant conféré au traité une valeur supérieure à celle des
lois, le juge sanctionne sa violation. En effet, l’article 87 de la constitution
reprenant en cela l’article 55 de la constitution française de 1958 dispose que
« les accords ou traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur
publication, une autorité supérieure à celle des lois ». Ce texte ajoute une réserve
de réciprocité à savoir l’application du traité par l’autre partie.
Les conditions posées par le constituant étant remplies, le traité devient
source de la légalité avec une valeur supra législative. Les conséquences d’une
telle situation sont que le traité et d’une manière générale les règles
internationales s’imposent à l’administration
C- la loi et le règlement
Ils constituent la principale source écrite du droit applicable à
l’administration mais ce sont deux sources de la légalité distinctes qui sont
souventes fois confondues ; la loi étant définie au sens large comme toute norme
émanant de l’autorité publique et présentant un caractère général, impersonnel
et obligatoire. Certes, il est vrai que le règlement participe de la loi par le fait
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 43
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
qu’il revêt le même caractère que celle-ci mais là s’arrête l’assimilation. Car la
loi est l’expression de la volonté générale élaborée par le parlement alors que le
règlement, norme à portée générale et impersonnelle est l’œuvre du pouvoir
réglementaire (pouvoir exécutif).
Enfermée dans le domaine que lui fixe la constitution (article 71), la loi
possède une autorité supérieure à celle du règlement. La solution, évidente pour
les règlements d’application des lois, vaut aussi pour les règlements autonomes
intervenus sur la base de l’article 72 de la constitution. Cela d’autant que le
règlement reste un acte du pouvoir exécutif soumis à la censure du juge et au
respect des principes généraux du droit.
Les ordonnances
Les ordonnances sont des mesures qui participent de la loi et du règlement. Ce
sont des mesures prises par l’exécutif dans le domaine du législatif sur
habilitation du législateur (art. 75 de la constitution.)
Pour l’exécution d’un programme donné, la loi autorise le Président de la
République à intervenir dans son domaine. Il s’agit d’une extension du pouvoir
réglementaire, et ce, dans un délai déterminé. A l’expiration de ce délai,
L’Assemblée Nationale retrouve sa pleine compétence sur les matières
déléguées.
Mais l’administration doit déposer ces ordonnances pour ratification sur le
bureau de l’Assemblée Nationale. Si le législateur est saisi à temps et qu’il
ratifie ces mesures, elles acquièrent force de loi ; dans le cas contraire, elles
gardent leurs valeurs d’acte administratif. S’il les repousse, les ordonnances
deviennent caduques.
PARAGRAPHE II : LES SOURCES NON ECRITES
Ces sources sont essentiellement constituées par la coutume et la
jurisprudence ; cependant, la coutume, mode de formation des règles de droit
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 44
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
des sociétés primitives, n’a qu’un rôle très réduit en droit public interne
particulièrement en droit administratif, à la différence du droit international
public, droit principalement coutumier.
C’est la raison pour laquelle, notre étude portera uniquement sur la
jurisprudence et les principes généraux du droit qui constituent une catégorie
autonome de jurisprudence.
A- La jurisprudence
Le terme jurisprudence revêt deux sens : lato sensu, il désigne l’ensemble
des décisions des juridictions ; stricto sensu, il s’entend de la solution générale
donnée par les juridictions à une question de droit. C’est surtout ce deuxième
sens qui sera pris en considération.
La jurisprudence ainsi définie constitue une véritable source de droit ayant
valeur de droit positif, force exécutoire et autorité de la chose jugée. A cet effet,
elle interprète le droit écrit, l’interprétation ayant la même valeur que la règle
interprétée. Elle crée aussi des règles en suppléant le silence de la loi. Il arrive
que le juge administratif forme expressément dans un arrêt dit de principe la
règle qu’il entend appliquer. Parfois la règle se dégage du rapprochement des
solutions données à des litiges semblables. Le législateur peut mettre fin à une
jurisprudence. Son abstention peut être considérée comme un accord à la règle
jurisprudentielle.
Les jugements devenus définitifs après épuisement des voies de recours
sont revêtus de l’autorité de la chose jugée et s’imposent à l’administration au
même titre que la loi.
B- Les principes généraux du droit (P.G.D)
Ce sont des principes non écrits qui s’imposent « à toute autorité
réglementaire même en l’absence de toute disposition législative » (C.E., 29 Juin
1959, syndicat général des ingénieurs conseils). Leur violation par
l’administration constitue, en effet, une illégalité, et pour cause, ils sont élaborés
par le juge pour assurer la protection des libertés et des droits individuels des
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 45
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
citoyens. Ils ne figurent dans aucun texte mais résultent de l’esprit général du
système juridique. Le juge administratif les découvre, constate leur existence en
s’inspirant de dispositions législatives particulières et convergentes, d’une
disposition de loi significative de l’orientation du droit, de l’idéologie du
préambule de la constitution ou de la déclaration des droits de l’homme et des
citoyens, des exigences de la conscience juridique. Cependant les PGD n’ont pas
de lien avec le droit écrit dont ils ne tiennent ni leur existence ni leur force
juridique. Ils s’appliquent même en l’absence de texte.
Les principaux PGD concernent l’égalité sous toutes ses formes, la liberté,
la non rétroactivité des actes administratifs, le respect des droits de la défense,
etc.
Avant 1958, on pouvait considérer que les PGD avaient la même valeur
que la loi : Ils s’imposaient à l’administration mais le législateur pouvait y
déroger. La thèse, le plus souvent, retenu a été souvent exposée par René
Chapus : les PGD ont une valeur supra décrétale et infra législative. Pourtant le
conseil constitutionnel Français a reconnu une valeur constitutionnelle à certains
(continuité des services administratifs, liberté individuelle, non rétroactivité des
actes administratifs, droit de la défense, liberté d’opinion, égalité devant la
justice.) Ainsi et au regard du droit positif, les PGD hiérarchisés n’ont pas tous
la même valeur juridique car ils se distribuent entre les PGD à valeur
constitutionnelle s’imposant aussi bien au législateur qu’à l’administration ; les
PGD à valeur législative auxquels le législateur peut déroger et les PGD à valeur
réglementaire qui s’imposent à l’administration en l’absence de réglementation
administrative contraire.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 46
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE II : LA PORTEE DU PRINCIPE
Le principe de la légalité est d’une portée considérable du fait qu’il est
sanctionné. Toutefois, cette portée se trouve quelque peu réduite par un certain
nombre de tempéraments ou de limites.
SECTION I : LES SANCTIONS DU PRINCIPE
La sanction du non respect du principe de la légalité est la nullité de l’acte
illégal dont la constatation est assurée par le contrôle de la légalité.
PARAGRAPHE I : LA NULLITE DES ACTES ADMINISTRATIFS
Il existe deux formes de nullité : la nullité stricto sensu et l’inexistence.
A-La nullité stricto sensu
C’est la sanction qui frappe l’acte administratif qui ne respecte pas le
principe de la légalité. L’acte illégal est dit nul et disparaît avec les effets qu’il a
déjà produits. On dit qu’il disparaît ab initio c’est-à-dire dès l’origine ou encore
rétroactivement.
Il y a deux sortes de nullité : la nullité absolue qui protège l’intérêt général et
la nullité relative qui protège les intérêts des particuliers.
B-L’inexistence
C’est la sanction qui frappe l’acte qui est entaché d’un vice
particulièrement grave. Il s’agit d’une irrégularité beaucoup plus grave que dans
l’hypothèse précédente sanctionnée par la nullité. Il convient toutefois de
distinguer l’inexistence juridique de l’inexistence matérielle.
En ce qui concerne l’inexistence matérielle, l’acte matériellement
inexistant ou littéralement inexistant est celui qui n’a jamais été pris et qui par
conséquent n’existe pas.
En ce qui regarde l’inexistence juridique, elle est dite inexistence stricto
sensu c’est-à-dire celle qui, comme précédemment indiqué, frappe les actes
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 47
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
entachés d’une irrégularité grossière. Ces actes sont dits nuls et de nul effet, nul
et non avenus ou entièrement inopérants. Il y a inexistence juridique quand il y a
par exemple usurpation de fonction, empiétement sur les attributions de
l’autorité d’un autre ordre notamment celle du juge, violation d’une règle
s’opposant radicalement à l’édiction de l’acte, absence de support juridique de
l’acte.
Si les deux catégories de décisions peuvent être déférées au juge, la
compétence juridictionnelle varie selon les cas. En effet, l’annulation ne peut
être prononcée que par le juge de l’administration c’est- à-dire par la chambre
administrative de la cour suprême. Le juge annule la décision après en avoir
reconnu l’illégalité. Quant à l’inexistence, à contrario, elle peut être constatée
par tout juge. On ne tient pas compte de la répartition des compétences entre les
juridictions car la juridiction saisie n’aura pas à annuler ce qui n’existe pas mais
à constater et à déclarer nul et non avenu l’acte incriminé. Dans tous les cas,
l’acte illégal et l’acte inexistant disparaissent retro activement. Ils sont censés
n’avoir jamais existé.
PARAGRAPHE II : LE CONTROLE DES ACTES ADMINISTRATIFS :
LE CONTROLE DE LA LEGALITE
Ce contrôle connaît deux modalités : le contrôle administratif et le contrôle
juridictionnel.
A- Le contrôle administratif
Ce contrôle comporte un recours hiérarchique et un recours gracieux.
Le recours hiérarchique est porté devant le supérieur de l’auteur de l’acte
incriminé. Quant au recours gracieux, il est porté devant l’auteur de l’acte pour
lui demander de revenir sur sa décision.
Le contrôle administratif est exercé par l’autorité administrative pour
illégalité et pour inopportunité. La décision administrative a autorité de chose
décidée c’est-à-dire susceptible de recours pour excès de pouvoir.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 48
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
B-Le contrôle juridictionnel
Il comporte le recours en annulation pour excès de pouvoir et l’exception
d’illégalité. Le recours pour excès de pouvoir est porté devant la chambre
administrative de la cour suprême et vise à faire annuler l’acte illégal et est
enfermé dans un délai de deux mois. Quant à l’exception d’illégalité, elle est
soulevée devant tout juge et vise non pas à faire annuler l’acte mais à écarter
son application au cas d’espèce. Elle peut être soulevée à tout moment.
Le contrôle juridictionnel est exercé par le juge selon certaines règles de
formes et de fond pour illégalité et quelques fois pour inopportunité. La décision
de justice, lorsqu’elle est définitive, a autorité de la chose jugée et ne peut faire
l’objet de contestation.
SECTION II : LES LIMITES DU PRINCIPE
Il s’agit en période normale des lacunes du contrôle juridictionnel et en
période de crise de la théorie des circonstances exceptionnelles.
PARAGRAPHE I : LES LACUNES DU CONTROLE JURIDICTIONNEL
Elles résultent du contrôle restreint sur le pouvoir discrétionnaire de
l’administration et de l’absence de contrôle sur les actes de gouvernement.
A- Le pouvoir discrétionnaire de l’administration
Il se définit par opposition à la compétence liée. Il y a compétence liée
lorsque l’administration est obligée d’agir et que sa conduite est dictée par des
textes. Il y a compétence discrétionnaire lorsque l’administration a le choix de
son action et du contenu de sa décision c’est -à-dire lorsqu’elle est libre d’agir et
de déterminer aussi bien son action que le contenu de sa décision.
Le contrôle du juge sur le pouvoir discrétionnaire est un contrôle
minimum qui se limite au contrôle de la qualité de l’auteur de l’acte, à la forme,
au but de l’acte et à l’existence des motifs allégués (erreur de droit ou de fait).
Tandis que sur la compétence liée, s’exerce un contrôle moyen et souvent même
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 49
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
un contrôle maximum comprenant le contrôle de légalité et le contrôle
d’opportunité.
B- Les actes de gouvernement
Ce sont des actes accomplis par les autorités administratives et insusceptibles
de recours juridictionnel. Il s’agit d’actes inspirés par un mobile politique. On en
distingue deux catégories :
- Ceux concernant les rapports pouvoir exécutif et pouvoir législatif
- Ceux concernant les rapports entre l’Etat ivoirien et les autres Etats et
Organisations Internationales.
L’acte de gouvernement bénéficie d’une immunité totale de juridiction c’est-
à-dire qu’on ne peut exercer aucun recours contre un tel acte.
PARAGRAPHE II : LES CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES
Dans certaines situations graves, l’administration ne saurait tout à la fois
respecter strictement la légalité, assurer l’ordre public et faire fonctionner les
services publics. On admet donc qu’en période de crise, le strict respect de la
légalité s’efface devant la nécessaire continuité de l’Etat et les exigences de
l’ordre public. L’administration reste soumise à la légalité mais à une légalité
d’exception dont le contenu diffère de celui de la légalité normale.
Ces circonstances organisées par des textes particuliers ont été étendues à
d’autres domaines par le juge qui a construit une véritable théorie des
circonstances exceptionnelles.
A- Les circonstances exceptionnelles organisées par les textes
Les textes organisant les circonstances exceptionnelles sont tantôt
constitutionnels, l’état de crise de l’article 48 de la constitution, tantôt législatifs
et concernent l’état de siège, l’état d’urgence et d’autres mesures de police.
L’état de crise stipulé par l’article 48 de la constitution autorise le
Président de la République « lorsque les institutions de la République,
l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses
engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 50
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics est interrompue » à exercer
tout seul la totalité des pouvoirs publics. Il devient à la fois exécutif et législatif.
Cette dictature temporaire se substitue ainsi à la légalité normale dominée par le
principe de la séparation des pouvoirs.
La loi du 30 décembre 1916 organise l’état de siège en cas de péril
imminent pour la sécurité intérieure et extérieure ; dans ce cas, il y a transfert
des pouvoirs de police à l’autorité militaire.
La loi du 07 Novembre 1959 déclare l’état d’urgence en cas de péril
imminent résultant d’atteinte grave à l’ordre public. Elle confère au Ministre de
la sécurité des pouvoirs de police exceptionnellement étendus.
La loi du 17 Janvier 1963 assurant la promotion économique et sociale de
la nation et ses décrets d’application autorisent le gouvernement à requérir des
personnes pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national.
B- La théorie Jurisprudentielle des circonstances exceptionnelles
Construite par le Conseil d’Etat à l’occasion de la première guerre
mondiale sous le nom de pouvoir de guerre, cette théorie est devenue par la
suite un cas particulier de la théorie des pouvoirs de crise ou des circonstances
exceptionnelles.
Les conditions d’existence des circonstances exceptionnelles découlent
des arrêts Heyriès (C.E., 28 Juin 1918) et Dames Dol et Laurent (C.E, 28 Février
1919). Il s’agit de situations graves, imprévues et anormales mettant l’autorité
administrative dans l’impossibilité de respecter la légalité normale. Mais les
mesures prises en violation de la légalité ordinaire doivent être strictement
limitées à ce qui est nécessaire à la sauvegarde de l’ordre public, de la continuité
de l’administration ou de l’intérêt public et à la durée des circonstances
exceptionnelles.
Le Juge écarte la légalité normale à l’occasion d’un litige précis, sa
violation étant excusée par les circonstances exceptionnelles qui doivent exister
lors de la prise de l’acte. Celui-ci doit cesser de produire ses effets dès lors que
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 51
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
les circonstances redeviennent normales. Par ailleurs, les circonstances
exceptionnelles légitiment les mesures nécessaires mais elles seules. Exemple :
suspension de l’application d’une loi par le gouvernement (Arrêt Heyriès
précité) ; intervention d’un organe de fait dans les compétences de
l’administration (C.E., 05 Mars 1948, Marion et autres).
Mais ces circonstances ne dispensent pas l’administration d’agir
légalement lorsqu’elle le peut (C.E., 28 Mars 1947, Ste Damien).
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 52
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
TITRE III : LES MISSIONS DE L’ADMINISTRATION
Deux missions régaliennes ont été assignées à l’Administration : ce sont
d’une part une mission de prestation s’incarnant dans le service public et une
mission de prescription à travers la police administrative.
CHAPITRE I : LE SERVICE PUBLIC
Clé de voûte de la construction étatique, le service public peut être défini
comme une mission de prestation qui consiste pour l’Administration à rendre
des services aux usagers.
Ainsi, après avoir cerné la notion de service public, nous nous attacherons
ensuite à en préciser le régime juridique.
SECTION I : LA NOTION DE SERVICE PUBLIC
La notion de service public occupe dans le droit administratif et dans
l’organisation de l’Etat une place très importante.
Du point de vue administratif, on appelle service public, d’une part, des
activités de production, de gestion, de services d’utilité collective prises en
charge par l’Administration ; et d’autre part, les organismes qui assurent ces
activités.
Dans le langage courant, le service public désigne donc l’ensemble des
administrations de l’Etat, des collectivités territoriales et des établissements
publics.
Quelle est donc la définition du service public ? Et quelle en est la
typologie ?
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 53
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE I : LA DEFINITION DU SERVICE PUBLIC
Le service public se définit aujourd’hui comme une activité d’intérêt
général assurée soit par une personne publique, soit par une personne privée
sous le contrôle d’une personne publique.
En toute hypothèse, le service public suppose réunis deux éléments : une
activité d’intérêt général et une dépendance organique vis-à-vis d’une
collectivité publique. Il y a donc deux éléments centraux :
- le critère matériel, c’est-à-dire l’activité : le service public se caractérise par
la réalisation de prestations fournies aux usagers.
-le critère finaliste, c’est-à-dire l’intérêt général : seule une activité d’intérêt
général peut être érigée en service public. Autrement dit, le service public a pour
but la satisfaction de l’intérêt général. Seuls les gouvernants sont chargés de
définir ce qui est l’intérêt général. Le service public, même lorsqu’il est assuré
par une personne privée, est toujours sous le contrôle ou la surveillance de
l’Administration.
PARAGRAPHE II : LA TYPOLOGIE DES SERVICES PUBLICS
En règle générale, il y a deux types de services publics : les services
publics administratifs (S.P.A.) et les services publics industriels et commerciaux
(S.P.I.C.). Trois critères permettent de distinguer ces deux types de services
publics : le critère tenant à l’objet de l’activité, le critère relatif au mode de
financement et le critère ayant trait au mode de gestion.
A- L’objet de l’activité
Lorsque l’activité du service public est analogue à celle d’une entreprise
privée, alors c’est un service public industriel et commercial (S.P.I.C.) ; a
contrario, c’est un service public administratif (S.P.A.).
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 54
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
B- Le mode de financement
L’essentiel du financement d’un S.P.I.C. doit provenir des redevances
payées par les usagers en contrepartie des prestations qui leur sont procurées par
le service ; alors que le principal mode de financement des S.P.A. est la
subvention à eux allouée par l’Etat.
C- Le mode de gestion
La gestion d’un S.P.I.C. doit relever du droit privé, c’est-à-dire que l’on
recourt aux règles de la comptabilité privée, à la recherche de rentabilité, de
profit ; alors que les S.P.A. sont régis par les règles du droit public.
SECTION II : LE REGIME JURIDIQUE DES SERVICES PUBLICS
L’étude du régime juridique des services publics conduit à analyser leur
fonctionnement et leur mode de gestion.
PARAGRAPHE I : LE FONCTIONNEMENT DES SERVICES
PUBLICS
Le fonctionnement des services publics repose sur des règles qui sont de
deux ordres : certaines sont communes à tous les services publics et d’autres
sont particulières aux S.P.A. ou aux S.P.I.C.
A- Les règles communes à tous les services publics :
les lois du service public
Certains principes fondamentaux s’imposent à tous les services publics.
On les appelle traditionnellement les «lois de Rolland » parce qu’elles ont été
systématisées par Louis Rolland.
Ces principes sont au nombre de trois : égalité, continuité, adaptation
auxquels la doctrine ajoute un quatrième, la neutralité.
1- Le principe d’égalité devant le service public
Ce principe interdit toute discrimination de la part du service public.
Ainsi, ce principe concerne aussi bien les agents de l’administration au regard de
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 55
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
leur recrutement et de leur avancement que les usagers (droit d’accès au service
public). Ce principe est également valable à l’égard des cocontractants de
l’Administration.
2- Le principe de la continuité du service public
Dès lors que le service public existe, l’Administration doit respecter le
principe de la continuité du service public. A cet effet, le service public doit
fonctionner sans interruption, de façon continue. La satisfaction de l’intérêt
général doit être assurée quelles que soient les circonstances même en période
exceptionnelle.
3- Le principe d’adaptation ou de mutabilité du
service public
Le service public doit s’adapter à tout moment à l’évolution des exigences
de l’intérêt général. Aucune situation acquise ne doit paralyser cette situation.
C’est une condition de l’efficacité de la satisfaction des besoins d’intérêt
général. Ce principe entraîne comme conséquence pour l’usager du service
public qu’il n’a aucun droit acquis au maintien du service public.
4- Le principe de la neutralité du service public
Ce principe voudrait que le service public fonctionne en n’ayant en vue
que l’intérêt général. Il ne doit prendre en compte ni le sexe, ni la race, ni les
croyances religieuses, philosophiques, ni les opinions politiques, ni l’ethnie etc.
B- Les règles particulières
Pour distinguer les S.P.I.C. des S.P.A., la jurisprudence utilise un faisceau
d’indices composé de trois éléments : l’objet du service, l’origine des ressources
et les conditions de fonctionnement.
De façon systématique, les S.P.A. sont soumis au droit public
relativement aux règles d’organisation, aux rapports avec les usagers, au
personnel et aux tiers.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 56
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Pour ce qui concerne le S.P.I.C., il est soumis en grande partie au droit
privé relativement aux rapports du service avec le personnel, les usagers, les
fournisseurs et les clients.
PARAGRAPHE II : LES MODES DE GESTION DU SERVICE PUBLIC
Il importe de distinguer la gestion par les personnes publiques de la
gestion par les personnes privées.
A- La gestion par les personnes publiques
La personne publique peut gérer elle-même le service public ou en confier
la gestion à une personne publique spéciale, l’établissement public.
1- La gestion directe par la personne publique : la régie
Il s’agit de l’exploitation directe du service par l’Administration avec ses
biens et son personnel. Le budget du service est intégré au budget de la
collectivité concernée. En d’autres termes, un service géré en régie ne dispose
pas de personnalité morale.
2- La gestion du service public par un établissement
public
L’établissement public, à la différence de la régie, est un service public
doté de la personnalité morale. C’est une personne morale de droit public qui
gère un service public. On parle alors de service public personnalisé.
Un établissement public est toujours créé par une personne publique. Il
doit donc être distingué des établissements d’utilité publique qui sont des
organismes privés, essentiellement des associations ou des fondations à qui
l’Administration a reconnu la qualité d’utilité publique.
En Côte d’Ivoire, il a deux types d’établissements publics, les
établissements publics administratifs (E.P.A.) et les établissements publics
industriels et commerciaux (E.P.I.C.). Outre leur objet, les E.P.A. se distinguent
des E.P.I.C. par leur mode de financement ; car les premiers sont financés
essentiellement par des dotations budgétaires de l’Etat et les seconds par le
produit de leurs travaux ou de leurs prestations.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 57
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
B- La gestion par les personnes privées
Les personnes privées gèrent les services publics. La personne privée peut
être investie de cette gestion sur la base d’un contrat dit de délégation de service
public (concession de service public). Mais la personne privée peut aussi gérer
directement un service public indépendamment de toute technique contractuelle
et sur la base d’une habilitation légale ou réglementaire. Le législateur ou le
pouvoir réglementaire crée des organismes privés auxquels il confère
directement des missions de service public.
Aujourd’hui, bon nombre de missions de services publics sont assurées
directement par les organismes privés (associations, fondations, sociétés, etc.)
qui agissent certes sous le contrôle de la puissance publique mais en l’absence
de toute habilitation contractuelle.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 58
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE II : LA POLICE ADMINISTRATIVE
A côté de sa mission de prestation, la seconde mission de l’Administration
est celle de la police administrative. Celle-ci a pour but le maintien de l’ordre
public dans le pays, ce qui est la condition essentielle de toute vie sociale
harmonieuse. Elle consiste à réglementer les activités privées de la vie sociale,
imposer des limitations aux droits et libertés des citoyens.
Le mot police a deux sens :
- au sens organique, elle est constituée par l’ensemble des forces chargées
d’assurer l’ordre public et, sous le contrôle de l’autorité judiciaire,
d’appréhender les individus qui se sont rendus coupables d’infraction afin de les
déférer à la justice. C’est en ce sens que l’on peut parler de fonctionnaires de
police ;
- au sens institutionnel ou matériel, la police est constituée par les activités
juridiques ou matérielles qui ont pour but de faire respecter l’ordre public, qu’il
s’agisse de prévenir les troubles ou qu’il s’agisse de réprimer les atteintes à
l’ordre public. Il s’agit là essentiellement de la police administrative qui est donc
une activité consistant à prévenir les troubles à l’ordre public et à maintenir
celui-ci.
La police administrative se manifeste à la fois par des activités matérielles
(exemple : vérification d’identité, bornage routier, surveillance de
manifestation…) et par l’édiction de normes juridiques de caractère
réglementaire ou individuel.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 59
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
SECTION I : LA NOTION DE POLICE ADMINISTRATIVE
La police administrative doit être distinguée de la police judiciaire. Elles
n’ont pas la même finalité. La police administrative se décline entre police
générale et police spéciale. Leurs activités ne sont pas les mêmes et elles
peuvent entrer en concurrence.
PARAGRAPHE I : LA DEFINITION ET LES CARACTERISTIQUES
DE LA POLICE ADMINISTRATIVE
La police administrative est le pouvoir qu’a l’Administration d’imposer
aux administrés des contraintes et des limitations à leur liberté en vue d’éviter
que l’ordre public ne soit troublé.
Elle se caractérise essentiellement par trois éléments qui permettent de la
définir comme l’action unilatérale des autorités administratives ayant pour but la
préservation de l’ordre public.
A- Le but de la police : l’ordre public
C’est l’élément central de la notion de police administrative. Il est plus
étroit et plus précis que le but d’intérêt général qui doit marquer toute action
administrative.
Traditionnellement, l’ordre public englobe trois préoccupations : la
sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique.
Les mesures de police ont donc pour objet d’éviter les risques d’accident,
d’incendie, d’inondation, les réglementations du bruit, des manifestations…
Elles peuvent aussi viser l’hygiène et la santé en veillant notamment à la
salubrité ou à la pollution de l’eau, des denrées alimentaires.
Mais la police n’a pas pour seul objet d’éviter les incidents matériels. La
moralité peut faire partie de l’ordre public. En effet, l’immoralité est un objet de
la police surtout si elle peut provoquer des troubles à l’ordre public vu les
circonstances locales. De plus en plus, des valeurs comme l’esthétique
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 60
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
(affichage, urbanisme), le respect de la dignité humaine sont prises en compte
par la police administrative et intégrées dans l’ordre public.
B- Le caractère préventif de la police administrative :
distinction avec la police judiciaire
La police administrative a pour but d’éviter que l’ordre public ne soit
troublé ; autrement dit, elle doit empêcher la survenance des troubles à l’ordre
public. Elle est donc préventive et se distingue ainsi de la police judiciaire qui a
pour but de rechercher les infractions, d’en rassembler les preuves et d’en livrer
les auteurs à la juridiction pénale. La police judiciaire est essentiellement
répressive.
La distinction entre les deux polices est fondée sur un critère finaliste. Il
faut préciser que si la police administrative est exercée selon les cas au nom de
l’Etat ou des autres personnes publiques territoriales, la police judiciaire est, au
contraire, une activité exclusivement étatique.
C- Le caractère unilatéral de la police administrative
La police administrative est une prérogative de puissance publique et est
une fonction monopolistique de l’Administration. Conséquemment, toutes les
activités juridiques de la police administrative doivent prendre nécessairement la
forme de prescriptions unilatérales.
Il n’est pas possible de prendre une mesure de police par contrat et
l’Administration ne saurait utiliser son pouvoir de police pour sanctionner la
violation des obligations contractuelles d’un de ses cocontractants. Il est
également strictement interdit à l’Administration de concéder ou de déléguer la
police à une personne privée.
PARAGRAPHE II : L’ORGANISATION DE LA POLICE
ADMINISTRATIVE
Il existe à côté de la police générale des polices spéciales. Les autorités de
ces polices peuvent intervenir sur le même territoire, le même objet. Ce qui pose
la question du concours de compétence des polices.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 61
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
A- Police générale et police spéciale
La police administrative générale est celle qui est exercée d’une manière
indifférenciée à l’égard de n’importe quel genre d’activité des particuliers.
Comme son nom l’indique, elle intéresse tous les individus, tous les groupes
d’activités et elle s’exerce en tout lieu, lieux publics et privés. Les autorités de
police générale sont le Président de la République, le ministre en charge de la
police par délégation présidentielle, les préfets et sous-préfets, le maire et le
conseil municipal.
Si les autorités titulaires du pouvoir de police générale peuvent prendre
des mesures visant toute la population dans le ressort duquel elles exercent leur
autorité, il existe également des polices spéciales qui visent à réglementer des
domaines particuliers d’activité ou certaines catégories de personnes. Il ne peut
y avoir de polices spéciales que prévues et organisées par des textes. Les textes
désignent les autorités qui en sont chargées. Les polices spéciales sont diverses
(exemple : police de la chasse, de la pêche, des étrangers, de la construction, des
chemins de fer, du cinéma, des jeux etc.).
B- Le concours et la concurrence des polices
Les différentes autorités de police sont parfois en accord, quelques fois en
concurrence pour régir la même matière. La diversité des polices et des autorités
compétentes peut être à l’origine de situations concurrentielles appelant des
partages de frontières. Il s’agit en réalité de complémentarité plus que de
concurrence dans la mesure où les différentes autorités concourent au maintien
de l’ordre public.
1- Combinaison entre les autorités de police générale
Le principe de la hiérarchie des normes veut que les règles édictées par
l’autorité supérieure priment sur celles édictées à un échelon moins élevé. Ainsi,
une mesure de police générale prise par le Président de la République devrait
être respectée par tous les départements ou tous les maires.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 62
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
L’autorité de police de niveau inférieur ne peut donc empiéter sur les
pouvoirs de l’autorité supérieure. Elle peut cependant compléter les
prescriptions de l’autorité supérieure mais seulement, en aggravant les mesures
prises par l’autorité supérieure, à condition que les circonstances locales le
justifient. Exemple : un maire peut, en considération des circonstances locales
(voies étroites très fréquentées) abaisser la vitesse maximale de 80 km/heure
autorisée pour la traversée des agglomérations. Il lui est par contre interdit, en
prétextant la longueur et le parfait état de la voie et l’absence de fréquentation,
d’autoriser une vitesse supérieure.
2- Combinaison entre la police générale et les polices
spéciales
En principe, la police spéciale l’emporte sur la police générale. Mais en
dépit de cela, même en cas d’intervention d’une autorité de police spéciale,
l’autorité de police générale peut intervenir à deux conditions : d’une part, il faut
que les circonstances locales le justifient et d’autre part, dans le sens de
l’aggravation de la mesure de l’autorité de police spéciale.
SECTION II : L’EXERCICE DU POUVOIR DE POLICE
La police administrative, prérogative de puissance publique, ne peut être
exercée par les autorités de police qu’au travers de certains procédés et dans
certaines limites.
PARAGRAPHE I : LES PROCEDES DE POLICE
Les mesures de police sont tantôt des opérations matérielles tantôt des
actes juridiques.
A- Les actes juridiques ou les mesures de police
Les mesures de police sont soient des mesures réglementaires soient des
mesures individuelles.
Les mesures réglementaires s’adressent à un nombre indéterminé de
particuliers et comportent plusieurs modalités :
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 63
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
- la réglementation qui consiste pour l’autorité de police à déterminer les
conditions d’exercice d’une liberté ou d’une activité donnée ;
- la déclaration préalable : dans ce cas, un individu ne peut exercer une activité
qu’après avoir informé l’autorité de police (exemple : l’association) ;
- l’autorisation préalable : le particulier ne peut exercer l’activité qu’après avoir
obtenu l’autorisation expresse de l’autorité de police ;
- l’interdiction qui est une mesure sévère consistant à prohiber l’exercice de
certaines activités déterminées.
Les mesures individuelles sont des mesures restrictives de liberté qui
s’adressent à un ou à quelques administrés. Ces mesures peuvent consister en
des autorisations ou interdictions écrites ou verbales. En principe, les mesures
individuelles sont prises en application des mesures réglementaires. Mais, il peut
y avoir des mesures individuelles autonomes.
B- Les actes matériels ou les moyens d’exécution
S’agissant des actes matériels, on parle souvent de coercition, laquelle
consiste dans la possibilité d’employer la force publique pour prévenir ou faire
cesser un désordre. Le principe est que la mise en œuvre de la force publique est
subordonnée à l’autorisation du juge, sauf en cas d’urgence. Il n’est
naturellement pas besoin de l’autorisation du juge lorsqu’il s’agit d’utiliser la
force publique pour maintenir l’ordre public.
PARAGRAPHE II : LES LIMITES DE L’EXERCICE DU POUVOIR
DE POLICE
Parce que ce pouvoir porte atteinte aux libertés et qu’il est admis que « la
liberté est la règle et la restriction de police l’exception », le juge va exercer un
contrôle étendu sur l’exercice du pouvoir de police.
Le contrôle va s’exercer sur la légalité du but et des motifs de la mesure
de police, laquelle ne doit avoir d’autre finalité que le maintien ou le
rétablissement de l’ordre public et être motivée par des menaces réelles à cet
ordre public.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 64
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Par ailleurs, la mesure de police doit être nécessaire ; elle doit avoir pour
but la sauvegarde de l’ordre public ; et certaines mesures de police sont en
principe prohibées ; enfin, les mesures de police doivent être en rapport avec la
nature de la liberté en question.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 65
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
TITRE IV : LES MOYENS D’ACTION DE L’AMINISTRATION
Pour remplir ses missions, l’Administration dispose d’un certain
nombre de moyens qu’il est possible de regrouper en deux grandes catégories :
les moyens humains et matériel d’une part, et les moyens juridiques, d’autre
part.
Les moyens juridiques constitués par les actes administratifs sont
soumis au régime juridique de droit public et sont de deux sortes : les actes
administratifs unilatéraux et les contrats administratifs qui sont pris et mis en
œuvre par le personnel de l’Administration.
CHAPITRE I : LES ACTES ADMINISTRATIFS UNILATERAUX
La prérogative essentielle de l’administration réside dans le pouvoir de
prendre des décisions s’imposant par la seule volonté de leurs auteurs
indépendamment du consentement de ceux qu’elles concernent. Grâce à cette
prérogative, l’administration peut imposer des obligations, délivrer des
autorisations, conférer des droits sans avoir à faire reconnaître son droit d’agir
par un juge.
L’acte administratif unilatéral est pris par une autorité publique dans
l’exercice de ses fonctions ou par une personne privée pour l’exécution du
service public dont elle est chargée et faisant usage de prérogatives de puissance
publique dont elle est investie pour accomplir ce service.
Sous la forme de la décision exécutoire, l’acte administratif unilatéral
constitue le principal mode d’action de l’administration. Hauriou voyait dans la
faculté de prendre des décisions exécutoires « le privilège du préalable »
signifiant que la décision est prise et s’applique préalablement à toute
intervention juridictionnelle. Pour le C.E, cette faculté constitue « la règle
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 66
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
fondamentale » du droit public (C.E, 02 Juillet 1982, Huglo). Le juge
n’intervient qu’a posteriori en conséquence d’un recours formé par une personne
qui entend contester la légalité de la décision.
L’acte administratif unilatéral, sous son apparente unicité recouvre en
réalité une panoplie de normes ; d’où la nécessité d’une classification de ces
règles. Par ailleurs, leur entrée en vigueur répond à certaines conditions et elles
produisent des effets.
SECTION I: LA CLASSIFICATION DES ACTES ADMINISTRATIFS
UNILATERAUX
Pour classer les actes administratifs unilatéraux, on peut se placer aux
deux points de vue organico - formel et matériel.
PARAGRAPHE I : LA CLASSIFICATION ORGANICO-FORMELLE
Ce critère prend en compte à la fois l’auteur de l’acte et sa procédure
d’élaboration. Il permet d’établir d’une manière générale la hiérarchie des actes
administratifs. On peut ainsi distinguer les actes du Président de la République,
des ministres et des autres autorités administratives.
Le Président de la République en sa qualité de chef de l’administration
peut prendre une variété d’actes parmi lesquels les décrets occupent une place
prépondérante.
Les dénominations des actes des ministres varient également selon leur
nature et selon leur importance. Il échet ici de distinguer les arrêtés des autres
actes. L’arrêté est la forme la plus solennelle des actes des ministres. Il est le
plus souvent réglementaire mais peut être individuel ou collectif. L’arrêté
interministériel est celui signé par deux ou plusieurs ministres. En dehors des
arrêtés, les ministres peuvent édicter une diversité d’actes : décisions
individuelles, notes de service, circulaires, etc.
En ce qui concerne les actes des autres autorités, il faut distinguer les
actes des autorités locales de ceux d’autres organismes. Pour les autorités
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 67
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
locales, la dénomination juridique varie selon que ces autorités sont
individuelles ou collégiales. Les actes des autorités individuelles (préfet, sous-
préfet, maire, etc.) sont appelés arrêtés tandis que ceux des autorités collégiales
(conseil municipal, conseil général) sont dénommés délibérations. Quant aux
actes des autres organismes, rentre dans cette catégorie une diversité
d’organismes intérieurs ou extérieurs à la structure de l’administration. On
mentionnera à titre d’exemples, dans le premier cas, les actes des autorités des
établissements publics nationaux et dans le second cas, ceux des personnes
privées agissant dans le cadre d’une mission de service public.
PARAGRAPHE II : LA CLASSIFICATION MATERIELLE
Le critère matériel se réfère au contenu de l’acte et permet de distinguer
l’acte réglementaire de l’acte non réglementaire. La distinction entre les deux
catégories d’actes se fonde sur des critères qui permettent d’apprécier la
différence de nature qui les sépare. On fait généralement appel à deux critères
distincts pour caractériser l’acte réglementaire. Ce sont d’une part le caractère
permanent de l’acte et d’autre part son caractère général et impersonnel.
Par le caractère permanent de l’acte, il faut entendre que l’acte s’applique
non pas à une situation ponctuelle, à une situation momentanée mais à toute une
catégorie, à une situation de longue durée. Constitue ainsi un acte réglementaire
celui qui fixe les conditions requises pour être candidat à un concours, le mode
de désignation du jury et la nature des épreuves. En revanche, ne revêt pas le
caractère réglementaire, l’acte qui, chaque année, ouvre le concours, fixe le délai
d’inscription, la date des épreuves et le nombre de places. Le critère tiré du
caractère permanent n’est cependant pas satisfaisant car un acte peut être
permanent sans être réglementaire. Il en va ainsi de la nomination d’un
fonctionnaire dont l’effet n’est pas limité dans le temps. Inversement, un acte
peut être réglementaire sans être permanent. Il en est ainsi d’un acte de police
édicté pour maintenir l’ordre public au cours d’un événement qui ne durera que
quelques heures.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 68
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Par le caractère général et impersonnel, l’acte vise non pas une situation
particulière ou une personne ou des personnes individuellement désignées, mais
une situation d’ensemble, tous les citoyens ou une catégorie de citoyens.
Constitue ainsi un règlement l’acte fixant le statut d’un corps de fonctionnaires.
La différence entre les deux catégories d’actes n’est pas de degré mais de
nature. Elle n’est pas quantitative mais qualitative car on ne prend pas en
considération le nombre de personnes visées par l’acte mais leur situation
objective. Ainsi, la décision nommant plusieurs fonctionnaires et même celle
conférant une décoration à des milliers de personnes ne sont pas réglementaires
car ces personnes bien que nombreuses sont chacune visées individuellement.
Constitue en revanche un règlement, l’acte conférant une indemnité de logement
au préfet d’Abidjan.
Il convient, en tout état de cause, de préciser qu’il existe deux catégories
d’actes non réglementaires : les actes individuels et les actes collectifs. L’acte
individuel est celui qui vise une ou plusieurs personnes sans qu’il n’y ait un lien
de solidarité entre leur situation respective. Il en va ainsi de la nomination d’un
ou de plusieurs fonctionnaires ou de la décision d’un jury d’examen intéressant
plusieurs personnes ; l’acte collectif est celui qui vise plusieurs personnes dont
les situations sont solidaires les unes des autres. L’exemple type est celui de la
délibération d’un jury de concours classant les candidats reçus : l’ordre de
classement lie l’autorité investie du pouvoir de nomination.
L’intérêt de la distinction entre acte réglementaire et acte non
réglementaire résulte de la différence de régime juridique : les modes de
publicité sont différents, la publication étant le mode normal de publicité de
l’acte réglementaire (ainsi que de l’acte collectif), alors que la notification est
celui des actes individuels ; la faculté pour l’administration d’abroger ou de
rapporter les actes obéit à des règles différentes selon qu’il s’agit d’un acte
réglementaire ou d’un acte non réglementaire.
En combinant les deux critères, on peut envisager trois hypothèses :
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 69
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
- Dans chaque catégorie d’acte réglementaire ou individuel (critère matériel), la
hiérarchie s’établit en fonction de la hiérarchie des autorités d’élaboration
(critère organico-formel). On obtient ainsi en allant du sommet au bas de
l’échelle la classification suivante : décret en conseil des ministres, décret
simple, arrêté présidentiel, arrêtés interministériels, arrêtés ministériels, arrêtés
préfectoraux, arrêtés municipaux, etc.
- Deux actes réglementaires ou deux actes individuels de la même autorité
sont en situation d’égalité et non de subordination : pas de hiérarchie. Mais
en cas conflit, le second doit prévaloir sur le premier : « lex posterior derogat
anteriore » ou le particulier sur le général : « lex spécialis derogat generale ».
- L’acte réglementaire s’impose à l’acte individuel. L’auteur d’un acte
individuel doit respecter les règlements qu’il a lui même pris, a fortiori, ceux
des autorités supérieures, voire ceux des autorités subordonnées.
SECTION II : L’ENTREE EN VIGUEUR DES ACTES UNILATERAUX
L’entrée en vigueur de l’acte qui marque son point de départ comporte
trois modalités : la validité de l’acte, son opposabilité et sa non rétroactivité.
PARAGRAPHE I : LA VALIDITE DE L’ACTE
Dès son émission, c’est – a -dire dès sa signature par l’autorité compétente,
l’acte devient valide, obligatoire et existe juridiquement. Il en découle deux
conséquences importantes : l’indifférence de la publicité et la création de droits.
L’absence de publicité de l’acte n’affecte nullement sa validité, celle-là
n’étant pas une condition de celle-ci qui s’appréhende au jour de l’émission de
l’acte. Ainsi, l’absence de notification à un fonctionnaire de la décision de sa
révocation n’est pas de nature à entacher ladite décision d’irrégularité (Cour
Suprême, Chambre Administrative (C.S.C.A.), 20 Février 1963, Kipré Gbeuly).
L’acte crée des droits au profit des administrés (et éventuellement des
obligations à leur charge) dès sa signature et son auteur ne peut dans certains cas
revenir sur sa décision. La Cour Suprême a expressément confirmé la
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 70
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
jurisprudence reconduite en la matière. (C.E., 19 Octobre 1952, demoiselle
Mattéi). En effet, dans l’arrêt El Hadj Bakary Koné contre ministère des travaux
publics en date du 22 Juillet 1981, la chambre administrative de la cour suprême
considère à propos du retrait d’une concession provisoire que « cette décision
individuelle a créé dès sa signature des droits au profit du requérant ». Toutefois,
le principe ne vaut que pour les actes individuels. Les actes réglementaires, eux,
n’engendrent des droits au profit des particuliers qu’à partir de leur publication
(C.E, 26 Décembre 1954, demoiselle Balthazar) et les mesures individuelles
prises en application d’un règlement non publié ou qui a fait l’objet d’une
publicité inadéquate ou insuffisante sont irrégulières pour manque de bases
légales.
PARAGRAPHE II : L’OPPOSABILITE DE L’ACTE ADMINISTRATIF
UNILATERAL
L’opposabilité est l’application effective de l’acte aux administrés. L’acte
n’est opposable aux administrés que s’il a fait l’objet d’une publicité c’est – à –
dire à partir du moment où il a été porté à leur connaissance. La publicité
constitue donc la condition de l’opposabilité. Elle est plus exactement, selon
Pierre Dévolvé, « la condition suspensive de l’effectivité de la force obligatoire
de l’acte ». On en distingue deux modalités: la notification et la publication.
La notification est le mode de publicité des actes individuels c’est –à-
dire un mode de publicité personnel utilisé pour les décisions individuelles.
Celles-ci doivent, en effet, être directement et personnellement portées à la
connaissance des intéressés.
La publication est le mode de publicité des actes réglementaires. C’est un
mode général et impersonnel destiné à porter l’acte à la connaissance de tous les
administrés ou de tous ceux qui pourraient être intéressés. La publication peut
se faire de diverses manières dont les principales sont :
- l’insertion au journal officiel de la république de Côte d’Ivoire (J.O.R.C.I) :
c’est le cas des lois, des ordonnances et arrêtés exécutoires sur tout le territoire
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 71
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
national trois jours francs après leur insertion sauf en cas d’urgence où on
procède par voie d’affichage à la préfecture suivi de trois communiqués radio
diffusés ;
- l’insertion dans le recueil local pour les actes préfectoraux ;
- ou par voie d’affichage pour les arrêtés municipaux.
PARAGRAPHE III : LA NON RETROACTIVITE DES ACTES
ADMINISTRATIFS UNILATERAUX
L’acte administratif unilatéral ne peut produire d’effet avant la date de sa
signature. La règle est donc la non rétroactivité mais elle comporte des
exceptions.
La règle de la non rétroactivité prescrite à l’article 2 du code civil pour les
lois est un principe général de droit (P.G.D.) en vertu duquel « Les règlements
ne disposent que pour l’avenir », (C.E., 25 juin 1948, Sté du Journal L’Aurore).
Ce principe porté par la jurisprudence reconduite a été expressément confirmé
par le Juge Ivoirien (C.S.C.A, 31 Mai 1967, Ahoué N’guessan contre le ministre
de la fonction publique ; 26 Mars 1980, Comaran Africa Line contre ministère
de la Marine).
Quant aux exceptions, elles se ramènent à deux hypothèses principales :
lorsque la loi autorise ou donne effet rétroactif à l’acte administratif ou
lorsqu’il s’agit de régulariser la situation engendrée par le retrait ou l’annulation
d’un acte illégal. Il en va ainsi de la reconstitution de la carrière du fonctionnaire
illégalement révoqué.
SECTION III : LES EFFETS DES ACTES ADMINISTRATIFS
UNILATERAUX
L’acte administratif unilatéral, lorsqu’il est régulièrement pris, produit
des effets certains. Ainsi pour exécuter ses décisions, l’administration dispose
de moyens exorbitants de droit commun qui échappent de ce fait aux
particuliers.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 72
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Mais les actes administratifs unilatéraux à un moment ou à un autre,
cessent de produire des effets, d’où leur fin ou leur retrait.
PARAGRAPHE I : LES MOYENS D’EXECUTION DES DECISIONS
ADMINISTRATIVES.
Les moyens qui assurent l’exécution des décisions par voie administrative
sont appelés privilèges. On en distingue deux : le privilège du préalable et le
privilège de l’exécution d’office.
Le privilège du préalable est en fait la manifestation du caractère obligatoire
que l’acte administratif porte en lui même. Il consiste dans la possibilité qu’a
l’administration de prendre des décisions qui s’imposent immédiatement aux
administrés sans s’adresser préalablement au Juge.
Le privilège de l’exécution d’office permet à l’administration de recourir
à la force pour assurer l’exécution de ses décisions.
PARAGRAPHE II : LA FIN DES ACTES ADMINISTRATIFS
UNILATERAUX
La fin des effets de l’acte administratif unilatéral peut résulter de plusieurs
causes tenant les unes à l’acte lui même, les autres à des circonstances
extérieures à la volonté de son auteur et d’autres, enfin, à la volonté de celui-ci
postérieurement à la signature de l’acte. Toutefois, il convient de faire le départ
entre l’acte régulier et l’acte irrégulier.
A- L’acte régulier
Il importe ici de distinguer le retrait de l’abrogation. Le retrait de l’acte
régulier n’est possible que si celui-ci n’a pas créé de droit. Il y a donc lieu de
distinguer l’acte créateur de droit de l’acte non créateur de droit. L’acte régulier
créateur de droit ne peut être rapporté. Cette solution s’explique aisément par la
jonction de deux principes à savoir le principe de la légalité et le principe des
droits acquis si bien que le retrait lui même est constitutif d’illégalité. L’acte
régulier non créateur de droit peut a contrario être rapporté.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 73
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Quant à l’abrogation, elle est possible pour l’acte régulier mais une
distinction s’impose selon qu’il s’agit d’un règlement ou d’un acte individuel.
Les règlements peuvent être abrogés ou modifiés car il n’y a aucun droit acquis
au maintien d’un règlement. En ce qui regarde les actes individuels, ils peuvent
être abrogés ou modifiés mais les règles varient selon que l’acte a créé ou non
des droits. Les actes individuels créateurs de droit, ne peuvent être abrogés que
dans les conditions légales c’est-à-dire conformément aux lois et règlements en
vigueur. Les actes individuels non créateurs de droit peuvent être toujours
rapportés a fortiori abrogés.
B- L’acte irrégulier
Ici également, on va recourir à la distinction entre acte créateur et acte non
créateur de droit.
Concernant les actes non créateurs de droit, les règles varient selon qu’il
s’agit du retrait ou de l’abrogation. Le retrait est possible, en tout état de cause,
l’administration a non seulement le droit mais aussi l’obligation de retirer l’acte
illégal (C.E, 22 Février 1951, Fédération Nationale des cadres d’assurances).
L’abrogation est également possible mais l’administration n’est pas tenue
d’abroger l’acte illégal. Elle a simplement la faculté de l’abroger à tout moment
(C.E, 06 Novembre 1959, Coopérative laitière de Belfort).
Quant aux actes irréguliers créateurs de droit, les droits acquis sont certes
illégaux mais méritent tout de même une certaine protection. C’est la raison
pour laquelle le retrait tout comme l’abrogation est possible mais à condition
d’intervenir, aux termes de l’arrêt Dame Cachet, dans le délai du recours
contentieux qui est de deux mois pour compter de la notification ou de la
publication de l’acte.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 74
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE II: LES CONTRATS ADMINISTRATIFS
SECTION I : LES CRITERES DES CONTRATS ADMINISTRATIFS
Tous les contrats conclus par l’administration ne sont pas des contrats
administratifs. Ces contrats peuvent être aussi des contrats de droit privé. Alors
se pose le problème de l’identification des contrats conclus par l’administration.
Ce problème conduit à rechercher les critères du contrat administratif en
l’absence de qualification légale ; le législateur s’étant contenté d’énumérer un
certain nombre de contrats et de les qualifier d’administratifs. Ce sont
notamment, les contrats de marché public, les contrats de travaux publics, les
contrats de fourniture de l’Etat, les contrats portant occupation du domaine
public, les contrats d’emprunts publics.
C’est donc le Juge administratif qui, à l’occasion de certaines affaires, a
été amené à dégager les critères du contrat administratif qui sont au nombre de
deux : Ce sont d’une part le critère organique et d’autre part le critère matériel.
PARAGRAPHE I – LE CRITERE ORGANIQUE
Ce critère prend en considération la qualité de personne publique de l’une
des parties au contrat. Mais ce principe comporte des exceptions.
A- Le principe de la présence d’une personne publique au contrat
Pour qu’un contrat puisse revêtir le caractère administratif, il faut que
l’une au moins des parties soit une personne publique. C’est une condition
nécessaire. La personne publique peut avoir conclu le contrat elle même ou par
l’intermédiaire de son mandataire. Dans ce dernier cas, la personne privée, (le
mandataire) dans cette situation, se confond avec celle de la personne publique
et elle agit au nom et pour le compte de celle-ci.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 75
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
Deux conséquences peuvent être déduites de ce principe : les contrats
conclus par les personnes publiques tels que l’Etat, les collectivités locales, les
établissements publics nationaux et leurs mandataires peuvent être des contrats
administratifs ; les contrats conclus entre des particuliers ou des personnes
morales de droit privé ne peuvent pas être des contrats administratifs même si
l’une des personnes est chargée d’une mission de service public. Il en va ainsi
des contrats conclus entre concessionnaires de service public et entrepreneurs.
C’est également le cas des contrats conclus entre les entrepreneurs de travaux
publics et les sous – traitants.
Mais ce principe comporte des exceptions.
b – Les exceptions au principe
Les contrats passés par les sociétés d’économie mixte en matière routière
ou autoroutière avec d’autres personnes privées ont été qualifiés par le Juge de
contrats administratifs. Cette jurisprudence a été inaugurée par l’arrêt du tribunal
des conflits du 08 juillet 1963, Société entreprise Peyrot contre Société de
l’autoroute Esterel côte d’Azur. En l’espèce, le critère administratif a été retenu
à un marché de construction passé par des entrepreneurs avec une société
d’économie mixte, personne privée mais agissant pour le compte de l’Etat. En
réalité, si le Juge a qualifié ce contrat d’administratif malgré la qualité de
personne morale de droit privé d’une telle société, c’est en considération de
deux éléments : la société d’économie mixte agissait pour le compte de l’Etat
donc comme son mandataire. Par ailleurs, l’accent est mis par le Juge sur l’objet
administratif du contrat estimant que la construction des routes qui a le
caractère de travail public appartient par nature à l’Etat puisqu’elle est
traditionnellement exécutée en régie directe.
Même si la présence d’une personne morale de droit public est
nécessaire ; elle n’est pas suffisante car au critère organique doit s’ajouter le
critère matériel.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 76
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II – LE CRITERE MATERIEL
Ce critère renvoie au contenu du contrat : En se référant à ce contenu, le
Juge retient l’objet du contrat et certains éléments exorbitants du droit commun.
A – L’objet du contrat
Un contrat passé par une personne publique est reconnu administratif dès
lors qu’il a pour objet de confier à son cocontractant l’exécution même du
service public. Ce critère a été consacré par l’arrêt Epoux Bertin. En l’espèce, il
s’agissait d’un contrat verbal par lequel les époux Bertin s’étaient engagés pour
une somme forfaitaire à assurer la nourriture de ressortissants Russes hébergés
dans un centre de rapatriement. Cette tâche a été consacrée comme une mission
de service public et le Juge a qualifié d’administratif le contrat conclu à cet
effet, c’est - à-dire le contrat conclu entre l’administration et les époux Bertin.
Le Conseil d’Etat a été très net sur ce point : « Considérant que ledit contrat a
eu pour effet de confier à cet égard aux intéressés l’exécution même du service
public ; que cette caractéristique suffit à elle seule à imprimer au contrat dont il
s’agit le caractère administratif ».
Mais l’objet du contrat est un élément alternatif c’est –a-dire que le juge
peut ne pas se référer à l’objet. Il peut aussi prendre en compte les éléments
exorbitants du droit commun.
B – Les éléments exorbitants du droit commun
Ces éléments renvoient à la présence de clauses exorbitantes dans le
contrat ou à la soumission du contrat à un régime exorbitant.
Lorsqu’un contrat conclu par une personne publique n’a pas pour objet de
confier au cocontractant l’exécution même du service public, il peut être
reconnu administratif s’il renferme des clauses exorbitantes du droit commun.
Ce principe a été posé par l’arrêt Société des granites porphyroïdes des Vosges
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 77
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
du C.E en date du 31 Juillet 1912. Les clauses exorbitantes du droit commun
sont des stipulations ou des clauses qui ne se rencontrent pas en droit privé.
Elles y sont étrangères ou en tout cas inhabituelles. Elles ont, a décidé le C.E, «
pour effet de conférer aux parties des droits ou de mettre à leur charge des
obligations qui ne sont pas susceptibles d’être librement consenties par
quiconque dans le cadre des lois civiles ou commerciales ». Dans tous les cas,
les clauses exorbitantes s’analysent en des prérogatives de puissance publique
reconnues à l’administration vis-à-vis du cocontractant. Si cette clause est
voulue par le cocontractant, le régime exorbitant, au contraire, est extérieur à sa
volonté.
Un contrat conclu par une personne publique qui ne comporte ni un
rapport direct avec le service public ni une clause exorbitante du droit commun
est dit administratif, « s’il est soumis à un régime exorbitant du droit
commun ». Ce critère a été tiré de l’arrêt du T.C. du 09 juin 1973, société
d’exploitation électrique de la rivière du Sant à propos du contrat de fourniture
d’électricité entre EDF et les producteurs autonomes d’électricité. En l’espèce,
pour qualifier d’administratifs ces contrats de fourniture d’électricité à EDF par
les producteurs autonomes, le juge retient la double obligation faite aux parties
de conclure ces contrats et de faire trancher leurs désaccords par décision
ministérielle avant tout recours juridictionnel. Le régime exorbitant peut donc
s’entendre de celui consistant en un cadre juridique fixé par les lois et
règlements et comportant pour les parties au contrat des droits et obligations qui
sont étrangers aux relations entre particuliers.
SECTION 2 : LES PREROGATIVES DE L’ADMINISTRATION ET
LES GARANTIES DU COCONTRACTANT DANS
L’EXECUTION DU CONTRAT ADMINISTRATIF
En droit administratif, spécialement en matière de contrat administratif,
l’administration se trouve dans une situation de supériorité par rapport à son
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 78
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
cocontractant. Elle dispose de ce fait de prérogatives exorbitantes du droit
commun justifiées par l’intérêt général et plus particulièrement par la nécessité
du service public.
Mais en contrepartie, son cocontractant dispose de quelques droits fondés
sur le principe de l’équilibre financier du contrat.
PARAGRAPHE I – LES PREROGATIVES DE L’ADMINISTRATION
Ces prérogatives sont très importantes, on ne les rencontre pas en droit
privé c’est-à-dire dans les relations entre particuliers. Elles comportent quatre
pouvoirs bien distincts : le pouvoir de direction et de contrôle, le pouvoir de
modification unilatérale, le pouvoir de résiliation unilatérale et le pouvoir de
sanction.
A – Le pouvoir de direction et de contrôle et le pouvoir de
modification unilatérale
Nous examinerons de prime abord le pouvoir de direction et de contrôle
avant de nous pencher sur le pouvoir de modification unilatérale.
1 – Le pouvoir de direction et de contrôle
Ces pouvoirs sont souvent prescrits par des dispositions légales ou
conventionnelles. Mais ils peuvent exister sans texte. Le pouvoir de direction
consiste à donner des ordres de service au cocontractant qui doit les exécuter
même s’ils lui causent des préjudices quitte pour lui à formuler des observations.
Le pouvoir de contrôle signifie que l’administration dispose du pouvoir de
surveiller et de contrôler l’exécution du contrat. Par exemple, dans les marchés
de travaux publics, les ingénieurs de l’administration peuvent pénétrer sur les
chantiers pour vérifier les conditions d’exécution des travaux et l’entrepreneur
ne peut s’y opposer, sinon il commet une faute pouvant justifier la résiliation du
contrat.
Quid du pouvoir de modification unilatérale ?
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 79
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
2 – Le pouvoir de modification unilatérale
L’administration peut modifier unilatéralement les clauses du contrat en
imposant des obligations nouvelles à son cocontractant différentes de celles
initialement prévues dans le contrat. Ce pouvoir existe même sans texte et
trouve son fondement dans les exigences du service public. Il s’agit d’adapter
constamment le service aux besoins nouveaux de la population. C’est le sens de
l’arrêt compagnie des Tramways de Cherbourg du 09 Décembre 1932.
Mais ce pouvoir comporte des limites. L’administration ne peut, en effet,
toucher à la rémunération du cocontractant. La modification ne doit toucher que
l’exécution du service public sous réserve de dépasser un certain seuil, sinon le
cocontractant peut demander au Juge la résiliation du contrat. Aussi la
modification ne doit – elle pas porter sur la substance du contrat c’est-à-dire
concerner la nature des prestations prévues à l’origine. Exemple :
l’administration confie à une société de ramasser les ordures. Elle ne doit pas,
par la suite et pour le même contrat lui confier le transport des élèves.
Mais le pouvoir de modification unilatérale se distingue nettement du
pouvoir de résiliation unilatérale et du pouvoir de sanction qui revêtent un
caractère coercitif.
B- Le pouvoir de résiliation unilatérale et le pouvoir de sanction
Ici également, nous examinerons successivement les deux pouvoirs.
1 - Le pouvoir de résiliation unilatérale.
Ce pouvoir consiste à mettre fin de façon unilatérale au contrat. Il s’exerce
également pour les besoins du service public. Il est reconnu à l’administration en
dehors même de toute stipulation contractuelle. Il constitue, aux termes de
l’arrêt Distillerie de Magnac-Laval (C.E, 02 Mai 1958), une règle fondamentale
du droit des contrats administratifs tout comme le pouvoir de sanction.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 80
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
2 – Le pouvoir de sanction
En cas de manquement grave à ses obligations, le cocontractant peut se
voir infliger des sanctions par l’administration. Celles-ci sont tantôt prévues par
le contrat, tantôt appliquées en dehors du contrat. On en distingue trois
catégories :
- les sanctions pécuniaires (clauses pénales ou pénalités de retard)
- Les sanctions coercitives (mesures de contraintes auxquelles
l’administration recourt).
- Les sanctions résolutoires
En ce qui concerne les sanctions pécuniaires, l’administration peut
infliger le paiement de pénalité au cocontractant en cas de retard de celui - ci
dans l’exécution du contrat.
Quant aux sanctions coercitives, l’administration peut substituer un tiers
au cocontractant défaillant en vue de l’exécution du marché. Le contrat est
exécuté en principe aux frais et aux risques du cocontractant. Ces sanctions
existent sans que les contrats ne les aient prévues. Mais elles ne sont prononcées
que pour manquement grave du cocontractant à ses obligations et après une
mise en demeure infructueuse.
En ce qui regarde les sanctions résolutoires, elles mettent fin au contrat.
Ce sont des résiliations - sanction qui supposent un manquement grave du
cocontractant à ses obligations. Mais elles sont contrôlées par le Juge et ne
peuvent être infligées qu’après une mise en demeure infructueuse.
Si l’administration bénéficie d’importantes prérogatives, celles-ci ne sont
pas exercées sans garantie pour le cocontractant.
PARAGRAPHE II – LES GARANTIES DU COCONTRACTANT
Les droits reconnus au cocontractant comprennent essentiellement le droit
au paiement du prix et les droits à indemnité.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 81
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
A – Le droit au paiement du prix
Le cocontractant a droit au paiement du prix convenu. Ce qui est soumis à
deux principes à savoir l’irrévocabilité et le service fait.
Le prix est irrévocable c’est-à-dire qu’il ne peut être touché par la
modification unilatérale. Il est donc intangible.
En ce qui concerne le principe du service fait, le prix ne sera payé
qu’après exécution de sa prestation par le cocontractant. Cela implique pour
l’administration l’obligation de constater l’exécution effective du marché.
Par ailleurs, l’exécution du contrat peut ouvrir droit à indemnité pour le
cocontractant.
B- Le droit à indemnité
L’indemnité peut être due au cocontractant pour responsabilité de
l’administration. Si celle-ci commet une faute engageant sa responsabilité
contractuelle, le cocontractant peut demander au Juge de prononcer contre elle
les sanctions qui s’imposent et réclamer des dommages et intérêts couvrant
l’intégralité du préjudice subi.
Concernant particulièrement les marchés de travaux publics, le
cocontractant peut demander des indemnités pour sujétions imprévues. Il s’agit
de difficultés qui ont rendu plus onéreuses les conditions d’exécution du
marché. Pour donner lieu à indemnisation, la sujétion doit être extérieure aux
parties. Ce fait anormal et imprévisible entraîne des frais supplémentaires. Le
cocontractant a alors droit à des indemnités pour couvrir ces frais.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 82
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE III : LE PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION
Le personnel de l’Administration est composé d’agents titulaires et
d’agents non titulaires qui ont des droits et corrélativement des obligations.
SECTION I : LES AGENTS TITULAIRES : LES FONCTIONNAIRES
Le statut général de la fonction publique en son article premier définit le
fonctionnaire comme « une personne qui, nommée dans un emploi permanent, a
été titularisé dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de
l’Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de
l’Etat. »
De cette définition, il ressort quatre éléments ou conditions pour avoir la
qualité de fonctionnaire :
- il faut être nommé en vertu d’un acte unilatéral de l’Administration ;
- il faut être nommé dans un emploi permanent ;
- il faut être titularisé dans un grade de la hiérarchie administrative ;
- il faut participer à un service public administratif, industriel et commercial.
Toutes ces conditions sont cumulatives. Mais ce qu’il faut retenir, c’est
d’une part la titularisation et, d’autre part, la permanence.
SECTION II : LES AGENTS NON TITULAIRES
Sous son apparente unicité, la notion d’agent public non titulaire regroupe
une diversité d’agents qu’on peut faire rentrer dans deux sous-ensembles.
Exception faite des collaborateurs, ce sont les agents journaliers et les agents
temporaires.
PARAGRAPHE I : LES AGENTS JOURNALIERS
Ce sont des agents contractuels dont la caractéristique est en principe
d’être payés à la semaine. Mais en réalité, ils sont payés au mois. Il s’agit
d’agents subalternes recrutés pour une durée indéterminée. Exemple : les
garçons et les filles de salle.
Cette catégorie d’agents ne fait l’objet d’aucun texte particulier en dehors
d’une référence au code du travail. Recrutés pour exercer des fonctions
précaires, ils deviennent dans la réalité des agents permanents jusqu’à l’âge de la
retraite.
Les journaliers sont soumis aux règles du droit privé et particulièrement
au code du travail. Ils n’ont quasiment aucun des droits et avantages attachés à
la qualité de fonctionnaire. Mais ils restent soumis, en revanche, aux règles du
service public.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 83
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II : LES AGENTS TEMPORAIRES
Ce sont des agents contractuels recrutés en principe pour une durée
déterminée. Le décret 65- 196 du 12 juin portant régime juridique des agents
temporaires, fixe cette durée à deux ans renouvelable. Mais le statut général de
la fonction publique en son article 15, fixe à deux ans renouvelables une seule
fois.
Les agents temporaires sont désormais recrutés pour occuper des emplois
de haut niveau, c’est-à-dire, dans la catégorie A. Ils sont nommés dans un
emploi permanent mais cela ne leur confère pas vocation particulière à être
titularisés dans un corps parce qu’ils ont été recrutés par voie contractuelle. Ils
se trouvent dans une situation contractuelle vis-à-vis de leur employeur,
l’Administration.
Les agents temporaires se voient donc soumis au code du travail. Ainsi,
aux termes de l’article 7 du décret précité, « les agents temporaires, qu’ils
occupent un emploi permanent ou non, n’ont pas la qualité de fonctionnaires de
l’Etat. » Cependant, dans l’exercice de leur fonction, les agents temporaires sont
quasiment soumis aux mêmes règles que celles régissant les fonctionnaires. Ils
se trouvent soumis aux obligations de service public ainsi qu’aux règles de
déontologie en vigueur dans la fonction publique.
Au total, on peut dire que la fonction publique est d’abord un substrat
humain agissant pour le compte de la puissance publique. Ainsi ces agents, dans
l’accomplissement de leurs tâches, bénéficient et réciproquement sont astreints à
des obligations.
SECTION III : LES DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DE
L’ETAT
Les agents de l’Etat, à l’instar de toute personne au service d’une autre,
ont des droits et concomitamment des obligations.
PARAGRAPHE I : LES DROITS DES AGENTS DE L’ETAT
Ce sont d’une part les avantages matériels et d’autre part, les libertés qui
leur sont reconnues.
Les avantages matériels sont le droit à la rémunération, à un traitement
après service fait (art. 61 statut gén. F.P.) ; la pension de retraite (loi du 7
novembre 1962) ; les avantages professionnels et sociaux.
Les libertés publiques reconnues aux agents publics sont d’une part, les
libertés politiques (liberté de conscience et d’opinion, liberté de réunion et
d’association) et d’autre part, les droits collectifs (le droit syndical et le droit de
grève).
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 84
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE II : LES OBLIGATIONS A LA CHARGE DES AGENTS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Ce sont d’une part les obligations générales et d’autre part, les obligations
particulières.
Les obligations générales sont l’obligation de servir, c’est-à-dire
l’obligation de se consacrer personnellement à ses fonctions et celle de les
assurer de façon régulière et continue ; et le devoir d’obéissance hiérarchique
(art. 28 statut gén. F.P.).
Quant aux obligations particulières qui constituent une sorte de
déontologie ou code de bonne conduite, elles mettent à la charge des agents de
publics les devoirs de loyalisme et de neutralité (art. 23 statut gén. F.P.) ; le
devoir de discrétion professionnelle et le secret professionnel (art. 26 al. 1&3
statut gén. F.P.) ; l’obligation de moralité (art. 23 & 25 statut gén. F.P.) ; enfin,
l’article 25 interdit la corruption.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 85
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
TITRE V : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
L’administration doit, dans certaines conditions, réparer les dommages
que son activité peut causer. L’arrêt Blanco (Tribunal des conflits (TC), 08
Février 1873) pose le principe de l’autonomie de la responsabilité administrative
par rapport au droit privé.
Le principe de la responsabilité de la puissance publique s’est imposé
lentement à partir de la fin du XIXe siècle, « la responsabilité qui peut incomber
à l’Etat pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu’il
emploie dans le service public n’est ni générale, ni absolue… Elle a ses règles
spéciales.» (Arrêt Blanco).
Aujourd’hui, les régimes spéciaux de responsabilités d’origine législative
se sont multipliés ; de plus, nombreux sont les services publics soumis au droit
privé ; la responsabilité personnelle des fonctionnaires en relève également. Au
demeurant, même s’il existe plusieurs régimes de responsabilités, celle-ci ne
saurait être engagée que dans le respect des conditions communes.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 86
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE I : LES CONDITIONS COMMUNES DE LA
RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE
Un préjudice ne peut être indemnisé que s’il présente certaines
caractéristiques ; s’il existe une relation de causalité entre le fait dont doit
répondre l’administration et le préjudice et si ce dernier est imputable à telle ou
telle personne. Par ailleurs, l’évaluation de l’indemnité obéit également à des
règles spécifiques.
SECTION I : LE PREJUDICE
La responsabilité civile à la différence de la responsabilité pénale ou de la
responsabilité disciplinaire ayant une fonction de réparation et non de sanction,
le préjudice est la condition de la responsabilité et de la mesure de la réparation
à laquelle le responsable des faits dommageables pourra être condamné. Il en
résulte que le préjudice doit être certain et qu’il doit être évaluable en argent
dans la mesure où la réparation se résout en dommage-intérêt.
SECTION II : LE LIEN DE CAUSALITE
La responsabilité de l’administration ne sera engagée que s’il est
démontré une relation de cause à effet entre le fait dommageable et le préjudice.
Mais l’existence de certaines circonstances dites exonératoires tels que la
faute de la victime, le fait du tiers, la force majeure et dans une moindre mesure
le cas fortuit, pourra faire disparaître ou atténuer la responsabilité de
l’administration
SECTION III : L’IMPUTABILITE
La détermination des personnes publiques auxquelles le dommage peut
être imputable est rendue parfois délicate par la coopération qui peut s’établir
entre plusieurs personnes publiques pour l’organisation conjointe d’un service
public. La jurisprudence tend à admettre que la victime peut se faire indemniser
par l’une ou l’autre des personnes publiques pour la totalité de son dommage, la
personne publique condamnée à réparer le préjudice pouvant engager une action
récursoire contre l’autre personne publique pour obtenir le remboursement de
tout ou partie de l’indemnité . La responsabilité de L’Etat a ainsi été reconnue
du fait de la transmission du virus du SIDA à l’occasion d’une transfusion
sanguine sans que l’Etat, responsable de l’organisation générale du service
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 87
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
public, ne puisse s’exonérer de sa responsabilité du fait des fautes imputables au
centre de transfusion sanguine.
SECTION IV : L’EVALUATION DE LA REPARATION
Une distinction est faite selon que les dommages ont été causés aux biens
ou aux personnes.
L’évaluation des dommages causés aux biens doit être faite à la date où
leurs causes ayant pris fin et leur étendue connue, il pouvait être procédé aux
travaux destinés à les réparer, (CE, 21 Mars1947, compagnie générale des eaux).
Pour les dommages causés aux personnes, l’indemnité doit être fixée de
façon à couvrir l’intégralité du préjudice tel qu’il apparaît à la date du jugement
sauf si la victime a présenté sa demande de dommage – intérêt avec un retard
anormal.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 88
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
CHAPITRE II : LES REGIMES DE LA RESPONSABILITE
ADMINISTRATIVE
Il existe plusieurs types de responsabilité de l’administration mais les
principales sont :
- La responsabilité personnelle des fonctionnaires.
- La responsabilité pour faute.
- La responsabilité sans faute.
SECTION I : LA RESPONSABILITE PERSONNELLE DES
FONCTIONNAIRES
Le dommage causé par l’administration trouve fréquemment son origine
dans le fait d’une ou de plusieurs personnes physiques agents de
l’administration. Le système ancien de la garantie des fonctionnaires qui
obligeait à obtenir l’autorisation du Conseil d’Etat pour poursuivre un
fonctionnaire ayant été aboli par le décret du 19 septembre 1870, le Tribunal des
Conflits (T.C) a bâti un système qui conduit à distinguer la faute personnelle de
la faute de service (CE, 30 Juillet 1873, Pelletier).
PARAGRAPHE I : LA FAUTE PERSONNELLE ET LA FAUTE DE
SERVICE
La faute personnelle est détachable du service, des fonctions
administratives. Elle révèle « l’homme avec ses faiblesses, ses imprudences. »
(Laferrière) Elle peut être dépourvue de tout lien avec le service ; c’est-à-dire
commise sous l’emprise d’un mobile strictement personnel (vengeance, haine) ;
commise en dehors du service mais non dépourvue de tout lien avec lui c’est-à-
dire commise à l’occasion du service ou en dehors du service mais avec les
moyens procurés par celui-ci. Exemple : véhicule de service détourné par un
agent à des fins personnelles ; négligence commise avec une arme de service
régulièrement détenue et exposant les tiers à des risques particuliers de
dommages ; enfin commise dans l’exercice des fonctions mais détachable de
celles-ci intellectuellement (acte de pure malveillance, violence, excès de
comportement, faute d’une très grande gravité). La faute personnelle engage la
responsabilité de l’agent sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 89
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
La faute de service est une faute professionnelle. Elle révèle un
administrateur plus ou moins sujet à erreur. En pratique, les victimes demandent
le plus souvent réparation à l’administration plus solvable.
PARAGRAPHE II : LES THEORIES DU CUMUL ET LES ACTIONS
RECURSOIRES
Les théories du cumul permettent d’agir contre l’administration dans de
nombreux cas où a été commise une faute personnelle.
A- Le cumul de fautes
Le cumul de fautes suppose que deux fautes distinctes aient été
commises. Il y a cumul de fautes lorsque plusieurs fautes, les unes personnelles,
les autres de service peuvent être décelées à l’origine d’un seul et même
dommage. Elles sont utilisées lorsqu’une faute de service (souvent de
surveillance) a donné à l’agent l’occasion de commettre une faute personnelle.
(C.E, 03 février1911, Anguet). La victime peut à sa convenance demander
réparation intégrale à l’administration ou à l’agent responsable.
B- Le cumul de responsabilités
Le cumul de responsabilités se réalise lorsque le dommage est causé par
une seule faute présentant les caractères d’une faute personnelle mais qui n’a été
rendue possible que par la mise à la disposition de l’agent de moyens, de
pouvoir ou d’instruments par le service (C.E, 26 juillet 1918, Epoux
Lemonnier). La faute constitue à la fois une faute personnelle et une faute de
service. La victime peut, à son choix, demander réparation à l’administration ou
à l’agent ou agir successivement contre les deux afin d’obtenir une réparation
intégrale. Cette possibilité joue en cas de faute personnelle commise en dehors
du service mais avec les moyens que le service a mis à la disposition de l’agent
(C.E, 18 Novembre 1949, Demoiselle Mimeur).
C- Les actions récursoires
Elles permettent à la personne condamnée à la place de l’autre de se
retourner contre cette dernière afin d’obtenir qu’elle lui verse la part qu’elle lui
doit. L’administration peut réclamer à ses agents la réparation des dommages
qu’ils lui causent à raison des fautes qu’ils ont commises. L’action récursoire de
l’administration est admise lorsqu’elle a réparé un dommage causé en tout ou en
partie par une faute personnelle de l’agent (C.E, 28 juillet 1951, Laruelle). En
cas de cumul de fautes, le remboursement de l’agent est limité à la proportion
dans laquelle sa faute personnelle a contribué à la réalisation du dommage. En
cas de cumul de responsabilités, l’agent fautif peut se voir réclamer la totalité de
l’indemnité. Si la faute de service a été provoquée par l’agent auteur de la faute
personnelle, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de cette faute de service
afin de diminuer ses obligations. Si un dommage est la conséquence des fautes
personnelles de plusieurs agents, la personne publique ne peut réclamer l’entier
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 90
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
remboursement à l’un d’eux seulement car ils ne sont pas tenus solidairement.
Chacun d’eux n’est tenu que dans la mesure où sa faute a contribué au dommage
(C.E, 22 Mars 1957, Jeannier).
SECTION II : LA RESPONSABILITE POUR FAUTE
En principe, la responsabilité pour faute de l’administration n’est engagée
que si le dommage trouve son origine dans un comportement fautif du service
public. Elle peut être une défaillance dans l’organisation ou le fonctionnement
du service. Elle peut consister dans un acte matériel ou juridique, résulter d’une
action ou d’un retard, d’une absence ou d’une négligence. Elle peut être
anonyme ou collective (faute du service) ou imputable à un individu précis
(faute de service). La faute est parfois présumée (théorie du défaut d’entretien
normal en faveur des usagers des ouvrages publics ; dommages graves
consécutifs à des soins courants dans les hôpitaux publics).
En principe, une faute simple suffit pour engager la responsabilité de la
personne publique : services de secours : (C.E, 20 juin 1997, Theux : aide
médicale ; 13 mars 1998, Améon : Secours en mer ; 29 Avril 1998, commune de
Hannapes : lutte contre l’incendie ) ; activités de contrôle : ( C.E, 09 Avril
1993, D. G. B. : réglementation et contrôle de la transfusion sanguine ; 26 mai
1995, N’ GUYEN : vice du produit sanguin transfusé ; 09 Juin 1995, Lesprit :
Licenciement des salariés protégés) ; activités hospitalières : ( C.E, 10 Avril
1992, M. et Mme V : Activité médicale ; 16 Novembre 1998 Mlle Reynier :
retard dans le diagnostic ; 14 Février 1997, CHR de Nice Contre époux Quarez :
Défaut d’information).
Mais dans des situations ou domaines délicats, une faute lourde est
exigée : en matière de service pénitentiaire, que le dommage soit subi par un
tiers (C.E, 03 Novembre 1998, Rakotoarinovy) ou par un détenu (C.E, 26 Mai
1978,Watcher) ; en matière de police administrative s’agissant d’opérations
matérielles d’exécution (C.E, 13 Mars 1925, Clef ).
SECTION III : LA RESPONSABILITE SANS FAUTE
La responsabilité administrative peut dans certains cas être engagée de
plein droit sans faute dès qu’un lien de causalité apparaît entre une activité
administrative et un dommage. La victime doit seulement prouver ce lien de
causalité. Cette responsabilité est objective, ce qui explique son développement
depuis 1895. Il existe deux types de responsabilités sans faute : la responsabilité
pour risque et la responsabilité pour rupture de l’égalité devant les charges
publiques.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 91
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
PARAGRAPHE I : LA RESPONSABILITE POUR RISQUE
Le dommage apparaît comme le résultat de la réalisation d’un risque. Le
Juge estime équitable que le risque du dommage entraîne l’institution d’un tel
régime de responsabilité.
Imaginé pour des choses dangereuses, ce régime s’est étendu à des
activités ou situations dangereuses. Les principaux cas d’applications sont les
suivants :
A- Les accidents subis par les collaborateurs
occasionnels de l’administration
Les collaborateurs occasionnels (ou bénévoles), victimes d’un dommage
en apportant leur concours désintéressé à l’administration, sont
automatiquement indemnisés, (C.E, 22 Novembre 1946, Commune de St Priest–
la - plaine) qu’ils aient été réquisitionnés ou aient agi d’eux – mêmes ; mais la
participation doit être effective, justifiée et être apportée à un véritable service
public.
B- Les choses et activités dangereuses
Le voisinage de choses ou d’activités dangereuses justifie l’application de
ce régime. Les choses dangereuses sont les explosifs (C.E, 28 Mars 1919,
Regnault Desroziers), les armes et engins dangereux (C.E, 24 Juin 1949,
Daramy), les produits sanguins viciés (arrêt N’guyen précité).
Les méthodes dangereuses consistent dans des méthodes libérales de
rééducation créant un risque pour les tiers (C.E, 03 Février 1956, Thouzellier :
institution d’éducation surveillée ; 13 Juillet 1967, département de la Moselle :
sortie d’essai ou placement familial des malades mentaux ; 02 Décembre 1981,
Theys : Mesure libérale accordée aux détenus) ; certaines mesures
thérapeutiques dont les suites ne sont pas connues. Trois sortes de risques
peuvent engager la responsabilité sans faute des hôpitaux publics : l’acte
médical – l’utilisation d’un produit de santé – l’affectation du patient.
C- La responsabilité de l’Etat du fait des rassemblements et
attroupements
L’Etat est civilement responsable des dommages et dégâts résultant des
crimes et délits commis à force ouverte ou par violence par des attroupements
armés ou non (C.E, 29 Décembre 2000, Assemblée Générale de France : groupe
de jeunes casseurs). L’Etat peut exercer une action récursoire contre la
commune dont la responsabilité serait engagée.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 92
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
D - Les tiers victimes d’accident de travaux publics
La responsabilité du maître d’ouvrage, de l’entrepreneur ou du
concessionnaire est engagée de plein droit à leur profit même en l’absence de
faute (C.E, 28 Mai 1971, Département du Var).
PARAGRAPHE II : LA RESPONSABILITE POUR RUPTURE DE
L’EGALITE DEVANT LES CHARGES
PUBLIQUES
Le principe de l’égalité devant les charges publiques donne son
fondement à la responsabilité sans faute des personnes publiques. Cette
responsabilité régit des cas où les dommages ne revêtent pas un caractère
accidentel mais sont la conséquence prévisible de situations ou de mesures qui
portent préjudice à certains au nom de l’intérêt général. Le dommage pour être
réparé doit être spécial et anormal.
A – La responsabilité du fait de décisions administratives
régulières
L’arrêt Couitéas (C.E, 30 Novembre 1923) ouvre droit à réparation aux
bénéficiaires de jugements prescrivant l’expulsion d’occupants sans titre de
logements. Lorsque l’exécution de la décision de justice porterait un trouble
grave à l’ordre public, l’administration est en droit de refuser à son bénéficiaire
le concours de la force publique qu’il lui demande. Le droit à réparation n’est
ouvert qu’à l’expiration du délai raisonnable dont dispose l’autorité pour
décider. Cette jurisprudence s’applique également lorsque la rupture d’égalité
est la conséquence d’un acte individuel légal (C.E, 31 Mars 1995, Lavaud :
fermeture de dix tours d’habitation faisant perdre de la clientèle à un
pharmacien) ou de l’abstention régulière de prendre un acte justifiée par l’intérêt
général ou les exigences de l’ordre public.
B - La responsabilité du fait des lois et conventions internationales
Elle résulte de la volonté du législateur ou des conventions. Ces textes
peuvent l’organiser ou denier tout droit à indemnité ; sinon l’indemnisation est
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 93
COURS DE DROIT ADMINISTRATIF E.N.A
possible mais rare car le préjudice est rarement spécial. Toute responsabilité est
exclue lorsque le régime mis en place est discriminatoire ou vise à satisfaire des
intérêts généraux et supérieurs.
L’arrêt société des produits laitiers la FLEURETTE pose le principe de la
responsabilité du fait des lois et l’arrêt compagnie générale d’énergie radio
électrique celui de la responsabilité du fait des conventions internationales. Pour
être indemnisable, le préjudice doit être certain, spécial et grave.
C - La responsabilité pour dommages permanents de travaux publics
Ouvrent droit à réparation les dommages non accidentels qui sont les
conséquences inévitables de l’exécution des travaux publics, de l’existence ou
du fonctionnement d’un ouvrage public quelque soit la qualité de la victime à
condition que le préjudice soit spécial et anormal (C.E, 24 Juillet 1931,
commune de vic – Fezensac). Tel est le cas des inconvénients ou servitudes de
voisinage.
M. TIA SERGE H 08-14-20-12 E-MAIL : tiasergeh@yahoo.fr 94
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide de Prepa Infj - 18-11-2019 PDFDocument39 pagesGuide de Prepa Infj - 18-11-2019 PDFTOURE FLORA100% (1)
- Support de Cours Sujet D'ordre General 2022 Bonne VersionDocument45 pagesSupport de Cours Sujet D'ordre General 2022 Bonne Versionfranck sery100% (2)
- Sujet D'ordre GeneralDocument49 pagesSujet D'ordre GeneralBi tra armand juldas TIZIE89% (9)
- ENA Sujet CorigésDocument221 pagesENA Sujet CorigésKOUAKOU100% (2)
- Cours Organisation Judiciaire 2022Document128 pagesCours Organisation Judiciaire 2022stephanejeanpaulkonan100% (2)
- Esquisses de Corrigés D'exercice de Droit Des Obligations Et Responsabilité CivileDocument32 pagesEsquisses de Corrigés D'exercice de Droit Des Obligations Et Responsabilité CivileMoussa Ndiaye100% (1)
- Note de SyntheseDocument26 pagesNote de SyntheseKadi SomaPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Administratif Ena 23Document71 pagesCours de Droit Administratif Ena 23Christophe Nemlin100% (1)
- Cours de Droit Administratif Abdoulaye Dieye PDFDocument68 pagesCours de Droit Administratif Abdoulaye Dieye PDFEl Hadji Djibril Samba100% (5)
- Administratif Sujet Corriger-1 PDFDocument34 pagesAdministratif Sujet Corriger-1 PDFEl Hadji Djibril Samba100% (1)
- La Dissertation de Culte Gene DouanesDocument54 pagesLa Dissertation de Culte Gene DouanesFrEeshii BoOy83% (6)
- Sujets ENA CONCOURS-1Document13 pagesSujets ENA CONCOURS-1Moulaye Youssouf Keïta100% (2)
- Ena Droit AdministratifDocument159 pagesEna Droit AdministratifKOUAKOU100% (2)
- Sujet Corriger Finances PubliquesDocument11 pagesSujet Corriger Finances PubliquesCHRISTIAN LAURIC100% (9)
- Droit Administratif PDFDocument71 pagesDroit Administratif PDFKadi Soma100% (1)
- Annale de Droi Administratif Ivoirien NouveauDocument208 pagesAnnale de Droi Administratif Ivoirien Nouveautousco roi100% (2)
- Culture GénéraleDocument66 pagesCulture GénéraleIbrahima Lougue100% (3)
- Cours 5 11 C1 1626660617Document87 pagesCours 5 11 C1 1626660617LOUA YVESPas encore d'évaluation
- Cours Opaj 2022Document82 pagesCours Opaj 2022Agbatou Jean Baptiste N'chiepo100% (2)
- Cours de Droit AdministratifDocument67 pagesCours de Droit AdministratifKoffi Maxime Diby100% (1)
- Droit Administratif Pa KANTE PDFDocument163 pagesDroit Administratif Pa KANTE PDFAma Dia100% (2)
- Support Droit ConstitutionnelDocument45 pagesSupport Droit ConstitutionnelMohamed KonePas encore d'évaluation
- Azaiza Edkhil 1Document10 pagesAzaiza Edkhil 1Aziza EdkhilPas encore d'évaluation
- Compil de Sujets de Dissertations-Culture Générale - Préparation Du Concours de l'ENADocument28 pagesCompil de Sujets de Dissertations-Culture Générale - Préparation Du Concours de l'ENAstrapol100% (11)
- Pecos Ena 2017Document82 pagesPecos Ena 2017Guillaume KOUASSIPas encore d'évaluation
- ENA Anciens Sujets Du ConcoursDocument16 pagesENA Anciens Sujets Du Concoursmadoudiarra565Pas encore d'évaluation
- 2020 Méthodologie Sog Dernière VersionDocument33 pages2020 Méthodologie Sog Dernière Versioncharles100% (3)
- DROIT CONSTITUTIONNEL-préparation ENADocument58 pagesDROIT CONSTITUTIONNEL-préparation ENAAlain BoaPas encore d'évaluation
- Cours de Contentieux AdministratifDocument15 pagesCours de Contentieux AdministratifBALLA KEITAPas encore d'évaluation
- Dissertation CorrigéeDocument70 pagesDissertation CorrigéeAnta SAKHO100% (3)
- Support Pecos 2022 OkDocument29 pagesSupport Pecos 2022 OkA.Gerard Adopo100% (2)
- 3 Exos Corrigés de Droit Const - CDocument16 pages3 Exos Corrigés de Droit Const - Cfranck amonPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Constitutionnel Ena 2023Document52 pagesCours de Droit Constitutionnel Ena 2023romsixPas encore d'évaluation
- Cas PratiqueDocument3 pagesCas PratiqueKaramPas encore d'évaluation
- Les Cour de DroitDocument56 pagesLes Cour de DroitSAMUEL ORO100% (1)
- Cours Finances Publiques-1Document139 pagesCours Finances Publiques-1GÉNÉRAL TECHPas encore d'évaluation
- Problemes Economiques Et SociauxDocument28 pagesProblemes Economiques Et Sociauxjean-marie FossouPas encore d'évaluation
- GUIDE DE PREPA INFJ - Version AUDEDocument52 pagesGUIDE DE PREPA INFJ - Version AUDEMonica EssohPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Administratif RDSDocument161 pagesCours de Droit Administratif RDSLuli jones100% (1)
- Extrait Annale Droit Constitutionnel IvoirienDocument11 pagesExtrait Annale Droit Constitutionnel IvoirienLuli jonesPas encore d'évaluation
- Sog BatDocument64 pagesSog BatAnge Emmanuel KROU100% (1)
- A Organisation Judiciaire-3Document70 pagesA Organisation Judiciaire-3Kone Zoumana100% (1)
- TD AdministratifDocument4 pagesTD AdministratifAma Dia100% (1)
- Esquisses de Corrigés D'exercice de Droit CivilDocument38 pagesEsquisses de Corrigés D'exercice de Droit CivilMoussa Ndiaye100% (1)
- Quelques Sujets de RéflexionDocument14 pagesQuelques Sujets de RéflexionLauren FlisherPas encore d'évaluation
- Esquisses de Corrigés D'exercice de Droit Administratif X (Enregistré Automatiquement)Document92 pagesEsquisses de Corrigés D'exercice de Droit Administratif X (Enregistré Automatiquement)Moussa Ndiaye50% (2)
- Corrigé Droit Administratif 2-1Document19 pagesCorrigé Droit Administratif 2-1Olive PrudencePas encore d'évaluation
- Exercices Corrigés Resumé Et SOGDocument14 pagesExercices Corrigés Resumé Et SOGalcide koffi100% (2)
- Esquisses de Corrigés D'exercice de Droit ConstDocument62 pagesEsquisses de Corrigés D'exercice de Droit ConstMoussa Ndiaye100% (2)
- Sujets Corrigés Doit Adm Et Droit ConstDocument12 pagesSujets Corrigés Doit Adm Et Droit Constalcide koffiPas encore d'évaluation
- 1-DOCUMENT SOG PROFESSIONNELS INFJ 2020-ConvertiDocument37 pages1-DOCUMENT SOG PROFESSIONNELS INFJ 2020-Convertibationo100% (1)
- Cartographie Des Risques Formation VdefDocument21 pagesCartographie Des Risques Formation VdefMalika Jaafari100% (1)
- Evaluation Du Risque D'anomalie Significative - Seuil de Signification - Plan D'auditDocument39 pagesEvaluation Du Risque D'anomalie Significative - Seuil de Signification - Plan D'auditMohamed Lamine Boutouatou100% (2)
- Cours Droit de La Fonction Publique Ena 2019Document72 pagesCours Droit de La Fonction Publique Ena 2019Abou SyPas encore d'évaluation
- Acte Administratif Unilatéral, Droit AdministratifDocument21 pagesActe Administratif Unilatéral, Droit AdministratifSophie100% (1)
- Cadre Hormonisé Des Finances Publiques de l'UEMOA PDFDocument121 pagesCadre Hormonisé Des Finances Publiques de l'UEMOA PDFBoubacar TemePas encore d'évaluation
- La Mamma MortaDocument7 pagesLa Mamma MortaSILVIA-SORINA MUNTEANUPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Adm ENA 22Document62 pagesCours de Droit Adm ENA 22Téhoua Kader AnéPas encore d'évaluation
- Les PECOS Aux Concours AdministratifsDocument7 pagesLes PECOS Aux Concours AdministratifsSophie Sohoun100% (2)
- Prepa Ena 11 11 2018Document64 pagesPrepa Ena 11 11 2018Mohamed Seyba Kalapo100% (1)
- Exercices Séance 4 Finances Publiques CorrigéDocument3 pagesExercices Séance 4 Finances Publiques CorrigéKhadija Lazrak100% (2)
- Organisation Administrative Du MaliDocument21 pagesOrganisation Administrative Du MaliBakaye Dembele100% (1)
- EXPERT FRANCOIS Mémoire 2020Document64 pagesEXPERT FRANCOIS Mémoire 2020Wissal AknakayePas encore d'évaluation
- Un Billet Sur Le Rassemblement Malien Pour Le Travail (RAMAT-parti Rahma) - EchosMediasDocument1 pageUn Billet Sur Le Rassemblement Malien Pour Le Travail (RAMAT-parti Rahma) - EchosMediaspt7nm8jqc7Pas encore d'évaluation
- Wassila Bourguiba La Main Invisible 9789938011487Document369 pagesWassila Bourguiba La Main Invisible 9789938011487testimony100% (3)
- PDFServletAttestationDeDroits Dopdf-2Document2 pagesPDFServletAttestationDeDroits Dopdf-2zktrrc2xb8Pas encore d'évaluation
- Histoire - Geo - BEPC - Blanc Du Balai Citoyen 2Document2 pagesHistoire - Geo - BEPC - Blanc Du Balai Citoyen 2Valerie ReworaPas encore d'évaluation
- Procédure de Fusion Ou ScissionDocument5 pagesProcédure de Fusion Ou ScissionLéa GiraultPas encore d'évaluation
- 9 Outils de Prise en Compte Genre AksDocument25 pages9 Outils de Prise en Compte Genre AksADANHOUMEPas encore d'évaluation
- Nouvelle Organisation Du MINTPDocument16 pagesNouvelle Organisation Du MINTPNosaibatou Fufe MusaPas encore d'évaluation
- Mise Au Point - Président de l'AMITH VFDocument1 pageMise Au Point - Président de l'AMITH VFAli AmarPas encore d'évaluation
- Idee 191 0004Document3 pagesIdee 191 0004matix08430Pas encore d'évaluation
- Congo - IGFDocument2 pagesCongo - IGFVanh MabikaPas encore d'évaluation
- JobAid 903 02 Security Screening Guide Online-FDocument12 pagesJobAid 903 02 Security Screening Guide Online-FThais RorizPas encore d'évaluation
- Clausede Stabilisation CM2018 Prof KABANGEDocument22 pagesClausede Stabilisation CM2018 Prof KABANGEMichel Tolima kitokoPas encore d'évaluation
- Fayz Marz.1Document12 pagesFayz Marz.1Hanane TansaouiPas encore d'évaluation
- Avis Vol III Docs MauritMarocDocument519 pagesAvis Vol III Docs MauritMarocJaouad El HajjajiPas encore d'évaluation
- Modele - Accord Type GeppDocument3 pagesModele - Accord Type GeppBademba SowPas encore d'évaluation
- CPS - Ao - 35 - 2023 - Mobilier Tranche 03 - FVDocument34 pagesCPS - Ao - 35 - 2023 - Mobilier Tranche 03 - FVzouhair asqiriba100% (1)
- IntroductionDocument3 pagesIntroductionBassma AzarhounPas encore d'évaluation
- PreambuleDocument9 pagesPreambuleesperawilPas encore d'évaluation
- Histoire Du Journal Le Monde 1944 - 2004-1Document741 pagesHistoire Du Journal Le Monde 1944 - 2004-1Mohand IssmailPas encore d'évaluation
- MicroéconomieDocument62 pagesMicroéconomieMohamed AzPas encore d'évaluation
- Aconf188d6 - FR, Saisie ConservatoireDocument16 pagesAconf188d6 - FR, Saisie ConservatoireBenromdhane ZeinebPas encore d'évaluation
- Corrigé Des Examens - Finance D - EntrepriseDocument36 pagesCorrigé Des Examens - Finance D - Entrepriseikram ezzariPas encore d'évaluation
- Les Médias Manipulent Ou Sont ManipulésDocument1 pageLes Médias Manipulent Ou Sont ManipulésPatrícia MoreiraPas encore d'évaluation