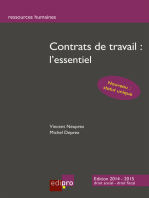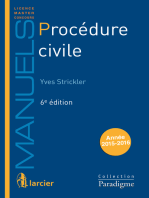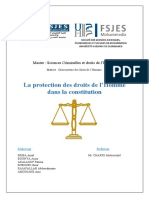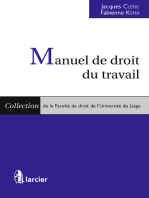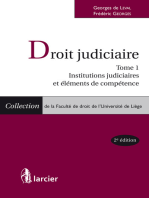Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fiscalité 1 - Introduction-Au-Droit-Marocain
Fiscalité 1 - Introduction-Au-Droit-Marocain
Transféré par
mr RightTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiscalité 1 - Introduction-Au-Droit-Marocain
Fiscalité 1 - Introduction-Au-Droit-Marocain
Transféré par
mr RightDroits d'auteur :
Formats disponibles
I - Définition de Droit :
Le mot droit peut prendre deux sens :
- Sens large « Droit objectif » : est un ensemble de règles juridiques qui
régissent les rapports entre les hommes dans un état bien déterminé. Le non
respect de ces règles est sanctionné ; c’est ainsi que l’on parle de droit civil,
droit commercial, droit de travail …
- Sens étroit « Droit subjectif » : désigne le pouvoir ou la faculté » reconnue
à une personne de faire ou désigné quelque chose en applications des règles de
droit c’est ainsi que l’on parle de droit de l’homme ; droit d’expression.
II - Les règles de droit :
Le droit est un ensemble de règles générales et permanentes et que leur fraction est
sanctionnée.
- Générale : car il s’applique d’une façon impersonnelle.
- Permanente : car il s’applique à chaque fois qu’une situation le demande.
III - Les sources de droit marocain
Etat souverain moderne et jaloux de sa spécificité, le Maroc a eu de soucis de se
constituer un droit moderne mais qui se réfère tout de même à ses racines et ses
traditions religieuses . Les sources du droit marocain peuvent être classés sous 2
types :
A – Sources historiques :
Le Quoran constitue la source classique principale, on trouve en suite les paroles du
prophète (Sounna), ce droit s’exerce par exemple dans l’héritage.
1° - Le droit religieux : Fidèle à sa tradition religieuse, le Maroc a fait de l’Islam sa
religion d’état. D’ailleurs le Roi et en même temps le souverain du Maroc est Amir
Almouminine . En application de ce principe constitutionnel le Quoran , la Sounna et la
Chariaâ constituent des sources non négligeables du droit marocain.
2° - La coutume : C’est l’ensemble des règles qui ont obtenu le consentement ( ou
l’accord) de certain groupes sociaux , ex : Respect du voisin .
3° - La jurisprudence : Elle est constituée par l’ensembles des décisions rendues
par les cours et les tribunaux sur une matière donnée en interprétant des textes.
4° - Le droit séculier : C’est le droit inspiré de la législation étrangère
essentiellement du droit français suite au colonialisme.
B – Sources modernes :
En plus de sources historiques, il était nécessaire pour un pays du 20ème siècle de
poser des règles juridiques modernes pour être capable d’évoluer au sein de la
communauté internationale. Ces règles dérivent essentiellement des conventions
internationales conclues entre le Maroc et les autres Etats (exemple : conventions de
Genève sur chèque). En plus des conventions, on trouve la constitution puis les textes
qui lui sont subordonnées : Les lois et règlements :
1 – Les lois :
La loi est un texte voté par la chambre des représentants ( le parlement) qui
constitue en effet la principale institution législative qui représente la volonté et le choix
de la société par le biais de ses représentants.
Remarque : La loi ne peut pas avoir des faits rétroactifs.
2 – Les règlements :
Le règlement est tout texte provenant du pouvoir gouvernemental ou administratif
(gouvernement ou ministre) qui n’est autre que pouvoir exécutif. Les règlements
peuvent être sous forme de Dahirs, de Décrets ou d’Arrêtés.
- Dahir : C’est une règle juridique émanant du Roi.
- Décret : C’est une règle juridique émanant du premier ministre.
- Arrêté : C’est une règle juridique élaborée et signée par une autorité
administrative subordonnée au premier ministre.
IV - L’organisation judiciaire au Maroc :
1 – Les juridictions communales et d’arrondissement :
Ces juridictions sont compétentes dans les affaires personnelles ou les affaires dont
l’objet ne dépasse pas 1000dh. Elles sont tenues par un juge unique, assisté d’un
greffier, qui essaye d’abord de concilier les parties avant de rendre son jugement.
2 – Les tribunaux de première instance :
Le tribunal de première instance est compétent dans les affaires de natures
différentes : civiles, statut personnel et successoral, commerciales, sociales, pénales,
… Les audiences sont tenues par 3 juges (un président et 2 conseillers), assistés d’un
procureur du roi et un greffier/
3 – Les cours d’appel :
Si une partie n’est pas satisfaite du jugement du tribunal de première instance, elle
peut recourir à la cour d’appel. Elle est compétente pour connaître et revoir les
décisions rendues par le juge du tribunal de première instance : soit en approuvant le
jugement du TPI, soit en annulant ce jugement. Les audiences sont tenues par 3
magistrats (un président et 2 conseillers), assistés d’un procureur du roi et un greffier.
Remarque : la partie qui se sent lésée par le jugement peut s’adresser la cour
suprême.
4 – La cour suprême :
Son rôle est de voir si la loi a été appliquée par le juge de la cour d’appel : si la loi
est bien appliquée, elle retient le jugement sinon le juge rend le jugement qui casse et
annule la décision de la cour d’appel et renvoi l’affaire à une autre cours d’appel. Les
jugements sont tenus par 5 magistrats.
Vous aimerez peut-être aussi
- Organisation Judiciaire MarocaineDocument46 pagesOrganisation Judiciaire Marocaineyoussef126100% (7)
- Résumé Action Administrative S3Document15 pagesRésumé Action Administrative S3sim100% (1)
- Introduction À L'étude de Droit - Cours N°1Document18 pagesIntroduction À L'étude de Droit - Cours N°1OverDoc100% (22)
- Cours Fiscalité S4 DroitDocument9 pagesCours Fiscalité S4 DroitLamiae Achel100% (1)
- Droit Commercial DutDocument111 pagesDroit Commercial Dutmustapha kaya100% (8)
- Contrats de travail : l'essentiel: Comprendre les enjeux du droit social et du travail belge dans son contratD'EverandContrats de travail : l'essentiel: Comprendre les enjeux du droit social et du travail belge dans son contratPas encore d'évaluation
- Ccours D - Introduction À L - Etude de Droit NaciriDocument43 pagesCcours D - Introduction À L - Etude de Droit Nacirimarlos costa100% (1)
- Cours Organisation Judiciaire 2014 PDFDocument28 pagesCours Organisation Judiciaire 2014 PDFMohamed Khalil100% (23)
- Procedurer PenaleDocument35 pagesProcedurer PenaleYouness Nounous50% (2)
- Droit CommercialDocument24 pagesDroit CommercialIs SamPas encore d'évaluation
- L'action Administrative - CopieDocument60 pagesL'action Administrative - CopieArije JaafariPas encore d'évaluation
- Droit FiscalDocument6 pagesDroit FiscalLi zey100% (1)
- 1 La Notion de DroitDocument11 pages1 La Notion de DroitIsmael BalogunPas encore d'évaluation
- Cours de L - Introduction À L - Études Du Droit PDFDocument34 pagesCours de L - Introduction À L - Études Du Droit PDFFsjes Guelmim100% (8)
- Introduction Aux Sciences Juridiques AgadirDocument18 pagesIntroduction Aux Sciences Juridiques AgadirAnass Yio83% (6)
- À la découverte de la justice pénale: Paroles de juristeD'EverandÀ la découverte de la justice pénale: Paroles de juristePas encore d'évaluation
- Regimes Constitutionnels ComparesDocument56 pagesRegimes Constitutionnels ComparesReĐønə Benz M-Psy100% (1)
- Introduction Au Droit S1Document83 pagesIntroduction Au Droit S1Birgit Vynckier83% (6)
- CHAPITRE 2 Droit (Schéma)Document2 pagesCHAPITRE 2 Droit (Schéma)Si Mohamed100% (2)
- La Police Judiciaire Au MarocDocument6 pagesLa Police Judiciaire Au MarocChaimae RibaniPas encore d'évaluation
- Cours Organisation Administrative S2 Fac SaléDocument53 pagesCours Organisation Administrative S2 Fac Saléwikilik86% (42)
- Droits S3 PDFDocument34 pagesDroits S3 PDFChaymae ChamittaPas encore d'évaluation
- COURS PROF 1 - Organisation AdministrativeDocument23 pagesCOURS PROF 1 - Organisation AdministrativeLina Ad100% (1)
- I - Principes Généraux Du Système Judiciaire Marocain-1Document50 pagesI - Principes Généraux Du Système Judiciaire Marocain-1Larbi Fsjes Kenitra100% (3)
- Droit Du Travail Marocain Partie1 S3Document47 pagesDroit Du Travail Marocain Partie1 S3mohamed chairi hachmi100% (2)
- Master 1Document23 pagesMaster 1rokaya el100% (1)
- Cours Ied Power PointDocument114 pagesCours Ied Power Pointtechn2 lifePas encore d'évaluation
- Organisation Judiciaire Au MarocDocument28 pagesOrganisation Judiciaire Au MarocBenabdouallah Younes100% (1)
- Les Questions Des Anciens Examens Droits de L'homme s4Document6 pagesLes Questions Des Anciens Examens Droits de L'homme s4oumaymabstnPas encore d'évaluation
- Droit Budgetaire s3Document6 pagesDroit Budgetaire s3KhalilTawïlPas encore d'évaluation
- Exposé Sur Les Juriductions de DT CommunDocument40 pagesExposé Sur Les Juriductions de DT CommunEl Mehdi Chentouf100% (1)
- Organisation Judiciaire Au Maroc S2Document5 pagesOrganisation Judiciaire Au Maroc S2Mohamed Amine Benayad100% (4)
- Organisation Administrative, 1ère PartieDocument29 pagesOrganisation Administrative, 1ère Partiejihane amraniPas encore d'évaluation
- Introduction À L'étude de Droit - Semestre1 - GA - SERGHINI Anas - PDFDocument82 pagesIntroduction À L'étude de Droit - Semestre1 - GA - SERGHINI Anas - PDFsaidPas encore d'évaluation
- L'Organisation Administrative Au MarocDocument31 pagesL'Organisation Administrative Au MarocLoubna Louly MakhoukhiPas encore d'évaluation
- Résumé Du Procédure Pénale by LebbarDocument34 pagesRésumé Du Procédure Pénale by Lebbarsara saraPas encore d'évaluation
- PoliceadministrativeDocument19 pagesPoliceadministrativeMohammed Benali100% (3)
- Introduction Au DroitDocument4 pagesIntroduction Au DroityoussefmugenPas encore d'évaluation
- Résumé Introduction Générale À L27étude de DroitDocument7 pagesRésumé Introduction Générale À L27étude de DroitBentebbaa Amine100% (2)
- COURS INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT 1ère AnéeDocument147 pagesCOURS INTRODUCTION A L'ETUDE DE DROIT 1ère AnéeSoureïa Haman yayaPas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit Marocain 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion Et ComptabilitéDocument2 pagesIntroduction Au Droit Marocain 2 Bac Science Economie Et Techniques de Gestion Et ComptabilitéNafie Elhaik100% (1)
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Introduction A L Etude de DroitDocument14 pagesIntroduction A L Etude de DroitHoussam AouraghPas encore d'évaluation
- Cour Droit de L'homme Au MarocDocument23 pagesCour Droit de L'homme Au Marocmike aliPas encore d'évaluation
- Les Sources Du Droit MarocainDocument4 pagesLes Sources Du Droit Marocainsaad essalmani100% (2)
- Les Sources Directes de La Regle de DroitDocument3 pagesLes Sources Directes de La Regle de DroitSimohamed GourichPas encore d'évaluation
- Cours DIP M.mehrez S2Document31 pagesCours DIP M.mehrez S2Hachad Hamza100% (1)
- Langue Et Terminologie Juridique 1Document3 pagesLangue Et Terminologie Juridique 1Ayoub Mhamda71% (7)
- Harcelement Sexuel Au MarocDocument1 pageHarcelement Sexuel Au MarocYoussef AlamiPas encore d'évaluation
- L Organisation Judiciaire Du Royaume Du MarocDocument26 pagesL Organisation Judiciaire Du Royaume Du MarocEva DamePas encore d'évaluation
- Introduction À L - Étude Du Droit JALAL ASSAIDDocument22 pagesIntroduction À L - Étude Du Droit JALAL ASSAIDBilal BilaloPas encore d'évaluation
- Loi N 42-10 Portant Organisation Des Juridictions de Proximité Et Fixant Leurs Competences.Document9 pagesLoi N 42-10 Portant Organisation Des Juridictions de Proximité Et Fixant Leurs Competences.Mouad Morchid ElouallousPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Droit Commercial PDFDocument9 pagesChapitre 1 Droit Commercial PDFAymane ZidaniPas encore d'évaluation
- Cours Institution Administratives Et Politiques Premiere PartieDocument117 pagesCours Institution Administratives Et Politiques Premiere PartieOumaima Smr100% (1)
- Cours Introduction A Letude Du Droit Semestre 1Document36 pagesCours Introduction A Letude Du Droit Semestre 1Chaimaa Hamdoune100% (2)
- S2 Organisation AdministrativeDocument4 pagesS2 Organisation AdministrativeBouchra AzrafPas encore d'évaluation
- Dialogue Social Au MarocDocument17 pagesDialogue Social Au MarocMeryem KrimiPas encore d'évaluation
- Droit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétenceD'EverandDroit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétencePas encore d'évaluation
- Tarikh Al Fattash - SudanDocument415 pagesTarikh Al Fattash - SudanPaulo MotaPas encore d'évaluation
- J'ai Mal À La GrèceDocument5 pagesJ'ai Mal À La GrèceMyrtó PapáPas encore d'évaluation
- Droit Administratif II Complet 1Document46 pagesDroit Administratif II Complet 1Besher Mousa100% (1)
- Le Lobbying (Pierre Bardon Thierry Libaert (Bardon Etc.)Document117 pagesLe Lobbying (Pierre Bardon Thierry Libaert (Bardon Etc.)blessingmanPas encore d'évaluation
- Rapport 1 GT PDFDocument434 pagesRapport 1 GT PDFJohn MalsalmoPas encore d'évaluation
- Migne. Patrologia Latina Tomus CXXX.Document653 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus CXXX.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- L'Écho Du Sahara Journal de (.) bpt6k5024574tDocument6 pagesL'Écho Du Sahara Journal de (.) bpt6k5024574tMoi MoiPas encore d'évaluation
- Additif 1 Procedure Penale Xl2ostDocument21 pagesAdditif 1 Procedure Penale Xl2ostghyslainbotysadiaPas encore d'évaluation
- La Realite de L Independance Des Juges: Reflexions Sur Un Partage Du PouvoirDocument6 pagesLa Realite de L Independance Des Juges: Reflexions Sur Un Partage Du PouvoirFaouzi MaalaouiPas encore d'évaluation
- R. C. Turcotte, 2014 QCCA - (N° 500-10-005723-141)Document26 pagesR. C. Turcotte, 2014 QCCA - (N° 500-10-005723-141)Léo FugazzaPas encore d'évaluation
- Les Sources Du Droit Fiscal MarocainDocument1 pageLes Sources Du Droit Fiscal MarocainAbdel Karim100% (2)