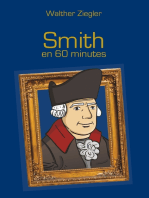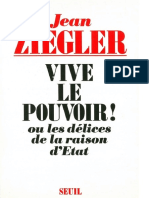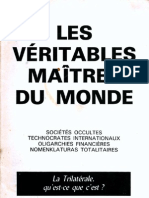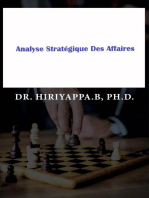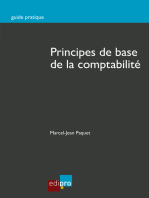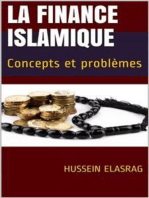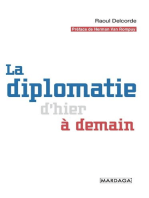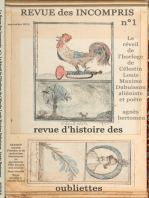Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Magasin XIXe Internationales Ouvrières
Transféré par
Dimitri Papaioannou0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues6 pagesTitre original
Magasin XIXe internationales ouvrières
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
22 vues6 pagesMagasin XIXe Internationales Ouvrières
Transféré par
Dimitri PapaioannouDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 6
Les internationales ouvrières
Samuel Hayat
To cite this version:
Samuel Hayat. Les internationales ouvrières. Le Magasin du XIXe siècle, 2018, Magasin du XIXe
siècle, 8, pp.126-131. �hal-02367988�
HAL Id: hal-02367988
https://hal.univ-lille.fr/hal-02367988
Submitted on 18 Nov 2019
HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents
entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de
teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires
abroad, or from public or private research centers. publics ou privés.
Les internationales ouvrières
Publié dans Magasin du XIXe siècle, n° 9, « Cosmopolis », p. 126-131
L’histoire des internationales ouvrières s’inscrit dans le large mouvement
d’internationalisation que connaît l’Europe au XIXe siècle. L’expérience du Cosmopolis, de
l’unification du monde comme monde, fût-elle très située et largement imaginaire, est alors
concurrencée par l’émergence d’un ordre international, c'est-à-dire d’un monde comme
ensemble d’Etats-nations dont les frontières se précisent et se renforcent, mais peuvent parfois
être franchies. Il ne faudrait pas trop durcir l’opposition, car le langage ne cesse de glisser au
gré des besoins, mais la distinction analytique vaut : l’international, contrairement au
cosmopolite, suppose un déploiement matériel, il n’existe qu’incarné dans des dispositifs
internationaux qui traversent explicitement les frontières nationales, sans véritablement les
mettre en question : sommets de chefs d’Etat, compagnies commerciales, associations
internationales. Il serait heureux de pouvoir séparer a priori ce qui, dans le mouvement
d’internationalisation de l’Europe, engage l’humanité dans l’horreur – la colonisation, la
guerre, l’exploitation – et ce qui l’élève – la solidarité internationale, les échanges dans les
sciences et les arts. Mais ces mouvements ne cessent d’aller de pair : l’internationalisation des
insurrections et celle de leur répression, l’internationale libérale et la Sainte-Alliance de
Metternich, la mondialisation capitaliste et la résistance ouvrière internationale.
L’internationalisme ouvrier s’insère dans cette dynamique contradictoire, dès ses
premières expressions. S’il y avait des contacts entre milieux ouvriers des deux côtés de la
Manche bien avant cette date, c’est à l’occasion de l’Exposition universelle de Londres, en
1862, que le projet d’une association internationale ouvrière s’ébauche. Des rencontres ont
alors lieu entre la délégation d’ouvriers français envoyée par Napoléon III et des syndicalistes
anglais, dans les interstices de cet événement tout à la gloire de la machine et du capitalisme.
L’année suivante, certains délégués français, dont le bronzier Henri Tolain, retournent à
Londres pour un rassemblement international contre la répression tsariste de l’insurrection
polonaise. Capitalisme et répression : l’internationalisme ouvrier se développe et se déploie
parallèlement aux dynamiques d’oppression auxquelles il s’oppose.
Le 4 novembre 1864, un nouveau meeting londonien, à Saint-Martin’s Hall, aboutit à
la création de l’Association internationale des travailleurs (AIT), bientôt simplement appelée
l’Internationale. Ce raccourci, de l’AIT à l’Internationale, n’est pas une construction
d’historien, c’est bien ainsi que ses partisans comme ses adversaires désignent l’AIT dès ses
premières années. Mais l’Internationale n’est pas seulement l’adjectif féminin substantivé de
l’Association internationale des travailleurs, ni le bel hymne écrit en 1871 par Eugène Pottier
et mis en musique en 1888 par le Lillois Pierre Degeyter, ni l’espoir d’une République vraie –
l’Internationale, qui « sera le genre humain », comme la Sociale. Hasard des noms ou signe de
l’époque, l’AIT n’est pas la seule Internationale à apparaître en 1864 : quelques mois avant sa
fondation, un décret impérial avait autorisé la création de « l’Internationale, compagnie
d’assurances maritimes et fluviales », réunissant 72 actionnaires, propriétaires, banquiers,
proches de Napoléon III, l’alliance entre les despotismes financier et impérial. Deux
conceptions de l’internationalisation se donnent à voir dans cette symétrie : Internationale
ouvrière contre Internationale capitaliste, les Etats pesant de tout leur poids pour que la
seconde triomphe de la première. Et on le sait, le long XIXe siècle s’achèvera dans la boue
des tranchées, le triomphe de l’industrie militaire et l’amoncellement de cadavres, sans que
l’Internationale ouvrière – la Deuxième Internationale, fondée en 1889 – ne puisse rien
empêcher, quoi qu’elle en ait et malgré les 3,5 millions d’adhérents des partis socialistes
qu’elle regroupait alors.
C’est à l’horizon de cette catastrophe qu’il faut lire l’histoire des internationales
ouvrières, car celles-ci ne cessent de se donner pour but explicite de mettre en échec la
politique tyrannique des gouvernements européens et l’internationalisation du capitalisme.
C’est ce qui ressort de l’adresse de 1864, écrite l’année précédente, que lit le leader trade-
unioniste George Odger, « au nom des ouvriers d'Angleterre », aux ouvriers français à Saint-
Martin’s Hall. D’un côté, dit-il, « les rois et les empereurs ont leurs réunions et leurs festins »
où « les crimes réussis se voient justifiés », et face à cela il faut « une union fraternelle des
peuples comme un moyen de mettre un terme aux abus actuels du pouvoir [...] despotique
[des] fourbes roublards » - Odger cite les interventions impériales en Italie, au Mexique, en
Suisse, en Chine. L’internationalisme est ici une forme de fraternité opposée au despotisme
impérialiste. D’un autre côté, c’est la question sociale qui se joue dans l’internationalisation,
car « toutes les fois que nous essayons d'améliorer notre condition sociale en réduisant les
heures de labeur, ou en augmentant le prix du travail, nos patrons nous menacent d'amener
des Français, des Allemands, des Belges et d'autres pour faire notre travail en acceptant des
salaires inférieurs ». Face à cette mise en concurrence, qui est le sens même de
l’internationalisation capitaliste, il faut « une union fraternelle entre les peuples », des
« rapports réguliers et systématiques entre les classes ouvrières de tous les pays » afin de « ne
pas permettre à nos patrons de créer la discorde entre nous et de nous réduire à la condition la
plus misérable, au gré de leurs cupides marchandages ». Il se dégage de l’adresse d’Odger la
perception d’une continuité entre exploitation capitaliste, domination despotique de l’Etat et
maintien sous tutelle des masses de travailleurs ; il se lit aussi la croyance dans la possibilité
de mettre fin à cet engrenage mortifère par la solidarité internationale.
La réponse des délégués ouvriers français, lue par Tolain, suit la même partition :
despotisme des tyrans – « Il ne faut plus que des Césars, le front souillé d'une couronne
sanglante, se partagent entre eux des peuples épuisés par les rapines des grands, des pays
dévastés par des guerres sauvages » ; despotisme du capital - « Progrès industriel, division du
travail, libre échange [...], les capitaux se concentrent, s'organisent en puissantes associations
financières et industrielles. Si nous n'y prenons garde, cette force sans contrepoids régnera
bientôt despotiquement » faisant de « chaque ouvrier un rouage dans la main des hauts barons
de l'industrie ». Et face à cette menace, une seule possibilité, se rencontrer, se reconnaître,
lutter ensemble : « Donc, ceignons nos reins, préparons-nous avec joie à la lutte, Il faut que le
peuple fasse entendre sa voix dans toutes les grandes questions politiques et sociales,
signifiant ainsi aux despotes que la fin de leur tyrannique tutelle est arrivée. Travailleurs de
tout pays qui voulez être libres : à votre tour d'avoir des congrès. C'est le peuple qui revient
enfin sur la scène, ayant conscience de sa force et se dressant en face de la tyrannie dans
l'ordre politique, en face du monopole, du privilège dans l'ordre économique. » Et il conclut :
« Sauvons-nous par la solidarité ! »
S’agit-il là d’une injonction moralisatrice, de cet humanisme que Marx détestait tant
chez ceux qu’il appelait « ces ânes de proudhoniens », les membres de la première section
parisienne de l’AIT, sise rue des Gravilliers ? Ce serait oublier que derrières ces mots, des
mécanismes de solidarité concrets se mettent en place. L’internationalisme n’est pas
seulement une analyse des liens entre le capitalisme et la tyrannie, encore moins un simple
état d’esprit fraternitaire, ce sont des échanges d’information, des soutiens financiers aux
grèves, un modèle organisationnel auquel les travailleurs de tous les pays peuvent s’accrocher
pour développer des sections locales – ce qui se fait surtout en Europe mais aussi ailleurs,
notamment aux Etats-Unis. C’est cette ambition pratique qui rend l’Internationale efficace et
donc dangereuse pour l’Etat et le capital.
A la fin des années 1860, une vague de grèves secoue l’Europe, notamment en France,
en Belgique, en Suisse, où les ouvriers demandent entre autres la journée de dix heures. Dans
ces pays, l’Internationale se développe fortement, ce qui convainc les gouvernements que
derrières les grèves se trouvent la main de l’étranger – alors que bien sûr, comme l’écrit le
Conseil Général dans son rapport au Congrès de Bâle de septembre 1869 à propos de la grève
des ovalistes, à Lyon, ces ouvrières qui avaient demandé à l’Internationale un soutien dans
leur grève, « ce n’était pas l’Internationale qui jeta les ouvriers dans la grève, mais la grève
qui les jeta dans l’Internationale ». En France, les procès se multiplient. La décision de l’AIT
de soutenir la Commune de 1871, malgré l’opposition d’une partie de ses membres, en
particulier les trade-unionistes anglais, est un tournant. Elle révèle que l’internationalisme
ouvrier n’est pas une vaine invocation de principes généreux, mais un outil de lutte qui vise la
transformation révolutionnaire, socialiste et ouvrière de l’Europe. Après l’insurrection, la
courte expérience de la liberté puis les massacres du printemps 1871, l’Internationale devient
l’ennemi à abattre, le nom même du mal qui pousse les ouvriers à sortir du rang et défendre
leurs droits. Une campagne est lancée, commençant avec une enquête parlementaire sur
l’insurrection du 18 mars 1871, se poursuivant avec nombre de livres d’auteurs libéraux ou
conservateurs : Charles de Mazade, Félix Lequien, Edmond Villetard, Oscar Testut, Claudio
Jannet, Pierre Zaconne. Qu’ils soient tricolores, bleus ou blancs, ces bons esprits puisent
indistinctement dans la grande tradition réactionnaire de la dénonciation des complots
maçonniques, jacobins, libéraux, socialistes qui a toujours accompagné les mouvements
d’émancipation. Après la fusillade et la calomnie, la campagne contre l’internationalisme
ouvrier en France prend l’apparence de la légalité avec la loi Dufaure du 14 mars 1872 qui
punit de prison l’appartenance ou le soutien à « toute association internationale qui, sous
quelque dénomination que ce soit et notamment sous celle d'association internationale des
travailleurs, aura pour but de provoquer à la suspension du travail, à l'abolition du droit de
propriété, de la famille, de la patrie ou des cultes reconnus par l'Etat ».
Ce n’est pourtant pas la répression qui met fin à l’expérience de la Première
Internationale, et qui condamne la Deuxième – cette numérotation n’apparaît qu’a posteriori,
en 1914 – à l’impuissance face à la guerre. Le Congrès de La Haye, en septembre 1872, voit
l’exclusion des antiautoritaires, qui se rassemblent à Saint-Imier quelques jours plus tard,
actant de fait la division du mouvement ouvrier international. Les raisons de la division sont
connues : conflit de personnes (notamment entre Marx et Bakounine), divergences de vues sur
le rôle du pouvoir d’Etat (à saisir ou à détruire) et surtout sur le fonctionnement de
l’organisation elle-même (centralisée ou reposant sur l’autonomie des sections). Il se dessine
là deux manières inconciliables de faire internationale, toutes deux traversées de
contradictions. Les antiautoritaires veulent un internationalisme décentralisé, respectueux de
l’autonomie des mouvements ouvriers nationaux, préfiguratif, comme le formulent les
délégués à Saint-Imier, « d'une organisation et d'une fédération économiques absolument
libres, fondées sur le travail et l'égalité de tous et absolument indépendantes de tout
gouvernement politique », amenées à remplacer les Etats. Mais comment construire un sujet
politique international, seul adapté à l’internationalisation du capitalisme, capable d’obtenir
« la destruction de tous les États nationaux » souhaitée par Bakounine à Bâle en 1869, si
l’Internationale se borne à être un simple « pacte d'amitié, de solidarité et de défense
mutuelle » ? Malgré les efforts de la Fédération jurassienne dans les années 1870, les
mouvements inspirés par l’internationalisme antiautoritaire, en particulier anarcho-
syndicalistes, se développent de manière largement indépendante.
Du côté du Conseil général, dominé par Marx, faire internationale suppose une action
coordonnée, centralisée, dirigée par Londres, quitte à faire fi de la volonté des mouvements
ouvriers de chaque pays. C’est là se donner les moyens de constituer un réel appareil de
représentation de la classe ouvrière internationale, mais s’engager dans la voie politique
amène à se limiter à la scène de l’Etat-nation – ce qui amène Friedrich Engels à se montrer
réticent à la reconstruction d’une Internationale en l’absence de partis socialistes nationaux
puissants. Comme l’écrit en 1905 le socialiste roumain Christian Rakovsky, « même le
socialisme le plus internationaliste procède par des voies nationales dans la mesure où chaque
Parti socialiste est organisé de manière nationale avant de l’être de manière internationale. »
Cette tension n’est jamais résolue, pas plus dans l’AIT débarrassée des anarchistes, qui survit
jusqu’en 1876, que dans la Deuxième Internationale, fondée en 1889, cette fois sous une
direction exclusivement marxiste, actée par le congrès de Londres de 1896 qui affirme le
primat de l’action législative et parlementaire. Les socialistes connaissent bien des succès
électoraux et intègrent progressivement l’élite étatique de leur pays, mais cela ne
s’accompagne pas d’un développement de l’internationalisme. Au contraire, malgré
l’institution en 1900 d’un Bureau Socialiste International, bientôt dirigé par le Belge Camille
Huysmans, la Deuxième Internationale ne devient jamais rien de plus qu’un outil de
collaboration, de discussion, parfois de solidarité, entre partis socialistes nationaux, sous la
domination des plus importants d’entre eux, le français et surtout l’allemand. A l’intérieur de
ces partis nationaux, de véritables débats ont lieu, notamment sur la question des nationalités
au sein du prolétariat du pays – en particulier dans les Etats multinationaux comme la Russie
et l’Autriche, là où existent des partis socialistes juifs ou encore pour les peuples répartis entre
plusieurs Etats, comme les Polonais. Mais ces débats ne se trouvent jamais réellement pris en
charge par l’Internationale, sauf de manière ponctuelle.
Rien ne dit mieux l’échec de l’internationalisme socialiste que le rapport à la
colonisation, cette entreprise d’exploitation et de destruction dans laquelle s’enfoncent alors
les pays européens. Certes, quand la question est soulevée dans les congrès de
l’Internationale, ce qui est rare, le colonialisme capitaliste est dénoncé, mais chez beaucoup
c’est au profit d’une politique coloniale dite positive qui « en régime socialiste pourra être une
œuvre de civilisation », selon les termes de la motion défendue par le Néerlandais Henri Van
Kol au Congrès de Stuttgart en 1907, qui n’échoue que du fait de l’intervention vigoureuse de
Karl Kautsky. La détérioration de la situation dans les Balkans, les révolutions en Turquie en
1908, en Iran et en Chine en 1911, créent un regain d’intérêt pour les questions internationales
chez les socialistes, mais achèvent de faire passer le problème colonial au second plan.
L’adoption des règles du jeu de la politique étatique laisse peu de place pour un
internationalisme qui serait un véritable dépassement des logiques impérialistes et guerrières
de l’intérêt national.
De là, peut-être, vient l’impuissance de l’Internationale face à l’entrée en guerre des
Etats européens. Ce ne sont pas les principes qui manquent, pourtant. Réunis à Bâle en
novembre 1912, les socialistes déclarent « guerre à la guerre » et veulent opposer « au monde
capitaliste de l’exploitation et du meurtre les masses du monde prolétarien de la paix et de
l’Union des peuples ». Mais face à l’emballement de la mécanique guerrière, l’Internationale
se révèle vide de toute volonté collective. Le 29 juillet 1914, le Bureau socialiste international
se réunit à Bruxelles et appelle à un congrès en urgence à Paris le 9 août. Le congrès n’aura
jamais lieu, car la guerre éclate entre temps, et tous les partis socialistes européens votent les
crédits de guerre et collaborent avec les gouvernements bourgeois, excepté en Russie et en
Serbie. L’Internationale ouvrière s’y révèle comme n’ayant jamais été plus que l’agrégation
de partis nationaux, fussent-ils socialistes, saisis au moment de la guerre par des logiques
internationales qui les rabattent vers le patriotisme.
Dans un texte d’avril 1916, alors que la guerre consume les peuples, Rosa
Luxembourg écrit : « Le 4 août 1914, la social-démocratie allemande officielle et, avec elle,
l'Internationale, s'effondrent misérablement. Tout ce que, pendant les cinquante années
précédentes, nous avions prêché au peuple, que nous avions déclaré être nos principes sacrés
[...] se révéla être un vide boniment. Soudainement, comme par magie noire, le parti de la
lutte de classe internationale prolétarienne est devenu un parti libéral national. [...] Nous
sommes devenus les outils indécis et justement méprisés de notre ennemi mortel, la
bourgeoisie impérialiste. [...] Le vieux cri orgueilleux : « Prolétaires de tous les pays, unissez-
vous ! » a été transformé sur le champ de bataille en un ordre : « Prolétaires de tous les pays,
égorgez-vous ! » » L’internationalisme ouvrier, tel qu’il avait pu être rêvé et pratiqué au XIXe
siècle, ne se relèvera pas de l’épreuve et laissera place, après la guerre, à une manière de faire
internationale sous la seule direction autoritaire de l’Union soviétique.
Samuel Hayat, CNRS (CERAPS)
Dogliani Patrizia, « The Fate of Socialist Internationalism », in Glenda Sluga et
Patricia Clavin (dirs.), Internationalisms. A Twentieth-Century History, Cambridge,
Cambridge University Press, 2016, pp. 38-60.
Haupt Georges et Rebérioux Madeleine (dir.), La Deuxième Internationale et l’Orient, Paris,
Editions Cujas, 1967.
Les Internationales et le problème de la guerre au XXe siècle, Ecole française de Rome, 1987.
Weill Claudie, « Les Internationales et la question nationale », in Jean-Jacques Becker et
Gilles Candar (dirs.), Histoire des gauches en France, Paris, La Découverte,
coll. « Poche/Sciences humaines et sociales », 2005, pp. 489-505.
Vous aimerez peut-être aussi
- Nouvelle histoire de la Commune de Paris en 1871: D'après les documents les plus authentiques et les plus récentsD'EverandNouvelle histoire de la Commune de Paris en 1871: D'après les documents les plus authentiques et les plus récentsPas encore d'évaluation
- La Domination Industrielle A5 Cahier 20pDocument10 pagesLa Domination Industrielle A5 Cahier 20pcroquignolPas encore d'évaluation
- Indignez-vous ! de Stéphane Hessel (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreD'EverandIndignez-vous ! de Stéphane Hessel (Analyse de l'oeuvre): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Notre Ennemi, Le CapitalDocument33 pagesNotre Ennemi, Le Capitalklausen12Pas encore d'évaluation
- Penser le travail avec Karl Marx: Comprendre le mondeD'EverandPenser le travail avec Karl Marx: Comprendre le mondePas encore d'évaluation
- Livre Ihs CGT Gard Avec CouvertureDocument100 pagesLivre Ihs CGT Gard Avec CouverturejeangardPas encore d'évaluation
- Contre le joug: Les libertaires de part le monde... en PérigordD'EverandContre le joug: Les libertaires de part le monde... en PérigordPas encore d'évaluation
- La Colonisation en Debat Site HerodoteDocument2 pagesLa Colonisation en Debat Site HerodoteGNINGUEPas encore d'évaluation
- L'Organisateur de Saint-Simon: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandL'Organisateur de Saint-Simon: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Les Dangers Du Marché Planétaire - Serge LatoucheDocument136 pagesLes Dangers Du Marché Planétaire - Serge Latouchenemesis4u100% (3)
- Eco Soc - Séance 3 (Exposé Associationnisme Ouvrier)Document9 pagesEco Soc - Séance 3 (Exposé Associationnisme Ouvrier)PESdeGREPas encore d'évaluation
- La guerre artistique avec l'Allemagne : l'organisation de la victoireD'EverandLa guerre artistique avec l'Allemagne : l'organisation de la victoirePas encore d'évaluation
- Limpérialisme Stade Suprême Du Capitalisme 1917 by Lénine, Wladimir IllitchDocument129 pagesLimpérialisme Stade Suprême Du Capitalisme 1917 by Lénine, Wladimir IllitchMandoPas encore d'évaluation
- La Prospérité Du ViceDocument92 pagesLa Prospérité Du ViceAndaluzPas encore d'évaluation
- Empêcher la guerre: Le pacifisme du début du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondialeD'EverandEmpêcher la guerre: Le pacifisme du début du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre mondialePas encore d'évaluation
- Stephane Hessel Indignez Vous! LP (2010)Document32 pagesStephane Hessel Indignez Vous! LP (2010)camille100% (1)
- 9782701304991Document35 pages9782701304991Zaghouane MalekPas encore d'évaluation
- Yves Guyot - La Démocratie IndividualisteDocument283 pagesYves Guyot - La Démocratie IndividualisteGu Si FangPas encore d'évaluation
- EBOOK Daniel Cohen - La Prosperite Du ViceDocument87 pagesEBOOK Daniel Cohen - La Prosperite Du Vicepauline.kamalaPas encore d'évaluation
- Balibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeDocument28 pagesBalibar, Cosmopolitisme Et InternationalismeSpinoza1974Pas encore d'évaluation
- Badiou Alain Le Reveil de L HistoireDocument169 pagesBadiou Alain Le Reveil de L Histoireeuagg75% (4)
- Moncomble Yann - L'Irrésistible Expansion Du MondialismeDocument252 pagesMoncomble Yann - L'Irrésistible Expansion Du MondialismeNunusse100% (1)
- CM 9Document6 pagesCM 9LefevrePas encore d'évaluation
- Support Syndicalisme Et Socialisme 2022Document3 pagesSupport Syndicalisme Et Socialisme 2022waly sow100% (2)
- Théorie Communiste N°16Document176 pagesThéorie Communiste N°16EspaceContreCimentPas encore d'évaluation
- Lapaque Mauriac BernanosDocument5 pagesLapaque Mauriac BernanosslapaquePas encore d'évaluation
- Les Dangers Du Marché Planetaire Serge LatoucheDocument136 pagesLes Dangers Du Marché Planetaire Serge LatoucheskiffleboyPas encore d'évaluation
- Synarchie FinanciereDocument28 pagesSynarchie FinanciereIlyass AtPas encore d'évaluation
- Résume de H.P.EDocument19 pagesRésume de H.P.Eabdel hakim100% (1)
- Spectacle Mythologique...Document75 pagesSpectacle Mythologique...Edgar AugéPas encore d'évaluation
- Garaudy-Avenir Mode D'emploi PDFDocument217 pagesGaraudy-Avenir Mode D'emploi PDFWonder Laurence100% (1)
- 4 5850418968153557395 PDFDocument375 pages4 5850418968153557395 PDFTor La sagessePas encore d'évaluation
- Texte Édito de La Nouvelle Critique 1948Document2 pagesTexte Édito de La Nouvelle Critique 1948GandoulfPas encore d'évaluation
- Hpe 5Document21 pagesHpe 52cpg8czw2mPas encore d'évaluation
- Michel Winock - "Désormais, C'est Le Média Qui Fait L'intellectuel"Document8 pagesMichel Winock - "Désormais, C'est Le Média Qui Fait L'intellectuel"denis100% (1)
- Capitalisme Et Pulsion de MortDocument173 pagesCapitalisme Et Pulsion de Mortflavielob100% (2)
- Exposé International SituationnisteDocument2 pagesExposé International SituationnisteaupairinbluePas encore d'évaluation
- Le-Complot-Mondialiste - Phillipe Ploncard D'assacDocument85 pagesLe-Complot-Mondialiste - Phillipe Ploncard D'assacArou N'a100% (4)
- ImperialismeDocument73 pagesImperialismeBoubacar IbrahimPas encore d'évaluation
- Ce Gros Mot de Communisme (Manuel Cervera-Marzal Collectif)Document151 pagesCe Gros Mot de Communisme (Manuel Cervera-Marzal Collectif)fall serigne mamaPas encore d'évaluation
- L'avènement de L'époque ContemporaineDocument16 pagesL'avènement de L'époque Contemporainegiulia CellerinoPas encore d'évaluation
- UtopiaDocument4 pagesUtopiaEnrike Iglesias FischerPas encore d'évaluation
- Abecedaire Partiel, Et PartialDocument490 pagesAbecedaire Partiel, Et PartialLaura RojasPas encore d'évaluation
- La Grande Transformation - PolanyiDocument10 pagesLa Grande Transformation - Polanyiwoodruff1986Pas encore d'évaluation
- 9782130510819Document36 pages9782130510819BambaPas encore d'évaluation
- L'avenir Mode D'emploiDocument389 pagesL'avenir Mode D'emploiGreenSheetPas encore d'évaluation
- Éric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalDocument13 pagesÉric Alliez, Maurizio Lazzarato - Guerres Et CapitalNicole BrooksPas encore d'évaluation
- Camman Robert - Les Veritables Maitres Du MondeDocument24 pagesCamman Robert - Les Veritables Maitres Du MondeAutres Vérités100% (4)
- Exercices - Les Enfants Gâtés Du Supermarché, Par Louis Pinto (Le Monde Diplomatique, Juillet 2018)Document4 pagesExercices - Les Enfants Gâtés Du Supermarché, Par Louis Pinto (Le Monde Diplomatique, Juillet 2018)Paola Felts AmaroPas encore d'évaluation
- Braudel - La Dynamique Du CapitalismeDocument5 pagesBraudel - La Dynamique Du Capitalismewindiz OutremerPas encore d'évaluation
- Bernard Chantebout - Le Tiers MondeDocument5 pagesBernard Chantebout - Le Tiers MondeGaiwe GnowePas encore d'évaluation
- Contraction Essai FrancaisDocument3 pagesContraction Essai FrancaisZenabou NassourPas encore d'évaluation
- Dissertation D Clin Des Conflits Du TravailDocument3 pagesDissertation D Clin Des Conflits Du Travailbeebac2009Pas encore d'évaluation
- Document 9 1Document6 pagesDocument 9 1Wael GarnaouiPas encore d'évaluation
- Bruno Rizzi, El Colectivismo BurocráticoDocument21 pagesBruno Rizzi, El Colectivismo Burocráticoantipaton100% (1)
- Anarcho CommunismeDocument356 pagesAnarcho CommunismeSwann ProfanePas encore d'évaluation
- Citations Et Aphorismes GrandDocument578 pagesCitations Et Aphorismes GrandCfleuPas encore d'évaluation
- L'âge Dystopique Du Masque - Une Omniprésence Prédite en 1932 Par Ernst Jünger - Les Maîtres Du Monde - SottDocument5 pagesL'âge Dystopique Du Masque - Une Omniprésence Prédite en 1932 Par Ernst Jünger - Les Maîtres Du Monde - SottOrdjounPas encore d'évaluation
- La CNT C'est Quoi? PDFDocument4 pagesLa CNT C'est Quoi? PDFRenzoForeroPas encore d'évaluation
- Liste Complète de Tous Les Nouveaux Députés AlgériensDocument12 pagesListe Complète de Tous Les Nouveaux Députés AlgériensAnonymous uKab5aIwrPas encore d'évaluation
- Bibliographie AnarchieDocument939 pagesBibliographie AnarchieLu LarPas encore d'évaluation
- Document Sur Aginter Presse (Partie 1)Document7 pagesDocument Sur Aginter Presse (Partie 1)Operation GladioPas encore d'évaluation
- Anarcho-Syndicalisme Et Syndicalisme Révolutionnaire en Allemagne - Gaëtan Le PorhoDocument8 pagesAnarcho-Syndicalisme Et Syndicalisme Révolutionnaire en Allemagne - Gaëtan Le PorhoFelipe_GumaPas encore d'évaluation
- Pelai Pagès, Le Mouvement Trotskyste Pendant La Guerre Civile D'espagne (1982)Document10 pagesPelai Pagès, Le Mouvement Trotskyste Pendant La Guerre Civile D'espagne (1982)danielgaidPas encore d'évaluation
- Ultra Droite en ProvenceDocument1 pageUltra Droite en ProvenceJ.P.Pas encore d'évaluation
- Oktober 15Document127 pagesOktober 15lanisaPas encore d'évaluation
- Christophe Bourseiller Ultra Gauche PDFDocument22 pagesChristophe Bourseiller Ultra Gauche PDFAnonymous va7umdWyh100% (1)
- Bibliothèque Du Mouvement Ouvrier - 1 500 Documents.Document37 pagesBibliothèque Du Mouvement Ouvrier - 1 500 Documents.nono mauritiusPas encore d'évaluation
- 1 Genèse Des TotalitarismesDocument2 pages1 Genèse Des TotalitarismesAlizée MichaudPas encore d'évaluation
- Anarchisme & Syndicalisme - Le Congrès Anarchiste 1907Document236 pagesAnarchisme & Syndicalisme - Le Congrès Anarchiste 1907Bob OboPas encore d'évaluation
- Profession de Foi CPN 2012Document4 pagesProfession de Foi CPN 2012sudemploi7627Pas encore d'évaluation
- Chrono ItalieDocument156 pagesChrono Italiequico36Pas encore d'évaluation
- Enver Hoxha Les KrouchtcheviensDocument172 pagesEnver Hoxha Les KrouchtcheviensbattleoflepantePas encore d'évaluation
- Les Accords Matignon Et Le Front Populaire, VEDocument1 pageLes Accords Matignon Et Le Front Populaire, VEGizemPas encore d'évaluation
- Benito MussoliniDocument38 pagesBenito MussoliniandoPas encore d'évaluation
- Extrême Gauche PDFDocument20 pagesExtrême Gauche PDFMarco RodriguezPas encore d'évaluation
- L AnarchieDocument2 pagesL AnarchieBrisak Pissed OffPas encore d'évaluation
- TUGAS Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia Berdasarkan Kurun Waktu TertentuDocument32 pagesTUGAS Pancasila Dalam Kajian Sejarah Bangsa Indonesia Berdasarkan Kurun Waktu TertentuLeorina AmandaPas encore d'évaluation
- Histoire de La Gauche Communiste ItalienneDocument85 pagesHistoire de La Gauche Communiste ItalienneClara MarañónPas encore d'évaluation
- Karl Radek, Le Triomphe Du FascismeDocument3 pagesKarl Radek, Le Triomphe Du FascismedanielgaidPas encore d'évaluation
- François Furet Ernst Nolte Fascisme Et CommunismeDocument5 pagesFrançois Furet Ernst Nolte Fascisme Et CommunismeneirotsihPas encore d'évaluation
- 3e Carte Mentale Guerre FroideDocument3 pages3e Carte Mentale Guerre Froidefrederic amadonPas encore d'évaluation
- Fête Du Travail OriginesDocument5 pagesFête Du Travail OriginesAmendaPas encore d'évaluation
- (BERU) Mouvance Autonome MemoireDocument34 pages(BERU) Mouvance Autonome MemoireGore KhaaPas encore d'évaluation
- De la démocratie en Amérique - Édition intégraleD'EverandDe la démocratie en Amérique - Édition intégralePas encore d'évaluation
- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)
- Les sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieD'EverandLes sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (451)
- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauD'EverandDiscours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauPas encore d'évaluation
- Le trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsD'EverandLe trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (19)
- Droit du commerce international: Les fondamentauxD'EverandDroit du commerce international: Les fondamentauxÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Pensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoD'EverandPensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoPas encore d'évaluation
- Coronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTD'EverandCoronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTPas encore d'évaluation
- Mémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)D'EverandMémento de clôture annuelle: Exercice d'imposition 2015 - Revenus 2014 (Belgique)Pas encore d'évaluation
- Vers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriqueD'EverandVers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriquePas encore d'évaluation
- Crypto-monnaies pour les débutants: Un guide pour développer votre avenir financier en investissant dans les monnaies numériques, stratégies d'extraction et de négociationD'EverandCrypto-monnaies pour les débutants: Un guide pour développer votre avenir financier en investissant dans les monnaies numériques, stratégies d'extraction et de négociationÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (5)
- Apprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)D'EverandApprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)Pas encore d'évaluation
- L'Éclaireur: Du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration françaiseD'EverandL'Éclaireur: Du recrutement à la formation, l'histoire vraie et stupéfiante du seul espion du KGB à avoir intégré l'ENA pour infiltrer l'administration françaiseÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (2)
- Les defis du developpement local au SenegalD'EverandLes defis du developpement local au SenegalÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- La diplomatie d'hier à demain: Essai politiqueD'EverandLa diplomatie d'hier à demain: Essai politiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- La consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesD'EverandLa consolidation: Contrôler les comptes d'entreprisesPas encore d'évaluation
- Revue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteD'EverandRevue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (3)