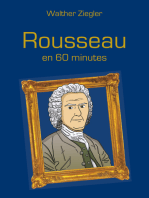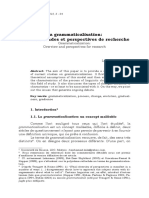Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rosen GRANDARTICLE 2000
Transféré par
selfkillerTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rosen GRANDARTICLE 2000
Transféré par
selfkillerDroits d'auteur :
Formats disponibles
GRAND ARTICLE: « Kojève à Paris.
Chronique »
Author(s): Stanley Rosen and Jean-Louis Breteau
Source: Cités , 2000, No. 3, Le corps humain sous influence: La bioéthique entre pouvoir
et droit (2000), pp. 197-220
Published by: Presses Universitaires de France
Stable URL: https://www.jstor.org/stable/40620695
JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide
range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and
facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.
Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at
https://about.jstor.org/terms
Presses Universitaires de France is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend
access to Cités
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
« Kojeve à Paris.
Chronique »1
Stanley Rosen
En 1960-1961 j'étais professeur Fulbright à la Sorbonne. Mon parrain
était Jean Wahl, un homme des plus aimables qui avait été l'un des
premiers, peut-être le premier, à attirer de nouveau l'attention des philo-
sophes français sur Hegel à la fin des années vingt par ses cours sur la
conscience malheureuse. Wahl était intéressant à cause d'un certain 197
manque de rigidité qui caractérisait sa nature. Par son éducation et son
âge il servait de symbole au Paris de la génération précédente. En même« Kojeve à Paris.
Chronique »
temps il faisait preuve d'une ouverture d'esprit juvénile et d'une prédispo- S. Rosen
sition imaginative pour la nouveauté qui suggéraient les choses à venir.
On ne pouvait le confondre avec les maîtres traditionnels de l'érudition
tels que Guéroult ou Gouhier, qui incarnaient au plus haut degré la
formation française classique d'entre les deux guerres mais qui, en même
temps, parlaient d'une voix feutrée à des oreilles en partie closes. Malheu-
reusement Wahl n'était plus dans la fleur de l'âge lorsque je l'ai rencontré.
Nos contacts étaient limités et de nature plus mondaine que philoso-
phique. Bref, même si Wahl était administrativement ou politiquement le
philosophe le plus important de l'université de Paris (c'est du moins ce
que je me suis laissé dire), il n'était plus en mesure d'ouvrir la voie à la
génération suivante.
1 . En anglais : memoir ; toutes les notes sont celles du traducteur. Cet article est tiré de
l'ouvrage Metaphysics in Ordinary Language, New Haven, Yale University Press, 1999. Nous
remercions Stanley Rosen et les Presses de Yale d'avoir autorisé la publication de cette traduction.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Malgré la présence d'intéressantes individualités plus jeunes (parmi
lesquelles on comptait Paul Ricœur), la Sorbonne était essentiellement
dans les mains de la vieille garde, un carré d'historiens cultivés ayant une
vue universitaire traditionnelle de la philosophie. Ceux qui s'intéressaient
à la philosophie en tant qu'entreprise vivante devaient chercher ailleurs : à
l'École des Hautes Études, chez les Jésuites, dans les salons et, surtout, au
Quai d'Orsay où officiait Alexandre Kojève.
Pour être tout à fait honnête, mon appartenance à la Sorbonne en
tant que professeur Fulbright était un moyen pratique me permettant de
mener à bien l'objectif premier qui m'avait amené à Paris. J'étais porteur
d'une lettre de recommandation à l'adresse de Kojève que m'avait
confiée Leo Strauss dont, après ma licence, j'avais été l'étudiant à
l'université de Chicago dans le cadre du Centre de recherches sur la
pensée sociale1 (organisation qui mérite bien qu'on lui consacre une
chronique à part entière). En I960, âgé de 31 ans, j'étais, pour
reprendre les termes du portrait que Raymond Aron avait dressé de moi
à notre première rencontre un « brillant jeune homme... mais pas trop
jeune ! » Ce dernier était assez poli pour se garder de préciser à quel
point j'étais brillant. Ce compliment ambigu était assez exact en ce qui
198 concerne mon âge, lequel me permettait d'admirer les personnalités frap-
pantes du Paris d'alors sans devenir leur disciple. J'avais, pour ainsi dire,
Grand article été vacciné contre le pathos de la vieille Europe en grandissant aux États-
Unis et contre toute tentation de devenir un disciple par le spectacle du
cercle (ou plutôt des cercles) qui gravitai(en)t autour de mon vieux
professeur à Chicago.
Comme ceci est une chronique personnelle du Paris de Kojève, il me
faut dire quelque chose sur les Parisiens de l'époque qui ont été pour moi
les plus importants ou les plus frappants. Mon épouse et moi-même
sommes arrivés à Paris la veille du désormais célèbre colloque de Royau-
mont sur la dialectique, auquel nous avions été invités par une amie,
Jeanne Hersch, professeur à Genève et membre bien connu du monde
philosophique parisien. Je fus officiellement initié à ce monde par Jacques
Lacan, personnage austère, au visage sombre, vêtu d'un complet noir et
qui ce jour-là parlait, mais mon souvenir est vague et probablement
inexact, de l'image-miroir. Je crois savoir que sa communication, qui a
duré environ trois heures, a été un événement historique marquant du
1. En anglais : « Committee on Social Thought ».
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
postmodernisme et fait ainsi partie des annales de l'influence de Kojève,
dont Lacan avait suivi le fameux cycle de conférences sur Hegel.
Comme tant d'autres célébrités du jour, Lacan, selon les renseigne-
ments que j'avais recueillis, avait été profondément influencé par
l'analyse que donnait Kojève de la dialectique du maître et de l'esclave.
Disons, en anticipant sur la suite, que, lorsque je demandai un jour à
Kojève son avis sur Lacan, il me répondit : « II gagne beaucoup
d'argent. »l Pour en revenir à la conférence, elle était donnée dans une
salle mal ventilée, surchauffée et remplie pour l'essentiel de spécialistes
de la dialectique venant d'Europe centrale, portant tous le même
costume sombre à rayures largement espacées et tirant tous des bouffées
de cigarettes à l'odeur insupportablement forte. Ma femme quitta les
lieux au bout d'un quart d'heure ; je restai trente minutes de plus
environ, m'efforçant désespérément de continuer à respirer, à la fois au
propre et au figuré, dans l'atmosphère épaisse créée par les cigarettes de
mes collègues et la rhétorique inassimilable du conférencier. Je trouvai
Lacan prétentieux, obscur et ennuyeux, impression qui scandalisera
peut-être certains lecteurs de cette chronique, mais que j'ai gardée
intacte, je dois l'avouer, depuis trente-cinq ans. Je ne prétends pas
formuler ici un jugement scientifiquement fondé, tout effort de ma part 199
pour remplacer les impressions initiales par une étude attentive des
textes clefs s'étant soldé par un échec.
« Kojève à Pans.
Ce fut peut-être l'événement le plus important du colloque d'un point Chronique »
de vue historique, mais il ne fut pour moi qu'éphémère. Il y avait dans S. Rosen
l'assistance un large assortiment d'individualités contrastées, allant de
l'imbécile au profond, chacune en mesure de contribuer de manière spéci-
fique à l'éducation d'un (pas trop) jeune Américain. Je me rappelle
distinctement un mandarin parisien, au milieu de la trentaine, auquel je
fus présenté par Jeanne Hersch comme quelqu'un qui partageait son
intérêt pour Heidegger. Le monsieur en question refusa de me regarder et
me fit pendant cinq minutes la faveur d'un curage de dents (les siennes,
bien sûr) élaboré avec l'ongle de son pouce droit tandis que je marmon-
nais les inepties d'usage. Ce rituel dentaire je ne l'avais vu précédemment
pratiqué qu'au cinéma, par Brigitte Bardot, chez laquelle j'y voyais une
manifestation de volupté. Dans le cas de mon interlocuteur d'alors, qui
avait, je me l'étais laissé dire, été un homme de main au service du parti
1. Citation en français dans le texte original.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
communiste grec, il me paraissait plutôt s'apparenter à une exécution
symbolique.
Ce ne fut que plus tard que je finis par comprendre l'antipathie mani-
feste du susdit monsieur pour quelqu'un dont il ne savait quasiment rien.
Sa conduite était en grande partie inspirée par un anti-américanisme qui
n'était malheureusement pas exceptionnel dans les années soixante chez
les parisiens de sa génération. C'est là un sujet qui offense quelques
universitaires français lorsque j'en fais mention, mais je ne puis guère
avoir d'indulgence pour leur irritation, surtout après avoir, lorsque je
vivais en France, fait les frais d'innombrables accès de grossièreté et de
critique tout à fait banale à l'endroit des États-Unis. Sur un point au
moins, une chronique doit être exactement semblable à un essai savant.
On doit dire la vérité. Je n'ai pas besoin de préciser que beaucoup de mes
meilleurs amis, en particulier ma femme, sont français et que j'ai fait
certaines des expériences philosophiques les plus satisfaisantes de ma vie
en leur compagnie. Mais il faut aussi dire que le trait le plus positif du
caractère français n'est pas celui de bien supporter la critique.
Il n'en demeure pas moins qu'en 1960 l'influence du marxisme en
général ainsi que de Sartre et de Simone de Beauvoir en particulier était
200 extrêmement forte à Paris. L'anti-américanisme de ces personnes est de
notoriété publique et n'a pas besoin d'être étayé par des anecdotes ou des
Grand article
souvenirs personnels. On doit garder à l'esprit des phénomènes qui y sont
associés comme l'insistance mise par de Gaulle à empêcher les Américains
de ternir l'éclat de la gloire française, tout autant que le dédain ressenti à
cette époque par la plupart des philosophes français à l'égard des mouve-
ments philosophiques du monde anglophone. Au niveau le plus profond,
cette condescendance philosophique vis-à-vis des Américains en particu-
lier devait beaucoup à l'influence de Kojève, mais surtout à celle de
Heidegger. Je dois dire qu'à cette période de ma vie, j'étais philosophique-
ment euro-phile1 et entièrement disposé à partager la critique que l'on
faisait des doctrines philosophiques de mes compatriotes. Ce que, en
revanche, je n'étais pas du tout prêt à accepter, c'était une critique igno-
rante et malveillante de mon pays.
Cette situation désagréable m'encourageait à passer le plus clair de mon
temps en compagnie de Russes, de Juifs polonais et lithuaniens et de
1 . En anglais : « philo-European » ; le terme « Europhile » est beaucoup plus courant, mais à
consonance plus directement politique.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
prêtres, qui avaient tous soixante ans ou presque et qui tous étaient
heureusement immunisés contre les conséquences vulgaires des idéologies
en vogue à cette période, même s'ils participaient à leur formulation intel-
lectuelle. Le point de vue général de presque tous ceux avec lesquels
j'entrai en contact était que l'Amérique devait être considérée au mieux
comme l'analogue de la Rome ancienne, tandis que les Français, naturel-
lement, étaient les Grecs de l'époque classique. Je rencontrai également ce
point de vue en Grande-Bretagne, mais avec une légère variante, selon
laquelle les Anglais assumaient le rôle de mentors helléniques à l'endroit
des Romains américains. En Allemagne et en Italie, de manière assez frap-
pante, je trouvai une admiration très répandue pour les États-Unis,
exprimée parfois de façon ambiguë (« Vous avez gagné la guerre ! Il faut
qu'on soit comme vous ! » m'entendis-je dire à Tübingen par un chirur-
gien en vue) et trop souvent liée au désir de recevoir des invitations
émanant de riches universités américaines.
Pour me limiter à Paris, les Français ne manifestaient à cette époque pas
la moindre velléité d'adapter leur supériorité aux largesses des établisse-
ment universitaires américains et ne souhaitaient pas non plus trans-
former leurs propres facultés de philosophie en bastions du pragmatisme
201
et de la philosophie analytique anglo-saxonne, comme le faisaient quel-
ques brillants représentants de la jeune génération allemande. Ceux-ci y
étaient poussés de manière compréhensible par la révulsion qu'ils éprou- « Kojève à Paris.
vaient à l'endroit des opinions philosophiques de la génération d'entre les Chronique »
S. Rosen
deux guerres et, en particulier, vis-à-vis d'Heidegger, dont on s'accordait
largement pour dire qu'il avait été nazi, qu'il était de surcroît une person-
nalité équivoque à d'autres égards et dont l'influence était tenue pour
largement responsable de la destruction de la société civile et spirituelle en
Allemagne.
En France, au contraire, Heidegger était (et est toujours) tenu en haute
estime. La première moitié de son célèbre aphorisme selon lequel méta-
physiquement parlant l'Amérique et la Russie sont identiques et que ces
deux pays constituent une paire de pinces entre les deux branches de
laquelle l'Allemagne est prise en tenaille, recevait l'aval de Kojève lui-
même. C'est un phénomène étrange que la France et les États-Unis soient
les deux pays dans lesquels les défenseurs de l'intégrité personnelle de
Heidegger ont résisté le plus longtemps contre l'évidence. Explorer en
détail pourquoi il peut en être ainsi m'entraînerait beaucoup trop loin. Il
suffit de dire que Heidegger a fourni aux États-Unis un point de rallie-
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
ment pour beaucoup de ceux qui ont rejeté le mouvement analytique
dominant dans la philosophie universitaire ou ont eux-mêmes été rejetés
par lui. En ce qui concerne la France, il convient au moins de noter que
Jean Beaufret, l'un des professeurs de philosophie les plus influents à Paris
(il enseignait au lycée Louis-le-Grand) était un ami intime de Heidegger
et partageait son idéologie politique et sociale. Néanmoins, comme le cas
de Derrida suffit à le montrer, il n'est guère possible de lier l'influence de
Heidegger en France à une propension à l'antisémitisme. Que cette
influence ait pris la forme politique caractéristique de la gauche plutôt que
de la droite est aussi un sujet qui mérite l'attention.
Il est surprenant de se rappeler à quel point l'opinion sur l'Amérique
défendue même par les intellectuels et les artistes a été formée par Holly-
wood et la bande dessinée. Les fantaisies de la conviction politique ont
aussi joué ici un rôle important. Je me contenterai d'une seule anecdote
datant d'une période un peu plus tardive. En 1963-1964, j'étais assistant
postdoctoral à l'Institut de recherches en sciences humaines1 de l'uni-
versité du Wisconsin. Un jour nous reçûmes la visite de Nathalie
Sarraute, une romancière française de renom qui était juive. On la plaça
auprès de moi pendant le déjeuner, sans doute parce que je parlais fran-
202 çais. Quand Sarraute sut que moi aussi j'étais juif, elle m'apprit qu'il y
avait plusieurs plages publiques à New York City dont les Juifs étaient
Grani arúck
exclus. Sur ce point, je ne parvins pas à ébranler une conviction qu'elle
avait acquise à Paris.
Je veux développer la remarque que je viens de faire au sujet des films
d'Hollywood. Ceux-ci rencontraient un très grand succès auprès des intel-
lectuels et des étudiants français qui faisaient de longues queues sous la
pluie pour voir un film de Robert Mitchum ou de Jerry Lewis, tout
comme les New-Yorkais pour voir ceux d'Ingmar Bergman et de Federico
Fellini. Ces films américains étaient discutés avec force détails et haute-
ment appréciés ; pourtant, de manière assez paradoxale, ils servaient large-
ment de base pour étayer l'opinion fortement péjorative que l'on avait de
la vie en Amérique. Une attitude similaire prévalait à l'égard du « coca »2
(le coca-cola, bien sûr), que les Parisiens consommaient en grande quan-
tité, alors même qu'ils blâmaient les Américains de le préférer au vin. On
pourrait raconter la même histoire à propos de la musique populaire. À
1. En anglais : « Humanities Research Institute ».
2. « Toward "le coca" » (en français dans le texte).
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
un niveau plus sérieux, le fait indéniable que constituait l'existence du
racisme était injustement exploité par les Parisiens, qui semblaient ne pas
remarquer que les Noirs brillaient par leur absence dans les quartiers chics
tels que le VIIIe et le XVIe arrondissements.
J'ajouterai un mot à propos de l'anti-américanisme lorsque je parlerai de
Kojève. Pour en revenir à Royaumont, un autre aspect amusant de cette
manifestation est que j'étais l'un des quatre anglophones de naissance
présents au colloque, les trois autres étant G. R. G. Mure, John Findlay et
Leslie Beck. Pour la première fois de ma vie, je me trouvai catalogué
comme anglo-saxon. J'ai gardé, à un degré ou à un autre, des relations
cordiales avec ces personnes après le colloque, mais ceci est une autre
histoire. Ce fait figure dans cette chronique à titre de détail d'arrière-plan
ou de préparation pour hparousie de Kojève. Ces anglophones charmants
et très à l'aise en français ont contribué à m'initier à la dialectique conti-
nentale tout en me fournissant des exemples vivants de ce qu'avait été la
philosophie britannique avant que triomphe l'analyse du langage ordi-
naire. Mure, qui appartenait à l'ère de Collingwood et de Joachim, était
particulièrement amer au sujet de l'avènement de la philosophie analytique
qu'il attribuait à la perte d'une génération entière de jeunes gens doués
pendant la première guerre mondiale. On n'a besoin d'accepter ni son 203
aversion pour la philosophie analytique, ni la manière précise dont il expli-
quait sa montée en puissance pour voir qu'il y a un lien entre la première
«KojheàPans.
guerre mondiale et la relève de la garde dans la vie intellectuelle en Europe. Chronique »
Le siècle de l'analyse et celui de ï Angst vordem Tode sont les conséquences S. Rosen
théoriques et pratiques de la destruction d'une époque historique.
Ce fut à Royaumont que je rencontrai pour la première fois un certain
nombre de figures qui ont joué un rôle périphérique dans mon éducation
parisienne, parmi lesquelles la plus hospitalière fut Lucien Goldmann.
Goldmann jouissait à Paris d'une réputation ambiguë, celle d'une sorte de
laquais de Georg Lukács. Son œuvre n'a jamais obtenu sur le continent
l'estime dont elle a fini par bénéficier pendant une brève période chez les
Américains et les Anglais. Je le trouvai à la fois ouvert et poli, malgré son
fanatisme évident : mélange fascinant s'il en est ! Il m'invita dans son
appartement où, après que sa femme nous eut servi le café et les gâteaux,
Goldmann me demanda d'une voix criarde et haut perchée : « Alors !
Quelle est votre position philosophique ? »l Je ne trouvai rien de mieux à
1 . « Alors ! Quelle est votre position philosophique ?» : en français dans le texte.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
dire que « Je suis platonicien » ou quelque chose d'approchant. « Platoni-
cien ! » s'écria Goldmann, ce sur quoi il se mit à parler pendant deux
heures à la vitesse d'une mitrailleuse, essentiellement à propos de Kasa-
vubu, Mobutu et Lumumba, figures de proue de la crise qui sévissait alors
au Congo. Je l'aimais assez, mais trouvais que ses conceptions relevaient
de l'historicisme conventionnel et n'étaient en rien comparables à la
netteté des formulations de Lukács. Je le choisis pour illustrer mon propos
parce qu'il était courageux et prêt à discuter de philosophie avec un jeune
Américain.
Mais la découverte la plus importante que je fis à Royaumont fut, de
loin, la personnalité remarquable du P. Gaston Fessard, S. J. Fessard n'est
pas seulement important en tant que tel ; c'était aussi l'un des plus
proches amis de Kojève, peut-être le plus proche à Paris. Pour anticiper
un instant sur la suite de mon exposé, mon emploi du temps à Paris
s'établit bientôt comme suit : le lundi matin au Quai d'Orsay, en conver-
sation avec la réincarnation de Machiavel, mâtiné de Hobbes et de
Cagliostro, et le jeudi après-midi à la Maison des Jésuites, avec un homme
de Dieu dont l'intelligence extraordinaire et la magnifique grandeur
d'âme lui avaient valu mon affection immédiate et durable.
204 Cinq hommes m'ont impressionné plus que tous les autres pendant ma
première année à Paris : Alexandre Koyré, Gabriel Marcel, Raymond
Grandärticle Aron, Fessard et Kojève. En distinguant ces cinq figures ou plutôt en
reconnaissant que la force de leur intelligence et de leur personnalité les
distinguait, je ne souhaite pas ignorer des individualités aussi intéressantes
que Paul Ricœur, Jean Hyppolite, le P. Dominique Dubarle, Henri
Lefebvre et d'autres que j'ai soit observées, soit rencontrées brièvement. Je
n'ai pas fait la connaissance de Merleau-Ponty, qui est mort avant que
Kojève ait eut l'occasion de me présenter à lui. À cette période, je n'ai pas
établi de contacts personnels avec Emmanuel Levinas et n'ai pas eu non
plus une idée claire de ses conceptions philosophiques, mais j'assistai à sa
soutenance de doctorat d'État et découvris en lui une personnalité impo-
sante à l'égard de laquelle ses examinateurs manifestèrent une déférence
inhabituelle. Je n'ai jamais vu Erich Weil mais ai une fois demandé à
Kojève ce qu'il en pensait. La réponse s'est limitée à un jugement négatif
sur le livre de Weil, Hegel et VÉtat.
En écrivant cette chronique, j'ai eu l'occasion de réfléchir une fois de
plus à une question qui m'embarrasse depuis bien des années. Le niveau de
la splendeur philosophique à Paris a-t-il décliné depuis la période des
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
années soixante jusqu'à la présente décennie ? Y a-t-il plus d'affectation
rhétorique ou seulement une rhétorique d'une espèce différente ? Je ne suis
pas le grand admirateur en Amérique des modèles de discours postmo-
dernes, mais je les préfère à la rhétorique marxiste du début des années
soixante. Derrida, Deleuze et Michel Serres, quand ils donnent le meilleur
d'eux-mêmes, ne sont pas radicalement inférieurs à Lukács (qui n'était pas
parisien, bien sûr, mais dont la présence se faisait beaucoup sentir
en 1960), à Goldmann et à Althusser. Dans ce contexte, je puis seulement
suggérer que les marxistes et les postmodernes réagissent de deux manières,
presque diamétralement opposées l'une à l'autre, à la même crise fonda-
mentale, à savoir l'apparent échec des Lumières dans la première partie du
XXe siècle. On ne devrait pas faire de comparaison entre les années soixante
et les années quatre-vingt-dix en se fondant seulement sur les adaptations à
succès d'une rhétorique politique légitime, mais plutôt en tenant compte
du sérieux et de la rigueur avec lesquels se trouve formulé le problème
fondamental par les meilleurs représentants des deux périodes.
Une manière de faire comprendre mon point de vue sur cette question
est de dire que je considère Nietzsche et Heidegger comme des penseurs
plus profonds que Marx. En revanche, Marx, malgré ses intentions révo-
lutionnaires à l'égard de la vieille Europe, incarne quelque chose de sa 205
largeur de vues et de sa lucidité qui n'est pas présent chez Heidegger et qui
chez Nietzsche est obscurci par sa tendance à l'emphase et au flou de « Kojève à Pans.
l'expression conceptuelle. Kojève est unique dans mon expérience parce Chronique »
que le vernis peu convaincant de marxisme (on pourrait presque dire S. Rosen
d'imbécillité spenglérienne) qui défigurait ses discours et ses écrits était
contrebalancé, sinon entièrement dissous, par une ouverture d'esprit slave
qui était unie au cerveau le mieux rempli et le plus agile que j'aie eu le
plaisir d'observer.
Je glisse ici une remarque à propos du style de cette chronique. Il s'agit
précisément d'une chronique et non pas d'un traité de métaphysique
systématique. Kojève en est le thème principal, mais dans ma symphonie
son apparition est préparée par une série de figures introductives. Il joue
ainsi dans cette chronique exactement le rôle que lui et ses proches amis,
Leo Strauss et Gaston Fessard, ont joué dans ma vie, qui a consisté inévi-
tablement en un effort pour me concilier le présent au moyen dune
recherche du temps perdu1 .
1. Les mots en italique sont en français dans le texte.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Si Ton met de côté la rhétorique excessive ou vulgaire du marxisme
d'une part et celle du postmodernisme de l'autre, je crois que nous
pouvons dire qu'aucun de ces deux moments de la culture philosophique
parisienne, les années soixante ou les années quatre-vingt-dix (et ce sont
là, bien sûr, des limites chronologiques artificielles, définies par mon
expérience et non par l'esprit du monde), ne l'emporte sur l'autre. Tous
deux sont des moments également sérieux et également nécessaires d'une
dialectique plus vaste, à laquelle il a été fait allusion ci-dessus, et cons-
tituée, telle que je la représente, par le destin des Lumières. Le postmoder-
nisme semble plus important pour nous par ce que c'est le mouvement
qui nous concerne aujourd'hui1. Cela augmente les dangers qu'il nous fait
courir, dont on reconnaît maintenant généralement qu'ils consistent en la
dissolution du sujet et de l'objet ou dans le remplacement du texte par un
gribouillage incohérent. Ce sont là des dangers, mais leur caractère dange-
reux n'annule en rien le sérieux de l'échec rencontré par le rationalisme
traditionnel, échec que l'on peut proprement tenir pour responsable des
pires excès du postmodernisme.
Pour autant que je puisse en juger, on peut raconter une histoire
semblable à propos du domaine de la recherche philosophique. Malgré
206 force récriminations exprimées de nos jours par les universitaires contre la
dégradation radicale de l'enseignement supérieur, surtout en ce qui
Grand article concerne les études littéraires (récriminations que l'on entend aussi bien
en Allemagne qu'en Angleterre), j'ai personnellement l'impression que la
recherche est florissante dans le Paris d'aujourd'hui, en grande partie à
cause de l'influence salutaire de Pierre Aubenque, qui a été pendant de
nombreuses années (il a récemment pris sa retraite) le centre d'un cercle
exceptionnellement large de chercheurs hautement compétents. L'excel-
lence de cette recherche est, à mon sens, de temps à autre atténuée par un
parti pris heideggérien, mais on doit aussi dire que l'influence d'Hei-
degger n'a pas peu contribué à redonner vie à l'étude de l'histoire de la
philosophie à Paris. Tout compte fait, je ne saurais dire que la recherche y
a radicalement décliné au cours des trente-cinq dernières années. Il y a
quelques lacunes, mais je ne suis pas sûr que l'on puisse autant les imputer
à une dégradation de la situation qu'au flux et reflux ordinaire des affaires
humaines.
Néanmoins quelque chose manque. Je déduis cela en partie de ce qui
1 . En anglais : « Postmodernism looks weightier to us today because it is our moment. »
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
sera considéré par beaucoup comme une préférence pour la culture philo-
sophique démodée de l'Europe d'avant la seconde guerre mondiale. Quoi
qu'il en soit, il y avait une largesse d'esprit chez les « étoiles » de la généra-
tion précédente qui a trop souvent été remplacée par le narcissisme et
quelquefois même la folie chez leurs successeurs d'aujourd'hui. L'excen-
tricité a pris la place de la grandeur d'âme et l'affectation rhétorique
prétend souvent être de l'originalité de pensée. Je crois que la principale
raison de cette dégradation est évidente : le rejet très général du paradigme
traditionnel du philosophe comme étant une personne de Bildung univer-
selle. Il y a eu un glissement dans notre conception de la sagesse, comme il
apparaît peut-être très manifestement dans le monde anglophone, où le
mot a acquis un sens péjoratif et ironique. Cela m'entraînerait trop loin
de discuter les raisons de ce glissement. Essayons au lieu de cela, de décrire
le Stimmung ou l'état d'esprit1 caractéristique de la conception ancienne.
Il y a un instant, j'ai utilisé l'expression « grandeur d'âme ». Si on la prend
strictement au sens aristotélicien de megalopsuchia, le terme est trompeur.
Il ne serait pas non plus assez précis de parler d'une allure aristocratique,
bien que cette expression contienne un élément de ce que j'ai à l'esprit.
Les meilleurs représentants de la formation européenne d'entre les deux
207
guerres avaient été imprégnés d'un mélange de courtoisie et de liberté ;
être philosophe, c'était pour eux avoir des idées fortes que l'on pouvait
défendre avec compétence et élégance, mais des idées aussi qui étaient le « Kofeve à Pans.
fait d'un esprit libre plutôt qu'elles ne maintenaient ou liaient l'esprit Chronique »
S. Rosen
dans le carcan d'une idéologie, ou même pire qu'elles ne conduisaient à se
donner de faux airs de liberté.
Je reconnais tout de suite que ce que je viens de dire est inadéquat, mais
au moins cela indique la bonne direction. Essayons une autre formula-
tion. Les manières, l'humour de bon aloi, l'ironie modulée par un enjoue-
ment bon enfant étaient l'expression d'une noblesse de l'intelligence et de
l'esprit et non pas celle de l'aristocratie de la classe ou de la richesse. Au
lieu de cela, aujourd'hui on rejette la noblesse, on célèbre la technique
plutôt que l'universalité et on transforme l'éloge de la liberté en une idéo-
logie qui restreint l'idée plutôt qu'elle ne l'amplifie. L'ensemble de traits
caractérisant l'époque précédente plongeait ses racines dans l'héritage
culturel européen. Déraciné de ce terreau, l'esprit d'aujourd'hui a vu sa
liberté dépérir. Je veux souligner que ce « changement de paradigme »
1. En anglais : « attunement of the spirit ».
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
n'est pas dû à la science et à la technique en tant que telles, mais plutôt à
une conception différente et plus étroite de la relation entre philosophie et
science. Il suffit de comparer les écrits de Cantor, de Brouwer et de Gödel
avec la philosophie des mathématiques actuelle ou ceux de Bohr,
d'Heisenberg et de Weizsäcker avec les travaux récents en philosophie de
la physique pour mesurer la différence.
Inutile de dire que je me suis efforcé de décrire deux types ou deux
paradigmes généraux, et non pas leurs nombreuses exceptions respectives.
Et, à n'en pas douter, les archétypes les plus achevés de l'ancien modèle
n'étaient pas sans défauts. L'exemple le plus pertinent en l'occurrence est
Kojève lui-même. Avant que je ne consacre directement mon attention à
ce dernier, disons quelques mots des quatre autres penseurs qui m'ont
particulièrement impressionné en tant que produits d'une civilisation
maintenant disparue.
Parmi les quatre, c'est sur Koyré que j'ai le moins à dire, non que je ne
le tienne en haute estime, mais parce que c'est lui que j'ai vu le moins
souvent. C'était un homme d'une grande distinction et un chercheur
lucide, érudit, rationnel et poli. La seule chose qui semblait lui manquer,
c'était la mania philosophique. Je ne fus pas surpris d'apprendre que, bien
208 que ce fut lui qui avait invité Kojève à faire des cours sur Hegel à l'École
des Hautes Études au début des années trente, les relations entre les deux
Grand article hommes n'étaient plus maintenant très bonnes. Kojève m'apprit que
Koyré pensait qu'il lui avait emprunté sa doctrine sur le lien entre le chris-
tianisme et la naissance de la science moderne, mais je soupçonne que la
personnalité singulière de Kojève et son charisme infiniment plus grand
avaient éveillé un sentiment de rivalité qui se développait sur un plan où
Koyré ne pouvait pas concourir.
Certains lecteurs seront peut-être surpris que j'inclue Gabriel Marcel
dans ma liste de cinq noms et je me dois de dire d'emblée que je connais
fort peu ses travaux philosophiques. Le seul passage qui me reste à l'esprit
est un commentaire qu'il fait quelque part sur la Révolution française.
Marcel accepte sans réserves la liberté et la fraternité, mais observe que
l'égalité est un concept difficile. Ou du moins c'est ce que j'en ai retenu.
Mon hommage va à l'homme, à sa personnalité vivante et à son intelli-
gence acérée tout autant qu'à sa grande générosité à l'égard de philosophes
plus jeunes. Je l'ai vu en privé une fois ou deux et j'ai fréquenté son salon
à quelques autres occasions où j'avais été invité à donner une communica-
tion. Je ne pourrais pas dire que j'éprouvais de la sympathie pour les idées
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
politiques de Marcel qui faisaient l'objet principal des conversations dans
son salon. Son cercle se composait pour l'essentiel d'épouses conserva-
trices de riches banquiers et industriels catholiques. Je me souviendrai
toujours d'avoir monté l'escalier conduisant à son appartement de la rue
de Tournon peu après que de Gaulle eut donné son indépendance à
l'Algérie. Le vestibule résonnait des accents de la voix de Marcel lisant son
editorial hebdomadaire (je ne sais plus pour quel journal) : « Général de
Gaulle, Je ne vous aime pas ! » Impossible de reproduire par écrit la
passion et l'emphase avec lesquelles cette réplique était déclamée. Et pour-
tant, Marcel était un ami de Fessard et d'Aron, et ce fait même parle en sa
faveur. Il était également à l'abri des préjugés idéologiques du jour et,
malgré son âge avancé, avait un esprit étonnamment délié et plein de fraî-
cheur face aux idées nouvelles. Il est aujourd'hui, dans une large mesure,
oublié et je veux m'en souvenir comme d'un être humain supérieur doué
d'une grande culture.
Raymond Aron n'a, je le présume, pas besoin d'être présenté aux
lecteurs de cette chronique. Je me bornerai à citer quelques impressions
personnelles à propos de cet homme peu commun. Il va sans dire qu'il
était hautement intelligent, extrêmement spirituel et d'une rare vivacité
d'esprit. Il avait été l'un des auditeurs réguliers du séminaire de Kojève sur 209
la Phénoménologie au cours des années trente, et les deux hommes étaient
restés de très bons amis. À la différence de beaucoup d'intellectuels pari- «Kojève à Pans.
siens, y compris, malheureusement, Kojève lui-même (mais pas Fessard), Chronique »
S. Rosen
Aron était politiquement sain. Le bilan de son opposition à la corruption
par le marxisme de la pensée politique et philosophique est exceptionnel
par son courage et sa lucidité. C'est le cas aujourd'hui, mais ce l'était
encore plus dans les années soixante. Il convient aussi de noter qu'Aron
considérait Kojève comme l'être humain le plus intelligent qu'il ait jamais
rencontré, jugement qu'il répète dans ses mémoires. Aron était un esprit
philosophique, mais, alors que je le trouvais plus stimulant que Koyré, il
me semblait souffrir de limites analogues. Aron était trop raisonnable
pour succomber à la mania philosophique. Sur ce point, il faisait plus
penser à Leo Strauss qu'à Kojève, bien que la comparaison entre lui et
Strauss fut erronée à divers titres. Strauss avait pénétré beaucoup plus
profondément qu'Aron la surface des choses ; d'une manière qui n'était
pas cependant si entièrement différente de Kojève, il était parvenu assez
tôt à des points de vue politiques exagérés (c'est là un jugement que parta-
geait Aron).
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Parmi les cinq hommes à propos desquels j'ai choisi de faire des
commentaires plus spécifiques, le P. Fessard était, à mon avis, l'être
humain le plus grand. Qu'il soit aujourd'hui quasiment inconnu dans le
monde anglophone, même chez ses confrères jésuites, n'est pas surprenant
vu le style et le contenu originaux de ses écrits qui constituaient invaria-
blement un mélange de philosophie et de théologie. Il était une figure
controversée dans son ordre et, en particulier, en France où il appartenait
à une génération d'esprits remarquables qui comprenait également Henri
de Lubac et Teilhard de Chardin. La controverse portait essentiellement
sur l'intention manifestée par Fessard de réécrire la théologie catholique
en prenant Kirkegaard, Hegel et même Marx comme fondement philoso-
phique en lieu et place de saint Thomas. Fessard était également célèbre
en France en raison des pamphlets qu'il avait écrits contre les nazis durant
la seconde guerre mondiale sous le pseudonyme de M. X... De ses débats
religieux et théologiques je ne mentionnerai que sa longue polémique
contre le mouvement des prêtres-ouvriers. Il n'était marxiste à aucun titre
et pourtant il était en même temps considéré par Kojève comme virtuelle-
ment la plus grande autorité sur Marx en France.
Fessard est le cas le plus remarquable dans mon expérience de quel-
210 qu'un qui unissait en lui les vertus du prêtre et du philosophe. Mon
éducation me poussait à croire qu'un mélange de ce genre était impos-
Grand artick sible. Fessard m'a enseigné le contraire par son exemple personnel. Par sa
lucidité et sa promptitude d'esprit, sa capacité à intégrer sur-le-champ des
idées étrangères à ses propres croyances et par ce mélange singulier de
profondeur et de simplicité enfantine qui marque les penseurs de premier
rang, Fessard surpassait tous ceux que j'ai vus à Paris à la seule exception
de Kojève. On pouvait dire qu'il acceptait le Christ tandis que Kojève
n'acceptait que sa propre personne. Mais les deux hommes sollicitaient
toutes les fibres de leur être spirituel pour produire un logos de leur foi.
J'en viens, ou plutôt j'en reviens, à Kojève lui-même. Mes remarques
seront de nouveau entièrement impressionnistes, comme disent les socio-
logues ; ceux qui sont en quête d'une analyse érudite de ses écrits devront
chercher ailleurs. Le problème avec la plupart des exégèses savantes des
« textes » de Kojève que j'ai vues, c'est qu'elles traitent celui-ci comme un
savant collègue qui doit être jugé selon les normes objectives de l'étude
universitaire de Hegel (comme si ces normes étaient bien connues et que
ces commentateurs les maîtrisaient parfaitement). Ceux qui prennent ce
chemin critiquent Kojève pour son arbitraire et vont même jusqu'à
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
conclure qu'il était lui-même une sorte de philosophe de café ou de
farceur, extrêmement talentueux, mais que Ton ne peut en dernière
analyse prendre vraiment au sérieux.
Au demeurant, Kojève a indéniablement contribué pour une très
large part à légitimer cette appréciation. Son interprétation de Hegel est
arbitraire et philologiquement infondée, malgré le fait (somme toute
inexpliqué par ses critiques universitaires orthodoxes) qu'il reste le meil-
leur en tant qu'il est l'auteur du livre le plus philosophique jamais écrit
sur Hegel, pour autant que j'aie pu en juger. Kojève, certes, avait
quelque chose du farceur, bien qu'il ne fût certainement pas un philo-
sophe de café. Il détestait les intellectuels tout autant que les professeurs
et passait le plus clair de ses heures de loisir, m'a-t-il dit, en compagnie
de prêtres. En plus, il était le deuxième homme le plus important du
gouvernement français, venant tout de suite après de Gaulle lui-même.
« De Gaulle prend les décisions concernant les relations avec la Russie et
h force de frappe »' m'a dit une fois Kojève. « Moi, Kojève [ainsi se dési-
gnait-il habituellement lui-même], je décide de tout le reste. » Cette
affirmation à première vue extravagante m'a été sur le principe
confirmée lors de conversations directes avec des parangons de sobriété
tels que Raymond Aron et André Philip, le chef de la représentation 211
française auprès du GATT.
Kojève était ce que j'ai décrit ailleurs comme le Mycroft Holmes du « Kojbe à Paris.
gouvernement français. Son bureau se trouvait au ministère des Affaires Chronique »
étrangères, Section économique, où il conseillait le ministre, Robert S. Rosen
Marjolin, qui avait été son étudiant dans les années trente. Mais il était
aussi le principal conseiller de la représentation diplomatique française
auprès du GATT et il rejoignait régulièrement le siège des Nations Unies
où il était le porte-parole de son gouvernement pour les affaires économi-
ques. De plus, il avait un réseau de disciples dans la haute fonction
publique française. Tout cela malgré le fait qu'il n'avait jamais officielle-
ment étudié l'économie ni certainement bénéficié d'aucune formation
universitaire en sciences politiques et encore moins d'aucune expérience
politique directe. Il maîtrisait les dialectes tibétains, la mécanique quan-
tique, la mystique russe, l'histoire de l'art et une vaste palette d'autres
disciplines. Et il était la personnalité la plus respectée et la plus crainte du
monde philosophique parisien. Je donne cette liste abrégée de ses talents
1. « Force de frappe » : en français dans le texte.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
parce qu'ils sont incompatibles avec l'idée, en partie générée par sa propre
conduite, que Kojève était un poseur superficiel et vain, que l'on ne
pouvait comparer en matière de Spizfindigkeit ou de compréhension de
Hegel avec les représentants sérieux de l'establishment universitaire. Il
convient aussi de préciser que Kojève était admiré au plus haut degré par
des gens comme Leo Strauss et Jacob Klein qui n'étaient pas spécialement
généreux lorsqu'il s'agissait de faire l'éloge de leurs contemporains, mais
aussi par des figures telles que Smart Hampshire et Sir Isaiah Berlin ; les
circonstances ont voulu que je me trouve en situation d'organiser une
rencontre entre Berlin et Kojève ; quant à Hampshire, il m'a un jour parlé
d'un groupe londonien de lecture dont il était membre et qui avait
consacré beaucoup de temps à l'étude du commentaire de Kojève sur la
Phénoménologie,
Je suis persuadé que ces remarques permettront de mesurer pourquoi il
est important de réfléchir soigneusement à la nature de Kojève. Nous
sommes maintenant prêts pour l'orchestration complète du thème prin-
cipal. Permettez-moi, cependant, en guise de préliminaire, de sacrifier un
instant au côté plus léger de cette chronique. Bien que j'aie vu Kojève en
maintes occasions et pendant des laps de temps relativement longs,
212
j'éprouve de grandes difficultés à me rappeler exactement les traits de son
visage. Cela ne peut être dû à une défaillance de ma mémoire visuelle. Par
Grand article exemple, je n'ai vu Karl Löwith qu'une fois, pendant une durée de
quarante-cinq minutes et pourtant j'ai un vif souvenir de son aspect. Le
lecteur trouvera peut-être ma suggestion frivole, mais je crois que la diffi-
culté que j'éprouve à me remémorer le visage de Kojève vient de ce qu'il y
avait dans son ossature et dans sa démarche quelque chose qui me rappe-
lait T. S. Eliot. Mes contacts avec le grand poète ont été tout à fait brefs et
de nature entièrement banale. Lorsque j'étais étudiant de troisième cycle à
Chicago, je fus employé quelque temps comme serveur au restaurant de la
faculté (connu sous le nom de Quadrangle Club). Un après-midi, Robert
Maynard Hutchins, Julian Huxley, T. S. Eliot et un spécialiste des caries
dentaires, le vice-président de l'Université, qui se nommait, je pense,
Ralph Wendell Harrison, entrèrent dans la salle et s'installèrent dans la
partie où je servais. Je fus pétrifié d'effroi. Hutchins, un homme très
grand, superbe et qui avait l'air arrogant, ne fit rien pour me rassurer
lorsqu'il ouvrit le feu en me montrant du doigt sa tasse à café et me dit :
« Est-ce que vous voyez cette tasse ? Faites en sorte qu'elle soit toujours
pleine ! » Je saute directement au moment le plus critique de l'affaire. Les
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
quatre convives avaient commandé des escalopes de veau panées et je n'en
apportai que trois parts. Toute ma vie j'entendrai Hutchins me crier à
travers la salle : « Serveur, une escalope de plus ! »
Que les freudiens fassent ce qu'ils veulent de cette histoire. J'accepte
tout. Quant à Eliot, il resta silencieux d'un bout à l'autre du repas, penché
sur ses diverses assiettes, et surtout avec son profil saisissant dangereuse-
ment proche de l'immersion dans le potage, ne prêtant même pas atten-
tion lorsque je lui demandai sotto voce si je pouvais lui servir un peu plus
de café. Le visage d'Eliot, je m'en souviens parfaitement. Kojève était
somme toute une version slave de T. S. Eliot. Et pourtant, cela est
absurde ; Kojève ne me faisait pas peur et il n'était ni sinistre, ni taciturne.
Au moment où j'écris ces lignes, ses traits commencent à émerger des
souvenirs brumeux du passé. Ses pommettes étaient plutôt hautes et ses
joues un peu creuses ; son nez n'avait rien de celui d'Eliot, étant beaucoup
plus droit. Il portait de lourdes lunettes à monture d'écaillés et fumait sans
arrêt, agitant un fume-cigarette en parlant. Son pas était pesant et ses bras
longs ; c'était sur ce point, comme pour les lunettes, que la ressemblance
avec Eliot me frappait. Ou du moins c'est ce dont je me souviens. Voilà
donc comment son image se détache de ce qui est pour moi son sosie.
Pour m'intéresser maintenant à sa personnalité, je veux d'abord parler 213
de la différence entre les philosophes et les professeurs. Kojève était géné-
ralement considéré à Paris comme un homme d'une arrogance inhabi- « Kojke à Pans.
tuelle et, en un sens superficiel, c'est là, à n'en pas douter, un jugement Chronique »
S. Rosen
correct. Kojève ne tolérait pas volontiers les imbéciles. Si quelqu'un ne
l'intéressait pas, il pouvait être bourru, voire grossier. Cela est sans doute
un défaut, mais qui ne nous amène pas au cœur du sujet. Les dialogues de
Platon montrent à l'évidence que Socrate, en dépit de son urbanité
attique, pouvait être impitoyable envers les prétentieux et les vaniteux. Par
sa simple présence, Socrate constituait un défi existentiel pour ceux qui
s'enorgueillissaient de leur sagesse ou de leur savoir. Je ne veux pas dire
que Kojève était au même niveau que Socrate. Mais sa supériorité vis-à-vis
de ses contemporains était aussi manifeste.
Socrate est décrit dans les dialogues comme étant à la recherche de
jeunes gens prometteurs afin de les interroger. À de rares exceptions près,
Kojève ne recherchait personne ; c'était les gens qui recherchaient sa
compagnie. Si les auspices étaient bonnes, Kojève était direct, ouvert,
amical et attentif aux idées de son visiteur. Je me suis laissé dire que la
spontanéité est une caractéristique du tempérament slave. Peut-être en
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
est-il ainsi. Je trouve plus plausible l'argument selon lequel les professeurs
souffrent de la vanité induite par des décennies d'auditoires captifs et la
recherche d'honneurs professionnels. L'âme professorale devient étriquée
par suite d'une vie consacrée à un domaine spécial d'étude ou à
l'application d'une technique particulière. Mais Kojève était un haut
fonctionnaire et les professeurs pouvaient aussi être des philosophes.
Disons simplement que le mélange de spontanéité slave et de liberté vis-à-
vis des coutumes de la vie universitaire donnait à la nature philosophique
de Kojève un espace où se déployer. On entrait directement en conversa-
tion avec lui, et je veux dire par là que la conversation, et non les conve-
nances, était le moyen de l'échange social.
Il y avait, cependant, chez lui un côté peu satisfaisant et même décon-
certant qui se manifestait très clairement dans ces défauts que sont
l'exagération ainsi que le désir d'épater le bourgeois1 et qui défigurent ses
textes écrits (il ne publiait pas lui-même de livres ; ceci a été fait par
d'autres qui ont édité ses notes de cours ou ses manuscrits). Tandis que
Kojève était entièrement cordial et attentif à l'égard de ses visiteurs favoris
et que les conversations avec lui n'étaient jamais des conférences mais
d'authentiques échanges, il manquait rarement de répandre autour de lui
214 une suprême aura de confiance en lui-même et de supériorité vis-à-vis de
tous, qui, justifiée ou non, portait tort à ladite supériorité. Je ne reproche
Grand article pas à Kojève la perception qu'il avait de sa propre valeur et je ne
m'attendrais pas non plus à voir quelqu'un d'une nature aussi remar-
quable que la sienne cacher ses vertus derrière un faux voile d'humilité. Ce
que j'essaie de montrer, c'est que Kojève avait une manière théâtrale de
cacher sa supériorité par un jeu d'ironie presque constant, parfois exprimé
verbalement, mais qui souvent se réduisait à une esquisse de sourire, un
mouvement du fiime-cigarette ou un clin d'œil.
Comme je l'ai déjà indiqué, Kojève parlait régulièrement de lui-même
en utilisant son propre nom, introduisant telle ou telle déclaration hété-
rodoxe par la formule (rituelle) : « X dit ceci ou cela, mais moi, Kojève, je
dis ... » II affirmait souvent sa supériorité en se désignant lui-même
comme un dieu, bien qu'il ait une fois nuancé cette assertion en ajoutant
que son secrétaire riait lorsqu'il exprimait cette prétention. Plus irritante,
cependant, était son habitude de me rappeler que « les Américains joue
avec des balles, tandis que moi, Kojève, je joue avec des gens ». Pour être
1. En français dans le texte.
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
honnête, je trouvais cela très amusant et impressionnant en ce temps-là et
il m'importe peu de savoir si Kojève m'accordait vraiment sa confiance ou
jouait avec moi. La prémisse de notre conversation était que, s'il allait sans
dire qu'il était le maître et moi l'étudiant, la raison pour laquelle il me
permettait de converser avec lui était que je méritais d'être son étudiant.
J'insiste sur ce point parce que je pense que c'est important pour
comprendre la nature de Kojève. Cela n'a rien à voir avec mon amour-
propre mais avec le degré auquel Kojève était un philosophe authentique
ou, peut-être plus précisément, avec ce que cela veut dire d'être un philo-
sophe authentique, plutôt qu'un professeur ou un homme d'État célèbre.
Il y a deux manières dont les individus très doués jouent avec les gens. La
première, c'est en essayant de les faire entrer dans leur jeu et par là de les
élever au-dessus de leur niveau habituel. La seconde, c'est de leur rappeler
sans cesse que l'on joue avec eux. Kojève était un joueur qui pratiquait ces
deux méthodes, mais tandis que la première était sa vertu, la seconde était
son vice. À mon avis, cette façon de jouer était une expression du mécon-
tentement qu'il éprouvait à l'égard de ses propres limites, lorsqu'il se
comparait non pas à ses interlocuteurs, ni certainement à moi, mais aux
figures de l'histoire mondiale qu'il souhaitait égaler et parmi lesquelles
l'individualité dominante était naturellement celle de Hegel. 215
Comme on le sait bien, Kojève soutenait que l'histoire au sens philoso-
phique du terme s'est terminée avec Hegel et que ne restait rien d'autre à « Kojève à Paris.
faire pour ses successeurs que de clarifier certains points du système absolu Chronique »
S. Rosen
et de jouer leurs rôles respectifs dans la réalisation de l'État mondial
universel. Selon une célèbre formule, ces rôles trouvaient leur apogée dans
l'amour physique ou l'accomplissement de la cérémonie japonaise du thé.
Ceci n'est pas le lieu pour une exégèse savante de l'interprétation donnée
par Kojève de Hegel ou de l'histoire du monde. Il s'agit d'une chronique
et la nature de cet exercice me permet de parler de quelque chose de plus
important que d'absurdes doctrines philosophiques. J'estime que les
thèses de Kojève sur la fin de l'histoire (et donc également de la philo-
sophie) sont sa version de la réponse donnée par Leo Strauss au dilemme
auquel font face ceux qui aspirent à la philosophie, mais sont loin de
parvenir au plus haut niveau de puissance intellectuelle et spirituelle.
Selon Strauss la philosophie consiste à rechercher continuellement les très
rares solutions plausibles aux problèmes fondamentaux, et non à prôner
avec conviction une solution unique pour chaque problème. Je dis à
nouveau : peut-être en est-il ainsi. Mais les plus grands philosophes ne se
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
sont pas limités à examiner les réponses possibles aux questions fonda-
mentales. Ils ont répondu à ces questions, et ce même lorsque la réponse
prenait la forme de questionnements supplémentaires. Je veux dire par là
que Ton ne peut pas soulever les questions fondamentales si l'on ne
connaît pas les fondements, et c'est ce savoir-là qui est l'essence de la
philosophie. Si l'on connaît les fondements, alors les réponses aux ques-
tions fondamentales deviennent moins importantes que l'expression
correcte des questions elles-mêmes. Mais on doit pouvoir décrire les
fondements.
Kojève m'a dit un jour que Strauss et lui étaient les deux penseurs
authentiquement originaux de leur époque parce que, tandis que les
autres affirmaient l'originalité de leurs propres idées, Kojève soutenait
l'enseignement de Hegel et Strauss défendait celui de Platon. Prises au
pied de la lettre, ces paroles n'ont pas ou peu de sens ; des hégéliens et des
platoniciens on en trouve, pour ainsi dire, à la pelle. Je pense que Kojève
voulait plutôt dire quelque chose comme ceci. Strauss et lui avaient
compris l'impossibilité de la philosophie au sens grandiose ou tradi-
tionnel, mais réagissaient différemment par rapport à cette reconnais-
sance. Pour Strauss, l'impossibilité de déterminer les réponses correctes
216 aux questions fondamentales nous laissait la tâche d'essayer de trouver les
questions. Pour Kojève, la même impossibilité est le fondement de la
Grand article liberté humaine. Nous sommes libres d'inventer nos propres réponses aux
questions qui sont considérées comme fondamentales parce qu'elles moti-
vent la problématique même de la nature philosophique. Pour Kojève, les
réponses inventées sont son interprétation de Hegel, au sens le plus large
d'une interprétation quasi hégélienne de la totalité de l'histoire humaine.
Les questions, ou plutôt la question, auxquelles répond l'interprétation,
c'est ce dont le désir humain est en quête.
L'une des leçons les plus importantes que je dois à Kojève, bien que ce
ne fut pas son intention, c'est que le réalisme et le rationalisme poussés à
leur extrême logique aboutissent à une reductio ad absurdum. Pour envi-
sager la même question à partir d'une perspective différente, on peut dire
qu'en 1960 la situation politique était encore d'une importance centrale
pour les philosophes qui assignaient à l'Europe un rôle de médiation entre
les États-Unis et la Russie dans la construction de l'avenir. J'ai cité plus
haut la conviction partagée par les Français et les Britanniques qu'ils
pouvaient les uns et les autres jouer le rôle d'Athènes par rapport à la
Rome américaine. La version donnée par Kojève de cette croyance était
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
une variante du gaullisme. Kojève et de Gaulle considéraient la classe diri-
geante américaine comme anglophile et donc comme non seulement
intrinsèquement naïve, mais influencée aussi par la culture inférieure des
Anglais. Disons que dans cette perspective les Américains étaient des
Goths ou des Vandales et les Anglais des Romains. Kojève acceptait cela,
comme le prouve sa répétition fréquente de la thèse d'Heidegger
mentionnée ci-dessus selon laquelle il n'y a pas de différence entre les
Russes et les Américains. Pour de Gaulle et Kojève, c'était la France qui
devait jouer le rôle décisif dans l'équilibre des puissances, et, de façon à
contrebalancer l'influence britannique sur les Américains, la France devait
s'appuyer sur la Russie.
C'était là aussi, je le répète, la version kojévienne de l'anti-
américanisme fondée sur un réalisme poussé jusqu'à l'absurdité et ainsi
transformé en cynisme et en idéologie. Néanmoins, elle plongeait ses
racines dans la perception du monde historique et politique réel et était
fondée sur la supposition qu'il existe un lien entre la théorie et la pratique
qui peut être exploité par le philosophe de manière positive. En d'autres
termes, la politique de Kojève était suffisamment proche du gaullisme
pour s'enraciner dans la pensée politique européenne traditionnelle.
Kojève, malgré tout son discours sur la fin de l'histoire et l'homme post- 217
philosophique, essayait encore de purifier et donc de préserver l'Europe
moderne. Son postmodernisme était au mieux un idéal régulateur et au « Kojbe à Paris.
pire une fantaisie rhétorique conçue pour choquer. Dans la génération de Chronique »
S. Rosen
penseurs qu'il a influencés, cependant, le réalisme et le traditionalisme
de Kojève ont disparu avec le gaullisme ; ce qui est resté, c'est la rhéto-
rique exagérée. La responsabilité du pouvoir politique réel a été remplacée
par l'invitation irresponsable et réitérée à détruire ; à ce point, le
nietzschéisme d'Heidegger s'est avéré être une influence capitale.
Kojève a transcendé non seulement ses contemporains, mais également
ses étudiants. J'ajouterai ma voix à celles des autres qui l'ont qualifié de
personne la plus intelligente qu'ils aient jamais connue. Si je semble avoir
mis l'accent sur les éléments faibles de sa personnalité, ce n'est pas en
vertu d'un désir quelconque de diminuer mon maître et ami, mais en
faisant effort pour le comprendre. La leçon la plus importante qu'un
philosophe peut léguer à ses étudiants est celle de sa propre nature. Les
livres du philosophe peuvent être lus dans les bibliothèques, mais la
nature de l'esprit philosophique, qui seul donne sens et valeur à ces livres,
n'est accessible qu'à travers le contact direct. On ne peut comprendre ce
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
que c'est d'être un philosophe sans saisir comment les fragilités humaines
sont transformées en forces par l'éros philosophique. Là où cette transfor-
mation n'a pas lieu, il y a aussi une leçon valable à recueillir.
Le dernier degré de liberté intellectuelle et spirituelle manquait chez cet
être supérieur, à mon avis parce qu'il était au fond un sceptique au sens
moderne du mot et très proche du nihilisme. Ne disposant pas d'un
système authentique ou n'ayant pas la capacité socratique d'exister philo-
sophiquement dans l'absence, et même de promouvoir l'impossibilité des
systèmes, Kojève fut conduit à construire un pseudo-système d'une
complexité sans cesse croissante et, assez étrangement chez un penseur qui
haïssait les universitaires, d'une rigidité scolastique.
Reformulons cette hypothèse. Parce qu'il n'était pas philosophe au sens
classique de ce terme, Kojève a tourné ses énergies vers ce qu'il y a de
mieux après cela, à savoir une existence d'homme politique, que les excen-
tricités de l'histoire lui ont permis de vivre à un niveau international.
Selon mes suppositions, il a tourné son attention vers le jeu sérieux consis-
tant à instituer une révolution philosophico-politique, ou à démontrer sa
nature divine en devenant l'un de ceux que Nietzsche appelle les chefs et
les législateurs de l'humanité, en d'autres termes, le philosophe authen-
218 tique (mais, dans ce cas, pas à travers la philosophie authentique). Je dis
« pas à travers la philosophie authentique » parce que Kojève lui-même ne
Grand article dissimulait pas le fait que son interprétation de Hegel, et donc de
l'histoire européenne, était mue par le but pratique d'influencer cette
histoire, et non pas par ce qui était pour lui un objectif impossible : celui
de parvenir à une compréhension théorique de la nature qui ne soit pas
confirmée par l'histoire elle-même.
À cette hypothèse que je viens de faire on pourrait objecter que pour un
hégélien la théorie est de fait confirmée par la pratique et donc que Kojève
agissait d'une manière directement hégélienne en essayant de susciter
l'avènement de ce qu'il nommait l'état mondial homogène ou universel,
le paradigme pour ce qui était depuis peu devenu la tristement célèbre
« fin de l'histoire ». J'ai déjà déclaré explicitement que j'écris une chro-
nique, et non une étude savante. Mon hypothèse n'a d'autre fondement
que les méditations que je poursuis depuis plus de trente-cinq ans sur
Kojève en tant qu'homme et que penseur. J'en suis venu à la conclusion
que mon intuition initiale, formée au cours de mon année d'étude et de
mes contacts hebdomadaires avec lui, était correcte : le système de Kojève
est indigne de son intelligence et même de ses commentaires éclairants sur
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
la Phénomologie. Non seulement cela, mais je crois également qu'il était
conscient du manque de valeur de ce système ou du moins en avait le
soupçon, ou bien encore qu'il en avait été conscient un jour, mais s'était
ensuite autorisé à l'oublier en s'enivrant de son propre succès.
En bref, Kojève nous offre l'étrange spectacle d'un esprit philosophique
de capacités exceptionnellement élevées qui passe son temps à s'amuser
lui-même comme seule alternative à l'impossibilité de la philosophie
authentique. Je veux dire immédiatement que, malgré toute son affecta-
tion, le jeu de Kojève était beaucoup plus éclairant que le travail sérieux de
presque tous les philosophes professionnels que j'ai eu l'occasion de
connaître personnellement. Je le répète : Kojève était un génie et non pas
un charlatan. Mais c'était un génie qui avait des failles. Il était à la fois
trop conscient, aux deux sens - le bon et le mauvais - de cette expression1
pour se perdre authentiquement dans un système et (je le répète) pas assez
conscient pour exister sans système.
L'ironie et l'enjouement de Kojève affectaient ses rapports personnels,
même avec ceux qu'il aimait véritablement. Sur un point, cependant, il
était sans pareil. Cet intellect extraordinaire était froid et distant avec
maintes célébrités parisiennes qui cherchaient à attirer son attention, mais
vis-à-vis des étudiants qui venaient le voir de la part de Strauss et qui satis- 219
faisaient peu ou prou à ses normes d'acuité, il était ouvert, direct, doux
lorsqu'il appliquait ses corrections et gracieux lorsqu'il acceptait une « Kojève à Paris.
critique plausible. Cette ouverture et ce manque de prétention ou même Chronique »
S. Rosen
de sens des règles (au-delà des exigences minimales de la politesse bour-
geoise) étaient peut-être dus à sa nature slave, mais je les ai trouvés égale-
ment chez les ressortissants vraiment supérieurs et hautement cultivés des
nations d'Europe de l'Ouest. Ajoutons simplement que je me sentais plus
à l'aise avec Kojève qu'avec tout autre personne, sauf le P. Fessard.
L'ouverture et la réceptivité de Kojève s'amoindrissaient périodiquement
quand il semblait se souvenir qu'il était, après tout, un dieu, et donc
requis de faire quelque remarque choquante. Ce n'était pas le cas avec
Fessard, qui était lui aussi bien conscient de ses talents personnels remar-
quables, mais qui était protégé contre la vanité par la perception corréla-
tive de la distance qui le séparait de son Dieu.
1 . L'expression anglaise « too self-conscious » utilisée ici a les deux sens opposés de « conscient
des limites de tout système » et de « trop prétentieux pour sacrifier toute caractéristique person-
nelle à la rigueur du concept ». « Not self-conscious enough » dans la deuxième partie phrase
signifie : « pas assez sûr de lui-même ».
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
En concluant ces remarques, je veux laisser au lecteur une impression
positive de Kojève. Il était Tun de ces rares individus qui nous ont
enseigné autant par leurs défauts que par leurs vertus. On ne peut éman-
ciper l'esprit philosophique sans risque. Cela est aussi vrai des rares
personnes douées que des nombreuses autres, bien que les risques soient
pris à différents niveaux et même dans des registres différents. Repenser à
Kojève pendant toute ma vie d'adulte m'a aidé à comprendre qu'il n'y a
pas d'unité entre la théorie et la pratique ou bien, si l'on formule les
choses plus prudemment, qu'il n'y a pas d'unité théorique entre les deux.
C'est là exactement le contraire de ce que Kojève cherchait à m'enseigner,
mais je le suis pour toujours redevable.
(Traduit de l'américain
par Jean-Louis Breteau.)
220
Grand article
This content downloaded from
24.160.133.227 on Wed, 21 Jun 2023 01:41:04 +00:00
All use subject to https://about.jstor.org/terms
Vous aimerez peut-être aussi
- Veyne - Le Pain Et Le Cirque Sociologie Historique Dun Pluralisme PolitiqueDocument894 pagesVeyne - Le Pain Et Le Cirque Sociologie Historique Dun Pluralisme Politiquepablosar8617050% (2)
- De la tyrannie et Correspondance, Leo Strauss et Alexandre Kojève: Les Fiches de Lecture d'UniversalisD'EverandDe la tyrannie et Correspondance, Leo Strauss et Alexandre Kojève: Les Fiches de Lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Marie-Hélène Bourcier - Queer Zones. Politiques Des Identités Sexuelles, Des Représentations Et Des SavoirsDocument242 pagesMarie-Hélène Bourcier - Queer Zones. Politiques Des Identités Sexuelles, Des Représentations Et Des SavoirspolicissePas encore d'évaluation
- Message Poétique Du SymbolismeDocument84 pagesMessage Poétique Du SymbolismeAlis Elena BUCUR100% (1)
- Ziller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleDocument321 pagesZiller, Carlos (1995) - L'Harmonie Du Monde Au XVIIe SiecleLucas Santos100% (1)
- Alain Renaut Sartre, Le Dernier Philosophe Le College de Philosophie 1993Document236 pagesAlain Renaut Sartre, Le Dernier Philosophe Le College de Philosophie 1993Murat Muratoğlu100% (1)
- La Composition Des Mondes Entretiens Avec Pierre Charbonnier by Descola - Philippe - Z Lib - Org - 1Document320 pagesLa Composition Des Mondes Entretiens Avec Pierre Charbonnier by Descola - Philippe - Z Lib - Org - 1Jairo Rocha100% (2)
- Jean Rousset Dernier Regard Sur Le Baroque. Petite Autobiographie D'une Aventure PasséeDocument13 pagesJean Rousset Dernier Regard Sur Le Baroque. Petite Autobiographie D'une Aventure Passéeze_n6574Pas encore d'évaluation
- Entre Amis Pierre Bourdieu PDFDocument6 pagesEntre Amis Pierre Bourdieu PDFFlorea IoncioaiaPas encore d'évaluation
- BARBARAS, R. Sartre - Désir Et LibertéDocument190 pagesBARBARAS, R. Sartre - Désir Et Libertémalcom100% (1)
- Homme As TresDocument902 pagesHomme As Tresdavid scoote ADKINSPas encore d'évaluation
- De La Guerre en Philosophie by Lévy, Bernard Henri Z Lib OrgDocument66 pagesDe La Guerre en Philosophie by Lévy, Bernard Henri Z Lib OrgJohnaël VALERINPas encore d'évaluation
- Vargas Llosa 4 Discours de M. Mario Vargas Llosa VF 17hDocument20 pagesVargas Llosa 4 Discours de M. Mario Vargas Llosa VF 17hdiegocqaPas encore d'évaluation
- Rousseau, Citoyen Du FuturDocument183 pagesRousseau, Citoyen Du Futurdagois100% (1)
- Gershom Scholem - Du Frankisme Au JacobinismeDocument99 pagesGershom Scholem - Du Frankisme Au JacobinismeAl SimsimahPas encore d'évaluation
- Maurice Godelier - Au Fondement Des Sociétés Humaines (2007, Albin Michel)Document222 pagesMaurice Godelier - Au Fondement Des Sociétés Humaines (2007, Albin Michel)Junior Wantie100% (2)
- ROBIN, Regine - Nous Autres, Les AutresDocument354 pagesROBIN, Regine - Nous Autres, Les AutresRodrigo FonsecaPas encore d'évaluation
- Jacques - Heers - L'histoire - AssassinéeDocument134 pagesJacques - Heers - L'histoire - AssassinéeCydcyd100% (3)
- Saint Louis Jacques Le GoffDocument1 044 pagesSaint Louis Jacques Le GoffabbayedonezanPas encore d'évaluation
- Sartre Desir Et LiberteDocument0 pageSartre Desir Et LiberteDajana100% (3)
- (Petite Bibliothèque) Héloïse Lhérété (Editor) - Michel Foucault - L'homme Et L'œuvre. Héritage Et Bilan Critique-Sciences Humaines (2017) PDFDocument171 pages(Petite Bibliothèque) Héloïse Lhérété (Editor) - Michel Foucault - L'homme Et L'œuvre. Héritage Et Bilan Critique-Sciences Humaines (2017) PDFricherPas encore d'évaluation
- Une Tout Autre Histoire by Elisabeth de Fontenay (Fontenay, Elisabeth De)Document186 pagesUne Tout Autre Histoire by Elisabeth de Fontenay (Fontenay, Elisabeth De)Jean-Paul Friedrich NgabuPas encore d'évaluation
- GuinzburgDocument26 pagesGuinzburgvibessa100% (1)
- Alexandre Kojève Et Eric Weil PDFDocument17 pagesAlexandre Kojève Et Eric Weil PDFFrankPas encore d'évaluation
- OnfrayDocument64 pagesOnfrayAmine Ouss100% (1)
- Armand ColinDocument18 pagesArmand ColinYoussef YouussefPas encore d'évaluation
- Du Jour Au Lendemain: Les Raisons D'une DésaffectionDocument8 pagesDu Jour Au Lendemain: Les Raisons D'une DésaffectionPierrePachetPas encore d'évaluation
- Maurice Maueu Jean Borreil La Raison de LautreDocument208 pagesMaurice Maueu Jean Borreil La Raison de LautreTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Biographique PDFDocument172 pagesBiographique PDFРадост МихайловаPas encore d'évaluation
- Léon Poliakov, Le Mythe Aryen (1971)Document316 pagesLéon Poliakov, Le Mythe Aryen (1971)Yi SUN-SIN100% (2)
- AfrocentrismDocument27 pagesAfrocentrismsadamer123Pas encore d'évaluation
- Bernard Sichere Cinquante Ans de Phi Lo Sophie FrancaiseDocument31 pagesBernard Sichere Cinquante Ans de Phi Lo Sophie FrancaisemarxpauloPas encore d'évaluation
- Cheikh Hamidou Kane: Aventure AmbiguëDocument6 pagesCheikh Hamidou Kane: Aventure AmbiguëJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- La Negritude Est-Elle Vraiment Un HumanismeDocument13 pagesLa Negritude Est-Elle Vraiment Un HumanismeBéthel MalukisaPas encore d'évaluation
- Sternhell - Zeev - Aux Origines D'israël - Entre-Nationalisme-Et-SocialismeDocument617 pagesSternhell - Zeev - Aux Origines D'israël - Entre-Nationalisme-Et-SocialismeGuilherme FreitasPas encore d'évaluation
- E Tudes de Philosophie Ancienne Et de Philosophie ModerneDocument602 pagesE Tudes de Philosophie Ancienne Et de Philosophie ModerneBreno Gomes100% (2)
- Le Kant À Soi de Gérard Lebrun - Libération PDFDocument3 pagesLe Kant À Soi de Gérard Lebrun - Libération PDFqsfqsfgsqfgsPas encore d'évaluation
- Entretien Avec Jacques LE GOFFDocument12 pagesEntretien Avec Jacques LE GOFFDionisos LudendiPas encore d'évaluation
- La Nef marrane: Essai sur le retour du judaïsme aux portes de l'OccidentD'EverandLa Nef marrane: Essai sur le retour du judaïsme aux portes de l'OccidentPas encore d'évaluation
- LE GOFF - Georges DubyDocument12 pagesLE GOFF - Georges DubyormrPas encore d'évaluation
- CANTIMORI, Delio. ''La Periodizacion de La Época Renascentista'' - In. Los Historiadores y La HistoriaDocument2 pagesCANTIMORI, Delio. ''La Periodizacion de La Época Renascentista'' - In. Los Historiadores y La HistoriaDaniel Magalhães Porto SaraivaPas encore d'évaluation
- Marcel Détienne - Rentrer Au VillageDocument13 pagesMarcel Détienne - Rentrer Au VillageEduardoHenrikAubertPas encore d'évaluation
- Le Libertinage de Molière Et La Portée de Dom Juan - R. LespireDocument31 pagesLe Libertinage de Molière Et La Portée de Dom Juan - R. LespireMrnPas encore d'évaluation
- Microphysique Des Poyvoirs Et Micropolitique Des DesirsDocument16 pagesMicrophysique Des Poyvoirs Et Micropolitique Des DesirsMarco SpagnuoloPas encore d'évaluation
- socco_1150-1944_1990_num_1_1_940Document41 pagessocco_1150-1944_1990_num_1_1_940Levent UnsaldiPas encore d'évaluation
- RicoeurDocument74 pagesRicoeurBreak Focus100% (1)
- Chestov WeilDocument24 pagesChestov Weilredvelvetmask2343Pas encore d'évaluation
- Mythes Et Littérature by Frédéric Monneyron Joël Thomas (Monneyron, Frédéric Thomas, Joël)Document73 pagesMythes Et Littérature by Frédéric Monneyron Joël Thomas (Monneyron, Frédéric Thomas, Joël)Mélissa Ould AmerPas encore d'évaluation
- Bollack - La Grèce de Personne Les Mots Sous Le MytheDocument496 pagesBollack - La Grèce de Personne Les Mots Sous Le MytheCarsten MadsenPas encore d'évaluation
- Occultiste Aux XVIII Et XIX Siècles. Édit. A Faivre. LouvainDocument3 pagesOccultiste Aux XVIII Et XIX Siècles. Édit. A Faivre. LouvainUsalamaPas encore d'évaluation
- Écriture Féminine Au XXème Et XXIème SiècleDocument67 pagesÉcriture Féminine Au XXème Et XXIème SiècleLouise AllemeerschPas encore d'évaluation
- Paul Ricoeur Une Herméneutique de La Condition Humaine by Domenico JervolinoDocument92 pagesPaul Ricoeur Une Herméneutique de La Condition Humaine by Domenico JervolinoJamaa AboussaberPas encore d'évaluation
- 9782307380108Document19 pages9782307380108Antonin MbaPas encore d'évaluation
- Collected Papers I the Problem of Social Reality by Alfred Schutz (Auth.), Maurice Natanson (Eds.) (Z-lib.org)Document403 pagesCollected Papers I the Problem of Social Reality by Alfred Schutz (Auth.), Maurice Natanson (Eds.) (Z-lib.org)Garrett NelsonPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Revue de Métaphysique Et de MoraleDocument2 pagesPresses Universitaires de France Is Collaborating With JSTOR To Digitize, Preserve and Extend Access To Revue de Métaphysique Et de MoraleElkouch HassibPas encore d'évaluation
- Le Voyage de L'âme Dans L'au-Delà D'après La Littérature LatineDocument716 pagesLe Voyage de L'âme Dans L'au-Delà D'après La Littérature LatineKORGANCHPas encore d'évaluation
- Le Désir de Participation, David BerlinerDocument20 pagesLe Désir de Participation, David BerlinerIoana Miruna VoiculescuPas encore d'évaluation
- Le Neveu de Rameau de Denis Diderot: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Neveu de Rameau de Denis Diderot: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Hermétique de Pernéty (1787) Enseigne Que Les Philosophes Ont Donné (Le NomDocument7 pagesHermétique de Pernéty (1787) Enseigne Que Les Philosophes Ont Donné (Le NomDanilo Santos RochaPas encore d'évaluation
- Fiche 10ADocument1 pageFiche 10AJosé AntonioPas encore d'évaluation
- Phrases ComplexesDocument3 pagesPhrases Complexesstanic jeremyPas encore d'évaluation
- Analyse Lenquete Sur Lentendement Humain Section V de David Hume 1 PDFDocument21 pagesAnalyse Lenquete Sur Lentendement Humain Section V de David Hume 1 PDFMARIUSPas encore d'évaluation
- Revue de Philosophie Du Neant Et de L AmDocument57 pagesRevue de Philosophie Du Neant Et de L Amdame nianPas encore d'évaluation
- La GrammaticalisationDocument20 pagesLa GrammaticalisationIdir MazighPas encore d'évaluation
- Les Plus Beaux Miracles de La Vierge 000000441Document179 pagesLes Plus Beaux Miracles de La Vierge 000000441GESPIOX100% (1)
- Resumer Du Livre Le Deuxième Sexe Par Simone de BeauvoirDocument1 pageResumer Du Livre Le Deuxième Sexe Par Simone de BeauvoirzakariakhatibPas encore d'évaluation
- COMME UN ROMAN de DANIEL PENNACDocument2 pagesCOMME UN ROMAN de DANIEL PENNACAsma MouhibPas encore d'évaluation
- Marginalia 64Document30 pagesMarginalia 64Norbert SpehnerPas encore d'évaluation
- Les Motivations Des PME Pour La RSE Au MarocDocument22 pagesLes Motivations Des PME Pour La RSE Au MarocIdriss DarkouchPas encore d'évaluation
- CréoleDocument13 pagesCréolemkmvnrjxysPas encore d'évaluation
- Exercice S Probab I LiteDocument30 pagesExercice S Probab I LitetakeshirohPas encore d'évaluation
- C.O. Le Modèle de Nagle Et Sanders PDFDocument4 pagesC.O. Le Modèle de Nagle Et Sanders PDFASlopPas encore d'évaluation
- La NegationDocument4 pagesLa NegationtequilaPas encore d'évaluation
- Maitrise de Son Argumentation Orale Pour Convaincre 032019 0Document7 pagesMaitrise de Son Argumentation Orale Pour Convaincre 032019 0BrownPas encore d'évaluation
- Des Noms DivinsDocument5 pagesDes Noms Divinsmariane_romaoPas encore d'évaluation
- Notions de Logique Corrige Serie D Exercices 1Document15 pagesNotions de Logique Corrige Serie D Exercices 1Brahim SAMAOUIPas encore d'évaluation
- ModalisateursDocument2 pagesModalisateursMouad ChoummaPas encore d'évaluation
- Roussillon - Agonie Clivage Et SymbolisationDocument358 pagesRoussillon - Agonie Clivage Et SymbolisationJoão Pedro Peçanha100% (1)