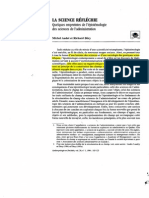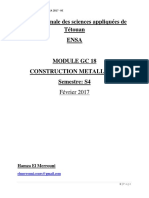Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Epistémologie I - 2021
Transféré par
lm.d0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues10 pageslass
Titre original
Epistémologie I_2021
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentlass
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
17 vues10 pagesEpistémologie I - 2021
Transféré par
lm.dlass
Droits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Epistémologie 1
1. Qu’est-ce que l’épistémologie ?
1.1. Tentatives de définition de l’épistémologie
Quoique le terme d’épistémologie soit récent, puisque l’on n’en trouve nulle occurrence avant
le 19e siècle, ses usages sont parfois ambigus et ont pu varier selon les contextes théoriques. Il
fut vraisemblablement introduit en langue anglaise (epistemology) pour la première fois dans
un contexte métaphysique par James Frederick Ferrier (1855) en tant que traduction de
l’allemand, « doctrine de la science », selon le sens spécifique que prend cette expression chez
Johan Gottlieb Fichte. Force est de constater que cet emploi du mot, intimement lié à des
réflexions sur le statut du sujet connaissant issues de l’idéalisme allemand, ne correspond
nullement aux usages actuels de la notion d’épistémologie.
Son apparition en français en 1901 dans la traduction par Louis Couturat de l’Essai sur les
fondements de la géométrie de Bertrand Russell, puis quelques années plus tard chez Emile
Meyerson (Identité et réalité, 1908), ne permet pas d’en formuler une définition précise.
Meyerson identifiait l’épistémologie à la philosophie des sciences, ce qui n’est pas vraiment en
accord avec l’emploi du terme epistemology en anglais. En 1926, André Lalande, dans son
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, traite l’usage anglais de manière
condescendante en remarquant que celui-ci fait violence à la langue grecque car il applique à
différentes « théories de la connaissance » un vocable qui devrait selon lui être réservé à l’étude
philosophique des sciences et de leur histoire, ce qui correspond au demeurant à la manière de
procéder de la tradition épistémologique française.
Ces ambiguïtés terminologiques pourraient être le reflet de quelques polémiques, mais elles
traduisent surtout une grande diversité d’approches d’un même paysage conceptuel.
Ce n’est donc qu’au début du 20e siècle que l’épistémologie apparait comme champ
disciplinaire spécifique. Ceux qui se sont essayés à en donner une définition s’appuient en
général sur l’étymologie du terme. Ils soulignent ainsi qu’ « épistémologie » est la combinaison
de deux mots grecs : épistèmé, qui signifie science, connaissance, savoir ; et logos, qui veut dire
discours, langage, jugement. L’épistémologie est ainsi, selon les cas, soit une étude sur la
science, soit une étude sur la connaissance.
Les anglophones privilégient la seconde de ces deux possibilités : ils emploient pour la plupart
epistemology comme synonyme de « théorie de la connaissance ». Les francophones
comprennent épistémologie en un sens plus étroit : ils l’utilisent uniquement pour qualifier la
réflexion sur la connaissance spécifiquement scientifique, réservant l’expérience de « théorie
de la connaissance » à l’étude de la connaissance en général (scientifique et non scientifique).
L’épistémologie interroge la nature et la valeur des principes, des concepts, des méthodes, et
des résultats des sciences. Ceci lui confère deux caractéristiques majeures :
- Elle est un discours réflexif, c’est-à-dire un discours faisant retour sur les sciences.
L’épistémologie présuppose donc la science et vient forcément après elle.
- Elle est un discours critique : elle ne se contente pas de décrire les sciences sans les juger ; elle
s’emploie de surcroît à discuter du bien-fondé et de la portée des propositions et des méthodes
scientifiques.
L’épistémologie étant un discours sur les sciences, il conviendra :
- De spécifier la nature du discours considéré (est-il philosophique ? scientifique ? quels sont ses
moyens ?
- De caractériser l’objet de ce discours (que faut-il entendre par « science » ? quelles disciplines
concrètes range-t-on dans la catégorie de science ?
1.2. Science et sciences
On oppose souvent la science et les sciences comme deux objets possibles de l’épistémologie.
Au premier abord, les liens sémantiques entre la science et les sciences semblent triviaux. Parler
de la science au singulier, c’est se référer à l’idée générale de scientificité. Mentionner les
sciences au pluriel, c’est sous-entendre l’existence d’une multitude de disciplines qui d’un côté
diffèrent, de l’autre sont semblables en ce qu’elles sont des instanciations particulières de l’idée
de science. L’on ne voit pas dans ces conditions pourquoi il y aurait lieu d’opposer le pluriel et
le singulier.
Selon L. Soler, l’opposition entre la science et les sciences est en fait tout d’abord née d’un
reproche adressé aux philosophes des sciences, qui s’exprime schématiquement dans un
raisonnement du genre suivant : les usages linguistiques conduisent à appeler « sciences » de
très nombreuses disciplines , qui à y regarder de plus près, apparaissent très spécifiques, voire
irréductibles les unes aux autres ; ils imposent par ailleurs un certain concept général de science,
une certaine idée de ce qui est la science au singulier ; or cette idée de science n’est en fait
qu’un leurre, un idéal nulle part réalisé, une fiction inventée par les philosophes des sciences.
Les épistémologues doivent donc cesser de raisonner sur un objet qui n’existe que dans leur
imagination, bannir toute référence à la science au singulier, et se focaliser enfin sur les sciences
réelles dans toute leur diversité.
A quoi peut-on répliquer ? D’accord pour étudier les sciences telles qu’elles se font réellement
et pour tenir compte des différences de domaine et de méthode qui les séparent ; mais ceci
n’implique nullement qu’il n’y ait aucun sens à parler de science au singulier ; d’abord parce
qu’il n’est pas certain qu’il soit impossible de mettre en évidence, entre les diverses disciplines
scientifiques réelles ou au moins entre certaines d’entre elles, un air de famille susceptible de
servir de point de départ à une définition générale de la science, ensuite parce qu’il peut être
intéressant de prendre en compte et de caractériser l’idéal de scientificité qui vaut à une époque
donnée, même s’il n’est pas nulle part concrètement incarné. Dans ces conditions, il n’y a plus
de problème à parler de la science au singulier. Il suffit seulement de veiller à bien préciser le
statut d’un tel concept.
1.3. Les deux types d’approche épistémologique
L’épistémologie peut s’intéresser de manière privilégiée à la science en général ou à l’une
quelconque des sciences particulières.
Dans le premier cas, elle est épistémologie générale : elle interroge la signification du concept
de science ; elle se demande quelles sont les méthodes proprement scientifiques ; elle propose
éventuellement des critères de scientificité permettant d’une part de démarquer la science
authentique des pseudo-sciences, d’autre part de préciser la spécificité des sciences par rapport
à d’autres modalités culturelles.
Dans le second cas, elle est épistémologie régionale : elle se focalise sur telle ou telle discipline
scientifique et, sous forme parfois très technique, fournit une caractérisation détaillée de son
objet, de ses concepts et de ses méthodes propres ; analyse et discute ses hypothèses
fondamentales ; évalue le degré de fiabilité de ses résultats.
Ainsi présentée, la distinction entre épistémologie générale et épistémologie régionale semble
seulement recouvrir deux approches potentiellement complémentaires, l’une globale et l’autre
locale. Mais elle est en fait bien souvent conçue comme une opposition entre deux espèces
incompatibles d’épistémologie, corrélat de l’opposition entre la science et les sciences.
Dans cette manière de voir, l’épistémologie générale, très décriée, est accusée de prendre pour
objet une pure fiction (la science au singulier) et est présentée comme un ramassis de généralités
non seulement creuses, mais de plus inexactes, œuvre de philosophes à la fois impérialistes et
défaillants d’un point de vue méthodologique. L’épistémologie régionale se voit au contraire
louée de prendre pour objet la « science telle qu’elle se fait » et de démontrer le caractère erroné
des conclusions de l’épistémologie générale. Les plus radicaux des régionalistes récusent toute
possibilité d’énoncer des généralités pertinentes sur les sciences, et soutiennent qu’il n’y a alors
d’épistémologie authentique que régionale.
Epistémologie générale et épistémologie régionale désignent ici non plus deux orientations
méthodologiques ayant vocation à entrer en dialogue, mais bien deux manières irréconciliables
de pratiquer l’épistémologie. Il semble toutefois plus fécond de concevoir les études régionales
comme le point de départ d’une épistémologie comparative de niveau supérieur qui, tout en ne
niant pas la singularité de chaque science, aurait en charge d’apporter des éléments de réponse
à la question de l’unité de la science.
2. En quel sens les sciences de l’homme et de la société sont-elles des sciences ?
L’épistémologie doit poser la question de la définition et du statut de l’objet d’étude de
disciplines qui prétendent à la scientificité. Cette question donne lieu à des difficultés
spécifiques lorsque l’être humain cherche à se prendre lui-même pour objet de connaissance.
Pouvons-nous vraiment étudier les actions d’individus ou de groupes humains de façon
objective ? Ne sommes-nous pas naturellement tentés d’interpréter les comportements de nos
semblables en leur octroyant immédiatement un sens influencé par notre éducation, notre
culture, nos idéaux ou par les innombrables interactions de notre vie quotidienne ? La
connaissance de l’homme par lui-même, qui se présente comme un objectif affiché de la
réflexion philosophique depuis l’Antiquité, peut-elle relever de la science ? Et si telle est le cas,
le discours explicatif des sciences de la nature est-il adapté à l’étude des réalités humaines ou
bien celles-ci requièrent-elles la mise en œuvre d’une méthode originale ?
L’expression ambiguë de « sciences humaines », employé dans le contexte universitaire
francophone depuis la Seconde Guerre mondiale, risque d’occasionner des confusions. Car la
logique, les mathématiques ou la physique sont des disciplines tout aussi « humaines» que la
psychologie ou la sociologie, bien qu’elles ne prennent pas l’Homme pour objet d’étude direct.
2.1. L’opposition sciences de la nature/ sciences de l’homme et de la société
Les sciences de la nature traite du fonctionnement interne de la nature animée ou inanimée.
Elles isolent notamment des successions constantes de phénomènes, appelés lois de la nature.
De telles lois sont supposées indépendantes du sujet humain qui s’emploie à les connaître, ainsi
que de la société à laquelle appartient ce sujet.
Quant aux sciences de l’homme et de la société, elles étudient les comportements humains et
les structures sociales qui en constituent le cadre. Notons d’emblée qu’il est souvent malaisé de
séparer nettement deux niveaux, l’un, individuel, qui relèverait exclusivement des sciences de
l’homme, l’autre, collectif, dont traiteraient plus spécialement les sciences de la société.
L’expression « sciences humaines » est d’ailleurs parfois utilisée comme un terme générique
pour désigner l’ensemble des disciplines opposées aux sciences de la nature. C’est qu’il s’agit
toujours d’étudier diverses dimensions de l’homme en ce qu’elles ont de spécifiquement
humain. L’homme est par exemple, comme tout animal, doté d’un corps régi par certaines lois
de fonctionnement interne ; à ce titre, il est l’objet de la biologie, mais n’intéresse aucune des
sciences humaines.
2.2. L’opposition sciences dures/ sciences molles
L’opposition sciences dures/sciences molles n’est pas à placer sur le même plan que les
précédentes, dans la mesure où elle repose essentiellement, quant à elle, un jugement de valeur :
parler de sciences « molles » est évidemment péjoratif. Le vocabulaire employé suggère qu’il
y a d’un côté les vraies sciences (soit un prestigieux ensemble de disciplines nobles, de
méthodes fiables et de résultats incontestés) ; de l’autre, des sciences au rabais (soit une série
disparate de pratiques discutées, de méthodes douteuses et de résultats largement débattus).
Cette opposition entre sciences dures et sciences molles coïncide globalement avec l’opposition
entre, d’un côté, sciences de la nature et sciences formelles, et de l’autre, sciences humaines et
sociales. La physique, unanimement considérée comme la reine des sciences empiriques, est
presque toujours érigée en paradigme de sciences dures. Psychologie, sociologie et économie
sont, du point de vue dominant, les « plus dures » des sciences molles.
Malgré les différences d’appréciation qui subsistent quand on rentre dans les détails, on
s’accorde en général à reconnaître que les sciences « molles » ne peuvent prétendre ni au même
degré de rigueur, de formalisation et d’axiomatisation, ni au même niveau d’efficacité
prédictive que les sciences dures. Ces dernières ont en outre des retombées techniques et
pratiques plus tangibles et maîtrisées.
2.3. La méthode expérimentale
La comparaison entre les sciences de la nature et les sciences de l’Homme et de la société
conduit souvent à constater l’impossibilité d’une application rigoureuse de la méthode
expérimentale aux phénomènes culturels, sociaux et psychiques qui occupent ces dernières
disciplines. La méthode expérimentale requiert en effet non seulement de simples observations,
mais en outre des observations susceptibles d’être reproduites à l’identique par différentes
personnes à différents moments. La possibilité d’un contrôle public et la substituabilité des
expérimentateurs garantit l’objectivité de la liaison constante établie entre un ensemble de
causes et un ensemble d’effets.
Or il va de soi que de nombreux savoirs relatifs à l’être humain ne sauraient satisfaire de telles
conditions. Ainsi l’irréversibilité du cours du temps proscrit-elle la reproduction d’évènements
dont il importe d’établir l’objectivité à une date donnée à partir de témoignages et de documents
dont la fiabilité doit être établie dans le cadre d’une enquête passant par une vérification des
sources de la connaissance historique.
Si E. Durkheim entendait faire de la sociologie une science rigoureuse en « considérant les faits
sociaux comme des choses », en les observant « en eux-mêmes, détachés des sujets conscients
qui se les représentent », c’est-à-dire en défendant la possibilité d’une application du principe
de causalité aux phénomènes sociaux, la « sociologie compréhensive » de M. Weber caractérise
, quant à elle, les interactions sociales par un sens que le chercheur doit dans une première phase
de sa démarche identifier en adoptant une vision empathique, la mise en avant de relations
causales ne pouvant intervenir qu’au terme de l’investigation menée.
La fameuse « querelle des méthodes » que connue l’Université allemande à partir des années
1880 et qui devait s’étendre à toutes les disciplines que nous qualifions des sciences de
l’Homme et de la société, portée précisément sur cette question de savoir si les sciences prenant
pour objet les comportements et les représentations humaines doivent ou non adopter une
méthode irréductible au modèle explicatif des sciences de la Nature.
C. Menger affirmait qu’il est possible d’atteindre, dans le domaine des phénomènes humains,
des lois exactes en adoptant la démarche déductive et formelle des sciences de la Nature, G.
Von Schmoller lui reprochait de méconnaitre la complexité des individus réels, le contexte
historique de leurs échanges économiques, ainsi que la contingence des actions humaines.
2.4. La neutralité axiologique
Les sciences de l’homme et de la société doivent-elles se contenter de formuler des jugements
de fait ou doivent-elles aboutir à des jugements de valeur ? Ne risquent-elles, dans ce cas, de
prendre la forme de discours idéologiques plutôt que scientifiques ?
Initialement proposée par M. Weber à propos de l’attitude des enseignants à l’Université, la
notion de « neutralité axiologique » est régulièrement invoquée pour défendre l’idéal d’un
savant libre qui transcenderait par son souci d’objectivité tout débat partisan. Néanmoins, une
rupture entre le travail scientifique respectant les méthodes savantes et destiné à des savants et
l’engagement public pourrait s’avérer néfaste dans la mesure où elle ne permettrait plus à la
société de bénéficier pleinement des recherches scientifiques dont elle fait l’objet.
La reconnaissance de cette difficulté devait conduire P. Bourdieu à dépasser la simple exigence
de neutralité pour définir une attitude critique liée à la conscience du fait que celui qui occupe
une position déterminée dans l’espace social et dans le champ de production scientifique au
sein duquel il construit ses discours prend inéluctablement position sur son objet d’étude, ne
serait-ce que d’une façon implicite ou indirecte. Mais comment s’assurer que la prise de
position du chercheur résulte bien de la rigueur de ses analyses plutôt que de son histoire
personnelle ou des positions qu’il est susceptible d’occuper au sein de la société et du champ
universitaire ?
Rompant avec la croyance en une science pure qui progresserait à travers les efforts d’une
« communauté scientifique » indépendante de toute influence extérieure, P. Bourdieu n’a pour
autant jamais renoncé à l’idée d’un progrès de la raison. Le développement des connaissances
requiert néanmoins que les chercheurs en science de l’Homme et de la société adoptent une
attitude réflexive, par laquelle le sociologue s’est longtemps efforcé de définir sa démarche
critique. Pour P. Bourdieu, la production du savoir est déterminée par un espace structuré et
potentiellement conflictuel au sein duquel chaque chercheur occupe une position définie, de
sorte qu’une véritable « science de la science » ne saurait opposer une analyse interne, réservée
à l’épistémologie.
3. Qu’est-ce qu’un fait scientifique (p : 119, Vernant)
Dans le langage courant, dire d’une situation ou d’un évènement que c’est un « fait » revient à
affirmer ce dont il est question s’est effectivement produit, peut ou néanmoins pu être constaté,
de sorte qu’il paraît difficile de remettre en cause sa réalité. D’une manière analogue, les
scientifiques pourront appeler « faits » tous les phénomènes avérés, faisant l’objet d’une entente
intersubjective à l’issue d’une procédure de vérification ou de contrôle expérimental. Ainsi
comprise, la notion de fait désigne un contenu empirique certain ou la situation décrite par un
énoncé vrai. Est-ce dire que les faits puissent constituer de pures données empiriques que la
science se contenterait de décrire de façon précise et objective ? Dans quelle mesure peut-on
alors dire que les faits sont eux-mêmes construits par la science ?
3.1.Entre données empiriques et constructions symboliques
La difficulté que renferme la notion de fait scientifique tient à ce qu’elle semble à la fois
renvoyer à de pures données à l’aune desquelles pourraient être évaluées les hypothèses ou
théories et à des constructions artificielles mettant notamment en jeu un procès de traduction de
notre expérience perceptible en formules symboliques. La question de savoir dans quelle
mesure les situations effectives figurées par les énoncés scientifiques sont données ou
construites recevra des réponses différentes selon que l’on adopte une théorie de la
connaissance rationaliste ou empiriste.
Alors que le rationalisme, sous ses différentes formes, peut tenir les résultats de l’observation
pour secondaires ou affirmer que la raison n’aperçoit dans la nature que ce qu’elle produit elle-
même selon ses propres plans, anticipant l’observation avec des principes qui déterminent ses
jugements selon des lois constantes, l’empirisme conduit à considérer les faits de simple
observation comme les sources de toute connaissance rigoureuse.
La tâche fondamentale de la science serait de découvrir de nouveaux faits, c’est-à-dire d’opérer
des constats précis dans des circonstances définies, pour intégrer leur description aux systèmes
théoriques dont dispose le chercheur. Il n’y aurait aucune différence de nature entre les
jugements de fait que nous produisons quotidiennement - comme : « il pleut » ou « il y a un
stylo rouge sur la table » - et les énoncés résultant de la recherche scientifique – comme : « la
Lune est un satellite de la Terre ». On peut certes distinguer parmi les énoncés de la science
entre les faits et les lois, les premiers se caractérisant par leur singularité alors que les lois
seraient par nature générales.
L’empirisme moderne présentera en ce sens la description de faits singuliers simples comme
l’objectif de la construction d’un ensemble d’énoncés protocolaires, c’est-à-dire d’énoncés
primitifs susceptibles d’une vérification directe, indépendamment de leurs relations logiques à
d’autres énoncés et auxquels les énoncés théoriques devraient pouvoir être réduits. Les énoncés
protocolaires assureraient le lien entre les théories et l’expérience brute, et seraient exprimés
par « un langage protocolaire » ou « langage primaire ».
Pour prendre un exemple simple d’énoncé protocolaire proposé par Carnap, considérons la
phrase : « Il y a un stylo rouge sur la table », que chacun pourra confronter à la perception d’une
situation concrète susceptible d’être décrite par une telle formule. N’est-on pas naturellement
conduit à tenir la description mentionnée pour une possibilité de description parmi d’autres de
la situation concrète dont il est question ? Peut-il seulement y avoir perception sans
interprétation ? Non seulement l’empirisme ne peut apporter de réponses adéquates à ces
questions, mais les énoncés scientifiques se caractérisent en outre par l’usage de formules
mathématiques dont la relation aux données de la perception met nécessairement en jeu une
construction symbolique.
Quoi qu’il se présente comme le résultat d’une construction intellectuelle, le fait scientifique
est irréductible à la stricte nécessité logique, de sorte que la science moderne a pu lui attribuer
la fonction décisive de permettre de confronter notre représentation de ce qui doit être à ce qui
advient effectivement, et donc de constituer la pierre de touche permettant de trancher entre
différentes hypothèses ou théories scientifiques concurrentes.
3.2. L’expérience cruciale
C’est Francis Bacon qui, le premier, introduit en 1620, la notion d’expérience cruciale. Notons
que Bacon n’emploie pas lui-même l’expression d’« expérience cruciale ». Il parle d’ « instance
de la croix ». Selon P. Duhem, Bacon a emprunté cette expression aux croix qui, dressées aux
bifurcations, indiquent et signalent la séparation des chemins. L’image est suggestive : le
voyageur, lorsqu’il débouche sur un croisement, ne saurait quelle direction emprunter si de
telles croix ne lui venaient en aide ; de même le physicien, parvenu à un carrefour théorique, ne
saurait quelle hypothèse conserver ou rejeter si l’expérience cruciale ne lui indiquait la voie à
suivre.
Il s’agit chez Bacon d’une procédure bien précise visant à prouver absolument et définitivement
la vérité d’une hypothèse. Soit un ensemble de phénomènes dont les scientifiques cherchent à
rendre compte. Dans ce but, ils constituent un répertoire exhaustif des différentes hypothèses
explicatives rivales possibles. Nous raisonner pour simplifier sur le cas où seulement deux
hypothèses sont en compétition, et nous nous appuierons pour fixer les idées sur un exemple
emprunté à l’histoire des sciences du 19eme siècle.
Admettons les phénomènes lumineux connus puissent seulement s’expliquer à partir de l’une
ou de l’autre des deux hypothèses concurrentes suivantes : la lumière est un flux de très petits
corpuscules, ou la lumière est une onde. L’expérience cruciale suppose tout d’abord de parvenir
à déduire de chacune des deux conjectures rivales des prédictions mesurables contradictoires.
C’est chose possible dans notre exemple : si la lumière est constituée de petits corpuscules,
alors, elle doit se propager plus rapidement dans l’eau que dans l’air ; si la lumière est une onde,
c’est l’inverse qui doit être le cas.
Il s’agit ensuite de concevoir et de mettre en œuvre une expérience qui permette de trancher.
L’expérience de Foucault, qui permet d’évaluer la vitesse relative de la lumière dans l’eau et
dans l’air, apparaît à première vue comme une bonne candidate. Dans l’esprit de Bacon, le
résultat obtenu réfute forcément l’une des deux propositions en compétition, et, du coup, valide
indirectement la candidate restante. Il semble ainsi possible de prouver, au moyen d’une unique
expérience dite cruciale, non pas seulement la fausseté, mais aussi la vérité d’une hypothèse.
Telle est en substance la notion d’expérience cruciale introduite par Bacon.
3.3. Holisme épistémologique
Raisonnons sur l’exemple de la théorie newtonienne de la lumière (T). Cette théorie se
constitue autour d’une hypothèse centrale (H1) : le caractère corpusculaire de la lumière. Un
rayon de lumière s’identifie ainsi à un flux de minuscules corpuscules émis à grande vitesse par
les sources lumineuses telle que le Soleil.
Outre H1, un très grand nombre d’autres hypothèses composent par ailleurs la théorie de la
lumière de Newton (hT1, hT2, etc.). On admet par exemple (hT1) que les rayons lumineux
subissent, lors de la traversée de divers milieux (eau, air, etc.) des actions attractives ou
répulsives obéissant à des lois déterminées. L’ensemble des hT1, hT2, etc., permet de rendre
compte d’un très grand nombre de phénomènes lumineux observés, notamment de phénomènes
de réflexion et de réfraction.
Soit maintenant un physicien désireux d’éprouver la validité de l’hypothèse corpusculaire H1.
Il lui faut déduire de H1 des conséquences mesurables. Dans le cas présent, on s’attend entre
autres à ce que la lumière se propage plus vite dans l’eau que dans l’air.
Or, souligne Duhem, la déduction des conséquences mesurables fait toujours appel à d’autres
hypothèses que H1. Pour conclure par exemple que la lumière est plus rapide dans l’eau que
dans l’air , on doit certes supposer H1, mais aussi admettre hT1, hT2, hT3, etc. Bref, la
conséquence observable supposée permettre de tester H1, découle non pas de H1, seule, mais
de tout un ensemble d’hypothèse incluant H1. Telles sont les prémisses de la thèse du holisme
épistémologique.
Vous aimerez peut-être aussi
- ÉpistémologieDocument18 pagesÉpistémologieArthur HemonoPas encore d'évaluation
- Philosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie analytique: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Epistémologie. Sã©ances 1 Et 2Document5 pagesEpistémologie. Sã©ances 1 Et 2马瑞楠Pas encore d'évaluation
- EpistémologieDocument2 pagesEpistémologieAbdelbasset akradPas encore d'évaluation
- ÉpistémologieDocument27 pagesÉpistémologieAbrahamPas encore d'évaluation
- MEDIA - 8622 - La Science Et La Philosophie. Préparé Par DR Pierre Malek - WatermarkDocument3 pagesMEDIA - 8622 - La Science Et La Philosophie. Préparé Par DR Pierre Malek - WatermarkMamady Janko100% (1)
- Boris Barraud, L'Épistémologie JuridiqueDocument14 pagesBoris Barraud, L'Épistémologie JuridiqueSaddougui MedPas encore d'évaluation
- Cours Philosophie Generale EpistemologieDocument6 pagesCours Philosophie Generale Epistemologiemounir57100% (1)
- Epistemologie de Science de L'educationDocument24 pagesEpistemologie de Science de L'educationAhmad HassanPas encore d'évaluation
- Thyèse D.U.Document24 pagesThyèse D.U.BijiramunguPas encore d'évaluation
- Nas EpistémologieDocument7 pagesNas EpistémologieTala DioufPas encore d'évaluation
- Epistemologie Licence 1 2020 AoutDocument29 pagesEpistemologie Licence 1 2020 Aoutdidiermambutu100% (1)
- VAR 57351 1001 24 04 2015 - 13 24 21 - AbbyyDocument14 pagesVAR 57351 1001 24 04 2015 - 13 24 21 - AbbyyKarim BoubayaPas encore d'évaluation
- Qu'est-Ce Que La Philosophie Scolastique ? Les Notions Fausses Et Incomplètes (Suite Et Fin)Document15 pagesQu'est-Ce Que La Philosophie Scolastique ? Les Notions Fausses Et Incomplètes (Suite Et Fin)abdmisaelPas encore d'évaluation
- La Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiDocument13 pagesLa Question Philosophique de La SCIENCE Bac Blanc 2023 EnvoiSarah AmmarPas encore d'évaluation
- Audet, Déry (1996)Document20 pagesAudet, Déry (1996)marcbonnemainsPas encore d'évaluation
- PHI 207 - Théories ÉpistémologiquesDocument17 pagesPHI 207 - Théories ÉpistémologiquesanselmeazidjePas encore d'évaluation
- Cours de PhilosophieDocument6 pagesCours de PhilosophieHadji KalonjiPas encore d'évaluation
- Phi 312 Syllabus Philosophie Du LangageDocument17 pagesPhi 312 Syllabus Philosophie Du LangageMarie Noël Bella MbeitePas encore d'évaluation
- L'épistémologie JuridiqueDocument15 pagesL'épistémologie Juridiqueavocat7Pas encore d'évaluation
- Suite Du SupportDocument10 pagesSuite Du Supportsowphalia15Pas encore d'évaluation
- Philo: La ScienceDocument7 pagesPhilo: La Sciencebeebac2009100% (1)
- La Philosophie Occidentale: DéfinitionDocument6 pagesLa Philosophie Occidentale: DéfinitionKarl ZINSOUPas encore d'évaluation
- Logique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressDocument456 pagesLogique Formelle Et Logique Transcendantale 2nbsped CompressHAEGELI Lucas100% (1)
- Résumé Du SéminaireDocument16 pagesRésumé Du SéminairePierrot LongaPas encore d'évaluation
- 1 Philo Et ScienceDocument6 pages1 Philo Et Scienceomar tambedouPas encore d'évaluation
- Untitled DocumentDocument17 pagesUntitled DocumentWissal ChawqiPas encore d'évaluation
- Plan Du DevoirDocument7 pagesPlan Du Devoirlouiswiselet98Pas encore d'évaluation
- Philosophie: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandPhilosophie: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Philo Et Science PDFDocument2 pagesPhilo Et Science PDFndiaye100% (1)
- Rastier - Herméneutique Matérielle Et Sémantique Des TextesDocument32 pagesRastier - Herméneutique Matérielle Et Sémantique Des Texteskairotic100% (1)
- L’évolution, de l’univers aux sociétés: Objets et conceptsD'EverandL’évolution, de l’univers aux sociétés: Objets et conceptsPas encore d'évaluation
- Cours D'epistémologie GénéraleDocument31 pagesCours D'epistémologie Généralealfred100% (2)
- Epistemologie 180219182952Document16 pagesEpistemologie 180219182952Abdelkrim OukerroumPas encore d'évaluation
- Élements Pour Une Épistémologie de La Méthode QualitativeDocument14 pagesÉlements Pour Une Épistémologie de La Méthode Qualitativemed_kerroumi76Pas encore d'évaluation
- Une Didactique de La Philosophie Est-Elle PossibleDocument18 pagesUne Didactique de La Philosophie Est-Elle PossiblePhilippa Simões100% (1)
- Qu'Est Ce Que La GéographieDocument6 pagesQu'Est Ce Que La GéographieCherif Samsedine SARR100% (1)
- ÉpistémologieDocument10 pagesÉpistémologiebeebac2009Pas encore d'évaluation
- Poly - Introduction À La Philosophie PDFDocument41 pagesPoly - Introduction À La Philosophie PDFNeima Quele Almeida da SilvaPas encore d'évaluation
- Structuralisme: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandStructuralisme: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- ScolastiqueDocument16 pagesScolastiqueAnton CusaPas encore d'évaluation
- UNZ Mpci Cours EpistemoDocument157 pagesUNZ Mpci Cours EpistemoAlbert SamaPas encore d'évaluation
- Introduction Cours DépistémologieDocument14 pagesIntroduction Cours DépistémologieChris JeanPas encore d'évaluation
- Cours1 OPEMTleSTDocument11 pagesCours1 OPEMTleSTHonoré Kokou SodogaPas encore d'évaluation
- Granger Et La Philosophie - LacourDocument11 pagesGranger Et La Philosophie - LacourmvianneyPas encore d'évaluation
- Cours. Sociologie Et ScienceDocument19 pagesCours. Sociologie Et ScienceZAKARIA ELPas encore d'évaluation
- Le Métier de SociologueDocument9 pagesLe Métier de SociologueZou DialloPas encore d'évaluation
- Philo DissertDocument4 pagesPhilo DissertcopaincopainPas encore d'évaluation
- Savoir Afa97 2003 2006Document26 pagesSavoir Afa97 2003 2006benwarrenallianceoliPas encore d'évaluation
- Cours de Philo Domaine 1Document24 pagesCours de Philo Domaine 1Fagarou rek75% (4)
- ZZZ 3Document6 pagesZZZ 3Karl ZinsouPas encore d'évaluation
- Sémiotique Et Philosophie A Partir Et A L'encontre de Husserl Et de Carnap (Georges Kalinowski)Document297 pagesSémiotique Et Philosophie A Partir Et A L'encontre de Husserl Et de Carnap (Georges Kalinowski)Coup Lisa100% (2)
- Théorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesD'EverandThéorie, réalité, modèle: Epistémologie des théories et des modèles face au réalisme dans les sciencesPas encore d'évaluation
- Passeron - Le Raisonnement SociologiqueDocument11 pagesPasseron - Le Raisonnement SociologiquePaulo100% (1)
- Les Philosophes Des Litteraires TheseDocument419 pagesLes Philosophes Des Litteraires TheseRachid BelaredjPas encore d'évaluation
- Def PhilosphiezDocument28 pagesDef PhilosphiezfrtgPas encore d'évaluation
- 8 PHILOscienceDocument2 pages8 PHILOscienceDiary BaPas encore d'évaluation
- La Philosophie - Comte-Spanville AndreDocument56 pagesLa Philosophie - Comte-Spanville AndreBenjamin Lassauzet100% (1)
- Méthodecommentaire Exemple Bernard VéritéDocument4 pagesMéthodecommentaire Exemple Bernard VéritéMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- LógicaDocument428 pagesLógicavaldemar abrantesPas encore d'évaluation
- TP TAS No 0 - Part 1Document2 pagesTP TAS No 0 - Part 1Boubou AnasPas encore d'évaluation
- Bfem 2009Document1 pageBfem 2009Diabel DiopPas encore d'évaluation
- 2 4lesgammespentatoniquesDocument3 pages2 4lesgammespentatoniquesTarek Tarekus0% (1)
- Corrigé TD5 Machines Tournantes ManDocument23 pagesCorrigé TD5 Machines Tournantes ManIsmaile Bouzzine100% (1)
- Traiter: Logiques SequentiellesDocument4 pagesTraiter: Logiques SequentiellesBlaise EdimoPas encore d'évaluation
- TP Identification Des Sols Mds PDFDocument13 pagesTP Identification Des Sols Mds PDFNadjibCalienté100% (1)
- TD 05 ConvectionDocument2 pagesTD 05 ConvectionWail Dridi100% (3)
- Section 5 - 2019Aut-MEC2405 - Analyse limite-PDF-No - VideoDocument68 pagesSection 5 - 2019Aut-MEC2405 - Analyse limite-PDF-No - Videoالدعم الجامعيPas encore d'évaluation
- Sujet de Révision N°1 PDFDocument4 pagesSujet de Révision N°1 PDFjhygjhgjh KaelPas encore d'évaluation
- FGD 212 S v1.03 EN FR ES (US)Document2 pagesFGD 212 S v1.03 EN FR ES (US)AndresZotticoPas encore d'évaluation
- VPN IpsecDocument6 pagesVPN Ipsecarthur_1569Pas encore d'évaluation
- Atelier 2 DSL-Xtext PR EntitéDocument5 pagesAtelier 2 DSL-Xtext PR EntitéES ChaymaaPas encore d'évaluation
- Note de Reprise Des Balcons Enigma Bat e Indice BDocument27 pagesNote de Reprise Des Balcons Enigma Bat e Indice BLo2 ConceptsPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Rappels Sur Le Filtrage NumériqueDocument13 pagesChapitre 1 Rappels Sur Le Filtrage Numériquedaya daya0% (1)
- Dynamique Des Sol 2Document71 pagesDynamique Des Sol 2SamehAnibi100% (1)
- 61 C 46 Cccba 3 A 0028992297Document5 pages61 C 46 Cccba 3 A 0028992297Karim Melliti0% (2)
- Chap 2 AlcènesDocument43 pagesChap 2 AlcènesWahab Houbad100% (1)
- Pfe TunisDocument50 pagesPfe Tuniszineb aterta100% (1)
- Chapitre 1 Généralités.Document27 pagesChapitre 1 Généralités.ETUSUP100% (1)
- ranaivosonTiavinaF ESPA MAST 21Document255 pagesranaivosonTiavinaF ESPA MAST 21DJARRA TIEMOKOPas encore d'évaluation
- 2015 - Tableaux Dérivées, Primitives, DLDocument3 pages2015 - Tableaux Dérivées, Primitives, DLAristode Makaya KissambouPas encore d'évaluation
- JustBIM Fiche ProduitDocument2 pagesJustBIM Fiche ProduitStéphane LOTZPas encore d'évaluation
- Essai MdsDocument4 pagesEssai MdsHi BaPas encore d'évaluation
- Inertie TrianglessDocument3 pagesInertie TrianglessMymhamedPas encore d'évaluation
- Construction Métallique - 3 PDFDocument24 pagesConstruction Métallique - 3 PDFBadr ChattahyPas encore d'évaluation
- MP Physique Electromagnetisme ADocument20 pagesMP Physique Electromagnetisme AYoussef BoughalladPas encore d'évaluation
- Plan F12Document20 pagesPlan F12Stephane DuhotPas encore d'évaluation
- Gnu Linux FRDocument82 pagesGnu Linux FRAlbert FotsoPas encore d'évaluation
- Regulation de La Temperature D'Une Serre Horticole: Par Logique FloueDocument51 pagesRegulation de La Temperature D'Une Serre Horticole: Par Logique FloueFatima EzzahraPas encore d'évaluation
- Plan D'étude TI Version 3.1 PDFDocument54 pagesPlan D'étude TI Version 3.1 PDFsamim1971Pas encore d'évaluation