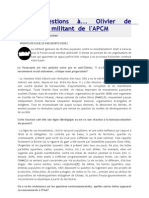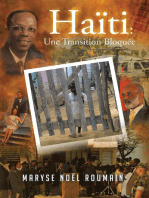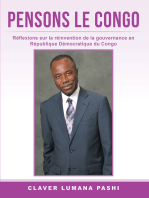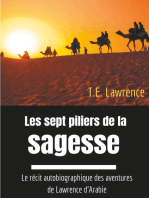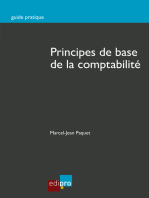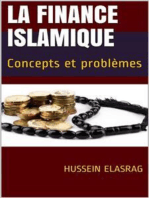Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Ana C Sit Int - FR
Transféré par
bordj0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
0 vues4 pagesTitre original
Ana C Sit int_FR
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
0 vues4 pagesAna C Sit Int - FR
Transféré par
bordjDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme DOCX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 4
Rébellions, insurrections et polarisation politique en Amérique du Sud
Ana Cristina C. Brésil
Cette contribution n'est qu'une partie d'un document plus complet sur la situation mondiale et
les tâches des révolutionnaires, que vous pouvez lire ici à partir du mardi 3 octobre :
www.rupturas.org/blogdaana
Depuis le début du siècle, l’Amérique du Sud a été le théâtre d’une série de luttes, d'n nombre
incalculables de manifestations , d’estallidos (émeutes) populaires, d’élections de gouvernements
réformistes nés de ces luttes et de beaucoup de polarisation politique – car le néo-extractivisme, la
prédation de la nature, la fracture sociale, les inégalités, la violence quotidienne, la militarisation et
les crises politiques se multiplient ici, qui alimentent également les alternatives d'extrême droite :
l'Uribisme en Colombie, Bolsonaro et ses fanatiques au Brésil, Kast et les pinochetistes au Chili, les
droites putschistes bolivienne et guatémaltèque, la droite sordide au Venezuela, et maintenant Milei
en Argentine. Nous vivons dans une macro-région où règnent des violences meurtrières de toutes
sortes extrêmement élevées, avec des inégalités socio-économiques, raciales et de genre croissantes.
Depuis 2018, un nouveau cycle de mobilisations a balayé de manière radicale les pays andins –
Chili, Bolivie, Pérou, Équateur, Colombie, auxquels s’est récemment ajoutée la province argentine
de Jujuy. Au Chili, en Bolivie, en Colombie et maintenant à Jujuy, les organisations syndicales sont
présentes, mais elles ne constituent plus l'avant-garde avec une identité de classe comme elles
l'étaient il y a 40 ou 50 ans. La première ligne des explosions et de la résistance a été la jeunesse
sans perspective (qui a affronté physiquement la répression brutale au Chili, en Colombie et au
Pérou) : des jeunes et des chômeurs, des étudiants, des travailleurs de l'éducation et de la santé ; des
paysans, qui sont généralement des peuples autochtones, comme en Bolivie, en Équateur et dans
une partie de la Colombie ; des femmes, soit à travers leurs propres mouvements pour le droit à
l’avortement et contre les violences sexistes, comme en Argentine, au Chili (et au Mexique), soit au
sein de mouvements ouvriers et populaires en général, dans lesquels se démarquent des militantes et
des dirigeantes féminines. Les mouvements des peuples noirs et autochtones, des femmes et de la
communauté LGBTQI+ doivent être soutenus et leurs revendications reprises dans le cadre du
mouvement général.
Les peuples indigènes andins, ceux qui ont été dépossédés depuis 531 ans, sont à l'avant-garde des
mouvements dans les pays à majorité autochtone (Bolivie, Équateur, Pérou). La CONAIE
équatorienne, le CSUTSB bolivien, les Mingas colombiens, voire les Mapuches du Chili sont des
acteurs essentiels des luttes. Même dans un pays dont 84 % de la population est urbaine et
seulement 1 % autoproclamés indigènes, comme le Brésil, plus de 200 peuples indigènes jouent un
rôle fondamental depuis des décennies dans la lutte pour leurs territoires, pour la protection des
forêts et des rivières, dans la résistance à Bolsonaro.
La multiplication et le radicalisme de ces affrontements ne se traduisent généralement pas par une
auto-organisation plus durable – en raison de difficultés objectives et parce qu’il n’existe pas de
gauche dotée de la politique et du poids nécessaires pour encourager la permanence des embryons
de pouvoir populaire et les élever à des organes de décision nationaux. Au Chili, après l’estallido de
2019, des assemblées de quartier ont eu lieu dans tout le pays. Lors de l’explosion colombienne, des
cabildos (assemblées populaires locales) ont été organisés sur les lieux de résidence, notamment en
périphérie. La jeunesse populaire se méfie et ne s'associe pas aux organisations plus traditionnelles,
telles que les syndicats et les partis.
Parfois les mobilisations réussissent partiellement. En Argentine, les foulards verts ont gagné
l’avortement légal ; en Bolivie, la résistance au coup d’État militaro-policier de 2019 (qui a été
facilité par les erreurs grossières d’Evo et de son entourage) a reconquis les élections et a ramené le
MAS au pouvoir l’année suivante. Lors des élections en Équateur, nous avons eu deux triomphes
populaires importants, avec la victoire du « oui » à Yasuni, pour laisser le pétrole de la région sous
terre, et dans le Chocó andin, qui a rejeté l'exploitation minière dans la province de La Pichincha,
où se trouve Quito.
En général, les luttes font face à une répression brutale, car la bourgeoisie ne cédera pas, sauf pour
des gains très partiels. C’est pourquoi les processus ont tendance à se répéter dans des contextes de
bouleversements sociaux, comme au Pérou qui a connu un soulèvement majeur en décembre et
janvier 2022, notamment dans le sud du pays, où vit une majorité de Quechua et d’Aymara. Les
manifestations contre le gouvernement de Dina Boluarte, imposé par un coup d'État parlementaire
contre Pedro Castillo, ont été fortement réprimées, mais ont donné lieu à l'organisation des régions
indigènes et à un organe de coordination appelé Assemblée nationale des peuples, qui comprend la
CGTP, des syndicats et des groupes politiques de gauche, avec le « programme » de renverser
Baluarte et d'appeler à une Assemblée constituante.
L'adaptation de la gauche à l'institutionnalisme
Alors que la crise capitaliste s’accélère et envahit toutes les sphères de la vie, les États bourgeois
exercent une pression toujours plus intense sur de larges secteurs de la gauche et de l’activisme pour
empêcher toute possibilité d’opposition radicale, d’indépendance et donc de progrès vers un
changement révolutionnaire. Il existe une combinaison de causes objectives et subjectives à cette
assimilation des dirigeants sociaux et des organisations dans les institutions bourgeoises et à leur
transformation en forces dépendantes du statu quo capitaliste. L’absence d’une autre référence pour
le socialisme depuis l’effondrement des États de l’Est et la montée du capitalisme en Chine ont
contribué de manière décisive à une profonde dégradation de l’horizon idéologique de la majeure
partie de la gauche.
En Amérique latine, après les grandes mobilisations des années 2000 et aujourd’hui, après le cycle
d’explosions de 2019 et 2020, des gouvernements plus ou moins réformistes ont émergé. Mais les
progressismes d’aujourd’hui sont confrontés à une corrélation régionale de forces plus précaire,
parce qu’ils n’ont plus les processus révolutionnaires au Venezuela ou les processus pré-
révolutionnaires comme ceux qui ont renversé le régime néolibéral en Bolivie, et parce que la droite
a polarisé un secteur de la société. D’où le rôle de plus en plus évident de la gauche réformiste en
tant qu’administratrice de la crise capitaliste et de sa situation plus instable que dans la période
précédente. Ceux qui, à leur manière, affrontent l'institutionnalisme sont l'extrême droite, dans le
but d'évoluer vers des régimes totalitaires, et, de manière beaucoup plus faible, les forces de la
gauche socialiste, qui défendent l'indépendance politique des exploités et des changements profonds
dans les structures sociales.
En combinaison, l’avancée des forces d’extrême droite sème la confusion dans de larges secteurs de
l’avant-garde. Les dirigeants réformistes profitent de la nécessité incontestable d’élargir l’unité dans
la lutte contre les nouveaux fascismes pour pousser encore plus fort en faveur d’un soutien ouvert
aux gouvernements « progressistes » (qui deviennent de moins en moins progressistes) comme
alternative possible. Une pensée objectiviste et pragmatique qui, en pratique, supprime les horizons
de changement radical. Des politiques d’unité (unités d’action et fronts uniques pour mobiliser ou
éventuellement pour voter) sont nécessaires pour combattre l’extrême droite néofasciste. Le
problème est que le « progressisme » actuel transforme la nécessaire politique d’unité en stratégies
permanentes de soutien à tout gouvernement qui n’est pas d’extrême droite. Ainsi, la défense des
libertés démocratiques préservées (quoique de moins en moins) dans les régimes démocratiques
bourgeois se confond avec la défense du régime lui-même.
La participation des socialistes aux élections périodiques à tous les niveaux est une tactique
importante et nécessaire, non seulement parce que nous faisons de la propagande à travers eux, mais
parce que nous pouvons amener les élus à devenir des personnalités politiques, des tribunes
populaires pour notre agitation et notre intervention dans la lutte des classes. Mais la participation
électorale et parlementaire doit être complétée par une stratégie de mobilisation. La gauche
réformiste considère de plus en plus les élections, les postes et les politiques publiques « dans le
cadre institutionnel » comme le seul moyen d’obtenir des améliorations pour les travailleurs et le
peuple, alors que nous savons que le seul cadre institutionnel, sans mobilisation, ne produit pas de
changements substantiels.
L’argent des entreprises et de l’État ronge et corrompt les processus électoraux et parlementaires
ainsi que presque tous les partis politiques. Les discours sur le « populisme de gauche » masquent
une adaptation au statu quo. Du progressisme latino-américain à la social-démocratie européenne,
des tenants du Green New Deal aux récents partis qui se sont proposés comme alternatives contre-
systémiques (Syriza, Podemos), nous assistons à une naturalisation totale des institutions de l'État
bourgeois comme le principal, sinon le seul, moyen de réaliser des conquêtes.
Le « progressisme » latino-américain aujourd’hui
En Amérique latine, nous connaissons une deuxième vague de gouvernements réformistes,
désormais polarisés à la fois entre la droite traditionnelle et l’extrême droite. Ce ne sont pas du tout
les mêmes processus politiques ou gouvernements. Lors de la première vague, au cours de la
première décennie du siècle, les avant-gardes de la région ont été les processus révolutionnaires ou
pré-révolutionnaires qui ont abouti aux gouvernements de Hugo Chávez et d'Evo Morales, qui ont
affronté l'impérialisme et les élites politiques traditionnelles de leurs pays, rompant avec les régimes
précédents : ils ont modifié des constitutions, se sont mobilisés contre les coups d'État, ont réétatisé
les secteurs économiques. Dans le cas de la Bolivie, ils ont créé un État plurinational sans
précédent, avec une majorité autochtone au sein du gouvernement. Lula et le PT, le kirchnérisme, le
Front large uruguayen et même Rafael Correa, initialement réformateur, sont restés dans le cadre du
modèle de développement néo-extractivistes et de l’administration de l'état. Dans le cas du Brésil, le
PT, Lula et Dilma ont poursuivi la régression de l’économie axée sur l’exportation de produits
primaires, la désindustrialisation et le néocolonialisme.
Contrairement à la première vague, cette deuxième vague est moins radicale. Au Mexique, López
Obrador est arrivé au pouvoir en vainquant la fraude et le régime historique de parti unique bâti par
le PRI. Lula 3.0 est né d’une large et nécessaire unité démocratique électorale contre Bolsonaro, qui
allait des secteurs conservateurs de la bourgeoisie aux forces de gauche, sans mobilisations
majeures – car c’est un point d’honneur pour le PT d’aujourd’hui de ne pas mobiliser. Les
gouvernements de Boric au Chili, d'Arce en Bolivie, de Petro en Colombie, voire celui du Castillo
déchu au Pérou, ont émergé après de fortes mobilisations. Mais tous ces gouvernements mènent leur
politique dans le cadre des institutions de l’État bourgeois, bien qu’avec de nombreuses différences
entre eux.
Cette évaluation marxiste des soi-disant « gouvernements progressistes » n’implique pas que nous
devrions avoir une politique d’opposition frontale. Cela implique, si nous reconnaissons qu’il ne
s’agit pas de gouvernements des travailleurs et du peuple, une politique de préservation et de lutte
pour l’indépendance et l’autonomie des mouvements sociaux et des partis dans lesquels nous
opérons vis-à-vis d’eux. Les tactiques concrètes au Parlement et dans l'action face aux
gouvernements progressistes varient selon les cas, combinant revendications et, le cas échéant,
quelques dénonciations. Comparons Lula et Petro. Le premier est un gouvernement d’unité
nationale – Lula, Alckmin, avec l’ex-bolsonariste Lira et des secteurs de l’oligarchie de droite la
plus vénale, le « Centrão ». Il met en œuvre des mesures d’ajustement néolibérales, qui réduisent le
budget de la santé et de l’éducation, votées par un parlement de droite. Avec une présence
minoritaire de personnalités indépendantes dans les domaines des droits de l'homme, des peuples
indigènes et de l'environnement, le gouvernement brésilien compte un grand nombre de ministres
bourgeois, dont le vice-président, un certain nombre de ministres du PT, gestionnaires avérés des
intérêts de la bourgeoisie dans les gouvernements précédents, et maintenant nombre de ministres
venant du Centrão et même du camp de Bolsonaro.
Petro a d'abord tenté de former un gouvernement avec la branche bourgeoise dirigeante du Parti
libéral. En neuf mois d'expérience, il n'a réussi qu'à faire voter une loi fiscale qui taxait les grandes
fortunes. Confronté aux obstacles à la réforme de la santé, des lois sur le travail et les retraites, il a
décidé de changer de gouvernement et a appelé à la mobilisation. À deux reprises, il a rempli les
rues de manifestants, à qui il a dit en un mot que seule la mobilisation permettrait de conquérir ces
réformes. Lula et Petro représentent désormais deux voies opposées. En ce qui concerne
l'exploration pétrolière, Petro a déclaré que le choix de Lula d'explorer le pétrole à l'embouchure du
fleuve Amazone représenterait un « déni progressif » de la crise climatique.
Si Lula et le PT se sont historiquement engagés, pendant deux décennies, à ne pas mobiliser la
population ni à encourager le peuple à s'organiser, Petro affirme désormais le contraire. Il est clair
que les tactiques à l’égard de l’un et de l’autre devront être différentes. Petro appelle la population à
s'organiser. Le parcours de son gouvernement dépendra de ce que feront les travailleurs, les
indigènes et les paysans colombiens pour suivre cette voie. La gauche qui arrive au pouvoir et
n'appelle pas systématiquement à la mobilisation finit par reproduire la voie du « lulisme » : se
limiter à être de bons gestionnaires de l'État capitaliste. Ceux qui appellent à la mobilisation
peuvent ouvrir un espace à des politiques de rupture avec le néolibéralisme et le capital.
La crise laisse peu de marge de manœuvre. Ce n’est qu’avec l’autonomie des mouvements,
l’indépendance politique des partis socialistes et, surtout, de grandes mobilisations et l’auto-
organisation des exploités et des opprimés qu’il est possible d’obtenir plus que des miettes et
d’avancer vers des solutions écologiques et socialistes.
septembre 2023
Ana Cristina, Israël, José Correa et Pedro Fuentes
Vous aimerez peut-être aussi
- DISSERTATION SalvadorDocument4 pagesDISSERTATION SalvadorLili Rivet LoonenPas encore d'évaluation
- Amérique Latine: Laboratoire pour un socialisme du XXIe siècleD'EverandAmérique Latine: Laboratoire pour un socialisme du XXIe siècleÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (1)
- Le Journal de Notre Amérique N°12: Entre Turbulence Et RésistanceDocument46 pagesLe Journal de Notre Amérique N°12: Entre Turbulence Et RésistanceAlexAnfrunsPas encore d'évaluation
- Le QUEBEC EN MOUVEMENTS - CONTINUITE ET RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES MILITANTES: Continuité et renouvellement des pratiques militantesD'EverandLe QUEBEC EN MOUVEMENTS - CONTINUITE ET RENOUVELLEMENT DES PRATIQUES MILITANTES: Continuité et renouvellement des pratiques militantesPas encore d'évaluation
- Article 1001637Document5 pagesArticle 1001637infoLibrePas encore d'évaluation
- La démondialisation ou le chaos: Démondialiser, décroître et coopérerD'EverandLa démondialisation ou le chaos: Démondialiser, décroître et coopérerPas encore d'évaluation
- Trois Questions À Olivier de MarcellusDocument2 pagesTrois Questions À Olivier de MarcellusneirotsihPas encore d'évaluation
- Entre peuple et élite, le populisme de droiteD'EverandEntre peuple et élite, le populisme de droitePas encore d'évaluation
- Los Modelos Revolucionarios y El Naufragio de La Vía Chilena Al Socialismo PDFDocument23 pagesLos Modelos Revolucionarios y El Naufragio de La Vía Chilena Al Socialismo PDFDiego ParraPas encore d'évaluation
- Lyonel TrouillotDocument2 pagesLyonel TrouillotBetschbel DorcéPas encore d'évaluation
- Histoire politique de l'Italie depuis 1945: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandHistoire politique de l'Italie depuis 1945: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- .Trashed-1709509270-Partis Politiques Et Comportement Electoral en HaitiDocument4 pages.Trashed-1709509270-Partis Politiques Et Comportement Electoral en HaitiKenny THELUSMAPas encore d'évaluation
- L'illusion localiste: L’arnaque de la décentralisation dans un monde globaliséD'EverandL'illusion localiste: L’arnaque de la décentralisation dans un monde globaliséPas encore d'évaluation
- Révolution Des OeilletsDocument14 pagesRévolution Des OeilletsmyriamdibbPas encore d'évaluation
- Le manifeste Utopia: Deuxième édition augmentée et réactualiséeD'EverandLe manifeste Utopia: Deuxième édition augmentée et réactualiséeÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Thème 1 Chapitre 2Document2 pagesThème 1 Chapitre 2daaisuPas encore d'évaluation
- Lula - Dix Ans Après Juin 2013Document5 pagesLula - Dix Ans Après Juin 2013caltamira-1Pas encore d'évaluation
- EMC Dossier/exposé Sur "L'Argentine, de La Dictature À La Démocratie"Document13 pagesEMC Dossier/exposé Sur "L'Argentine, de La Dictature À La Démocratie"myriamdibbPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 2Document4 pagesChapitre 1 2victor.beaufils76Pas encore d'évaluation
- Module Sciences Sociales Sec IvDocument156 pagesModule Sciences Sociales Sec IvJuan96% (27)
- HGGSP - Fiches de RévisionsDocument3 pagesHGGSP - Fiches de RévisionsMahaut BonneaudPas encore d'évaluation
- Contester en Contextes Semi-AutoritairesDocument16 pagesContester en Contextes Semi-AutoritairesGabin Damien De TchidjePas encore d'évaluation
- Crisis Group 020511Document43 pagesCrisis Group 020511malarky19Pas encore d'évaluation
- Silvia Federici Le Fémi Nisme D'état Est Au Service Du Déve Lop Pe Ment Capi Ta ListeDocument10 pagesSilvia Federici Le Fémi Nisme D'état Est Au Service Du Déve Lop Pe Ment Capi Ta ListediscomolinoPas encore d'évaluation
- Thème Libre 2022 2Document3 pagesThème Libre 2022 2Rashid AlsaifPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 Les Mouvements Contestataires EC 2024Document7 pagesChapitre 6 Les Mouvements Contestataires EC 2024dario.v2006Pas encore d'évaluation
- Mai 68 - AFDocument11 pagesMai 68 - AFTiagoPas encore d'évaluation
- Carlos Marighella - Manuel de Guérilla UrbaineDocument15 pagesCarlos Marighella - Manuel de Guérilla UrbainemouwahhidPas encore d'évaluation
- Antisystème PDFDocument40 pagesAntisystème PDFAnonymous oyUAtpKPas encore d'évaluation
- Version Finale Le Woke1Document18 pagesVersion Finale Le Woke1ESSABRY MOHAMMEDPas encore d'évaluation
- Fascicule de Corrigées IèreDocument6 pagesFascicule de Corrigées IèremsambihafilsPas encore d'évaluation
- Thomas Piketty - Le Combat Pour L'égalité Peut Encore Être Gagné - AlternatiDocument12 pagesThomas Piketty - Le Combat Pour L'égalité Peut Encore Être Gagné - AlternatiRémy Bres-FeuilletPas encore d'évaluation
- Discours ThomasDocument21 pagesDiscours ThomasCohen ZabsonrePas encore d'évaluation
- HGGSP DemocratisationDocument41 pagesHGGSP DemocratisationAmanda ADPas encore d'évaluation
- Cours de La Semaine Allant Du Mardi 9 Au 30 FEVRIER 2026 SCIENCES SOCIALESDocument16 pagesCours de La Semaine Allant Du Mardi 9 Au 30 FEVRIER 2026 SCIENCES SOCIALESsaintfleurpametinyPas encore d'évaluation
- Harbi Etudes - Process-legitim-AlgDocument10 pagesHarbi Etudes - Process-legitim-AlgALI BELGHANEMPas encore d'évaluation
- Socialisme Fasciste - BARDECHE Maurice - Livret (2012)Document16 pagesSocialisme Fasciste - BARDECHE Maurice - Livret (2012)BibliothequeNatioPas encore d'évaluation
- Intro Mouvements Protestataires Et Luttes PopulairesDocument10 pagesIntro Mouvements Protestataires Et Luttes Populairesjs DoryPas encore d'évaluation
- C19. Hist. 3e5 2Document5 pagesC19. Hist. 3e5 2Yani BossPas encore d'évaluation
- MOUVEMENT BLACK LIVES MATTER ET LE CHANGEMENT SOCIAL AUX ETATS UNIS - Docx..bakDocument23 pagesMOUVEMENT BLACK LIVES MATTER ET LE CHANGEMENT SOCIAL AUX ETATS UNIS - Docx..bakMavoungouPas encore d'évaluation
- Les Tensions Sociales, ManifestationDocument3 pagesLes Tensions Sociales, ManifestationPseudo785Pas encore d'évaluation
- La DémocratieDocument6 pagesLa DémocratieLidia FloresPas encore d'évaluation
- Convergence Des Gauches - Es-Tu Déjà-Là - PolitiqueDocument11 pagesConvergence Des Gauches - Es-Tu Déjà-Là - PolitiqueMarcEPas encore d'évaluation
- Lahouari AddiDocument4 pagesLahouari AddiSoleil OptionPas encore d'évaluation
- La Lucha TshisekediDocument10 pagesLa Lucha Tshisekedi8rvz5qg7rmPas encore d'évaluation
- Table Ronde Regards 1998Document3 pagesTable Ronde Regards 1998Ta Tôn Philôn KoinaPas encore d'évaluation
- FernentDocument22 pagesFernentAlexAnfrunsPas encore d'évaluation
- Ismail Gourich 17003813 TAF 4 GeopoliticsDocument8 pagesIsmail Gourich 17003813 TAF 4 GeopoliticsIsmaïl GourichPas encore d'évaluation
- La Dictature Franquiste-2Document3 pagesLa Dictature Franquiste-2Ziyad Moussa El HnoudiPas encore d'évaluation
- 15B. Lopposition Au Système de La Restauration.Document4 pages15B. Lopposition Au Système de La Restauration.Paula Abellan LopezPas encore d'évaluation
- Moore, SkocpolDocument14 pagesMoore, SkocpolJonas JobéPas encore d'évaluation
- Le LibéralismeDocument3 pagesLe LibéralismeLidia FloresPas encore d'évaluation
- Svampa. NeodevelopemmentalismeDocument28 pagesSvampa. NeodevelopemmentalismeNo onePas encore d'évaluation
- 8 Les Partis PolitiquesDocument4 pages8 Les Partis Politiquesimanestrella75Pas encore d'évaluation
- Chomsky WazanniDocument5 pagesChomsky WazanniStanPas encore d'évaluation
- L'heritage de La PGMDocument3 pagesL'heritage de La PGMNatalia RinconPas encore d'évaluation
- Untitled DocumentDocument4 pagesUntitled Documentolivierke125Pas encore d'évaluation
- La Condition PolitiqueDocument557 pagesLa Condition Politique--Pas encore d'évaluation
- F2021094Document23 pagesF2021094mohamedsaadPas encore d'évaluation
- Loi Pour Les NomadesDocument9 pagesLoi Pour Les Nomadesavenir professionnellePas encore d'évaluation
- Sujet Epreuve Ecrite Session 2017Document28 pagesSujet Epreuve Ecrite Session 2017N9Health BossPas encore d'évaluation
- La Rectrice de L'académie de GrenobleDocument1 pageLa Rectrice de L'académie de GrenobleCarlos TanarroPas encore d'évaluation
- 3 - Pour Un Observatoire Des Finances Publiques AfricainesDocument11 pages3 - Pour Un Observatoire Des Finances Publiques Africainesjulien mamadou FAYEPas encore d'évaluation
- DSL Loi Portant Code Foncier I1 AllassaneDocument112 pagesDSL Loi Portant Code Foncier I1 AllassanegabdonPas encore d'évaluation
- Rapporteuse Spécial ONU 2021Document25 pagesRapporteuse Spécial ONU 2021Lucie FourezPas encore d'évaluation
- ReponseB3 - 05 09 2023Document5 pagesReponseB3 - 05 09 2023Aleksi KOSTADINOVPas encore d'évaluation
- Migne. Patrologia Latina Tomus CVI.Document777 pagesMigne. Patrologia Latina Tomus CVI.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisPas encore d'évaluation
- La Police Communautaire Au Cameroun: Le Cas de La Sûrete NationaleDocument107 pagesLa Police Communautaire Au Cameroun: Le Cas de La Sûrete NationaleLionnel Bessala BidzangaPas encore d'évaluation
- L'Algérie Déplore Fortement L' Irresponsabilité Des Auteurs D'Document17 pagesL'Algérie Déplore Fortement L' Irresponsabilité Des Auteurs D'elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Genocide RwandaisDocument20 pagesGenocide RwandaisAnonymous sKiJcJ7SxCPas encore d'évaluation
- Les Lois Folles de La Republiqu - Bruno FuligniDocument195 pagesLes Lois Folles de La Republiqu - Bruno FuligniBarbara VastiePas encore d'évaluation
- Cas Prat - FamilleDocument7 pagesCas Prat - FamilleLebbar MohcineePas encore d'évaluation
- Etude D'impact Sur Les Implications de L'adhésion Du Maroc À La CedeaoDocument66 pagesEtude D'impact Sur Les Implications de L'adhésion Du Maroc À La Cedeaojeuneafrique97% (31)
- Comprendre L'argentDocument65 pagesComprendre L'argentAmir AmiralPas encore d'évaluation
- "Logement, Crise Publique, Remèdes Privés" - Vincent Benard, Institut Turgot, 2007Document154 pages"Logement, Crise Publique, Remèdes Privés" - Vincent Benard, Institut Turgot, 2007Vincent Benard100% (1)
- Responsabilité Administrative Et Les Droits Fondamentaux en HaïtiDocument14 pagesResponsabilité Administrative Et Les Droits Fondamentaux en HaïtiWorsley Saint JeanPas encore d'évaluation
- Le trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsD'EverandLe trading en ligne facile à apprendre: Comment devenir un trader en ligne et apprendre à investir avec succèsÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (19)
- Pour un développement de l'approche psychosociale dans les projets de solidarité internationale: Retours d’expériences au RwandaD'EverandPour un développement de l'approche psychosociale dans les projets de solidarité internationale: Retours d’expériences au RwandaÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Les partis politiques français: Attention dangerD'EverandLes partis politiques français: Attention dangerÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Pensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoD'EverandPensons Le Congo: Réflexions Sur La Réinvention De La Gouvernance En République Démocratique Du CongoPas encore d'évaluation
- Transformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitD'EverandTransformez votre vie: Utilisez le pouvoir créateur qui est en vous pour construire votre vie à l'image de ce que vous voulez qu'elle soitÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (14)
- Les sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieD'EverandLes sept piliers de la sagesse: Le récit autobiographique des aventures de Lawrence d'ArabieÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (451)
- Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauD'EverandDiscours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes: la matrice de l'oeuvre morale et politique de Jean-Jacques RousseauPas encore d'évaluation
- Dictionnaire des Idées & Notions en Économie: Les Dictionnaires d'UniversalisD'EverandDictionnaire des Idées & Notions en Économie: Les Dictionnaires d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Coronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTD'EverandCoronavirus, la dictature sanitaire: Collection UPPERCUTPas encore d'évaluation
- Principes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgeD'EverandPrincipes de base de la comptabilité: La comptabilité appliquée au droit belgePas encore d'évaluation
- Cryptotrading Professionnel: Gagnez Votre Vie Avec Des Stratégies, Des Outils Et Des Techniques De Gestion Des Risques ÉprouvésD'EverandCryptotrading Professionnel: Gagnez Votre Vie Avec Des Stratégies, Des Outils Et Des Techniques De Gestion Des Risques ÉprouvésPas encore d'évaluation
- Vers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriqueD'EverandVers Une Nouvelle Afrique? (Tome 1): Recueil Des Réflexions Et Solutions Pour Une Nouvelle AfriquePas encore d'évaluation
- La dette odieuse de l'Afrique: Comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continentD'EverandLa dette odieuse de l'Afrique: Comment l'endettement et la fuite des capitaux ont saigné un continentÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (4)
- L'Agenda 21 Exposé !: La Démolition de la Liberté par le Green Deal & la Grande Réinitialisation 2021-2030-2050 Plandémie - Crise Économique - HyperinflationD'EverandL'Agenda 21 Exposé !: La Démolition de la Liberté par le Green Deal & la Grande Réinitialisation 2021-2030-2050 Plandémie - Crise Économique - HyperinflationÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- Droit du commerce international: Les fondamentauxD'EverandDroit du commerce international: Les fondamentauxÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (3)
- Apprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)D'EverandApprendre la T.V.A.: Initiation au fonctionnement du système de la T.V.A. et notions de base (édition 2017)Pas encore d'évaluation