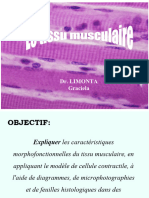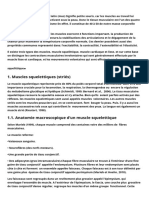Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Histologie Generale Les Tissus Musculaires
Histologie Generale Les Tissus Musculaires
Transféré par
khi khoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Histologie Generale Les Tissus Musculaires
Histologie Generale Les Tissus Musculaires
Transféré par
khi khoDroits d'auteur :
Formats disponibles
lOMoARcPSD|30569103
Histologie générale : les tissus musculaires
Histologie générale (Université Clermont-Auvergne)
Studocu n'est pas sponsorisé ou supporté par une université ou un lycée
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
LES TISSUS MUSCULAIRES
TABLE DES MATIERES
I. GÉNÉRALITÉS........................................................................................................................ 1
II. TISSU MUSCULAIRE STRIÉ SQUELETTIQUE ................................................................ 2
A. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................. 2
B. RHABDOMYOCYTES ................................................................................................................................ 2
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUE EN MICROSCOPIE OPTIQUE (MO)....................................... 2
2. MYOFIBRILLES ET SARCOMÈRES EN MO.................................................................................. 3
3. MYOFIBRILLES ET SARCOMÈRES EN MICROSCOPIE ÉLECTRONIQUE À
TRANSMISSION (MET)................................................................................................................................... 3
4. AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU RHABDOMYOCYTE EN MET..................................... 4
5. ULTRASTRUCTURE MOLÉCULAIRE DU SARCOMÈRE EN MET ..................................... 4
6. CYTOSQUELETTE DU RHABDOMYOCYTE ................................................................................ 5
7. CARACTÉRISTIQUES MORPHOFONCTIONNELLES............................................................... 5
8. CELLULES SATELLITES .................................................................................................................... 6
9. JONCTIONS MYO-TENDINEUSES ................................................................................................... 6
10. FUSEAUX NEUROMUSCULAIRES............................................................................................. 7
11. INNERVATION MOTRICE ............................................................................................................. 7
C. PATHOLOGIES ............................................................................................................................................ 7
1. RHABDOMYOLYSE ............................................................................................................................... 7
2. MYOPATHIES........................................................................................................................................... 8
3. RHABDOMYOSARCOME ..................................................................................................................... 8
III. TISSU MUSCULAIRE MYOCARDIQUE .......................................................................... 8
A. GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................................................. 8
B. CARDIOMYOCYTES .................................................................................................................................. 8
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUE EN MO ............................................................................................ 8
2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MET ...................................................................................... 9
C. AUTRES CELLULES DU TMM ....................................................................................................................... 9
1. CELLULES MYOENDOCRINES......................................................................................................10
2. CELLULES CARDIONECTRICES ...................................................................................................10
D. PATHOLOGIES ..........................................................................................................................................10
IV. TISSU MUSCULAIRE LISSE............................................................................................. 10
A. GÉNÉRALITÉS ...........................................................................................................................................11
B. LÉIOMYOCYTES .......................................................................................................................................11
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MO ........................................................................................11
2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MET .....................................................................................11
3. PARTICULARITÉ DU SARCOLEMME EN MET .......................................................................12
4. INNERVATION MOTRICE ................................................................................................................12
I. GÉNÉRALITÉS
On distingue trois types de tissus musculaires (TM) :
1
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
• Le tissu musculaire strié squelettique (TMSS) : qui dépend du système nerveux somatique. Le TMSS
comprend les cellules qui interviennent dans la réalisation de la commande volontaire.
• Le tissu musculaire myocardique (TMM) : qui n’est que régulé par le système nerveux autonome.
On ne retrouve le TMM qu’au niveau du muscle cardiaque. Il assure le mouvement rythmique et
les contractions automatiques du cœur.
• Le tissu musculaire lisse (TML) : on l’appelle également le tissu musculaire viscéral. Il dépend du
système nerveux autonome. Le TML comprend les cellules qui interviennent dans la réalisation de
la commande involontaire. On le retrouve majoritairement dans les organes creux, dans la paroi des
vaisseaux et au niveau du derme.
Si on peut définir trois TM distincts, ces-derniers présentes quelques caractéristiques communes, dont un
type de cellules bien particulier : les myocytes. Ces cellules sont toutes spécialisées dans la contraction
musculaire. Leur cytoplasme est riche en protéines fibrillaires, que l’on appelle les myofilaments. Ces
myofilaments sont de deux types : soit ils sont fins, et correspondent alors à des polymères d’actine, soit ils
sont épais, et on parle alors de myosine. Ce sont ces myofilaments qui sont responsables des propriétés
contractiles des cellules musculaires. Par ailleurs, les cellules des trois TM sont revêtues d’une membrane
basale (MB), et contiennent myoglobine1 (pigment respiratoire capable de fixer l’oxygène) et complexes
protéiques de dystrophine et d’autres protéines qui lui sont associées.
II. TISSU MUSCULAIRE STRIÉ SQUELETTIQUE
Le TMSS assure la motricité volontaire de l’organisme. Il est dépendant du système nerveux somatique ou
volontaire. Le TMSS s’insère, comme son nom l’indique, majoritairement au niveau du squelette.
Néanmoins, il existe quelques exceptions à ce principe : les muscles peauciers (notamment au niveau de la
face et du cou), s’insère majoritairement dans le derme ; la couche musculaire de l’œsophage comprend des
cellules réparties de façon circulaire pour permettre la déglutition ; et on retrouve au niveau des régions
sphinctériennes (comme les canaux anal et vaginal et l’urètre) des muscles non-insérés sur le squelette.
A. GÉNÉRALITÉS
Le muscle peut être subdivisé en deux parties : le corps et les tendons. Le corps du muscle correspond à la
partie contractile. Il est constitué de cellules, les myocytes, entourées d’une MB. Les tendons sont quant à
eux constitués de tissu conjonctif (TC) dense, à fibres orientés
unitendues, et permettent l’ancrage du muscle sur le squelette.
Sur le plan tissulaire, les cellules musculaires striées squelettiques
(CMSS), sont entourées d’un TC lâche non-spécialisé,
l’endomysium. Les CMSS se regroupent en faisceaux, eux-mêmes
limités par le périmysium. Les faisceaux se regroupent entre eux
et forment des muscles, muscles délimités par l’épimysium,
support de la vascularisation, recouvert par un TC dense orienté bitendu (que l’on nomme l’aponévrose).
Plus on va vers l’extérieur du muscle et plus les fibres de collagène seront abondantes.
Endomysium, périmysium et épimysium sont les TC support de l’innervation et de la vascularisation.
B. RHABDOMYOCYTES
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUE EN MICROSCOPIE OPTIQUE (MO)
1
L’équivalent de la myoglobine dans le sang est l’hémoglobine.
2
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
Le rhabdomyocyte, ou CMSS, est une cellule très allongée (de
quelques millimètres à plusieurs centimètres), cylindrique et
recouverte d’une MB qui la sépare de l’endomysium. Le
rhabdomyocyte est une cellule plurinucléée, qui possède plusieurs
centaines de noyaux en position sous-sarcolemmique. On appelle la
membrane plasmique (MP) du rhabdomyocyte le sarcolemme et son
cytoplasme, le sarcoplasme. Ce sarcoplasme contient des
myofilaments organisés en myofibrilles, qui sont à l’origine des
striations transversales de la CMSS, striations visibles en MO.
2. MYOFIBRILLES ET SARCOMÈRES EN MO
Les myofibrilles sont des structures cylindriques allongées selon le grand axe longitudinal de la cellule,
parallèles entre elles et formées d’une succession de cylindres identiques, les sarcomères. On dit ainsi qu’elles
sont organisées selon un modèle sarcomérique.
Un sarcomère détermine des zones claires et des zones sombres dans la myofibrille, zones alternées
périodiquement qui donnent son aspect strié en MO au TMSS.
Le centre du sarcomère
correspond à une bande
sombre, que l’on note bande
A. De part et d’autre de
cette bande A, on trouve
une bande claire, que l’on
appelle bande I. Chaque
bande I est centrée par une
strie, que l’on appelle strie
Z. Le sarcomère correspond
ainsi à l’espace délimité par deux stries Z consécutives. Un sarcomère est donc constitué selon le modèle :
! !
𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐼 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐴 − 𝑏𝑎𝑛𝑑𝑒 𝐼. Les sarcomères d’une cellule sont tous alignés entre eux.
" "
3. MYOFIBRILLES ET SARCOMÈRES EN MICROSCOPIE
ÉLECTRONIQUE À TRANSMISSION (MET)
En MET, le sarcomère apparaît comme une association
de myofilaments fins et épais, toujours organisés en
stries. Les zones claires et sombres dépendent de la
disposition des myofilaments au sein de la myofibrille.
En coupe transversale, la bande A décrite en MO
correspond à la présence de myofilaments épais de
myosine et de filaments fin d’actine. Au centre de la
bande A, on observe une zone plus claire, uniquement
visible en MET : c’est la bande H, où les myofilaments
épais sont seuls. Au centre de cette bande H, on trouve
une strie plus sombre, la strie M, qui correspond au
renflement médian formé par l’assemblage des myofilaments de myosine. La bande I précédemment décrite
en MO correspond à la présence de myofilaments fins d’actines seuls. Au centre de la bande I, on retrouve
la strie Z plus sombre, qui correspond à la ligne d’interpénétrations des myofilaments fins de deux
sarcomères voisins.
En coupe longitudinale, on observe que les myofilaments s’organisent en hexagone.
3
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
4. AUTRES CARACTÉRISTIQUES DU RHABDOMYOCYTE EN MET
Le sarcolemme des CMSS présente des invaginations en forme de tubules, que l’on nomme les tubules T.
Ces invaginations s’enfoncent transversalement dans le sarcoplasme et cheminent entre et autour des
myofibrilles, et ce jusqu’au cœur de la cellule.
La MB passe en pont au-dessus des tubules T : elle ne suit pas leurs invaginations.
Le réticulum endoplasmique lisse (REL) des CMSS est très développé ; dans les rhabdomyocytes, on ne le
nomme pas REL mais réticulum sarcoplasmique (RS). Le RS est formé d’un fin réseau de canalicules à
disposition longitudinales, anastomosées entre eux. Les canalicules entourent les myofibrilles. Le RS se
termine en citernes terminales situées de part et d’autre des tubules T.
Les tubules T, qui cheminent entre les myofibrilles,
entourent les citernes, citernes présentes à la
jonction entre les bandes A et I. Le RS est un
réservoir de calcium pour la cellule ; la libération de
calcium par le RS permet la contraction des
myofibrilles. Un tubule T et les deux citernes qui
l’entourent forment ce que l’on appelle une triade
(situé en regard de la jonction entre bandes A et I).
L’ensemble des triades constitue le système
sarcotubulaire. Ce système permet la
synchronisation entre la surface et la profondeur de
la cellule dans la libération du Ca2+ par le RS et dans
la contraction des myofilaments.
Par ailleurs, les CMSS possèdent beaucoup de
mitochondries. Elles se disposent en file indienne
entre les myofibrilles. Le sarcoplasme est également riche en grains de glycogène, en gouttelettes lipidiques
(visibles aussi bien en MO qu’en ME) et évidemment en noyaux (situés sous le sarcolemme).
5. ULTRASTRUCTURE MOLÉCULAIRE DU SARCOMÈRE EN MET
Le sarcomère est constitué de filaments fins et de filaments épais.
Les myofilaments fins sont, rappelons-le, des polymères
d’actine, qui forment une protéine filamenteuse en
enroulée en double hélice. Les molécules d’actine sont
associées tout le long de la double hélice à des molécules
régulatrices : la troponine et la tropomyosine. Les myofilaments épais sont, rappelons-le également, des
polymères de myosine. La molécule de myosine est formée de :
• 2 chaînes lourdes : elles forment la tête et la queue de la myosine. Les queues s’enroulent en double
hélice et les têtes sortent à l’extrémité. Sur la partie centrale du myofilament épais, les têtes de
myosine n’émergent pas : cela correspond au renflement médian (strie M) visible en MET.
• 2 chaines légères : elles sont appariées, c’est-à-dire qu’une molécule de myosine comprend deux
paires de chaînes légères.
Ce sont les têtes de la myosine qui portent l’action ATPasique. Cette action ATPasique est activée
par les molécules d’actine.
Lors de la contraction musculaire, le calcium est libéré. Il interagit avec les filaments fins d’actine par le biais
de la troponine. Cette interaction entraîne un changement de la conformation de la troponine, qui déplace
la tropomyosine. Les myofilaments glissent alors sur les myofilaments épais, en conservant leur taille. In fine,
4
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
cela aboutit à un rapprochement des stries Z les unes des autres, et donc à une diminution de la taille du
sarcomère. La bande H et la bande I diminuent également, seule la bande A reste identique. Le sarcomère
est bien l’unité contractile musculaire élémentaire. En cas d’étirement du muscle, c’est l’inverse.
6. CYTOSQUELETTE DU RHABDOMYOCYTE
Dans la CMSS, le cytosquelette a trois positions différentes : il peut être endosarcomérique (à l’intérieur du
sarcomère), exosarcomérique (à l’extérieur du sarcomère) ou alors sous-sarcolemmique.
• Cytosquelette endosarcomérique : deux molécules contribuent à l’assemblage et au maintien du
sarcomère. La titine2 relie chaque myofilament épais de myosine à la strie Z, ce qui permet de
maintenir l’alignement des myofilaments épais et de s’opposer à un étirement excessif du muscle.
La nébuline est quant à elle associée aux myofilaments fins. Elle guide la polymérisation de l’actine
et détermine sa longueur.
• Cytosquelette exosarcomérique : il contient des microtubules, des filaments d’actine non-
sarcomérique (celle du cytosquelette) et des filaments intermédiaires de desmine, très abondante au
niveau des stries Z. Le desmine forme un réseau d’une MP à l’autre, et permet ainsi le soutien des
myofibrilles.
• Cytosquelette sous-sarcolemmique : il est constitué notamment d’un complexe de dystrophine et
de molécules associées. La dystrophine est une grande protéine, que l’on retrouve dans tous les
types de myocyte, sous le sarcolemme. Elle est associée à des molécules, certaines sarcoplasmiques
et d’autres transmembranaires. La dystrophine crée un pont entre le réseau d’actine non-
sarcomérique et les molécules de la MB (collagène de type IV, et réseau de laminine). Ce complexe
permet de stabiliser et de consolider la MP et espace sous-sarcomérique contre les forces de
cisaillement. Le cytosquelette sous-sarcolemmique présente également un complexe
intégrine/taline/vinculine, qui permet de relier le sarcomère à la MB et à la région sous-
sarcolemmique, et donc par extension au sarcolemme.
7. CARACTÉRISTIQUES MORPHOFONCTIONNELLES
Les rhabdomyocytes peuvent être de deux types : soit des cellules de type I, soit des cellules de type II.
2
À l’origine, la protéine était appelée Titan Protein du fait de sa très grande taille. La contraction des
deux termes a donné le nom de titine.
5
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
CMSS DE TYPE I CMSS DE TYPE II
RAPIDIDTÉ DE CONTRACTION LENTE RAPIDE
POSTURALE /
FONCTION PHASIQUE
TONIQUE
GLYCOSLYSE AÉROBIE ANAÉROBIE
ABONDANTE FAIBLE QUANTITÉ
MYOGLOBINE
(COULEUR ROUGE) (COULEUR BLANCHE)
MITOCHONDRIES ABONDANTES FAIBLE QUANTITÉ
GOUTTELETTES LIPIDIQUES ABONDANTES FAIBLE QUANTITÉ
CALIBRE PETITE GRANDE
On étudie les différents types de CMSS par
histoenzymologie, ce qui permet de révéler les
différences de contenu enzymatique des cellules.
La répartition dans l’organisme des deux types de
cellules est assez homogène (50/50) mais varie en
fonction du muscle, c’est-à-dire que localement,
les proportions seront différentes. La proportion
globale est génétiquement déterminée (cela a été
prouvé par l’étude de jumeaux homozygotes), ce
qui signifie que certaines personnes ont des
prédispositions à l’effort. Néanmoins, la
proportion et la taille (augmentation du diamètre
des CMSS par synthèse de myofilaments fins et épais, qui aboutit à une hypertrophie des CMSS) des cellules
sont modifiables par l’entraînement (le marathonien développera ses cellules de type I alors que le sprinter
développera ses cellules de type II).
8. CELLULES SATELLITES
On les appelle également les cellules myogéniques de réserve (sorte de cellules souches). Ce sont de petites
cellules immatures et quiescentes, associées au rhabdomyocyte mature. Elle comporte un noyau unique, et
sont situées entre la MB et le sarcolemme. Elles permettent de régénérer les rhabdomyocytes lésées : les
cellules satellites activées se divisent, et donnent à nouveau des myoblastes, indépendants d’une CMSS
existante. Les myoblastes vont se séparer de la cellule satellite et du rhabdomyocyte, proliférer, s’aligner et
fusionner, formant un myotube, les noyaux se collant sous le sarcolemme de part et d’autre de la cellule,
cette-dernière se remplissant de myofibrilles. Ce phénomène est également observable lors de
l’entraînement, où il peut y avoir hyperplasie des CMSS : les cellules satellites sortent de leur quiescence, se
divisent, donne un myoblaste qui va fusionner avec le reste de la CMSS existante, permettant l’ajout d’un
noyau dans le rhabdomyocyte.
9. JONCTIONS MYO-TENDINEUSES
Les jonctions myo-tendineuses sont des zones de jonction entre les CMSS et les tendons. Elles permettent
la transmission de la contraction musculaire. Les nombreux replis entre le sarcolemme et la MB augmentent
la surface de contact entre rhabdomyocytes et fibrilles. Les fibrilles de collagène sont en contact avec la MB,
s’y accrochent en s’enfonçant dans les replis.
6
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
10. FUSEAUX NEUROMUSCULAIRES
Ce sont des récepteurs sensitifs
encapsulés qui répondent aux degrés
de tension du muscle et à sa vitesse
d’étirement. Ils s’apparentent à des
mécanorécepteurs qui perçoivent la
longueur du muscle, et par extension
son degré de contraction. Ils sont
disposés en parallèle des
rhabdomyocytes classiques, qui sont
des cellules musculaires extrafusales.
Dans les fuseaux neuromusculaires,
on trouve des cellules musculaires intrafusales (de 4 à 10 environ). Elles sont entourées d’une capsule de
TC. Ce complexe reçoit des afférences et efférences nerveuses multiples.
11. INNERVATION MOTRICE
L’innervation motrice se fait par l’intermédiaire du motoneurone a. Ce-dernier est situé dans le corps
cellulaire de la corne antérieure de la moelle épinière. Il peut innerver plusieurs CMSS extrafusales de même
type morphofonctionnel (soit de type 1 soit de type 2). On parle d’unité motrice de Sherrington. Une unité
motrice correspond donc au motoneurone a et à l’ensemble des cellules qu’il innerve. Le motoneurone
forme une synapse avec les cellules musculaires extrafusales : c’est la plaque motrice (jonction
neuromusculaire). Une CMSS n’est innervée que par un seul nerf, mais un nerf innerve plusieurs CMSS.
C. PATHOLOGIES
1. RHABDOMYOLYSE
La rhabdomyolyse correspond à une destruction aigüe du MSS, avec passage des composants intracellulaires
dans la circulation sanguine. Les causes classiques de la rhabdomyolyse sont la compression prolongée des
membres (chute de personnes âgées qui ne parviennent pas à se relever), la consommation de toxines
(comme l’alcool) ou la prise de certains médicamenteuse ou drogue (comme l’héroïne). L’élément le plus
grave de la maladie est le fait que la myoglobine, élément constitutif du rhabdomyocyte, passe dans le sang
et précipite dans les reins, ce qui entraîne une insuffisance rénale et à terme une destruction du rein.
7
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
2. MYOPATHIES
Une myopathie est une dégénérescence progressive du muscle. La plus connue est la myopathie de
Duchenne ou dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). C’est une maladie génétique, qui correspond à
une mutation du gène DMD codant la dystrophine. Elle touche le plus souvent les garçons et est transmise
par la mère. La dégénérescence des MSS entraîne une faiblesse musculaire pendant l’enfance et une atrophie
des muscles, rendant la marche impossible. Les tissus myocardiques et lisses sont également touchés. En
cas de myopathie déclarée dans la famille, un dépistage en prénatal peut être proposé.
3. RHABDOMYOSARCOME
Le rhabdomyosarcome est une tumeur maligne des CMSS. Elle touche essentiellement les enfants et les
adolescents.
III. TISSU MUSCULAIRE MYOCARDIQUE
Le TMM est un muscle strié myocardique. Il se contracte spontanément de façon rythmique et assure une
contraction forte, renouvelée et constante, qui correspond aux battements cardiaques. L’automatisme
cardiaque est intrinsèque. Il est donc indépendant du SNA. Le TMM ne possède pas de cellules souches et
donc pas de cellules satellites : en cas de lésion, les cellules du TMM ne pourront pas se régénérer d’elles-
mêmes.
A. GÉNÉRALITÉS
Le TMM forme la tunique moyenne de la paroi du cœur, le myocarde. La paroi cardiaque comprend trois
feuillets : l’épicarde (feuillet viscéral du péricarde), le myocarde (plutôt mince au niveau des oreillettes et
assez épais au niveau des ventricules, notamment le ventricule gauche) et l’endocarde (qui tapisse l’intérieur
de l’organe). La face externe est lisse, a contrario de la face interne qui, elle, est irrégulière.
B. CARDIOMYOCYTES
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUE EN MO
8
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
Les cardiomyocytes ont globalement une forme cylindrique, et son nettement moins longs que les
rhabdomyocytes, à savoir environ 100 µm de long., beaucoup moins longue que CMSS. Ils sont ramifiés à
leurs extrémités, ce qui leur permet de communiquer entre eux selon un réseau anastomotique complexe.
Les cellules sont délimitées par un sarcolemme. Les stries scalariformes3 correspondent aux jonctions où les
cardiomyocytes sont reliés les uns des autres.
Dans le sarcoplasme des CMM, on trouve un noyau unique, ovoïde et central. Le sarcoplasme en lui-même
peut être divisé en deux régions distinctes : une région périnucléaire, qui ne présente pas de striation du fait
des divergences des myofibrilles et de l’absence de myofilaments, et une région de myofilaments, qui
présente quant à elle des striations transversales tout comme dans le rhabdomyocytes, car les myofilaments
s’organisent en sarcomère.
2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MET
La région périnucléaire correspond aux cônes sarcoplasmiques. On y
trouve de très volumineuses mitochondries, un appareil de Golgi
développé, et des insertions de glycogène et de pigments. Il n’y a pas de
myofilaments
La région des myofilaments justement comprend les myofibrilles, avec
une organisation analogue au MSS. Entre les myofibrilles, on retrouve de
multiples mitochondries, organisées en file indienne, ainsi que des
gouttelettes lipidiques.
Le système sarcotubulaire n’est pas organisé en triades comme dans le
TMSS, mais en diades. Les tubule T sont plus larges, et doublés par la MB,
qui s’invagine en regard des stries Z, a contrario du TMSS. Les tubules T
sont associés au RS (moins abondant), constitué de tubules longitudinaux anastomosés formant un réseau
désorganisé (sans citerne). Une diade correspond donc à un tubule T et à une terminaison du RS. La
libération de calcium se fait par le tubule T.
Concernant les stries scalariformes, on observe une alternance entre segments transversaux et segments
longitudinaux. Au niveau des segments transversaux, on retrouve des jonctions d’adhérence (desmosomes
permettant le couplage mécanique des cellules), et au niveau des segments longitudinaux, on observe des
jonctions GAP communicantes (qui laissent passer les électrolytes, permettant le couplage électrique des
cellules). Ces deux types de jonction permettent la synchronisation de la contraction cardiaque.
C. AUTRES CELLULES DU TMM
3
Scalariforme signifie « en forme d’escalier ».
9
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
1. CELLULES MYOENDOCRINES
On retrouve notamment ce type de cellules dans la paroi des oreillettes, et notamment au niveau de
l’oreillette droite. Ces cellules sont pauvres en myofibrilles, mais possède une activité endocrine. Leur
cytoplasme comprend des vésicules de sécrétion au niveau de la région périnucléaire, contenant des
précurseurs de peptides natriurétiques. En cas d’étirement des cellules musculaires, les cellules
myoendocrines, excrètent leurs facteurs natriurétiques, qui participent au maintien de l’homéostasie des sels
dans le corps. Ils permettent de diminuer la tension exercée sur la cellule et ont une action vasodilatatrice,
qui permet d’équilibrer la PA et la pression exercée sur les parois du cœur.
2. CELLULES CARDIONECTRICES
Ce sont les cellules du système de conduction du cœur. Elles se dépolarisent spontanément, et assurent la
transmission de l’onde de dépolarisation par un système de conduction jusqu’aux cardiomyocytes. Ils
existent trois types de cellules cardionectrices : les cellules nodales, qui sont responsables de l’automatisme
cardiaque, plus petites que les cardiomyocytes classiques et pauvres en myofibrilles (présentes au niveau du
nœud sino-atrial, qui dirige le rythme cardiaque et transmet l’influx aux autres cellules, c’est-à-dire le nœud
pacemaker, et au niveau du nœud atrio-ventriculaire, les deux nœuds étant reliés par l’intermédiaires de
faisceaux internodaux), les cellules du faisceau de His (qui s’organisent en deux régions, un tronc commun
que l’on appelle le tronc du faisceau de His, tronc qui se divise en deux branches distinctes, les branches
droite et gauche du faisceau de His, formant ainsi un faisceau qui relie l’oreillette au ventricule) et les cellules
de Purkinje, plus grosses que les cardiomyocytes classiques, avec un cytoplasme abondant, mais peu de
myofibrilles. Ces cellules conduisent la dépolarisation aux autres cardiomyocytes, qui forment la paroi du
cœur (elles s’associent par ailleurs pour former le réseau de Purkinje dans les parois ventriculaires).
D. PATHOLOGIES
La principale pathologie du muscle cardiaque est l’infarctus du myocarde. Ce-dernier survient en cas de
d’apparition de caillots dans les artères coronaires. Cela entraine une dévascularisation de la zone en aval.
Cette dévascularisation entraine une mort des cellules myocardiques et une nécrose du tissu, généralisée ou
locale. En l’absence de cellules souches, la lésion occasionnée ne pourra pas être réparée.
IV. TISSU MUSCULAIRE LISSE
10
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
Le TML joue un rôle dans la vie végétative. Il assure la motricité involontaire, et intervient dans les processus
de digestion, de thermorégulation et d’accouchement, ainsi qu’un niveau urinaire et génital. Le TML est
innervé par le SNA. Les CML sont le siège de contraction continue de faible puissance : cela correspond au
tonus musculaire de base, qui peut être régulé par différents stimuli. Les CML sont capables de se diviser,
ce qui rend possible la régénération du TML.
A. GÉNÉRALITÉS
On distingue deux catégories de CML.
• Les CML groupées : elles forment des musculeuses dans les parois des organes creux (appareil
digestif, urinaire, respiratoire et génital), et on les retrouve dans les couches musculaires des
vaisseaux sanguins (c’est-à-dire dans la média). Elles peuvent également former des muscles,
comme les muscles érecteurs du poil et les muscles de l’iris.
• Les CML isolées : elles sont très présentes dans les TC, comme par exemple dans le stroma de la
prostate, le scrotum, les villosités intestinales ou encore les mamelons, ou dans les glandes
exocrines, comme les cellules myoépithéliales ou les cellules myoépithélioïdes (appareil
juxtaglomérulaire du rein).
B. LÉIOMYOCYTES
1. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MO
Les léiomyocytes sont des cellules fusiformes plus ou moins longues (de l’ordre de 20 µm dans les vaisseaux
contre 200 µm dans le tube digestif ou encore 700 µm dans l’utérus pendant la grossesse). La partie centrale
est léiomyocytes est plus large, et leurs extrémités assez effilées. Leur sarcolemme est doublé par une MB,
et leur sarcoplasme comprend un noyau central et unique, allongé selon le grand axe de la cellule, et peut
être divisé en deux régions, à la manière des CMM. La région périnucléaire et la région périphériques (qui
ne comprend pas de striations en MO).
2. ASPECTS MORPHOLOGIQUES EN MET
La région périnucléaire correspond aux cônes sarcoplasmiques. Elle contient des organites, notamment un
appareil de Golgi, un REG et des mitochondries développés.
La région périphérique correspond à la région des myofilaments. Elle constitue le reste de la cellule, et
contient des protéines contractiles non-organisées en sarcomère. Les myofilaments ne forment pas de
myofibrilles. Ils forment un réseau entrecroisé complexe et sont accrochés à des structures spéciales du
cytosquelette.
Les protéines contractiles peuvent être
soit des myofilaments fins, soit des
myofilaments épais. Les myofilaments
fins sont des polymères d’actine
organisés en double hélice et associés à
différentes molécules, dont la
tropomyosine, la calponine et la caldesmone. A contrario du TMSS, les myofilaments fins ne comprennent
pas de troponine. Ces myofilaments fins sont accrochés sur les corps denses, structures du cytosquelette.
Les myofilaments épais correspondent quant à eux à des polymères de myosine (constitués de 2 chaines
lourdes et 2 paires de chaines légères). Les têtes de myosine pointent sur toute la longueur, sans interaction
en médian et dans des directions opposées. Ils sont intercalés entre les myofilaments fins, et ne sont pas en
11
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
lOMoARcPSD|30569103
Mme. VÉRONÈSE HISTOLOGIE 18/10/16
contact avec les éléments du cytosquelette.
Les CML présentent plus de myofilaments fins que les CMSS, mais moins de myofilaments épais.
Le cytosquelette des CML comprend des corps denses, qui sont des formations lenticulaires cytoplasmiques
et qui permettent l’ancrage des myofilaments fins et des filaments intermédiaires du cytosquelette, des
plaques denses, qui sont des formations lenticulaires sous-sarcolemmique et qui permettent également
l’ancrage des myofilaments fins et des filaments intermédiaires à la MP, et finalement, des filaments
intermédiaires de desmine (dans le muscle lisse) ou de vimentine (dans les vaisseaux), qui relient corps et
plaques denses.
3. PARTICULARITÉ DU SARCOLEMME EN MET
Le sarcolemme comprend des plaques denses situées en regard des unes des autres lorsque les cellules sont
groupées, qui permettent de mettre en relation les molécules contractiles de deux cellules voisines, et
assurant ainsi un couplage mécanique, des jonctions GAP communicantes, qui permettent le passage de
molécule (Ca2+ notamment) et donc un couplage électrique si les léiomyocytes sont groupées et enfin des
cavéoles, invaginations membranaires augmentant la surface membranaire de près de 60 %, cavéoles
étroitement liées au RS, qui sont un équivalent des tubules T et constituent une réserve extracellulaire de
calcium
4. INNERVATION MOTRICE
L’innervation des CML se fait par le SNA : une terminaison
nerveuse libre se termine dans le TC lâche entourant le TML. Il n’y
a pas de synapse. Une terminaison nerveuse lisse arrive depuis le
SNA, contenant des neuromédiateurs. En fonction de l’innervation,
on distingue les muscles unitaires (situés dans la paroi des vaisseaux,
les viscères et les musculeuses des organes creux) qui comprennent
une terminaison nerveuse sur un groupe de CML, et les muscle
multi-unitaires (comme au niveau de l’iris), où chaque CML reçoit
une terminaison nerveuse.
La contraction résultant de l’influx nerveux est lente et durable pour les CML. L’influx nerveux entraîne une
dépolarisation membranaire, et une augmentation de la quantité de calcium dans la cellule. Le calcium entre
soit depuis les cavéoles, soit libéré à partir du RS. Le calcium permet l’interaction entre l’actine et la myosine,
libérant l’activité ATPasique de la myosine et permettant le glissement des myofilaments entre eux.
12
UE2
Téléchargé par Raja Tanjaoui (raja.tanjaoui@gmail.com)
Vous aimerez peut-être aussi
- tp7 CorrigeDocument4 pagestp7 CorrigeEmmanuel KoffiPas encore d'évaluation
- Tissu Musculaire Poly Etud 2022Document27 pagesTissu Musculaire Poly Etud 2022Edna windiam LaubouetPas encore d'évaluation
- Tissus Musc1Document19 pagesTissus Musc1Khoudia Sy CamaraPas encore d'évaluation
- Histo23 07-Tissu MusculaireDocument11 pagesHisto23 07-Tissu MusculaireSamwil SUANONPas encore d'évaluation
- 7 - Les Tissus MusculairesDocument6 pages7 - Les Tissus MusculairesHayfa Ben taherPas encore d'évaluation
- CoursDocument14 pagesCourspartiraretirapasPas encore d'évaluation
- 1.physiologie Musculaire 2023Document59 pages1.physiologie Musculaire 2023aminezebar3Pas encore d'évaluation
- 6 - Tissu Musculaire.Document11 pages6 - Tissu Musculaire.Ha NaàPas encore d'évaluation
- Tissus MusculairesDocument33 pagesTissus MusculairessafemindPas encore d'évaluation
- Tissu Musculaire 2024BISDocument27 pagesTissu Musculaire 2024BISFARAH ISTAPas encore d'évaluation
- Tissus MusculairesDocument93 pagesTissus Musculairesnihallydia24Pas encore d'évaluation
- Les Tissus MusculairesDocument56 pagesLes Tissus MusculairesIdrissou Fmsb100% (2)
- Support de Cours Physiologie Et Physiopathologie de La Cellule Musculaire ABED NousseibaDocument33 pagesSupport de Cours Physiologie Et Physiopathologie de La Cellule Musculaire ABED NousseibaSamwil SUANONPas encore d'évaluation
- 06-Les Tissus MusculairesDocument9 pages06-Les Tissus MusculairesBemmoussat AsmaPas encore d'évaluation
- Les Tissus MusculairesDocument14 pagesLes Tissus Musculairesariane.vasseur29Pas encore d'évaluation
- Fichier Produit 1153Document26 pagesFichier Produit 1153Salomon JosephPas encore d'évaluation
- Physiologie Muscles Striés SquelettiquesDocument16 pagesPhysiologie Muscles Striés SquelettiquessafemindPas encore d'évaluation
- BBMV1285 A Histologie Syllabus 2024 01Document15 pagesBBMV1285 A Histologie Syllabus 2024 01el boubsiPas encore d'évaluation
- Cours Du Tissu Musculaire 2023Document9 pagesCours Du Tissu Musculaire 2023agag.salahPas encore d'évaluation
- ContractionDocument13 pagesContractionPY00Pas encore d'évaluation
- CM Muscle FRB 6 DiaDocument13 pagesCM Muscle FRB 6 DiaWilly Le DruillennecPas encore d'évaluation
- Les Tissus MusculairesDocument11 pagesLes Tissus MusculairesZoulkiffiPas encore d'évaluation
- Cours 5 Tissu Musculaire PDFDocument5 pagesCours 5 Tissu Musculaire PDFOmar KodbePas encore d'évaluation
- La Physiologie MusculaireDocument51 pagesLa Physiologie MusculaireJoronavalona RASAMIMANANAPas encore d'évaluation
- Physiologie Animale Cours 15Document168 pagesPhysiologie Animale Cours 15g69wwpfw5kPas encore d'évaluation
- 2-Physiologie MusculaireDocument44 pages2-Physiologie MusculaireIslęm OuaribPas encore d'évaluation
- TissumusculaireDocument28 pagesTissumusculaireAbdou OuarfliPas encore d'évaluation
- Le Système Musculaire CoursDocument11 pagesLe Système Musculaire Coursvan bagaPas encore d'évaluation
- 21 Tspe M1 FicheDocument2 pages21 Tspe M1 FicheMathilde JaeckelPas encore d'évaluation
- Thèse 2Document25 pagesThèse 2Julie BrachetPas encore d'évaluation
- Le Tissu MusculaireDocument94 pagesLe Tissu MusculairemboolaPas encore d'évaluation
- Tissu MusculaireDocument14 pagesTissu MusculaireSana JebbarPas encore d'évaluation
- Muscle Cardiaque - 20231220 - 172623 - 0000Document5 pagesMuscle Cardiaque - 20231220 - 172623 - 0000siheemmedPas encore d'évaluation
- Tissu MusculaireDocument14 pagesTissu Musculairekingofegypt7000Pas encore d'évaluation
- Tissue Musculaire - para Clase 2Document39 pagesTissue Musculaire - para Clase 2tntanime00Pas encore d'évaluation
- Tissu Musculaire 2Document28 pagesTissu Musculaire 2Faculté De Médecine Béchar100% (1)
- La Contraction Musculaire PDFDocument9 pagesLa Contraction Musculaire PDFFaculté De Médecine Béchar50% (2)
- Chapitre 5 Tissu Musculaire DR Lamda 2021Document31 pagesChapitre 5 Tissu Musculaire DR Lamda 2021LàkàmoràEnAlgériePas encore d'évaluation
- 7 Tissu Musculaire Polycope 2020Document15 pages7 Tissu Musculaire Polycope 2020randomPas encore d'évaluation
- Bilan Du Chapitre 11 - La Contraction MusculaireDocument12 pagesBilan Du Chapitre 11 - La Contraction MusculaireYousra INDIAPas encore d'évaluation
- La MyologieDocument6 pagesLa MyologieBilly Bel Vocale MesidorPas encore d'évaluation
- 4.contraction MusculaireDocument40 pages4.contraction MusculaireKima MadPas encore d'évaluation
- Tissus Conjonctifs Cours de Paces Du Professeur TalagasDocument20 pagesTissus Conjonctifs Cours de Paces Du Professeur Talagaskhi khoPas encore d'évaluation
- Contraction Musculaire CouleurDocument286 pagesContraction Musculaire Couleurmatis47215100% (1)
- Physiologie FCT MusculaireDocument14 pagesPhysiologie FCT MusculaireJon FuagaPas encore d'évaluation
- 7 - Physiologie Du Muscle SquelettiqueDocument11 pages7 - Physiologie Du Muscle SquelettiquePascal GadedjissoPas encore d'évaluation
- On Retrouve Différents OrganismesDocument16 pagesOn Retrouve Différents Organismes6h28v69xrfPas encore d'évaluation
- TD 3 Le CytosqueletteDocument7 pagesTD 3 Le CytosqueletteĐî ŅæPas encore d'évaluation
- Physiologie Du Muscle Et de La Contraction MusculaireDocument5 pagesPhysiologie Du Muscle Et de La Contraction MusculaireImane BenderazPas encore d'évaluation
- Tissu Musculaire Dr. Zergui (Version Réduite) 23 24Document30 pagesTissu Musculaire Dr. Zergui (Version Réduite) 23 24belarbihind68Pas encore d'évaluation
- Physio Du MuscleDocument19 pagesPhysio Du Musclesamcruz31100% (1)
- Tissu MusculaireDocument23 pagesTissu MusculaireSalif OUEDRAOGOPas encore d'évaluation
- Muscles: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandMuscles: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Electro - Syst Nerveux - CHAP IV B Transmission NeuromusculaireDocument68 pagesElectro - Syst Nerveux - CHAP IV B Transmission NeuromusculaireAliou LabaykaPas encore d'évaluation
- Offre D'emploi 2018Document287 pagesOffre D'emploi 2018abigael ilungaPas encore d'évaluation
- Chapitre4.1 Biochimie Cellulaire Et FonctionnelleDocument7 pagesChapitre4.1 Biochimie Cellulaire Et Fonctionnelledraboissouf174Pas encore d'évaluation
- ChikhanisDocument36 pagesChikhanisIHee Eb'sPas encore d'évaluation
- Cours MuscleDocument64 pagesCours Musclezerkarim222Pas encore d'évaluation
- Introduction 20231220 142059 0000Document11 pagesIntroduction 20231220 142059 0000siheemmedPas encore d'évaluation
- WWW Schoolmouv FR Cours Conscience Democratique Et Relations Internationales FiDocument12 pagesWWW Schoolmouv FR Cours Conscience Democratique Et Relations Internationales Fikhi khoPas encore d'évaluation
- Correction Des Exercices Du Lundi 11 MaiDocument2 pagesCorrection Des Exercices Du Lundi 11 Maikhi khoPas encore d'évaluation
- Correction 2n6 Ex1aDocument2 pagesCorrection 2n6 Ex1akhi khoPas encore d'évaluation
- Correction 2n6 Ex4a1-4a3-4a6Document2 pagesCorrection 2n6 Ex4a1-4a3-4a6khi khoPas encore d'évaluation
- Correction - 2n6 - Ex3b1 3b4 3b7 3b8 3b9Document1 pageCorrection - 2n6 - Ex3b1 3b4 3b7 3b8 3b9khi khoPas encore d'évaluation
- 2n6 Ex3bDocument1 page2n6 Ex3bkhi khoPas encore d'évaluation
- Jeudi 02 Avril - CoursDocument2 pagesJeudi 02 Avril - Courskhi khoPas encore d'évaluation
- Programme EPS CONFINEMENTDocument10 pagesProgramme EPS CONFINEMENTkhi khoPas encore d'évaluation
- Mardi 02 Juin - CoursDocument1 pageMardi 02 Juin - Courskhi khoPas encore d'évaluation
- FormecanoniqueDocument2 pagesFormecanoniquekhi khoPas encore d'évaluation
- Mardi 12 Mai - CoursDocument1 pageMardi 12 Mai - Courskhi khoPas encore d'évaluation
- Correction p.211 Et 215Document2 pagesCorrection p.211 Et 215khi khoPas encore d'évaluation
- Les Figures de Style CoursDocument5 pagesLes Figures de Style Courskhi khoPas encore d'évaluation
- Embryologie Des Tissus Mous de La Bouche (Enregistrement Automatique) (Enregistrement Automatique)Document34 pagesEmbryologie Des Tissus Mous de La Bouche (Enregistrement Automatique) (Enregistrement Automatique)David BienvenuePas encore d'évaluation
- 3 EstomacDocument60 pages3 EstomacrayanekliouaPas encore d'évaluation
- Copie de Copie de SVT 34Document2 pagesCopie de Copie de SVT 34Lucas BeslingabetPas encore d'évaluation
- Estomac AnatDocument14 pagesEstomac AnatEla saadallahPas encore d'évaluation
- 3 Tiges Vet. - CoursDocument36 pages3 Tiges Vet. - CoursNadinePas encore d'évaluation
- Unité 3Document50 pagesUnité 3Mery ChristmasPas encore d'évaluation
- VB Pelvic Cavity Ebook - FRDocument20 pagesVB Pelvic Cavity Ebook - FRHanane AzurePas encore d'évaluation
- Cour 4Document46 pagesCour 4YacinePas encore d'évaluation
- PEAUDocument25 pagesPEAUMaassoumi MustaphaPas encore d'évaluation
- Scrotum Et TesticuleDocument36 pagesScrotum Et Testiculevaryvira6677Pas encore d'évaluation
- Atlas Du Manuel D'anatomie Descriptive PDFDocument352 pagesAtlas Du Manuel D'anatomie Descriptive PDFanne-laure gueudretPas encore d'évaluation
- Histologie Du Parodonte WordDocument8 pagesHistologie Du Parodonte Wordمحاضرات علميةPas encore d'évaluation
- Embryologie Humaine GénéraleDocument13 pagesEmbryologie Humaine GénéraleHugues Roodly JeannitePas encore d'évaluation
- Exam sv4 Phya Bouhaimi PDFDocument16 pagesExam sv4 Phya Bouhaimi PDFKan3gaz DimaPas encore d'évaluation
- Les Epitheliums de RevetementDocument65 pagesLes Epitheliums de RevetementHenri BelingaPas encore d'évaluation
- 09 - Annexes Et Placenta.Document32 pages09 - Annexes Et Placenta.7d4bww52jtPas encore d'évaluation
- 8.annales IFMKDocument15 pages8.annales IFMKfy46kcjbchPas encore d'évaluation
- 2 S7 Cours 1Document50 pages2 S7 Cours 1Chabane OubarechePas encore d'évaluation
- 2023 Devoir de Maison 1 Td2 Pierre GadieDocument5 pages2023 Devoir de Maison 1 Td2 Pierre GadieCheick Ahmed KonatePas encore d'évaluation
- SPLANCHNOLOGIEDocument6 pagesSPLANCHNOLOGIEdhcbhvct7bPas encore d'évaluation
- TP1 Biologie Animale BIOL-J101-StudentsDocument25 pagesTP1 Biologie Animale BIOL-J101-StudentsbruxellesdeleerPas encore d'évaluation
- Tissu ConjonctifDocument11 pagesTissu Conjonctifgerry iPas encore d'évaluation
- Système Nerveux SoDocument20 pagesSystème Nerveux SoJoël MampirodoPas encore d'évaluation
- 2 Épitheluim Glandulaire - Qcms CorrigésDocument5 pages2 Épitheluim Glandulaire - Qcms CorrigésazizowonodoPas encore d'évaluation
- TD Histo-Embryo 1Document3 pagesTD Histo-Embryo 1Mahamoud DickoPas encore d'évaluation
- FC 1 - Physiologie PulmonaireDocument30 pagesFC 1 - Physiologie PulmonaireArié AmzallagPas encore d'évaluation
- PR Bouziane - Anatomie Chirurgicale Du Duodénum Et Pancréas - CM PDFDocument83 pagesPR Bouziane - Anatomie Chirurgicale Du Duodénum Et Pancréas - CM PDFmomoPas encore d'évaluation
- Structure Et Different Type de CheveuxDocument5 pagesStructure Et Different Type de Cheveuxmelany lafonPas encore d'évaluation
- Cours Anatomie Prostate - 28327217Document43 pagesCours Anatomie Prostate - 28327217nadamalika581Pas encore d'évaluation
- Trachee Anatomie Physiologie Endoscopie Et ImageriDocument19 pagesTrachee Anatomie Physiologie Endoscopie Et ImageriyametePas encore d'évaluation