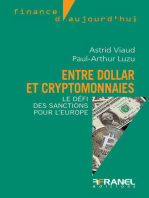Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Winnicott Était-Il Gestaltiste
Winnicott Était-Il Gestaltiste
Transféré par
vffwfsdk77Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Winnicott Était-Il Gestaltiste
Winnicott Était-Il Gestaltiste
Transféré par
vffwfsdk77Droits d'auteur :
Formats disponibles
Winnicott était-il gestaltiste ?
Jean-Luc Martineau
Dans Gestalt 2006/1 (n o 30), pages 167 à 182
Éditions Société française de Gestalt
ISSN 1154-5232
DOI 10.3917/gest.030.0167
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
Article disponible en ligne à l’adresse
https://www.cairn.info/revue-gestalt-2006-1-page-167.htm
Découvrir le sommaire de ce numéro, suivre la revue par email, s’abonner...
Flashez ce QR Code pour accéder à la page de ce numéro sur Cairn.info.
Distribution électronique Cairn.info pour Société française de Gestalt.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le
cas échéant, des conditions générales de la licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie, sous quelque
forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est
précisé que son stockage dans une base de données est également interdit.
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 167
Winnicott était-il
gestaltiste ?
Jean-Luc MARTINEAU Après une expérience de
pédagogie des adultes et de
conseiller de direction,
l’auteur a orienté son parcours,
au travers de l’École Parisienne
de Gestalt et la Psychothérapie
Gestaltiste des Relations
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
a souffrance nous étreint avec l’étrangeté de son injustice. Le
L mouvement psychothérapeutique a su élever une protestation
neuve contre l’abandon de ceux qui souffrent quand cela semble
d’Objet (PGRO),
vers la psychothérapie, qu’il
pratique actuellement à Paris.
venir de l’intérieur. Après la figure du fondateur, les premiers
grands psychanalystes nous apportent une vision de la souf-
france dont nous, gestaltistes, pouvons tirer profit.
Le Docteur Donald Wood Winnicott (1896 - 1971), figure émi-
nente de la psychanalyse britannique, s’est toujours ouvertement
situé dans la continuité respectueuse de l’enseignement de S.
Freud. Il a conduit, selon le protocole freudien, de très nombreu-
ses psychanalyses. Comme pédiatre il a suivi un très grand nom-
bre d’enfants et d’adultes - on parle de plus de 2000 cas - en tant
que psychothérapeute, au travers de thérapies plus ou moins
brèves. Mais il n’a bien sûr jamais prononcé ou écrit le mot Gestalt
à propos de son travail.
ALORS POURQUOI UNE TELLE QUESTION ?
D. W. Winnicott n’a pas connu la Gestalt, et sa formation comme
son expérience étaient faites en Grande Bretagne lorsque F. Perls
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 167
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 168
Winnicott était-il gestaltiste ?
(1893 - 1970) avec Goodman ont commencé à faire connaître leurs
approches dans un cercle américain. Quand l’un était soucieux
de maintenir l’unité d’un mouvement psychanalytique tiraillé entre
plusieurs courants, l’autre inventait sa méthode propre sans égards
apparents pour la théorie d’origine. Reste qu’ils sont contempo-
rains à trois ans près, et qu’ils sont morts presque la même année.
Si tout les oppose, démarche, style, culture, quelque chose pour-
tant les rapproche : une attention constante à ce qui se passe ici
dans la relation avec un patient, une grande disponibilité à l’ex-
périence avant le respect de la théorie.
La question a aussi quelque intérêt parce que Winnicott a admis
lui-même être sorti de la psychanalyse dans certaines circons-
tances telles que les psychothérapies brèves et dans certaines
psychanalyses prolongées, en cas de régression profonde.
Elle a un intérêt encore plus vaste si l’on se rend compte que
Winnicott, changeant de perspective, ouvre la voie à une com-
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
préhension nouvelle de la relation thérapeutique, faite non pas d’in-
terprétations – qui pour lui viennent toujours trop tôt – mais d’une
attention aiguë à ce qui se produit dans l’ici et maintenant de la
relation entre le patient et son thérapeute, révélant une souffrance.
Il observe, dans la séance, ce qui serait une réactualisation ici et
maintenant de ce qui aurait été manqué au cours de la crois-
sance du patient avec une qualité d’attention dont nous pouvons
tirer des leçons.
Car dans la pratique gestaltiste nous vivons une succession d’ex-
périences qui, dans leurs dimensions actuelles, attirent notre atten-
tion sur un processus de croissance en train de se compléter, qui
nous alertent sur ce processus inachevé. Nous sommes, nous,
thérapeutes gestaltistes, cet environnement accueillant à ce qui
survient dans le champ, s’y reproduit avec insistance. Nous som-
mes là pour accueillir cet inachevé qui parle en creux. Et ce qui
survient alors peut grandement être éclairé par certains repères
– j’hésite à dire concepts – que Winnicott nous rapporte, fruits de
sa longue expérience.
168 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 169
Jean-Luc Martineau
Je regarderai successivement cinq approches, spécifiques de
Winnicott, qu’elles soient pratiques ou conceptuelles :
- Le « squiggle », qui est un jeu, mais qui donne à voir la rela-
tion véritable de Winnicott avec ses jeunes patients et qui consti-
tue un remarquable exercice de Gestalt.
- Ensuite je regarderai ce qu’il nous dit du rôle de la « mère suf-
fisamment bonne » dans le développement puisque par là il éclaire
de façon souvent originale la psychopathologie.
- Puis ce que Winnicott nous dit de la régression nous mon-
trera comment une attitude d’écoute et d’empathie peut aller jusqu’à
soutenir un patient dans une difficulté telle qu’il n’y a plus de mots
pour la traduire.
- Après quoi la notion de faux self et vrai self nous montrera ce
qui peut être vain dans un appel trop précoce à la responsabilité
du patient, qui nous est pourtant chère.
- Enfin un détour du côté de l’espace transitionnel permettra de
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
mieux voir en quoi la séance est un espace transitionnel et ce
que cela implique dans la mise en jeu de l’interne et de l’externe
du patient.
Je ne prétends donc pas ici faire un survol exhaustif de l’œuvre de
Winnicott mais tout au plus y grappiller quelques éclairages origi-
naux qui me paraissent des plus utiles à notre pratique gestaltiste.
LE SQUIGGLE
Le premier élément que je propose de regarder n’est pas une
proposition théorique mais une pratique qu’il avait avec les enfants,
et qui nous est parvenue sous le terme de « squiggle », consis-
tant à faire un dessin (un gribouillis) avec eux. Le terme veut dire
en français brouillon ou gribouillage. Il a été transmis tel quel dans
la traduction française de ses ouvrages, pour signifier l’originalité
de cet exercice.
Voici comment il le pratiquait : il prenait un feuille de papier et
un crayon ; il commençait par tracer un trait de forme quelcon-
que, en fermant les yeux lui-même pour bien montrer à son inter-
locuteur qu’on n’était pas dans un effort « sérieux » de grande
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 169
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 170
Winnicott était-il gestaltiste ?
personne pour représenter vraiment quelque chose, mais dans un
jeu nouveau. Ensuite c’était au tour de l’enfant. Il le décrit ainsi :
« dans ce jeu je trace quelques lignes, et lui les transforme en quel-
que chose, et ensuite il en trace quelques-unes pour que j’en fasse
1- D. W. W. Crainte de quelque chose à mon tour » (1). S’appuyant sur la propension des
l’effondrement, p. 115. enfants à s’exprimer par le dessin, il ne se contente pas de leur
demander un dessin, il dessine avec eux.
Les enfants se prenaient au jeu d’un gribouillage où ils ne se sen-
taient pas en infériorité, car le dessin leur est toujours plus un
langage spontané que la parole adulte. Que faisait Winnicott de ce
dessin ? Essentiellement un support d’interprétation dans lequel
il tentait de remonter à la source de la souffrance de l’enfant. Le
dessin permet au moins à l’enfant de dire une souffrance difficile
à exprimer directement avec les mots.
C’est cet échange qui va du dessin aux mots qui me touche
particulièrement. Il met en scène un élément très important, à mon
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
sens, d’un travail gestaltiste : un espace commun aux deux par-
tenaires, dans une relative égalité d’implication, au sein duquel
s’élabore un sens à partir de ce qui est généré dans l’ici et main-
tenant de l’échange. Winnicott se donne le droit de dire son sen-
timent sur le dessin de son patient, du moins dans ses commen-
taires. Ce dessin, comme un geste que l’on observe et restitue à
notre patient, est porteur d’une signification en partie ignorée de
celui qui le fait, au moment où il le fait. Ce dessin est élaboré à
deux, et c’est à deux, avec son jeune patient, que Winnicott cher-
che ce que cela peut bien évoquer. Le but – dit-il – est « de faire
naître un cas à la vie, comme si, par les dessins, l’enfant chemi-
nait à mon côté, et, jusqu’à un certain point, participait à la descrip-
tion du cas » (1). Ce n’est qu’ensuite qu’il livre une interprétation.
En Gestalt, nous avons cette démarche de co-élaboration du
sens à partir d’un tissage fait des apports successifs du client et
de l’utilisation juste du contre-transfert du thérapeute. Ici le sens
s’élabore à la frontière contact, dans un état natif ne devant rien
à une interprétation venue d’ailleurs. En considérant ensemble l’im-
portance relative des différents éléments qui viennent au devant
de la scène, le thérapeute et son client explorent tous deux leur
univers commun et y créent des perspectives nouvelles.
170 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 171
Jean-Luc Martineau
De plus le squiggle est une bonne image de la mise en jeu de
la figure et du fond qui est à l’œuvre à chaque instant de la construc-
tion de la relation thérapeutique. L’un fait apparaître des figures,
multiples ou en évolution subtile tout au long de la séance, l’autre
permet que ces figures successives puissent de plus en plus libre-
ment émerger, soient acceptées, portent un sens et trouvent leur
place dans le processus de changement.
LA MÈRE SUFFISAMMENT BONNE
Winnicott est un grand visionnaire de l’architecture du dévelop-
pement humain. Ses apports les plus novateurs à la tradition psy-
chanalytique sont issus de ses observations multiples d’enfants
avec son regard de pédiatre. En particulier il est attentif aux trou-
bles qui peuvent survenir du fait d’une rupture avec l’environne-
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
ment naturel de l’enfant – sa mère essentiellement au début – du
fait d’insuffisances de celle-ci ou d’accidents qui interrompent leur
relation.
Il est le premier à mettre un tel accent sur les étapes essentiel-
les d’un développement sain et les conditions de passage d’une
étape à une autre. Une des conditions de la réussite de cette suc-
cession d’étapes de développement est l’adaptation de la mère
aux besoins du petit qui vient au monde sans pouvoir les expri-
mer verbalement. Il forge pour cela le terme de « mère suffisam-
ment bonne », qui a eu une grande popularité, parfois au détriment
de sa compréhension.
Cette « mère suffisamment bonne » n’est pas une femme qui
aurait acquis un niveau de compétence mesurable dans l’éduca-
tion des enfants, bien au contraire. Qui alors ? Il observe que,
dès la naissance, le couple mère-enfant fonctionne d’une manière
particulière : la mère « sait » en temps utile quels sont les besoins
de son enfant et y réagit à chaque instant de façon adaptée. Ce
qui est vital à un moment où le bébé est complètement dépendant.
Winnicott avance que cette sensibilité particulière de la mère qui
s’installe naturellement dès l’apparition de l’enfant, repoussant
les limites des autres sollicitations familiales ou sociales, caracté-
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 171
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 172
Winnicott était-il gestaltiste ?
rise la « mère suffisamment bonne ». Et cette relation est vécue
comme « parfaite » par le bébé, si tout marche bien.
À partir de ce premier état de dépendance absolue, petit à petit
cependant de menus décalages vont s’installer, s’accentuer, du fait
que l’amplitude d’exploration de l’enfant va croître, du fait aussi que
la mère va s’ouvrir de nouveau aux sollicitations extérieures. Ces
décalages, obligeant l’enfant à s’adapter, vont lui permettre de se
rendre compte de l’autonomie de son être. Cette évolution, depuis
une adaptation quasi magique jusqu’à une désadaptation progres-
sive, la « mère suffisamment bonne » en est le pivot. Il est même
préférable qu’elle ne soit pas trop férue de théorie sur l’éducation
des enfants pour jouer ce rôle, qui demande beaucoup à l’intuition,
d’une façon naturelle.
Si au contraire quelque chose ne marche pas, l’enfant va réa-
gir en « marquant » l’accident dans son processus de croissance,
comme pour le mettre en réserve afin de donner ses chances à
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
une réparation ultérieure. Winnicott montre que malgré l’étape man-
quée dans la succession qui conduit à l’autonomie adulte, le déve-
loppement peut se poursuivre. Mais ce manque enkysté se mani-
festera de façon insistante par quelque douleur jusqu’à ce qu’un
espoir de le combler survienne dans l’environnement. La thérapie,
entre autres rencontres, est faite pour cela. La souffrance conser-
vée en est le signal.
Or tout ceci parle de la pratique gestaltiste : cette relation mater-
nelle qui conditionne la capacité d’existence du tout petit est comme
la matrice du champ relationnel qui nous sert de référence. Winnicott
montre que l’homme ne peut être compris comme refermé sur
lui-même et ses pulsions mais comme un être construit en rela-
tion. Si quelque chose s’est mal passé dans ce champ primitif de
la relation à la mère, nous devons permettre son actualisation dans
le champ de la relation thérapeutique, avant toute tentative de répa-
ration hâtive de la souffrance. L’awareness que nous recherchons
en Gestalt en est la porte.
En permettant l’élargissement de son champ de conscience,
nous aidons notre client à identifier sa souffrance véritable. En
découvrant avec lui à quel âge s’est produit sa difficulté nous som-
mes sur un chemin juste. Nous évitons ainsi de tenter prématu-
172 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 173
Jean-Luc Martineau
rément de réparer la souffrance à l’aide de la volonté de l’adulte
actuel. Le chemin juste consiste à retrouver les gestes qui ont man-
qué alors.
Ce faisant, le thérapeute, ne redevient-il pas une « figure suffi-
samment bonne » sur laquelle le client peut de nouveau s’appuyer ?
En particulier quand il s’adapte à chaque seconde à l’énergie qui
émane de l’expérience interne du client et quand il soutient l’ef-
fort de celui-ci pour actualiser dans la relation la blessure qui l’en-
combre encore, en lui permettant d’avoir soudain sept ans, deux
ans, et encore moins.
Il prend alors la position, homologue à celle de la mère, de com-
prendre, prendre en même temps l’autre comme un adulte réussi
dans bien des aspects et un bébé plein d’espoir, tout ceci sans
jugement ni contradiction. Nous sommes alors une figure intuitive-
ment adaptée, rationnellement justifiée mais aussi faillible. Ce carac-
tère faillible que le thérapeute assume également et qu’il pourra
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
assez progressivement faire admettre à son client.
Ceci éclaire autrement l’attention qu’il nous faut avoir à toute
les émergences dans la relation, depuis les mots, jusqu’aux sen-
sations les plus subtiles et aux micro-signes les plus ténus. Pas
seulement parce qu’ils nous donnent une information complémen-
taire, qu’ils nous aident à laisser émerger la figure importante
pour un travail fertile ; mais aussi parce que cette expression-là,
celle du bébé dans l’adulte, c’est l’expression la plus authentique
de celui qui est venu nous consulter. C’est le seul moyen de lais-
ser s’instituer la répétition de la relation au sein de laquelle autre-
fois quelque chose s’est peut-être brisé.
De plus notre faculté de laisser cette relation se reconstituer, c’est
ce que notre client attend depuis longtemps de trouver chez un
partenaire, pour se sentir reconnu dans ce qu’il est vraiment. Car
la souffrance est multipliée quand elle est impossible à faire recon-
naître. C’est ce qui nourrit chez moi la légitimité, la nécessité des
reflets empathiques : ils mettent des mots sur les impressions et
réactions contre-transférentielles générées par le client, lui permet-
tant à son tour de sortir de son enfermement avec des mots pour
le dire. En faisant là ce qu’une mère « insuffisamment bonne » a
pu ne pas faire, en mettant des mots sur la relation primitive bles-
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 173
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 174
Winnicott était-il gestaltiste ?
sée, nous légitimons le besoin du client de connaître un dévelop-
pement complet.
Par exemple lorsque quelque chose, dans la séance, nous appa-
raît décalé ou doublé d’agressivité, c’est peut-être le signe de la
résurgence d’un espoir. Mais cela exige de nous une clairvoyance
spécifique : retrouver derrière le geste décalé le besoin toujours
vivant d’une reconnaissance, d’une relation plus pleine, et d’une
vraie réponse autrefois refusée. La démarche gestaltiste est sans
doute la meilleure pour une écoute juste et une réponse pleine.
Winnicott m’aide à lui donner tout son sens. Car le client a besoin
que ce qui lui « arrive », même une pulsion agressive, soit accepté,
supporté par le thérapeute sans réaction de vengeance, que le thé-
rapeute « survive » dirait Winnicott. Il va enfin trouver une réponse
à ce besoin qu’il avait dû jusque-là masquer, devant des figures
parentales défaillantes ou fautives.
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
LA RÉGRESSION
Winnicott a été concerné très particulièrement par la régression,
notamment à l’occasion d’une longue « psychanalyse » avec une
patiente qui vivait des épisodes psychotiques. Les guillemets sont
ici justifiés par ce qu’il en a dit lui-même : à cette occasion il avait
dû sortir durablement du cadre rigoureux de la psychanalyse. Il a
bien pris cette patiente en psychanalyse mais, avec elle, les inter-
prétations étaient sans effet, la parole, inopérante. Le besoin de
cette patiente était que son psychanalyste se retienne d’interpré-
2- Margaret Little, ter, mais accepte d’être là, et de veiller sur elle (2).
Des états limites. Ainsi lorsque Winnicott parle de régression et de régression pro-
3- D. W. W. De la pédiatrie fonde (3), il évoque une situation où la personne revit et fait revi-
à la psychanalyse, p. 250. vre à son entourage un stade très antérieur de son évolution : c’est
la régression jusqu’au stade de la dépendance. Mais c’est toujours
en signe d’espoir que le client amène une telle situation. L’espoir
consiste à trouver dans l’environnement actuel, notamment chez
le psychothérapeute, la personne qui va enfin lui permettre de se
réparer.
174 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 175
Jean-Luc Martineau
Au cours d’une telle régression peuvent apparaître l’envahisse-
ment par des émotions archaïques, l’impulsion subite de pas-
sage à l’acte, ou un silence insurmontable et incompréhensible.
Mais c’est simplement l’aveu dans l’ici et maintenant, nous dit
Winnicott, d’une blessure qui resurgit du fond de l’âge où elle à été
subie. Ces manifestations régressives sont un appel pour que
quelqu’un fasse, et soit, enfin ce qu’il faut. Cette souffrance-là n’a
pas à être consolée mais réparée. On peut lire la régression comme
une situation inachevée où la force reproductive dans l’ici et main-
tenant est un appel à l’achèvement.
Or nous trouvons dans la pratique gestaltiste un cadre favorable
à des revécus « régressifs », c’est-à-dire surgissant dans l’ici et
maintenant, avec un goût ancien et parfois préverbal. Cela nous
permet de nous ressaisir avec nos clients d’événements jusque-
là non conscients, qui continuent à les accompagner dans leur
vie adulte en faisant poids durablement.
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
Nos pratiques gestaltistes, les exercices et jeux de rôle, font appa-
raître des situations fortes, des affects étonnants pour le client
lui-même. Non seulement ils manifestent un revécu important et
caché, mais ils renvoient à des situations qui « frappent à la porte »
pour être acceptées et travaillées dans l’ici et maintenant.
Winnicott nous éclaire sur le fait que le but du travail n’est pas
spécialement de « retrouver » la situation historique. Il faut sim-
plement permettre que la dynamique de la vie reprenne ses droits,
grâce à une juste prise en compte de ce qui apparaît dans le champ.
Et c’est dans l’ici et maintenant de la relation thérapeutique que
la conduite de la relation peut être réparatrice.
Pour Winnicott, lorsque la régression est profonde il faut par-
fois accepter que le seul lien valable à ce moment soit d’être là,
avec l’autre, dans un simple accord de respiration par quoi on le
porte au travers d’un passage difficile, dont on ne saura peut-être
pas tout, même après coup. Mais que quelqu’un ait été là à ce
moment difficile c’est ce qui a toujours douloureusement manqué
à cette personne.
Il nous invite à retrouver l’attitude de la « mère suffisamment
bonne » qui devine sans savoir, accueille une réaction qu’elle ne
comprend pas mais qui a une place dans la chaîne de la vie.
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 175
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 176
Winnicott était-il gestaltiste ?
On pourrait penser qu’il suffit que le besoin de régression se
manifeste, que des sentiments, des affects, soient exprimés pour
que la « guérison » intervienne. Winnicott nous montre qu’il ne faut
pas s’arrêter là, mais trouver le sens de l’apparition d’une abréac-
tion qui ouvre une nouvelle possibilité de grandir pour le client, et
l’accompagner suffisamment longtemps. Il a constaté en particu-
lier que le revécu d’aspects traumatiques de la naissance doit avoir
lieu de nombreuses fois pour que le client puisse s’en détacher sai-
nement.
Il nous invite à la patience.
FAUX SELF – VRAI SELF
Une des propositions les plus intéressantes pour un travail de
Gestalt est celle de l’existence d’un faux self, inférant par là l’exis-
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
tence d’un vrai self. Le self est pour lui à la fois le soi et la per-
sonnalité et non le self tel que nous le définissons en Gestalt. Le
self pour Winnicott c’est la conscience de son identité comme indi-
vidu. Un enfant qui grandit sainement acquiert une conscience
d’exister assez forte pour perdurer au travers des agressions de
l’environnement une fois adulte.
Le faux self chez Winnicott est une construction adaptative archaï-
que de la personnalité quand l’enfant, obligé précocement de se
protéger des intrusions d’une mère incohérente ou toxique, s’en
fait un bouclier. C’est donc pour Winnicott une adaptation excep-
tionnelle, répondant à une situation de souffrance exceptionnelle
due à l’environnement. En effet le faux self a pour fonction de contrer
cette mère incohérente en étant complaisant à son égard, pour
la calmer, protégeant ainsi le vrai self d’agressions qu’il n’a pas
encore la maturité de pouvoir supporter. Ce faisant, le faux self,
tout en maintenant le vrai self dans un état de non développement,
prend sur lui de grandir à sa place, artificiellement : d’où, chez
ces personnes, un sentiment de mal-être lié à l’incertitude de leur
identité qui les conduit, une fois adultes, et dans le meilleur des
cas, à consulter. Ainsi cette exception devient majoritaire dans nos
cabinets de consultation.
176 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 177
Jean-Luc Martineau
Une approche gestaltiste de base nous pousserait à réagir à
ce « faux » self par une demande d’être plus vrai. Le contre-trans-
fert du thérapeute peut l’inciter à ressentir le faux et, ayant mis cette
constatation dans le champ, demander au client d’entrer en contact
avec ce qu’il y a de plus vrai en lui, et qu’il semble éviter.
Winnicott nous indique qu’il pourrait y avoir là une source d’er-
reur par trop de précipitation. Le faux self n’est pas tel parce qu’il
aurait honte du vrai, ou qu’il se méfierait de sa spontanéité et
voudrait la cacher. Le faux self a pour fonction de protéger un
vrai self trop fragile et en réalité trop souffrant pour être exposé.
Mais l’ayant jusque-là protégé, il lui a aussi conservé sa fragilité.
Demander au client d’être plus spontané, plus près de ses senti-
ments ou de faire droit aux émergences du ça, c’est demander à
son faux self de trahir sa mission. Car le faux self, seul interlocu-
teur du thérapeute, est le seul à lui répondre. Il ne pourrait alors
que devenir encore plus complaisant, à l’égard du psychothéra-
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
peute cette fois, devenant ainsi en quelque sorte toujours plus faux.
Cela m’éclaire en tous cas sur des moments de psychothérapie où
on a l’impression de tourner en rond et d’être ramené à la case
départ après bien des efforts.
Winnicott nous indique une ligne à suivre : de toutes façons,
dit-il, c’est le faux self qui est aux commandes chez ces person-
nes. C’est donc à lui qu’on doit s’adresser, dans son langage, jusqu’à
ce que celui-ci, ayant établi une suffisante confiance en celui qui
veut l’aider, lui remette en mains son rôle de protection du vrai self.
Si le psychothérapeute a su être patient jusque-là, alors le faux self
lui confie un vrai self dans un état régressé dont il va falloir accom-
pagner la croissance. Notons que cet aspect nouveau du patient
peut contraster fortement avec le haut niveau d’adaptation – sou-
vent intellectuelle – constaté chez lui et qui est l’œuvre du faux self.
La souffrance apparaît alors brutalement.
Si au contraire, le thérapeute est trop impatient de mettre en
figure du vrai, il peut provoquer une rupture. Les choses alors se
passent très mal, voire très très mal. Si le faux self, qui consti-
tuait un noyau d’espoir, est déçu, il peut y avoir une tentative de
suicide comme dernier recours.
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 177
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 178
Winnicott était-il gestaltiste ?
Bien sûr tous les signes d’adaptation à l’environnement ne relè-
vent pas du faux self. Winnicott signale que le fait de savoir s’adap-
ter aux exigences sociales et de savoir respecter les règles de
vie en commun ne constitue pas, au contraire, un signe d’arrêt pré-
coce du développement. Il ne faut pas que ce faux self social cepen-
dant envahisse la personnalité au point de réprimer les sentiments
authentiques d’une saine affirmation de soi. Dans ce cas une appro-
che plus classique peut apporter une solution.
L’ESPACE TRANSITIONNEL
L’espace transitionnel, une des notions les plus précieuses que
nous ait apporté Winnicott, n’est pas des plus faciles. Tout le monde
connaît « l’objet transitionnel », représenté par une poupée informe,
ou un chiffon, que le bébé s’approprie et qu’il ne veut pas quitter
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
dans ses déplacements, et encore moins tolère-t-il qu’on le lave
ou le répare.
De cette observation Winnicott infère qu’il existe un domaine par-
ticulier de la réalité qui n’appartient pas entièrement au moi, mais
en fait partie, qui n’appartient pas complètement à la réalité objec-
tive, mais en est partie prenante.
Ce domaine particulier, qu’il nomme espace transitionnel, a cette
fonction très précise de servir de tampon entre la réalité interne,
avec laquelle toute la réalité est confondue au début de la vie, alliée
à la toute-puissance, et la réalité externe que l’enfant se met à
découvrir au fur et à mesure qu’il gagne en autonomie, et avec
un lot de souffrances auparavant inconnues !
Pour l’enfant qui a vécu jusque là en symbiose avec sa mère,
baigné de l’illusion de créer ce dont il a besoin, la découverte de
la réalité et de ses contraintes incontournables est vraiment une
sale affaire ! Il peut y avoir une souffrance intolérable à se sentir
seul, impuissant, dans un monde soudain indifférent. C’est le rôle
de l’espace transitionnel que de permettre d’être à la fois dedans
(dans la symbiose) et dehors (dans la réalité) sans en avoir plei-
nement les inconvénients. Comment cela est-il possible ? Par le
recul donné par la capacité de jouer-créer. C’est ainsi que l’en-
178 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 179
Jean-Luc Martineau
fant apprend à réduire la différence entre « ce qui est objective-
ment perçu et subjectivement conçu » (4). C’est en jouant que l’en- 4- D. W. W. Jeu et réalité,
fant apprivoise la réalité, tout en renonçant à l’illusion de créer p. 21.
tout ce dont il a besoin. Ainsi, grâce à l’aire transitionnelle, il peut,
à son rythme, dominer les lois de la réalité sans être écrasé par
elles. « L’aire intermédiaire à laquelle je me réfère est une aire,
allouée à l’enfant, qui se situe entre la créativité primaire et la
perception objective basée sur l’épreuve de réalité » (4).
Chez le petit enfant l’espace transitionnel est donc cet espace
intermédiaire à partir duquel il peut jouer l’essentiel de son drame,
c’est-à-dire l’absence et la présence de sa mère, sans être écrasé
ou fou. Et ainsi de tout ce qui présente la dureté des réalités objec-
tives. L’objet transitionnel symbolise le fait qu’il réussit à ne pas
être anéanti par le malheur de ne plus être tout-puissant. Ensuite
cette fonction perdure chez l’adulte où elle migre dans les activi-
tés de jeu entendu largement par toutes les activités culturelles :
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
les loisirs, le sport, les distractions de toutes sorte, les jeux de
langage, etc.
Que nous apporte cette vision de l’entrée dans la réalité du
monde ? Elle nous montre que, quand la difficulté d’être trouve son
origine dans une présentation du monde erronée, proposée par
une famille souffrante, donnant une vision rigide et étroite de soi et
de la société, c’est en introduisant du jeu, des jeux, et en les ver-
balisant, que la Gestalt peut apporter un progrès réel. N’est-ce pas
un des domaines d’excellence de la Gestalt ?
Winnicott indique clairement que la relation thérapeutique est
basée sur le jeu, mais il le dit dans plusieurs sens, à la fois pour
mettre en jeu dans le champ une figure donnée, pour donner du
jeu à ce qui coïnce, et pour donner à sa propre figure de per-
sonne supposée savoir un côté accessible, quelqu’un dont on peut
faire un certain usage. Il le dira lui-même en boutade « Si votre
client ne sait pas jouer, vous devez pouvoir lui apprendre et si vous
ne savez pas jouer vous-même, alors il faut changer de métier » !
C’est aussi par des jeux, des jeux de rôle ou des jeux d’aller-
retour entre la figure et le fond, que les relations entre la partie saine
et la partie souffrante du patient vont s’améliorer. C’est en jouant
qu’il va apprendre à utiliser sa partie saine pour prendre en charge
Revue Gestalt - N° 30 - Et la souffrance ? 179
HD-Winicott…JL Martineau 6/06/06 16:28 Page 180
Winnicott était-il gestaltiste ?
sa partie souffrante. Le jeu, la mise en jeu est un aspect essen-
tiel de notre démarche gestaltiste. Winnicott nous montre comment
le voir autrement, dans une perspective de développement.
Peut-être trouvera-t-on que c’est jouer de la pensée d’un psy-
chanalyste que de vouloir en tirer des leçons de Gestalt. C’est pos-
sible. On sait le danger d’amalgame de surface entre deux appro-
ches théoriques différentes. Il reste que nous avons en commun
de vouloir soulager des personnes souffrantes. Et il n’est pas trop
d’expériences pour nous aider à pénétrer ce qui nous est au fond
le plus étranger : le malheur d’autrui. On peut bien emprunter à
Winnicott un peu de son expérience. N’hésitons pas à nous met-
tre à l’écoute d’une si riche personnalité dont les quelques notions
évoquées plus haut sont loin de constituer la totalité du génie.
Pourquoi se priver ?
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
BIBLIOGRAPHIE
DUPARC F. (sous la direction de) : Winnicott en 4 squiggles, in press édi-
teur, Paris 2005.
GREEN A. : Jouer avec Winnicott, PUF, Paris, 2005.
LEHMANN J. P. : Le clinique analytique de Winnicott, Éres éditeur, 2003.
LITTLE M. I. : in Des états limites, Des femmes éditeur, Paris, 1991, en
particulier le chapitre « Mon analyse avec Winnicott ».
MADELEINE D., DAVID W. : Winnicott, introduction à son œuvre, PUF,
Paris, 1992.
WINNICOTT D. W. : De la pédiatrie à la psychanalyse, Payot, 1969 -
Through paedriatrics to psycho-analysis, Tavistock 1958 - Processus de
maturation chez l’enfant, Payot, 1970 - The maturational process and the
facilitating environnement, Hogarth press, 1965 - Jeu et réalité, Gallimard,
1975 - Playing and reality, Tavistock, 1971 - La Consultation thérapeuti-
que et l’enfant, Gallimard, 1972 - A psychotherapeutic consultation in child
psychiatry, Hogarth press, 1971 - La Petite « Piggle », Payot, 1980 - The
Piggle, an account of the psycho-analysis of a little girl, Hogarth press,
1978 - La Nature humaine, Gallimard, 1990 - Human Nature, Free nasso-
ciation Books, 1988 - Lettres vives, Correspondance, Gallimard, 1989 -
The spontaneous gesture, Harward universuty press, 1987 - La crainte de
l’effondrement et autres situations cliniques, Gallimard 2000, Psycho-ana-
lytic explorations, Karnak Books, 1989.
180 Revue Gestalt - N° 30 - Juin 2006
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
Page 181
16:28
6/06/06
HD-Winicott…JL Martineau
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
Page 182
16:29
6/06/06
Notes de lecture N°30
© Société française de Gestalt | Téléchargé le 17/04/2024 sur www.cairn.info (IP: 45.148.196.39)
Vous aimerez peut-être aussi
- A2tests PDFDocument45 pagesA2tests PDFAlianza Francesa Tres ArroyosPas encore d'évaluation
- Gest 037 0175Document15 pagesGest 037 0175Rebèl Jan Batis ViksamaPas encore d'évaluation
- Régression, Décharge Émotionnelle, CatharsisDocument16 pagesRégression, Décharge Émotionnelle, Catharsisvffwfsdk77Pas encore d'évaluation
- Gest 054 0078Document12 pagesGest 054 0078thietiPas encore d'évaluation
- RFPS 047 0091Document17 pagesRFPS 047 0091MANAL MOUSSAIDPas encore d'évaluation
- Gest 038 0093Document11 pagesGest 038 0093Damien BaudryPas encore d'évaluation
- Des Racines de Lauto-SabotageDocument9 pagesDes Racines de Lauto-SabotageCarol-Ann DuchesnePas encore d'évaluation
- Théorie Clinique de La RégressionDocument11 pagesThéorie Clinique de La Régressionvffwfsdk77Pas encore d'évaluation
- JDP 386 0020Document7 pagesJDP 386 0020Damien BaudryPas encore d'évaluation
- La Sante Selon WinnicottDocument18 pagesLa Sante Selon Winnicottimane aziziPas encore d'évaluation
- De Sophie Morgenstern L'oubliée À Françoise Dolto La TapageuseDocument5 pagesDe Sophie Morgenstern L'oubliée À Françoise Dolto La TapageuseAllegue KarimaPas encore d'évaluation
- Évaluer Le Développement DurableDocument18 pagesÉvaluer Le Développement DurableadobiraphaelgeorgiPas encore d'évaluation
- Leph 081 0071Document26 pagesLeph 081 0071matix08430Pas encore d'évaluation
- Snap ChatDocument6 pagesSnap ChatNadi HamidPas encore d'évaluation
- Psye 561 0005Document33 pagesPsye 561 0005Vlad GhionoiuPas encore d'évaluation
- Rodrigo L'onto-Logique de L'événement Chez WhiteheadDocument17 pagesRodrigo L'onto-Logique de L'événement Chez WhiteheadPhilippeGagnonPas encore d'évaluation
- La Stratégie en ThéoriesDocument15 pagesLa Stratégie en ThéoriesManuela MPas encore d'évaluation
- Psye 441 0169Document46 pagesPsye 441 0169sandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- Pourquoi La Maladie Et Le Réflexe Dans La Philosophie Biomédicale de Canguilhem ?Document10 pagesPourquoi La Maladie Et Le Réflexe Dans La Philosophie Biomédicale de Canguilhem ?Yi-Ying TsaiPas encore d'évaluation
- Rips1 064 0067Document37 pagesRips1 064 0067turkikramPas encore d'évaluation
- RFP 862 0277Document12 pagesRFP 862 0277dekraPas encore d'évaluation
- Longo Esthétique de La SpéculationDocument14 pagesLongo Esthétique de La SpéculationDaniel ErixPas encore d'évaluation
- Ling 501 0035Document41 pagesLing 501 0035Hakim AjaidiPas encore d'évaluation
- Du Processus Psychanalytique À La Cure de ParoleDocument9 pagesDu Processus Psychanalytique À La Cure de ParoleTimothy PricePas encore d'évaluation
- Échelle de Dépistage BBDocument8 pagesÉchelle de Dépistage BBsandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- Sava 045 0007Document6 pagesSava 045 0007Ali MouzaouiPas encore d'évaluation
- Anso 152 0457Document27 pagesAnso 152 0457iliasraj10Pas encore d'évaluation
- Dio 197 0059Document7 pagesDio 197 0059Cayo YandjuePas encore d'évaluation
- Puf Soler 2009 01 0205Document11 pagesPuf Soler 2009 01 0205julienboyerPas encore d'évaluation
- Cdu 067 0014Document10 pagesCdu 067 0014SamuelLaperchePas encore d'évaluation
- Que Faire de Notre VulnérabilitéDocument13 pagesQue Faire de Notre Vulnérabilitéel fatehy boujemaaPas encore d'évaluation
- Ri 133 0041Document13 pagesRi 133 0041fatoumatadiallo.2101Pas encore d'évaluation
- RN 161 0002Document4 pagesRN 161 0002marine henryPas encore d'évaluation
- L'évaluation Du Comportement de Retrait Relationnel Du Jeune Enfant Lors de L'examen Pédiatrique Par L'échelle D'alarme Détresse Bébé (Adbb)Document22 pagesL'évaluation Du Comportement de Retrait Relationnel Du Jeune Enfant Lors de L'examen Pédiatrique Par L'échelle D'alarme Détresse Bébé (Adbb)sandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- La Raison D'état MachiavelDocument16 pagesLa Raison D'état MachiavelIssoufou Boubacar SouleymanePas encore d'évaluation
- 1 - Mediation, Quand Tu Nous Tiens !Document5 pages1 - Mediation, Quand Tu Nous Tiens !lea.delestPas encore d'évaluation
- Les Cartes Dixit Dans Une Approche Orient e Comp Tences 1703499187Document14 pagesLes Cartes Dixit Dans Une Approche Orient e Comp Tences 1703499187Merya DefanaPas encore d'évaluation
- 2 - Andre Bullinger Et La Question Du DualismeDocument17 pages2 - Andre Bullinger Et La Question Du Dualismelea.delestPas encore d'évaluation
- Zafiropoulos, Markos - Du Père Mort Au Déclin Du Père de Famille Où Va La PsychanalyseDocument255 pagesZafiropoulos, Markos - Du Père Mort Au Déclin Du Père de Famille Où Va La PsychanalyseJohn ErikePas encore d'évaluation
- Rmi 204 0157Document13 pagesRmi 204 0157hasnaPas encore d'évaluation
- Puf Zenat 1994 01 0000Document15 pagesPuf Zenat 1994 01 0000OiehjcvnjsPas encore d'évaluation
- Cdu 045 0034Document13 pagesCdu 045 0034pbouvigniesitmPas encore d'évaluation
- 3 - Mediation. Therapeutique. CorpsDocument7 pages3 - Mediation. Therapeutique. Corpslea.delestPas encore d'évaluation
- L'Organisation de La Financiarisation LBO - 2018Document34 pagesL'Organisation de La Financiarisation LBO - 2018Manal AFconsultingPas encore d'évaluation
- Anso 201 0153Document23 pagesAnso 201 0153matix08430Pas encore d'évaluation
- JDP 337 0046Document5 pagesJDP 337 0046sandrine Bonnefont-DesiagePas encore d'évaluation
- Bardout J.-C. - Malebranche Et Les Mondes ImpossiblesDocument19 pagesBardout J.-C. - Malebranche Et Les Mondes Impossiblesdescartes85Pas encore d'évaluation
- Moreau UtopieDocument17 pagesMoreau UtopienachazPas encore d'évaluation
- Herméneutique Critique LittéraireDocument3 pagesHerméneutique Critique LittéraireTasedlistPas encore d'évaluation
- Croyance Religieuse Et NarcissismeDocument8 pagesCroyance Religieuse Et NarcissismeFRANCOISPas encore d'évaluation
- Du Cinétisme de La Signification LexicaleDocument21 pagesDu Cinétisme de La Signification LexicaleagusPas encore d'évaluation
- Leph 011 0049Document19 pagesLeph 011 0049Jean-Paul Friedrich NgabuPas encore d'évaluation
- Leph 082 0209Document15 pagesLeph 082 0209AbrahamPas encore d'évaluation
- Cips 117 0119Document27 pagesCips 117 0119Adolfo SalgadoPas encore d'évaluation
- La Psychanalyse Est-Elle Réfutable (Roger Perron)Document14 pagesLa Psychanalyse Est-Elle Réfutable (Roger Perron)bazenmatthieuPas encore d'évaluation
- Nre 022 0055Document11 pagesNre 022 0055Dominique DemartiniPas encore d'évaluation
- Rôle Du Marketing en Conception Innovante: Les Leçons Du Cas AxaneDocument17 pagesRôle Du Marketing en Conception Innovante: Les Leçons Du Cas AxaneYasmine MadmadiPas encore d'évaluation
- Les Sans Domicile FixeDocument2 pagesLes Sans Domicile FixelcdseverinePas encore d'évaluation
- Anso 182 0295Document21 pagesAnso 182 0295Lissy Romero JimenezPas encore d'évaluation
- Les GrenadesDocument9 pagesLes Grenadesgael.gellePas encore d'évaluation
- Entre dollar et cryptomonnaies: Le défi des sanctions pour l'EuropeD'EverandEntre dollar et cryptomonnaies: Le défi des sanctions pour l'EuropePas encore d'évaluation
- d6.1 Cawtar FinalDocument23 pagesd6.1 Cawtar FinalMahmoud YagoubiPas encore d'évaluation
- Genette NarratologieDocument3 pagesGenette Narratologieismail yassinePas encore d'évaluation
- Thèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETDocument135 pagesThèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETMélanie LE ROYPas encore d'évaluation
- Marketing Interne Rapport FinalDocument23 pagesMarketing Interne Rapport FinalSalwa MoumènPas encore d'évaluation
- Le Système ClimatiqueDocument5 pagesLe Système ClimatiqueNatacha DUROSEPas encore d'évaluation
- 3chap0 Fiche 1 PDFDocument1 page3chap0 Fiche 1 PDFPout InePas encore d'évaluation
- BBU Guide-bonnes-pratiques-V7 WEBDocument59 pagesBBU Guide-bonnes-pratiques-V7 WEBHa NanePas encore d'évaluation
- Fiches Sons Période 3Document11 pagesFiches Sons Période 3hichbivk hichbivkPas encore d'évaluation
- 985 PDFDocument28 pages985 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- ARTICLE FINALE PAR DR IKAPIDocument10 pagesARTICLE FINALE PAR DR IKAPIntoutoume.scientoPas encore d'évaluation
- Decembre 07Document10 pagesDecembre 07Best OffensivePas encore d'évaluation
- BVH2083FRDocument10 pagesBVH2083FRFranck Aristide DoyaPas encore d'évaluation
- Rapport D'activité 2011 - Fondation Pour La Mémoire de La ShoahDocument54 pagesRapport D'activité 2011 - Fondation Pour La Mémoire de La ShoahFondation pour la Mémoire de la ShoahPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document11 pagesChapitre 3Yessine BouhamedPas encore d'évaluation
- Geometrie CM1Document39 pagesGeometrie CM1girardPas encore d'évaluation
- Les Sons Complexes Cartes Mentales3Document3 pagesLes Sons Complexes Cartes Mentales3fatimatou2607Pas encore d'évaluation
- Brevet Polynesie Sept 2003Document3 pagesBrevet Polynesie Sept 2003vik 006Pas encore d'évaluation
- Le 11 Octobre 2020Document2 pagesLe 11 Octobre 2020Houcem TrabelsiPas encore d'évaluation
- Didactique Des Langues Approche CulturelleDocument4 pagesDidactique Des Langues Approche CulturelleM'barkiAbdellahElPas encore d'évaluation
- Types de CommutationDocument6 pagesTypes de CommutationMuhamed Yussuf H'ajji100% (2)
- MemoireDocument71 pagesMemoireAissa JupiterPas encore d'évaluation
- L3 TheorieGroupes - TD2 CorrigeDocument15 pagesL3 TheorieGroupes - TD2 CorrigeJonah LJDPas encore d'évaluation
- Cinquante +Document148 pagesCinquante +SPORTIFSMAGAZINEPas encore d'évaluation
- Classification GenDocument3 pagesClassification GenolfaPas encore d'évaluation
- Fiches Pedagogiques Asc2 Francais Au College STR IDocument89 pagesFiches Pedagogiques Asc2 Francais Au College STR IFatii MaPas encore d'évaluation
- Cameroun Le Temps de La Diplomatie ScientifiqueDocument142 pagesCameroun Le Temps de La Diplomatie ScientifiqueandelajoelPas encore d'évaluation
- Fiche PDFDocument4 pagesFiche PDFDadati SouPas encore d'évaluation