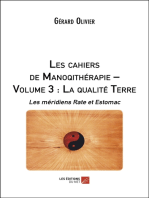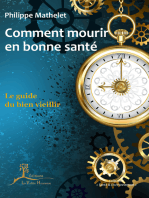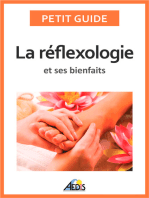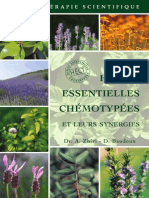Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Le Sang Et Les Défenses Médecine Chinoise
Transféré par
EllisgoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Le Sang Et Les Défenses Médecine Chinoise
Transféré par
EllisgoDroits d'auteur :
Formats disponibles
1
Docteur Jacques COVIN
Prsident de lASOFORMEC
XVimes Journes de la FAFORMEC Abbaye Royale de Fontevraud 25 & 26 novembre 2011
Le Sang et les dfenses
xe wi
I Point de vue de la mdecine occidentale :
1 Les mcanismes de dfense :
Les mcanismes de dfense regroupent tous les phnomnes qui maintiennent lintgrit de lorganisme. Ils utilisent des processus de mmorisation cods, invariables, hrditaires. Ils comprennent la raction inflammatoire, les agents cellulaires et les facteurs humoraux. Ils peuvent mettre en route les phnomnes dimmunit, celle-ci tant dfinie comme la discrimination entre le Soi et le Non-Soi.
2 La raction inflammatoire :
1. tape mtabolique : agrgation plaquettaire, dgradation mastocytaire, scrtions de mdiateurs (srotonine, histamine, prostaglandines, leucotrines, thromboxane). 2. tape vasculaire : une vasodilatation in situ engendre une exsudation plasmatique de substances anti-bactriennes (complment, transferrine, hapto-globuline, neuropeptides, ). 3. accumulation cellulaire : granulocytes, puis monocytes. 4. phagocytose : six heures aprs lagression, libration in situ de macrophages avec dgranulation des leucocytes et libration dune enzyme hydrolysante pour la destruction bactrienne.
3 Les agents cellulaires :
Ce sont les phagocytes du sang qui regroupent les granulocytes et les macrophages. Les granulocytes (polynuclaires neutrophiles et polynuclaires osinophiles) dtruisent les agents pathognes, soit en les digrant, soit en mourant, engendrant alors le pus. Les macrophages, provenant des monocytes, sont capables : - de moduler la fivre, linflammation et limmunostimulation. - dinduire limmunosuppression par les prostaglandines. - dagir sur les infections virales par linterfron alpha.
4 Les facteurs humoraux :
Le lysozyme : cest une enzyme hydrolysante qui agit sur les mucopolysaccharides et dtruit les parois de certaines bactries. Il est prsent dans certains liquides organiques, dont les larmes, et dans de nombreux tissus. Le complment : cest une substance thermolabile complexe prsente dans le srum normal et comprenant neuf fractions. Cette substance est capable de dtruire les bactries.
5 La rponse immunitaire :
Elle peut tre humorale (avec les anticorps qui sont des immunoglobulines produites par le lymphocytes B), ou cellulaire (lymphocytes T et cellules NK, natural killer). Les lymphocytes B : ils sont produits par la moelle osseuse. Quand un lymphocyte B rencontre un antigne spcifique, il prolifre et engendre des plasmocytes et des cellules mmoire (qui ragissent donc plus rapidement), avec scrtion dune grande quantit danticorps. Les anticorps (ou immunoglobulines) sont surtout responsables de lopsonisation (processus par lequel les bactries sont altres de telle sorte quelles puissent tre englouties par les phagocytes). Les immunoglobulines A sont apparentes une glu qui empche lentre des facteurs pathognes travers la muqueuse. Elles sont retrouves dans la salive, les larmes, les scrtions bronchiques et digestives. Elles fournissent une dfense prcoce contre les virus et les bactries. Les immunoglobulines G reprsentent le premier mdiateur de la rponse immune secondaire contre les virus et les bactries. Elles neutralisent les toxines bactriennes, fixent le complment et stimulent la phagocytose par opsonisation. Elles provoquent lagglutination et la cytolyse. Elles jouent un rle dans la rponse mmoire . Les immunoglobulines M sont les premires apparatre aprs stimulation antignique. Elles rduisent la diffusion des particules extra-cellulaires, toxines, etc. Elles fixent le complment, assurent lopsonisation, provoquent lagglutination et la cytolyse.
Les lymphocytes T : ils sont lis limmunit rponse cellulaire. Les cellules tueuses T cytotoxiques agissent sur les cellules infectes par les virus, elles induisent la lyse des cellules infectes par perforation ou dsintgration interne.
3 Linterfron : cest une glycoprotine, spcifique de lespce infecte. Il est rapidement produit par les cellules infectes par le virus, inhibe la reproduction virale et stimule galement la raction immunitaire cellulaire.
II Point de vue de la mdecine chinoise traditionnelle :
1 Etude du caractre
wi : dfense.
La partie centrale est forme du caractre wi qui reprsente le cuir travaill (deux hommes qui tirent et retournent la peau pour la tanner et obtenir ainsi le cuir dont on fait les cuirasses, les boucliers, les protections) ; le sens de ce caractre est protger, comme les gardes protgent le roi en lentourant . Ce caractre est plac au centre du caractre xng qui signifie faire route, marcher en bon ordre, corps darme ; linterprtation traditionnelle y voit le tour de garde accompli par la patrouille militaire, le mouvement rgulier des guetteurs qui arpentent les chemins de garde autour du palais. Le caractre wi signifie donc escorter, protger, dfendre ; il dsigne aussi la zone concentrique entourant le domaine imprial, la plus extrieure, formant donc les frontires du pays.
2 Les agents pathognes :
En Mdecine Traditionnelle Chinoise, la maladie (bng yn yng
) apparat lorsque les activits du
se drglent, dclenchant des mouvements contraires lordre naturel.
Cette dsorganisation du yn yng, des Essences et des Souffles, de leurs circulations et de leurs transformations, peut tre provoque par des causes exognes, endognes ou non exognes non endognes.
- Les causes exognes : les six drglements li yn
Quand : les six Souffles des quatre saisons sont en excs, ils dbordent de leur temps normal, ils sont trop faibles ou quils narrivent pas en leur temps, alors, ils ne sont plus corrects et leurs drglements peuvent engendrer des maladies. Ces agents pathognes externes pntrent dans le corps par la peau ou les voies respiratoires, pervertissant les Souffles corrects de lorganisme.
4 - Vent fng
: il correspond au printemps. :
cest la chaleur torride du plein t qui succde la
- Chaleur sh
chaleur plus douce davant le solstice dt, appele la Tideur wn
- Humidit sh : elle correspond la fin de lt et au dbut de lautomne. - Scheresse zo - Froid hn
: elle correspond lautomne.
: il correspond lhiver.
- Feu ho : quand on fait correspondre ces six agents pathognes aux Cinq Modalits, le Feu disparat et seule la Chaleur correspond alors llment Feu. Le Feu existe en tant quEnergie naturelle du corps : par exemple, le Feu de mng mn , indispensable la production du Souffle. Ici, le Feu pathogne correspond une chaleur forte, brlante, engendrant la monte et lagitation. Le plus souvent le Feu pathogne est dorigine interne, produit par une perturbation physiologique ou par la transformation des motions ; on parle alors de Chaleur interne (ni r ).
- Les causes endognes : les sept sentiments q qng
En Mdecine Traditionnelle Chinoise, les ractions motionnelles sont vues comme des perturbations des mouvements normalement rguls du Souffle. Les ractions motionnelles, lorsquelles ne dpassent pas certaines limites, font partie du fonctionnement normal de tout tre humain. A la suite de perturbations brutales, prolonges ou rptes, elles peuvent prendre des proportions excessives et perturber lorganisme en stimulant trop fortement les mouvements spcifiques des Souffles ; ces ractions motionnelles peuvent alors directement affecter les Organes-recel (zng ) et provoquer ainsi des maladies.
5 Les sept sentiments sont dcrits dans le chapitre 39 du Huang Di Nei Jing Su Wen
:
- la colre n : elle est rapporte au Foie gn ; la colre fait refluer le Souffle vers le haut. - lallgresse x : elle est rapporte au Cur-conscience xn ; lallgresse ralentit le Souffle car laire de dploiement de celui-ci est plus large. Remarque : l : la joie, cest le bien-tre dune vie qui compose harmonieusement ses lments et ressent ainsi la vibration cleste. - la frayeur jng : elle est rapporte au Cur-conscience xn ; la frayeur trouble le Souffle. - la pense obsessionnelle s : elle est rapporte la Rate p ; la pense obsessionnelle entrane une stagnation du Souffle qui est alors nou : lEsprit individuel shn , peine parti, revient ! - la tristesse bi : elle est rapporte au Poumon fi ; la tristesse entrane une dissolution du Souffle. La tristesse correspond un mouvement chronique, se rapprochant ainsi de la mlancolie. - le chagrin yu : il est rapport au Poumon fi ; le chagrin entrane une dissolution du Souffle. Le chagrin est un sentiment teint danxit correspondant une compression dun territoire de dialogue affectif, un territoire du Cur-conscience ntant plus alors fonctionnel ; cest un mouvement brutal, aigu. - la peur kng : elle est rapporte aux Reins shn ; la peur entrave la circulation du Souffle.
- Les causes non exognes non endognes :
- Lalimentation yn sh : Elle est indispensable la vie de lHomme. Elle peut devenir une cause de maladie lorsque : les aliments sont quantitativement inadapts, elle comporte des substances impropres la consommation, elle est dsquilibre sur le plan de lquilibre yn yng, de la nature des aliments ou de la prdominance dune saveur particulire. - Les pidmies y l : Ce sont des maladies trs contagieuses qui apparaissent brutalement et prsentent des signes de toxicit levs. Elles dpendent souvent de facteurs lis lenvironnement, lalimentation et / ou aux conditions sociales. - Lexcs de travail ou dinactivit lo y
Lexcs de travail peut tre : o physique, induisant un puisement progressif des Souffles. o intellectuel, avec puisement de lEnergie de la Rate et du Sang du Cur. o sexuel, entranant lpuisement du Principe Vital des Reins. Lexcs dinactivit perturbe la circulation du Souffle et du Sang. - Les traumatismes wi shng : Ce sont les blessures causes par les armes, les traumatismes divers, les brlures, les engelures, les piqres ou les morsures danimaux - Les parasitoses j shng chng : Lingestion daliments souills en est la cause principale.
3 Les agents de dfense : Le Foie gn
Il thsaurise (cng
) le Sang.
Le chapitre 8 du Huang Di Nei Jing Su Wen nous dit : Le Foie a la charge de commandant des armes ; analyse de conjoncture et conception des plans en procdent . Le Foie donne llan pour faire circuler et scouler, pour faire pntrer partout sans difficults et sans obstacles, permettant ainsi le bon dplacement des Souffles, ce qui permet alors le bon fonctionnement des Organes Il garde le Sang (base yn) et en rgule la quantit disponible dans lorganisme en le librant propos (effet yng). Par sa capacit dgager les blocages, il empche les motions et penses de sincruster dans lEsprit et dy faire des nuds, ce qui pourrait alors agiter celui-ci et lempcher de se librer.
Le Sang : xe
Le Sang est la visibilit de la vie. A la diffrence du Souffle Energie (q ), il est de nature matrielle : il est dfini comme un liquide rouge, trs nutritif, qui circule dans les vaisseaux. Il abrite le hn , esprit associ au Foie. Sa formation est dcrite dans le chapitre 81 du Huang Di Nei Jing Ling Shu
:
chng wi shu g zhng jio ch q r l shng zh x g r shn sn mi jn y h tio bin ha r ch wi xe LEstomac et les Intestins reoivent les grains le Foyer moyen fait sortir le Souffle Energie comme de la rose (= ce sont les Souffles porteurs de Liquides Organiques extrmement labors), cela monte et se dverse dans les petites et les grandes valles (= les espaces inter-musculaires), et pntre dans les vaisseaux fins comme des fils (= les capillaires) ; les Liquides Organiques superficiels et profonds sharmonisent et saccommodent, il y a alors changement et mtamorphose et cela devient alors rouge pour former le Sang.
8 Sa formation se fait donc partir des saveurs subtiles alimentaires (shu g jng wi
) transportes et transformes par lEstomac-duodnum et la Rate ; celle-ci fait monter
la partie pure, travers le diaphragme, vers le Poumon o elle se combine la partie pure de lair inspir. Le Poumon la dirige ensuite vers le Cur et le Matre Cur ( le Cur qui agit en matre ) et vers la superficie du corps o le Sang est alors form. LEnergie nourricire (rng q ou yng q ) et le Sang peuvent tre considrs comme deux aspects dune mme ralit. Les Liquides Organiques pntrent galement dans les Vaisseaux o ils maintiennent et rgularisent la concentration du Sang. La formation du Sang peut aussi se faire partir du Principe Vital (jng ) du Ciel antrieur contenu dans le Rein yn et qui peut se transformer en Sang avec la participation du Foie. Les Reins sont les gardiens des Essences originelles : la fonction du Rein yn est de modeler les Essences, assimiles par la digestion, sur le yn originel (yun yn ) de faon ce que les Essences prsentes et actives de lorganisme soient fidles au yn authentique (zhn yn ). Si les Essences ont la qualit requise, les Souffles seront eux aussi fidles au modle originel. Le Rein yng est garant de la quantit et de la force des Souffles, il soutient le yng originel (yun yng
), ou yng authentique (zhn yng ), appel aussi Feu de mng mn
( ). Le Feu de mng mn est ce qui permet la vie de dbuter et de continuer jusqu son terme, en maintenant le fonctionnement du systme organique et des circulations vitales.
Le Sang et les Souffles : xe q
Le Sang vivifiant nexiste jamais sans les Souffles. La ralit du Sang, cest un Sang qui circule, se distribue, se rgnre, cest--dire un Sang pntr par les Souffles. Sang et Souffles prsentent une intimit totale, une compntration dans laquelle les deux lments sont insparables. La prsence dun agent pathogne modifie lharmonie yn yng de la vitalit, ce qui est une altration du Sang et des Souffles.
Le Souffle authentique (zhn q ) : lauthenticit rside dans la fidlit au naturel, sa propre nature ; cest lintgration au plus profond de soi-mme du mouvement de la vie, analogue, en soi-mme, ce quil est dans lUnivers. Laccent est mis ici sur la fidlit la source de vie.
9 Le Souffle correct (zhng q
) : il suit les rgles des changes harmonieux du yn et du yng et soppose aux Souffles pervers (xi q ).
Le Souffle correct nest pas autre chose que le Souffle authentique, mais ici laccent est mis sur le bon fonctionnement de lorganisme. Avoir un Souffle correct de bonne qualit permet lorganisme de bien se dfendre contre lattaque des Pervers.
LEnergie dfensive (wi q ) : elle sassocie lEnergie correcte pour former les principes essentiels capables de protger le Soi et capables de maintenir lintgrit de celui-ci. Elle se renouvelle partir de lalimentation : tant yng, elle sappuie constamment sur le yn pour nourrir sa puissance. Sa force centrifuge, ses qualits, prennent leur origine au Rchauffeur infrieur (xa jia ), exprimant la potentialit du yng originel (yun yng ). Elle enregistre ainsi, sa source, linfluence subtile des dfenses archaques de la ligne et de lespce et en subit aussi les tensions et les dsirs. LEnergie dfensive a une action sur les causes exognes des maladies : pendant la veille, le Sang est extrioris, pouss par lEnergie dfensive, partir des yeux, vers les points puits (jng ) aux extrmits du corps. LEnergie dfensive parcourt alors 25 tours (chaque tour seffectuant en 28 minutes et 42 secondes, temps pendant lequel le niveau deau de la clepsydre descend de deux encoches), en suivant les mridiens appels tendino-musculaires (jng jn mouvement musculaire li un mridien ). Ce sont de larges bandes de diffusion sur la peau, les tendons et les muscles ; ces zones daction dterminent le pouvoir de lEnergie dfensive de rchauffement et de dfense de la peau, en dirigeant la thermo-rgulation et certains aspects de la sudation. Principalement actifs en superficie, lavers (bio ), zone de la peau et des poils, elle y maintient la juste temprature, y assure la circulation des Liquides et la bonne irrigation des couches de la peau ; elle contrle louverture et la fermeture des pores, laissant sortir la sueur et retenant les fluides essentiels. LEnergie dfensive a aussi une action sur les causes endognes des maladies : au moment de lentre dans le sommeil, il se produit un renversement de cette Energie, du Sang en direction de lIntrieur, lEnergie dfensive pntrant par la voie du mridien des Reins vers les cinq Organes-recel (zng ). Elle passe alors, dans sa dynamique nocturne, cinq fois dans chacun des cinq Organe-recel selon le cycle de contrle ou de domination (xang k ou xang shng ) de la loi des Cinq Mouvements (w xng ). Cette dynamique de contrle, plac sous la responsabilit du Foie, reprsente une remise en ordre avec vacuation des Energies indsirables.
10 LEnergie dfensive complte donc son rle diurne par une activit nocturne destine exprimer et rsoudre dventuels conflits au sein des Organes-recel ou entre les Organesrecel eux-mmes. Son circuit dans les cinq Organes-recel, partir des Reins, permet ces Souffles de garder les biorythmes spcifiques de lindividu, denraciner et de soutenir limmunit. Une partie de cette action sexprime sous forme de rves (mng ) qui apparaissent pendant les phases paradoxales du sommeil, lindividu possdant alors la capacit de contempler (sh voir avec les yeux de lEsprit ) en lui-mme. Pendant le sommeil, le Sang et le hn retournent au Foie, dirigeant toute lactivit onirique nocturne (ils ninterviennent cependant de faon active quau cours des cinq priodes pendant lesquelles lEnergie dfensive dpendra du Foie). On peut supposer que lensemble des motions, des dsirs, des tensions, des dfenses et des peurs survenus pendant la priode de veille prcdente, ait pu avoir une influence directe sur lEnergie dfensive en y imprimant une empreinte nergtique participant ainsi au scnario des rves. Remarque sur les rves : ceux-ci peuvent tre classs en cinq catgories : - le rve psychologique : il trouve son origine dans les sentiments et les penses du jour qui, ne pouvant sexprimer totalement le jour, vont trouver dans le rve un excutoire. - le rve physiologique : il trouve son origine dans les stimuli externes qui entravent le bien-tre du corps et que celui-ci peroit pendant le sommeil au moyen de lun de ses cinq sens. Il exprime la sensation lie au stimulus externe selon une logique symbolique qui sappui sur les souvenirs propres chaque individu. - le rve organique nergtique : cest un rve psychologique qui exprime un risque de somatisation ; il est lexpression dun dysfonctionnement nergtique au sein des Organes-recel. Le drglement nergtique engendrera en rve principalement de la peur, le corps tant menac, mais aussi un excs motionnel en relation avec les correspondances entre les Organes-recel et les Emotions. Il sexprime travers un contenu motionnel commun tous les Hommes, quelle quen soit leur culture. - le rve pathologique : il est lexpression du corps malade, cest--dire dj pntr par les Pervers. - le rve symptomatique : il exprime le symptme dune pathologie. Il engendrera plutt de la douleur, ou tout du moins un sentiment dinconfort, une sensation dsagrable car le corps est souffrant. Il exprime la sensation lie au symptme selon une logique symbolique qui sappui sur les souvenirs propres chaque individu.
11
Bibliographie : Bossy Jean Acupuncture et immunit Encyclopdie des mdecines naturelles Editions Frison-Roche 1996 Connaissance de lAcupuncture Ming Men porte de la vie Editions You Feng 2010 Dictionnaire Ricci des Caractres Chinois Instituts Ricci (Paris-Taipei) Descle de Brouwer Paris 1999 Eyssalet Jean-Marc La rumeur du dragon et lordre du tigre Guy Trdaniel diteur 1999 Eyssalet Jean-Marc Sminaires de lInstitut de Dveloppement des Etudes en Energtique et Sinologie (IDEES) Paris. Lng sh Traduction et commentaires de Constantin Milsky & Gilles Andrs Edition La Tisserande 2009 Mari Eric Prcis de mdecine chinoise Editions Dangles 2008 Rochat de la Valle Elisabeth Les 101 notions-cls de la mdecine chinoise Guy Trdaniel diteur 2009 Rochat de la Valle Elisabeth & Larre Claude La vie, la mdecine et la sagesse ; S Wn, les onze premiers traits Les ditions du Cerf / Institut Ricci 2005 Sapriel Marc & Stoltz Patrick Une introduction la mdecine traditionnelle chinoise. Le corps thorique Springer 2006 Vavril Rudy La science des rves en Chine Editions You Feng 2010
Vous aimerez peut-être aussi
- Les cahiers de Manoqithérapie – Volume 3 : La qualité Terre: Les méridiens Rate et EstomacD'EverandLes cahiers de Manoqithérapie – Volume 3 : La qualité Terre: Les méridiens Rate et EstomacPas encore d'évaluation
- Les cahiers de Manoqithérapie – Volume 1 : La qualité Métal: Les méridiens Poumon et Gros IntestinD'EverandLes cahiers de Manoqithérapie – Volume 1 : La qualité Métal: Les méridiens Poumon et Gros IntestinPas encore d'évaluation
- Les cahiers de Manoqithérapie - Volume 2 : La qualité Feu: Les méridiens Coeur, Intestin Grêle Maître-Coeur et Triple RéchauffeurD'EverandLes cahiers de Manoqithérapie - Volume 2 : La qualité Feu: Les méridiens Coeur, Intestin Grêle Maître-Coeur et Triple RéchauffeurPas encore d'évaluation
- Comment mourir en bonne santé: Le guide du bien vieillirD'EverandComment mourir en bonne santé: Le guide du bien vieillirPas encore d'évaluation
- La réflexologie et ses bienfaits: Une médecine alternative pour avoir une bonne hygiène de vieD'EverandLa réflexologie et ses bienfaits: Une médecine alternative pour avoir une bonne hygiène de viePas encore d'évaluation
- Anatomie Humaine: Un Manuel Pratique et Intuitif pour Découvrir le Corps Humain et Toutes ses ComposantesD'EverandAnatomie Humaine: Un Manuel Pratique et Intuitif pour Découvrir le Corps Humain et Toutes ses ComposantesPas encore d'évaluation
- La guérison est en vous !: S'informer et comprendre pour une santé durableD'EverandLa guérison est en vous !: S'informer et comprendre pour une santé durablePas encore d'évaluation
- Examen Des Pouls 2011-2012Document9 pagesExamen Des Pouls 2011-2012superser123465100% (2)
- 4 Examens Synthese 2009-2010 PDFDocument39 pages4 Examens Synthese 2009-2010 PDFPaula Vieira Martins50% (2)
- Les fondations du Système d'Équilibrage des Méridiens: Manuel de référence cliniqueD'EverandLes fondations du Système d'Équilibrage des Méridiens: Manuel de référence cliniqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Meridien S CurieuxDocument25 pagesMeridien S Curieuxhonore belloti100% (1)
- 6h Syndromes ZangFu-1Document17 pages6h Syndromes ZangFu-1api-26081450100% (2)
- 1A - YinYang - CorrigeDocument8 pages1A - YinYang - Corrigesuperser123465Pas encore d'évaluation
- Le Triple RechauffeurDocument22 pagesLe Triple Rechauffeursuperser123465Pas encore d'évaluation
- Prescriptions Courantes en Acupuncture Abdominales PDFDocument1 pagePrescriptions Courantes en Acupuncture Abdominales PDFraskolnikov20Pas encore d'évaluation
- L'Acupuncture Chinoise Véritable (Traduit): Doctrine - Diagnostic - ThérapieD'EverandL'Acupuncture Chinoise Véritable (Traduit): Doctrine - Diagnostic - ThérapiePas encore d'évaluation
- Dietetique Chinoise en ResumeDocument11 pagesDietetique Chinoise en ResumeKathia Silva100% (1)
- Méthode Du Point Unique 1Document3 pagesMéthode Du Point Unique 1noisat100% (1)
- Sem2011 Kpole Efficience 9 EMARIEDocument22 pagesSem2011 Kpole Efficience 9 EMARIEpacha19100% (1)
- La Conception Des Maladies de Tiedeur Dans La Medecine Chinoise (The Conception of Warm Diseases in Chinese Medicine)Document47 pagesLa Conception Des Maladies de Tiedeur Dans La Medecine Chinoise (The Conception of Warm Diseases in Chinese Medicine)Upiperi100% (2)
- Les BIDocument100 pagesLes BICeciliavas100% (1)
- Les ZangDocument17 pagesLes Zangsuperser123465Pas encore d'évaluation
- Le Ren Mai Dans Le Zhen Jiu Jia Yi JingDocument24 pagesLe Ren Mai Dans Le Zhen Jiu Jia Yi Jingsuperser123465100% (1)
- Principes Fondamentaux de La Medecine ChinoiseDocument48 pagesPrincipes Fondamentaux de La Medecine ChinoiserichplusPas encore d'évaluation
- Les Six Niveaux EnergetiquesDocument9 pagesLes Six Niveaux EnergetiquesJulien CatherinePas encore d'évaluation
- Interrogatoire en MTC La Chanson Des Dix QuestionsDocument10 pagesInterrogatoire en MTC La Chanson Des Dix QuestionsSonia Losson100% (1)
- InsomnieDocument3 pagesInsomnielexpo100% (1)
- Recherches Sur Les Origines Et La Formation de La Médecine Traditionnelle Chinoise - Un Guide de Référence Du Classique de L'intérieur de L'empereur Jaune Huang Di Nei Jing Et Ses Origines PDFDocument208 pagesRecherches Sur Les Origines Et La Formation de La Médecine Traditionnelle Chinoise - Un Guide de Référence Du Classique de L'intérieur de L'empereur Jaune Huang Di Nei Jing Et Ses Origines PDFOlivier Sinder100% (1)
- Pts Shu AntiquesDocument95 pagesPts Shu AntiquesmarioPas encore d'évaluation
- Principaux Groupes de Points AcupunctureDocument72 pagesPrincipaux Groupes de Points AcupunctureAntiSpamReg100% (2)
- Syndrome WeiDocument10 pagesSyndrome Weisuperser123465Pas encore d'évaluation
- Epuisement Du Rein Et Acupuncture MemoireDocument48 pagesEpuisement Du Rein Et Acupuncture MemoireZakia Rahali100% (1)
- 4 Examens PDFDocument39 pages4 Examens PDFsuperser123465100% (2)
- Les Différents Styles D'acupuncture - Chinoise, Taiwanaise (Tung), Coréenne (SaAm, Sasang), Japonaise...Document4 pagesLes Différents Styles D'acupuncture - Chinoise, Taiwanaise (Tung), Coréenne (SaAm, Sasang), Japonaise...nathcravo100% (1)
- Les Principes Fondamentaux de La M Eacute Decine Chinoise PDFDocument2 pagesLes Principes Fondamentaux de La M Eacute Decine Chinoise PDFAlinour AmenaPas encore d'évaluation
- Marié Eric - Grand Formulaire de Pharmacopée Chinoise PDFDocument970 pagesMarié Eric - Grand Formulaire de Pharmacopée Chinoise PDFspandaa100% (11)
- Medecine ChinoiseDocument29 pagesMedecine Chinoisejonathan.boussoir22150% (1)
- Les Six Grands Meridiens IIDocument16 pagesLes Six Grands Meridiens IISylvieMartin100% (1)
- Détails Des 12 Principaux Méridiens de La Médecine ChinoiseDocument33 pagesDétails Des 12 Principaux Méridiens de La Médecine ChinoiseDavid Brun100% (4)
- Soulie Acuponcture PDFDocument197 pagesSoulie Acuponcture PDFJhonSea100% (1)
- Les Six Grands Meridiens IDocument10 pagesLes Six Grands Meridiens ISylvieMartinPas encore d'évaluation
- Le Pouls ChinoisDocument26 pagesLe Pouls Chinoissuperser123465100% (2)
- 11 Le Maitre Du Coeur Le Tripple Rechauffeur Et La Grossesse EYSSALETDocument18 pages11 Le Maitre Du Coeur Le Tripple Rechauffeur Et La Grossesse EYSSALETMarc ValléePas encore d'évaluation
- Généralités en AuriculothérapieDocument22 pagesGénéralités en AuriculothérapieKatie Belaloui100% (1)
- 6g FoieVBDocument20 pages6g FoieVBjeanroPas encore d'évaluation
- Am2007 64Document80 pagesAm2007 64EmmanuelleLizé100% (1)
- Regurgitations Acides Sionneau ComDocument18 pagesRegurgitations Acides Sionneau ComIzo JEANNE-DIT-FOUQUE60% (5)
- Acupuncture Et Moxibustion - Volume 8 Numéro 03Document61 pagesAcupuncture Et Moxibustion - Volume 8 Numéro 03mignard100% (1)
- Hote Invite - CC - 81 Zhu Ke Final 2Document3 pagesHote Invite - CC - 81 Zhu Ke Final 2Philippe Fabre100% (1)
- (Dr. Jean-François Borsarello) Acupuncture PratiqDocument54 pages(Dr. Jean-François Borsarello) Acupuncture Pratiqunbelievable686100% (4)
- Maladies FebrilesDocument16 pagesMaladies Febrilessuperser123465100% (1)
- Zhongfeng ApoplexieDocument8 pagesZhongfeng Apoplexiesuperser123465Pas encore d'évaluation
- Caudet Pi Ana Felip - Une Introduction Ö La Moxibustion JaponaiseDocument124 pagesCaudet Pi Ana Felip - Une Introduction Ö La Moxibustion JaponaiseStreza G Victor100% (1)
- Acupuncture 1A Physiologie de Rate-EstomacDocument9 pagesAcupuncture 1A Physiologie de Rate-EstomacChloë Durand-CarliezPas encore d'évaluation
- Acupuncture 1A Les Meridiens Et Les LUO PDFDocument34 pagesAcupuncture 1A Les Meridiens Et Les LUO PDFCHASSANPas encore d'évaluation
- Dan TianDocument8 pagesDan TianbaugetPas encore d'évaluation
- Introduction À l'ACU-ANMO PDFDocument68 pagesIntroduction À l'ACU-ANMO PDFTM100% (2)
- Cuisine ArabeDocument467 pagesCuisine Arabeapi-3747360100% (11)
- Cuisine Gourmande - Les PâtesDocument215 pagesCuisine Gourmande - Les PâtesCarmen100% (12)
- Entorse de La Cheville Et Acupuncture DR DelahaixDocument14 pagesEntorse de La Cheville Et Acupuncture DR DelahaixEllisgo100% (2)
- Univ Meridiens Du FoieDocument44 pagesUniv Meridiens Du FoieEllisgoPas encore d'évaluation
- Amputes Tibial Prothese PDFDocument51 pagesAmputes Tibial Prothese PDFEllisgoPas encore d'évaluation
- Amputes Emboiture ProthetiquesDocument5 pagesAmputes Emboiture ProthetiquesEllisgoPas encore d'évaluation
- Les Mouvements Du Qi Selon La Médecine ChinoiseDocument6 pagesLes Mouvements Du Qi Selon La Médecine ChinoiseEllisgo100% (1)
- Zhiri Abdesselam - Baudoux Dominique - Huiles Essentielles Chémotypées Et Leurs Synergies PDFDocument84 pagesZhiri Abdesselam - Baudoux Dominique - Huiles Essentielles Chémotypées Et Leurs Synergies PDFspit7100% (5)
- Prévention Des Troubles Circulatoires Chez La FemmeDocument21 pagesPrévention Des Troubles Circulatoires Chez La FemmeEllisgoPas encore d'évaluation
- Acupuncture Contre La Bronchite ChroniqueDocument2 pagesAcupuncture Contre La Bronchite ChroniqueEllisgoPas encore d'évaluation
- Projet Fin D'étude en AcupunctureDocument155 pagesProjet Fin D'étude en AcupunctureEllisgo100% (1)
- Atlas de Poche - PhysiopathologieDocument415 pagesAtlas de Poche - Physiopathologieapi-26081450100% (18)
- ACUPUNCTURE ET MEDECINE Chinoise Dans Un Cabinet VétérinaireDocument224 pagesACUPUNCTURE ET MEDECINE Chinoise Dans Un Cabinet VétérinaireEllisgo100% (1)
- CompendiumDocument8 pagesCompendiumEllisgoPas encore d'évaluation
- Études Des Textes Sino-Européens Sur Les Médicaments TradDocument199 pagesÉtudes Des Textes Sino-Européens Sur Les Médicaments TradEllisgoPas encore d'évaluation
- Atlas de Poche - MicrobiologieDocument317 pagesAtlas de Poche - Microbiologieapi-2608145094% (18)
- ExamSys1 LMD 2010 2011 EpreuveCorDocument2 pagesExamSys1 LMD 2010 2011 EpreuveCorSira NdiayePas encore d'évaluation
- Atelier1 PowerQueryDocument2 pagesAtelier1 PowerQuerylouay bencheikhPas encore d'évaluation
- SAAD 2019 ArchivageDocument224 pagesSAAD 2019 ArchivageCarlos Redondo BenitezPas encore d'évaluation
- Endo Revision PDFDocument13 pagesEndo Revision PDFMedecine Dentaire100% (2)
- American Gods - Neil GaimanDocument254 pagesAmerican Gods - Neil GaimanmrabdoPas encore d'évaluation
- Generateur High Tech Mig Mag Digiwave III Saf-Fro FRDocument16 pagesGenerateur High Tech Mig Mag Digiwave III Saf-Fro FROmar MaalejPas encore d'évaluation
- Moez El Kouni: ExperienceDocument1 pageMoez El Kouni: ExperienceMoezPas encore d'évaluation
- Construire en TerreDocument274 pagesConstruire en Terreridha1964100% (4)
- Ligne Directrice 2021 - DyslipidémieDocument1 pageLigne Directrice 2021 - Dyslipidémiesara harvey vachonPas encore d'évaluation
- Série TD 5 Phys2 2019 2020+corrigéDocument5 pagesSérie TD 5 Phys2 2019 2020+corrigéamiranomi5Pas encore d'évaluation
- Pinpankôd Désigne Celle Des Jeunes Garçons Et Filles Dont L'âge VarieDocument20 pagesPinpankôd Désigne Celle Des Jeunes Garçons Et Filles Dont L'âge VarieNajimou Alade TidjaniPas encore d'évaluation
- Flyer Passerelle VF (18752)Document2 pagesFlyer Passerelle VF (18752)grosjeanblandinePas encore d'évaluation
- Format Label 113Document5 pagesFormat Label 113Marlisa IchaPas encore d'évaluation
- Pyramide MaslowDocument3 pagesPyramide Maslowvibus2014Pas encore d'évaluation
- Brevet Sur Le Front Populaire Avec CorrectionDocument2 pagesBrevet Sur Le Front Populaire Avec Correctiondouzi nourPas encore d'évaluation
- 27 Eme - Tob - 02-10-2021Document2 pages27 Eme - Tob - 02-10-2021Joyce DouanlaPas encore d'évaluation
- Module 3 La Mise en Oeuvre La Résine Epoxy Clé en MainDocument19 pagesModule 3 La Mise en Oeuvre La Résine Epoxy Clé en Maintommy100% (1)
- Babas Savarins-1Document1 pageBabas Savarins-1Benjamin GevoldePas encore d'évaluation
- Histoire Et Géographie Sacrées Dans Le CoranDocument37 pagesHistoire Et Géographie Sacrées Dans Le CoranCatharsis HaddoukPas encore d'évaluation
- Compl Biologie Etudiant S-1Document43 pagesCompl Biologie Etudiant S-1aloys NdziePas encore d'évaluation
- FoQual Rapport Incidents FRDocument40 pagesFoQual Rapport Incidents FRMarco SanPas encore d'évaluation
- Bourdieu Emprise JournalismeDocument4 pagesBourdieu Emprise JournalismebobyPas encore d'évaluation
- PHARMACO Respi. Médicaments de La TouxDocument40 pagesPHARMACO Respi. Médicaments de La TouxyvesPas encore d'évaluation
- Droit Des Affaires 2019 - 2020Document104 pagesDroit Des Affaires 2019 - 2020YassminaPas encore d'évaluation
- 1715944Document1 page1715944ADRIANNE BETTAPas encore d'évaluation
- Manuel MilitaireDocument204 pagesManuel MilitaireFRED100% (1)
- 1710 PDF Du 30Document26 pages1710 PDF Du 30PDF JournalPas encore d'évaluation
- Formula D PDFDocument16 pagesFormula D PDFNour-Eddine BenkerroumPas encore d'évaluation
- Algorithmes de Traitement Suggeres HTADocument3 pagesAlgorithmes de Traitement Suggeres HTAZiedBenSassiPas encore d'évaluation
- A3 2 PDFDocument34 pagesA3 2 PDFLéopold SENEPas encore d'évaluation