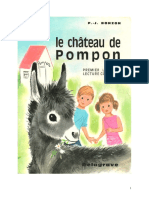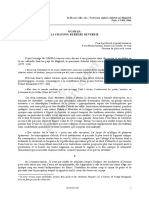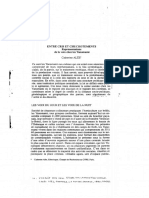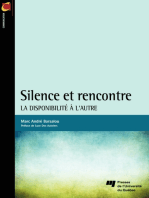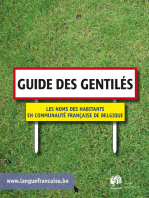Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Sentiers de L'extinction Des Langues
Les Sentiers de L'extinction Des Langues
Transféré par
chami40007522Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Sentiers de L'extinction Des Langues
Les Sentiers de L'extinction Des Langues
Transféré par
chami40007522Droits d'auteur :
Formats disponibles
E VI
l'extinction
la dispartion
L TRNSFORMATION
Il semblerait faons, pour une
de disparatre. La premire est la transformation: une
lange est assez fortement modife, au cours d'un pro
cessus qui peut tre long, pour qu' un cerain moment, on
puisse considrer qu'une nouvelle est appare; telle est
l'histoire de la transformation du lati n cn diverses langues
romanes; un autre cas est celui, illustr plus haut par le
russe, le turc, etc., des langues moderes dont ceraines
langues classiques l'tat ancien; on a vu
la continuit assez troite ; dans
le latin, on ne peut
strctement sens d'limination
mme s'il est ne peut que par
tre appel fanais modere est fort
d'tre du franais mdival. La transformation ne sera
donc pas retenue ici comme cas pertinent de mort d'une
lange.
94 HA L TE A L A M 0 R T DES L AN GUE S
LA SUBSTITUTION
On qu'une langue venue l'extrieur se
L
'
EXTINCTION
prcdemment
lorsque cette
trs variable,
s'absorber en
est donc
balbutiaient encore,
qui la parlait,
avoir,
avec la langue
d'un pro
Ies struc
ne restent d'usage
une faible mino-
ges. Lextinction s'achve en substitution lorsque, ainsi
qu'il frquemment, les
abandonnent la et en
adoptent une autre.
On
est
considre un
LE S S ENTIER S DE L [Ne T/ON N 95
toutes les vie quotidienne.
11 .' ... vivante sera
celle d'une communaut qui renouvelle
locuteurs de ; et une langue morte, si
conserver ce d'une communaut o
comptence native a disparu, dans la mesure
o les locuteurs de n'ont transmis
ment leur savoir, transmettant
tour une aptitude faible parler et com-
l'idiome
Deux COSEa
En premier lieu,
notion de mort est ici
certes pas celle d'une
socit humaine qui
ne meurt pas elle-mme
est un pnencm
tires ces
l'implication individuelle
mort d'une
physique,
une langue pour une autre
autant. Mais la mort
collectif. C'est le
'`` individuel, on considrer que
d'une langue qui disparat avec eux est celle d'une commu
naut linguistique.
second lieu, locuteurs de naissance
partir desquels s'amorce le D[CeSSlIS
se trouver dans deux
l'espace d'origine,
autochtone,
l&l_1& est parle comme
un lieu
96 HAL TE LA M 0 R T DES LAN GUE S
L
'
extinction par tapes
Dans ce qui suit, je tenterai de caractriser les tapes
d'un processus dont l'aboutissement dernier est la mort
d'une langue. Je parlerai de prcarisation propos des
tapes initiales, et d'obsolescence propos des tapes ant
rieures l'issue ultime. Pour rfrer d'une manire plus
gnrale l'ensemble du processus, j'emploierai d'autres
notions, comme celle de dlabrement, ou, prises mtapho
riquement partir de la gologie et du droit, celles d'ro
sion et de dshrence.
LE DFAUT DE TRANSMISSION NORMALE
Manue total ou partiel d'ducation
dn la langue autochtone
Le fait qu'une langue cesse d'tre transmise aux enfants
comme elle l'est dans ses conditions naturelles de vie est
l'indice d'une prcarisation importante. Dans de nombreux
cas, les parents, pour des raisons qui seront examines
plus bas, ne sont pas spontanment ports enseigner
leurs enfants, par un moyen aussi simple que de la parler
avec eux l'exclusion de toute autre, la langue de la com
munaut. Cela ne signife pas qu'ils renoncent entirement
l'utiliser dans le cadre de l'ducation. Certains nan
moins sont bien dans ce cas, et l'on peut parler alors d'un
dfaut radical de transmission. Dans d'autres familles, le
dfaut de transmission n'est que partiel. Mais d'une part
les lments qu'enseignent les parents sont insuffsants,
d'autre part, en n'assurant pas une transmission commen
ant ds le plus jeune ge comme il est courant pour toute
LES SEN TI ERS DE L' E X TIN C Tl 0 N 97
langue vivante, ils lguent des connaissances que leurs
enfants n'acquirent pas d'une faon continue.
Labsence de continuit implique, pour certains
apets de la langue, une acquisition trop tardive, c'est-
dIre mtervenant un ge, entre l'enfance et la pradoles
cence, o l'avidit d'coute et d'apprentissage est en train
d
.
e dcrotre, et o s'amorce une stabilisation slective,
snon un
,
e sclrose, d'une partie des aptitudes neurolo
gIques d attention et d'assimilation (cf. Hagge 1 996 a,
cha. l
,
et Il)
:
:ar un fcheux concours, cet ge est aussi
celUI ou, preClsment, les enfants s'intressent de plus en
plus la langue ou aux langues, autres que celle de la com
munaut, qui sont prsentes dans l'environnement, proche
ou mme lointain.
L'absence d'enfants parmi les locuteurs d'une langue
comme signe annonciateur d sa mort
Une langue que parlent uniquement les adultes d'une
comunaut, tandis que les enfants n'en connaissent
qu une autre ou d'autres trangres cette communaut
n'est pas condamne mort d'une manire immdiate ni
certaine. Entre eux, les adultes les plus jeunes s'en seri
rnt encore, en principe, jusqu' la fn de leur vie. Et
d autre part, la fondation d'coles o puissent l'apprendre
les enfants qui elle n'est pas transmise dans leur milieu
familial reste toujours possible. Dans la plupart des cas
connus, nanmoins, cette absence de jeunes locuteus est
considrer comme un pronostic sombre pour la survie de la
lange (cf. p. 202, o elle est utilise comme discriminant).
98 HA L TE A L A M 0 R T DES LAN GUE S
LE BILINGUISME D'INGALIT
ET LES LANGUES EN GUERRE
Les ravages du contact en situation d'ingalit
Ltape qui, dans le processus de prcarisation d'une
langue, suit le dfaut de transmission est la gnralisation
du bilinguisme chez ses usagers. Mais ce qui est en cause
n'est pas un type quelconque de bilinguisme. Les contacts
tissent l'histoire de toutes les communauts humaines, et
sont loin d'tre ncessairement dltres. Il ne suffit pas du
contact entre deux langues pour que l'on puisse prdire la
mort de l'une d'elles, ni mme, dans les trs nombreuses
situations o ce contact est troit, pour que l'une constitue
une menace quant l'existence de l'autre. Il s'agit en fait,
ici, de ce qui a t appel ailleurs (cf. Hagge 1 996, chap. XI)
bilinguisme d'ingalit, ou ingalitaire. Celle des deux
langues dont la pression s'exerce d'une manire redoutable
sur l'autre est en position beaucoup plus forte du fait de
son statut social ou de sa diffusion nationale ou interatio
nale (cf. chap. V). Le dfaut de transmission intervient
dans le cadre ainsi dfni. Les dtenteurs les plus gs de la
langue communautaire, qui n'est plus en tat de rsister
la concurrence d'un autre idiome, la transmettent d'une
manire imparfaite leurs enfants, qui la transmettent
eux-mmes plus imparfaitement encore, ou ne la trans
mettent plus, la gnration suivante.
l'afrontement entre du langues
La communication des derniers locuteurs avec leurs
petits-enfants dans la langue dont s'interrompt le pro
cessus de transmission devient de plus en plus inadquate
ou de plus en plus difficile. La consquence est son
abandon croissant, au bnfce de celle qui est en mesure
de remporter la victoire. Car les deux langues en prsence
f
LE S S EN Tl E R S DE L' E X TIN C Tl 0 N 99
se livrent une vritable guerre. Les moyens utiliss par cha
cune sont diffrents. Il s'agit d'une lutte armes ingales
entre une langue pousse la fn de son rgne et une
langue qui tend le sien. Mais surtout, le bilinguisme in
galitaire scrte un (ype particulier de locuteurs, dont il va
tre question maintenant.
LES SOUS-USAGERS
En effet, du bilinguisme d'ingalit ainsi illustr, on
passe, au cous de l'inexorable cheminement vers l'extinc
tion, une autre tape, par laquelle s'amorce l'obsoles
cence. Pour caractriser cette tape, je propose d'appeler
sous-usagers d'une langue donne les locuteurs qui l'utili
sent, des degrs variables selon les situations, sans pos
sder ce que j'ai appel plus haut comptence native. La
manire dont les sous-usagers parlent la langue de leur
communaut est un signe inquitant du pril auquel eUe
est expose, et dans les cas les plus avancs, une annonce
claire de sa disparition prochaine.
Divers auteurs ont tudi, dans des groupes parti
culiers, l'tat de langue dont il s'agit. On a, notamment,
appel semi-locuteurs (Dorian 1977) les usagers chez qui le
maniement de la langue d'origine devient de plus en plus
incerain. On a parl de semi-linguisme (cf. Hansegard
1 968) propos d'une situation que j'appelle (Hagge 1 996 a,
261 -262) double incomptence. C'est celle des familles
d'immigrs rcents qui ont une pratique fautive de la
langue du pays d'accueil, sans avoir conser une comp
tence complte dans leur propre langue. Il s'agit ici non
d'un phnomne d'obsolescence pour aucune des deux
langues, bien que les circonstances ne soient pas sans ana
logies, mais d'une privation linguistique des individus d'un
groupe socialement et conomiquement dfavoris. On ne
peut donc pas parler, dans ce cas, de sous-usagers, comme
chez les locuteurs de diverses langues en voie d'extinction.
100 HAL TE LAM 0 R T DES LAN GUE S
Les productions de ces locuteurs seront tudies plus bas,
et permettront de prciser le contenu de la notion de sous
usagers. Qu'il soit simplement prcis ds prsent que les
sous-usagers se distinguent des sujets dous d'une comp
tence passive. Ces deriers ne produisent certes pas, le
plus souvent, de discours suivi et n'utilisent pas la langue
comme peuvent le faire ceux qui possdent une pleine
comptence; mais ils n'ont pas perdu la connaissance du
systme et peuvent, du moins en principe, en reconnatre
tous les traits en tant qu'auditeurs, ce qui n'est pas le cas
des sous-usagers.
L'ALTRATION DE LA LANGUE DOMINE
ET LE DNI DE LGITIMIT
Le type de langue que parlent les sous-usagers dans
les situations d'obsolescence initiale peut tre illustr par
bien des exemples. On en retiendra deux ci-dessous.
Le quetchua en Bolivie face l'spagnol
Le premier exemple est celui du quetchua de la ville
et de la valle de Cochabamba en Bolivie (cf. Calvet 1 987).
Le quetchua est l'tat moderne de la langue que l'on par
lait dans l'empire inca l'arrive des conqurants espa
gnols. L'hispanisation culturelle et linguistique ne l'a pas
rduit une situation aussi fagile que celles de nom
breuses autres langues indiennes d'Amrique. Le quet
chua est parl par prs de la moiti des cinq millions et
demi d'habitants de la Bolivie. Mais il est, videmment,
soumis la pression de l'espagnol. En milieu urbain (ville
de Cochabamba et alentours immdiats), les commer
ants, ainsi que l'administration et les mdias, laissent
une place indniable au quetchua, mais la forme qu'ils uti
lisent est assez diffrente de celle dont se servent les pay
sans (valle de Cochabamba).
,
LES SENT/ERS DE L
'
EXTINCTION . 1 01
Sur le plan phonologique, le quetchua des campagnes
possde deux voyelles i et u, mais pas de e ni de a sinon
comme prononciations possibles des mots: i peut quelque
fois tre prononc e, auquel il ressemble, et de mme pour
u par rapport a ; cela signifie qu'il n'existe, en quetchua
moins influenc par l'espagnol, aucune paire de mots dont
les membres, identiques en tout, s'opposent uniquement,
l'un l'autre, par la prsence de i dans l'un et de e dans
l'autre, ou par celle de u dans l'un et de 0 dans l'autre. Au
contraire, en quetchua de la ville, qui fait maints emprunts
l'espagnol, les voyelles e et 0 sont des phonmes
(ensembles de traits sonores servant distinguer les mots)
de plein droit. En effet, ces sons s'introduisent dans le
quetchua urbain en mme temps que les mots espagnols
qui les comportent. Ainsi, les systmes phonologiques du
quetchua urbain et du quetchua rural de la rgion de
Cochabamba sont assez diffrents pour que l'on puisse
parler de deux langues distinctes.
Les faits ne s'arrtent pas l. On vient de voir que la
contamination du systme phonologique du quetchua
citadin par l'espagnol tait corollaire de J'afflux
d'emprunts, qui est un phnomne lexical. Mais la gram
maire est atteinte elle aussi. Sur le plan grammatical, le
quetchua plus conservateur des paysans possde des
caractristiques trs diffrentes de celles de l'espagnol. Le
verbe, notamment, est en position fnale dans la plupart
des phrases, lesquelles sont le plus souvent courtes. En
espagnol, le verbe n'est pas plus en position fnale qu'il ne
l'est en franais, o il n'est pas d'usage de dire ils ont leur
mas au march vendu. Ds lors, c'est sous l'influence
omniprsente de l'espagnol que l'ordre des mots du quet
chua de Cochabamba-ville devient un ordre verbe en
position non fnale dans la plus grande partie des phrases.
Dans un environnement de guerre des langues o
l'ingalit est forte, la langue lgitime est celle des lites
conomiques. Or ces lites, Cochabamba, sont prcis
ment les communauts d'usagers d'un quetchua de plus en
102 HAL TE A LA M 0 R T DES LAN GUE S
plus hispanis, en disparatre en tant que quetchua
lorsque le processus d'absorption phonologique,
ticale et lexicale par aura atteint son tene.
Ainsi, ces loin d'tre
dclasss, lors mme d'origine est
est celui d'une !O!1gLV
F(1T11F
se trouve rcuse.
est son tour
locuteurs. On
menaante et le
partie, solidairement,
Mais il existe
abondante, de
aux classes
lent le quetchua
le statut mme
lgitimation de la
de la langue menace
processus d'affnnation.
une autre catgorie,
locuteurs, appartenant
socit bolivienne, qui
aussi d'un mauvais eSlagn
vritable, se servent
dit espagnol andin
d'ascension sociale
plus en plus hispanis
qui est stigmatis.
conduit imiter le
sous-usagers la
nombre des S01s-usag(rs
l'autre,
du quetchua
La situation en milieu colophone dn les Caraibe
Lautre exemple concere une des langues de l'le
antillaise de Trinit-et-Tobago, situe proximit des
orientales du est la langue offcielle
cet
tat membre du La langue
la majorit de est un crole base
comme la les des
Mais la moiti galement une autre
langue. Ce sont en des travailleurs
du centre-est de
bhojpuri. apparent
en 1838,
sucre; ils
o se parle le
dominante ce
+
LES SEN Tl ERS DEL 1 E X TIN C TI 0 N 103
pays, et dont
cents millions
pour langue
bhojpuri de
LJcIVLLO sont utiliss par de
Indiens de Trinit ont donc
locale du bhojpuri, ou
Cependant, certains
prouver le du bhojpuri Trinit, on
constate une nette entre les locuteurs
de 75 ans ns en 75 ans ns
ceux qui, galement ont au-dessous de ans.
Une exprience sur ces locuteurs (cf. Mohan et
Zador 1 986) tablit connaissance du bhojpuri
dcrot trs premier au deuxime
puis du deuxime au si l'on utilise pour
minant l'emploi correct et fquent de certains
qui sont propres cette telle qu'elle est
Inde, et qui sont comme en
Il s'agit des : pronoms personnels
rifques, verbes rdoubls sens
distributif, ```'"
second reprend avec
avec pour rsultat
genre ).
un premier
' x et autres choses
Si l'on ajoute la rapidit d'locution
nettement aussi du au deuxime puis de
au troisime qu'au contraire le taux
emprunts considrablement
x,
ce
mme direction, on que par OpposJtlon aux
plus gs, qui ne transmettent qu'imparfaitement
comptence, sont devenus des UU:-Ud'l:
de la langue Il est
cet gard,
qu'il de mauvais
d'autodrision.
plus trs loigne.
propre expres
bhojpuri Trinidad
104 HAL TE A LA M 0 R T DES LAN GUE S
L'INVASION PAR L'EMPRUNT
Le noyau dur et le lexique face l'emprunt
I.emprunt, essentiellement l'emprunt lexical, c'est-
dire celui des mots du vocabulaire, est une condition de la
vie des langues (cf. Hagge 1 987, 75-79). Il n'existe pas de
langue, mme parle par des communauts vivant dans un
isolement presque complet (les trs loignes de tout
autre territoire, hautes valles spares des lieux de peu
plement voisins par des crans rocheux diffciles fran
chir, etc.), qui ne fasse des emprunts une ou plusieurs
autres langues.
On peut considrer que les parties les plus structures
des langues sont leur noyau dur, c'est--dire leur compo
sante la plus rsistante face l'usure du temps, et
l'influence d'une langue trangre. Ce sont la phonologie et
la grammaire. Au contraire, le lexique (inventaire des mots
disponibles un moment donn de l'histoire de la langue)
est un domaine moins structur, et beaucoup plus ouvert
l'emprunt. Il ne s'agit ici, certes, que d'une tendance gn
rale, mais en dpit des contre-exemples que l'on ne
manque pas de rencontrer, on peut la prendre pour cadre
d'tude des phnomnes.
Il importe de noter que l'emprunt n'est pas en soi une
cause de l'extinction des langues. Il en est un signe inqui
tant lorsqu'il est envahissant et ne laisse intact aucun
domaine, comme on va le voir.
L'alternce ds cods
Lemprunt de vocabulaire est d'abord un fait propre au
discours, les phrases en langue veraculaire tant encom
bres de mots pris une autre langue. C'est le phnomne
dit d'alterance des codes au sein d'un mme nonc.
LES SEN T J ERS DEL
'
E X TIN C Tl 0 N 105
Lalterance des codes est loin d'tre toujours un signe de
dlabrement. Elle est extrmement rpandue. Tout audi
teur attentif, sans tre ncessairement linguiste de son
tat, peut entendre les deu protagonistes d'une communi
cation passer d'une langue l'autre au sein d'une mme
phrase, pourvu que la scne se droule dans un environne
ment plurilingue.
Ainsi, qui n'a pas remarqu que souvent les arabo
phones que l'on peut entendre au Quarier latin Paris,
par exemple, emploient, en les insrant au milieu d'un dis
cours qui semble tre pour l'essentiel en arabe, des mots
fanas, et mme des expressions entires? Beaucoup de
Mexicains d'origine, qui se sont installs en Califorie, au
Texas, ou dans d'autres terrtoires de l'ouest des tats-Unis
(qui les ont conquis militairement, au X" sicle, sur le
Mexique, auquel ces territoires appartenaient), font cons
tamment alterer les codes d'une manire comparable,
passant de l'anglais l'espagnol et inversement. Les Malais
cultivs font de mme, insrant de nombreux mots anglais
dans un discours en malais.
Dans tous ces cas, il ne s'agit pas d'un bilinguisme
d'ingalit. Car mme si une des langues (le fanais pour
ces arabophones, l'anglais par rapport l'espagnol ou au
malais dans les deux autres cas cits) incare pour les
locuteurs un pays riche dont on apprcie l'enseignement
universitaire ou certains schmas socio-conomiques, il
n'y a pas d'attitude de rejet de la langue autochtone au
proft d'une autre qui la dpouillerait de sa lgitimit. Et
quand la situation n'est pas ingale, ou que divers facteurs
compensent un taux lev d'importations de mots tran
gers, l'emprunt n'est pas le signe d'une menace pour la
langue.
106 HAL TE LA M 0 R T DES LAN GUE S
L d'ingalit
et l'emprnt par les sous-usagers
discursifs emprunts, colonne avance
l'invasion lexicale
l'on se trouve, au
non galitaire,
tout il y a alterance
multiplication de petits mots aussi
tables. sont
marqueurs
un discours en
lexicaux,
originel, processus peut
emprunts et l'ofensive en masse
peuvent pour
seule-
une langue est souvent conduite par
de l'emprunt, qu'il
kusaien, langue
l'archipel
LES SENTlERS DE L
'
EXT/NeTlON 107
( librement j aux tats-Unis), le
l'anglo-amricain a pour effet une
du lexique, que locuteurs ne savent
presque
gnaient.
les quelque termes qui dsi-
non altr de la diffrentes
phases de la appauvrissement lexique est
J'amricanisation des usages, et
disparition de celui
salut,tH)nS de bienvenue un attouchement des
gnitales,
tants, dont
spectacle
nement amricain,
relations d'extrme
des tudi par
E. T. (1 966). D'innombrables mots
kusaien, du du changement des
altres par dclin des dbats
1",plnT des substituent. On
cet tat du lexique, par dpouillement
ses ressources propres et d'emprunts, comme une
phase de la de la
C'est
contribu
en dsignations
est en situation plus est
108 H 1 L TE LA M 0 R T DES LAN G U E S
expose aux qui rsultent de ses
travers la pninsule indochinoise. Mlabri utilisent
massivement le tha pour tout ce qui ne se rapporte
domestique, et l'on peut prdire une disparition
langue dlai, sauf considrer qu'il s'agit de
plus en plus d'une langue et que dans cette mesure,
le mlabri viable p. 240- 243).
Londe dferlante des emprnts: du lexique la gammair
Das les prses en exemples quet-
chua Cochabamba et bhojpuri de Trinit, c'est par le
biais l'emprunt et de modles de phrses o
fgurent ces mots, dans un cas, l'anglais dans
l'autre, que s'introduisent traits Ce
est un important dlabrement: on
une corlation entre le taux d'emprunt degr
dstabilisation de phonologie et la ; la
langue cette pression ses
propres dont l'expansion nVr,"<
annonce la mort de cette C'est cette faon,
que se prcipite des aborignes
d'Australie, par le walpiri, qui emprunte un grand
nombre mots l'anglais, non seulement des
notions qui taient, l'origine, l'ethnie (turki,
truck camion >, de bicycle : bicyclette,
lanji, de lunch djeuner ), etc.), mais
du fonds autochtone: ainsi, au et
wawir, le walpiri emploie couramment boomerang et
kangaroo respectivement, c'est--dire des mots
n'est sans ironie, quand on que ser-
vant ici de vecteur, les lui-mme empnmts une
autre langue australienne, selon le
joural de James crit en 1 sillage
du bientt celle du
d'une
T
LES S E N Tl ERS D E L
'
E X TI N C Tl 0 N 109
en particulier, que le
le fonds lexical propre est en usage
d'une dsactivation processus
de mots nouveaux.
acquis une comptence
nante, un nombre considrable
emprunts cette langue au des
nent la domine.
lexical sujets, et "'''<'<Lm
discours du systme.
autochtones, qui font double emploi
imports, commencent disparatre.
calque morphologique est caractris-
phnomnes d'emprunt. simple
du Welland, l'Ontario p.2 14),
o, par the one, the ones, on le
celui, le la celle, ceux, les Mougeon et
Beniak 1989. 300), emplois l'on par rapport au
non cette influence morphologique,
l'ajout de l'article et le mlange
LE PROCESSUS D
'
ROSION ET LES INDICES
DE SON
Pofl gal du processu
des situations
d'rosion est
une large mesure des
communaut. Ainsi, il y a une dizaine
du langue iroquoise
avaient t dplacs pour consigns dans
",,c
l'Oklahoma, taient en train de ""Y,
noms de
1 1 0 ,
LTE LA MORT DES LANGUES
de l'Ontario (chez qui la langue se
beaucoup complexits du
morphologique (cf. Mithun 1989), ce qui
encore t SUIVIe
vritable, et illustre la complexit et
situations d'extinction de de
qui parfois se contredisent entre eux.
dahalo, langue couchitique de la province
Knya, il est soumis la forte pression de
centres urbains comme Lamu, o domine le swahili,
pratiquent nombre de Dahalo bilingues, qu'autre-
fois, il des ; le dahalo a,
son abondance de consonnes, dont
Iiw/, consonne les
latrale fricative appendice labiovlaire) sont assez rares;
mais il a perdu l'opposition pourtant
enracine en couchitique, ainsi autre trait qui l'est
galement, marques trs diversifes de plu
riel, caractrises par des rduplications et alternances
nombreuses.
. Altration du noyau dur
Si on tente d'tablir, au-del de
cas pariculiers, un profl
cessus d'rosion et de la dont sont alors
les composantes d'une on rappellera
que
des cas, les parties
longtemps le lexique. Quand eUes sont atteintes
leur ce qui disparat d'abord est la grammaire. Il
notamment, de la
essentielles
les
de phono-
logie, et en
rduction des
le
les mca
traits qui caractrisent le plus
r
LES SENTIERS DE L XT/NeT/ON . 1 1 1
la langue en d'extinction. distinction
nences de cas dans qui en possdent, ceBe
,r=F" et des modes verbes sont perdues.
les plus courantes formation des mots
,
dans
les langues elles ont un important, cessent
productives, et plus rares tout
comme la des formes dans
Ainsi, quelque 26 000 immigrs qui vin-
rent en Sude fn de la Seconde Guerre mondiale, et
surtout celui enfants, ont perdu la
entre le nominatif, gnitif et le partitif comme marques
l'objet, s'en remettant, sur modle du sudois,
l'ordre des mots marquer les fonctions. Le
lange d'une tribu masai quelques per-
sonnes vivant sur l'le la septentrionale
du Knya, a perdu, au contact du swahili et du somali,
langues de rgion, de nombreux : la
distinction des la plupart morphmes mar-
quant le temps et l'aspect que J'emploi
productif des indices On note galement
perte l'exubrante morphologie verbale du kemant,
langue couchitique d'thiopie; l un trait sous-
usagers spectaculaire la conservation cette
morphologie
vieillards de Gondar.
dit, il ne
et il
des
u,u',U\. bien qu'en voie de dlabrement, conservent nan-
moins longtemps une partie de leur
Pere
organisation
on a pu
murik et l'arapesh,
tendance est la perte
statistiquement rares dans
humaines, et troitement une
du monde. en Nouvelle-
(cf. Laycock 1 973) le buna, le
papoues, avaient perdu, en
1 1 2 HALTE A LA MORT DES LANGUES
vingt-cinq ou trente ans, les systmes complexes de classi
fcation nominale qui les caractrisaient, et qui consistaient
en une srie d'une douzaine de marques diffrenciant
autant de classes de noms en fonction de l'objet du monde
auquel ils rfrent.
Le kiwai, autre langue papoue, avait perdu, peu prs
dans le mme espace de temps, la diffrenciation qu'il fai
sait entre un singulier, un duel, un tri el et un pluriel;
d'autre part, il ne lui restait plus qu'un prsent, un pass et
un futur, alors qu'il avait possd autrefois deux passs et
trois fturs. Plus prs de Paris, les parlers bigouden et tr
gorrois du breton ont perdu un trait fort original, qui
consistait ajouter deux fois le sufxe de pluriel aux noms
marque diminutive -ig, ce qui donnait, par exemple, sur
paotr gars}, paotr-ed-ig-o { les petits gars), o le nom
reoit la marque du pluriel des anims, -ed, le sufxe -ig
recevant l'autre marque de pluriel, -o (cf. Dressler 1981, 8).
Moins prs de Paris, en ayiwo, langue de l'archipel de
Santa-Cruz l'extrmit orientale des es Salomon, les
seize classes nominales, du mme type que celles des
langues que l'on vient de citer, ont galement disparu, ou
quasiment, entre deux enqutes dont la seconde suivait de
vingt ans la premire
.
Les usagers les plus jeunes sont ceux
chez qui cette disparition est totale, les plus gs n'ofant
plus que des vestiges de l'ancien systme. Le kamilaroi,
langue australienne aujourd'hui moribonde du centre
nord des Nouvelles-Galles-du-Sud, a perdu presque toutes
les fnes distinctions que faisait son systme verbal entre
les difrents moments de la journe qui, du lever au cou
cher du soleil, servent de cadre un vnement.
Un des traits rcessifs les plus rapidement perdus est
le systme de numration, souvent originaL que poss
daient des langues o l'on comptait les objets par rfrence
aux parties du corps: non seulement une main pour
cinq, les deux mains pour ( dix, un homme (= deux
mains et deux pieds) pour vingt , mais aussi une impor
tante srie de repres cororels prenant, par convention,
LES SENTlERS DE L'EXTINCTION . 113
des valeurs numriques assignes chacun, comme en
wambon, langue papoue d'Irian Jaya (cf. Hagge 1998, 51 ).
Nivetlements analogiques, fonulations dilues
Dans le cas le plus fquent, le type de connaissance
que les sous-usagers conservent de la langue en ddin peut
tre dfni par deux caractristiques : d'une part l'limina
tion des irrgularits par nivellement analogique, d'autre
part la perte des structures denses et leur remplacement
par des formulations dilues, dans les nombreux cas o, ne
possdant plus la rgle pour produire le mot ou l'expres
sion adquats, ils s'expriment par priphrases; ils se ser
vent galement de calques quand un mot autochtone leur
manque, comme les sous-usagers fnno-amricains rem
plaant, pour dire foyer , le mot fnnois takka, qu'ils ne
connaissent plus, par tuli-paikka, calque de l'anglais fre
place (il s'agit ici d'un fnnois en voie de di
parition
.
non in
situ (en Finlande), mais en diaspora (aux Etats-Ums. Un
exemple de nivellement analogique est fouri par un locu
teur de l'irlandais utilisant une forme ncha, par analogie
de fche vingt , au lieu de deich is cheithre fichid ( dix et
quatre vingtaines) pour dire quatre-vingt-dix; ce
locuteur abandonne l'ancien comptage vigsimal, qui se
trouve survivre aussi dans quatre-vingt-dix, mot fanais de
France, l o les Belges francophones disent nonante.
Cas d'expolition, et rduction des registres de style
Parfois, un signe du dlabrement avanc de la l angue
chez des bilingues qui sont en voie de passer la langue
trangre est l'expolition. J'utilise ici ce terme de la rh
torique classique, en le spcifant pour dsigner l'emploi
en succession immdiate, dans la mme phrase, d'un
mot de cette langue dominante puis de son quivalent en
langue autochtone, comme chez un informateur du
comt de Donegal disant, en irlandais contamin par
l'anglais, bh{ s black dubh (tait il noir noir) c'tait tout
116 HA L TE A LA MORT DES LANGUES
C'est une exprence faite, contre leur gr, par certains linguistes, que de se trouver face un vieillard prsent
comme muet, car il ne se souvient plus de sa langue, et ne
fait plus qu'en bredouiller des brbes incohrentes. Cette
imputation de mutisme ceux qu'on ne comprend pas est
depuis fort longtemps un des signes de la prise de distance
face la clture du dialogue: les peuples ger1aniques
taient appels { muets par plusieurs peuples slaves (et
les langues slaves modernes dsignent encore ainsi les
Allemands; { allemand , en tchque, se dit nemecky, et
( muet nemy), car les seconds n'entendaient dans le
discours des premiers que borborgmes dpourvus de
sens. Mais ici, il s'agit d'un tout autre mutisme. Une
scne du flm de W. Herzog, Das Land, \10 die Ameisen
traumen ({ Le pays o les fourmis rvent ) montre un
vieillard australien pathtiquement muet (information
due Mme H. Albagnac). Ici, la blessure linguistique prend
le visage d'une dramatique Crctarit
.
Lusager possde
encore, sans doute, quelques souvenirs, mais sa langue
est presque dtruite, car il n'a plus personne avec qui
l'employer. C'est la conscience mme de ses insufsances
qui donne son expression une forme quasi cataleptique;
et prcisment, par un efet de retoUI cette suspension
entre la parole et le silence est, pour la langue la dernire
tape de son agonie, un signe de la mort.
Comparaison avec l ca des pidgins
Certins des traits des langues en dshrence parais
sent accrotre la transparence, en rduisant les irgula
rits et le nombre des formes. La transparence tant aussi
une caractristique des pidgins (cf. p. 352-357), on a pro
pos de comparer ces derier aux langues morbondes. De
fait, quelques proplits sont communes aux deux situa
tions : tendances l'invariabilit, l'anal)1icit, l'emploi de
trits universelement rcurrents dans les langues, plutt que
de traits rcessifs. Un autre trit commun aux langues en
r
1
LES S EN TIERS DE L'EXTIN C TIO N . 117
'" d'extinction et aux pidgins est que dans les deux cas, VOle
. '
l
"
les locuteur les plus jeunes ne sont pas soumls a
,
Inter-
vention normative des adultes, agissant comme re
ula
teurs de l'acquisition, et prescrivant le rejet des formtIOns
analogiques qui violent l'usage, ainsi que de t
utes
.
autres
fOffi1es dviantes. En efet, les deux types de SItuatIOns se
caractrisent par l'importance de la variation et l'absece
de nOffe fxe, dans un cas (pidgin) parce qu'elle ne s est
pas encore tablie, dans l'autre (langues en obsolescence)
parce qu'elle s'est rode.
, .
,
.
.
Cependant, il existe d autres traIts par lesquels pldg:ns
et langues en dshrence se distinguent. Le caracte
e
alatoire des destructions qui afectent une langue en VOle
de disparition apparat notamment en ceci que les sous
usagers prsentent souvent une rten
.
tion d' l
ents qUI
n'ont pas de fonction ni de sens claIrs, et qUI sont des
rsidus, surivant au milieu du dlabremen d
:
la la
,
ngue.
Ce phnomne n'a pas t sgnal
ns les pIdgInS, ou tout
lment rpond une fonctIon preCIse.
A ,
D'autres caractrstiques font apparaltre des dlferences
importantes entre les pidgins et les l
gues
,
m
?
ribonde.
Ainsi, le procd d'expolition, qu'on a Illustre cI-de
sus a
propos de l'irlandais (cf. p. 113-114), se trou
.
e aUSSI dans
certains stles crits de pidgins, comme celUI de Nouvelle
Guine (appel tok pisin), qui, rcemment encore, da
.
ns les
colonnes des jouraux de Port-Moresby,
dme:tlt, a;
milieu d'une phrase, l'insertion de mots anglaIS, maIS Imme
diatement suivis d'une traduction (cf. Hagge 1993, 30.).
Cependant, ici, contrairemet au cas de
la
gus en
,
vo
e
d'extinction, il ne s'agit pas d une contamInatIon . I
.
e pIdgm
est bien vivant, et les usagers qui lisent cette pr
sse Ignorent
souvent l'anglais, d'o la ncessit de trdUIre les mots
d'emprunt que l'on emploie ici ou l.
118 HALTE LA MOR T DES LANGUES
Rythme d l'rosion et conscience d locuteurs
Les changements que subit une langue en voie de des
tuction sont beaucoup plus rapides que ceux, tout fait
cour
ns, qui caractrisent la vie des langues non exposes
au dechn. Les sous-usagers ne sont pas toujours conscients
du ryth
auquel leur langue se disloque, mme lorsqu'il
est vertIgmeux. Ils sont souvent convaincus qu'ils parlent
encore une langue normale, alors qu'elle est moribonde.
Les formes qui donnent l'illusion d'une continuit sont
dj, le plus souvent, celles d'un autre systme, en cours
d mstallation, et qui est le prlude l'extinction totale.
L
'
ILLUSION DE VE
Les recherches en divers lieux o les langues sont
entres dans un processus de dlabrement peuvent rvler
des phnomnes qui paraissent dmentir les pronostics
d'extinction, mais qui, tre examins de prs, les confr
ment. Trois phnomnes de ce type sont prsents ci
dessous.
Les adresses de connivence
Plusieurs cas ont t rapports dans lesquels la langue
veraculaire, chez des communauts qui sont en train de
passer massivement une autre, peut tre entendue dans
l
iscors de
.
certains suj
ts. Ces deriers souhaitent par
la etabhr un hen de conmvence avec les partenaires sus
ceptibles de comprendre. Ainsi, une tude (Mertz 1989)
mentionne le cas de locuteurs anglophones de l'le du Cap
Breto
, qui fait partie de la Nouvelle-cosse, province
atlantique du Canada (o habitaient autrefois beaucoup de
fa
co
hones, qui ne sont plus aujourd'hui que 5 %, par
extmctlOn croissante du franais dans cet environnement
r
LES S E NTIERS D E L
1 N eTIO N 1 19
canadien anglophone). Le galique cossais, que parlait
encore, au dbut du xe sicle, un grand nombre des des
cendants d'cossais vivant sur cette le, a subi, partir des
annes quarante de ce mme sicle, un processus d'limi
nation au proft du seul anglais, qui a transform en uni
lingues les membres de cette communaut anciennement
bilingue.
Cependant, la langue n'a pas totalement disparu de
l'usage. On peut entendre le galique employ, sous forme
d'interections ou de phrases courtes, par des locuteurs
n'appartenant pas aux plus rcentes gnrations. Il s'agit
d'adresses lances l'interlocuteur, ou de rfexions d'ordre
gnral, ou encore de paroles exprimant une motion, ou
un vigoureux assentiment, ou une raction humoristique,
ou enfn, de salutations, d'obscnits ou de bribes de
vieilles lgendes. Certaines de ces adresses ont pour cible
le locuteur lui-mme. Cet emploi en monologue peut,
certes, dnoter une relation intme encore entretenue avec
la langue. Nanmoins, i ne peut apporter d'argument
srieux en faveur d'un maintien vritable, puisque les locu
teurs qui ont t entendus dans ces situations se servent
presque uniquement de l'anglais dans les autres circons-
tances de leur vie.
On peut en dire autant de l'usage comme langue
secrte entre vieux, et quelquefois jeunes, usagers, que
relie ainsi une complicit d'initis excluant les allognes.
Cette fonction intgrative de l'emploi d'un fantme de
langue comme marque de l'appartenance un groupe
s'observe aussi dans certaines communauts unilingues en
espagnol , aussi bien Lima pour le quetchua qu' Mexico
pour le nahuatl (aztque), alors que ces deux langues sont
bien vivantes dans la plupart des communauts bilingues,
et, bien entendu chez celles, habitant les zones rurales, qui
sont unilingues dans l'une d'entre elles.
1 20 HALTE LA MORT DES LANGUES
La crativit des sous-usagers
Le foisonnement d'inventions
On a observ que dans certains cas d'extinction
ano, les sus-usagers manifestaient une fappante
creatIVIte. DepUIS au moins le dbut du X" sicle, on
assure que le hongrois de l'est de l'Autriche est en voie de
dsparition imminente. Dans la petite agglomration
d Oberwart, par exemple, moins de douze kilomtres de
la fontire avec la Hongrie, 2 000 habitants, qui reprsen
ten le tiers de la population, devraient depuis longtemps
aVOIr cess d'tre bilingues, et ne plus parler que l'alle
mand du Burgenland, abandonnant leur hongrois ances
tral. Or le hongrois continue de vivre, si contraire que soit
pour cette survie l'environnement entirement gerano
phone. Mais la manire dont il vit est assez singulire.
Selon une enqute ralise entre 1974 et 1983 (Gal
1989), de nombreux habitants d'Oberwart, et non pas seu
lement parmi les plus gs, construisent des noms et des
verbes avec des lments non attests dans la norme
hongroise; ou bien, ne se souvenant plus des mots en
usage, ils en forgent de nouveaux, qui, bien qu'ils n'existent
pas, sont proches, par leur structure, des mots tombs
dans l'oubli; ou bien, ils donnent, des mots qu'ils poss
dent encore dans leur inventaire lexical, des sens indits,
faute de connatre le mot adquat pour ces sens; ils fabri
quent des verbes composs l' aide d'lments que la
norme hongroise combine dans certains cas mais non
dans d'autres; ils ne savent plus activr certains
mcaismes
,
: par exemple, dans l'enqute dont il s'agit, on
a
.
note que 1 un des sous-usagers disait tanult nekem (tu
dler-Y-pers. singulier-pass -moi) ( il m'a appris (des
choses) )}, au lieu de tnit, verbe causatif signifant ( faire
aprndre )}, seul adquat ici car le sens est { enseigner }.
AmsI , le vocabulaire de ces sous-usagers abonde en nolo-
r
LES S E NTIERS DE L'EXTINC TION 1 21
gismes qu'un Hongrois de Hongrie peut aisment com
prendre, tout en les identifant immdiatement comme
propres des locuteurs qui ont une connaissance inad-
quate de la langue.
I existe bien d'autres exemples de crativit des sous-
usagers, et notamment celui des deriers locuteurs de
l'arvanitika, dialecte albanais mridional qui, la fn de
l'Empire byzantin, fut introdut au nord-ouest de la Grce
par des colons albanais. tmergence d'une nation grecque
puis d'un tat, aprs la rvolution de 1 821 contre la domi
nation ottomane, rduisit l'enclave albanaise la fragilit
d'un lieu de culture minoritaire, et ce processus fut encore
accentu par la diffusion gnralise du grec dans l'duca
tion et l'administration. Les sous-usagers de l'arvanitika
parlent aujourd'hui un albanais fortement hellnis sur les
plans lexical et mme grammatical (cf. Tsitsipis 1989).
Lattention qu'ils prtent la manire de trouver la formu
lation la plus adquate avec des ressources en dclin
continu est un signe indicateur de la brivet probable du
temps encore allou l a langue avant une dispartion que
tout laisse prvoir.
Locuteurs de naissance et sous-usagers
On pourrait considrer que cet exemple, ainsi que
d'autres du mme type travers le monde, font apparatre
les sous-usagers comme capables d'invention. Leur atti
tude linguistique s'explique par la valeur attache la
langue veraculaire, et par le dsir conscient de la pro
mouvoir quand on sait qu'une concurrence redoutable
vient l'investir et l'liminer. En outre, les performances des
sous-usagers, mme si elles vont souvent contre l'usage
tabli, ne peuvent pas tre assimiles celles de sujets
trangers qui auraient mal appris la langue, ou seraient au
dbut de leur apprentissage. Elles ne peuvent pas davan
tage tre considres comme proches de celles d'enfants
aux tapes initiales d'acquisition de leur langue mater-
122 HA L TE A L A MO R T DE S L A NG UES
nelle, ainsi qu'on l e dclare ici ou l. Les moyens partir
desquels les enfants francophones de moins de cinq ans,
par exemple, compensent leurs lacunes par extensions
analogiques du type il a mouru ou i sontaient pas l sont
plus maigres que ceux des sous-usagers, au moins en
priode d'obsolescence non encore proche d'une mort
i mminente.
Ainsi, bien qu'ils ne possdent pas la comptence
native dfnie plus haut, les sous-usagers ont nanmoins
une certaine comptence : leur relative aisance forger et
combiner les lments pour gnrer des formulations que
l'usage majoritaire ne ratife pas dnote une comptence
intermdiaire entre celle des locuteurs de naissance et celle
des trangers. On sait, en effet, qu'une caractristique des
trangers qui ne matrisent pas une langue, mais ont assez
d'astuce pour savoir exploiter fond leurs connaissances
lacunaires, est de multiplier les priphrases, qui disent, en
le glosant, ce que dirait plus vite le mot unique qu'ils ne
possdent pas. Cependant, mme si des cas comme celui
des Hongrois d'Oberwart conduisent nuancer le traite
ment simpliste en termes de vie et de mort, ainsi qu'
afner les notions de locuteur de naissance et de comp
tence native, il faut admettre que le comportement de ces
sous-usagers cratifs est rvlateur du profond appau
vrissement de leurs connaissances linguistiques. Ils sont
contraints de contourer par l'invention, et avec des for
mulations fautives quoique comprhensibles, l'ignorance
croissante o ils sont d'une langue en voie de s'tioler sous
la pression d'une autre, et hors de son pays d'origine.
Rigueurs puristes et fuctuations laistes
Les communauts dont la langue est en obsolescence
offrent souvent deux signes inconscients de cet tat: d'une
par le souci des styles fgs, et d'autre part une rigueur
puriste, qui n'exclut pas que, contradictoirement, la langue
1
'
LES S ENT I ERS DE L'EXT I NC T I ON 1 23
soit en mme temps abandonne dans un tat de fuctua
tion l'cart de toute norme.
La conservation des usages ritualiss
La perte de l'usage quotidien d'une l
gue
,
dans la
,
vie
intime et publique est souvent, aux derleres etapes d un
processus d'rosion, accompagne, sinon rvle, par la
prsence exclusive d' emplois ritu
ls de
.
cette langue. Le
u
r
style soutenu s'oppose fortement a celUI de la parole quotl
d
i
enne. Ainsi, selon une tude de 1 989 (cf. Campbell et
Muntzel) , le derier locuteur du chiapanec, langue ot
mangue de l'tat de Chiapas au Mexi(
u
.
e, se so
v
:
alt
presque uniquement, alors, d'un texte rehgleux destme a l a
rcitation solennelle, ne connaissa
t, en o
,
tre, qu
quelques mots de cette langue ; l
s ha?ltants de l Ile de Tn
:
nit (autres que les Indiens mentIOnnes plus haut) chez q
l
le yoruba de leurs ascendants africains (de la basse vallee
du Niger) est agonisant n'en connaissent plus que quelques
chants traditionnels; les deriers locuteurs du kemant e
avaient non seulement perdu, comme on l'a v tout
.
a
l'heure, les formes verbales trs diverses, mais en outre, Ils
donnaient un signe de son tat de disparition toute proch
:
,
en ceci qu'ils pouvaient, faisant i1lusi
?
,
sur le
:
compe
tence, dbiter des prires dans une vanete archalque de la
langue.
Les textes encore mmoriss peuvent tre longs: les
seuls locuteurs} existants d' un dialecte du tzeltal (langue
maya), celui du Sud-Est, autrefois parl couramment dans
l'
t
at de Chiapas, taient capables de rciter queques
prires, dont une, faite de couplets symtriques et nch
:
s
en mtaphores, importante dans leur culture, et partagee
avec les usagers du tojolabal, autre langue maya, elle
.
en
bonne sant. En tout tat de cause, cette seule attestatIOn
d'une phrasologie solennelle en style ritu
lis,
.
l'exclu
sion de tout emploi naturel, signale la reductIOn de la
langue l'tat de fossile musifi.
1 24 HA L TE LA MORT DES LA NGUES
Le purisme des moins comptents
.
La plupart des socits, soit par la voix d
.
CIel, soit par celle des spcialistes dont l ' t
OUV
Ir o
fxent une nore de leur lan
au onte est etabhe,
avec des degrs variables de
ge.
T
Ues peuvent la concevoir
d
f
enseurs les plus soul
souP
d
esse. O constte que les
..
eux u modele nor tf pallOlS, dans les communaut ' ' 1 l
a sont
dlabrement, ceux qui ont d':
o a a
gue est en tat de
tine, Ainsi, au
Mexique ' l
e :ratIq
e
.
la plus incer
ceraines parties et mo
e
d
n ual reslste bien das
semi-locuteurs des diaectes :au:
s d aus
:
les derer
fxent une norme exigeante (cf. Hill
le d obsolescence
par exemple aux autes d' til'
). Ds rprochent,
"
u Iser une stct
1 pour 1 expression de la possession ainsi d'
e espago e
la derir syllabe les m t
'
,
qu: accentuer sur
o empruntes meme
d il touve que cette accentuation est l
'
quan se
prescrivant la fdlit l'accentu
r a noe en espagol ;
ravant-derre syllabe l'}S
. In na uatl, qui fppe
, reqUIerent que l'
par exemple, ciad ({ vlle ) et !gar ({ lieu
)
,
n prononce,
Or ceux qUI prescrvent cett
mmes dont la lan
'
e norme sont ceu-l
ont depuis 10ngtem::;:e:n
e dst
cturation. s
:e
r
I:
x
tYPi
.
que
dU
d
nahuatl, tels :
l
:rf
, ( Je VIan e-mange ) pour si nifier l' est un mangeur de viande) l
.
g
que on
tions subordonnes Le
;: cnst
ctIOn des Proposi
nahuatl est ici l'indi
e de
P
l'
, .
de
d
f
en
l
sIf des
zlateurs du
erOSIOn e eurs c
.
Certes, le purisme peut fort b'
A
onnalssances.
bons, et mme de fort
len etr
recommand par de
Mais il s'agt alors d
'
autr
;
s
o
:
1
::
s
le
d
a l
ngue.
OCcupe, cette attitude est typique d l
'
as
j
qUI nous
comme si les semi-locuteurs i u
e 0 so escence,
v
?
ulaient, par le maintien artifciel ;
phase prt
.
erminale,
s opposant l'mage de l
.
d
une norme ngoureuse
pleine comptence
.
a VIe, se onner J'illusion de la
L ES SE N Tl ERS DE L ' E X Tl N C Tl 0 N 1 25
Les hypercorcctions
Panni les caractristiques de la langue rode des sous
usagers, il en est une qu'il convient de mettre part et d'ins
crre au dossier des marques de vie renouvele qui sont, en
fait, des indices de mort proche. Ce sont les hypercorec
tions, ou emplois fautifs par application trop large d'une
rgle au champ troit, ou par prorogation artifcielle d'un
usage ancien disparu dans la langue modere. Ainsi, dans
deux langues peut-tre connues encore de quelques vieil
lards. mais plus probablement teintes aujourd'hui, le xinca
(au sud-est du Guatemala), et le pipil (au Salvador, et
appartenant la famille aztque), des enqutes ralises
entre 1 975 et 1 985 relevaient que les locuteurs employaient
dans tous les contextes quelques consonnes d'articulation
complexe dont l'apparition, dans la norme, tait strictement
limite certains contextes. Les hypercorrections sont loin
d'tre inconnues dans les langues en bonne sant. Ainsi,
c'est une hypercorrection que de dire en fanais contempo
rin, par restauration de l'usage classique, j' pense (o y
rfre un humain) ou je n'ai pu m'mpher de le vous
dclarer. Mais les hyercorrections, dans le cours nonnal de
l'volution, ne prennent pas la fquence qu'on les voit
prendre dans les cas comme celui qui est cit ici.
Le trait dominant de ces phnomnes est, en fait,
l'instabilit. Il n'y a pas de limite obserable aux hyper
corrections, ni de rgle qui en organise la rpartition. Il n'y
a pas davantage de dlimitation prcise. et encore moins
concerte, des domaines auxquels devront s'appliquer des
prescriptions puristes. Tout au contraire, i l manque cruel
lement aux semi-Iocuteurs une vue cohrente de ce que
pourrait tre une dfense de la norme. Les pulsions
puristes, quand elles existent, ne se dploient qu' contre
courant, comme on l'a vu pour certains dialectes nahuatl,
et non pour appliquer un dessein gnral de dfense.
C H A P I T R E V I I
Le bataillon des causes
Les trois groupes de causes principales
LES CAUSES PHSIQUES
Mort brutale d'une lngu
Par disparition de tous les locuteurs : catastrophes natureles,
gnocides, pidmies, migrations
C'est le cas le plus simple, si l'on ose dire. Ici, les locu
teurs disparaissent tous, sans qu'ait t assure aucune
transmission de la langue, mme des trangers. Il peut
s'agir d'une catastrophe naturelle, comme l'ruption vol
canique qui, en 1 8 1 5, causa la mort de la totalit des
Tambora, habitants de l'le de Sumbawa, dans l'archipel
indonsien des petites les de la Sonde, qui sparent Java
de Timor. On n'a du tambora que la coure liste de voca
bulaire qu'avait tablie un voyageur anglais au dbut du
X" sicle. Actuellement, les petites tribus des monts Goliath,
en Irian Jaya, et leurs langues, diverses et peu connues
comme presque toutes celles de Boro, se trouvent, sans
1 28 HA L TE L A M 0 R T DES L AN G UE S
avoir encore t dtruites, sous la menace des glissements
de sols et tremblements de terre particulirement f
quents dans cette rgion (cf. Dixon 1 991 ).
.
Le phnomne de mort des langues peut aussi con
CIder avec un ethnocide, c'est--dire l'limination d'une
culture et d'une langue, sans qu'il y ait massacre de ses por
teurs. Mais il peut aussi s'agir d'un gnocide. Ainsi, en 1 226
les Mongols de Gengis Khan anantissent les Xixia (o
Tangut), peuple tibto-birman de l'ouest de la Chine (rgion
actuelle du Gansu), qui avait dvelopp une culture floris
sante et invent une criture idographique Oliginale ; leur
langue est broye en mme temps qu'eux. En 1 62 1 , les
Hollandais dpeuplrent l'archipel des lots Banda, au
centre de l'ensemble insulaire des Moluques, en massacrant
ses habitants. De mme, nous n'avons plus aucune trace de
la ou des langues qui se parlaient en Tasmae, car les occu
pants aborignes de l'le ont t annihils.
Un massacre (ran matanza dans la mmoire popu
laire) eut lieu au Salvador en 1 932, dont frent victimes
plus de 25 000 Indiens. Avec eux moururent totalement
eux langues
:
le cacaopera et le lenca. Les Andok, popula
tIon amaZOnIenne du sud-est de la Colombie et du nord
ouest du Brsi, furent dcims par une srie d'atrocits
que perptrrent les compagnies exploitant le caoutchouc
sauvage au cour du xe sicle (cf. Landaburu 1 979). En
Colombie encore, des massacres d'Indiens ont eu lieu au
xe sicle. Les guerres fontalires de 1 982 et 1 995 entre le
Prou et l'quateur ont conduit au bord de l'extinction de
nombreuses tribus indiennes des deux pays, et de mme,
pe
dant
.
la deire dcennie, les violences de l'organi
satIon dIte SentIer lumineux sur les hauts plateaux andins
au Prou. La destruction programme des Juif d'Europe
de 1 933 1 945 par la machine hitlrienne a eu raison du
ydiche
t d
djudezmo (cf. p. 2 1 7-21 8). Un programme
d
xtermI
atlOn comparable a galement priv les parlers
tZiganes d une grande partie de leurs locuteurs.
r
LB B A T A I L L ON DBS CA USES . 1 29
S'il ne s'agit pas de massacres, i peut aussi s'agir
d'pidmies, qui ne laissent aucun survivant, ou de guerres
de destruction ayant le mme effet. Mais les causes sont
rarement simples et uniques. Le Mexique de la seconde
moiti du XVe sicle ofe un exemple dramatique de ce
que peut produire leur conjugaison : bactries et agents
pathognes de toutes sortes, au pouvoir exterinateur
considrable, comme on peut l'imaginer, sur des popula
tions totalement dpourvues de dfenses immunitaires et
non armes d'anticorps, frent maints ravages ds le
contact avec les Europens ; mais il s'y ajouta d'autres fac
teurs la nocivit trs sre : changements radicaux dans
les relations avec l'agriculture, dplacements, sur des
terres peu prs strles, de paysans chasss de leurs
champs fertiles par les Espagnols qui s'en saisissent.
Dpossds de leurs traditions, de leurs biens et de
leur civilisation, habits du sentiment d'tre abandonns
de leurs dieux, beaucoup d'Indiens en venaient perdre la
saveur de vive. De l l'abstinence sexuelle, les avortements
et les suicides, qui expliquent la disparition d'un grand
nombre de langues tribales. C'est tous ces facteurs que se
sont ajouts les massacres, pour faire de la mort des
hommes une cause essentielle et efayante de la mort des
langues. Et ce qui est vrai des ethnies d'Indiens du
Mexique l'est peu prs des aborgnes d'Australie,
ravags par la syphilis, la variole, la grppe, et dcims par
la violence des Blancs (qui dfendaient ainsi les terri
toires de chasse o se rintroduisaient ceux qu'ils en
avaient exclus).
Enfn, une langue peut disparatre par suite du dpart
de ses locuteurs sur d'autres terres que les leurs. Souvent,
il s'agit de communauts dont l'activit traditionnelle est
en dclin, et qui cherchent ailleurs des emplois pour vivre.
Elles adoptent alors la langue du lieu d'immigration. Ce
processus peut tre lent. I peut aussi tre rapide, comme
dans le cas des habitants de petites les s'installant sur le
1 30 HAL TE LA MORT DES LANGUES
continent, et soumis l'infuence de la langue, fort pou
voir d'expansion, qui s'y parle.
Par dispartion des deri ers locuteurs sans transmission
La mort d'une langue peut. galement, tre lie la
pure et simple disparition physique, sans descendance
ayant acquis cette langue, non pas d'une ethnie entire,
mais des ultimes locuteurs, les vieillards qui connaissaient
encore l'idiome du groupe. Divers travaux citent les noms
des deriers usagers uniingues de nombreuses langues,
notamment amrindiennes, qui, aprs la mort de ces usa
gers habitus les utiliser entre eux, n'ont videmment pas
pu leur survivre.
L'occultation par stratgie de survie
I ne s'agit pas ici d'une disparition physique, mais on
peut imputer aux causes physiques, au moins indirectes,
les situations d'oppression ou de pril dans lesquelles se
trouvent des populations. Pour chapper de graves dan
gers, des perscutions insupportables, ou la mort, une
communaut abandonne brusquement sa langue, par stra
tgie de survie, dans la mesure o c'est un acte ngatif de
dfense que de se dissimuler en tant que locuteurs, face au
sort tragique de ceux qui afchent l'usage de cette langue.
C'est ainsi qu'au SalvadOl: lors des massacres de 1 932 men
tionns ci-dessus, les locuteurs du pipil, voyant qu'une
grande partie des leurs subissait le mme sort que les
Cacaopera et les Lenca, renoncrent abrptement leur
langue. Le pipi] tait devenu moribond dans les annes qui
suivirent, et il est probablement teint aujourd'hui.
La dportation
Dans ce cas encore, il ne s'agit pas de disparition phy
sique. POUliant, c'est une contrainte corporelle que la
r
LE BATAI LLON DES CAUSES . 1 3 1
dportation, a
ec les consquences qu'elle induit. En
Australie, aux Etats-Unis, au Canada, beaucoup de com
munauts ont t araches leurs terres ancestrales, et
transportes contre leur gr sur d'autres. Leffet que cette
violence produit sur les langues est facile comp:edre ,:
partout, les tribus dpores se retrouvent mlee a
d'autres, galement dportes, qu'elles ne connaISSaIent
pas et dont elles ignorent la langue. Celles des opressurs,
ou divers jargons d'urgence qui naissent de ces situatIons,
deviennent les seuls moyens de communiquer. Les langues
tribales d'abord rduites au seul usage familial, perdent de
plus en lus leur raison d'tre, tant dnn la vie nouvelle
laquelle sont confrontes les populatIOns, et les rapports
troits qui commencent les lier entre e!les.
,
Ces lagus
fnissent par disparatre le plus souvent. C est la le scenarIO
qui a domin depuis deux cents ans l'?istoire ?e beaucoup
de langues australiennes, et, aux Etats-Ums, celle des
langues de communauts dportes en Oklahoma.
LES CAUSES CONOMIQUES
ET SOCIALES
Pression d'une conomie plus puissante
On pourrait se demander p
urquoi le nerlandais ne
s'est pas maintenu dans les Etats de New York, du
Delaware et du New Jersey, possessions des colons des
Nouveaux Pays-Bas de 1 623 1 664, pourquoi le fan
ais a disparu dans l'
tat du Maine, o les immigrs fan
cophones d'Acadie taient pourtant tres nombreux, pour
quoi enfn les langues aficaines n' on pas survcu dans les
communauts noires amricaines (cf. Mufwene 1 999). La
rponse n'est peut-tre pas rechercher trop loin. La
machine conomique et, par consquent, les structures
administratives coloniales et postcoloniales, avaient un
moyen d'expression et un seul : l'anglais. Certes, cette pr-
132 HALTE LA MORT DES L A NG UES
minence ne fut pas immdiate : les colons dominrent vite
l'agriculture, mais la rvolution industrelle, qui s'tait
amorce ds les premires dcennies du XVIII' sicle en
Angletere, fut plus tardive aux tats-Unis, o il fallut
construire les structures politiques et rparer les dom
mages de la guere de Scession. Mais ds le derier tiers
du Xe sicle, l'anglais, et non les autres langues, devenait,
et allait devenir de plus en plus, le vecteur linguistique, et
mme un des signes, du progrs conomique.
Cette mme cause explique sans doute le dclin des
langues amrindiennes : les structures conomiques mises
en place par la population anglophone devenue majori
taire rendaient la connaissance de l'anglais de plus en plus
ncessaire aux Indiens ds lors que ces deriers, devenus
minoritaires et domins sur leurs propres teritoires, sou
haitaient entrer en relation vritable avec le nouveau sys
tme, et y trouver des espaces d'insertion professionnelle.
Ds lors, la conservation d'une aptitude bilingue devenait
de moins en moins justifable, si l'on suit le raisonnement
ordinaire, videmment critiquable, des communauts,
dans lesquelles la majorit des parents posent le problme
de l'apprentissage des langues en termes de cot et de
rendement : la transmission des langues indiennes tendait,
selon un mouvement d'amplitude croissante, tre juge
trop onreuse, au regard des dividendes, mesurs en
termes de mtier et d'intgration, qu'elle pouvait rapporter
aux enfants.
Crtion d'une clsse social supieure
Au sein d'une communaut, il se constitue souvent un
groupe d'individus qui s'inspire, pour se porter aux com
mandes, de modles trangers. Si ce groupe parvient
s'imposer, et s'il s'accrot, alors un moment peut ariver o
la langue, extreure au groupe, que celui-ci a adopte
pour ce qu'elle reprsente de force conomique, exerce une
pression sur la langue veraculaire. Pour peu que l a langue
r
LE BA T A I L LON DES C A USE S 1 33
intruse tende son audience grce l'apparition de locu
teurs de naissance, sa pression devient plus puissante
encore.
,
Tel est en termes gnraux, le processus que 1 on peut
tenir pour
'
responsable du dclin du
,
gall
is au p
ys de
Galles, en dpit de l'apparence de sante qu Il offe, SI on le
compare la prcarit des principales autres langues cel
tiques, dont le breton et l'irla
dais.
ffet, un
.
e c!asse
suprieure politiquement dommante s etaIt constItuee au
pays de Galles ds l'poque des Tudor ; cette
.
cla
se ait de
plus en plus attire vers Londres et sa dommatIOn econo
mique et culturelle ; et d
ns ;a
econde miti du
XVIIIe sicle le dclin du gallOls, qu aVait commence de pro
voquer ce;te situation, se trouva encore acclr par
l'immigration de locuteurs anglophones dans les mines de
charbon du sud-est du pays de Galles.
Il est vrai qu'il existe d'apparents contre-exemples.
Car les phnomnes linguistiques, q
i mettent en )e
.
u
ne
matire humaine, ne sont pas de 1 ordre du predlctlble
sans exceptions, et plus encore quand i n
/
tervien
ent des
facteurs exteres, comme les facteurs economiques et
sociaux. Ainsi, on signale (cf. Poulsen 1 98 1) le cas du
dialecte fison parl sur les les de Fhr et d'Amrum (
n
mer du Nord, au large des ctes orientales du Schl
Vg
Holstein) . Aprs le dclin de la pche au hareng tr
dltIOn
nelle une cole fut fonde, au XVIe sicle, pour enseIgner la
naviation aux garons de ces les, qui trouvrent ensuite
des emplois dans les compagnies nerla
dases don les
btiments sillonnaient les mers.
Parler ledit dIalecte frison
tait un avantage, et les immigrants avaient intr
l'apprendre s'ils voulaient devenir memre
de ce mIlIeu
assez ferm de marins. Ce fut un des pnnClpaux facte
rs
de maintien d'un dialecte prcdemment en danger de dIS
parition. Mais, d'une part, les con;re
exmple
de ce ype
sont assez rares ; d'autre part, il s agit d un mlcrosyst
:
me
conomique et d'un milieu professionnel restreint, qm ne
r i
1 34 HA L TE L A M 0 R T DES L A N G UE S
sont pas imaginables pour une vaste communaut
confonte une langue dominante.
Langue dominante et lngu domin.
Interrtation cologique des modles socio-conomique
Il est possible d'interprter en termes cologiques les
phnomnes dont il vient d'tre question. Si on largit la
notion, propose prcdemment (cf. Hagge 1 985, 246-
247), d'colinguistique, on dira que les langues, pour sur
vivre en continuant de mener une vie normale, doivent
s'adapter aux nouvelles ncessits de l'environnement co
linguistique. Les pressions qu'exerce un environnement
colinguistique jusqu'alors inconnu deviennent beaucoup
trop fortes pour que les communauts confontes un
mode de vie radicalement nouveau aient les moyens et le
temps d'y faire face en adaptant leurs langues. Le rempla
cement de ces langues par d'autres, reprsentant un statut
conomique et social plus puissant, apparat ds lors
comme la consquence, leurs yeux, de cette situation. En
d'autres termes, la renonciation la langue autochtone, et
l'adoption de la l angue qui est vue comme la plus efcace
sur le march des valeurs linguistiques, semblent tre les
moyens de la promotion conomique et de l'ascension
sociale.
Ici s'afontent une langue dominante et une langue
domine. La langue dominante est en position d'assaillant.
Le territoire conqurir pour eHe, dfendre pour l'autre,
est un vritable gisement exploitable. Ce teritoire n'est
autre que la communaut linguistique mme qui s'tait
constitue autour de la langue d'origine, passe au statut
de langue domine. On peut parler d'une rosion fonction
nelle de la langue domine, au sens o son rendement
comme moyen de communication ne cesse de dcrotre
mesure que s'tend, symtriquement, celui de la langue
rivale, qui est associe une rvolution des murs cono
miques.
LE BA TA I L L ON DES CA USES 1 35
L slection naturell
On pourait galement interprter en termes darwi
niens de slection naturelle le phnomne par lequel la
langue d'une population conomiquement plus puissante
tend menacer celle d'une population plus faible. Mais il
faut alors considrer l'afontement entre les systmes co
nomiques comme le thtre de forces produites par la
nature et par les conditions de l'environnement. Un tel
traitement est concevable. Certes, la volont consciente qui
produit la domination conomique diffrencie d'une
manire profonde les socits humaines et les autres
socits animales. On ne saurait oublier que la langue,
espce naturelle par beaucoup de ses aspects (cf. chap. II),
est aussi, d'une part, le produit d'une aptitude cognitive
inne, et d'autre part une institution sociale. Mais on peut
admettre que les rapports de domination sont eux-mmes
des donnes naturelles, reprsentation mtaphorique des
donnes sociales. Dans la lutte des langues pour la vie, plu
sieurs facteurs rendent dominantes certaines d'entre ell es.
Cela est vrai dans n'importe quel territoire et toutes les
chelles, comme va le faire apparatre un autre exemple,
cette fois pris en AfTique.
Chasseurs-cueilleurs et leveurs-agiculteurs
Les langues des socits de chasseurs-cueilleurs sont
particulirement exposes au dclin. C'est en Afique de
l'Est que l'on observe surtout ce phnomne. Il s'agit de
petits groupes souvent misrables dont la rputation,
auprs des agriculteurs et leveurs. tait traditionnelle
ment mauvaise, car leur activit de nomades, en qute de
gibier et de plantes et vivant sans hygine, tait considre
comme proche de celle d'animaux. Bien que les faits vo
luent raison mme des initiatives que prennent ces
groupes pour modifer leurs conditions de leur statut
1 36 HA L TE LA M 0 R T D ES L A N G UE S
s
?
cial est assez bas. Ils subissent donc une trs forte pres
SIOn du modle pastoral, qui leur permet la fois moins de
pauvret et un meilleur statut.
Il s'ensuit que les socits de chasseurs-cueilleurs sont
pousses, par des raisons conomiques et sociales, aban
donner leurs langues en faveur de celles du groupe auquel
elles souhaitent s'intgrer. Les exemples de cette situation
sont assez nombreux. On n'en retiendra que deux ici. Les
Kwegu du sud-ouest de l'Ethiopie, en partie sdentariss
dans de pauvres villages le long de la rivire Omo, prati
q
ent une culture immerge, assez rduite, du mas, mais
VIvent surtout de la chasse l'hippopotame et de l'apicul
ture, vendant leur hydrof.el, dont le pouvoir enivrant est
apprci sur les hauts plateaux thiopiens, mais gardant
pour
.
leur consommation la viande ; car leurs voisins, les
Mursl et les Bodi, considrent comme taboue la chair de
nombreux animaux.
Les Kwegu entretiennent des relations de clientle
avec ces voisins, qui veillent leurs intrts, et dont ils gar
dent les troupeaux avec l'espoir de devenir proprtaires de
ttes de btail ; ils pousent souvent les flles de leus pro
tecteurs. Les couples ainsi forms seront d'autant moins
incits transmettre le kwegu que les mres ne le parlent
pas, et le considrent comme difcile alors qu'il a beau
coup e points communs avec le mursi et le bodi, qui
appartIennent comme lui la famille linguistique nilo
saharienne ; et surtout, le bilinguisme d'ingalit qui se
gnralise ne profte pas au kwegu, langue sans valeur
socio-conomique. Un autre exemple, galement aficain,
est celui des Dahalo, chasseurs-cueilleurs au nombre de
quelques centaines, qui vivent dans la province ctire du
Knya, e
,
n face de l'le Lamu, et dont on a vu (p. 1 1 0) que la
langue s est fortement rode sous la pression du swahili,
parl par la majorit de la population dans les villes.
Les chasseurs-cueilleurs qui tendent devenir le
veurs et agriculteurs gardent quelque temps la conscience
d'appartenir une certaine ethnie. Mais en abandonnant
LE BA TAILL O N D E S CA US ES . 137
leur mode de subsistance et en changeant de statt social
du fait des mariages intertibaux et des rapports de clien
tle et de protection, ils abandonnent aussi les activits
culturel1es et les traditions qui sont lies l'usage de leur
langue ; ces deux abandons se cumulent pour les conduire
sacrifer cette langue elle-mme. Ds lors, le mantien
d'une vritable identit distincte, mme s'il est fortement
souhait, devient largement illusoire. I en est de mme
dans d'autres socits, comme celles de pcheurs. Pour ne
prendre qu'un exemple i ci aussi, les Elmolo. anciens
pcheurs des rives mridionales du lac Turkana, au Knya,
ont quasiment perdu leur langue (de la famile couchi
tique), en passant celle des Samburu, peuple nilotique
auquel ils se sont assimils conomiquement et cultu-
rellement.
Dcin d l ve rura
De mme que les chasseurs-cueilleurs et les pcheurs
s'assimilent aux agriculteurs et leveurs dont ils veulent
acqurir le statut suprieur, de mme les paysans sont sou
vent attirs par la vie urbaine, o ils esprent trouver une
meilleure situation conomique. La consquence linguis
tique, plus ou moins brve chance, est, ici aussi,
l'extinction. C'est l ce qui pourrait advenir, au moins dans
les villes, au nubien, langue de la famille nilo-saharienne,
en principe parle encore par 200 000 personnes en Egypte
et au Soudan. En Egypte, les Nubiens les plus jeunes,
attirs par les meilleures perspectives d'emploi qu'offe
leurs yeux la ville, sont nombreux se rendre au Caire ou
Alexandrie. La prsence de ]' lectricit, et donc de la radio
et de la tlvision, fait beaucoup pour promouvoir parmi
eux l'arabe, dont les hommes deviennent ainsi des vec
teurs. Car ils sont plus prsents dans les foyers, du fait de
la proximit de leurs lieux de travail par rapport aux vil
lages, et tendent parler en arabe leurs enfants. Seul le
1 38 HA LTE A LA MORT DES LANGUES
nubien des zones rurales chappe encore au dclin qui
menace la langue dans les zones urbaines.
On pourrait considrer que ce schma, quelques
variantes prs, s'applique partout. Le dclin des langues
rgionales, des dialectes et des patois en France fut li la
dsertifcation des campagnes, la mobilit profession
nelle, l'attrait du confOli (relatif) de la vie citadine. Selon
une certaine opinion, les paysans franais qui renoncrent
leurs langues locales, autrement que sous les brimades
des instituteurs chargs de rpandre la langue de la nation
et elle seule, agirent librement : ils taient attirs par le
progrs, ou ce qu'on dsigne ainsi. Mais l'volution rapide
des modes de vie les mettait-elle en situation de choisir ?
Abandon des activit traditionnells
Lorsqu'une population renonce son mode de vie pour
des raisons conomiques et sociales, un des efets de ce
choix est la rduction, et bientt l'abandon, des activits
anciennes. Or la langue dans laquelle ces activits s'expr
maient tait celle de la tradition, ensemble des symboles
culturels o se reconnaissait l'ethnie. La langue ethnique est
donc expose disparatre en mme temps que la cultue
dont elle tait le vhicule. Parmi les exemples de ce pro
cessus, on peut retenir celui des langues des AbOli gnes
d'Australie. Dans la plupart des groupes, la chasse et la
pche ont disparu ou ne se pratiquent plus qu' petite
chelle. l en est de mme des ftes noctures appeles cor
roborees (par rinterrtation selon le mot anglais le plus
proche, mais sans aucune parent smantique (to corrobo
rte coroborer ), du mot korobr, signifant danse ,
probablement en wunambal, encore parl au nord de l'Aus
tralie occidentale). Au cours de ces festivits, qui clbraient
la vi ctoire d'une tribu ou quelque autre vnement faste, on
dansait et discourait, videmment en langue veraculaire.
Au dbut, les Aborignes se servaient de leurs langues dans
ces circonstances, comme dans toutes celles de leur vie per-
LE BATA I L LON DES CAUSES 1 39
sonnelle et familiae, et de l'anglais dans leurs activits pro
fessionnelles et dans leurs relations avec les Blancs. Mais
mesure que l'assimilation entranait le dclin des coutumes,
ils consacraient de moins en moins de temps ces
derires ; par suite, ils se servaient de moins en moins des
langues qui en taient le support, et de plus en plus de
l'anglais. C'est de cette faon que le changement de repres
culturels peut conduire la mort des langues.
On observe mme des cas de corlation directe entre
le dclin des activits traditionneles et l'rosion du sys
tme grammaticaL Ainsi, on peut comprendre pourquoi
les ultimes locuteurs du kamilaroi (cf. p. 1 12) avaient
presque compltement perdu, lors de la derire enqute
dans les annes 1 970, le systme trs labor par lequel les
verbes y permettaient de distinguer morphologiquement
les moments de la joure o s'accomplit une action.
Limportance culturelle de ce systme tenait ceci, qu'il
tait fond sur les cycles de comportement adopts, entre
le lever et le couchr du soleil, par les animaux que les
Kamilaroi avaient jadis l'habitude de chasser. Prcisment,
les deriers vieillards avaient depuis bien longtemps cess
toute activit de chasse, et les plus jeunes membres de la
tribu s'taient dtachs de ce mode traditionnel de relation
avec l'environnement.
LES CAUSES POLITIQUES
Les lngues immoles sur l'autel d l'tat
Les tats et le plurilinguisme
rtablissement de pouvoirs politiques centraliss et
soucieux d'tendre leur matri se sur toutes les rgions qui
sont censes relever de leur autorit n'est pas toujours
compatible avec le maintien de petites ethnies parilles
sur de vastes territoires. Le dveloppement des Etats cons-
1 40 HA L TE LA MOR T D E S L A N G UE S
cients de leur poids politique s'est souvent accompag'
d'
.
e
entrepnses particulirement nfastes pour ces ethnies '
destruc
ion de l'habitat, dforestation, dplacement d
ul
tIOns, assimilation force. Telle est, par exemple,
1 hIstOIre d
.
la
.
colonsation espagnole en Amrique cen
tral
.
et
.
mendIOnal
,
.
et de la colonisation angaise puis
a
encame en Amenque du Nord. Les politiques colo
males des autres pays, Portugal, Pays-Bas, France n'ont
pas t trs diffrentes de ce schma.
'
Les co
squence linguistiques de ce rapport de
f
?
rces se laI
sent facIlement apercevoir. L'idologie des
Etats construIts autour de la domination d'une nation n'est
gure favorable au foisonnement des langues et aux tenta
tions de dispersion qu'il implique. La rduction constante
du rle des langues rgionales est l 'efet le plus visible de
la politique l inguistique en France, sous la monarchie
comme sous l rpublique. Lordonnance de Vil er-Cottert
n
fait que po
ctuer, en 1 539, une srie d'actes royaux qui,
des avant le regne de Louis X, n
'
avaient eu d'autre objet
que l'
xtension de la langue de l'tat rognant les positions
du latm, c
,
ertes,
.
mais aussi celles des langues rgionales.
So
s la
volutIOn, le mot de l'abb Grgoire est signif
catIf, qUI mvoque la ncessit d'une seule langue sans
laquelle il est impossible de se comprendre l'chlle de
toute l a nation, et par consquent impossible d'assurer la
circulation des marchandises et celle des ides.
ete politique est une des causes (mais non la seule)
du declm des langues rgionales, ainsi que des dialectes et
des patois, dans la France contemporaine (cf. Hagge 1 987
et 1 996b) . La France est loin d'tre un cas isol. C'est, dans
la plupart des socits riges en tats, une caractristique
fondamentale de la conception qu'elles se font des bases de
l'unit nationale, que de construire ces derires sur l'unit
linguistique. Il se pourrait que la conception de la cohsion
nationale comme lie l'unit linguistique ft surtout
rpandue en Europe et en Amrique, en juger par l'atti
tude plus souple que l'on trouve, face au plurilinguisme, en
r
LE B A TA I L L O N DES CA U S E S 1 41
Inde, en Thalande, en Malaisie, et mme, dans une cer
taine mesure, en Chine (cf. Fodor et Hagge 1 983- 1994) .
Ltat et le linguicide
Les pouvoirs politiques ne s'en tiennent pas des
mesures limitant l'usage des langues minoritaires. Sou
vent, ils ne font rien pour empcher une mort que tout
annonce pour certaine. Mais ils vont parfois plus loin. I
arrive ainsi qu'ils pourchassent les langues, sans
J
0ur
autant exterminer l eurs locuteurs. Le linguicide d'Etat,
c'est--dire l'limination concerte d'une ou de plusieurs
langues par des mesures politiques explicites,
st nota
ment illustr par la guerre que livrrent les Etats-Ums,
durant les premires dcennies du X" sicle, aux langues
parles sur diverses les de Micronsie, comme l'est le cha
morro (ou guamefo) Guam, ainsi qu' Saipan, Rota,
Tinian, Pagan, Anatahan et Alamagan. Le pouvoir amri
cain, plus encore que le pouvoir espagnol avant lui,
s'effora, par des dispositions administratives trs strictes,
d'annihiler le chamorro, et parvint une rduction specta
culaire du nombre de ses locuteurs. Il semble nanmoins
que la langue ne soit pas morte.
Un autre exemple bien connu se situe dans la mme
rgion. Ds les premires annes du xe sicle, aux Philip
pines les autorits politiques amricaines, aprs l'viction
de l 'Espagne entre 1 898 et 1 90 1 , entreprennent, par l'envoi
d'auxiliaires anglophones jusque dans les villages e mon
tagnes, une vritable extirpation de l'espagnol, qu avaient
fortement introduit parmi les lites prs de cinq cents ans
de pouvoir colonial, certes remis en cause depuis le dbut
du XVIe sicle par une longue srie de rbellions.
Parfois, l'entreprise de linguicide a t perptre par
un groupe dominant qui appartenait la popula;on m
e
des locuteurs d'origine. Par exemple, l'Acte sur 1 EducatIOn
adopt par le parlement cossais en 1 61 6 stipule que dans
chaque paroisse, les coles devront gnraliser l'usage de
1 42 HA L TE L A MO R T DES L A N G UES
l'anglais, et pourchasser le galique cossais, dcrit comme
sourc
de toute barbarie, et par consquent W abolir et
suppnmer de tout enseignement.
Les instruments d l'excution difre
Les tats e sont certes pas obligs de prendre, contre
les angues qu Ils ont condamnes, des mesures adminis
t
:
atlVes ex
licitement adaptes l'entreprise d'extermina
tIon. Ils dIsposent aussi d'instruments d'excution des
lang
es qui, pour tre plus lents, sont tout aussi effcaces.
Ces m
ruments sont bien connus, et ne seront rappels ici
que bnevement. Ce sont l'arme, les mdias et l'cole. Il ne
sera
.
questio
i
i que de l'arme et des mdias. J'exami
neraI plus lom 1 action de l'cole.
Larme
On sait que le brassage des conscrits fut en France
sous la troisime Rpublique, moins qu'il ne l'ait t d'
1 I l
es
a
.
premIere, o
ue a Rvolution levait en masse pour
f
Ire f
ce axpenls sur les frontires, un des moyens de la
IfsIOn generale du fanais, raison mme de l'assigna
tI
?
n ?es
,
a
gues rgi
,
n
le
, .ialectes et patois, un statut
redUIt d IdIOmes de 1 mtlmlte. Le russe a jou un rle sem
blable au xe sicle par rapport aux nombreuses langues
des
.
mbattant de base des armes tsaristes et surtout
s
vletlues, qu Ils fussent originaires du Caucase, des
r
phqu
s musul
,
m
nes d'Asie centrale, des rgions de
SI bene onentale ou VIvent de; ethnies disperses turques,
10ngoles et toungouses, ou d aill eurs ; dans toutes les par
t
:
es d
A
ce pays, la langue la plus forte, le russe, ayant voca
tIOn d etre langue de l'union, assimilait toutes les autres.
Les mdias
.
L bo
bardement des masses par la radio et la tlvi
SIon s expnmant dans l'une ou dans l'autre des quelques
T
LE B A TA I L L ON DES CA US ES 1 43
langues de diffusion mondiale (anglais, espagnol, franais,
portugais) ne peut avoir qu'un rle dltre pour le
langues tribales et rgionales qui en sont absentes, et qUI
se trouvent tre celles d'une partie des auditeurs et specta
teurs. I est inutile d'insister sur cette cause transparente
de disparition des langues mal dfendues. On se conten
tera de rappeler que parmi les tribus isoles dans des
brousses inaccessibles, le nombre est de plus en plus rduit
de celles qui, ne disposant pas de postes rcepteurs, chap
pent cet assaut quotidien. Il faut aussi souligner que les
plus exposs sont ceux et celles qui sont encore les moins
pourvus en connaissances, et chez qui la transmission des
langues prcarises se fait de moins en moins alors qu'ils
sont les cls de leur surie : les nouvelles gnrations,
march idal pour la diffusion massive des cultes
(rmunrateurs ! ) ports par les mdias dominante
anglophone, notamment la musique pop, la mode et les
sports.
L'imprialisme de l 'anglais
La hirarchie des langes
Limprialisme de l'anglais occupe, aujourd'hui, une
place de choix parmi les facteurs de la mort des langues.
Les causes conomiques et sociales sont, certes, prendre
en considration avant toutes les autres. Mais l'anglais,
qui, tant la langue des socits les plus industrialises, est
le principal bnfciaire du choc entre communauts
quand l'une est conomiquement plus forte que l'autre,
acquiert, du fait mme de cette suprmatie, un poids
encore plus considrable, de nature politique, qui, son
tour, accrot son pouvoir de pression. Langlais amricain
recueille son proft tous les fruits de l'opposition quasi
ment hirarchique, et de plus en plus abrupte dans le
monde d'aujourd'hui, entre une langue locale rserve aux
rapports privs et une langue interationale qui a vocation
1 44 HA L TE LA MO R T D ES LA NG UES
'tre l e vecteur des transactions commerciales vaste
echelle, et donc aussi celui des idologies politiques et cul
turelles.
La promotion de l'unilinguisme et de la mentalit unilingue
Une consquence de cet tat de fait est la suprmatie
de cex qui ne parlent qu'une langue, et la faveur que
recueIlI
leur attachement cette seule langue. Une telle
p
omotI
n e l'unili
guisme et de la mentalit unilingue se
faIt benefce de 1 anglais. La comptence des individus
mult
.
Ilmgue
, au lieu d'tre apprcie pour ce qu'elle est,
s
volr u
?
e
.
ches
.
se, se trouve dvalorise comme un han
dIcap .
.
Lun
:
lmgUlsme au proft de l'anglais est v comme
g
rantIe, SInon comme condition ncessaire, du moder
msm
,
et du progrs, alors que le multilinguisme est
as
ocIe au
.
sous-dveloppement et l'arriration cono
n
:
lqU
, socIale
t poltique, ou considr comme une tape,
egatI
e et breve, sur le chemin qui doit conduire
1 ang!als
,
seul
.
Le
locuteurs se trouvent implicitement
consIgnes dans 1 troite cellule d'un choix : ou bien
conserver sa langue materelle, minoritire, ou politique
ment sans poids mme quand elle est majortaire, et ds
lors ne pas apprendre correctement l'anglais ou bien
apprendre 1'a
n
glais et donc ne pas conserver
'
sa langue
maternelle. DIvers travaux (cf., notamment, Lambert
1 967) montrent que ce choix est bien celui o l'on enferme
de
,
nombreuses communauts, par exemple celles d'immi
gres ans l
s p
:
ovinces canadiennes autres que le Qubec.
La evalonsa;lOn du bilinguisme va donc jusqu' faire
oublIer que I on peut apprendre une langue sans pour
autan renoncer celle que l'on parlait prcdemment.
BIen entendu, dans cette situation foncirement in
gale, les anglophones de naissance ne perdent rien. Car
pour eux, au contraire, l'acquisition d'une autre langue est
co
ue comme possible sans qu'elle implique le moindre
cout pour leur langue d'origine, ce qui signife que
LE BA TA I L L ON DES CA USES . 145
l'apprentissage est d'addition, comme il est naturel, et non
de substitution. En revanche, pour les autres, c'est bien
d'une substitution qu'il s'agit, car tout est fait pour les per
suader que le bilinguisme est un luxe coteux, et que seule
la langue dominante vaut l'investissement d'apprentissage,
puisque seule elle apporte un rsultat gratifiant et rmun
rateur. Encore cette pression explicite n'a-t-elle pas tou
jours t ncessaire : le bilinguisme ingalitaire, chez la
plupart des peuples domins, dvalorise de lui-mme, et
fnit par condamner, la langue autochtone, puisqu'elle est
confonte un modle conomique et social que tout fait
apparatre comme plus prestigieux.
rcole anglophone en Amrique du Nord, machinere de mort
pour les langues indiennes
On vient de voir que les tats sont capables de
prendre des mesures scolaires visant l'radication pure et
simple d'une ou de plusieurs langues. Les mesures expli
cites d'abolition ou de promotion ne sont qu'un des aspects
du rle de l'cole dans la mor des langues. Lcole est, de
surcrot, le lieu et l'instlllment d'une agression de longue
haleine.
La politique des gouverements fdraux, au Canada
comme aux tats-Unis, fut, ds la fn du XIXe sicle, d'int
grer par l'cole anglophone les communauts indiennes. Il
tait explicitement dit (cf. Zepeda et Hill 1 991 ) que le seul
moyen de civiliser les enfants indiens tait de les sous
traire l'influence { barbare de leurs milieux de nais
sance, en les transfrant dans des pensionnats loigns de
leurs villages. Cette opration d'arrachement fut parfois
ralise par la force. Les familles taient trop dmunies
pour tre en mesure de faire revenir leurs enfants, mme
durant les vacances d't. Dans toutes les coles, qu'elles
fussent fdrales, paroissiales, ou qu'il s'agt d'tablisse
ments secondaires l'chelon local d'une agglomration,
l'utilisation des langues amrindiennes tait absolument
146 HA L TE L A M aRT D E S L A N G UE S
interdite, et toute infraction tait punie d'une manire
aussi svre qu'humiliante, mme quand les enfants
taient encore trs jeunes. Dans certaines zones, ce sys
tme existait encore au dbut des annes 1 970.
Ailleurs, i n'avait pas t ncessaire de le maintenir,
tant avaient t errcaces les brimades cororelles et morales
infliges aux enfants indiens qui osaient se servir encore de
leur langue materelle. Des vieillards des ethnies tlingit et
haida, dont les langues, jadis parles au sud-est de l'Alaska,
sont aujourd'hui moribondes, assurent qu'ils fissonnent
ce souvenir, lorsqu'il leur anive de parler encore entre eux la
langue de leur communaut ; une savante mise en scne,
avec fgurations grimaantes et personnages effayants,
tait utilise l'cole amricaine, afn d'extirer tout atta
chement aux cultures indiennes, de faire apparatre les
langues comme des crations diaboliques, et de chaser par
la tereur toute vellit de les utiliser. tait-il possible d'en
conserver encore quelque dsir, alors qu'on entendait les
matres afrmer que Dieu, auquel on apprenait obir en
tout, n'aimait pas les langues indiennes ?
On peut, pour ne retenir qu'un exemple, mentionner
les coles diriges, en Alaska, par des missionnaires
jsuites, moraves (ordre d'inspiration hussite, n en
Moravie) et orthodoxes. Jusqu'aux premires annes du
xe sicle (cf. Krauss 1 992), ces coles utilisaient, pour la
formation des enfants indiens dans leurs propres idiomes
veraculaires, des matraux en aloute, yupik central,
langues de la famille eskimo-aloute, ainsi qu'en plusieur
langues de la famille athapaske. Mais vers 1 91 2, la der
nire cole religieuse aloute avait ferm. Une politique
rigoureuse ft institue, aux termes de laquelle tout
recours aux langues indiennes dans l'ducation tait
expressment banni. Cette mesure d'ostracisme absolu
demeura en vigueur durant soixante ans.
Conduisant les familles indiennes considrer que
leurs langues veraculaires n'avaient aucun avenir, et donc
que l'enseignement de ces langues ne pouvait que nuire
LE B A TA I L L ON D E S CA U S E S 1 47
leurs enfants, cette politique eut de: effet
dvastat
1 979 i l ne restait plus, au sud-est de 1 Alaska, q
l
'
en
1 l
'
thapaske le kutchin (ou loucheux, par e
seu e angue a
,
n du
lors le long du bas Mackenzie et d
cours
oye
"
ukon) et une seule communaut aleoute,
.
qUi eussen
neore
'
des locuteurs enfants ; les langue
,
s e
.
sklmo, qu
nt a
:Ues c'est--dire le yupik et l'inupiaq, etaIent en vOle de
dsitgration ; les enqutes les plus rcente
conrment
que leur dtrioration les conduit au bord de 1 agome.
Mmes comportements et mmes succs en Austraie
Ce ui prcde concere les lan
,
gues
.
amndiennes
victimes
q
de l'cole anglophone, mais s apphqu
l
e egalee:
,
rs dans les mmes termes, aux angues l
et a peu p
rtie du monde celles des Aborignes d'Aus
tout autre pa
" 1' . ar la pression de
tralie elles aussi conduites a agome P . r
'
l'cole
'
l
'
anglis dans tous les domaines, t en Prtl
d
cu
f
ler a
, 1 u
,
" oir te enleves e oree a e
y furent envoyes, apre
av
" ,
.
d 1 8 1
4 30 % des
familles pendant prs d un Slecle a partIr e
d
'
lr s
enfants autochtones, soit plusieurs dizaines e ml 1er )
l' plaait dans des familles blanches, dans des
heats, ou tou
.
t si
u
:plement an des i
71;:: 1:t:
carcral, o il taIt, bIen enten
,
u, o
.
rme
,
' la fn
d'utiliser les langues autres que 1 anglaIS. Ce n est qu
,
d annes 1 960, quand il tait trop tard, que
.
le
ouvel l1e
r:nt australien a rvis sa politique d'radicatlon com-
plte des langues aborignes.
La pression politique exerce p
r d'autres langues
que l'anglais sur d petites langues
La olitique scolaire de la France, et, s un
.
p
d portuOal dans leurs empl I es co10
momdre mesure, u
" ,
.
t ) fut
.
(1 de l'Espagne en Amrique latme est au re ,
nau
l
C
t
S
Si cela n'a pas eu d'effet ngatif sur l
:
s
d aSSlmi a IOn.
l ' l t arfOis
1 va dl' ffremment chez es e 1 es, p
masses, 1 en
1 48 HA L TE A L A MO R T D E S L A N G UE S
gagnes par la tentation de l'unilinguisme au proft d'une
langue europenne.
Mais en
p
utre, d'autres langues que l'anglais, leves
par certains Etats au statut de langues offcielles, exercent
sur les langues ethniques une pression redoutable.
LAfrique ofre des illustrations claires de cette situation.
Contrairement ce que l'on croit parfois, le pril, pour les
langues rgionales et tribales d'Afrique, ne vient plus,
aujourd'hui, des langues europennes, alors que tel est
bien le cas en Asie septentrionale ( rsse), en Amrique
centrale et du Sud (espagnol), en Amrique du Nord
(anglais), en Australie (anglais). En Afique, si les langues
europennes ont pu exercer une pression l'poque colo
niale, leur emploi est prsentement limit la socit favo
rise, ce qui les rend compatibles avec le maintien des
identits ethniques et des petites langues
.
Le vlitable prl
provient plutt des langues africaines de grande diffusion
et vocation fdratri ce, dont la promotion concide avec
celle des structures de l '
tat. Tel est le cas du swahili en
Tanzanie. Limportance du swahili en tant que langue of
cielle promue comme ciment de l'unit nationale en fait
une source d'emprunts, au point que mme des langues
appartenant au mme groupe gnalogique que lui au sein
de la famille bantoue puisent en swahili de nombreux
nologismes, alors qu'elles pourraient aisment s'en cons
truire, puisqu'elles possdent des proprits drivation
nelIes identiques aux siennes.
Un paradoxe peut tre dcel ici. Dans les annes qui
ont suivi l'accession l'indpendance des anciennes colo
nies britanniques et fanaises d'Afrique, la politique
d'exoglossie des premiers gouverements, c'est--dire
l'adoption de l'anglais ou du franais en tant que langues
ofcielles, tait prsente comme le moyen de prserver
l'unt nationale en vitant de promouvoir l'htrognit
linguistique qui caractrise l'Afique, et de favoriser par l
les tentations sparatistes. Or en ralit, dans l'environne
ment africain, le choix d'une langue exogne favorise les
T
LE B A L4 I L L 0 I DE S C A U S E S 1 49
langues rgionales. En effet, les ltes et la classe poss
dante sont seules connatre bIen les langues euro
pennes. Les masses dem
urent attach
s lers idiomes
veraculaires. Au contraIre, la promotion d une langue
africaine, tant envisage par le pouvoir c
mme u
act
d'afirmation nationale, met en prU les idIOmes mmon
taires, qui ne sont pas en tat de rivaliser
.
avec elle,
puisqu'elle reoit le renfort des mesures scolaires et des
mdias. Si leurs locuteurs passent massivement la langue
promue, les idiomes ninritaies s trouvent menacs.
Telle est aujourd hm la sItuatIOn pour beaucoup de
lanaues en Tanzanie, et dans une certaine mesure au
Kya, le swahili en tant le bnfciaire dans les deux cas.
On peut prvoir une volution comparable en faveur de
deux autres langues parles par une masse de locuteurs : le
peul, rpandu dans presque tous les pays 'Afrique ce
traIe, du Sngal au Tchad et la Rpubhq
e cet
afri
caine, et le haoussa, qui a, comme le peul, servI de vehIcule
de l'islam dans de vastes zones ; la pression du peul sur les
autres langues est particulirement sensible dans le ord
du Cameroun (sous sa variante locale ou foulfoulde du
Diamar) ; celle du haoussa l'est tout autant dans le nord
du Nigra. L'avenir de ces deux langu
s d
ns lurs pa
s
respectifs sera-t-il aussi brillant que celm qm p
raIt promIS
au swahili ? En Tanzanie, le succs de ce derIer annonce
un sort incertain pour l'anglais lui-mme. On notera, par
ailleurs, que le lingala est en train de s'emparer,
.
seon n
processus comparable, des positions du fTnaI a Km
shasa et dans une partie du nord de l a repubhque du
Congo, ce qui n'est pas ncessairement favorable aux
petites langues de ce pays.
Les substitutions multipls
La consquence l a plus commune des agressions de
toutes sortes que subit une langue dpourvue de moyens
effcaces pour se dfendre est qu'elle est supplante par
1 50 HA L TE A LA M 0 R T DES L A N G UE S
une autre langue, qui fnit par se substituer compltement
elle. Mais il peut mme arriver qu'elle soit assige non
par une seule langue, mais par plusieurs. Dans ce cas, c'est
difrents niveaux la fois que la langue assaillie doit
faire face, et qu'elle est souvent contrainte de s'effacer. Un
exemple de cette situation peut tre pris en Afrique de
l'Ouest. Le basar, dont la plupart des locuteurs occupent
la rgion fontalire entre le Sngal et la Guine, est
expos, au Sngal, trois pressions conjugues, aux
niveaux local, rgional, et national. Localement, il est le
voisin du peul, dont les locuteurs sont en constantes rela
tions commerciales avec lui, sans compter que les femmes
basari pousent souvent des Foulb (Peuls), les enfants
de ces unions devenant des Foulb de statut et de langue.
l'chelle rgionale, le basari est dsavantag par rapport
au malink, qui a statut ofciel au sud-est du Sngal et
qui, de ce fait, est activement promu comme langue crite
d'ducation, s'utilise dans les mdias et s'enseigne dans les
coles. l'chelle nationale, un Sngalais qui souhaite
dvelopper d'autres activits que traditionnelles a i ntrt
connatre le ouolof et le fanais, le premier parce qu'il est
pratiqu dans toutes les zones urbaines du pays et connu
de la majorit des Sngalais, ce qui en fait la vritable
langue nationale du pays, le second parce qu'il est omni
prsent dans l'enseignement suprieur et dans les alles du
pouvoir.
Nanmoins, hors du Sngal, en Guine, o dominent
galement le peul et le malink, le basari bnfcia d'une
certaine promotion sous le rgime de Skou Tour, qui
favorisa les langues indignes. Mais aprs la mort de
Skou Tour en 1 984, le rgime militaire qui lui succda,
considrant cette politique indigniste comme responsable
des maux du pays dans les domaines de l'ducation et de
J'conomie, l'abrogea compltement. Ainsi, le basari se
trouve expos la concurrence redoutable de langues
beaucoup plus armes que lui pour s'imposer, et cela en
T
LE BA TA I L L ON DES CA USES 151
dehors du Sngal comme au sei de ce pays. C'est assez
pour prvoir l'extinction du basan,
Les envaisseurs envahis
Le schma courant de disparition des langues sous
l
,
a
,
l't' e d'une force suprieure, souvent ce e
PreSSIOn po I IqU
, ,
' 1 s
.
"
nt chez ceux qu Ils ont valllCUS e
d'envahIsseurs qUI cree
d
,
E' tat soufe quelques apparentes excep-
structures un
,
"
0
' t e les
f qu'il est intressant d exammer, n saI qu
.s n'imposrent pas leur langue
,
au llo-
qu'ils avaint
,
vaincus, et q
l
ue_e M_olS
formation
aux Carolmglens, la Gau e t e
.
'
1
'
d'une nouvelle lange, le ftur fanaIs, qUI, bIen
,
qu e e aIt
dans sa phontique et dans son l:xique des ralts
.
germa-
,
dus ce contact est essentIellement neo-latme.
mques
m
' e
'
rs du chef danois Rohlf (Rollon),
Quant aux gue
e l
V'k'n s qui entre la fn du !e et le dbut du x SIeC e,
.`iet
l
lngteps efay les populations de <aule pa:
leurs ravages, ils reurent, certes, de Charles le Imple, rOI
des Francs, l a province qui porte ecre eur
,
nom
d N d (Normands) '
malS Ils adopterent,
Q hommes u or }}
' a
en s'y sdentarisant, les coutumes du ays et re_e
f
r
langue (la variante normande du franaiS en VOIe
,
m
mation), sans parvenir ni implanter leur langue, m me
d
l a sauvegarder, en dpit d' efo:s
,
comme ceux du fls
Rollon, Guillaume 1er Longue Epee, envoyat son fls
, "tal' t maintenue une cole scandmave, pour Y
Bayeux, ou s e
.
l ' t es
ndre le dialecte de vieux-nOD'OlS que par aI en
,
S
appre
( f H 1 996 b) Ainsi les Vikings se fondlf
.
ent
anctres c , agege
. "
, 1
dans ce qui est aujour'hui la NormandIe, tout comne I
l
s
<
d' tre pays conqUls, a
adoptrent la l angue romane un au
,
. nt as
S' '1 Ailleurs leurs parents les Varegues ne fI C : ?
ICI e.
,
d l a fn du IXe sicle, ayant orgamse le
a
`..t'.lv, embryon de la Russie kivienne
;
Hs se
lavisrent culturellement et linguistiquement. Il
,
y d autfe
.
bl s . l ont celui des Tutsis, peuple mlotlque qUI,
cas compara e , U
1
'
1
152 HA L TE LA MOR T DES LAN G UES
appuy
.
sur la force que lui confrait son conomie pasto
ral
, pnt le pouvoir aux dpens de ses htes les Hutus, et
qUI, pourta
?
t, aopta, en se sdentarisant, leurs langues
bantoues, lrundl et kinyanvanda (cL Mufwene 1 998).
,
L pUIssance politique et militaire de ces envahisseurs
n
,
au
aIt-
lle pas d, pourtant, constituer un facteur
d extl
ctIOn pour les langues des peuples qu'ils
soumlre
? eux
.
raisons, toutes deux ncessaires, expli
quent qu Il n en aIt pas t ainsi. La premire est que les
Francs, le
,
N
rmands et les Vargues n'taient pas nom
breux, et 1 etaIent, en tout tat de cause, beaucoup moins
que les populations investies par eux. Mais cela ne sufft
pa
, c
r
,
c
ent expliquer que l'intrusion du castillan se
soit reveee
.
SI meurre pour une grande quantit de
l
es mdl
nnes d Amrque, alors que les Espagnols
n
,
eta
ent, meme farouches et surarms, qu'une troupe
redUIte
.
de guerriers, occasionnellement augmente des
po
p
ulatIOns locales avec lesquelles ils contractaient
alIa
ce ? 'est qu'en fait, les Espagnols, escorts de leurs
m
SSIOnnaIreS, n'taient pas simplement des visiteurs
aVIdes e famliq
:
es a
anires brutales. Ils taient por
teurs
.
d une altiere Ideologie civile et religieuse, et
convamcus de sa supriorit sur toute autre.
On
eut en dduire que pour qu'un idiome d'envahis
eurs
,
msse
.
en v
nir dominer la langue du peuple vaincu
J
squ la faIre
.
dlspa
atre, il faut qu'il reflte une civilisa
tlO
tr
s conSCIente d elle-mme
. Faute de cela, la destine
ordmaIre des minorits nomades, qui surgissent parmi
une com
unau sdentaire et la dfont par les armes, est
d
se seden
tanser comme elle, de s'absorber en elle,
d adopter m
me sa langue, comme il advint aussi beau
co
p plus lom, en Orient extrme, des envahisseurs de la
hm
, le
Yuan (Mongols). Et plus tard, tout comme elle
1
aIt faIt des o
gols, la puissance d'absorption de la
VIeIlle
ulture c
.
hmOlse engloutit en une totale sinisation la
dyn
stle
,
des mg (Mandchous), qui dura jusqu' la mort
de I lmperatnce Tseu-Hi en 1 9 1 1 ; rien ne les distinguait
r
LE B A TA I L L ON D E S CA US ES
153
plus, ni Mongols, n Mandchous, des dynasties
?
urement
chinoises des Han, des Tang, des Song et des Mmg. Alors
que le mandchou tait encore langue de la diplomatie et des
notes ofcieles en 1 644, date o est chass de Pkin le der
nier empereur Ming, la fascination qu'exerce sur les nou
veaux venus la civilisation chinoise et le respect qu'ils res
sentent pour le chinois mandarin fnira par les conduire
remplacer par ce derer leur langue ancestrale ; aujour
d'hui, le mandchou est virtuellement mort parmi les quatre
millions de Chinois d'origine mandchoue qui vivent en
Chine, et qui portent depuis longtemps des noms chinois.
Si la langue des Arabes n'a pas subi le mme sort, c'est
que, comme les Espagnols, ils taient les soldats d'une
idologie religieuse sre d'ele-mme et conqurante, qui
les a conduits, quasiment en un clair, porter l'islam
jusqu' la cte atantique du Maroc l'ouest, et l'est
jusqu'au Caucase et au Sind, tant parvenus dominer
notamment, sous les trois premiers califes puis sous les
Omeyyades, l'Espagne, l'Afrique du Nord, la Syrie, l a
Msopotamie, la Perse, l'gypte, la Transoxiane, en atten
dant qu' la fn du xe sicle les Turcs eussent soin de
rpandre l'islam plus loin encore, et qu'au dbut du X" i
pntrt jusqu'en Malaisie.
Pourquoi, ds lors, l'arabe, porteur d'une civilisa!ion
qui fut une des plus brillantes du monde au Moyen Age,
n'a-t-il pas domin jusqu' leur extinction les langues des
pays conquis ? La raison en est simple : la plupart poss
daient une vieille culture, et l'islamisation a t une fcon
dation rciproque, sans que les langues qui exprimaient
ces cultures y aient perdu leur clat. Pour ne prendre qu'un
exemple parmi beaucouP d'autres de cette symbiose cultu
relle, les grands grammairiens dont les analyses pn
trantes de l'arabe constituent, entre le VII" et le Xe sicle,
un des chapitres les plus remarquables de l'histoire de la
rfexion l inguistique, taient en fait arabo-persans. Et
dans les pays chrtiens, comme l'Espagne, l'attachement
la religion et la conviction entretenue quant sa suprio-
1 54 HAL TE A LA M 0 R T DES LAN G UE S
rit avaient pour effet, le plus souvent, le refus de l'islami
stlOn, et donc de l'arabe qui en tait le vecteur. Une situa
on semblable, plus tard, est celle que rencontra le turc
ans les al
.
kans conquis, face au grec, au bulgare et au
serbe,
.
qUl IUl frent des emprunts de vocabulaire, mais aux
quels 11 ne se substitua pas
.
L perte de prestige et la mort des langues
La erte de prestige ne semble pas avoir de rle
causal dIrect. Des langues sans renom partI' l '
. . .
cu 1er se
mamtlenent aIment, ds lors que n'agissent pas les
fateurs e?o
.
n?mlques, sociaux et politiques, dont le pou
VOIr st declslf. La perte de prestige est, en fait, une des
consquences ls pls communes de ces facteurs. Le
prstIge, quand Il est mgalement rparti entre les popu
latons
,
,
confrontes, apparat comme une sorte de mon
nal d change sr l burse des valeurs linguistiques.
Lo squ a
.
u c
.
otaIre Il n est pas ingalement rparti et
qu une
.
nvahte s tablit entre les groupes, dont chacun le
re
,
vendlque, le ?restige est capable de rduire les effets
l
devastateurs qu une pression massive exerce sur la vie des
angues.
LE PRESTIGE, MONNAIE D'CHANGE
SUR LE MARCH DES LANGUES
Le prestige et les langues
Le transfert d'attributs
C'est
.
une illsion
.
de croire que le prestige d'une
langue SOIt un attnbut mhrent. Les langues sont des com-
LE BAT AI L L O N DES CAU S ES 1 55
plexes de structures volutives qui jouent un rle essentiel
dans le dveloppement cognitif des individus, et qui sont,
d'autre part, utiliss par eux dans la communication. Il n'y
a rien en soi, dans la phonologie, la morphologie, la syn
taxe ou le lexique d'une langue, qui soit porteur de pres
tige. Le prestige, c'est--dire la rputation de valeur et
d'minence, ne peut, tant donn les implications de ces
notions, ne s'attacher qu' des humains. Quand donc on
dit qu'une langue est prestigieuse, il s'agit, en ralit, de
ceux qui la parlent ou des livres qui l'utilisent. Par un pro
cessus de transfert, qui est courant dans la relation au
monde et aux valeurs dont on le charge, le respect ou
l'admiration qu'inspire une collectivit ou ses ralisations
se trouve report sur ses attributs. Or la langue est un des
attributs principaux de toute communaut humaine.
Extinction du gaulois
Le prestige dpend vdemment des circonstances et
des lieux. Le gaulois disparut au dbut de l're chrtienne
parce que les classes suprieures de la socit se romanis
rent, s'carant de leur langue comme de leur culture, ainsi
que l'atteste l'histoire du druidisme, religion forissante au
temps de Csar, qui bascule plus tard dans l'image avilie
d'une pratique de sorciers relgus au fond des campagnes
isoles (cf. Vendryes 1934). Le latin submergera vers le
me sicle les deriers lots linguistiques gaulois, qui survi
vaient encore dans les massifs forestiers du centre du pays.
Dclin de l'irlandais et de l'cossais
Au dbut du XVIIe sicle, les langues celtiques des
cossais et des Irlandais subissaient depuis longtemps
dans les les Britanniques un dclin certain, et donc une
chute de prestige : elles taient associes la culture popu
laire et aux manifestations folkloriques ; elles n'taient
pas les moyens d'expression d'hommes, d'institutions,
d'uvres littraires, d'une ducation scolaire, ayant une
1 56 HAL TE A L A J'i 0 R T DES L A N G UE S
imporance nationale. Ce dclin s'accrut encore au
XIIIe sicle du fait de la rvolution industrielle, dont la
langue tait l'anglais, et, plus tard, de la grande famine, qui
provoqua en Irlande, au milieu du XIe sicle, une drama
tique saigne. Mais cossais et Irlandais immigrs en
Amrique, qui furent avec les Anglais les premiers cultiva
teurs des terres dont ils s'taient empars, le plus souvent
au dtriment des Indiens, occuprent en anglais le Nou
veau Monde, et ds la fn du XIX sicle, pour les survants
des massacres de communauts indiennes, le prestige des
colons tait devenu le prestige de l'anglais. De mme dans
tout le reste de l'Amrique, le castillan (dsignation
ancienne, et toujours trs vivante, de l'espagnol en ces
lieux), langue des conqurants, des missionnaires, des plus
riches et des plus puissants, devint ds le Xe sicle, en
dpit (ou du fait) des violences, des massacres, des confs
cations de teres, la langue de prestige, et le portugais le
devint au Brsil.
Le prestige et la Bourse des langues
Ainsi, le prestige des langues n'est autre, l'origine,
que celui de leurs locuteurs, lequel se fonde, lui-mme, sur
des facteurs conomiques, sociaux et politiques. Mais il
devient, par son transfert sur les langues, une sorte de
moyen de paiement, l'aune duquel chacune s'apprcie.
Les langues les plus prestigieuses sont les plus demandes,
comme le sont en Bourse les valeurs les plus rmunra
trices. Les langues les moins prestigieuses apparaissent
comme moins proftables, et suscitent une demande
moindre. C'est ainsi que leurs propres locuteurs en vien
nent se dtacher d'elles, et juger peu rentable leur
transmission aux gnrations suivantes. Ainsi, le prestige,
monnaie d'change sur le march des valeurs linguis
tiques, en vient dcider, en apparence, du sort des
langues.
r
LE BA TA I L L O N DES CA USES 1 57
Les aunes d l perte de prestige
Le prestige d'une l angue n' est p
s une donne o?jec
tive ni aisment mesurable. Il est de 1 ordre de la represen
tation. On ne peut donc l'valuer qu' l'aune des
,
valeurs
que la pense symbolique se construit pour rep
res. Et
cette construction est le fait des locuteurs chez qm la
ela
tion entre les langues, telle qu'ils l'intriorisent, est ve
ue
soit positivement, soit comme gnratrice
.
d'
ne c
lse.
Dans ce derier cas, la langue devient la VctIme d une
perte de prestige.
Lassociation avec la vie paysanne et avec le pass
De nombreuses langues sont associes par les locu
teurs avec la vie paysanne ou avec le pass. Ils les opp
sent
des langues qu'ils considrent avec respect parce qu elle
sont au contraire, associes, pour eux, avec le travaIl
indstriel dans les villes et avec l'avenir. Tel est, par
exemple, le type de confontation qui met en prsence,
dans le village autrichien d'Oberwart, l'all
mand et
.
le ?on
grois (cf. p. 1 20-1 2 1). La i
?
-orit ongro
se asSOCIe l alle
mand avec l e pouvoir polItIque, 1 educ
tlOn
n
oder
r
e, l a
mobilit qui facilite l'accs des professl
ns
meux remu
nres et moins pnibles que celles de 1 agnculture. ur
tous ces points, le hongrois est jug
tro
rade, ce qu
;
le
dpouille de tout prestige, et le fmt meme apparaltre
comme inutile.
La pulsion mimtique l'gard des migrs qui font retour
Dans les communauts menant une vie traditionnen
mais dont cerains membres sont partis la ville ou a
l'trnger puis font retour, la pulsion d'imitation des
ou
veau ts qu'ils rapportent avec etx est t
,
rs
.
f
e parmI
.
les
plus jeunes gnrations. Le prestige se defmt ICI en fonctlOn
des modles i nnovants et du dtachement par rapport aux
1 58 HA L TE A L A MO R T D E S L A N G UES
modls anciens. Les modes de parole occupent une place
de ChOlX dans ce schma de pense et d'action. Chacun veut
s'exprimer de la mme faon que ceux que l'on voit revenir
avec de l'argent et des expriences ou rcits nouveaux. Sur
les hauts plateaux de Nouvelle-Guine, par exemple, le
pidgin anglais qui se parle dans les villes de la cte, et parti
culirement dans la capitale, Port-Moresby, est adopt par
un nombre croissant de Papous qui ont quitt leurs villages
des hauteurs. Lorsqu'ils y retourent, le pidgin devient le
vhicule travers lequel s'introduisent de nouveaux sch
mas de pense, qui disloquent les schmas anciens, et donc
ls lanes locales qui les portent. C'est un processus paral
lele qUl afecta le breton lorsque les soldats partis du Tr
gorrois, du Finistre, du Vannetais, etc., revinrent de la
Premire Guerre mondiale, o ils avaient appris dsigner
en fanais des innovations qui sollicitaient leur intrt.
Le dfaut de conscience nationale
Lorsqu'une communaut ne se reconnat pas d'iden
tit nationale, elle peut en venir se reprsenter sa langue
comme dnue de toute valeur symbolique. Cette commu
naut, pour peu qu'elle vive au voisinage d'une autre
qu'elle considre comme suprieure, en vient, dans les
cas extrmes, s'identifer elle, au point de se nier elle
mme en tant que groupe. C'est l ce qu'on observe, dans
le Caucase, chez les Svanes, qui, attirs par leurs voisins
gorgiens, plus nombreux et plus puissants, fnissent par
rcusr leur propre identit, et par se faire passer pour
georglens, appelant gorgien leur langue, qui, pourtant,
bien qu'elle soit gntiquement apparente, est assez
difrente du svane. Les plus j eunes Svanes refusent
d'apprendre la langue de leurs pres.
L'absence de tradition littraire
Les locuteurs d'une langue domine, mme quand ils
ne sont gure lettrs, soulignent souvent, comme pour se
L E B A TA I L L O N DE S CA US ES 1 59
donner de meilleures raisons encore de s'en dtacher, que
leur langue n'a pas t choisie par de grands crivains pour
faire une uvre littraire, et que par consquent, elle est
dpourvue de tout prestige, n'ayant ?as don lie de
bons livres que tout un chacun connaIsse et pUlsse CIter.
Les stigmtes d l honte
Lillusion d'inadquation
Une langue en bonne sant est volontiers valorise par
ses locuteurs, qui la trouveront belle, riche, prcise,
raison mme du fait que, la connaissant mieux que toute
autre quand ils ne sont pas de parfaits bilingues, ils ne
s'expriment vraiment leur convenance que dans cett
langue. Au contraire, les usagers qu'une autre langue sollI
cite cessent de valoriser la leur, et mme commencent en
avoir honte, ce qui, en retour, les conduit s'en dprendre
davantage encore. Une sorte d'anxit les tourmnte
l'ide de se servir encore d'une langue que plus nen ne
recommande, et celle-ci devient le lieu de toutes sortes
d'associations ngatives, dont ils ont la plus grande peine
se librer. Is se persuadent, notamment, qu'elle est inapte
l'expression de la moderit, et incapable d'exprimer les
ides abstraites, sans savoir, videmment, que n'importe
quelle langue a ce pouvoir, ds lors qu'on prend la peine
d'entreprendre une action nologique.
Labandon d'une langue avilie
Tel est le sentiment que les chercheurs de terrain ont
observ, par exemple, dans la communaut tlingit, au sud
est de l'Alaska. Les parents, qui ont appris, dans leur
enfance se dprendre de leur langue (cf. p. 1 46), vont
jusqu'
'
penser que parler encore en tlingit, c'est risquer
d'apparatre comme un demeur ou un rustre, et ils redou
tent que l'enseignement de cette langue aux enfants ne
160 HA L TE A LA M 0 R T DES L A N G UE S
etard chez
.
eux !n seulement l'ge d'apprentissage de
1 anglaIS, malS meme l e dveloppement mental. Ils crai
gnent aussi que cet enseignement ne maintienne les
croyances traditionnelles, dont ils veulent s'loigner
c?me de qelque marque humiliante. Selon une inspira
tIon a peu pres semblable, les Rama (Nicaragua) dclarent
qu le rama est laid , que ce n'est pas une langue , et
qu on a honte de le parler (cf. Craig 1 992) . Un autre
exemle
,
est elui des Nubiens les plus jeunes et les plus
urba
.
mse
,
'
qm srent que le nubien n'est pas une langue,
{ pmsqu Il ? s ecnt pas , contrairement l'arabe, et que
s:ul es VIeIllards arrrs utilisent le nubien, alors qu'en
reallte, cette langue est encore parle par des populations
rurales d'ges varis.
Unconsquence brtale d la perte d prestige :
l'abandon volontaire
La dcision publique des Yaak
?n conat quelques cas spectaculaires o la perte de
prestlge, au heu de conduire par tapes une extinction de
l a langue dvalue, provoque un certain moment une
dcision collective d'abandonner cette langue. Le plus
connu de ces cas est celui des Yaaku. Cette population du
centre-nor du Knya parlait une lange appartenant la
ranhe onental de la famille couchitique. Les Yaaku pra
tIquaIent la cueIllette, la chasse et la pche, et vivaient
assez pauvrement, comme il est courant chez les nomades
qui exercent essentiellement cette activit de subsistance.
rour amliorer leur condition, beaucoup d'hommes
s emplOyaIent chez les Masai voisins, dont ils gardaient les
troupeaux. La culture et la langue mas ai exercrent sur les
Yaaku une influence croissante. Ils abandonnrent la
stricte endogamie d'autrefois. Les mariages devinrent de
plus en plus frquents entre les deux ethnies, et les Yaaku
commencrent changer de mode de vie, passant, du fait
LE BA TA I L L O N DES CA US ES 1 61
de l'acquisition de btail, une conomie pastorale. Le
processus fut le mme que chez d'autres chasseurs
cueilleurs (cf. p. 1 35- 1 37) : si les femmes yaaku adoptaient
la langue de leurs maris masai, les femmes masai n'adop
taient pas celle de leurs maris yaaku. Il en rsulta une
rduction du nombre d'enfants parlant le yaaku.
La consquence de ces changements rapides et pro
fonds fut une runion publique des Yaaku avec tous leurs
notables, qui eut lieu durant les annes 1 930. Au cours de
cette runion, on souligna que la langue et les murs des
Masai avaient plus de prestige que celles des Yaaku, et qu'en
particulier, le yaaku, dont le vocabulaire fait une place
importante la chasse, tait inadapt une socit d'le
veurs de btail. Il fut donc dcid qu'on ne pouvait trans
mettre aux enfants yaaku une langue aussi peu propice
leur avenir, et que, par consquent, l'on abandonnerait
dsormais le yaaku en faveur du masai comme moyen
d'expression de l'ethnie dans tous les domaines.
Autres cas de reniement
une chelle plus rduite, des cas comparables sont
attests. Plusieurs communauts sames (lapones) vivant le
long de fjords refusent de transmettre le same leurs
enfants, et les lvent en norvgien.
Un autre exemple
encore est celui de certaines des langues de la famille
khoisan d'Afrique du Sud, comme le kheokoe, dont les
locuteurs dcidrent, ds le dbut du XVIIIe sicle, de passer
dsormais au nerlandais, langue des colons dont ils
taient les esclaves, et qui avait ncessairement, du fait de
cette situation, le plus de prestige. Je ne connais pas
d'autre cas de passage volontaire de toute une ethnie afri
caine une langue europenne.
1 62 HA L TE A L A M 0 R T DE S L A N G UE S
Les retourements de forune : langues ds Aztques
et ds Incas, ou du prestige l'abaissement
La mcanique du prestige et de son clipse est impla
cable. La roche Tarienne est proche du Capitole, et quand
les causes objectives du dclin commencent agir, et la
perte de prestige s'ensuivTe sans dlais, le souvenir d'une
ancienne gloire est impuissant restaurer l'clat pass. Les
Aztques avaient tendu fort loin leu empire depuis la for
mation, en 1 429, de la triple alliance entre Tenochtitlan
(aujourd'hui Mexico), leur capitale, fonde un sicle plus
tt, et les
tats de Texcoco et Tlacopan. Dans cette alliance,
ils avaient vite acquis une position dominante. Ils poss
daient au dbut du X1e sicle, grce leurs conqutes, la
matrise d'importants territoires, tendus depuis le nord de
la fture Veracruz sur l'Atlantique jusqu' ce qui est
aujourd'hui l '
tat de Guerero, sur le Pacifque, et au Sud,
jusqu' l'isthme de Tehuantepec. Sur tous ces tertoires, ils
avaient assur leur langue, le nahuatl, un statut de pres
tige, li cette domination politique et militaire. Les noms
mmes qu'ils donnaient aux peuples soumis disent assez
avec quelle condescendance ils les regardaient, et combien
la position dominante du nahuatl lui confrait de pouvoir :
Popoloca inintelligible >, Chontal tranger >, Totonac
( rustr }) (cf. Heath 1 972, 3).
Or c'est prcisment cette heure de son histoire, au
moment mme o il se trouve au sommet de sa puissance
et de son rayonnement, que sur l'horizon de l'Empire
aztque, le destin fai t surgir les Espagnols, et avec eux,
presque ds le dbut de ce choc brutal, les ravages de
l'extrme violence. Corts et ses troupes, aprs des revers
sans relle importance, anantissent cet empire en un
temps tonnamment bref, mme si l'on tient compte de l a
plus grande effi cacit de leur armement (engins feu), de
leur quipement en chevaux, alors inconnus en Amrique,
et de leur adresse semer partout la division. Les cons-
L E BA T A I L L ON D ES C A USES 1 63
quences linguistiques de cette exorbitante imposture, et de
l'agression culturelle perptre par les conquistadores,
sont, comme on sait, catastrophiques : un nombre consi
drable de langues meurent de mort violente en mme
temps que la majorit de leurs locuteurs, ds la premire
moiti du XVF sicle.
Quant au nahuatl , au bout d'une certaine priode, il
passe du statut de langue des vainqueurs celui de langue
des vaincus ; son prestige, jusque-l, tait grand : mme
des Mayas, extrieurs l'aire d'extension aztque, le con
naissaient, si l'on en croit la lgende qui veut que la
Malintzin, compagne et traductrice de Corts, ait t une
princesse aztque qui , durant sa captivit dans le Yucatn,
communiquait sans peine dans sa langue avec les habi
tants, de langue maya yucatec, avant qu'elle n'apprt elle
mme cette derire langue. Lespagnol devient la langue
dominante. Le nahuatl soufe encore aujourd'hui d'tre
alors devenu langue domine. Tant il est vrai que sur le
march des valeurs linguistiques, l e prix que vaut une
langue est troitement li l a place qu'occupent ses locu
teurs sur l'chelle de prestige.
Les Incas avaient eux aussi, depuis le derier tiers du
xe sicle, tendu leur empire, partir de la valle de Cuzco,
sur un trs large espace : au Nord jusqu'au site de Quito, et
au Sud par-del les rgions qui concident aujourd'hui avec
une grande partie de la Bolivie et avec les portions septen
trionales du Chili et de l'Argentine. Paralllement, le quet
chua, devenu langue ofcielle de l'empire, avait commenc
de s'tendre, se posant en rival des langues de l'univers
andin, mais sans tre encore parenu, faute de temps, les
supplanter. La guelTe civile qui, aprs la mort du derier
empereur inca en 1 527, opposa ses deux fls, facilita certai
nement la conqute de Pizarro. Cette conqute fut, comme
au Mexique, violente et trs rapide. Lespagnol se substitua
au quetchua comme langue de prestige. Mais malgr cela, l e
quetchua joua, et continue de jouer, un rle dont les vic
times sont les idiomes de peties ethnies encore plus
1 64 HA L TE L A N 0 R T D E S L A N G UE S
domines : loin de l'empcher de jouer c rle, l'espagnol lui
en donna les moyens, comme on le verra plus bas.
L promotion de lngues vhiculires
La lngua franca
Les langues auxquelles la domination d'une autre
communaut et de son idiome a fait perdre leur prestige ne
sont pas toujours exposes cette seule concurrence.
Leurs positions sont aussi rognes par la diffusion de cer
taines autres, que diverses circonstances ont promues au
statut de langues vhiculaires. Mais ces idiomes ne sont
pas tous galement dangereux. Il peut s'agir, en efet, d'un
simple jargon de fortune, qui n'a d'autre rle que de per
mettre une relation lmentaire entre deux individus dont
chacun parle une langue opaque l'autre. Une forme histo
rique de ces jargons servit de moyen de communication
partir de l'poque des Croisades, entre les musulmans
'
et
l es Europens, l esquels, depuis les affontements entre
descendants mrovingiens de Clovis et armes arabes arr
tes Poitiers en 732, taient appels Francs, d'o le nom
de Zingua {rnca que reut cette langue.
Sur une grande partie des pourtours mditerranens,
dont les ctes de l'Italie, de la France, de l'Espagne et du
Maghreb
la Zingua franca ft en usage, durant tout le
Moyen Age, l'poque classique, et j usqu'au dbut du
xe sicle, dans les relations commerciales, politiques,
dtplomatiques ou guerrires qu'eurent avec les Franais les
souverains d'Alger et de Tunis, ainsi que les marchands et
voyageurs, militaires et marins. La dynamique de ces rap
ports assez instables, et sans doute aussi le caractre
color et pittoresque d'un sabir o se mlangeaient des
mots d'origines htroclites (surtout italiens, mais aussi
provenaux, catalans, castillans, fanais, grecs, turcs et
arabes) frnt de la Zingua franca un sujet de fantaisies litt
raires, comme il en apparat dans les pices de Goldoni,
LE B A T A n L O N D E S CA U S E S 1 65
Calder6n, et, chez Molire, dans la clbre turquerie d'une
des scnes du Bourgeois gentilhomme .
La promotion commerciale spontane
La Zingua franca ne possdait pas de prestige particu
lier, pouvant au contraire tre un objet de drision. Mais
elle avait les proprits d'une langue vhiculaire, telle que
peut en scrter le contact entre communauts linguisti
quement htrognes. Ds lors qu'une langue vhiculaire
est non pas un jargon, mais un des idiomes en prsence
dans une zone plurilingue o elle permet la communica
tion et les relations commerciales, sa promotion de prf
rence celle d'une autre, et l'habitude que prennent de s'en
servir la plupart des habitants de cette zone, peuvent fnir
par lui confrer une manire de primaut. Il est vrai que
les situations sont variables. et que bien des facteurs
entrent en jeu, qui sont de nature modifer ce processus,
et ne permettent pas l'mergence d'une langue de prestige.
Ainsi, sur la cte du nord-ouest des tats-Unis et dans
une partie des terres intrieures du Washington et de
l'Oregon, l es Chinook, habitant, l'origine, dans la valle du
fleuve Columbia, taient jusqu'au dbut du Xe sicle
l'ethnie indigne la plus importante en teres dmogra
phiques, et une des plus dynamiques sur le plan commer
cial. Un des dialectes de leur lange, l e chinook d'aval (lower
Chinook), se rpandit, sous le nom de Chinook jargon, chez
de nombreux peuples indiens, entre lesquels il facilitait la
circulation des marchandises, et cela jusgu'au nord de la
Califorie d'un ct et jusqu'au sud de l'Alaska de l'autre.
On trouve des situations comparables dans beaucoup
d'autres parties du monde, et des chelles trs variables.
Par exemple, dans l'le de Timor, l'extrmit orientale de
l'archipel indonsien, un idiome rcemment n du tetum,
langue de la famille austronsienne, est utilis comme
moven de communication dans les rapports commerciaux
et, plus gnralement, sociaux, entre locuteurs de langues
1 66 HA L TE L A M 0 R T DE S L A N G UE S
difrentes. Il devient mme une sorte de langue nationale
dans ce pays encore meurtri (cf. p. 356-357).
La promotion politique voulue
.
La promotion d'une langue vhiculaire peut n'tre pas
sImplement le rsultat d'une habitude pratique prise par
les populations locales, mais bien celui d'une arrive
massive d'trangers. C'est ainsi que l'araucn devint l a
langue vhiculaire, et mme materelle, des Tehuelches et
autres populations du sud du Chili, lorsque les Mapuches
(cf. p. 201 ) , ses locuteurs, ayant travers la cordillre des
Andes, vinrent s'installer dans les territoires de ces der
nires. La langue des Tehuelches disparut de ce fait
(cf. Clairis 1 99 1 , 4-5) .
Dans d'autres cas, la promotion d'une langue vhicu
l
ire rsulte d'un choix ofciel soutenu par l'autorit poli
tIque. Un efet de prestige peut alors jouer. Il en est ainsi
pour le sango, langue reconnue comme nationale en Rpu
blique centrafricaine (cf. p. 353). Une telle promotion ne
peut manquer de lui confrer un statut privilgi, avec les
consquences que l'on peut envisager sur les langues dont
sa fonction rduit le prestige.
Une situation comparable celle du sango en Centra
fique fut celle du quetchua dans l'Empire inca avant
l'arrive des Espagnols. Les conqutes s'taient accompa
gnes, comme on l'a v, d'un dbut de difsion du quet
chua, probablement sous la forme pratique la fn du
X sicle dans la rgion de Cuzco. Un tmoignage contem
porain de ce phnomne est prcisment la diversit dialec
tale du quetchua d'aujourd'hui, prsent dans sept pays.
Cette diversit est la consquence de plusieurs sicles d'vo
lution indpendante travers un vaste territoire, de la
Colombie l'Argentine. Mais un autre facteur, dont il va tre
question ci-dessous, devait assurer au quetchua comme
d'autres langues de par le monde, un rayonnment plus
grand encore, au dtriment des idiomes dfavoriss.
LE BA TA I L L O N DE S CA US ES 1 67
Les dcisions des conqurants et de l'glise missionnaire
Les missionnaires franciscains qui arrivrent
Mexico en 1 523, deux ans aprs la conqute, par les
troupes de Corts, du site aztque de cette ville, eurent tt
fait de constater que le paysage linguistique tait d'une
grande varit. Celle-ci leur apparut sans doute com
e un
morcellement. C'est pourquoi, voyant dans cette multItude
de langues indignes un obstacle l'vanglisation, mais
galement la domination de l'glise, les missionnaires
entreprirent d'en promouvoir certaines comme vhicu
laires. Ils choisirent pour cela celles que leur nombre de
locuteurs, ou leur degr dj atteint de diffusion, leur
paraissait rendre recommandables. Ils rdigret ds
.
tra
vaux remarquables sur certaines des langues d Amenque
du Sud : en soixante ans de prsence des Franciscains,
parurent plus de quatre-vingts livres, grammaires, vocabu
laires, catchismes, dont les clbres descriptions du
nahuatl par A. de Oimos ( 1 547) et A. de Molina ( 1 555).
Selon les habitudes de l'poque, ces ouvrages impo
sent le modle latin pour cadre d'tude ; le prestige du latin
chez les lites catholiques d'Espagne tait tel (cf. p. 73),
que les Franciscains apprenaient mme certains sujets
dous, parmi leurs ouailles indiennes, l'art de composer
des posies latines (cf. de Pury Toumi 1 994, 492) ! Les
grammaires nahuatl sur modle latin seraient inconce
vables aujourd'hui. Pourtant, ces ouvrages nous donnent
une ide prcise de ce qu'tait le nahuatl la fn du
XVI" sicle, tout comme, pour le quetchua et le tupi, ceux
que d'autres missionnaires, la mme poque, rdigrent
au Prou et au Brsil, ou, au dbut et au milieu du XVIIe,
ceux qui furent composs, respectivement, sur l'aymara en
Bolivie (< Haut- Prou cette poque) et sur le guarani au
Paraguay.
Cep
'
endant, au Mexique, entre missionnaires francis-
cains d'une part et d'autre part conqurants puis gouver-
@
168 HA L TE A LA M 0 R T D ES L A N GUE S
eurs ainsi que la hirarchie du clerg sculier, l es rela tIons ne furent pas toujours simpl es. Les vainqueurs espagnols, au xvr sicJe, avaient constat la diffusion du tarasque ans le royaume de Michoacan et de ]' otomi dans une partIe du plateau central mexicain. I1s avaient remarqu aussi que les langues mayas connaissaient une plus grande extension encore, depuis le Yucatan jusqu'au s
du Guatemala actuel, en dpit de la dispersion en cltes-tats non fdres si non par des al l iances locales ce qUI avait facilit la conqute espagnole ds 1 5 1 1 . Le Espagnols virent que ces trois groupes de langues taient p
u prs les seuls qui eussent encore une di ffsion au del
de leurs locuteurs d'origine, depuis que les Aztques v
Ient commenc un sicle plus tt, par leurs conqutes, a Iuplanter le nahuatl dans de nombreuses rgions. Cor
s t se
:
s
ccesseur comprirent vite que cette hg mome h
gu
stIque
,
pouvait, par l 'unit et les facilits de com
IcatlOn qu elle permettait, servir leurs desseins de dommatIOn.
,
Cependant, .s commencrent, en mme temps, repandre le castIllan, afn qu'il se substitut un jour au na
atI. Mais, bien q'ils fussent soutenus par le pouvoir
ohtlq
e en Espagne, Ils se heurtrent la volont des mis SIOnnaIres fanciscains, qui voyaient dans leur mission une uvre de conversion des Indiens au chrstianisme et non de castilla
i sation. Il fallut qu'en 1 550, un dret de Chares Qumt recommandt l 'emploi gnralis de l'espa n
l, non s
.
eue
ent dans l'vanglisation et l 'ducation de 1 anstocratIe mdIenne, comme cela avait commence' ,
'
1 ' .
a se rea l
er nals pour tous les Indiens. Nanmoins, au MeXIque, 1 aontement se poursuivit encore longtemps
ntre ceu
qUI, pour servir la domination coloniale, voulaient Imposer J espagnol, et ceux qui souhaitaient promouvoir q
elques
de
l
ngues indiennes ; cet antagonisme ne pnt fn qu 1
rnvee des Jsuites, qU, certes, admiraient be
ucoup l azteque, mais qui, contrairement aux Francis cams avant eux, vanglisaient en castillan : il s'agissait
r
LE B A T A I L L O N DES C A USES 1 69
d'une population qui tait non plus simplement conquise,
comme au temps des Franciscains, mais dj colonise.
Contrairement au souhait des Franciscains (cf. de Pur
Toumi 1 994), le nahuatl ne devint donc pas V langue
gnrale y comme le tupi le fut dans une partie du Brsil
(cf. ci-dessous). Pourtant, les Jsuites, en Europe, dfen
daent la cause des langues indignes d'Amrque.
La politique linguistique des missionaires espagnols
eut plus de succs au Prou. Le quetchua ofe u exemple
typique de leur action. Paradoxalement, les nombreuses
langues des Andes non encore vinces par lui au moment
o les envahisseurs venus de Castille s'emparrent de
l'empire furent les victimes du choix que le
,
prtr caho
liques fent du quetchua comme langue d evangehsatlOn,
dont ils prirent le parti d'imposer l'usage tous leurs no
phytes. Cette promotion d'une langue vhiculaire, devenue
prestigieuse par le fai t mme, eut raison du puruh, du
kafar, du kakan, du kul'i, de l'uru-pukina et de beaucoup
d'autres langues. Le mouvement s'est prolong au
xe sicle : les Zaparos des basses terres occidentales de
l'quateur sont alors passs massivement au quetchua. Les
vanglisateurs parvinrent mme implanter le quetchua
dans des zones que n'avait pas atteintes la conqute inca,
comme la province, aujourd'hui argentine, de Santiago del
Estero, ou les rgions du haut Caqueta et du haut Putu
mayo au sud-ouest de la Colombie actuelle.
Une autre langue des Andes ft, elle aussi, promue par
les missionnaires comme instrument de catchse :
l'aymara, que parlent au Prou et en Bolivie plus d'un
,
mil
lion et demi de locuteurs, chife probablement plus eleve
que celui du dbut du XVIe sicle, car de cette poque nos
jours, de nombreuses communauts indiennes perdIrent
leur langue pour adopter l'aymara.
En Amrique du Sud encore, mais cette foi s dans la
rgion qu'occupent aujourd'hui le Brsil mrdional et le
Paraguay, les missionnaires utilisrent grande chelle
deux l angues apparentes, et dj importantes, car elles
1 70 HA LTE L A MOR T D E S L A NG U E S
taient parles par un grand nombre d'Indiens, le tupi et le
guarani. Les Jsuites, qui gouverrent et vanglisrent le
Paraguay jusqu' leur expulsion en 1 768, frent beaucoup
pour la diffusion du guarani (cf. p. 249-252). C'est au
jsuite A. R. de Montoya qu'est due la plus clbre descrip
tion du guarani, encore utilisable aujourd'hui en dpit du
caractre dsuet de ses analyses latinisantes. Et au Brsil,
durant la priode coloniale, le tupi ctier fut, sous le nom
de lfngua geral ( langue gnrale ), l'idiome de communi
cation dans les pays de la basse Amazone et dans le Sud
Est. Comme dans les exemples prcdemment cits, ce
statut choisi de langue vhiculaire fut un des facteurs de
l'extinction de langues tribales varies, qui ne rsistrent
pas la pression d'idiomes que favorisait, dj, leur diffu
sion naturelle et le poids dmographique de leurs usagers.
Tout ce qui prcde ne saurait faire oublier que les
vritables bnfciaires de la politique coloniale en Am
rique latine furent, en dernier ressort, les langues
europennes : espagnol et portugais. Certains s'merveille
ront, notamment, de l'tonnante histoire de l'espagnol, qui
se rpandit sur de si vastes territoires, et dans une telle
quantit de pays, aujourd'hui culturellement unifs par
lui. Soit. Mais la ranon de ce succs, ce fut la mort de trs
nombreuses langues indiennes.
Le russe, langue vhiculaire en Union sovitique
Contrairement au rgime tsariste, qui n'eut pas de
vritable politique linguistique, l'Union sovitique accorda
une place importante aux langues des nombreuses ethnies
parpilles sur son immense territoire, en tant que pices
matresses de la dfnition des entits nationales. Jusqu'au
dbut des annes trente du X" sicle, elles connurent, avec
la multiplication des dictionnaires et des manuels, une
priode videmment faste. Nanmoins, il est rvlateur
que dans la terminologie offcielle d'alors, le russe ait t
appel langue commune , ou V langue internationale ,
LE B A TA I L L ON DE S CA US ES 1 71
OU mme seconde langue maternelle . Dans un empire
o se parlaient plus de cent trente langues, ce statut parais
sait quasiment rpondre une ncessit naturelle. Une
importante rforme scolaire de 1 958, qui laissait aux
parents le choix de la langue d'ducation avait pour inten
tion, et eut pour effet, une forte promotion du russe,
langue de prestige, car elle tait non seulement celle du
socialisme, mais aussi celle des mtiers de l'industrie et du
progrs scientifque et conomique (cf. Hagge 1 994, 220-
238 et 255-264) .
La plupart des rpubliques autres que celle de Russie
dictrent des lois linguistiques ds 1 988, c'est--dire une
poque o l'Union sovitique ne s'tait pas encore dislo
que, mais commenait subir de plus en plus de fractures
graves. Ces lois reconnaissaient le statut vhiculaire du
russe, explicitement dsign comme langue des relations
entre nationalits , mais elles dfendaient aussi les autres
langues, dont beaucoup taient fragilises par l'impor
tance des taux d'emprunt au russe dans toutes les zones du
vocabulaire qui refltent la vie moderne. Si l'on ajoute
cela que dans beaucoup de rpubliques autonomes,
rgions autonomes ou districts nationaux, la population
russophone tait importante et souvent majoritaire, et que
par ailleurs une forte fragmentation dialectale caractri
sait nombre de langues d'lRSS, on peut comprendre que
le statut d'une langue de prestige servant d'instrument de
relation ordinaire entre tant de peuples ait jou un rle
dans l'effacement de parlers ouraliens, turcs, mongols,
toungouses, sibriens qui, sauf dans des cas fort rares,
n'avaient gure de moyens d'opposer de rsistance.
Les implications et les consquences du choix de l'anglais
La perte de prestige de nombreux idiomes confronts
une langue vhiculaire et ce qu'elle reprsente d'effca
cit pour la communication vaste chelle est, dans le
monde contemporain, encore plus redoutable pour l a
i l
, ,
l
1 72 HA LTE LA MOR T DES LANG UES
survie lorsque l a langue en question est l'anglo-amricain.
En efet, il ne s'agit plus alors d'un simple moyen
d'change linguistique qui possde quelque rputation, et
dont la slection, ayant d'abord paru rpondre un
consensus, accrot encore le prestige. Car toutes les
langues de ce type n'ont de difsion que rgionale. Le
rsse lui-mme a certes exerc en Union sovitique,
comme on vient de le voir, une forte pression, mais si vaste
que ft le pays, le phnomne demeurait rgional.
Au contraire, adopter l'anglais pour langue vhiculaire
ne signife pas seulement faciliter les relations en milieu
plurilingue. Cela signife s'intgrer un espace linguistique
auquel se trouvent appartenr, comme locuteurs de nais
sance, les citoyens de pays pari les plus puissants du
monde, dans les domaines conomique, politique, scienti
fque et culturel. JI est probable que ces considrations
n'ont pas jou de rle dcisif dans l'esprit des locuteurs de
tant de langues amrindiennes ou australiennes engages
dans u processus d'extinction, ou dj teintes. Ces locu
teur adoptaient simplement ) la langue de la socit
dominante, prsente dans leurs lieux de travail et dans
leurs environnements, et permettant d'abattre les barires
que semble dresser le foisonnement des langues trbales.
Mais le choix de l'anglo-amricain ne saurait tre innocent
tant donn les circonstances dans le monde depuis le
milieu du XIC sicle. Une langue vhiculaire qui est aussi,
partout, celle de la puissance et de l'argent n'est pas un
moyen neutre de communiquer.
LES RIVALITS DE PRESTIGE,
ET LEURS EFFETS SUR LE SORT
DES LANGUES
Les locuteurs que vient investir une autre langue
apparemment bien arme pour s'assurer une domination
ne cdent pas toujours l'intruse. Dans deux cas au moins,
LE BA TA I L L ON DES C A USES 1 73
ils continuent de croire au prestige de leur langue d'origine
et aux valeurs culturelles qu'elle porte, en sorte que cette
langue sort indemne de la confontation. Le premier cas
est celui des emprunts massifs balancs par une conscience
natonale aigu. Le second est celui des lites bilingues.
Quand les emprunts massifs
n'entranent pas l'absorption
Quand il n'y a pas de bilinguisme ingalitaire,
l'emprunt massif de vocabulaire peut se produire, sans
annoncer aucunement une disparition de la langue
emprunteuse par absorption dans la langue prteuse. Trois
cas mrtent d'tre retenus ici. L'un se situe en AngletelTe,
un autre dans l'Orient musulman, le derier en Asie de
l'Est et du Sud-Est.
Langlo-norand et la tnacit de l'anglais
Les linguistes appellent anglo-normand la forme que
prit en Angletere, aprs la conqute de ce pays, en 1 066,
par Guillaume, duc de Normandie, le normand, ml de
picard, que parlaient les conqurants, et qui reut au
XIIe sicle, avec l 'arrive de nombreux marchands, un
important contingent angevin, relay plus tard par des
apports d'le-de-France. Linfuence franaise s'accrt
encore du fait que les usagers de ce dialecte no-latin de
France occidentale revendiquaient le modle du fanais
littraire en voie de formation et d'unifcation autour de l a
cour de France, avec laquelle certains taient en relation
permanente. Mais ces usagers taient en fait une minorit.
Seuls la cour, l'aristocratie fodale, les riches marchands,
les vques, les abbs et d'autres privilgis parlaient cette
variante normande du fanais en gestation.
La masse de la population, quant elle, ne parlait que
l'anglais (cf. Hagge 1 996 b, 32-36). Nanmoins, elle
absorba les emprnts massifs qui furent faits, selon les
1 74 HA L TE L A MO R T DES L A N G UES
poques, diverses formes du fanai s, et qui donnent
l'anglais, aux yeux d'un fancophone, cette physionomie si
particulire de langue germanique latinise. Encore ne
s'agit-il que de la nouvelle tape d'une latinisation qui avait
conmnc ds la christianisation du pays au Ve si cle, peu
a
res 1 m
allation des Jutes, des Angles et des Saxons, pre
mlers utIlIsateurs, refoulant l'ouest les Cehes autoch
tones, de la langue germanique d'o l'anglais natra. Ainsi
l'apport considrable de mots anglo-normands est-il la
suite naturelle d'une hybridation latinisante amorce
bea
coup plus tt. Parmi ces faits bien connus, je rppel
leraI seulement la conservation du sens ancien de mots
anglo-norands emprunts qui ont aujourd'hui perdu ce
sens en France, l'altration du sens d'autres mots (< faux
amis : cf. ici p. 63), et le maintien en anglais de mots
mdivaux que le fanais modere a perdus, comme to
remember se rappeler , mischief dgts ou rndom
hasard , etc. (cf. Hagge 1 994, 36).
Cette forme d'indpendance dans la manire d'assi
miler une langue de conqurants donne la mesure et
l'explication de la rsistance de l'anglai s. lannexion de la
Normandie par Philippe Auguste en 1 204 avait isol
l'Angleterre du continent, et contribu l'apparition d'une
conscience nationale anglaise, qui exercera une pression
ationa
,
liste, notamment travers la critique de la poli
tIque d ouverture aux trangers sous le rgne du fils de
Jean sans Tere, Henri III. Ds la fn du XW sicle il se
forme une bourgeoisie qui s'affirmera de plus en plus
au XV. Or cette bourgeoisie anglophone n'a aucune atti
tude d'humilit face la variante de fanais dont se
servent les milieux dirigeants. Cette langue trangre de
descendants d'envahisseurs est pour elle symbole d'un
sservisse
lent, et suscite donc dans ses rangs une impa
tIence croIssante. Cette bourgeoisie entend imposer l'usage
de l'angl ais, et faire savoir qu'il n'est plus considrer
comme l'idiome de masses peu scolarises.
LE BA TA I LLON DES CA U S ES . 1 75
C'est ainsi qu'en 1 362, pour la premire fois, le chan
celier, au parlement de Londres, prononce son discours en
anglais. la fn du xwe sicle, le fanais a perdu sa place
privilgie dans renseignement. Les crivains, dont
Chaucer, ne composent plus qu'en anglais. Lavnement
d'Henri I en 1 399 sera celui du premier monarque de
langue materelle anglaise. Ainsi, l'aristocratie normande
en Angleterre retrouvait en symtrie le destin de ses
anctres en France au xe sicle. Ils s'taient fanciss, elle
s'anglicisa. Loin de fanciser dfnitivement l'Angletere,
les descendants des barons normands taient fnalement
devenus anglophones au bout de trois sicles, pour avoir
perdu leurs bases en Norandie, pour avoir conclu avec
des femmes de l'arstocratie locale, faute de femmes nor
mandes en nombre sufsant, des mariages qui avaient en
outre l'avantage de donner quelque lgitimit un pouvoir
d'abord obtenu par l'invasion violente, et surtout pour
s'tre heurts une population attache sa langue.
La domination du fanais en Angletere est donc loin
d'avoir nui l'anglais, et moins encore de l'avoir conduit
sur la voie de l'tiolement. Les structures de la socit fo
dale ont empch la variante normande du fanais de
s'imposer au-del des minorits privilgies. Ds lors la
classe commerante autochtone et anglophone issue des
masses a pu s'affrmer, et assimiler les emprunts, malgr
leur nombre norme, en faonnant le premier visage de
l'anglais modere. N'ayant, en dpit du prestige initial de
l'anglo-normand, aucune raison de regarder leur langue
comme dpouille de tout prestige, les Anglais du Moyen
ge ont fort bien digr le choc du fanais.
Le persan et le turc l'preuve de l'arabe
On connat la conqute et l'islamisation de la Perse
sous le rgne du deuxime calife, Omar, entre 634 et 644, et
plus tard, l'islamisation progressive des Turcs par les Ira
niens musulmans avec lesquels ils commercent ; quant
176 HA L TE L t1 i\1 0R T D E S L A N G UE S
l'islamisation des mamelouks, mercenaires turcs au ser
vice des Abbassides, elle aboutit la fondation par l'un
d'entre eux, Alp Tagin, du premier empire turc musulman,
celui des Rhaznvides, en 962. Selon un processus qui
s'tend sur plusieurs sicles, le persan et le turc emprunte
ront l 'arabe des milliers de mots. Dans le cas du persan,
une troite symbiose de prs d'un millnaire avec l' arabe,
langue de la religion musulmane adopte, dans sa version
chi'ite, par la quasi-totalit des Iraniens, mais aussi langue
de la science et des relations interationales avec le reste
du monde musulman, eut pour effet une pntration du
noyau dur lui-mme : le persan, indo-europen, possdait,
comme les autres langues de cet ensemble gntique, les
prcds usuels de formation des mots par afxation et
par composition, mais il y a ajout, en empruntant les
mots arabes par familles entires, l e procd smitique de
drivations multiples sur la base d'une racine trois
consonnes ; la syntaxe et la phonologie du persan ont elles
mmes t soumises l'influence de l 'arabe.
Mais c'est videmment le vocabulaire qui a t le plus
profondment marqu : sans renoncer tout fait puiser
dans les stocks lexicaux de l'avestique d'une part, son
anctre codif sous les Sassanides au Ie sicle mais alors
disparu depuis longtemps comme langue pare, et d'autre
part du pahlavi, moyen persan, en usage lors de la
conqute arabe, le persan ft, au cours des sicles, des
emprunts normes J 'arabe dans tous les domaines. Pour
tant, la haute position de l 'arabe n'eut pas le pouvoir de
faire perdre au persan son prestige. La rvolution de 1 906
en faveur d'un gouverement constitutionnel ft suivie
d'un mouvement nationaliste exaltant les gloires de l a
Perse antique, mais prnant en mme temps la
modernisation ; un des aspects de cette derire fut,
partir des annes 1 920, le dbat sur les mrtes compars
des mots arabes et des mots de pur persan en vue de
l'entreprise nologique ncessite par l 'adaptation aux
nouveauts du monde occidental : les partisans de ]a
L E B A T A I L L ON DES CA US ES . 1 77
dfense du persan dclaraient, notamment, que celui-ci
tait une langue de culture urbaine, alors que l'arabe tait
adapt la vie du dsert avant de se trouver au contact
fcond de la brillante culture iranienne, et que par ailleurs
ses procds de formation des mots taient moins clairs
que ceux du persan (cf. Jazayery 1 983).
C'est aussi le rveil de la conscience nationale turque
lors des dfaites militaires du dbut du X" sicle, qui peut
expliquer les tonnantes mesures du rgime kmaliste. Les
classes dirigeantes de l'Empire ottoman, tat islamique
thocratique, taient soumises depuis bien des sicles
une intense acculturation arabo-persane, qui envahissait la
langue crite au point d'en faire un idiome savant inacces
sible aux masses, et o l'on disait que seuls taient turcs les
mots de liaison fonction purement grammaticale. Ds
lors, quand, en 1 928, Atatrk annonce le remplacement de
l'alphabet arabe par l'alphabet latin, il s'agit, sous l'appa
rente modifcation purement technique, d'une rvolution ;
car ce qu'crivaient les lettres arabes, c'tait cette langue
de l'ancien pouvoir ottoman, alors que les lettres latines
notent la langue telle qu'elle existe chez les masses
(contrairement ce qu'avait t leur fonction dans
l'Europe chrtienne, pour le latin, avant la conscration
des langues parles).
La rvolution kmaliste est d'inspiration populiste et
nationaliste. Elle ne se contente pas d'un changement
d'criture. Dsorais, c'est dans le fonds lexical du turc
osmanli et des autes langues turques que l'on puisera
pour former des mots nouveaux, ainsi que dans la langue
populaire, qui depuis trs longtemps, en cette terre
d'islam, avait assimil bien des mots arabes et persans,
mais beaucoup moins que l'ottoman offciel ; et dans les
coles, o il n'avait pas droit de cit, le turc prendra la
place de l'arabe et du persan ; enfn, on procdera l'pu
ration des lments arabo-persans dont la ncessit ne
s'impose pas. Si l'on songe au degr d'imprgnation depuis
1 78 HA L TE L A MO R T D ES L A N G UE S
une poque aussi lointaine, cette entreprse tait immense.
Elle durerait encore, dit-on, aujourd'hui . . .
Ainsi, en dpit de l a profondeur et de l a dure de l'isla
misation, ni le persan, ni le turc n'ont disparu par fusion
au sein de l'arabe. quoi attribuer cette prservation, lors
mme que la Perse c: l'Empire ottoman ont longtemps
incarn, surtout le second, le pouvoir musulman lui
mme, sinon au maintien d'une conscience tenace de leurs
cultures, y compris chez les Turcs, pourtant descendants
de nomades ?
D'autres langues encore, pour les mmes raisons lies
l'islamisation de leurs locuteurs, ont t exposes un
afux de mots arabes, sans pour autant se dissoudre dans
cette aventure. Mais il est vTai que les emprunts n'y ont pas
t aussi nombreux qu'en turc et en persan. On sait que l e
malais comporte une strate arabe, en provenance, surtout,
de l'Hadramaout, et que l'hindustani (pour revenir ce
terme qui ne dsigne ni l'hindi sanskritis, ni l'ourdou per
sanis, mais le fonds de langue qui leur est commun) com
porte une certaine quantit de termes arabo-persans qu'il a
bien assimils, et qui continuent de s'employer trs cou
ramment dans la langue parle, en dpit d'un important
apport contemporain de mots anglais.
Lafrmation du japonais, du coren et du vietnamien face
la pression du chinois, matrice culturelle de l'Asie orientale
Une part considrable du vocabulaire du japonais,
du coren et du vietnamien est constitue d'emprunts
chinois. Leur importance est telle que les composantes lexi
cales qu'ils forent sont appeles, respectivement, sino
japonais, sino-coren et sino-vietnamien. Elles se sont
chafaudes dans le sillage de l'emprunt des idogrammes
de l' criture chinoise, qui n'ont t abandonns en Annam
qu'en 1 65 1 , date du premier dictionnaire crit selon l a
notation en alphabet latin du pre jsuite A
.
de Rhodes.
En Core du Nord, ils sont ofciellement interdits
L E BA T A I L L O N D E S CA U S E S 1 79
en 1 949, et en Core du Sud, aprs une srie de mesures
contradictoires, un arrt de 1 974 a limit 1 800 le
nombre de caractres de base appris dans l'enseigne
ment secondaire. Le japonais, quant lui , continue,
depuis plus de quinze sicles, s'crire pour l'essentiel en
caractres chinois, combins, il est vrai, avec des sylla
baires autochtones.
La question de l'criture est fondamentale. Tout
comme l'limination de l'alphabet arabe en Turquie, tant
celle des mots arabes qui s'crivaient par ce moyen,
conduisait logiquement leur remplacement par des mots
turcs, de mme l'abandon des caractres chinois en
Annam visait le chinois lui-mme. Lannamite avait t
particulirement expos son infuence, puisque l'Annam,
conquis par la Chine deux sicles avant l're chrtienne, ne
devint indpendant qu'au xe sicle. Mme aprs cette date,
pourtant, le pays resta trs imprgn par la morale confu
cenne, qui servait l'intrt des rois annamites par sa
conception de la socit comme systme hirarchique o
chacun se voit assigner une place. Le chinois demeura
donc la langue des fameux concours de recrutement des
mandarins-fonctionnaires, qui ne frent abolis qu'en 1 91 9.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les Japonais s'taient
substitus aux Franais, lesquels avaient eux-mmes tent,
dans la logique coloniale qui tait alors la leur, de mettre l e
franais en tat de supplanter le chinois. Mais rien ne
rduisit vraiment l'importance de ce dernier, malgr la pro
motion du vietnamien comme langue de l'enseignement en
1 945, et les emprunts au chinois continurent de foi
sonner, surtout dans la langue ofcielle et j ouralistique au
Vietnam du Sud, et dans la phrasologie politique marxiste
au Nord. Nanmoins, une conscience nationale aigu a
toujours permis aux Vietnamiens de garder confance dans
leur langue, et cette dernire n'a jamais perdu son prestige.
partir de l'invention par le roi Sejong, en 1 446, d'un
alphabet coren, toujours en usage, on cessa d'crire en
idogrammes les mots sino-corens. Mais leur proportion
1 80 HA L TE A LA MO R T DES LANGUES
tait telle (60 % du vocabulaire) et ils taient s i solidement
tablis (les contacts de l'ancien pays de Choson avec la
culture chinoise remontent au premier millnaire avant
l're chrtienne), qu'on ne tenta pas de les remplacer. Cer
tains sont des emprunts au sino-japonais, et ils entrent,
comme les mots sino-corens, dans la structure d'une
masse de mots composs, que ne put supprimer Kim Il
Sung, longtemps chef de la Core du Nord, auteur de nom
breux essais de coranisation du lexique, et contempteur
du coren du Sud, ses yeux trop japonis et amricanis.
Quoi qu'il en soit, ni les emprunts chinois nagure, ni les
emprunts anglais aujourd'hui n'ont dracin le coren, et
le nationalisme culturel de ses locuteurs clairs a eu pour
efet le maintien de son prestige face aux langues
intruses -
On peut en dire autant du japonais, alors qu'on y voit,
de nos jours, un raz de mare de mots amricains succder
l'norme aflux de mots chinois. Mais bien qu'il soit sans
doute plus imprgn encore d'anglais que le coren, le
japonais a conserv les caractres chinois, malgr
quelques tentatives avortes de latiniser l'criture. Ces der
niers notent non seulement les mots qui pullulent dans la
terminologie savante, et qui corespondent aux racines
grecques ou latines des mots techniques fanais, mais
aussi, tout simplement, la plus grande partie des mots du
vocabulaire courant. Tout comme en persan, en turc, en
vietnamien, en coren, on continue, en japonais, fabri
quer des mots mixtes l'aide d'un terme emprunt
qu'accompagne un verbe faire du fonds autochtone.
Ces procds sont anciens. Les emprunts n'empchent nul
lement les usagers d'avoir une conscience claire de leur
culture. Leur langue grappille depuis des sicles dans des
langues prestigieuses, mais, pour autant, ne perd aucune
ment son prestige. Le japonais est en excellente sant.
L E B A TAI L L O N DES CAUS ES . 1 81
Quand l bilinguisme n'implique que les lites :
l ge Rome au temps d Cicron
Sur deux mots clbres de Csar
Dans le prt--porter culturel d'anciens lves de latin
fgurent deux mots clbres que l'on attribue Csar en
deux moments dcisifs de sa vie. Quand, revenant de la
conqute des Gaules, il fanchit en -49 le Rubicon, violant
l'ordre du snat et la coutume, il aurait dit : alea jacta est !
le sort en a t jet ! ; et aux ides de mars -44, jour de
son assassinat, on l'aurait entendu dire Brutus, qui lui
portait les derniers coups de couteau : tu quoque, mi fJi !
toi aussi, mon fls ! `- En ralit, Csar n'a profr ni l'un
ni l'autre de ces deux mots historiques . Et cela pour la
simple raison que s'H Ies a dits, il l'a fait en grec, et non en
latin. En ce qui concere les deriers mots de Csar, Su
tone crit expressment (Vies des douze Csars, Jules Csar,
79) : On raconte que voyant M. Brutus prt le fapper, il
se serait cri en grec : "Et toi aussi, mon fls ! I> Dion Cas
sius corobore ce
tmoignage (XIV, 1 9, 5). Csar a donc
dit Kat c, 'Kvov ! [kai su teknon], soit, mot mot, aussi
toi, enfant ! - Le tu quoque, {U mi, que l'on rpte partout
et qui ne fgure dans aucun texte ancien, est une traduction
des grammairiens de la Renaissance, reprise par Lhomond
dans son De viris illustribus (cf. Dubuisson 1 980).
Encore cette traduction est-elle inexacte, car Kat c
toi aussi ! tait en ralit une formule de maldiction,
et ce que Csar voulut exprimer, cc fut non pas une consta
tation douloureuse en voyant le fls de sa matresse Ser
vilia, qu'il considrait comme son propre fls, se ruer su
.
r
lui pour l'achever de son stylet, mais bien un anathme ; Il
dit Brutus en mourant : Puisse-t-il t'arriver la mme
chose ! Quant aux mots prononcs en fanchissant le
Rubicon, il est tabli (cf. DubuisSOT, ibid. ) qu'ils l'ont ga
lement t en grec : veppi9r KVO< [anerriphth kubos],
1 82 HA L TE LA M 0 R T D ES L A N G UE S
c'est--dire littralement que (le) d le sort) ait t
jet ! . La traduction latine qui fait autorit, et dont l'qui
valent fanais le sort en est jet s'emploie lorsque l'on
prend une audacieuse dcision, est encore plus inexacte
que la prcdente, car vepp9r est en grec ancien un
impratif parfait passif ; il s'agit donc d'un ordre rtro
actif indiquant le rsultat d'une action, et il conviendrait
d'adopter pour l a traduction latine de ce proverbe grec
bien connu, la correction d'rasme jacta alea esta, sans
compter qu'alea jacta est signife, en fait, { le sort en a t
jet , ce qui est bizarre, l e parfait latin rfrant au pass,
et non, comme le parfait grec, au rsultat toujours actuel
d'un acte que l'on vient d'accomplir.
Le grec, lange premire des patriciens romains
Pourquoi Csar a-t-il parl en grec en deux circons
tances o son motion tait forte, d'une part quand il fait
un choix trs hardi, d'autre part quand il sent qu'il
s'enfonce dans la mort ? Prcisment parce que le grec
tait la langue apprise depuis l'enfance, celle, donc, qui
resurgit quand le trouble est son comble, et son degr le
plus bas le contrle de soi-mme.
Sur le statut du grec dans l'ducation des enfants
appartenant aux familles privilgies de Rome, tous les
textes sont parfaitement clairs. Un des plus clbres est
celui du l ivre 1 de l 'Institution oratoire, o Quintilien
peut encore crire, plus d' un sicle aprs l a mort de
Cicron :
( Je prfre que l'enfant commence par le gec, parce que
le latin tant davantage utilis, nous nous en imprgnerons
de toute faon [ . . . ]. Je ne voudrais pas, cependant, [ . . . ] que
l'enfant ne part ou n'apprt pendant trop l ongtemps que le
grec, ce qui est le cas pour la plupart. Cette habitude
entrane un grand nombre de dfauts de prononciation,
[ . . . ] ainsi que d'i ncorrections de langage. "
LE B A T A T L L ON DES C A US ES 1 83
D'o venait cette situation ? On connat le mot
d'Horace : Graecia capta ferum victorem cepit ( La Grce
soumise a soumis son grossier vainqueur . De fait, la
dcouverte de l'clatante civilisation grecque, depuis qu'en
- 1 46 Rome avait vaincu la Grce et en avait fait une pro
vince mise sous son autorit, produisit parmi les lites
romaines un sentiment d'infriorit, encore trs vif
l'poque de Cicron. Assez vite, l 'apprentissage du grec
leur appalt comme celui du rafnement et de la seule
vraie culture, et son ignorance comme le fait d'un lstre,
ou, chez un reprsentant des classes suprieures, comme
une anomalie. Le grammairien Varron dfendit mme la
thorie chevele de l'origine grecque du latin, bien
entendu sans aucun argument qui puisse nous convaincre
aujourd'hui, ni sans doute qui le persuadt lui-mme,
puisqu'il s'agissait surtout de rehausser le prestige du latin
(cf. Dubuisson 1 981 ) . Lhellnisation de l'aristocratie
romaine possdait des aspects plus cachs. La connais
sance du grec parmi les classes dirigeantes devint un enjeu
politique, dans la mesure o la pratique de la rhtorique
athnienne, en amliorant l'art oratoire, leur fourissait
une arme effcace de conqute, et de conservation, du
pouvoir ; des mesures furent mme prises ds la fn du
ne sicle avant J. -C. pour empcher la formation d'coles
de rhteurs latins.
Les ambiguts du bilinguisme Rome (fn de la Rpublique et
dbut de l'Empire)
la fn du leI sicle, le pote Juvnal s'en prend, dans
une de ses Satires, l'usage que feraient du grec certaines
femmes romaines (des classes aises) jusque dans les dou
ceurs prives. Cette pntration, si l'on ose ainsi dire, du
grec dans la vie intime des riches n'est peut-tre pas sans
liens avec l'ide, rpandue chez beaucoup de lettrs, de
l'infriorit du latin par rapport au grec. Lucrce, crivant ,
au lr sicle avant l're chrtienne, son De natllra rerum, se
184 HA L TE LA M 0 R T DES L A N G UE S
plaint de la pattii sennonis egestas ( indigence de notre
langue paternelle }) pour exposer la doctIine d'picure.
Cicron, comme bien d'autres intellectuels bilingues,
adopte en public une attitude nationaliste et antigrecque,
refusant de ratifer le mot de Lucrce, assurant intrpide
ment que le latin est plus riche que le grec, crditant, avant
Snque et Quintilien, le latin de force et de sIeux dans
l'loquence par opposition la dlicatesse et la subtilit
du grec, mais sa correspondance recourt tout naturelle
ment au grec chaque fois qu'il ne trouve pas en latin la for
mulation adquate.
Le bilinguisme des lites, et la forte prsence du grec,
qui afectait mme la vie ofcielle romaine, n'taient pas
sans entraner des ractions assez vives. Un texte clbre
de Valre Maxime, contemporain de Tibre, regrette le
temps o les Romains dfendaient davantage leur langue :
[ . . . ] les magistrats d'autrefois veillaient prserver [ . . . ]
leur propre dignit et celle du peuple romain [ . . . ]. On peut
citer [ . . . ] leur souci constant de ne jamais accorder de
rponse aux Grecs qu'en latin. Bien plus, on liminait l a
faconde qui fait leur avantage en l es forant se servir d'un
interprte, et cela non seulement Rome, mais mme en
Grce et en Asie, afn, bien entendu, de rendre plus respec
table et de rpandre dans tous les peuples l'honneur de l a
langue latine. Ces hommes ne manquaient pourtant pas de
culture ; mais ils pensaient que l e manteau grec devait tre
subordonn l a toge : c'tait une indignit, selon eux, que
d'ofir aux attraits et au charme des lettres le poids et
l'autorit du pouvoir. "
Suit un loge de Marius, chaudement approuv de
n'avoir pas accabl la curie d'interventions en grec ), et
dont on sait que, bien qu'il connt fort bien le grec, il
jugeait ridicule (contrairement son adversaire Svlla,
d'origine sociale plus leve) d'apprendre la littrature
d'un peuple que les Romains avaient rduit en esclavage,
puisque ce rafnement n'avait pas servi la libert de ceux
LE BA TA I L L O N DE S CA USES . 185
qui en faisaient profession. Valre Maxime, en outre, se
rfre implicitement aux Romains qui dfendaient le latin
contre le grec, notamment Caton, lequel, en - 1 91 , venu
Athnes en qualit de tribun militaire, avait pris le parti de
parler en latin la foule, en s'aidant d'un interrte, alors
que les patriciens tels que lui taient capables, cette
poque dj, de s'exprimer en grec. Ce que demande donc
Valre Maxime, ce sont de vritables mesures de protec
tion contre un bilinguisme qui donne au grec une place
excessive ses yeux.
Que les modles anciens dont il se rclame ne soient
plus suivis un sicle plus tard, c'est ce que montre, entre
bien d'autres exemples, le choix que fait Cicron, non sans
indigner ses ennemis, de parler en grec, en -70, au snat de
Syracuse. Lempereur Tibre avait t lev en grec, et le
parlait parfaitement (il l'utilisait mme quand il crivait
des pomes), mais i refusait de s'adresser dans cette
langue au snat, ft-ce pour dire quelques mots, et mon
trait un purisme sourcilleux face aux hellnismes des
Romains cultivs et l'excs apparent d'emprunts grecs en
latin. Il en ft de mme de l'empereur Claude.
Ainsi, le bilinguisme Rome dans les deriers sicles
de la Rpublique et le premier de l'Empire, est la fois
gnral en priv et souvent condamn en public par les
personnages ofciels. Il est intressant de noter qu'en latin
classique, l'adjectif bilinguis est une qualifcation pjora
tive du mlange des langues, et que, dans un autre de ses
sens, il rfre, comme si celui qui a deux langues ne pou
vait tre qu'un fourbe, la duplicit, que rcuse l'exigence
romaine de droiture, et mme la mdisance et au men
songe, tout comme son hritier en fTanais mdival. C'est
assez dire la mfance qu'inspirait, ct de la fascination
qu'elle exerait, cette langue grecque que l'on apprenait
trs tt . Si Auguste encouragea Virgile et Tite-Live crire
leurs ouvrages fondateurs, ce fut surtout parce qu'il voulait
que la posie et l'histoire eussent Rome leurs lettres de
noblesse, afn de balancer l'infuence des grandes uvres
1 86 HA L TE L A M O R T D E S L A N G UE S
grecques. Il fallait, ses yeux, que le latin cesst de lais
ser au grec seul le statut de langue vhiculaire principale
des pays mditerranens, et d'instrument d'une culture
prestigieuse.
Le grec et les masses romaines
Tant de mesures de protection, tant de frilosit et tant
de craintes n'taient pourtant pas ncessaires. Le grec ne
pntra jamais au-del de la socit patricienne, car la
plbe n'avait pas les moyens de stipendier des prcepteurs
hellnophones. Or seul un vritable enracinement du grec
dans les milieux plbiens aurait eu le pouvoir de lui
donner un statut assez puissant pour qu'il pt rivaliser
avec le latin. En d'autres termes, une langue intruse ne
s'implante solidement et profondment que si elle touche
toute une communaut, et non ses seules lites. L'clatante
et trs longue destine du latin en Occident (cf. ci-dessus,
p. 68-74), alors qu'aujourd'hui le grec est la langue d'un
petit pays d'Europe soumis pendant prs de quatre cents
ans au joug ottoman, devait montrer que le bilinguisme de
l'aristocratie romaine l'poque classique n'tait qu'un
pisode sans lendemain. Le prestige du grec n'avait pas tu
celui du latin, mme s'il avait donn des complexes aux
omains cultivs. Et une langue qui garde intact son pres
tle malgr la rivalit d'une autre, mme trs prestigieuse,
n est nullement mise en situation prcaire.
.
Mais aux risques graves qu'entrane, quand elle se pro
dUlt, la perte de prestige peuvent s'ajouter d'autres circons
tances, qui rduisent encore les capacits de rsistance
d'une langue, si dj des facteurs comme ceux qui ont t
tudis moussent ces capacits. Ce sont ces circonstances
qu'il faut examiner maintenant.
L E B A TA I L L O N DE S CA US ES . 1 87
De quelques circonstances ' favorables
l'extinction des langues
Parmi les circonstances qui participent, sans avoir de
rle causal direct, la disparition des langues, on peut
ranger le purisme dfensif et l'absence de nom1alisation
d'une part, d'autre part le dfaut d'criture, enfn le fait
d'tre un groupe minoritaire.
LE PURISME ET LE DFAUT
DE NORMALISATION
Les apores du pursme
Lexaltation du fonds lexical autochtone
Une outrance dans l'attitude ou dans la prescription
puriste peut acclrer le processus de prcarisation d'une
langue malade. On en observe les effets semblables partir
de cas apparemment contradictoires. Les uns rejettent des
emprunts en faveur de mots du fonds local que depuis fort
longtemps plus personne n'emploie ; ainsi, dans les
langues celtiques en tat prcaire, comme l'irlandais, cer
tains locuteurs gs utilisent des termes autochtones tout
fait archaques et inconnus des partenaires, l o des mots
d'origine anglaise intgrs de longue date sont les seuls
dont se servent ceux qui pratiquent encore la langue. Les
autres appliquent cette attitude la grammaire, s'atta
chant avec une ombrageuse obstination des formes ou
des constructions dsutes. Tel est, notamment, le cas des
puristes dfendant une norme archaque du nahuatl, dans
les paliies du Mexique o cette langue est menace par
1 88 HA L TE L A MO R T DES L A NG UES
l 'afontement avec l'espagnol. On a v au chapitre VI que
c'est l un des signes de l'obsolescence des langues. Ces
garants du bon usage, qui, par l'insistance artifcielle sur
une norme exigeante, cherchent se convaincre de leur
propre comptence sans vouloir admettre qu'elle s'tiole,
sont parfois vilipends par ceux qui jugent que le purisme
est ennemi de la langue.
Le refs d'emprunt et son efet perver: l'abandon
Mais une autre fore de purisme exerce une action
pericieuse. C'est }' attitude des locuteurs qui refusent
d'emprunter des mots trangers pour rfrer des ralits
du monde et de la technique moderes, sous prtexte que
ces emprunts dnaturent la langue. On ne saurait
demander aux locuteurs d'tre linguistes professionels,
videmment. Mais ce rejet systmatique d'un phnomne
comme l'emprunt, natrel et assez peu nuisible ds lors
qu'il est contenu dans certaines limites, dnote une igno
rance de ce qui fait la ve des langues. Cette ignorance
devient dltre quand elle produit l'efet que l'on a not
dans d'autres communauts nahuatl : faute de disposer des
teres ncessaires, car la langue ne les a pas crs, les
puristes, ici, jugeant que l'emprunt des termes espagnols
n'est pas admissible au sein d'un discours en nahuatl,
renoncent purement et simplement parler leur langue et
passent l'espagnol !
Les circularits de la revendication puriste
On observe enfn, parfois, une trange circulart. Les
locuteurs commencent par multiplier les emprunts la
langue de prestige, aprs quoi ils dclarent impure la
langue dont ils ont eux-mmes provoqu l'implosion !
Selon un tmoignage recueilli il y a vingt-trois ans (Hill et
Hill 1 977), les locuteurs chez qui le taux d'emprunt
l'espagnol tait le plus lev taient aussi ceux qui affr
maient qu'un nahuatl ce point contamin produit une
L E B A TA I L L O N DES CA US ES 1 89
impression de honte, et ne mrite pas d'tre plus long
temps prserv !
La gnralisation de ces attitudes est de nature acc
lrer la disparition de la langue ancestrale, alors que juste
ment, dans les communauts aztques o le nahuatl se
porte bien, les locuteurs ont assimil les emprunts espa
gnols, et ne se font pas grief de les utiliser quand la chose
est ncessaire.
La droute ds cods non normaliss
Une tonnante contradiction s'observe ici. Les mmes
qui prfrent renoncer une langue o il leur faudrait
introduire trop d'emprunts ne se soucient pas de faire ce
qui, prcisment, permettrait de rduire le nombre de ces
deriers. Cette entreprise dont ils mconnaissent la nces
sit est celle qui a contribu faonner le vocabulaire de
maintes langues, dont le fanais, ou encore, pour citer des
exemples plus exotiques, le hongrois, le fnnois, le turc,
l'estonien et bien d'autres (cf. Fodor et Hagge 1 983- 1 994).
I s'agit de la normalisation, ou action consciente que des
experts, cautionns, sinon sollicits, par l'autorit
publique, accomplissent sur le vocabulaire d'une langue,
pour l'adapter l'volution des techniques, des connais
sances et des habitudes. Le rglage des langues diverses
poques de leur histoire a souvent t un facteur efcace
de leur adaptation aux changements, comme le montre
clairement, entre autres, l'tude de celles que je viens de
mentionner. Dans le domaine du vocabulaire, les rforma
teurs ont souvent prfr les solutions nationales (mots
drivs du fonds ancien, donc en principe motivs) aux
solutions interationales (emprunts directs, donc opaques,
mme sous un revtement local).
Cela dit, quand le dfaut de normalisation a longue
ment rod les forces d'une langue, il peut arriver qu'il soit
trop tard pour intervenir. Lexemple des langues celtiques
le montre. Le gouvernement irlandais a promu partir de
1 90 HA L TE L A MOR T DES L A NG UES
1 958 une forme crite, fonde sur certaines variantes
moderes, et laquelle i l s'est efforc de donner une auto
rit relle en organisant son enseignement tous les
niveaux du systme d'ducation, et en l'utilisant dans
l'administration et dans les documents offciels chaque fois
qu'une version irlandaise est recommande ct de la
version en anglais. Mais i ne semble pas que cette entre
prise ait ralenti le dclin que subit l'irlandais depuis plus
d'un sicle et demi face la concurrence de l'anglais. Car la
minorit de ceux qui, dans les comts de l'Ouest, ont
encore un maniement naturel de cette langue, se sert des
variantes dialectales, dont l'existence vivante a plus de ra
lit que des crations artifcielles.
Cela est encore plus vrai pour le breton. Du moins
l'irlandais profte-t-il de son statut offciel dans la constitu
tion du pays, qui rend moins illusoire la promotion d'une
norme. Mais quand la langue supradialectale que l'on
entend promouvoir n'a de statut que rgional, alors les
usagers des variantes locales ont plus de raisons encore de
la juger artifcielle, et de ne pas souhaiter s'en servir. Le
breton unif que l'on tente de favoriser a le mrite
d'exister et devrait, videmment, pennettre une renais
sance de la langue. Mais les usagers des parlers restent
souvent mfants l'gard d'un breton construit, qui n'est
pas la langue materelle de quelqu'un. Il convient, au
demeurant, de ne pas s'exagrer la dispersion dialectale du
breton. Lexprience prouve que tous les Bretons se com
prennent quand ils utilisent leur parler local. Le problme
d'un breton unif se pose, certes, mais le dclin du breton
s'explique aussi par d'autres causes que l'absence de cette
norme fdratrice.
La marginalit des parlers entre lesquels se disperse
une langue peut dcourager l'effort de normalisation, sur
tout lorsque les communauts qui tentent cet effort ont en
face d'elles une l angue l a vaste diffusion rgionale ou
interationale et la puissante capacit d'absorption. Que
peuvent, par exemple, les langues ouraliennes, altaques
LE B A TA I L L ON DES CA USES . 1 91
ou sibriennes de Russie, qui dj, dans l es enclaves o
elles existent encore, sont cernes de vastes terres domi
nes par l e russe ? Leur isolement et l'absence d'un vouloir
culurel s'exprmant dans une politique scolaire et dito
rale dcouragent tout essai de dgager une norme unife
partir des forts contrastes dialectaux qui les dynamitent.
C'est ainsi que, sauf heureux retourement dont on n'aper
oit pas les signes, paraissent vous une extinction
proche l'nets (pninsule de Taimyr), le yukaghir
(Yakoutie), le nivkh (le de Sakhalne) et beaucoup
d'autres. Mais il faut redire que l'absence de normalisation
n'est pas en soi une cause sufsante, et qu'elle ne fait
qu'aggraver la situation en s'ajoutant aux autres causes.
L'ASENCE n'CRITURE
L'absence d'criture n'est pas non plus en soi une
cause directe d'extinction d'une langue. Si important que
soit le rle jou par l'crture dans l'histoire des langues de
civilisation, il s'agit d'une invention tardive, et d'un revte
ment extrieur, qu'on ne saurait compter parmi les pro
prits inhrentes. Lexistence d'une crture n'a pas
empch des langues qui furent autrefois prestigieuses et
rpandues de s'teindre, et inversement, il existe dans le
monde d'aujourd'hui, en Afrique et en Ocanie notam
ment, de nombreux pidgins qui ne s'crivent pas, et qui,
nanmoins, rendent assez de servces ceux qui peuvent
par ce biais entrer en communication, pour se porter fort
bien et ne pas paratre exposs disparatre dans un bref
dlai.
Cela dit, entre deux langues que d'autres discrimi
nants dsignent comme soumises aux mmes risques
d'obsolescence, celle qui possde un systme d'criture
sera gnralement plus arme que l'autre pour rsister. Il
ne s'agit pas ici de facteurs de maintien ni de moyens de
lutte, mais bien du prestige suprieur que confre, dans la
1 92 HA L TE A L A MOR T DES L A N G UES
plupart des socits (non dans toutes), l a notation gra
phique, et de l'appoint essentiel qu'elle constitue, de par le
pouvoir qu'elle donne une langue de diffser la parole en
la reproduisant au-del des situations concrtes de son
change. Lexistence d'une criture permet quatre autres
entreprises qui font beaucoup, aussi, pour l'affermisse
ment des langues : la littrature crite, qui facilite la
conservation sur support matriel et ne fait pas, comme
l'orale, appel la seule mmoire, l 'ducation scolaire, la
diffusion d'imprims, et la normalisation. propos de
cette derire, on rappellera un point important : c'est
faute de possder une criture que tant de langues sont
appeles par les masses des dialectes et ce terme, qui
n'voque pas, pour la majorit, la ralit purement tech
nique qu'y voient les linguistes (cf. p. 1 95), mais un mode
d'expression dvalu sinon mpris, agit en retour sur les
locuteurs eux-mmes. et accentue l'absence d'estime qu'ils
peuvent avoir pour leur propre langue.
L
'
TAT DE NATION MINORITAIRE
Le statut des minorits
parmi les nations homognes
Dans certaines socits, les minorits sont stigmati
ses, et le fait mme, pour une langue, d'tre parle par un
petit nombre de locuteurs peut contrbuer, en venant
renforcer d'autres facteurs, la mettre en situation de fra
gilit. C'est surtout le cas quand l'environnement est
constitu par une communaut homogne et trs cons
ciente de son identit. Les Thas sont une illustration de ce
genre de communaut. Leur orgueil national a t forg
par cinq cents ans d'unit fonde sur la domination pra
lable de groupes importants, comme les Mons et les
Khmers. Les Thas (du moins ceux du Siam) n'ont jamais
t coloniss, ni par un peuple asiatique. ni par un pays
europen. Le systme monarchique et le bouddhisme
L E BA TA I L L O N DES C A US ES . 1 93
theravada sont, avec la conscience nationale, les piliers de
l'identit tha (cf. Bradley 1 989). Il s'ensuit qu'en dpit de
la reconnaissance dont elles bnficient ofciellement. les
minorits non thas, descendantes de populations jadis
conquises ou demeures priphriques. sont regards en
Thalande avec hostilit, du fait de leur statut mme de
groupuscules isols. Pour chapper leur isolement, cer
taines tentent de s'assimiler par mariage. Tel est le cas des
Ugong. La consquence est la menace d'extinction de leur
langue.
L sentiment d'identit
rduisant le ef ets du petit nombre
Mme quand elles vivent l'cart des grands courants
commerciaux qui laminent les individualits, il est diffcile
aux petites tribus de rester elles-mmes culturellement et
l inguistiquement. Cela est encore plus vrai quand elles
sont exposes la rapacit meurtrire des prospecteurs et
des marchands, comme il est arriv aux Andok de l'Ama
zonie colombienne (cf. p. 1 28) . Pourtant, le petit nombre
peut tre compens par un puissant sentiment d'identit,
et ds lors ne plus tre un des facteurs de la prcarit d'une
langue. Ai
}
si, le bayso, langue couchitique orientale du
sud de l'Ethiopie, a rsist durant un millnaire la
concurrence des langues plus rpandues qui l'environnent,
alors que le nombre de ses locuteurs (500 en 1 990) a tou
jours t faible.
De mme, on voit s'opposer d'une manire signifca
tive le hinouk (nord-est du Caucase) et le ngidal (langue
toungouse de la rgion de Khabarovsk). Ils n'ont, l'un et
l'autre, que deux cents locuteurs environ. Mais le premier
s'appuie sur une forte conscience d'identit. ce qui n'est
pas le cas du second. Les Hinoukh apportent mme la
preuve qu'un sentiment identitaire puissant a le pouvoir de
neutraliser les efets des unions allognes. Les hommes
hinoukh se marient avec des femmes du village voisin, o
1 94 HA L TE A L A M OR T D ES L A N G U E S
se parle le dido, et les femmes hinoukh uittent aussi l a
communaut en pousant des hommes d autres groupes
ethniques (cf. Kibrik 1 99 1 , 259). Pourtnt, la conscience
ethnique ne se dissout pas dans ces umons, tant elle est
enracine.
Ainsi, mme quand les circonsance
.
sont
.
c?ntraires,
une volont de vivre et une passlOn d Identl1e peuvent
sauver une langue de l'anantissement.
C H A P I T R E V I I I
Le bilan
Dfnitions et critres
VALUATION DU NOMBRE DES LANGUES
ACTUELLEMENT PARES
DANS LE MONDE
Avant d'tablir un bilan de la mort des langues, il est
utile de connatre peu prs le chiffre de celles qui sont
vivantes. Cette valuation peut tre assez variable selon
les critres qui sont adopts pour dcider de ce que l'on
appellera une langue. Une des causes de cette variation
est que si ce sont les langues qui sont prises en compte,
on devra alors exclure les dialectes ; or l'attribution, un
idiome donn, de l'un ou l'autre de ces deux statuts varie
selon les linguistes, et tous ne s'accordent pas sur la df
nition qui parat la plus simple : une langue est celui des
dialectes en prsence ( un moment donn) qu'une auto
rit politique tablit, en mme temps que son pouvoir,
dans un certain lieu ; s'il existe une criture, fonction
administrative et littraire, c'est au service de ce dialecte
qu'elle sera mise.
230 HA L TE L A M 0 R T DES L A N GUE S
proportion considrable des quelque 1 650 000 espces
actuelles, lesquelles se rparissent en 45 000 vertbrs,
990 000 invertbrs et 360 000 plantes. Pour donner
quelques dtails, on retiendr que sur 4 400 espces de
mammifres, 326, soit 7,4 %, et sur 8 600 espces d'oiseaux,
231 , soit 2, 7 %, sont en danger. Encore ces chifes sont-ils
optimistes, et ceux qui les produisent considrent-ils que si
l'on tient compte des problmes de comptage des animaux,
il serait plus exact de parler de 1 0 % pour les mammifres et
de 5 % pour les oiseaux. Si la progression continue au
rthme actuel , 25 % des espces animales rsquent d'tre
efaces du globe avant 2025, et 50 % avant 21 00, soit des
proportions sensiblement gales celles des langues.
Cependant, il se pourait, sinon que la tendance soit
inverse, au moins que le rthme soit ralenti. En efet, les
tats les plus avertis du prl immense ont adopt ou adop
tent des mesures. Il existe plus de 40 organismes intera
tionaux des Nations Unies pour la sauvegarde de la nature.
Et par ailleurs, l'initiative prve ne fait assurment pas
dfaut : pour la protection du monde animal comme pour
celle des vgtaux, on compte plus de 300 associations.
La disparition des langues est regarder comme un
grave dommage subi par ce qui a t appel le ( gnome
linguistique de l'espce humaine (cf. Matisoff 1 991 , 220),
ou patrimoine de gnes linguistiques que reprsente
l'ensemble des langues vivantes et mortes depuis l'origine
des temps. N'y a-t-il rien qu'il soit possible de faire pour
ragir contre ce dommage ? Les langues qui sont encore
vivanes sont-elles moins dignes d'tre protges que les
espces animales et vgtales ?
:
C H A P I T R E I X
Facteurs de maintien et lutte
contre le dsastre
Les facteurs de maintien
L CONSCIENCE D'IDENTIT
Lattitude actuelle d'une partie des Bretons, des Ecos
sais, des Occitans, pour ne prendre que ces exemples, peut
tre considre comme une nouveaut. Aors que les fac
teurs essentiel de l'abandon de ces langues ont t l a mise
l'cart sur les plans conomique, social et politique, et la
perte de prestige qui en est rsulte, on note qu'une rsur
gence de fert apparat depuis peu chez les plus cons
cients. C'est l un facteur qui peut agir dans un sens
oppos celui des forces de dislocation. Hritiers d'une
tradition d'humiliation, ils la remettent en cause, et pui
sent un haut sentiment d'identit dans cela mme qui fai
sait mpriser la langue ancestrale : sa maranalit ou celle
t
de ses locuteurs.
Un phnomne analogue a t relev chez les Abori
gnes d'Australie, mpriss par les Blancs non contents de
les avoir dpossds de leurs teles. Ces laneues mmes
qui sont, avec la culture qu'cnes cxpriment .
la cible du
l
232 HA L TE L A M OR T D E S L A N G UES
mpris, sont souvent l'objet d'un regain d'intrt de l a part
des Aborignes qui les abandonnaient pour s'adapter. Car
eUes leur permettent d'afrmer leur identit, notamment
dans les situations o ils peuvent, de surcrot, dfer l'auto
rit de leurs adversaires, les policiers blancs, face auxquels
les idiomes aborignes sont empl oys comme langues
secrtes (cf. Wurm 1 99 1 , 1 5). Pouvoir parer entre soi une
langue que les adversaires ne comprennent pas, c'est l,
bien entendu un facteur d'attachement cette langue, dans
la mesure o une telle situation confre le sentiment d'une
supriorit, que le rejet raciste par les oppresseurs rcuse
obstinment. Mais cet emploi des l angues aborignes pour
narguer les Blancs n'est qu'un des aspects d'un rveil
gnral de la conscience identitaire chez les Australiens
autochtones. En juillet 2000, les plus dtermins des Abo
rignes ont rclam une reconnaissance du grave prjudice
caus aux enfants qu'on aracha de force leurs familles et
leurs langues durant presque tout le Xe sicle.
La conscience d'identit est particulirement fore
dans les communauts solidement structures, comme le
sont certaines tribus des pentes orientales des Andes,
notamment les Chuars (
quateur), les Campas (Prou) et,
une chelle numrque plus importante, les Aymaras de
Bolivie. On rapporte mme qu'un dirgeant de la tribu des
Cogui (groupe arhuaco de la famille linguistique chibcha,
vivant mi-hauteur de la Sierra Nevada de Santa Marta
dans le dpartement de Magdalena en Colombie) avait
interdit la population de parler en espagnol, dans le souci
de prserver son identit culturelle et son homognit (cf.
Adelaar 1 99 1 , 5 1 ) .
FA e TE URS DE MA ] NT] E N E T L UT T E 233
LA VIE SPARE :
HABITAT CHEZ SOI, ISOLEMENT,
COMMUNAUTS RURALES
L'itat autochton
La prseration d'une langue autochtone semble favo
rise par l'attachement au territoire originaire des locu
teurs. Inversement, les dplacements, rinstallations,
dportations des locuteurs hors de leur patrie ont des
effets ngatifs sur l a conservation de leurs l angues. On a v
plus haut (cf. p. 1 1 0) que le cayuga se maintient mieux
dans la rgion des Grands lacs amricans et canadiens,
habitat originel des Iroquois (Ontario est un mot iroquois,
signifant beau (io) lac (ontar) ). Le cayuga est, en
revanche, plus menac en Okahoma,
tat o ont t
dplacs dans des rserves, l'origine (1 834), les Indiens
des cinq nations ), et plus tard, d'autres peuples indiens
chasss de leurs tertoires.
Dans l'ancienne Union sovitique, de mme, les dpla
cements, volontaires ou imposs, en particuier les regrou
pements, durant les annes 1 940, dans des fermes collec
tives, ont eu des consquences nfastes sur les langues de
plusieurs populations, notamment le naukan et le nivkh,
qui ne doivent leur survie prsente qu' une assez forte
conscience ethnique; celle-ci neutralise peu prs,
jusqu'ici, les effets d'un autre facteur ngatif qui affecte le
nganasan, savoir la dispersion ; au contraire, de nom
breuses langues, mme quand le nombre de leurs locu
teurs est trs faible, se maintiennent bien dans les rgions,
en particulier montagneuses ou d'accs diffcile, o vivent
depuis longtemps leurs usagers : tel est le cas, par exemple,
de celles du Daghestan (est du Caucase), du bats en
Gorgie, ou des idiomes du Pamir (yazgulami, bartangi et
autres langues iraniennes).
!
i.
I
1
f
l
1
234 H.4 L TE L A MOR T DES L A N G UES
L choix du ghetto e t l'endogamie
Ce que ralise l'isolement d des conditions natu
relles, un choix social peut aussi le raliser. Les Chinois
amricains de la troisime gnration rsidant dans les
ghettos des quartiers qu'ils peuplent exclusivement (china
towns) passent moins souvent r anglais langue materelle
que ceux qui vivent en dehors de ces lieux de sgrgation
volontaire. Lendogamie constitue aussi un facteur de
maintien, li au prcdent, puisque c'est la sortie hors du
groupe qui favorise l'exogamie, et terme, met l a langue
en danger.
L vie rra
l'cart des grnds axes et des feuves
La vie au sein de communauts rurales est galement
un facteur de maintien des langues. Encore ce facteur
n'agit-il \Taiment que lorsque lesdites communauts vivent
l'cart des grands axes de circulation. Comme on l'a
remarqu (cf. Dixon 1 998, 82), la majorit des langues
indignes qui ont pu survivre dans le bassin de l'Amazone
se trouvent tre celles d'ethnies habitant assez l'cart des
principaux feuves ; si elles vivaient dans leur voisinage
immdiat, elles seraient exposes aux contacts avec les
communauts les plus nombreuses, qui sont aussi celles
dont l'activit conomique est fonde sur l'exploitation des
ressources hydrographiques. Dans un environnement dif
frent, ceux des Nubiens qui continuent de vivre la cam
pagne depuis que la construction du barrage d'Assouan et
la ralisation du lac Nasser ont entran, partir de 1 960,
l'inondation de leur ancien territoire et les ont fait migrer
un peu plus au nord, sont non seulement for loin enore
du Caire, mais en outre une dizaine de kilomtres des
rives du Nil. Ils attachent beaucoup plus d'impor1ance que
FA C T EU R S D E MA I N TI E N E T L UTTE . . . 235
les Nubiens urbaniss l a conservation de leur langue
comme symbole de leur appartenance ethnique, et pour
raient contribuer sa sauvegarde au moins provisoire face
au prestige de l'arabe et l'arabisation totale d'une pal1ie de
la socit nubienne (cf. p. 1 37- 1 38), qui se dtache de plus
en plus du nubien. On verra pourtant, plus bas, qu'un
facteur de maintien qui de\Tait agir en faveur de ce derier,
l a religion, est, en ralit, une menace de plus pour lui.
Le maintien par une soudaine prosprit : Val d'Aoste et TyTol
du Sud
Ce qui prcde possde une valeur gnrale, mais non
universelle. Des circonstances particulires peuvent faire
que ce soit non la vie rurale, mais au contraire la renoncia
tion cette vie, qui devienne un facteur de maintien des
langues. La valle d'Ayas, dans la rgion autonome du Val
d'Aoste en Italie, connaissait une conomie agricole et pas
torale jusqu'aux dernires dcennies. Mais le passage une
conomie fonde sur le ski et le tourisme a install la pros
prit, et il est devenu possible de fnancer un programme
prscolaire d'enseignement trilingue pour les enfants de 3
5 ans ; dans ce programme, l e dialecte fanco-provenal,
dont la situation gnrale est prcaire, a sa place ct de
l'italien et du fanais.
De mme, les parlers ladins, qui, avec ceux des Gri
sons suisses l'ouest et ceux du Frioul l'est, constituent
un des trois ensembles dialectaLx trs fagiles que l'on
regroupe sous le nom de rhtoromanche, ont bnfici
d'une tonnante promotion ; pourant, les districts du
Tyrol mridional (au nord de l'Italie) o l'on rencontre ces
parlers sont petits et discontinus : ce sont quatre valles
formant une croix autour d'un massif montagneux des
Dolomites. Mais une industrie touristique f0rissante s'y
est dveloppe, s'articulant sur le ski de luxe. Le tourisme,
tant largement international, a introduit non une langue
menaante unique, mais plusieurs, qui, de surcrot, ne
236 HA L TE A LA MOR T DES L A N G UES
peuvent exercer d'efet durable, car i l s'agit d'une activit
saisonnire, les habitants demeurant entre eux durant les
autres parties de l'anne, et dans un certain tt d'isole
ment. Il n'est pas exclu que ces facteurs aient agi en faveur
du renforcement des parers ladins, que l'on observe
depuis quelque temps.
Les grandes langues de l'Unon indienne, les moins gdes,
et le rle des vlles
Il se trouve qu'en Inde, c'est l'urbanisation, et non
l'exaltation de la ve la campagne, qui a servi beaucoup
de langues. Le rle jou par Calcutta au Xe sicle dans le
dveloppement du bengali, et celui qu'a jou Delhi dans la
promotion du hindi ont souvent t souligns (cf. Maha
patra 1 991 , 1 85 1 86). C'est aux langues parles su un ter
ritoire o se trouve au moins une grande ville que l'tat
accorde une reconnaissance, et ce cas, mme si l'argument
n'est pas voqu, est bien celui des 1 8 mentionnes dans le
fameux article VIII de la Constitution de l'Union indienne ;
pour certaines, comme le telugu, le gujrati, le marati,
l'assamais, le pendjabi, cela signifait la cration d'un
nouvel tat dot de pouvoirs politiques, donc possdant
un centre urbain important. Et c'est partir de tels centres
qu'ont t conduites contre le gouverement fdral, des
annes 1 950 au dbut des annes 1 970, des luttes parfois
violentes pour la reconnaissance.
Ainsi, le pays est pass, des 1 4 tats et 6 terrtoires de
1 956, tous dfnis, on le notera, sur des bases l inguistiques,
22 tats et 9 territoires. La situation fut longtemps trs
tendue dans l'extrme nord-est, autour de l'Assam, sur les
hauts plateaux et la chane de l'Arakan. Dans cette zone,
qui borde, du sud au nord, divers pays et provinces gale
ment plurlingues : Bangladesh, Birmanie, Tibet, et qui
rejoint, l'ouest, la fange orientale de l'Himalaya, cer
taines rgions ont fnalement obtenu la reconnaissance de
New Delhi. Elles constituent donc de nouvelles entits
FA C TE UR S DE MA I N TI E N E T L U T TE . . . 237
politiques, encore une fois dfnies sur le critre des
langues dominantes dans les agglomrations : tats du
Manipur, du Meghalaya et du Nagaland, Territoires du
Mizoram et de l'Arunachal Pradesh. Dans ces lieux se par
lent des langues des familles tibto-birmane (notamment
garo et manipuri), ou mon-khmer (khasi, entre autres) ; le
nombre des locuteurs est variable, allant pour certaines
jusqu' quelques centaines de milliers, mais toutes sont
fagiles ; et cette promotion ofcielle les renforce contre la
puissance des langues qui les entourent : bengali, birman,
assamais. Quant aux langues tribales du reste de l'Inde,
parles par des minorits parfois assez dmunies sinon
misrables, leur mode de vie rural, bien qu'il contribue
peut-tre les maintenir, n'est pas, dans le contexte indien
d'aujourd'hui, un facteur favorble leur promotion.
LA COHSION FAMILIALE
ET RELIGIEUSE
La cohsion familiale et la cohsion religieuse, qui
sont souvent solidaires, jouent certainement un rle en
tant que facteurs de maintien des langues. Lune et l'autre
ont beaucoup fait pour la permanence du norvgien aux
tats-Unis pendant une longue priode jusqu' ce qu'il soit
vinc par l'omniprsence grandissante de l'anglais (cf.
p. 2 1 4-2 1 5). Les relations entre ces facteurs sont logiques :
la cohsion religieuse donne plus de force aux traditions,
et une de ces derires est le respect des personnes ges,
lesquelles sont elles-mmes les plus srs garants des
langues ancestrales qu'elles ont transmises. De plus, la
cohsion religieuse, au X" sicle, conduisait les Norv
giens des tats-Unis fesselTer leurs rangs autour de leur
glise luthrienne, en opposition hautaine la dispersion
des nombreuses obdiences protestantes anglophones,
rivales entre elles.
238 HA L TE L A M O R T DES L A N G UES
Le rle jou par la religion s'observe ailleurs aux
tats-Unis, mine d'exemples pertinents, dans la mesure o
seules des langues pUssamment dfendues sont capables
de rsister, mme sans s'en affanchir compltement, au
poids de l'anglais. Il existe au centre et au sud-est de la
Pennsylvanie, ainsi que, plus sporadiquement, en Ohio,
Illinois, Indiana et Virginies du Nord et du Sud, des com
munauts allemandes, descendant de celles qui s'y instal
lrent aux temps colonaux. Chez tous ces locuteurs,
l'allemand prsente des traces d'rosion importantes,
notamment la confusion entre les cas de dclinaison, que
)' on trouve aussi dans divers dialectes rhnans et autres en
Allemagne, mais un moindre degr d'avancement. Or on
constate que ces dlabrements sont moins accentus chez
les Germano-Amricains qui appartiennent une des deux
sectes des Mennonites et des Amish, de stricte observance
religieuse, surtout la seconde. On peut en dduire, bien
qu'il existe des contre-exemples surrenants (cf. Huffnes
1 989), que la religion a le pouvoir de contribuer au main
tien d'une langue. Il est mme probable que si l'allemand
tait destin disparatre en Pennsylvanie dans l'emploi
quotidien, il se consererait dans l'usage confessionneL
Cependant, en certaines circonstances, l'effet de l a
religion peut jouer dans l e sens oppos. Les Nubiens de
Haute gypte, par exemple, dont on vient de voir qu'ils
prservent ce qu'ils peuvent de leur langue dans les villages
isols o ils continuent de vivre, sont, paradoxalement,
plis au pige du renouveau islamiste, qui se manifeste en
gypte comme dans d'autres pays musulmans. En effet, la
langue dans laquelle s'exprime cette foi revigore, travers
une fquentation accrue des mosques, est et ne peut tre
que l'arabe. sermons se font en arabe classique ; les
enfants nubiens qui rcitent convenablement les versets du
Coran sont rcompenss ; les femmes nubiennes, qui ne
sont pas les moins enthousiastes parmi les promoteurs de
ce renouveau reli gieux, tudient l'arabe afin de prati quer
correctement la lecture du Coran et l' islam en gnral . Le
FA C TE UR S D E MA I N TI E N E T L UT T E . 239
nubien est absent de toutes ces activits. Il y a plus : il en
est la victime, brve chance.
Dans certains environnements culturels, le fait, pour
une langue, de s'crire est un instrument de promotion
important. Ce cas est bien illustr par l'Inde. Dj, dans le
pass, la notation des prkrits par une variante ou une
autre de l'criture brahml, puis de la devanagar, a cons
titu pour eux le moyen de conqurir une relle dignit
nationale dans chacune des rgions o ils se sont fors.
Mais en outre, l'heure actuelle, les langues que la Consti
tution reconnat et qui sont assures de se maintenir sont
celles qui s'crivent, par opposition celles de petites
ethnies, que l'absence d'criture fragilise.
Cependant, ici comme dans d'autres cas, les situations
ne sont pas simples. Lcriture peut se muer en instrument
d'oppression, pour peu que sa forme soit impose d'en
haut, et ne soit pas celle que les populations avaient
choisie. C'est ce qui s'est produit en Union Sovitique
lorsque le pouvoir, aprs avoir promu l'criture latine
durant les annes 1 920, en est venu, durant les annes
1 930, gnraliser l'criture cyrillique. On sait que der
rire cette dcision, l'intention relle tait la russifcation
des langues et des ethnies. Cela fut bien peru par les intel
lectuels russes, comme le linguiste Polivanov, ou ceux des
rpubliques turques, de l'Ouzbkistan au Kirghizstan, qui
prirent le risque de s'opposer cette politique d'apparence
anodine.
L'UNILINGUISME
Je n'insisterai pas ici sur ce facteur. Il suft de rap
peler que les langues ethniques auxquelles leurs usagers
240 HA L TE A L A MOR T D ES L A NG UES
restent attachs tout en tant bilingues sont plus menaces
que celles qui n'ont que des utiisateurs unilingues. Ce fait
peut tre illustr, entre autres, par diverses langues tribales
de Tanzanie, qui sont exposes au raz de mare des locu
teurs de swahili (cf. p. 205-206).
LA MI
J'appellerai langues mixtes les hybrides linguistiques
qui rsultent du contact entre deux langues, dont les sys
tmes se mlent totalement. Il ne s'agit donc pas de l'alter
nance des codes, qui est un mlange non au niveau de la
structure d'une langue, mais dans la succession linaire de
la phrase, dont les lments appartiennent, alterative
ment, l'une ou l'autre des deux l angues en prsence. Il
s'agit de l'issue d'une infuence rciproque, qui peut avoir
dur pendant une assez longue priode. J'en donnerai ici
quelques illustrations.
Communiquer sur l'le du Cuivre
Lle du Cuivre appartient au petit archipel des les du
Commandeur, situes 90 km, environ, de la cte orien
tale de la presqu'le du Kamtchatka, et 1 50 km d'Attu, la
plus occidentale des les Aloutiennes. Il se parle sur cette
le une trange langue mixte (cf. Vakhtin 1 998). Une quin
zaine d'Aloutes avaient t installs sur l'le du Cuivre par
la Compagnie russoamricaine en 1 8 1 2 ; plusieurs
familles aloutes provenant de diverses les voisines y
furent encore transportes durant le XIX sicle, et en 1 900,
la population tait de 253 personnes. Il s'agissait essentiel
lement d'Aloutes, locuteurs de leur langue et du russe,
ainsi que de Russes et de quelques Eskimos et Kamtcha
daIs (habitants du Kamtchatka) . Or le fait frappant est
qu'il se dveloppa en ce lieu une langue mixte. Pour
mesurer son intrt, il faut comparer la situation linguis
FA C TE UR S DE MA I NT I EN E T L U TTE . . . 241
tique de l'le du Cuivre avec celle de l'le Brina vosine
.
Bring, o vit la totalit des quelques centaines
o
d'Aoutes
la majorit de la population, comme dans tout le nord-es
de la Russie, est passe au russe ; l'aloute ne survivait,
e; 1?90, qUI; chez une vingtaine de personnes ges. Il
s agIt donc d une langue au bord de l'extinction.
Au contraire, sur l'le du Cuivre, il s'est form durant
un sicle et demi de contact trs troit entre l'idioe indi
gne et le russe, une langue hybride o l'on dit, par
exemple, asa-yit ( il meurt , axsa-chaa-yis tu tues
sagyi-gii-yis tu as un fusil n, ou ni-ayuu- l ils n'taien
pas longs . On voit que dans ces phrases, les dsinences
vebales s<nt toutes russes : -yU = 3e personne du singulier
p
.
resent, -yd 2e personne du singulier prsent, et -l ::plu
nel de toutes les personnes au pass ; de mme est russe la
marque de ngation ni. Au contraire, sont tous des mots de
la langue aloute le verbeadjectif ayuu tre long , le radi
c verbal axsa, le morhme de factitif -clzaa- (= faire }),
comme dans faire mourir , c'est--dire tuer ), le nom
sagi sil
.
), le verb
,
e auxiliaire -ggii, qui signife poss
der , e mdqe que I on possde ce qu'exprime le nom qui
l pecede (lcl le nom est sagyi, et par consquent, sagi-ggii
sIgmfe possder un fusil ).
n d'autres termes, la langue mixte en question
aSSOCIe, par afxation (prfxes et sufxes), certaines dsi
nences verbales, ngations, et autres morhmes pris du
nsse, avec des radicaux qui appartiennent l'aloute.
Lltrt u procd provient de sa raret, comme il est
fac:le de s en convaincre en comparant la langue de l'le du
CUIvre avec celle des habitants de l'le Atka, situe l'est
des Aloutes : dans cette langue, les dsinences sont
autochtones, et ce sont les radicaux qui sont souvent
emprunts, en l'occurrence l'anglais, comme dans la
phrse fsh-iza-xx i l va habituellement la pche , o le
radical verbal fsh, emprunt, est suivi de deux mor
phmes aloutes, iza, qui indique un prsent d'habitude et
x, qui est la dsinence verbale de Je personne du Singulier.
242 HA L TE L A MOR T DES L A N G UES
On pourrait se demander comment il se fait que la
langue de l'le du Cuivre ne soit pas un pidgin du russe,
c'est--dire une langue vocabulaire russe et morphologie
rduite. La raison semble en tre qu'ici les rapports ne
sont pas d'ingalit, comme ils l'taient entre les esclaves
dports sur les plantations des tarabes et leurs matres
(cf. p. 350-352). Sur l'le du Cuivre, les Russes et les
Aloutes taient des travailleurs de mme statut, et
l'imprgnation linguistique tait rciproque. Selon les
enquteurs qui ont tudi cette langue mixte, les habitants
sont persuads qu'ils parlent en russe. Et de plus, cette
langue est trs vivante et ne parat pas, malgr le petit
nombre de ses locuteurs, tre menace d'extinction. On
peut en dduire que l'aloute est ici le bnfciaire d'un
trange salut par l'hybridation. Pour une langue amrin
dienne du grand nord sibrien et canadien qui risquait de
disparatre, l'troite symbiose avec le russe, ralise tra
vers celle de deux communauts, russe et aloute, apparat
comme un facteur de maintien inattendu, mais effcace.
Autres ca d'ybridation
Il existe d'autres cas d'hybridation profonde. Le ma?a,
ou mbugu, en est un exemple. Parl en Tanzanie du nord
est, le mbugu est une langue de la famille couchitique, qui
a emprunt aux langues bantoues voisines un grand
nombre de particularits de sa morphologie et de sa syn
taxe, tout en conservant un vocabulaire couchitique pour
l'essentiel. Un autre exemple est celui de la langue d'un
groupe tzigane de Grande-Bretagne, qui associe une gram
maire anglaise avec un lexique romani. Un autre encore
est celui de la V media lengua parle en quateur, qui
possde une grammaire quetchua et un lexique espagnol.
Un autre enfn est celui du mitchif, langue mixte parle
dans une rserve indienne prs de la localit de Lac La
Biche et du lac du mme nom, 220 km au nord-est
d'Edmonton (Alberta, Canada), par une communaut de
FA C TE U R S DE MA I N TI E N ET L U TTE . . . 243
mtis d'Indiens Cri et de Franais venus du Qubec au
dbut du xe sicle ; cette langue hybride associe des
racines cri (algonquines) et une grammaire franaise.
Il ne s'agit pas, dans tous ces exemples, du pril rsul
tant d'une situation de contact intense, qui fait perdre
une langue certains de ses traits, comme dans le cas du
dahalo abandonnant, sous le poids du swahili, son opposi
tion entre les genres et ses marques diversifes de pluriel.
Je ne crois pas non plus, contrairement d'autres auteurs
(cf. , par exemple, Myers-Scotton 1 992), que l'emprunt
d'une morphologie trangre soit le signe d'un tat mori
bond, et moins encore l'emprunt d'un lexique tranger que
l'on associe avec une base grammaticale autochtone. Bien
entendu, l'hybridit drange. Les langues trs composites
comme celles qui viennent d'tre cites paraissent, aux
yeux de certains, n'tre pas des langues V normales - Mais
c'est la myopie du contemporain qui fausse le jugement.
Lhistoire des langues contient bien des cas d'emprunts sur
une vaste chelle. La mixit peut tre le rsultat d'une lutte
pour s'adapter. Loin d'tre une tape conduisant vers la
mort, elle apparat, dans les cas cits ici, comme l'image de
la vie, c'est--dire d'un ajourement de la mort.
La lutte contre le dsastre
Il n'existe pas seulement des facteurs de maintien des
langues, contribuant empcher qu'elles ne disparaissent.
Il existe aussi des initiatives concrtes que prennent les
socits pour retenir, au bord du dsastre, les langues que
les anctres ont construites. l'tudierai successivement
dans cette section l'cole, l'ofcialisation, l'implication des
locuteurs, et le rle des linguistes.
244 HA L TE L A M 0 R T DE S L A N G UE S
On a v que l'cole amricaine tait pour les autres
langues, aux tats-Unis et au Canada, un redoutable fac
teur d'extinction. Plus gnralement, il n'est pas paradoxal
d'afrmer que dans tout pays o domine une langue,
l'absence, en certains lieux isols, d'coles o elle
s'enseigne est une chance pour la langue domine, sinon
mme un lment, ngatif, de sauvegarde. Cela apparat,
par exemple, dans les rgions de Thalande o des langues
de minorits rsistent l'influence du tha. Inversement, la
cration d'coles enseignant la langue domine peut avoir
un efet dcisif pour la sauver, mme lorsqu'elle est sur le
point de disparatre. C'est ce qu'attestent l'histoire du
maori et celle du hawaen. Le succs est moins vident
dans le cas de l'irlandais et des langues de Sibrie.
La renaissance du maori
En 1 867, le gouverement no-zlandais lana un pro
gramme d'ducation dans lequel l'anglais tait la seule
langue prsente. Le succs de ce programme fut d'autant
plus grand que les Maoris avaient t alphabtiss ds
1 835 par les missionnaires, et que dix ans plus tard, le
nombre d'exemplaires du Nouveau testament tait gal la
moiti de la population maorie. Lalphabtisation avait eu
un efet tout fait nfaste sur le maori, mpris, de sur
crot, par la population blanche, et en voie d'tre entire
ment chass par l'anglais. Cependant, un sursaut national
eut lieu dans les annes 1 970, c'est--dire une date qu'on
aurait pu croire trop tardive, tant le maori tait alors
malade : sur les 300 000 membres de cette nation, un quart
environ se servaient de leur langue, et les enfants ne
l'apprenaient plus. Les Maoris rclamrent ofciellement
la cration d'coles enseignant exclusivement leur idiome
FA e TE URS D E MA I N T I E N E T L U T T E. . . 245
veraculaire. la fin des annes 1 980, six coles primaires
et secondaires frent cres, dans lesquelles le maori est la
principale langue d'instruction. Ds 1 982 avait commenc
d'tre appliqu un programme d'immersion, dans lequel
1 3 000 enfants se trouvaient intgrs en 1 994. Il y avait
alors 400 kohanga reo, c'est--dire nids de langues o
6 000 enfants, environ, apprenaient le maori. Ce pro
gramme est donc, en quelque mesure, un succs. Certaines
circonstances sont favorables. D'une part, le maori est
aujourd'hui la seule langue indigne de Nouvelle-Zlande,
et sa promotion n'entre donc pas en concurrence avec
d'autres entreprises. D'autre part, il existe une volont
afne des Maori de ranimer leur langue et de ne pas la
laisser disparatre, dans la mesure o elle exprime des
valeurs qu'a perdues, selon eux, la socit blanche, et aux
quelles ils sont attachs, notamment la tolrance et la
solidarit.
La lutte pour le hawaen
Il s'agit ici encore d'une entreprise trs rcente.
Lexemple du maori a inspir les membres de la commu
naut hawaenne, dcids tout tenter pour sauver leur
langue au bord du gouffe. Car Hawa est un des 50 tats
amricains, et il est facile d'imaginer ce que cela signife
pour une langue minoritaire, comme l'est le hawaen dans
son propre pays. Initialement, les tablissements d'immer
sion pour enfants d'ge prscolaire taient une initiative
prive, dirige par un professeur d'universit. En 1 987, les
trois qui existaient furent reconnus par le ministre
hawaen de l'ducation, et reurent un fnancement d'tat
(cf. Zepeda and Hill 1 99 1 ). Les promoteurs parvinrent
mme obtenir une dispense quant aux diplmes pure
ment pdagogiques qui sont requis pour enseigner, car le
pouvoir voulut bien convenir que l'urgence ne justifait pas
une telle prcaution, le recrutement de personnes tout sim
plement capables de parler aux enfants et de les instruire
246 HA L TE A L A M 0 R T DE S L A N G UE S
travers ce dialogue n'allant dj pas de soi pour une langue
moribonde. On s'eforce nanmoins de former des matres,
afn que cet enseignement soit tendu aux grades sup
rieurs, au moins jusqu'au collge. On se heurte, sur ce
point, un obstacle qui apparat de manire rcurrente
pour les langues menaces d'extinction : face aux enfnts,
dont on s'vertue forer un nombre croissant, les seuls
locuteurs naturels du hawaen sont les plus gs, en
nombre assez faible et disparaissant progressivement.
Pour rpondre ce df, on invite les parents apprendre
la langue en mme temps que leurs enfants, et tenter de
la parler avec eux dans leurs foyers ; on leur ofre des cours
pour adultes. En 1 987, une quinzaine d'enfants entre deux
et cinq ans parlaient le hawaen.
Les tribultions de l'rlandis
Je n'insisterai pas ici sur ce point, dj trait ailleurs
(cf. Hagge 1 994, 242-245). Je rappellerai seulement l'exis
tence des gaeltachtai, c'est--dire les zones, toutes situes
la priphrie dans les comts de l'ouest (abris historiques
des Celtes), o les modes de vie traditionnels ont maintenu
l'usage de l'irlandais, et o il est le vecteur de l'enseignement
dans les coles. Ce sont les seuls conservatoires vivants de
cette langue. Deux facteurs ont conjugu leurs effets pour
rendre trs difcile une vritable restauration : la politique
britannique d'limination de l'irlandais, conduite durant
plusieurs sicles partir du xe, et bien entendu le prestige
universel de l'aglais dans le monde contemporain.
L langues d Sibrie
Plusieurs langues de Sibrie font l'objet, depuis
quelques annes, d'un effort d'introduction l'cole l
mentaire parmi les matires d'enseignement, dans les
rgions o ces langues se parlent. Il s'agit du yukaghir, du
nivkh, de l'ulch, du selkup, du kt. Il est trop tt pour
FA C T E U R S D E MA I N TI EN E T L U T TE . . . 247
savoir quels rsultats produira cette politique, applique
des langues en fort mauvaise sant, parles par des popula
tions disperses, et depuis longtemps fortement russifes.
L'OFFICIALISATION
Langue ofciell et langue national. Du luxembourgeois
et du rhto-romanche
Une reconnaissance ofcielle par l'tat signife, en
fait, l'inscription d'une langue dans la Constitution de cet
tat. On rpute ofcielle une langue que la loi soutient,
que l' tat a le droit d'utiliser dans ses relations diploma
tiques, et dans laquelle tout citoyen est habilit
demander toute prestation, judiciaire, de services, etc. Les
langues nationales ne sont pas ncessairement ofcielles,
bien qu'on leur accorde une reconnaissance de facto. Tel
est le cas, au Luxembourg, du luxembourgeois, dialecte
moyen-allemand du groupe fancique mosellan, qui est la
langue de la famille, des affaires et des tribunaux, et
auquel sont attachs les habitants, comme la marque
mme de leur personnalit, sans avoir, pour autant, choisi
de l'ofcialiser, attribuant ce statut au fanais, et assi
gnant une place culturelle i mportante l'allemand.
Lensemble form par les parlers rhto-romanches des
Grisons est aussi langue nationale en Suisse, mais non
langue offcielle, ce qui implique simplement un soutien
fnancier du canton et de la Confdration (cf. Hagge
1 994, 1 54- 1 55) . Beaucoup de langues domines, ne jouis
sant pas du statut de langue nationale, pour ne rien dire
de celui de langue ofcielle, ont men un long combat
pour la reconnaissance. J'ai soulign plus haut que dans
l 'Union nienne, ce combat a abouti, pour certaines, la
reconnaissance d'un tat ou d'un Territoire, organis
autour d'un grand centre urbain.
248 HA L TE A L A M 0 R T D ES LA N G UE S
Timids balbutiements en Amrique du Nord
Qu'une langue, quelle qu'elle soit, autre que l ' anglais,
et, au Qubec, le franais, reoive un statut de reconnais
sance ofcielle en Amrique du Nord n'est videmment pas
concevable dans le contexte poli tique et culturel
d'aujourd'hui . On n'en aura que plus d'intrt pour les cas
rcents et trs isols de deux territoires canadiens. Les
North Territories ont accord un statut offciel, ct de
l'anglais et du fanais, aux langues des communauts
indiennes. Il resterait savoir dans quel tat sont actuelle
ment ces langues. On peut en avoir une ide quand on sait
qu'une autre mesure positive a t prise, il y a peu, par un
second teritoire, le Yukon, qui, sans reconnatre de statut
ofciel aux langues indiennes, dclare que leur prsera
tion est un but explicite.
Les luttes ds lngues pour l reconnaissance
en Amrique latine
LAmrique latine est un cas trs reprsentati f de ces
luttes pour l a reconnaissance, conue comme un moyen de
rsister l'espagnol et de ne pas le laisser supplanter les
langues autochtones jusqu' leur extinction. Les rsultats
sont ingaux, comme on va le voir.
Le nahuatl, l'aymara et
l
e quetchua dans l'impasse
ne prendre en compte que les langues parles par
plus d'un million de locuteurs, ni le nahuatl , ni l'avmara
n'ont obtenu de statut ofciel, au Mexique pour le prmier,
en Bolivie, au Prou ou en quateur pour le second. Le
quetchua, pour lequel a t cre au Prou, en 1 953, une
Acadmie au rle surtout symbolique, a connu une brve
priode d'clat dans ce mme pays lorsque, en 1 975, le
gouverement militaire du gnral J. Velasco Alvarado l'a
F A CTE URS D E MA I l T l EN E T L UT TE. .
249
dclar seconde langue ofcielle ct de l'espagnol, par
un dcret dont aucun travail pralable de promotion et
d'explication n'avait prpar ni rendu possible l'applica
tion, sans compter que le renversement du rgime l'anne
mme de la promulgation de ce dcret l'a fapp de nullit.
Cette situation est proccupante. Car bien que le
nahuatl, l'aymara et l e quetchua ne paraissent pas tre
menacs pour le moment si l'on retient le crtre du
nombre de locuteurs, l'audience mondiale de l'espagnol
fait de ce derier, aujourd'hui comme hier, un rva redou
table pour ces langues. C'est ce qu'ont bien comprs tous
ceux qui ont lutt et continuent de lutter pour une recon
naissance offcielle de ces langues dans les pays o elles
ont une relle importance dmographique.
Le guarai dans
l
a g
l
oire
Seul le guarani a t jusqu'ici l e vainqueu de ce
combat. Il tait favors, certes, par un long pass de pro
motion dans son pays de difsion principale, le Paraguay.
Lhistoire est assez exemplaire pour valoir d'tre rappele
dans ses grands traits. Ds le milieu du Xe sicle avait t
institu le rgime de l'encomienda, ou rpartition des
Indiens et de leurs teres aux colons espagnols. Entre ces
deriers, dus de n'avoir rencontr que les moiteurs et les
vipres du Chaco sur l a route qui devait les conduire aux
profusions d'or du Prou, et la population indienne sou
mise, et bientt asservie, la priode est, certes, celle d'un
mtissage gnral, qui est la base de la socit para
guayenne d'aujourd'hui . De plus, les colons connaissaient
souvent le guarani. Mais ils exploitaient les Indiens et mul
tipliaient les abus, eux-mmes gnrateurs de rvoltes, si
bien que la couronne espagnole, recherchant une issue la
crise, institua le systme des Rductions, ou regroupement
des Indiens sur de grandes terres autour d'un centre urbain,
sous l'autorit des missionnaires (cf. Villagra-Batoux 1 996,
1 83-2 1 8). L, les Indiens sont rduits vassaux du roi,
250 HA L TE A LA M 0 R T DES L A N G UE S
mais aussi sauvs de la servitude par les prtres, qui, pour se
donner les moyens de les vangliser, les isolent des exploi
teurs, c'est--dire d'une partie de la socit espagnole. Ils
sont ( invits cesser d'tre nomades, paens, pares
seux . Ils sont d'abord dirigs, ds 1 575, par les Francis
cains, puis, partir de 1 605, par les Jsuites.
Il se trouve qu'au mme moment, dans le dbat qui
gagnait les cours europennes sur les langues utiliser
pour christianiser, les Jsuites prenaient position en faveur
des veracularistes plutt que des latinistes . Ils y
taient encourags par le roi Philippe II lui-mme, qui,
plus tolrant sur ce point que son pre, recommandait de
ne pas contraindre les Indiens abandonner leurs l angues
pour le castilan brutalement impos. La consolidation des
Rductions, l'troite relation entre missionnaires et
Indiens, et les besoins de l'vanglisation se substituant
aux mauvais traitements sous le rgime prcdent, eurent
pour efet de rendre indispensable la matrise du guarani,
et conduisirent une politique linguistique assez diff
rente de celle que d'autres Jsuites adoptaient au Mexique.
Le guarani occupa bientt une place quasiment gale
celle de l'espagnol dans la vie civile.
Vu le contexte culturel de l'poque, marqu par le
pass et par l'histoire du latin, cela signifait aussi l'accs
l'criture, situation d'autant plus tonnante que l'imposi
tion du castillan tait vcue comme celle d'une langue qui
avait ravi au latin, mais en mme temps hrit de lui, le
prestige d'tre crite. Les Jsuites, s'prenant vritable
ment du guarani, langue belle et subtile, lui donnrent la
dignit littraire d'un idiome indien cultiv. Finalement, ce
guarani jesuitico fut mme promu par eux seule langue
ofcielle dans toute la Province. Il demeura, sous leur
rgime, seule langue d'enseignement, pour toutes les
matires scolaires. Conservant le systme de transcription
graphique du frre dominicain Luis de Bolafos, ils frent
aussi pour le guarani ce qui assure tant de langues euro
pennes un statut solide, et dont j'ai dit plus haut combien
FA CTE U R S DE MA I NT I EN E T L U T T E . . . 25 1
le manque est prjudiciable : un travail de normalisation,
fxant une forme de la langue qui, parmi les variantes dia
lectales, sera celle qui fera autorit.
I.ge d'or prend fn avec le dpart des Jsuites, et une
nouvelle priode s'ouvre la fn du XVne sicle, qui aboutit,
vers le milieu du XIXe, une tout autre politique : le mercan
tilisme libral, soucieux d'ouvrir le Paraguay la moderit
et aux modes de production du capitalisme europen,
s'empresse de bannir le guarani de l'cole secondaire et de
promouvoir l'espagnol seul. Mais un nouveau paradoxe du
bel et dramatique destin du guarani fut sa renaissance
partir de 1 870, en raction la terrible Guerre de la triple
alliance, tentative de gnocide de la population de ce pays
par ses voisins d'Argentine, du Brsil et d'Urguay, inquiets
de ses progrs conomiques et excits contre lui par la
Grande-Bretagne. l'intention de gnocide s'ajoutait celle
de linguicide : un reprsentant des intrts des
tats-Unis
recommandait l'extermination des Guaranis et de leur
langue diabolique } (Villagra-Batoux 1 996, 276-277).
Durant la plus grande partie du xe sicle, et notam
ment sous la dictature militaire qui, succdant d'autres,
gouvera le pays de 1 954 1 989, le guarani fut loin de
connatre, ni l'cole ni dans la vie publique, l 'clat qu'il
avait connu de 1 575 1 768. C'est pourquoi il convient de
considrer l'vnement de 1 992 comme une rvolution
autant que comme un accomplissement : l'article 1 40 de
la nouvelle Constitution dclare le guarani langue ofi
cielle du Paraguay ct de l'espagnol, cependant que
l'article 77 stipule l'obligation de l'ducation bilingue.
Deux ans plus tard, les travaux du Consejo Asesor de la
Refonna Educativa aboutissent l'introduction de l'duca
tion bilingue dans la totalit des coles du Paraguay, fai
sant de ce pays le seul d'Amrique latine, jusqu' prsent,
avoir donn un tel statut une langue amrindienne.
Malgr le nombre de locuteurs, cette nouveaut est
consi drer comme un facteur de lutte ncessaire, car
dans le contexte du monde moderne, toutes les langues
252 HA L TE A L A MOR T DES L A N G UES
amrindiennes, sans exception, sont exposes au prl de
disparition.
11 n'est pas indifrent d'ajouter que dans un pays peu
loign du Parguay, les langues indiennes n'ont pas joui
du mme privilge. LUruguay est un pays sans Indiens,
seul dans ce cas parmi tous ceux d'Amrique latine, car les
populations d'origine y ont t extermines, en particulier
les Cha11as, que le gnral Rivera attira dans un guet
apens meurtrier en 1 83 1 . Pourtant, les traces de langues
indiennes y sont nombreuses, commencer par celles qui
s'observent dans son nom mme, qui est guarani (dans
cette langue, urugu signife V escargot ) et y feuve }).
On doute, aujourd'hui , que toutes les langues d'Uruguay
soient apparentes au guarani, dont l a prsence dans l a
toponymie pourait tre due celle d'un grand nombre de
Guaranis, qui quittrent les Rductions des Jsuites aprs
l'expulsion de ces deriers (cf. Pi Hugarte 1 998). Mais on
est sr qu'il y eut de nombreuses tribus indiennes de chas
seurs, dont les langues ont disparu avec leurs locuteurs,
qu'il s'agisse du Iule, du vilela, auxquels on rattache parfois
le cha11a ainsi qu'une langue galement disparue, le
chan, ou de toutes celles dont on n' a d'autres traces que
de brefs vocabulaires tablis par des missionnaires.
L
'
IMPLICATION DES LOCUTEURS
Par implication des locuteurs, i faut entendre aussi
bien la sensibilisation des locuteurs entreprise du dehors,
que J 'engagement spontan de la communaut en faveur
de la promotion de sa langue menace. C'est donc d'une
uvre, ncessairement artifcielle pour une part, de rani
mation ou de revitalisation qu'il s'agit ici.
Les programmes de ranimation de langues sont
nombreux de par le monde, raison mme de la prise de
conscience des risques encourus par beaucoup d'entre
FA C T E U R S D E MA I N TI E N E T L U TTE . . 253
elles. J'examinerai ici quelques exemples d'Amrique du
Nord et d'Amrique latine.
tats- Unis et Canada
" US English ^ et les ractions indiennes
En Amrique du Nord, un des continents o les
langues autres que l'anglais sont le plus menaces, la prse
de conscience des indignes a t favorise, en quelque
mesure, par un assez curieux phnomne. Les tats-Unis,
comme on sait, n'ont pas de langue(s) ofcielle(s) (tradi
tion de pragmatisme anglo-saxon , comme aiment
dire les gourmands de lieux communs ?), et l'anglais n'y
possde un statut d'crasante domination que selon la cou
tume, et non selon la loi. Du moins jusqu'au milieu des
annes 1 980. En effet, depuis lors, un mouvement dit US
English , initialement issu, en 1 983, d'une organisation
(raciste ?) de parents hostiles l' immigration, a commenc
d'agir.
Fort de nombreuses adhsions travers tout le pays, ce
mouvement pousse les tats lgaliser l'anglais comme
langue ofcielle, en attendant qu'il obtienne ce statut au
niveau fdraL Son dessein explicitement proclam est
d'empcher l'institutionnalisation des langues d'migrs
en concurence avec l'anglais . Il se trouve qu'un aspect du
programme d'US English prsentait la prservation des
langues amricaines autochtones comme une obliga
tion intellectuelle ) l'gard de ces langues, qui ne sont
parles nulle part ailleurs au monde (cf. Zepeda and Hill
1 991 ). Or paradoxalement, cet aspect n'ayant, volontaire
ment ou non, reu aucune publicit, les communauts
indiennes ne retinrent d'US English qu'un fait : en s'oppo
sant au fnancement des programmes d'ducation bilingue,
ce mouvement menaait les langues amrindiennes.
C'est ainsi qu'US English a t le moteur indirect
d'une floraison d'initiatives prises, en faveur de leurs
252 HA L TE A LA MOR T DES L A N G UES
amrindiennes, sans exception, sont exposes au pril de
disparition.
Il n'est pas indifrent d'ajouter que dans un pays peu
loign du Paraguay, les langues indiennes n'ont pas joui
du mme privilge. LUruguay est un pays sans Indiens,
seul dans ce cas parmi tous ceux d'Amrique latine, car les
populations d'origine y ont t extermines, en particulier
les Chamias, que le gnral Rivera attira dans un guet
apens meurtrier en 1 83 1 . Pourtant, les traces de langues
indiennes y sont nombreuses, commencer par celles qui
s'obserent dans son nom mme, qui est guarani (dans
cette langue, urugud signife escargot et y feuve ).
On doute, aujourd'hui, que toutes les langues d'Uruguay
soient apparentes au guarani, dont la prsence dans l a
toponymie pourrait tre due celle d'un grand nombre de
Guaranis, qui quittrent les Rductions des Jsuites aprs
l'expulsion de ces deriers (cf. Pi Hugarte 1 998). Mais on
est sr qu'il y eut de nombreuses tribus indiennes de chas
seurs, dont les langues ont disparu avec leurs locuteurs,
qu'il s'agisse du Iule, du vilela, auxquels on rattache parfois
le chamia ainsi qu'une langue galement disparue, le
chana, ou de toutes celles dont on n'a d'autres traces que
de brefs vocabulaires tablis par des missionnaires.
L
'
IMPLICATION DES LOCUTEURS
Par implication des locuteurs, il faut entendre aussi
bien la sensibilisation des locuteurs entreprise du dehors,
que l'engagement spontan de la communaut en faveur
de la promotion de sa langue menace. C'est donc d'une
uvre, ncessairement artifcielle pour une part, de rani
mation ou de revitalisation qu'il s'agit ici.
Les programmes de ranimation de langues sont
nombreux de par le monde, raison mme de la prise de
conscience des risques encounlS par beaucoup d'entre
FA e TE URS D E MA I N T I E N E T L UT TE. . . 253
elles. J'examinerai ici quelques exemples d'Amrique du
Nord et d'Amrique latine.
tats-Unis et Canada
" US English ^ et les ractions indiennes
En Amrique du Nord, un des continents o les
langues autres que l'anglais sont le plus menaces, la prise
de conscience des indignes a t favorise, en quelque
mesure, par un assez curieux phnomne. Les tats-Unis,
comme on sait, n'ont pas de langue(s) ofcielle(s) (tradi
tion de pragmatisme anglo-saxon , comme aiment
dire les gourmands de lieux communs ?), et l'anglais n'y
possde un statut d'crasante domination que selon la cou
tume, et non selon la loi. Du moins jusqu'au milieu des
annes 1 980. En effet, depuis lors, un mouvement dit US
English , initialement issu, en 1 983, d'une organisation
(raciste ?) de parents hostiles l'immigration, a commenc
d'agir.
Fort de nombreuses adhsions travers tout le pays, ce
mouvement pousse les tats lgaliser l'anglais comme
langue ofcielle, en attendant qu'il obtienne ce statut au
niveau fdral. Son dessein explicitement proclam est
d'empcher l'institutionnalisation des langues d'migrs
en concurrence avec l'anglais . Il se trouve qu'un aspect du
programme d'US English prsentait la prservation des
langues amricaines autochtones comme une obliga
tion i ntellectuelle l'gard de ces langues, qui ne sont
parles nulle part ailleurs au monde (cf. Zepeda and Hill
1 99 1 ). Or paradoxalement, cet aspect n'ayant, volontaire
ment ou non, reu aucune publicit, les communauts
indiennes ne retinrent d'US English qu'un fait : en s'oppo
sant au fnancement des programmes d'ducation bilingue,
ce mouvement menaait les langues amrindiennes.
C'est ainsi qu'US English a t le moteur indirect
d'une floraison d'initiatives prises, en faveur de leurs
254 HA L TE L A MOR T DE S L A NG UES
langues, par les Indiens, que motivait la crainte de voir
l'anglais devenir, travers un amendement de la Constitu
tion, langue ofcielle des
tats-Unis. Bien entendu, le
programme d'US English n'est pas la seule cause de cette
foraison. Quoi qu'il en soit, en 1 990, les organes directeurs
des tribus sioux, chippewa, ute, yaqui, havasupai, apache
et navaho, se fondant sur leur statut lgal de nations souve
raines possdant, avec les
tats comme avec les autorits
fdrales amricaines, des relations de gouverement
gouvernement, avaient adopt des mesures linguistiques,
au terme desquelles la langue indienne est rpute langue
ofcielle de la tribu, et l'anglais langue seconde. Aprs
diverses pripties, les Indiens parvinrent faire voter par
les deux chambres du Congrs un Native American Lan
guage Act, qui garantit la prservation, la protection et la
promotion des langues amricaines autochtones (y com
pris celles de l'Alaska, et en y ajoutant celles de Hawa et
des les du Pacifque ( Micronsie) sous administration des
tats-Unis), ainsi que le droit de les utiliser et d'en dve
lopper la pratique. Le gouvernement canadien avait pris
des mesures semblables prcdemment.
La ranimation du mohawk
Les principes ainsi recommands par un vote ofciel
relvent de l'idal. Ils devraient, certes, contribuer, s'ils
sont appliqus, sauver ce qui peut l'tre. Mais il est utile
d'examiner quelques cas pratiques d'implication des locu
teurs dans la dfense de leur langue gravement menace.
Je commencerai par une langue iroquoise, appartenant
une tribu dont le contact avec les Blancs remonte au
XVIIe sicle, l e mohawk. Les locuteurs de cette langue
taient connus pour leur loquence et leur got de l'l
gance verbale. Cependant, le mohawk, comme tant
d'autres langues d'Amrique du Nord, ne s'entendait
presque plus en public au dbut des annes 1 970, et seuls
les anciens s'en servaient peut-tre encore en priv. En
FA C T EU R S D E MA I NT I EN ET L U T TE . . 255
1 972, les principaux reprsentants de l a nation mohawk
qui vivaient au Qubec organisrent Kahnaw:ke un
systme scolaire d'immersion, en utilisant des manuels
confectionns par les chercheurs (cf. ci-dessous { Le rle
des linguistes ). Les adultes dcidrent de parler mohawk
entre eux. Bientt les enfants s'habiturent voir dans
cette langue un bien propre leur nation. La preuve ft
apporte que l'apprentissage du mohawk n'tait pas un
obstacle celui de l'anglais, ni celui du fanais, nces
saire au Qubec, le plus souvent, pour trouver du travail .
Beaucoup reste faire, il est vrai. Mais un seuil psycholo
gique a t franchi, et la lutte pour sauver cette langue en
perdition est bien amorce.
Le hualapai et l'exprience de Peach Springs
Une autre langue d'Amrique du Nord, le hualapai,
appartenant au groupe yu ma de la grande famille hoka
sioux, et parl autrefois dans la basse valle du Colorado, a
fait l'objet, partir de 1 975, d'un programme d'ducaton
bilingue destin contenir une progression alarmante de
l'rosion. Dans les annes 1 980, l'exprience dite de Peach
Springs, du nom de la localit de l'Arizona septentrional,
sur la fange sud-ouest du Grand canyon, o elle a t ins
talle, tait cite partout chez les Indiens des
tats-Unis.
Lorsque le programme fut lanc, prs de 50 % des Hua
lapai avaient l'anglais pour langue premire. La situation
semble s'tre amliore, mais, en dpit des efforts prodi
gus, ainsi que du dvouement et de la comptence du
personnel, la baisse rgulire du fnancement fdral
constitue un lment ngatif (cf. Zepeda and Hil 1 99 1 , 1 46).
Guatemal, Nicargua
On a v que sur la vingtaine actuelle de langues de la
famill e maya, cinq seulement, le yucatec, le quich, le
qeqchi, le kakchiquel et le mam paraissent relativement
256 HA L TE L A MO R T DES L A N G UES
valides, avec un nombre de locuteurs variant entre 400 000
et 1 000 000. Pour les consolider et pour prserver toutes
les autres, dont la situation est beaucoup plus prcaire, les
Mayas du Guatemala, aprs la guerre civile qui a ravag ce
pays au dbut des annes 1 980, ont tabli une Acadmie
s langues mayas, qui a t reconnue ofciellement par
1 Etat en 1 99 1 . Un alphabet valable pour l'ensemble de la
famille a t labor et lgalis par dcret prsidentiel. Il
existe encore d'autres institutions, qui ont pour but de
donner aux lites maya une formation linguistique, afn
qu'elles puissent organiser la normalisation.
Un cas remarquable est, au Nicaragua, celui du rama,
langue de la famille chibcha, parle au milieu des anes
1 980 par 25 personnes environ, et victime d'une profonde
dprciation aux yeux mmes de ses locuteurs, en corrla
tion avec le passage l'anglais sous l' influence des mission
naires moraves dans la seconde moiti du Xe sicle (cf.
Craig 1 992) . La Rvolution sandiniste, aprs avoir voulu
promouvoir une ducation gnrale en espagnol, s'adapta
aux demandes des populations de la cte atlantique, pour
lesquelles elle tablit un statut d'autonomie. ce facteur
favorable mais insufsant s'ajouta l'implication des locu
teurs, et en particulier d'une femme qui, s'tant prise du
rama, avait engag toute son nergie pour le prserver de
la mort. Elle n'en tait pourtant pas une locutrice de
naissance !
LE RLE DES LINGUISTES
Les linguistes, ou du moins les linguistes qui s'intres
sent aux langues concrtes travers le monde, sont nces
sairement parmi ceux que la mort des langues laisse le
moins indifrents. Ce phnomne les proccupe assez
pour tre devenu une nouvelle thmatique au sein des
tudes linguistiques, et pour faire l'objet, dj, d'un grand
nombre de travaux et de runions savantes. C'est pourquoi
FA C TE UR S DE MA I N TI E N E T L UTTE . , . 257
le rle que l es linguistes peuvent jouer dans la lutte contre
le dsastre des extinctions de langues humaines en grand
nombre et partout n'est certainement pas ngligeable. Ce
rle s'exerce sur les deux plans du travail linguistique pro
prement dit et de l'action auprs des populations de locu
teurs, comme on va le voir maintenant.
L thes ordinaires du linguiste profesionnel
et le tribut au terain
Les travau savants
Comme toute science, la linguistique propose des
modles thoriques. Mais elle doit aussi les mettre
l'preuve, sous peine de strilit. Certains linguistes ali
mentent la thorie linguistique de sa propre substance
indfniment dglutie. D'autres, eux aussi linguistes profes
sionnels et donc thoriciens, pratiquent et dfendent une
linguistique des langues, la fois comme pralable et
comme aboutissement d'une recherche des traits linguis
tiques universels, ainsi que d'une linguistique du langage.
Cela suppose un afontement des ralits de beau
coup de langues, notamment travers des sjours sur l e
terrain. Et l comme dans le l ieu o il se retire pour rfl
chir et composer, les tches ordinaires qui attendent le
linguiste sont multiples. Il doit, sur la base des lments
appris auprs de ses informateurs, rdiger une phono
logie, une grammaire, un dictionnaire, un recueil de
rcits traditionnels ou plus gnralement de littrature
orale, qu'il transcrira, quand la langue n'a pas de systme
reconnu d'criture, selon un mode de graphie qu'il lui
appartient de fxer lui-mme, avec l'assistance des plus
motivs parmi ses informateurs. Cet aspect orthogra
phique de sa tche met en pleine lumire l'importance du
concours qu'il est cens apporter aux populations. Car
l'orthographe qu'il labore et qui , en gnral, ayant un
258 HA L TE . L A MO R T DES L A N G U E S
but scientifque, ne notera que ce qui est distinctif parmi
les sons et non chacun des dtails de toute production
sonore, est souvent prise par les informateurs comme
modle pour rpondre leurs propres besoins de mise en
criture.
Lurgence du combat contre le temps
Le linguiste qui sait qu'une langue est menace est
plus particulirement incit en faire la description que si
elle est parle par des locuteurs trs nombreux et de tous
ges. C'est une tche douloureuse autant qu'exaltante que
de recueillir sur les lvres d'un vieillard les derires
phrases qu'il peut encore produire d'une langue qu'il ne
consent pas facilement parler, car il n'a plus d'interlocu
teur naturel avec qui la partager. Et frquemment, le
linguiste sait que lors de son prochain sjour, le vieil infor
mateur ne sera plus l pour lui transmettre ce dont il se
souvenait encore. Pl us une langue menace est isole sur le
plan gntique (c'est--dire dpourvue de parentes au sein
d'une mme famille linguistique), et en outre plus elle est
isole sur le plan typologique (c'est--dire seule tmoin du
type de structure, phonologique, grammaticale ou lexicale,
qu'elle illustre), plus il est urgent de la dcrire avant qu'elle
ne meure.
Mais la description qu'en fera le linguiste ne servira
pas seulement la science. Ce serait dj un motif bien suff
sant pour agir au plus vite, que la prise de conscience d'une
dramatique ralit : la linguistique pourrait bien, si les lin
guistes ne se htent pas d'aller explorer les trs nom
breuses langues encore inconnues qui sont menaces de
mort, tre la seule science qui aura tranquillement laiss
disparatre 50 % 90 % du matriau sur lequel elle
travaille ! Pour ne prendre qu'un exemple des tches qui
restent accomplir il suft de dire que sur les quelque 670
langues d'Indonsie, en dpit des nombreux et bons tra
vaux qu'ont accomplis les linguistes de Leyde et d'autres
FA CT EU R S D E MA I N TI E N E T L UTTE . . . 259
universits des Pays-Bas l'poque o le pays tait une
colonie nerlandaise, 6 % seulement sont connues d'une
manire satisfaisante. Mais cette raison imprative d'agir
en toute hte s'en ajoute une autre : les travaux que laisse
le linguiste sont les seuls tmoignages existants sur une
langue, dans les cas, nombreux, o elle n'a jamais t
dcrite avant qu'il ne vienne sur place pour ]' tudier. Sans
les travaux du linguiste, une langue inconnue avant lui et
en voie d'extinction s'engoufferait dans l'oubli, et avec
elle, toute la culture qu'elle exprime.
Lminente vocation des tmoignages et supports :
livres, enregistrements sonores, Interet
C'est pourquoi le travail de linguiste revt une si haute
signifcation. Il est le germe d'une rsurrection possible.
En d'autres termes, s'il ne sauve pas de l'extinction une
langue qui en est gravement menace, il procure les l
ments qui peuvent permettre de lui redonner un souffle,
condition qu'un vouloir puissant se manifeste pour la res
taurer. On pourrait soutenir, videmment, que les travaux
laisss par le linguiste confrent la langue teinte un
profl de conservation qui est celui d'un objet de muse.
Mais il faut rappeler qu'en dehors des livTes qu'il crit, tout
linguiste, en principe, se sert aussi d'enregistrements
sonores. Certes, ces supports sont aussi matriels et peu
vent un jour se dgrader, mais leur dure de vie est, quoi
qu'on dise, assez longue, et ils peuvent beaucoup pour
ceux qui seront dtermins s'en servir. Leur nombre
s'enrichit aujourd'hui d'un nouvel apport : les sites sur
Interet, dont je parlerai en conclusion de ce livre.
La part prise l'efort de standardisation
Les linguistes sont souvent sollicits par les respon
sables de la politique des langues, en particulier dans les
pays plurilingues, pour donner leur opinion ou leurs sug
gestions quant au travail, souvent ncessaire, de mise au
260 HA L TE A L A / 0 R T DES L A N G UE S
point et de promotion d'une norme dialectale surlombant
des parlers disperss. Il arrive qu'un tel travail favorse la
survie d'une langue menace. Ainsi, les langues kheokoe,
autrefois appeles hottentots , d'Union sud-africaine et
de Namibie ont t rduites la portion congrue par deux
sicles de politique coloniale, depuis l'poque (fn du
XVIIe sicle) o la Compagnie des Indes Orientales com
mena d'imposer l e nerlandais aux Aficains, dont les
intressantes langues consonnes claquantes (prononces
par jection du soufle : cf. p. 22 1 -222) taient tenues par
les colons pour purs borborygmes et hoquets de sauvages.
Aujourd'hui, les seuls survivants de cette famille lin
guistique sont le nama et l e damara, assez proches l'un de
l'autre. Bien qu'ils soient encore parls par quelque
125 000 locuteurs, ils sont mis en danger par la pression de
l'afrikaans et de l'anglais (cf. Haacke 1 989). Seule l'action
des linguistes pourrait, en recommandant une standardi
sation, favoriser la survie du nama, le plus rpandu des
deux, que beaucoup d'usagers abandonnent avec l'ide
qu'il n'a pas de prestige, du fait de cette dispersion en deux
langues proches, et qu'ils sont donc mis par lui en mau
vaise position sur le march de l'emploi.
Le linguiste a souvent aussi pour tche l a nologie.
Que les locuteurs le lui demandent explicitement ou qu'il
en ressente lui-mme la ncessit, il doit, en fonction des
besoins d'adaptation du vocabulaire et de ce qu'il sait des
rgles de formation des mots dans la langue qu'il tudie,
proposer des termes nouveaux. Les linguistes qui se sont
rendus dans des pays lointains pour y dcrire des langues
savent aussi que parfois, les autorits politiques les invi
tent apporter un concours technique l'uvre d'difca
tion d'une terminologie modere dans de nombrelx
domaines.
FA C TE URS D E MA I N TI EN E T L UTTE . . 261
L action auprs ds locuteurs
Laide la prise de conscience
On remarque que le plus souvent, les locuteurs ne
prennent conscience du pril o se trouve leur langue que
lorsqu'il est trop tard pour qu'une action efcace puisse
tre entrepri se. Le linguiste, qui reconnat les signes de
prcarisation et d'obsolescence (cf. chap. VI), a pour devoir
d'avertir le plus tt possible les locuteurs du processus qu'il
observe. La plupart des linguistes le comprennent, qui
assistent activement les populations, quand celles-ci ont
dcid d'chafauder un programme d'ducation bilingue
pour sauver leur langue. Le linguiste les aide, alors, l a
respecter et en tre fers.
Une des meilleures faons de favoriser l a prise de
conscience est tout simplement de former des linguistes
professionnels pari les locuteurs. C'est encore une tche
qu'accomplissent de nombreux linguistes, confant l a
poursuite de l'entreprise, quand ils quittent dfnitivement
un terain, et mme quand ils ont le projet de s'y rendre de
nouveau, des informateurs bien entrans, qui joignent
leur aptitude de descripteurs l'avantage d'tre eux-mmes
locuteurs de naissance. Le linguiste tranger qui poursuit
un travail scientifque a l'intention de le soumettre ceux
qui, dans son pays, le jugeront. Il est donc soucieux de sa
promotion universitaire. Mais il a le devoir de se soucier
aussi des populations, et non pas seulement des spcia
listes autochtones auxquels il a transmis son savoir tech
nique. C'est pourquoi il importe qu'il rende lisibles, au
moins pour une part, les descrptions qu'il rdige, mme si
l'on doit admettre qu'il ne puisse se dispenser d'une termi
nologie de mtier. Beaucoup de linguistes de terrain qui
conduisent leurs enqutes sur des langues menaces lais
sent galement aux autochtones des manuels qu'ils ont
rdigs en vue de l'enseignement aux enfants. Ainsi, par une
262 HA L TE A L A M 0 R T DE S L A N G UE S
sorte de paradoxe, les meilleurs informateurs fournissent
la matire, et c'est le linguiste qui, form pour l'interprter
et la systmatiser, la ressert comme tereau d'enseignement
la masse des autochtones en voie d'oublier leur langue !
Souvent, les locuteurs qui n'ont pas les moyens de lancer un
programme de ranimation de leur langue en danger, appr
cient que le linguiste laisse une description, destine
empcher qu'elle ne soit oublie. Tel est le cas, par exemple,
des Yimas de Papouasie-Nouvelle-Guine.
Laide la ranimation
Dans certains cas rares, mais attests, l'action de lin
guistes joue un rle important, en contribuant ranimer
une langue en dshrence. Lurat, langue papoue de la pro
vince du Sepik orental, en Nouvelle-Guine, tait en voie
d'tre abandonn au bnfce du tok pisin. Mais les lin
guistes qui ont exerc leur activit dans cette rgion ont
tant fait pour revaloriser l'urat aux yeux des usagers, qu'il
connat une sorte de nouvelle floraison. Un autre cas est
celui de l'atacamefo, autrefois parl dans la rgion dser
tique du mme nom, au nord du Chili. Sans parvenir
rintroduire dans l'usage quotidien cette langue, qui tait
moribonde ds la seconde moiti du X' sicle, les cher
cheurs trangers l'ont rendue de nouveau estimable ses
propres usagers, qui l'abandonnaient pour l'espagnol, au
point qu'aujourd'hui, beaucoup d'indignes peuvent pro
duire des mots et expressions si on le leur demande
(cf. Adelaar 1 99 1 , 50). Tant il est vrai qu'une soHicitude
inattendue venue de l'extrieur a le pouvoir d'entretenir l a
mmoire, par l e plaisir qu'elle procure ceux qui ne
croyaient plus en leur langue.
Les exigences des Mayas
Une des attitudes les plus intressantes est celle des
Mayas du Guatemala. Trs conscients de la valeur cultu
FA e TE U R S D E MA I N T 1 E N ET L U T TE. . . 263
relIe de leur hritage, trs soucieux de se faire entendre
des spcialistes, un groupe de Mayas organisa Antigua
en 1 985 un Atelier, qui adressa trois sommations explicites
aux linguistes trangers : ne pas contribuer aux divisions
interes de chaque langue maya, ne pas isoler les l ocuteurs
lors du travai l sur leur propre langue, ne pas monopoliser
la mthodologie linguistique et les connaissances sans les
faire partager aux peuples mayas. Quatre ans plus tard,
dans un nouvel Atelier, ce mme groupe afrme que faire
de la l inguistique est un acte essentiellement politique, et
que le fnancement de telle recherche linguistique plutt
que telle autre rpond des choix politiques. Le plus dter
min des membres de ce groupe dclare ouvertement
(Cojtf Cuxil 1 990, 1 9) que le rgne ancien du colonialisme
espagnol au Guatemala a rduit les langues mayas un
statut subordonn, et les condamne mourir, en sorte que
les linguistes ne peuvent aucunement se vouloir neutres ou
apolitiques, et sont confTnts une alternative : ou bien
une complicit active avec l'ordre colonial, ou bien un
engagement en faveur d'un ordre linguistique nouveau, qui
respecte les droits de toutes les communauts.
Un dtail qui pourra surrendre concere les
exemples. Les Mayas de ce groupe n'apprcient gure que
les verbes signifant tuer ou fapper apparaissent
dans de trs nombreux exemples, et jugent que le linguiste
qui donne ces exemples offe de leur peuple l'image fort
ngative d'un ensemble d'assassins et d'tres violents. Les
Mayas qui ont reu une formation linguistique savent
pourtant bien que dans toute langue humaine o l'on
tudie le phnomne de grammaire appel transitivit, les
notions tuer } ou fapper prsentent un avantage
important : ceux qui participent ces actions peuvent tre
indiffremment un je un tu un il , etc. , et au sin
gulier comme au pluriel ; cette absence de restriction
grammaticale facilite grandement l'examen des phrases
qui sont bti es sur une structure de transitivit pure ; cette
dernire est celle o des agents (ceux qui frappent ou
264 HA L TE LA MOR T DES L A NG UES
tuent) soumettent des patients (ceux qui sont frapps ou
tus) un processus conduit jusqu' son terme, ce terme
tant mme, dans un des deux cas, la suppression du
patient ! Ce sont bien les structures syntaxiquement rv
latrices comme celle-l qui sollicitent l'attention des sp
cialistes des langues. Est-ce donc un garement, que de
s'intresser aux formes ? Les locuteurs n'admettent pas
aisment que ce soit la vocation mme du linguiste. Car
pour eux, la langue est d'abord faite pour produire du sens
partir de situations relles, plutt que d'exemples de
grammaire.
Mais les Mayas ne sont pas seuls le penser. Les lec
teurs britanniques sont tout aussi sensibles sur ce point :
la fn des annes 1 970 (cf. Sampson 1 980, 66 n. 1 ), le direc
teur d'une respectable maison d'dition retira de la vente
tous les exemplaires d'un ouvrage de linguistique la veille
de sa parution ; en effet, cet ouvrage illustrait, lui aussi, les
faits de transitivit grand renfort d'exemples o des John,
des Bill et des Mary n'avaient d'autre occupation que de
massacrer mthodiquement leur entourage ; l'diteur crai
gnit donc que les lecteurs qui portaient ces prnoms, tout
fait courants, n'eussent la tentation d'engager des pour
suites pour obtenir rparation de l'outrage qui leur attri
buait une conduite ignoble de tueurs en srie. On peut
comprendre que le linguiste soit embarrass devant ces
attitudes, si mme des locuteurs de langues qui ne sont
aucunement menaces s'opposent l'image diabolique que
donnerait d'eux, selon leur opinion, un trait de linguis
tique qui tait fort loign d'avoir une telle intention.
On ne peut esquiver le problme que posent aux lin
guistes des revendications comme celle des Mayas. Les lin
guistes sont forms la rigueur scientifque, au souci d'un
examen objectif des faits, au bannissement de toute
prise de position subjective ou normative, la recherche des
modles de phrases qui donnent le plus fdlement possible
l'image du fonctionnement d'une langue, notamment de la
relation qu'entretient le verbe avec son sujet, ainsi qu'avec
FA eTE UR S D E MA I N TI E N E T L UT TE. . . 265
son complment ventuel. Et pourtant, il demeure vrai que
la demande des populations directement conceres par
son travail ne saurait tre ignore. Le mieux qu'il puisse
faire est de leur fourir tous les instruments qu'elles rcla
ment, de leur montrer une grande attention et de faire, dans
leur intrt, le tavail le plus approfondi possible.
LA VOLONT, CHEZ LES LOCUTEURS,
D'ABANDONNER LEUR LANGUE
Un solo dans une autre tonalit
Face au concert des voix qui avertissent des prils, une
autre opinion s'est exprime, peu prs contraire, et qui
n'est probablement pas si isole. Selon cette opinion (cf.
Ladefoged 1 992), c'est du pateralisme que de vouloir faire
revenir leurs langues ceux qui ont pris le parti de s'en
carter, et il n'appartient pas aux linguistes de contrecarrer
les choix des locuteurs. En fait, ma connaissance, aucun
linguiste n'a jamais exerc de pression directe, physique
par exemple, pour contraindre les locuteurs d'une langue
en voie de disparition la parler de nouveau ; et en tout
tat de cause, l'impossibilit d'une telle conduite est assez
vidente pour en rendre risible l'vocation. J'ai analys au
chapitre VII les causes de l'extinction des langues, et il doit
apparatre clairement que ceux qui cessent de parler leur
langue n'agissent pas sous l'effet d'un caprice, qu'ils y
soient conduits par la pression des vnements, ou qu'ils
en fassent, ou croient en faire, librement le choix. S'il est
vrai que pour leurs descendants, la pratique d'une langue
qui n'est pas celle des anciens a le caractre de l'vidence,
car ils y sont ns, et ne savent du monde o rgnait l'autre
que ce qu'on leur en a cont, en revanche, une bonne part
de ceux qui vivent le changement le peroivent comme un
malheur. C'est ce qu'attestent un grand nombre de rac
tions positives au travail des linguistes.
266 HAL TE L A M 0 R T DES LA N G UE S
La dense motivations politiques ou conomiques
J'ai entendu des adversaires des langues indiennes des
tats-Unis, que je ne puis citer nommment car il s'agissait
d'anonymes rencontrs en voyage ou en mission, soutenir
que les tribus qui affectent de promouvoir ces langues,
dont elles ne se servent plus, obissent d'autres motiva
tions que purement culturelles. L'exigence de restauration
linguistique ne serait pas sincre. Il s'agirait, en ralit,
d'un tendard noble, derrire lequel s'abriteraient des
revendications conomiques, comme la possession d'un
territoire dont le sous-sol recle d'abondantes ressources.
Ou bien la dfense de la langue cacherait des vises poli
tiques, comme l'autonomie administrative d'une rgion
habite par telle ou telle ethnie. Je n'ai pas les moyens de
vrifer le bien-fond de ces dclarations. S'il devait
s'avrer qu'il en est bien ainsi dans l es faits, on ne voit pas
en quoi la promotion linguistique pourrait souffir d'avoir
t prise comme prtexte, pourvu qu'elle soit ralise. En
outre, la mort des langues indiennes d'Amrique est troi
tement lie l'expulsion violente hors de leurs territoires
traditionnels, dont furent victimes les tribus autochtones
au cours du Xe sicle. La revendication de ces territoires
ne peut que favoriser les langues indiennes.
La libert du choix
Il est exact que l'abandon d'une langue qui n'a plus,
aux yeux de ses possesseurs, ni prestige, ni valeur sur le
march de l'emploi, ni perspectives d'avenir pour leurs
enfants, est souvent dcid en pleine libert, et sans
aucune coercition. Est-il plus humain se demande
G. Mounin ( 1 992, 1 57), d'essayer de sauver artifcielle
ment des langues non viables que de vouloir maintenir en
vie par d'hroques interventions chirurgicales un patient
condamn sans espoir ? . Il va de soi que le facteur essen-
FA C TE U R S D E MA I N TI E N E T L U TTE . . . 267
tiel est la volont des locuteurs. Mais cette volont est elle
mme un rsultat. Ce dont elle rsulte, ce sont les causes
conomiques et sociales analyses au chapitre VII, et qui,
elles, ne dpendent pas de la volont de ceux qu'elles
conduisent abandonner leurs langues.
On peut certainement admettre que la mor des
langues est un phnomne aussi naturel que celle des cul
tures. Mais on doit galement comprendre qu'en perdant
sa langue, une socit perd beaucoup, et que ceux qui ont
pour vocation de dcrire les langues voient dans leur mort
celle de tmoignages prcieux de la crativit des hommes.
C'est assez pour qu'il ne soit pas illgitime de lutter contre
ce phnomne, tant qu'il est encore possible de le faire,
sans aveuglement, certes, sans outrance artifcielle, mais
aussi sans faiblesse.
Rfrences
ADELAAR, W. F H., 1 99 1 , The endangered languages problem :
South America ^, in Robins and Uhlenbeck eds., 45-9 1 .
AUROUX, S. , sous la direction de, 2000, Histoire des ides linguis
tiques, tome 3, Lhgmonie du comparatisme ^ coll. Phi
losophie et langage Lige, Mardaga.
BAD ER, F, sous la direction de, 1 994, Langues indo-europennes,
coll. Sciences du langage ^ Paris, CNRS
ditions.
BALLY, C. , 1 965 ( I re d. 1 932), Linguistique gnrle et linguistique
franaise, Bere, Francke.
BANNIARD, M. 1 992, Viva voce, Communication crite et commu
nication orale du I au IXe sicle en Occident latin , Paris,
Institut des
tudes augustiniennes.
BAUMGARTEN, J., R. ERTEL, 1. NIBORSKI, A. WIEVIORKA, dirig par
1 994, Mille ans de culture ashknaze, Paris, Liana Levi.
BERTHELOT-GUIET, Karine, 1 997, L'apport de la publicit la
langue quotidienne des locuteurs de Paris et de la rgion pari
sienne, Thse de l'
cole Pratique des Hautes
tudes,
Ie Section, soutenue sous la direction de C. Hagge.
BHATACHARJA, D. and M. V SREEDHAR, 1 994, Two decades of
Nagamese Language Refor , in Fodor et Hagge, dir,
vol. V, 1 01 - 1 22.
BrCKERTON, D. , 1 98 1 , Roots oflanguage, Chicago, Karoma.
BUKSTEIN, L, 1 995, Kaspar Hauser, ou a Fabricao da Realidd,
Sao Paulo, Editora Cultrix.
BRADLEY, D., 1 989, The disappearance of the Ugong in
Thailand in Dorian ed. , 33-40.
,
1
[
..
,
370 HA L T E L A MOR T DE S L A N G U E S
BRENZINGER, M. cd. , 1 992, Language Dea/h, Factua! and Theore
t ical Explortions \l'ith Special Reference to East-Africa, Berin 1
New York. Mouton de Gmvter.
BRIANT, P. , 1 996, Histoire de j'Empire perse de Cyrus Alexandre,
Paris, Fayard.
BRIQUEL, D. , 1 994, tmsque et indo-europen , in Bader, dir.
3 1 9-330.
'
BRIXHE, C. , 1 994, Le phrygien , in Bader, dir. , 1 65- 1 78.
BRIXHE, C. et A. PANAYOTOU, 1 994 a, Le thrace ", in Bader, dir.
1 79-203.
'
BRIXHE, C. et A. PANAYOTOU, 1 994 b, Le macdonien ", in Bader
dir. 205-220.
'
BRUNOT, E, 1 966 ( l re d. parir de 1 906), Histoire de la langue
franaise des origines nos jours, XIII tomes, Pari s, A. Colin.
BUYSSENS, E. , 1 970, La
c:1
mlunication et l'articulation linguistique,
Bmxelles, Presses Umversitaires de Bmxelles 1 Paris, PU.E
CAVET, L. J., 1 987, La guerre des langues et les politiques linguis
tiques, Paris, Payot.
CAMPBEL, L. , 1 988, compte rendu de Greenberg 1 987, Language,
64, 3, :91 -61 5.
CAMPBELL, L. and M. MITHUN eds. , 1 979, Te Languages of Native
America : llistorical and Compartive Assessment, Austin, Uni
versity of Texas Press.
CAMPBELL, L. and M. C. MU:TZEL, 1 989, The stmctural conse
quences of language death , in Dorian ed. , 1 8 1 - 1 96.
CERRON-PALOMINO, R. , 1 987, Linguistica Quechua, Cuzco, GTZ et
Centro de estudios rurales andinos Bartolom de las Casas .
CHFE, W. L. , 1 962, Estimates regarding the present speakers
of North American lndian languages ", International Joural
of American Linguistics, 28, 1 62- 1 7 1 .
CHAMOREAU, C. , 1 999, { Description du purepecha, une langue
mexicaine menace de disparition , Travaux du SELF VII,
1 3 1 - 1 46, Paris, Universit Ren-Descartes-Pars-V, U. ER. de
Linguistique gnrale et applique.
CHAVE, H. J., 1 862, Les langues el les races, Paris.
CHILDS, T., 1 997, { The status of lsicamtho, a Nguni-based urban
va r et y of Soweto }, in The structure and status of pigins and
creoles, ed. by A. K. Spears and D. Winford, 341 -367, Ams
terdamlPhiladelphia, John Benjamins.
CLAIRIS, c., 1 991 , { Le processus de disparition des langues , La
Linguistique, 27-2, 3- 1 3.
COIT- ClJXIL, D. , 1 990, { Lingstica e idiomas Mayas en Guate
mala. Lecturas sobre la lingistica Maya ", ed. by N. C. England
T
RFR E NCES . 371
and S. R. Elliou, 1 -25, Guatemala, Centro de Investigaciones
regionales de Mesoamrica.
CMI G, C. , 1 992, { A constitutional response to language endan
germent : the case of Nicaragua ", Language, 68, 1 , 1 7-24.
DARWN, c. , 1 859, The origin of species, Londres.
DECIMO, M., 1 998, ( La celtomane au XIX" sicle , Bulletivl de la
Socit de Lingu.istique de Paris, XCIII, 1 , 1 AO.
DESIT, P. , 1 993, La Revue de l inguistique et de philologie
compare ( 1 867- 1 9 1 6), organe de l a linguistique naturaliste en
France , Preprnt nr. 1 47. Katholieke Universiteit Leuven.
DESMET, P. et P. SWIGGERS, 1 993, { La nature et la fonction du
langage dans l'uvre linguistique d'Abel Hovelacque , in
{ Geschichte der Sprachtheorie : Studien zum Sprachbegriff der
Neuzeit ", sous la direction d'U. Hoinkes, Mnstersches Log
buch zur Linguistik, 4, 1 29- 148.
DIXON, R. M. W. , 1 980, The languages of Australia, Cambridge,
Cambridge University Press.
DIXON, R. M. W. , 1 99 1 , ( The endangered languages of Australia,
Indonesia and Oceania , in Robins and Uhlenbeck eds. , 229-
255.
DIXON, R. M. w, 1 998, The rise and fall of languages, Cambridge,
Cambridge University Press.
DORIAN, N. c., 1 977, ( The problem of semi-speakers in language
death ", Interational Joural of the Sociology of Language, 1 2,
23-32.
DORRf, N. c. , 1 98 1 , Language death : the life ccle of a Scottish
Gaelic dialect, Philadelphia, The University of Pennsylvania Press.
DORIAI., N. C. ed. , 1 989, Investigating obsolescence, Studies i n
Language contraction and death, coll. Studies in
.
the Social
and Cultural Foundations of Language ", Cambndge, Cam
bridge University Press.
DRESSLER, w, 1 98 1 , Language shif and l anguage death, a Pro
tean challenge for the linguist , Folia Linguistica, XV, 1 -2, 5-28.
DUBOIS, J. , 1 962, tude sur la drivation suffixale en frnais
modere et contemporain, Paris, Librairie Larousse.
DUBUISSON, M., 1 980, Toi aussi, mon fls ! , Latomus, XXI,
4, 88 1 -890.
DUBUSSON, M. , 1 98 1 , { Utraque lingua >, L'allliquit classique,
L, 1 -2, 274-286.
DUHAMEL, H. , 1 995, Pillotage, Mmoires de lecture 1 985- 1 995,
Orlans, ditions Paradigme.
DUM:D, J. -M. , 1 997, Les documents pistolaires du palais de
Mari, Paris, ditions du Cerf.
372 HA L TE L A MO R T DE S L A NG UES
FISHMAN, J . A. , 1 968, Sore contrasts between linguistically
homogeneous and linguistically heterogeneous polities , in
J. A. Fishman ed. , Language problems of developing nations,
John Wiley & Sons, Inc. , 53-68.
FISHMAN, J. A. , 1 994, Sociologie du yiddish ", in Baumgarten et
al. , dir, 427-436.
FODOR, 1. et C. HAGGE, sous la direction de, 1 983-1 994, La
rforme des langues : Histoire et avenir / Language Reform : His
tmy and Future, 6 volumes. Hamburg, Buske.
FRANou, B. , 1 980, A short history of literary Croatian, Paris,
Nouvelles ditions latines.
FRNou, B., 1 983, { The development of literary Croatian and
Serbian ", in Fodor et Hagge, dir, vol. II, 85- 1 1 2.
GAL, S. , 1 989, Lexical innovation and loss : The use and value
of restricted Hungarian ", in Dorian ed., 3 1 3-33 1 .
GEORGE, K. J. , 1 989. The reforms o f Cornish. Revival of a Celtic
language ", in Fodor et Hagge, dir . voL IV. 355-376.
GREENBERG, J. H. , 1 987, Language in the Americas, Stanford,
Stanford University Press.
GRENOBLE, L. A. and L. J. WHALEY eds. , 1 998 a, Endangered lan
guages, Cambridge, Cambridge University Press.
GRENOBLE, L A. and L. J. WHALEY, 1 998 b, Toward a typology of
language endangerment . in Grenoble and Whaley eds. , 22-54.
GUILLAUME, G., 1 969, Langage et science du langage, Paris, Nizet 1
Qubec, Presses de l' Universit Laval.
GU!DERSEN, D. , 1 983, On the development of modem
Norwegian ", in Fodor et Hagge, dir, vol. IL 1 57- 1 73.
HAACKE, W. H. G. , ] 989, ( Nama : revival through standar
dization ? }, in Fodor et Hagge, dir., vol. IV, 397-429.
HADAS-LEBEL, M. , 1 976, Manuel d'histoire de la langue hbraque,
Paris, Publications Orientalistes de France.
HADAs-LEBEL, M. , 1 980 a, El iezer Ben Ychuda et la renaissance
de la langue hbraque ", Yod (INALCOJ , 1 2, 2 1 -3 1 .
HAoAS-LEBEL, M. , 1 980 b, La scularisation des terleS religieux
dans le vocabulaire politique de l' hbreu isralien , Yod
(INALCO), 1 2, 63-68.
HADAS-LEBEL, M. , 1 992, L'hbreu, 3 000 a1lS d'histoire, Pars, Albin
Michel.
HAGGE, c., 1 973, Profl d'un parler arbe du Tchad, Groupe lin
guistique d'tudes chamito-smitiques, Supplment 2, Atlas
linguistique du monde arabe, Paris, Geuthner
HAGGE, C. , 1 975, L problme linguistique des prpositions et la
solution chinoise (avec lm essai de typologie trvers plusieurs
RF RENCES . 373
groupes de langues) , { Collecion lin
uistique
.
pL
:
bl
.
ie ar la
Socit de linguistique de Pans ", Pans/Louvam, edItIODS Pee-
.
b ' . HAGGE, C. , 1 98 1 . L comox lhaamen de Colombie
:
ltanmq
e.
Prsentation d'une langue amrndienne, i n m
rmdta, numero
spcial 2, Paris, Association d'Etudes m
ndlenne
.
.
HAGGE, C. , 1 983, ( Voies et destins de 1 actIOn humame sur les
langues , in Fodor et Hagge, dir. , vol. l. , 1 1 -68.
HAGGE, C. , 1 985, L'homme de paroles, colL Le temps des
sciences , Paris, Fayard.
HAGGE, c. , 1 987, Le franais et les sicles, Pai s, ile Jacob.
HAGGE, C. , 1 993 a, compte rendu de . M. fomle ed., Marked
ness hl Svnchrony and Diachrony, Berlm.JN
w Yor, Mouton e
Gruyter, . 1 989, Bulletin de la Socit de LmgUstlque de Pans,
UcXVIIl, 2, 34-44.
v
HAGGE, C. , 1 993 b, compte rendu de J. Cemeriki, G. Im
rt,
O. Tikhonova-Imart, Paronymes russo-Is
rbo-
.
c
oates (< anUS
et ,( faux-amis ) ), Aix-en-Provence, UmversIte ?e Provence,
1 988, Bulletin de la Socit de Linguistique de Pans, LXXXVIII,
2, 284-290.
h HAGGE, c. , 1 993 c, The Language Builder, n Essay on t e
Human Signature i n Linguistic Morp}wgenes
s, c
l l .
.
A
ster
dam Studies in the Theory and History of Lmgmstic SCience,
series IV - CUIent Issues in Linguistic Theory )) , Amsterdam!
Philadelphia, John Benjamins.
. .
HAGGE, C. , 1 994 (1 re d. 1 992), L soufe de la langue, Pans,
Odile Jacob.
HAGGE, c., 1 995, Le rle des mdiaho
.
ues d
ns a
.
langue
et dans le discours ), Bulletin de la SOCIete de Ll1gwstzque d
Paris, XC, 1 , 1 - 1 9.
1 b HAGGE, c. , 1 996 a, L'enfant aux deux langes, Paris, Odi e
.
Iao
.
'
HAGGE, c. , 1 996 b, L franais, histoire d un combat, Pans, EdI-
tions Michel Hagge.
. .
HAGGE, C. , 1 998, Grammaire et cognition. Pour une partlc
pation de la linguistique des langues
.
a
x recherches cogm-
tives }) , Bulletin de la Socit de Lingwsttque de Pans, XCIII,
1 , 4 1 -58.
1 l
'
. d ' HAGGE, c. , sous presse, ( Le multilinguisme dans a sp lere JU eo-
tunisienne )' , Actes d'un colloque ( 1 999).
.
HAGF, GE, C. et A. G. HAUDRICOURT, 1 ?78, L phonologie pan
chronique, coll. Le Linguiste ", Pans, P. U.F.
HALE, K. , 1 992, Language endangerment and the human value
of linguistic diversity ", Language, 68, 1 , 35-42.
374 HALTE L A MO R T DES LA NGUES
HALL, E. T, 1 966, The hidden dimension, New York, Doubleday
& CO
HANSEGRD, N. -E. , 1 968, TWsprakighet eller halvsprakighet ?
Bilinguisme ou semi-linguisme ? ), Stockholm, Aldusl
Bonniers.
HAUGEN, 1 989, The rise and fan of an immigrant language :
Norwegian in America , in Dorian ed. , 6 1 -73.
HEATH, S. R, 1 972, Telling tangues : language policy in Mexico,
colony ta nation, New York, Teachers College Press.
HILL, J. H., 1 987, ( Women's speech i n Mexicano ", in Philips el
al. eds., 1 2 1 - 1 60.
HILL, J. et K. HILL, 1 977, ( Language death and relexifcation i n
Tlaxcalan Nahuatl ), Interational Joural of American Lin
guistics, 1 2 , 55-69.
HOVELACQUE, A. , 1 878, La vie du langage " , in A. Hovelacque et
J. Vinson, tudes de linguistique et d'ethnographie, Paris.
HUFFINES, M. L., 1 989, Case usage among the Pennsylvania
Geran sectarians and nonsectarians , in Dorian ed., 2 1 1 -226.
HULL, G. , 1 994, A national language for East Timor , i n Fodor
et Hagge, dir. , vol . VI, 347-366.
ISEBAERT, L. , 1 994, { Le tokharien I, in Bader, dir. , 85- 1 00.
JACQUESSQN, E, 1 998, ( Lvolution et la stratifcation du
lexique. Contribution une thorie de l'volution linguis
tique ", Bulletin de la Socit de Linguistique de Paris, XCIII,
L 77- 1 36.
JAZAYERY, M. A. , 1 983, ( The modernization of t he Persian voca
bulary and language reform in Iran , in Fodor et Hagge, dir,
vol . II, 241 -267.
JOCKS, C. , 1 998, " Living words and cartoon translations : Lon
ghouse "texts" and the limitations of Engl ish , in Grenoble
and Whaley eds., 2 1 6-233.
KIBRIK, A. E. , 1 99 1 , The problem of endangered languages in
the USSR , in Robins and Uhlenbeck eds. , 257-273.
KING, R. , 1 989, ( On the social meaning of linguistic variability
in language death situations : Variation in Newfoundland
French " , in Dorian ed., 1 39- 1 48.
KLAUSNER, L, 1 935, Ifalutsei ha-dibbur ha-'ivri be'artsot ha
Gola , ( < Pionniers de ]' expression en hbreu dans l es pays de
la diaspora ") , Lesfonenu la'am, Xv, 1 -2 .
KOSZTOLANYI, D. , 1 996 ( l re d. 1 935), L'trcmger et la mort, Paris.
ditions IN FINE.
Kuss, M. , 1 992, The worl d's languages in crisis , Language,
68, 1 . 4- 1 0.
RF R ENC ES . 375
LADEFOGED, P., 1 992, { Another view of endangered l anguages J) ,
Language, 68, 4, 809-81 1 .
LAMBERT, W E. , 1 967, A social psycholog of bilingualism ",
Joural of social issues, 23, 91 - 1 09.
LANDABURU, J, 1 979, L la11gue des Andoke (Amazonie colom
bienne), Paris, Socit d'tudes Linguistiques et Anthropolo
giques de France.
LANDABURU, J. , 1 995, Las lenguas indgenas de Colombia : len
guas en peligro JJ, Rapport dactylographi de l'Universidad de
los Andes.
LAU NEY, M., sous presse, Les langues de Guyane, des langues
rgionales pas comme les autres ? " , Actes d'un Colloque
( 1 999).
LAYCOCK, D. C., 1 973, { Sepik languages : checklist and prelimi
nary classification ", Pacific Linguistics B, n 25.
LEROY, M. , 1 985, {( Honor Chave et l'difcation de la grammaire
compare , Quaderi della cattedra di linguistica dell'univer
sitl di Pisa, Serie monografca V, 209-225.
MAHAPATRA, B. P. , 1 991 , { An appraisal of lndian languages ", in
Robins and Uhlenbeck eds. , 1 77- 1 88.
MASSON, M. , 1 976, Les mots nouveaux en hbre,u modere, Paris,
Publications Orientalistes de France, col l . Etudes .
MASSON, M. , 1 983, ( La renaissance de l'hbreu , i n Fodor et
Hagge, dir. , vol . II, 449-478.
MASSON, M. , 1 986, Langue et idologie. Ls mots trangers en
hbreu modere, Paris, ditions du CNRS.
MATISOFF, J. A., 1 99 1 , Endangered languages of mainland
South-East Asia , in Robins and Uhlenbeck eds . . 1 89-228.
MEILLET, A. , 1 958, Linguistique h istorique er linguistique gnrale,
Collection linguistique publie par la Socit de l i nguistique
de Paris , Paris, Champion.
MERTZ, E., J 989, ( Sociolinguistic creativity : Cape Breton Gaelic's
linguistic "tip" " , in Dorian ed., 1 03- 1 1 6.
MUHUN, M. , 1 989, The incipient obsolescence of polys:nthesis :
Cayuga in Ontario and Oklahoma ", in Dorian ed., 243-257.
MrTHUN, M. , 1 998, The signifcance of diversity in l anguage
endangerment and preservation , in Grenobl e and Whaley
eds. , 1 63- 1 9 1.
MmlA\, P. and P. ZADOR, 1 986, Di scontinuity in a l ife cycle : the
death of Trinidad Bhojpuri ", Language, 62, 2, 291 -3 1 9.
Moss, S. , 1 985, Une l ettre indite de Gershom Scholem
Franz Rosenweig. propos de notre langue. Une confessi on ,
Archives des sciellces sociales et religieuses. 60, 1 , 83-84.
376 HA L TE LA MO R T DE S LA N G UES
MOUGEON, R. and E. BENIAK, 1 989, Language contraction and
linguistic change : the case of Welland French ^, in Dorian cd.
287-3 1 2.
'
MOUNIN, G. , 1 992. Discussion. Sur la mort des langues , L
Linguistique. 28. 2. 1 49- 1 58.
MUFWENE. S. , 1 998, Pa st and reeent population movements in
Afriea. Theil' impact on its l inguistic landscape , article pr
sent la 29'> Annua} Conference of African Linguisties, Yale
University.
MUFWENE, S. , 1 999, Language endangerment : what have pride
and prestige got to do with it ? P manuscrit.
MYERS-SCOlON, c., 1 992, ' Codeswitching as a meehanism of
deep borowing. language shift and language death i n Bren
zinger ed. , 3 1 -58.
PHILIPS, S. U. , S. STEELE and C. TAZ eds. , 1 987, Language, gender
& sex in compartive perspective, coll. Studies in the Social
and Cultural Foundations of Language )}, Cambridge, Cam
bridge University Press.
PI HUGARTE, R" 1 998, Los Indios deI Uruguay, Montevideo, Edi
dones de la Banda Oriental.
POULSEN, J. H. W, 1 98 1 , The Faroese language situation , i n
Haugen, E. , J. D. Mc Lure & D.S. Thompson eds., Minority lan
guages to-day, Edinburgh. Edinburgh University Press.
PURY-ToUMI. S. de, 1 994. Si le nahuatl avait t langue gn
rale . . . Politique linguistique et idologie nationaliste au
Mexique ^ in Fodor et Hagge, dir, vol. VI, 487-51 1 .
Ry, A, sous la direction de, 1 992, Dictionnaire historique de l
langue franaise, 2 volumes, Paris, Dictionnaires Le Robert.
ROBINS, R. H. and E. M. UHLENBECK eds .. 1 99 1 , Endangered Ln
guages, Oxford / New York, Berg.
ROSEN, H. B., 1 970, La politique linguistique, l'enseignement
de la langue et la linguistique en Isral Ariel, 2 1 , 93- 1 1 5.
ROSETI, A, 1 985, Linguistique balkanique, Bucarest, Editura
Univers.
ROUCHDY, A., 1 989, "Persistence" or "tip" in Egyptian Nubian ^
in Dorian cd., 91 - 1 02.
SAMPSON, G., 1 980, Making sense, Oxford, Oxford University
Press.
SASSE, H. J. , 1 990, Theor of language death ", Arbeits
papier 1 2, Cologne, Universitat zu KIn : Institut fur Spra
chwissenschaft.
SAUSSUR, F de, 1 878, Mmoire sur le systme primitif des voyelles
en indo-eurpen, Leipzig.
RFRENCES . 377
SAUSSURE, F de, 1 962 ( l I " d. 1 9 1 6), Cours de linguistique gn
rale, publi par C. BaBy, A. Sechehaye et A. Riedlinger Genve.
SCHILLING-EsTES, N. and W. WOLFRM, 1 999, Alterative models
of dialect death : dissipation vs. concentration . Lnguage. 75,
3, 486-521 .
SCHLEICHER, A., 1 860, Die deutsche Sprache, Leipzig.
SCHLEICHER, A., 1 865, Ober die Bedeutung der Sprache [ilr die
Naturgeschichte des Menschen, Leipzig.
SCHOLEM, G., 1 962, Von der mystischen Gestalt der Gol/l1eit,
Zurich, Rhein Verlag.
SEGAL, M. H. , 1 927, A grammar of Mishnaic Hebrew, Oxford. _
SEPfHA, H. V. , 1 977, L'agonie des Judo-espagnols, Paris, Edi
tions Entente.
SINGER, A. , 2000, Le net dlie les langues rares joural Lib-
ration, 1 2 juillet, 22.
SMITH STA, T.C. , 1 995, " El estado actual de los estudios de las
lenguas mixtecas y zapotecas P in D. Bartholomew, Y Lastra,
L. Manrique (coord. ), Panorama de los estudios de las lenguas
de Mico, tome II, 8-9, Quito, Abya-Yala.
STURLUSON, S., 2000 ( l ' rdaction 1 230), Histoire des rois de
Norvge, traduit du vieil islandais, introduit et annot par
F-X. Dillmann, coll. Laube des peuples ". Paris, Galimard.
SZULMAJSTER-CELNIKlER, A., 1 99 1 , Le yidich travers la chanson
populaire, Les lments non germaniques du yidich,
Bibliothque des Cahiers de l'Institut de linguistique de
Louvain P, Louvain-la neuve, Peeters.
SZULMAJSTER-CELNIKlER, A., sous presse, V Le yidiche in Perot,
sous la direction de, Ls langues du monde.
TORT, P. , 1 980, volutionnisme et linguistique. L'histoire naturelle
des langues, Paris, Vrin.
Tosco, M. , 1 992, Dahalo : an endangered language P, i n Bren-
zinger ed. , 1 37- 1 55.
TSITSIPIS, L. D. , 1 989, Skewed performance and full perfor
mance in language obsolescence : The case of an Albanian
variety ^ in Dorian ed., I l - t 37.
TURNIANSKY, C. , 1 994, Les langues juives dans le monde ashk
naze traditionnel `, in Baumgaren et al, dic, 41 8-426.
VAKHTIN, N., 1 998, Copper Island Aleut : A case of l anguage
"resurection" , in Grenoble and Whaley eds., 3 1 7-327.
VAUGELAS, C. F de, 1 647. Remarques sur la langue franaise.
Paris, chez la veuve Camusat.
VENDRYES, J. 1 934, La mort des langues ", in Conferences de l'ins
titut de Lil1guistique de l'Un l't!it de Pars, 5- 1 5. Paris. Boivin,
1
l
378 HA L TE LA MOR T DES L A NG UES
VILLAGRA-BATOUX, 1 996, L guarani paraguayen. De l 'oralit la
langue littraire, Villeneuve d'Aeq, Presses Universitaires du
Septentrion.
WATSON, S. , 1 989, Scottish and Irish Gaelie : the giant's
bedfellows ", in DOlian ed., 41 -59.
WHITNEY, W. D. , 1 867, Language and the study of language, Londres,
Trubner.
WURM, S. A., 1 991, Language death and disappearance : causes
and cireumstances , in Robins and Uhlenbeck eds., 1 - 1 8.
ZANANIRl, G. , 1 978, { Ben Yehuda et la renaissance de la langue
hbraque ", Sens, 1 , 3- 1 7.
ZEPEDA, O. and J. H. HILL, 1 99 1 , ( The condition of native Ame
rean languages in the United States , in Robins and Uhlen
beck eds., 1 35-1 55.
Index des notions
(sont imprims en gras le; termes et expressions introduits par l'auteur)
absorption : 1 73.
alterance des codes : 1 04, 1 05. 1 06.
240.
bilinguisme : 98. 1 32. 1 44. 1 45. 1 81,
1 83, 1 84, 1 85. 1 86, 205, 25 1 , 255.
261 , 279, 284. 286, 364.
bilinguisme d'ingalit : 98. 99.
1 05. 106, 1 36. 145.
bioprogramme : 351 .
code : 39. 1 89.
cognitif : 1 5 . 1 35, 1 55, 223. 226.
comparatisme : 33.
comptence actve : 7 1 . _
comptence nat!\
:
e : 94, 9:, 1 22.
comptence asslve. : 7 1 . 1 00.
conscience Imgulstlque : l 06, 1 16,
1 1 8. 1 22, 1 74. 1 77. 1 79. 1 93. 206,
228. 23 1 , 261 .
conscience nationale : 1 58.
_
crole : 343, 348. 350, 351 . 352. 3:3.
355.
dfaut de transmission : 96, 1 27,
1 30 201 , 204, 2 1 8.
dlabement : 96, 1 03. 105, 1 07.
1 08. 1 13. 1 17, 1 1 8, 1 24, 238.
demi-comptence : 1 1 5.
dsactivation : 1 0'.
dshrence : 96, 1 l 6, 1 1 7, 1 87, 262.
345.
5
dialecte : 79, 1 38, 1 40, 142, 1 92. 19 .
1 96, 273, 274. 324, 330, 362, 363.
diaspora : 1 9. 95. 2 1 3, 2 1 7, 290, 291 ,
292. 295, 298, 309, 3 1 6, 32 1 , 329,
334.
diglossie : 339.
double icomptence : 99.
colinguistique : 134, 229. _
crture : 1 95, 257, 258, 275, 3)8.
emprunt massif : 1 05, 1 54, 1 7 1 . 1 73,
1 75, 1 76. 2 1 5. 243. 283.
energeia : 37, 38.
enfants locuteurs : 1 47, 1 96, 202,
203.
ergon : 37. _
rosion : 96, 1 09. 1 1 8, 1 25, 25:,
fonctionnelle : 1 34.
ethnocide : 128.
expolition : 1 1 3. 11 7.
facult de langage : 17. 228.
gnocide : 1 28, 251 .
gnome linguistique : 230.
glottique : 26, 27.
guerre des langues : 98. 99, 1 01 . 1 41 .
Haskala : 299. 306. 309.
hybridation : 1 74. 242, 293. 334.
identit : 1 93. 2 1 7, 220, 231 . 323.
334. 365.
idologie : 48, 1 40. 1 44. 152, 1 53
2Y8327, 328.
impralisme : 366.
imprialisme linguistique : 143.
in situ : '5, 204, 2 13.
judo-langue : 293. 294, 31 3.
\
t
Vous aimerez peut-être aussi
- La Linguistique 2018Document129 pagesLa Linguistique 2018adamsontask73100% (1)
- Projet de Porcs en EngraissementDocument9 pagesProjet de Porcs en EngraissementAMALAMAN100% (1)
- CHAMOISEAU, Patrick. Que Faire de La ParoleDocument9 pagesCHAMOISEAU, Patrick. Que Faire de La Parolerodrigoielpo100% (1)
- La Langue Des Oiseaux À La Recherche Du Sens Perdu Des Mots (French Edition)Document279 pagesLa Langue Des Oiseaux À La Recherche Du Sens Perdu Des Mots (French Edition)natacha deer100% (1)
- Isefra Iqburen N Leqbayel N Mulud at MɛemmerDocument476 pagesIsefra Iqburen N Leqbayel N Mulud at MɛemmerMahomad AbenjúcefPas encore d'évaluation
- Bonzon P-J 03 Le Jardin de ParadisDocument153 pagesBonzon P-J 03 Le Jardin de ParadisledrogoPas encore d'évaluation
- Anatomie de L'oesophageDocument26 pagesAnatomie de L'oesophageilham bzikha33% (3)
- ParksDocument32 pagesParksFrançoisPas encore d'évaluation
- Traduction SupDocument7 pagesTraduction Supahmed aboulkacemPas encore d'évaluation
- Savoirs Naturalistes Populaires en GUADELOUPEDocument114 pagesSavoirs Naturalistes Populaires en GUADELOUPEPhytodoc100% (1)
- Exemple Document DALF C2Document12 pagesExemple Document DALF C2aller_retour100% (7)
- Blyton Enid Histoires Du Coin Du FeuDocument190 pagesBlyton Enid Histoires Du Coin Du FeugerbotteauPas encore d'évaluation
- Lymphocyte B Et BCRDocument23 pagesLymphocyte B Et BCRWalid BaghdadiPas encore d'évaluation
- Bonzon P-J 01 Le Château de PomponDocument145 pagesBonzon P-J 01 Le Château de Pomponledrogo100% (2)
- Parole Et Silence - LevinasDocument85 pagesParole Et Silence - LevinasCarlos Villa Velázquez Aldana100% (2)
- Dutilleux Ainsi La NuitDocument22 pagesDutilleux Ainsi La NuitewwillatgmaildotcomPas encore d'évaluation
- La Chanson Berbere ReverdieDocument15 pagesLa Chanson Berbere ReverdieIdir MazighPas encore d'évaluation
- PCEM1 2008 Cours 3 Col VertebralDocument44 pagesPCEM1 2008 Cours 3 Col Vertebralphilippefr100% (1)
- M. Arrivé. Saussure, Un Langage Sans VoixDocument12 pagesM. Arrivé. Saussure, Un Langage Sans Voixمختار زواويPas encore d'évaluation
- Petit Dictionnaire Des Expressions DauphinoisesDocument77 pagesPetit Dictionnaire Des Expressions DauphinoisesLaurencePas encore d'évaluation
- Naoto YuasaDocument10 pagesNaoto YuasaFabio WenoPas encore d'évaluation
- Funerailles Et Veuvage PDFDocument4 pagesFunerailles Et Veuvage PDFLoua Bertin OuahouPas encore d'évaluation
- Cruel Zelanda V-2 EditDocument63 pagesCruel Zelanda V-2 EditDark_LetterPas encore d'évaluation
- (CAPÍTULO) GAUVIN, Lise (2004) Les Littératures Francophones - Manifester La Différence + Du Carnavalesque Au Baroque + ConclusionDocument48 pages(CAPÍTULO) GAUVIN, Lise (2004) Les Littératures Francophones - Manifester La Différence + Du Carnavalesque Au Baroque + ConclusionThiago MattosPas encore d'évaluation
- Liri3 Oa tr-1Document146 pagesLiri3 Oa tr-1GabrielladeLuccaPas encore d'évaluation
- Langues Du Monde Jeu Kosmopolit-Cheucle - 2020 - Kosmopolit - LivretDocument60 pagesLangues Du Monde Jeu Kosmopolit-Cheucle - 2020 - Kosmopolit - LivretAnne Marie PauleauPas encore d'évaluation
- Dpa 2019 - PDF BDDocument2 pagesDpa 2019 - PDF BDVinicius CarneiroPas encore d'évaluation
- Aarsleff - Bréal, La Sémantique Et SaussureDocument20 pagesAarsleff - Bréal, La Sémantique Et SaussureMichael ZockPas encore d'évaluation
- Épuiser Le CorpsDocument309 pagesÉpuiser Le CorpsJosé Carlos CardosoPas encore d'évaluation
- 04 GaviardDocument7 pages04 GaviardfarahanesPas encore d'évaluation
- DMDM 2017-2018 Livret HDDocument52 pagesDMDM 2017-2018 Livret HDMan C Is a SuksPas encore d'évaluation
- Pour La Traduction Michel RiaudelDocument13 pagesPour La Traduction Michel RiaudelIvi VillarPas encore d'évaluation
- (ARTIGO) SAMOYAULT, T (2014) Vulnérabilité de L'oeuvre en TraductionDocument13 pages(ARTIGO) SAMOYAULT, T (2014) Vulnérabilité de L'oeuvre en TraductionThiago MattosPas encore d'évaluation
- Amawal Amectuh N Tussniwin N UgamaDocument50 pagesAmawal Amectuh N Tussniwin N Ugamaarbaouihussein_43698Pas encore d'évaluation
- Entre Cris Et Chuchotements.Document25 pagesEntre Cris Et Chuchotements.francisco2and2aPas encore d'évaluation
- Cournot Fondements 2Document412 pagesCournot Fondements 2Bruno De SolerePas encore d'évaluation
- Supporter L Imaginaire La Jouissance deDocument6 pagesSupporter L Imaginaire La Jouissance deGilles RobertPas encore d'évaluation
- Analyse Textuelle de L'etranger D'albert Camus - Superprof PDFDocument1 pageAnalyse Textuelle de L'etranger D'albert Camus - Superprof PDFjoel PapaPas encore d'évaluation
- Bons Baisers DecoloniauxDocument33 pagesBons Baisers DecoloniauxGdr AlexPas encore d'évaluation
- Les Sociétés Humaines Et Les Langues Comme Sources VitalesDocument2 pagesLes Sociétés Humaines Et Les Langues Comme Sources Vitalesfsoya2009Pas encore d'évaluation
- Le FR Des Jeunes Haddad PDFDocument4 pagesLe FR Des Jeunes Haddad PDFSimonaPas encore d'évaluation
- PAROLES CONVENUES Mots Et Jeux de Mots TouaregsDocument11 pagesPAROLES CONVENUES Mots Et Jeux de Mots Touaregsⴰⵖⵡⵡⴰⵖ ⵓⵣⵣⴰⵍPas encore d'évaluation
- EPAISSEUR GILLE DELEUZE ButelDocument11 pagesEPAISSEUR GILLE DELEUZE ButelannoncekikPas encore d'évaluation
- La Traduction Littéraire Source D'enrichissement de La Langue D'accueil (Wuilmart FR.)Document10 pagesLa Traduction Littéraire Source D'enrichissement de La Langue D'accueil (Wuilmart FR.)flormanacasPas encore d'évaluation
- Le Dictionnaire Des Difficultés Du FrançaisDocument680 pagesLe Dictionnaire Des Difficultés Du FrançaisAnis BeyPas encore d'évaluation
- Le Prisme Du Macrolangage RéunionnaisDocument4 pagesLe Prisme Du Macrolangage RéunionnaiscpehauaPas encore d'évaluation
- 978 2 86781 964 3 IntroDocument4 pages978 2 86781 964 3 IntroperfilstshibalPas encore d'évaluation
- Cahiers de La Méditerranée, 69 - 2004 Langage Des CitésDocument4 pagesCahiers de La Méditerranée, 69 - 2004 Langage Des CitésCarolineGarrigouPas encore d'évaluation
- CastellaniDocument8 pagesCastellaniJuan Carlos AlonsoPas encore d'évaluation
- Langage de KoltèsDocument6 pagesLangage de KoltèsAbdelillah KrimPas encore d'évaluation
- Pourquoi Parlons-Nous Français en CH?Document4 pagesPourquoi Parlons-Nous Français en CH?Mariana Giordani KostezerPas encore d'évaluation
- Proverbes Espagnols - Un Figement ImmuableDocument12 pagesProverbes Espagnols - Un Figement Immuablezekr lilaPas encore d'évaluation
- Khatibi - PDF L'écrivain de La Troisième Voie - PDF RESUMEDocument14 pagesKhatibi - PDF L'écrivain de La Troisième Voie - PDF RESUMEMed yahya BensalahPas encore d'évaluation
- Le Langage de Krishnamurti, Par Yvon AchardDocument6 pagesLe Langage de Krishnamurti, Par Yvon AchardJoop-le-philosophePas encore d'évaluation
- Parcours:: Jean-Luc LAGARCE, Juste La Fin Du Monde (1990)Document9 pagesParcours:: Jean-Luc LAGARCE, Juste La Fin Du Monde (1990)Chim Chim My Little FairyPas encore d'évaluation
- Exotisme & Post-Memoire - Texte DB (7 Avril24)Document8 pagesExotisme & Post-Memoire - Texte DB (7 Avril24)Denis BERTRANDPas encore d'évaluation
- (Art) Hybride Et Monstrueuse Textualistation Des Langues Dans Solibo Magnifique de Chamoiseau PDFDocument14 pages(Art) Hybride Et Monstrueuse Textualistation Des Langues Dans Solibo Magnifique de Chamoiseau PDFGabriel González CastroPas encore d'évaluation
- Le Pouvoir Des Fables La FontaineDocument3 pagesLe Pouvoir Des Fables La Fontainefenelon06100% (2)
- HOLDERLIN - 1956 - Les Romantiques Allemands - Ed GUERNE - PP 58 60 WebDocument5 pagesHOLDERLIN - 1956 - Les Romantiques Allemands - Ed GUERNE - PP 58 60 WebLéopold FrienckPas encore d'évaluation
- Langues Du Québec Combe 103-108Document4 pagesLangues Du Québec Combe 103-108Kirby KjongPas encore d'évaluation
- Didi-Huberman, G. - Passer, Quoi Qu Il en Coûte (Fragment)Document5 pagesDidi-Huberman, G. - Passer, Quoi Qu Il en Coûte (Fragment)Guión II UCINEPas encore d'évaluation
- Vers L'équipe de L'intime: Hélène DorionDocument5 pagesVers L'équipe de L'intime: Hélène DorionmatissechaponPas encore d'évaluation
- Michel Foucault - La Pensée Du Dehors-Fata Morgana (1986)Document39 pagesMichel Foucault - La Pensée Du Dehors-Fata Morgana (1986)maiaramonmaiaramonPas encore d'évaluation
- Présentation 1Document10 pagesPrésentation 1Franzann D.O.LPas encore d'évaluation
- Evoquer Invoquer Survivre C HALDocument24 pagesEvoquer Invoquer Survivre C HALNicolas MachiavelPas encore d'évaluation
- Muta Eloquerntia Ou Les Avatars de La RhétoriqueDocument7 pagesMuta Eloquerntia Ou Les Avatars de La RhétoriqueCezara Ripa de MilestiPas encore d'évaluation
- DeuilDocument5 pagesDeuilJorge SeguraPas encore d'évaluation
- Le ConteDocument21 pagesLe ConteAnonymous djdP36Pas encore d'évaluation
- Lang RomanesDocument6 pagesLang RomanesBAHATI DIROKPAPas encore d'évaluation
- Le Corps Et La Méthaphore Dans Les Langues Gestuelles - Danielle BouvetDocument144 pagesLe Corps Et La Méthaphore Dans Les Langues Gestuelles - Danielle BouvetFabriziaPas encore d'évaluation
- Guide des gentilés: Les noms des habitants en Communauté française de BelgiqueD'EverandGuide des gentilés: Les noms des habitants en Communauté française de BelgiquePas encore d'évaluation
- Les Expressions ImagéesDocument5 pagesLes Expressions ImagéesrromeresPas encore d'évaluation
- Vous Rencontre Shemale Je Sexy Que Fille PeuxDocument2 pagesVous Rencontre Shemale Je Sexy Que Fille Peuxcurlytradition649Pas encore d'évaluation
- Bibolo Et SavrikoDocument7 pagesBibolo Et SavrikoGeana IrinaPas encore d'évaluation
- Sylvain SalnaveDocument24 pagesSylvain SalnaveJean JerryPas encore d'évaluation
- InvertebresDocument20 pagesInvertebresFrancisco de la Flor0% (1)
- Tiré-À-Part (Chiens)Document33 pagesTiré-À-Part (Chiens)Jean-Marc LucePas encore d'évaluation
- BDQ AnatomieDocument22 pagesBDQ AnatomiebayaPas encore d'évaluation
- L'ecole LyonnaiseDocument2 pagesL'ecole LyonnaiseRay Hanna100% (1)
- OiseauDocument3 pagesOiseauКарелијаPas encore d'évaluation
- Cloche, IsocrateDocument144 pagesCloche, IsocratealverlinPas encore d'évaluation
- Spongi AiresDocument15 pagesSpongi AiresNabil holmesPas encore d'évaluation
- Gamme de Traitement LET IT GROW PDFDocument1 pageGamme de Traitement LET IT GROW PDFMarie-Eve D.BPas encore d'évaluation
- Michel Tournier - La Goutte D'orDocument7 pagesMichel Tournier - La Goutte D'orsavdenPas encore d'évaluation
- Cours FrancaisDocument31 pagesCours FrancaisBoutlikhtPas encore d'évaluation
- Les Études de Linguistique BerbèreDocument16 pagesLes Études de Linguistique BerbèreZemmouri Houssam0% (1)
- Breton TaalDocument9 pagesBreton TaaltaxanderPas encore d'évaluation
- Catalogue 2009 EnvoyéDocument13 pagesCatalogue 2009 EnvoyéraharahaPas encore d'évaluation