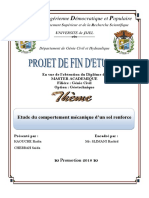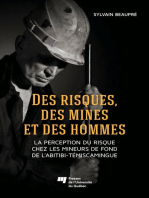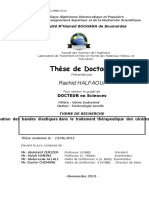Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
09-Chapitre 1 Ir PDF
09-Chapitre 1 Ir PDF
Transféré par
HabibaZenatiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
09-Chapitre 1 Ir PDF
09-Chapitre 1 Ir PDF
Transféré par
HabibaZenatiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Partie I Prsentation du problme
Partie I
Prsentation du problme
25
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Partie I : Prsentation du problme
26
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Chapitre 1
Le renforcement des sols par inclusions
rigides verticales
Partie I : Prsentation du problme
27
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
SOMMAIRE
LE RENFORCEMENT DES SOLS COMPRESSIBLES...................................................................... 29
PRESENTATION DE LA METHODE................................................................................................... 30
2.1
2.2
2.3
2.4
PRINCIPE DU RENFORCEMENT ............................................................................................................. 30
LES INCLUSIONS RIGIDES .................................................................................................................... 32
LE MATELAS DE TRANSFERT DE CHARGE ............................................................................................ 34
LES NAPPES DE RENFORCEMENT ......................................................................................................... 35
DOMAINES DAPPLICATION .............................................................................................................. 36
CONTEXTE DE LA THESE ET OBJECTIFS ...................................................................................... 37
Partie I : Prsentation du problme
28
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
1 LE RENFORCEMENT DES SOLS COMPRESSIBLES
Les sols compressibles de mauvaise qualit ont toujours exist, mais la rarfaction des sols de
bonne qualit pour dvelopper les rseaux routiers, autoroutiers et ferroviaires ainsi que les
zones industrielles entrane la ncessit de mettre en uvre des techniques de renforcement
des sols compressibles (Dhouib et al., 2004).
Il existe diffrentes mthodes de renforcement des sols compressibles, plus ou moins
anciennes et plus ou moins dveloppes. Magnan (1994) prsente un bilan des mthodes
permettant de rduire les tassements des remblais difis sur sols compressibles. Les diverses
mthodes ainsi que les principales conclusions sont reportes dans le Tableau 1. Gue et Tan
(2001) exposent les solutions gotechniques pour ldification de remblais ferroviaires sur
sols compressibles.
Parmi toutes ces mthodes, on observe depuis quelques annes en France le
dveloppement du renforcement des sols par des inclusions rigides verticales, qui peut
concerner des domaines dapplication un peu diffrents des mthodes traditionnelles . Le
principal avantage de cette mthode est sa mise en place rapide, en plus dune importante
rduction des tassements. Cette technique permet de conserver le sol compressible en place,
ce qui constitue un avantage conomique et environnemental non ngligeable.
Il existe une grande diversit dapproches de dimensionnement pour lapplication de
cette technique, mais il subsiste un manque vident sur la comprhension du fonctionnement
de louvrage. Dans un contexte de dveloppement rapide de cette mthode, il est apparu
important de mener des travaux de recherche sur ce type douvrage de renforcement.
Partie I : Prsentation du problme
29
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Technique
Donnes
ncessaires
Contrainte
Fiabilit
Commentaires
Prchargement
Compressibilit
Permabilit
Temps
ncessaire
Peu fiable pour
obtenir de faibles
dplacements
Lent
Peu cher
Prchargement
avec drains
verticaux
Compressibilit
Permabilits
verticales et
horizontales
Plus rapide
Plus flexible
Rapide
Relativement
cher
Remplacement
du sol
Epaisseur de la
couche
Mise en dpt
du sol
Nouveau
matriau
Bonne en cas de
remplacement
total
Rapide
Cher
Colonnes
ballastes,
colonnes de
sable compact
Rsistance et
dformabilit du
sol
Equipements
Plot
exprimental
Bonne aprs
analyse de plots
exprimentaux
Cher
Rapide
Bonne
Trs cher
Dalle sur pieux
Rsistance du sol
Electro-osmose
et injection
Proprits chimicophysiques
Compressibilit
Permabilit
Destruction
des lectrodes
Alimentation
lectrique
Incertaine
Trs cher
Remblai lger
Compressibilit
Permabilit
Protection du
matriau lger
Peu fiable pour
obtenir de faibles
dplacements
Cher
Bonne
Cher
Rapide
Bonne
Cher
Rapide
Remblai sur
inclusions
rigides
Colonnes de jet
grouting
Rsistance et
dformabilit du
sol
Rsistance et
dformabilit du
sol
Tableau 1 Les principales mthodes de renforcement de sol de fondation pour ldification des remblais
daprs Magnan (1994)
2 PRESENTATION DE LA METHODE
2.1 Principe du renforcement
Le principe du renforcement est illustr par la Figure 1. La charge applique en surface est
transmise un substratum rigide par lintermdiaire de la combinaison dun rseau
dinclusions rigides et dun matelas de transfert de charge.
Les inclusions rigides sont mises en place travers lhorizon compressible et permettent
de transfrer les charges vers le substratum par le dveloppement dun effort de pointe et
de frottements le long de linclusion. Des dallettes peuvent tre mises en place au niveau
des ttes dinclusion afin daugmenter la surface de reprise des charges.
Partie I : Prsentation du problme
30
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Le matelas de transfert de charge est dispos entre le sol compressible renforc par les
inclusions et louvrage en surface. Sa fonction est de rduire et dhomogniser les
tassements sous louvrage en assurant le transfert des charges vers les ttes dinclusion.
Le matelas de transfert de charge est constitu de sol granulaire. Le tassement diffrentiel
en base du matelas entre les inclusions rigides et le sol compressible induit du
cisaillement dans le sol granulaire et donc la formation de votes qui assurent le transfert
des charges vers les ttes dinclusion, lhomognisation et la rduction des tassements
en surface. La prsence de ce matelas diffrencie cette technique de celle des pieux, car
les inclusions sont dsolidarises de louvrage en surface.
Afin daugmenter le report des charges vers les inclusions, une nappe de renforcement
gosynthtique peut tre dispose en base du matelas. Le tassement diffrentiel entre les
ttes dinclusion et le sol compressible induit la mise en tension de la nappe qui contribue
au report de charge par effet membrane.
Charge applique en surface
Gosynthtique
Matelas de transfert
de charge
Dallette
Sol compressible
Inclusion rigide
Substratum
Figure 1 - Principe de la mthode
Le frottement le long des inclusions participe galement aux mcanismes de transfert
de charge. La Figure 2 prsente le comportement dun rseau dinclusions soumis un
chargement. Au niveau de la partie suprieure des inclusions, le sol compressible tasse plus
que les inclusions et entrane du frottement ngatif le long de linclusion, ce qui contribue au
report de la charge sur les inclusions. Ainsi le sol de fondation participe aux mcanismes. Au
niveau de la partie infrieure, les inclusions poinonnent le substratum qui nest jamais
parfaitement rigide, ce qui entrane du frottement positif. Au niveau de la base de linclusion
se dveloppe un effort de pointe.
Partie I : Prsentation du problme
31
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Figure 2 Rseau dinclusions soumis un chargement daprs Berthelot et al. (2003)
La Figure 3 illustre le chargement dune inclusion soumise du frottement ngatif et
du frottement positif, comme cela est propos par la mthode de dimensionnement de
Combarieu (1988), complte et dveloppe par Simon (2001) et Berthelot et al. (2003).
Figure 3 Frottement le long des inclusions daprs Berthelot et al. (2003)
Les mcanismes qui se dveloppent dans le matelas de transfert de charge et le long
des inclusions sont en forte interaction. Les tassements au niveau de linterface entre le sol
compressible et le matelas conditionnent simultanment la formation des votes dans le sol
granulaire, la mise en tension du gosynthtique ventuel et le frottement le long des
inclusions.
2.2 Les inclusions rigides
De nombreux types dinclusions rigides peuvent tre envisags suivant les proprits
mcaniques et la gomtrie de la couche compressible. Les inclusions peuvent tre
prfabriques ou construites in situ. Leur module de dformation varie entre 20 MPa (colonne
de soil mixing) et 200 GPa (pieu mtallique).
Parmi les inclusions prfabriques se retrouvent tous les types de pieux mis en place par
battage ou fonage (pieux bois, pieux mtalliques, pieux en bton arm ou prcontraint).
Lavantage des pieux prfabriqus est quils sont constitus dun matriau manufactur.
Par contre leur mise en place peut tre source de nuisances sonores ou vibratoires et dans
certains cas le refoulement latral du sol peut affecter les structures voisines.
Parmi les inclusions construites in situ on distingue essentiellement les pieux fors, les
pieux battus tubs (pieux en bton arm), les pieux de type Vibro Concrete Column
(VCC), les colonnes module contrl (CMC, Liausu et Pezot, 2001), les colonnes par
mlange dun liant avec le sol (jet grouting, Lime Cement Columns, etc.). Les techniques
Partie I : Prsentation du problme
32
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
de ralisation de ces inclusions sont dcrites par Brianon (2002) et Kempfert (2003). La
mise en uvre des inclusions in situ est plus souple que les inclusions prfabriques, avec
peu de refoulement du sol adjacent et une longueur qui peut sadapter aux horizons
gologiques du site.
Les inclusions sont gnralement ralises jusqu un substratum plus rigide sur lequel
elles reposent ou sont ancres. Le rseau dinclusions et le diamtre des inclusions sont
dimensionns en tenant compte dun coefficient de scurit. Nous pouvons noncer deux
approches de dimensionnement des inclusions :
1. Les inclusions sont supposes reprendre la totalit des charges appliques par le matelas,
le remblai et louvrage en surface, plus particulirement dans le cas de la mise en place
dune nappe de renforcement gosynthtique en base du remblai qui transfre aux
inclusions toutes les charges qui nont pas t transfres par effet de vote. Dans ce cas
la contribution du sol de fondation est nglige (Collin et al., 2005).
2. Le systme peut tre optimis en tenant compte du support partiel apport par le sol de
fondation, mme en prsence dun gosynthtique (Habib et al., 2002 ; Russel et
Pierpoint, 1997 ; Rogbeck et al., 1998). Cependant les tassements de consolidation du sol
compressible doivent tre pris en compte.
Les dallettes coiffant les inclusions peuvent tre de section carre ou circulaire. La
Figure 4 prsente le cas dun chantier o les inclusions ont des ttes en bton de section
carre.
Figure 4 Chantier de remblai ferroviaire, visualisation des ttes dinclusion avant ldification du
remblai, daprs Zanziger et Gartung (2002)
Les inclusions sont mises en place suivant un maillage rectangulaire (Figure 5a) ou
triangulaire (Figure 5b). En appelant AP la section dune tte dinclusion et As la surface dune
maille lmentaire, le taux de recouvrement est la proportion de la surface totale couverte
par les inclusions et est dfini par :
AP
As
Partie I : Prsentation du problme
quation 1
33
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
As
AP
a Maillage rectangulaire
bMaillage triangulaire
Figure 5 Rseau d'inclusions
2.3 Le matelas de transfert de charge
Le matelas de transfert de charge assure la transition entre les charges appliques en surface et
les inclusions rigides. Il permet de concentrer les charges sur les inclusions, de rduire et
homogniser les tassements en surface grce la formation de votes. Ainsi sa prsence
permet de diminuer les sollicitations sur louvrage afin den assurer le bon fonctionnement et
la prennit.
Ce phnomne de vote rencontr dans les sols granulaires a notamment t dcrit par
Terzaghi (1943) et peut galement tre connu sous la dnomination deffet silo. Diverses
mthodes de dtermination de la charge transmise aux inclusions par effet vote existent et
sont prsentes dans le chapitre 4. Le bilan des mthodes de dimensionnement effectu par
Brianon et al. (2004) montre une grande diversit et la confrontation des mthodes met en
vidence des carts considrables.
Le dveloppement des votes suppose que le matelas ait une rsistance au cisaillement
et une hauteur suffisante (Rathmayer, 1975). Les tassements sont susceptibles dtre
galement dpendants du module de dformation du sol ainsi que de sa dilatance.
Le matelas de transfert de charge est gnralement constitu par un matriau noble
comme des graves ou du ballast, par des matriaux traits la chaux ou au ciment, afin den
augmenter les proprits mcaniques (Dano et al., 2004) ou encore par un matriau grossier.
Cette dernire option est certainement la moins onreuse alors que lutilisation dun matriau
noble peut savrer coteuse. Cependant il nexiste aucune tude concernant le
dveloppement des mcanismes de report de charge en fonction de la nature du sol constituant
le matelas (Brianon et al., 2004). La bibliographie concernant les ouvrages renforcs par des
inclusions rigides ne fournit quasiment pas dinformations ou de donnes caractrisant le
matelas de transfert de charge. Glandy et Frossard (2002) prcisent cependant que le matelas
doit tre mis en uvre suivant les critres routiers.
La caractrisation du comportement mcanique des sols pouvant constituer le matelas
a cependant fait lobjet de plusieurs tudes, dans le cadre de leur utilisation dans dautres
domaines.
La caractrisation des graves et ballasts a fait lobjet de quelques exprimentations dans
le cadre de son utilisation pour les voies ferres et les chausses souples notamment.
Indraratna et al. (1998), par des essais sur des ballasts lappareil triaxial de diamtre
300 mm, montrent que les dformations et le comportement au cisaillement sont trs
diffrents selon la valeur de la contrainte de confinement.
Partie I : Prsentation du problme
34
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Le LCPC a entrepris une tude de caractrisation des graves non traites (GNT)
lappareil triaxial chargements rpts, dans le cadre de lutilisation pour la
construction de chausses. Paute et al. (1994) mettent en vidence un comportement
mcanique complexe et notamment une lasticit non linaire, dpendant des contraintes
appliques, et des dformations permanentes voluant avec le nombre de cycles
appliqus. Les rsultats obtenus sur une grande varit de matriaux montrent linfluence
sur les performances mcaniques des GNT de la minralogie des granulats, de la teneur
en eau, et un degr moindre, de la compacit. Bouassida (1988) prsente des rsultats
obtenus lappareil triaxial sur une grave non traite, utilise en construction routire.
Lors du cisaillement, le matriau est contractant puis dilatant. La cohsion de ce matriau
est non ngligeable (c = 30 kPa) et langle de frottement est lev ( = 54).
Les sols grossiers posent un problme de caractrisation, plus complexe encore que pour
les matriaux nobles, car chaque sol est propre au site et prsente des caractristiques
diffrentes. La particularit des sols grossiers est de prsenter des lments de taille trs
variable, mais la dfinition dun sol grossier varie selon les auteurs (Perrot, 1968 ; Lambe
et Whitman, 1976 ; Craig et Susilo, 1986 ; Charles, 1989). Afin de pouvoir tester le
matriau, les lments de grande taille doivent tre crts et lappareillage dessai doit
tre de dimension suffisante. Des auteurs sintressent alors la mise au point de
procdures afin de pouvoir tester ce type de matriaux (Fragaszy, 1990 ; Donaghe et
Torrey, 1994). Les rsultats des essais de caractrisation dpendent de lappareillage
dessai (taille de la bote, type dessai). De nombreux auteurs mettent en vidence
laugmentation de la rsistance au cisaillement avec laugmentation du diamtre maximal
des grains (Gotteland et al., 2000 ; Valle, 2001 ; Pedro et al., 2004 ; Levacher et al.,
2004). Le paramtre ayant le plus dinfluence sur le comportement semble tre la densit
initiale (Valle, 2001 ; Paul et al., 1994). La synthse bibliographique des rsultats des
essais effectus sur des sols grossiers montre que leur comportement est non linaire,
lordre de grandeur de langle de frottement est de 40, mais il peut aussi tre bien plus
important : Kany et Becker (1967) dterminent un angle de frottement de 48,5 pour un
sol de remblai sans cohsion compos de gros morceaux de roche. La cohsion, quant
elle, se situe entre 0 et 60 kPa. Le comportement est gnralement dilatant (Bourdeau,
1997).
Les essais de caractrisation du comportement mcanique des sols traits montrent que la
cimentation des chantillons permet daugmenter la rsistance au cisaillement, la rigidit
et la dilatance du sol (Coop et Atkinson, 1993 ; Consoli et al., 1998 ; Asghari et al.,
2003 ; Dano et al., 2002).
2.4 Les nappes de renforcement
Le renforcement en base du matelas de transfert de charge par des nappes horizontales est peu
courant en France mais assez rpandu dans de nombreux autres pays (Brianon et al., 2004).
Les seules normes ou recommandations existantes dans le domaine prconisent son utilisation
(BS8006, 1995 ; EGBEO, 2004). Lorsque quune seule nappe gosynthtique est dispose sur
les ttes dinclusion, elle contribue au renforcement par effet membrane. Lorsque plusieurs
nappes sont mises en uvre au sein du matelas granulaire, leffet membrane se rajoute un
effet de rigidification du matelas (Guido et al., 1987 ; Bell et al., 1994 ; Collin, 2004). La
Figure 6 prsente les diffrentes dispositions de la nappe dans le matelas. Les nappes de
renforcement sont gnralement constitues soit de gotextiles, soit de gogrilles qui
Partie I : Prsentation du problme
35
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
permettent lenchevtrement du sol dans la nappe. Dans certains cas, le matelas est galement
renforc par un treillis soud (Combarieu et al., 1994).
gosynthtique
gosynthtiques
Figure 6 Diffrentes dispositions du renforcement horizontal dans le matelas de transfert de charge,
daprs Brianon et al. (2004)
3 DOMAINES DAPPLICATION
La technique du renforcement des sols compressibles par des inclusions rigides verticales a
connu un grand essor depuis les annes 70 mais son utilisation en France nest courante que
depuis une dizaine dannes.
La Figure 7 prsente diffrents domaines dapplication : les remblais routiers ou ferroviaires
(a), les remblais daccs des ouvrages dart (b), les fondations pour plates-formes
industrielles (c), rservoirs de stockage ou stations dpuration (d). Nous trouvons dans la
littrature divers exemples dapplication de cette technique en France et ltranger (Sude,
Allemagne, Grande-Bretagne, Irlande, Pays-Bas, Portugal, Malaisie, USA). Des ouvrages de
rfrence ont t rpertoris par Brianon (2002) qui fournit des prcisions sur les
caractristiques du renforcement.
Les remblais routiers ou autoroutiers peuvent tre construits sur sols
compressibles renforcs par inclusions rigides afin de contrler les tassements en
surface du remblai et de rduire la dure du chantier (Barry et al., 1995 ; Card et
Carter, 1995 ; Wood, 2003 ; Quigley et al., 2003 ; Stewart et al., 2004 ; Collin et al.,
2005).
Llargissement dune route existante sur sol compressible peut entraner du tassement
diffrentiel entre la nouvelle et lancienne voie et donc des fissures au niveau de la
chausse. Le renforcement par inclusions rigides apporte une solution rapide ce
problme (Habib et al., 2002 ; Lambrechts et al., 2003 ; Wang et Huang, 2004).
De nombreux remblais ferroviaires situs en Allemagne sont fonds sur sol renforc
par inclusions rigides (Alexiew et Vogel, 2002 ; Zanziger et Gartung, 2002 ; Brandl et
al., 1997). Cortlever et Gutter (2003) prsentent un projet dlargissement de remblai
ferroviaire en Malaisie.
Les remblais daccs aux ouvrages dart peuvent tre difis sur sol compressible
renforc par inclusions rigides afin dviter les tassements diffrentiels entre la cule
fonde sur pieux et la voie daccs (Holtz et Massarsch, 1976 ; Holmberg, 1978 ; Reid
et Buchanan, 1984 ; Combarieu et al., 1994 ; Forsman et al., 1999 ; Lin et Wong,
1999 ; Mankbadi et al., 2004 ; Plomteux et al., 2004). Combarieu et Frossard (2003)
prsentent un projet de remblai daccs un quai portuaire des berges de la Loire.
Liausu et Pezot (2001) prsentent le cas dun dallage industriel de grande surface situ
dans la Somme, difi sur sol compressible renforc par colonnes module contrl.
Pinto et al. (2005) prsentent le cas dun renforcement des berges du Tage pour la
construction de btiments industriels lgers.
Partie I : Prsentation du problme
36
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
a Voirie
b Remblai daccs un ouvrage dart
c Dallages et fondations de plate-forme
industrielle
d Rservoirs
Figure 7 Domaines d'application
4 CONTEXTE DE LA THESE ET OBJECTIFS
Le renforcement des sols compressibles par inclusions rigides verticales met en uvre des
mcanismes identifis mais complexes et en forte interaction. Des mthodes de
dimensionnement existent, reposant sur divers concepts, mais elles peuvent aboutir des
rsultats contradictoires. Cela confirme la ncessit de progresser dans la modlisation du
comportement de ces ouvrages complexes.
Ce constat a conduit lIREX, en liaison avec le Rseau Gnie Civil et Urbain
(ministres de la Recherche et de lEquipement), rassembler des entreprises, des bureaux
dtudes, des matres douvrages et de centres de recherche au sein dun Projet National qui a
dbut en 2005. Ce projet, intitul ASIRi pour Amlioration des Sols compressibles par des
Inclusions Rigides , vise proposer des recommandations pour la conception, le
dimensionnement et la ralisation du renforcement des massifs de fondation par inclusions
rigides. Ce projet sappuiera sur des exprimentations en vraie grandeur, des essais en
laboratoire et en centrifugeuse, des modlisations numriques divers niveaux de complexit,
afin de dvelopper des mthodologies de dimensionnement.
Ce travail de thse entre dans le cadre du Projet National et sinscrit dans les parties
Exprimentations en laboratoire et Modlisation numrique . Lobjectif de ce travail de
recherche est plus particulirement ax sur la comprhension et la modlisation des
mcanismes qui se dveloppent dans le matelas granulaire de transfert de charge.
Partie I : Prsentation du problme
37
Chapitre 1 : Le renforcement des sols par des inclusions rigides verticales
Partie I : Prsentation du problme
38
Vous aimerez peut-être aussi
- Routes Et ChausséesDocument38 pagesRoutes Et ChausséessamifaPas encore d'évaluation
- Grand Remblai Conception Et ExécutionDocument16 pagesGrand Remblai Conception Et ExécutionJiPe2011Pas encore d'évaluation
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Guide Technique Construction Bois 1 PDFDocument12 pagesGuide Technique Construction Bois 1 PDFguillaumePas encore d'évaluation
- Définition Des Parois MouléesDocument6 pagesDéfinition Des Parois MouléesAbdelhak ZianePas encore d'évaluation
- ROUTESDocument67 pagesROUTESSoumana AbdouPas encore d'évaluation
- AFFOUILLEMENT (Enregistré Automatiquement)Document6 pagesAFFOUILLEMENT (Enregistré Automatiquement)Hamza El FadiliPas encore d'évaluation
- Guide D'utilisation Des Normes NF en 287-1 Et NF en ISO 15614-1Document45 pagesGuide D'utilisation Des Normes NF en 287-1 Et NF en ISO 15614-1asta57100% (1)
- Etude Geotechnique D'avant ProjetDocument61 pagesEtude Geotechnique D'avant ProjetAbdou HababaPas encore d'évaluation
- Pratique de L'interaction Sol StructureDocument6 pagesPratique de L'interaction Sol StructureAminePas encore d'évaluation
- Bonnes Pratiques Essais Compression Eprouvettes PDFDocument28 pagesBonnes Pratiques Essais Compression Eprouvettes PDFqwerty2500Pas encore d'évaluation
- Nikiema Wilfried Nicaise Natabzanga Armel PDFDocument91 pagesNikiema Wilfried Nicaise Natabzanga Armel PDFclaudePas encore d'évaluation
- Etude VoirieDocument12 pagesEtude VoirieErrmadiPas encore d'évaluation
- GuideTechnique LCPC SOUTMET PDFDocument108 pagesGuideTechnique LCPC SOUTMET PDFmorralla123Pas encore d'évaluation
- AFPS - Guide - Technique - 2002 - Protection Parasismique Des Ponts de TuyauteriesDocument64 pagesAFPS - Guide - Technique - 2002 - Protection Parasismique Des Ponts de TuyauteriesYaya MamadouPas encore d'évaluation
- Etude GéotechniqueDocument6 pagesEtude GéotechniqueyouccefPas encore d'évaluation
- 32 - BSM - Béton en Site MaritimeDocument287 pages32 - BSM - Béton en Site MaritimebaudryPas encore d'évaluation
- CELB7chapitre2 Technique Paroi Moulée TirantDocument19 pagesCELB7chapitre2 Technique Paroi Moulée Tirantmichalakis483Pas encore d'évaluation
- Colonnes BalastéesDocument73 pagesColonnes BalastéesMendli AbdessamadePas encore d'évaluation
- Remblai Sur Zone Compressible 1 Cas de RDocument15 pagesRemblai Sur Zone Compressible 1 Cas de RAbdelkarim ELPas encore d'évaluation
- RAPPORT SAGA N°05862 Version 1 Etude Géotechnique G2 AVP - DRANCY - Lycée Saint GermainDocument35 pagesRAPPORT SAGA N°05862 Version 1 Etude Géotechnique G2 AVP - DRANCY - Lycée Saint GermainAymen Frikhi100% (1)
- Recherche Paroi MouléeDocument12 pagesRecherche Paroi MouléeAmine 1997Pas encore d'évaluation
- PieuxDocument5 pagesPieuxmtssofienePas encore d'évaluation
- Etude Geotechnique Station de Pompage Marina de HullDocument54 pagesEtude Geotechnique Station de Pompage Marina de HullFatima Belgasmi50% (2)
- R A D P: Épublique Lgérienne Émocratique Et OpulaireDocument93 pagesR A D P: Épublique Lgérienne Émocratique Et Opulairerahma AyPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - La Geotechnique RoutiereDocument182 pagesChapitre 1 - La Geotechnique RoutiereFadwa El KhouPas encore d'évaluation
- Technique Et Méthodes Des Laboratoires, Ponts Et ChausséesDocument71 pagesTechnique Et Méthodes Des Laboratoires, Ponts Et ChausséesАли Рафик100% (1)
- Girabase 40Document36 pagesGirabase 40Vanessa CrosnierPas encore d'évaluation
- Chapitre 5 ELEMENTS DE CARTOGRAPHIE 5.1 PDFDocument6 pagesChapitre 5 ELEMENTS DE CARTOGRAPHIE 5.1 PDFAT NMPas encore d'évaluation
- STB Geotec Rapport G2proDocument245 pagesSTB Geotec Rapport G2proAnonymous WXJTn0Pas encore d'évaluation
- Etude PortDocument36 pagesEtude PortAnonymous mzn5BiPas encore d'évaluation
- Carottage ChausséeDocument26 pagesCarottage ChausséeBilly2022Pas encore d'évaluation
- Glissement TerrainDocument9 pagesGlissement Terrainamical1955Pas encore d'évaluation
- Prop. ThermiquesDocument39 pagesProp. ThermiquesSmail BenidirPas encore d'évaluation
- Reconaissance Du Sol Au Pnemometre Dynamyque PDFDocument0 pageReconaissance Du Sol Au Pnemometre Dynamyque PDFRedha MerkhiPas encore d'évaluation
- Réalisé Par: Housni CHADLI Demandé Par: Pr. ELARRIM EMERA 2016-2017. Module: OcéanologieDocument44 pagesRéalisé Par: Housni CHADLI Demandé Par: Pr. ELARRIM EMERA 2016-2017. Module: OcéanologieFeki Mahdi100% (2)
- Essai de PlaqueDocument12 pagesEssai de PlaqueAziz Elkhayari100% (1)
- 2 - Etude GeotechniqueDocument48 pages2 - Etude Geotechniquenanfack100% (1)
- Extrait PenetrometreDocument10 pagesExtrait PenetrometreLatanya JenkinsPas encore d'évaluation
- Cet 1002Document60 pagesCet 1002Walid KhalidPas encore d'évaluation
- GEO5 - Modules Et Packs - 2020Document2 pagesGEO5 - Modules Et Packs - 2020Sabrina DerradjiPas encore d'évaluation
- 2017 GTI5 Guidetechnique Ifsttar PDFDocument74 pages2017 GTI5 Guidetechnique Ifsttar PDFAT NMPas encore d'évaluation
- Chaussees PortuairesDocument15 pagesChaussees PortuairesAnonymous 7OG1zAPas encore d'évaluation
- DTP SKIKDA - Attribution 2015Document25 pagesDTP SKIKDA - Attribution 2015Karim NazefPas encore d'évaluation
- 3.1. M. Si - Tayeb - Reparation Des Tunnels PDFDocument27 pages3.1. M. Si - Tayeb - Reparation Des Tunnels PDFSmail ZennouchePas encore d'évaluation
- RR77Document83 pagesRR77Alaa GuessmiPas encore d'évaluation
- Rapport PFE Laurent PELISSIER - GC5 ADocument95 pagesRapport PFE Laurent PELISSIER - GC5 AFethi Mouaki BenaniPas encore d'évaluation
- Rapport MoiseDocument40 pagesRapport MoiseElfrid Elfrid100% (2)
- SANGLERAT Tome 2 PDFDocument369 pagesSANGLERAT Tome 2 PDFMohammed Kamel BerraniPas encore d'évaluation
- Calcul de Mur Poids - Souténement by ZAKI Idriss - Ingénieur CivilDocument168 pagesCalcul de Mur Poids - Souténement by ZAKI Idriss - Ingénieur CivilIdriss ZakiPas encore d'évaluation
- Renforcement Des Sols en Remblais 2011 PDFDocument58 pagesRenforcement Des Sols en Remblais 2011 PDFRachida TchagbelePas encore d'évaluation
- PresentationDocument6 pagesPresentationMokhtarLaroussiPas encore d'évaluation
- !!!M S GC Mokhtari+Hosni PDFDocument84 pages!!!M S GC Mokhtari+Hosni PDFZouhirPas encore d'évaluation
- Remblai Zone Inondable ConvertiDocument107 pagesRemblai Zone Inondable ConvertiChh Song ZpermzPas encore d'évaluation
- Mémoire ValidéDocument88 pagesMémoire ValidéAliAnis0% (1)
- Documentation HydraProjectDocument12 pagesDocumentation HydraProjectRajaa Kodad100% (1)
- Rapport de StageDocument108 pagesRapport de StageIssam BenlahbiibPas encore d'évaluation
- Specifications Pour MS PDFDocument8 pagesSpecifications Pour MS PDFBENPas encore d'évaluation
- Exposé Terre Armée Groupe 12Document14 pagesExposé Terre Armée Groupe 12Alassane DABOPas encore d'évaluation
- Des risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscamingueD'EverandDes risques, des mines et des hommes: La perception du risque chez les mineurs de fond de l'Abitibi-TémiscaminguePas encore d'évaluation
- Inclusion RigideDocument8 pagesInclusion RigideABPas encore d'évaluation
- Ahm RaportDocument5 pagesAhm Raporthelmi trabelsiPas encore d'évaluation
- Les PieuxDocument15 pagesLes PieuxREDA100% (1)
- Modes Opératoires Des Travaux PublicsDocument23 pagesModes Opératoires Des Travaux PublicsFatima Z'hra AmmarPas encore d'évaluation
- Les Solutions Opte Pour La Liquefactions Des SolsDocument11 pagesLes Solutions Opte Pour La Liquefactions Des SolsAmada TarekPas encore d'évaluation
- Expo Mec 1Document5 pagesExpo Mec 1Zineb MhdPas encore d'évaluation
- Expo Mec 1Document7 pagesExpo Mec 1Zineb MhdPas encore d'évaluation
- Chapitre Iii Les FondationsDocument23 pagesChapitre Iii Les FondationshansdevisdjimelinawaPas encore d'évaluation
- 169829Document8 pages169829AT NMPas encore d'évaluation
- d279 PDFDocument10 pagesd279 PDFAT NMPas encore d'évaluation
- THESE AdB 5 PDFDocument513 pagesTHESE AdB 5 PDFAT NMPas encore d'évaluation
- Reflexion Sur Le Tassement Des Fondations SuperficiellesDocument3 pagesReflexion Sur Le Tassement Des Fondations SuperficiellesAT NMPas encore d'évaluation
- TD de PlanétologieDocument43 pagesTD de PlanétologieAT NMPas encore d'évaluation
- 386, Note 01 PDFDocument9 pages386, Note 01 PDFAT NMPas encore d'évaluation
- Mur HammamDocument31 pagesMur HammamAT NMPas encore d'évaluation
- 141048freo PDFDocument80 pages141048freo PDFAT NMPas encore d'évaluation
- Calcul TassementDocument1 pageCalcul TassementAT NMPas encore d'évaluation
- Bilante Rre MouvementDocument1 pageBilante Rre MouvementAT NMPas encore d'évaluation
- 356, Note11 PDFDocument8 pages356, Note11 PDFAT NMPas encore d'évaluation
- Bon1 PDFDocument107 pagesBon1 PDFDilane GhomsiPas encore d'évaluation
- Cours Choix Des Materiaux Et Des ProcedeDocument51 pagesCours Choix Des Materiaux Et Des ProcedeHana HosniPas encore d'évaluation
- Découpage, Emboutissage, Tôlerie, Outillages, Repoussage - CetimDocument3 pagesDécoupage, Emboutissage, Tôlerie, Outillages, Repoussage - CetimWasfi ZakariaPas encore d'évaluation
- TamisageDocument4 pagesTamisageWanis BouhadjerPas encore d'évaluation
- Métallurgie Des Poudres - Aubert & DuvalDocument8 pagesMétallurgie Des Poudres - Aubert & DuvalHouda Sidi AmmiPas encore d'évaluation
- Rayen 3Document27 pagesRayen 3aaaaPas encore d'évaluation
- Les Differents Types de MursDocument3 pagesLes Differents Types de MursFama Seye100% (1)
- Chapitre 01Document37 pagesChapitre 01Narimen NinouPas encore d'évaluation
- Halfaoui Rachid Doctorat-ConvertiDocument147 pagesHalfaoui Rachid Doctorat-Convertiheheyam56Pas encore d'évaluation
- Acccouplement FlexiblesDocument16 pagesAcccouplement FlexiblesSiéJustinDembelePas encore d'évaluation
- 9622, Materiaux de Substitution Du GravelDocument52 pages9622, Materiaux de Substitution Du Graveljenic assanhounPas encore d'évaluation
- Notions Sur Les FissuresDocument3 pagesNotions Sur Les FissuresBendj Kheir EddinePas encore d'évaluation
- Projet GC 3èmeDocument114 pagesProjet GC 3èmeKais BENABDALLAHPas encore d'évaluation
- Joints de Chaussee de Ponts Routes N F at j0 13 02 at Jo 13 02 JointsDocument16 pagesJoints de Chaussee de Ponts Routes N F at j0 13 02 at Jo 13 02 JointsPhilip RichPas encore d'évaluation
- Béton Bas Carbone SB-146Document14 pagesBéton Bas Carbone SB-146docteur84Pas encore d'évaluation
- Etude de La Liquéfaction D'un Sol MouDocument4 pagesEtude de La Liquéfaction D'un Sol MouService techniquePas encore d'évaluation
- 1-Les Techniques de Construction Du Batiment - EL ASRI Najat 22-10-2017 PDFDocument121 pages1-Les Techniques de Construction Du Batiment - EL ASRI Najat 22-10-2017 PDFNajat Nona ElasriPas encore d'évaluation
- Réhabilitation: Exigences Et Conception Parasismique: 1 Et 2 Qui Ont Été Endommagées Par L'incendieDocument3 pagesRéhabilitation: Exigences Et Conception Parasismique: 1 Et 2 Qui Ont Été Endommagées Par L'incendieaaaPas encore d'évaluation
- Prat XXIV-3Document4 pagesPrat XXIV-3Mohamed Taha FadelPas encore d'évaluation
- Centreurs en Acier À Roulettes Et À Patins Et Supports de TubesDocument7 pagesCentreurs en Acier À Roulettes Et À Patins Et Supports de TubesIslam-Lotfi Hadj-ArabPas encore d'évaluation
- Catalogue Detendeurs Gce 89Document170 pagesCatalogue Detendeurs Gce 89AmiroucheBenlakehalPas encore d'évaluation
- TD SupmecaDocument13 pagesTD Supmecasalim aribPas encore d'évaluation
- RHEOLOGIEDocument52 pagesRHEOLOGIEfadwaPas encore d'évaluation