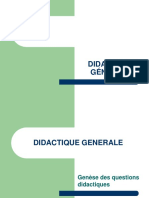Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Module 3 Les Methodes Pedagogiques French Booklet
Module 3 Les Methodes Pedagogiques French Booklet
Transféré par
ernest8712Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Module 3 Les Methodes Pedagogiques French Booklet
Module 3 Les Methodes Pedagogiques French Booklet
Transféré par
ernest8712Droits d'auteur :
Formats disponibles
ROYAUME DU MAROC
Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail
DIRECTION RECHERCHE ET INGENIERIE DE FORMATION DIVISION FORMATION DES FORMATEURS
OFPPT
-
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES GENERIQUES DES FORMATEURS
LES METHODES PEDAGOGIQUES
MODULE :
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
REMERCIEMENTS
Le DRIF/OFPPT remercie toutes les permis llaboration du prsent document. personnes qui ont contribus ou
Pour la supervision :
Mr BAHAR Redouane : Chef de la Division Formation des Formateurs
Pour la conception :
Mme MADANI Yamina
: Responsable de la formation en pdagogie et en communication
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
SOMMAIRE
Page 4 5 9 10 10 10 12 14 15 16 17 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 23
OBJETIFS DU MODULE TEST DENTREE ET DE SORTIE INTRODUCTION TYPOLOGIE DES MTHODES METHODES CENTREES SUR LACTION DU FORMATEUR o La mthode magistrale o La mthode interrogative o La mthode dmonstrative o La mthode Dentranement LES METHODES CENTREES SUR LACTIVITE DE LAPPRENANT o Travail en groupe o Jeux pdagogiques o Etude de cas o Sorties ou visites ducatives o Mthode de formation par projet LA METHODE CENTREE SUR LE TRAVAIL INDIVIDUEL o Le didacticiel o Les logiciels outils o Le travail individuel o Lenseignement distance o Lenseignement programm o Lenseignement assist par ordinateur
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
OBJECTIFS DU MODULE
OBJECTIF GENERAL :
Matriser lutilisation des mthodes pdagogiques en formation
OBJECTIFS SPECIFIQUES : Identifier les diffrentes mthodes pdagogiques ; Utiliser
adquatement les mthodes pdagogiques en
formation.
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
METHODES ET TECHNIQUES PEDAGOGIQUES TEST DENTREE ET DE SORTIE DE MODULE
Recommandations TEST DENTREE ET DE SORTIE DE MODULE : Ce test dentre du module permet dvaluer les acquis et les prrequis des personnes former. Ce mme test doit tre repris en fin de module, il permet chaque participant dvaluer sa propre volution. Ce test peut faire lobjet dune correction de la part de lanimateur, comme il peut tre exploit en auto-valuation.
Matricule Nom/Prnom Etablissement EXERCICE 1 : Compltez le tableau suivant METHODE MEDIATION
: : :
TECHNIQUES
DOMAINE DE COMPETENCE
II
III
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
EXERCICE 2 : Citez 6 types de questions utilises en formation : QUESTION
1 2 3 4 5 6
EXERCICE 3 : Compltez le tableau suivant en indiquant les phases qui constituent une dmonstration pratique : PHASE
1 2 3
EXERCICE 4 : Compltez le tableau suivant en mettant trois caractristiques de la mthode pdagogique du travail en groupe : Caractristiques
1 2 3
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
EXERCICE 5 : Compltez le tableau suivant en mettant deux caractristiques de la mthode pdagogique des jeux de rles : Caractristiques
1 2
EXERCICE 6 : Compltez le tableau suivant en mettant deux caractristiques de la mthode pdagogique par simulation : Caractristiques
1 2
EXERCICE 7 : Compltez le tableau suivant en mettant deux caractristiques de la mthode pdagogique par tude de cas : Caractristiques
1 2
EXERCICE 8 : Compltez le tableau suivant en mettant deux caractristiques de la mthode pdagogique par projet : Caractristiques
1 2
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
EXERCICE 9 : Compltez le tableau suivant en indiquant dans la case vide la mthode pdagogique dont il est question : Mthode Caractristiques Permet le dveloppement de savoir-faire pratiques Cest une mthode trs pertinente pour la formation au diagnostic et dcision dans un grand nombre de domaines Lapprentissage se fait sur des situations relles Son principal avantage cest de permettre le travail en commun et les changes entre personnes en formation Nest pas motivante en elle-mme et laisse peut dinitiative lapprenant Principalement centre sur laction du formateur
1 2
3 4
5 6
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
INTRODUCTION
Une mthode pdagogique est un ensemble structur de principes qui orientent la faon de concevoir la formation (ses tapes, la relation formateur- participant, lapproche de la connaissance, le choix des techniques,...). Une mthode pdagogique, cest une manire spcifique dorganiser les relations entre le stagiaire, le formateur et le savoir. Cependant, on utilise indiffremment le mot attitude, mthode et technique qui sont des notions qui ne relvent pas du mme plan. Une mthode peut se dcrire partir de ce que lon fait, cest une manire raisonne dorganiser une pratique pour atteindre certains objectifs. Une attitude est une manire spcifique lindividu de se comporter et dentrer en relation avec son environnement et avec les autres, elle relve du savoir-tre. Une technique cest un moyen choisi parmi dautres en fonction dun certain nombre de critres : cohrence avec les mthodes avec les objectifs, prise en compte des contraintes matrielles. La meilleure mthode pdagogique nexiste pas , toutes les mthodes sont quivalentes lorsquil sagit de faire atteindre des objectifs simple comme lacquisition et la comprhension de connaissances. Cependant les mthodes pdagogiques centres sur le stagiaire favorisent particulirement bien latteinte des objectifs. Ils permettent aussi la mmorisation long terme, le dveloppement de la pense, le dveloppement de la motivation et la transposition des apprentissages. Les rsultats suprieurs obtenus avec certaines mthodes pdagogiques sont apparemment moins attribuables ces mthodes elles-mmes qu la quantit et la qualit de travail intellectuel personnel quelles permettent de gnrer.
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
A/ TYPOLOGIE DES METHODES PEDAGOGIQUES :
Le nombre de mthodes pdagogiques est assez limit, et se rduit une trentaine de mthodes regroupes selon trois catgories (ou trois grandes familles de mthodes) :
Mthode
centre sur laction du formateur : mthode dite passive qui repose sur diverses formes dexposs magistraux, Mthode centre sur lactivit des stagiaires : mthode dite active, qui favorise la discussion ou le travail de groupe, Mthode centre sur le travail individuel : mthode fonde sur lapprentissage individuel,
B/ METHODE CENTREE SUR LACTION DU FORMATEUR :
Dans ce type de mthode cest le formateur qui a linitiative et la responsabilit de la transmission du savoir. Il apparat comme la mdiation ncessaire entre le stagiaire et le savoir.
I- LA METHODE MAGISTRALE :
Cette mthode, communment pratique par les formateurs, est nomme de diffrentes manires :
lappelle magistrale, car ce qui importe cest laction du formateur : On
savoir prparer une intervention, puis la raliser en utilisant certaines techniques. Lefficacit de la mthode dpendra trs largement de la performance du formateur.
On lappelle expositive parce quelle utilise comme principale technique
lexpos de type magistral, o le formateur dit dans une forme aussi labore et assimilable que possible ce les stagiaires doivent apprendre. Le groupe se contente de recevoir et denregistrer.
On lappelle parfois dogmatique, car cest le formateur et lui seul , qui
dtermine les contenus de formation ; formation qui apparat aux stagiaires comme un dogme , comme un modle une vrit. On lappelle aussi traditionnelle pour deux raisons : Parce quelle est ancienne, tel point quil serait difficile de lui assigner une origine ponctuelle.
10
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
Parce quelle correspond un mode de transmission du savoir qui utilise la distinction entre le formateur et le stagiaire. Celui qui sait (ladulte, lhomme dexprience, le sage) et celui qui ignore(le jeune le novice).
1) Caractristiques de la mthode :
Cest une mthode qui valorise le rle du formateur, valorisation qui se justifie par laccs privilgi du formateur au savoir. Cest le formateur qui prend en charge la production, il organise le contenu du cours en prenant en compte le programme, le niveau des stagiaires, en le situant dans une progression, il le ralise devant, plus quavec, les stagiaires : le fait que les stagiaires soient dix ou cent ne modifie pas la nature de lintervention . Cest le formateur aussi qui prend en charge la gestion, cest--dire lorganisation du fonctionnement du groupe dans lespace et dans le temps ; cette organisation est largement tributaire de son mode dintervention : les stagiaires doivent pouvoir lentendre, le voir et prendre des notes. Cest lui enfin qui assure la rgulation de lactivit : il pose des questions, rappelle les stagiaires lordre, sanctionne ventuellement, cest lui que revient linitiative du travail du groupe.
2) Avantages de la mthode :
Cest la mthode la plus scurisante pour le formateur, et, dans une certaine mesure la plus facile : il peut raliser son intervention selon le plan quil a tabli pralablement. Elle permet une transmission rapide des connaissances un grand nombre de personnes en mme temps. Elle permet galement au formateur de faire passer un contenu trs thorique travers un expos quil pourra rendre plus attrayant en utilisant des supports sa communication.
3) Inconvnients de la mthode :
Cest une mthode qui comporte des faiblesses sur le plan de lapprentissage : on se demande ce que le formateur enseigne, et comment il lenseigne, on ne se demande pas assez comment les stagiaires apprennent, et si mme ils apprennent. On dfinit bien les conditions de lenseignement, mais pas assez celles de lapprentissage. Cest une mthode qui, lorsquelle est systmatiquement pratique, risque dengendrer chez le stagiaire passivit et dpendance.
11
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
II-
LA MTHODE INTERROGATIVE :
La mthode interrogative occupe une place importante en formation : dune part, elle reste lune des mthodes la plus employe par les formateurs et dautre part, les connaissances que le stagiaire aura acquises par lui-mme, grce des questions habiles, seront plus solides et plus durables que celles quon lui enseignerait dautorit. Habituellement, on interroge pour faire trouver ou dcouvrir, pour contrler les acquis pour maintenir lattention du groupe et pour vrifier si les connaissances dispenses ont t acquises. Une formation bien conue fait appel un intrt profond du stagiaire et sadresse sa pense vivante et lincite comprendre non pas reprer sans comprendre. Or comprendre et une opration complexe qui suppose un certain effort intellectuel : cest pourquoi on a pens faire participer le stagiaire lenseignement quon lui donne, en linterrogeant souvent. La mthode interrogative a pour fondement essentiel la ncessit de comprendre. Coussinet lappelle lart de faire digrer .
1) Les caractristiques de la mthode interrogative :
La mthode interrogative est une mthode classique de formation qui a pour objectif de susciter limplication des apprenants, elle permet aussi de : Vrifier la comprhension et la mmorisation chez les stagiaires. Corriger les erreurs de comprhension et perception. Faire apparatre dventuelles lacunes dans les connaissances. Vrifier si les informations prsentes correspondent bien aux besoins. Fournir loccasion de discuter de nouvelles connaissances et de les appliquer. Permettre une rcapitulation ou un rsum. Faire apparatre certaines explications supplmentaires dont les stagiaires auront besoin pour appliquer leurs connaissances.
2) Les diffrents types de questions :
Question
ouverte : Les questions ouvertes permettent plusieurs types de rponses. Gnralement ce sont des questions dont la rponse suppose un dveloppement long.
Question
ferme : Les questions fermes entranent une rponse par oui ou par non , vrai ou faux , ou par un terme prcis une rponse bien dtermine.
12
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
Question
en miroir : reprendre la fin de chaque rponse sous forme de
question.
Question
en relais : reprendre la mme question tour de rle pour tous les participants.
Question Question
directe : Question qui sadresse un apprenant en particulier. manipuler,
suggestive : question qui a pour objectif de dinfluencer, de faire adopter lautre un comportement prcis.
Question
pige : question qui a pour objectif de vexer lautre, de le dstabiliser, de le mettre lpreuve. Le formateur ne devrait normalement pas avoir recours ce type de question. Lorsquil est lui-mme soumis ces questions il doit y rpondre avec beaucoup de prcautions.
3) Technique du questionnement :
Poser des questions aux apprenants, interroger est un art. Les questions poser doivent tre soigneusement prpares. Il est important de dterminer au pralable la pertinence lutilit de la question en lui fixant un objectif bien dtermin. Une bonne question prsente les caractristiques suivantes :
Concision
: Les questions longues et diffuseront souvent pour effet de saturer les participants, elles provoquent confusion et dsintrt.
Clart
: La question doit se concentrer sur un seul point prcis. Les questions trop complexes facettes multiples entranent un sentiment de frustration, sans provoquer de rflexion.
Pertinence
: la question doit concerner le sujet du dbat. Une question venant largir le dbat pourra sembler hors sujet aux participants.
Dfi
: Les questions utiles sont celles qui suscitent la rflexion, qui contiennent une part de provocation et qui encouragent la crativit, lvaluation, linterprtation, la compassion, la synthse. Les questions qui font simplement appel aux informations mmorises par les participants sont viter car elles nont de valeur pdagogique relle.
Pratique
de la reformulation : reformuler vos questions en vous assurant chaque fois que les stagiaires ont compris. Reformulez autan de fois quil sera ncessaire.
13
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
III- LA MTHODE DMONSTRATIVE :
Elle consiste montrer aux apprenants comment accomplir une tche ou une activit. Elle est trs souvent prcde dune introduction thorique et suivie dun exercice pratique. Le formateur a pour rle : dintroduire la dmonstration, en montrant ce dont il sagit ; de procder la dmonstration en dcomposant les lments de la tche ; de rsumer ce qui a t dmontr ; dassister les apprenants lors de lexercice pratique ; de relier la dmonstration la ralit du terrain ;
1) Les diffrentes phases dune dmonstration pratique :
1- la phase dobservation et de reprage des points cls : au cours de cette phase les stagiaires doivent dcouvrir les lments essentiels de lopration et identifier les tapes les plus importantes ou les plus difficiles raliser. Ils doivent aussi reconstituer phase par phase le droulement chronologique des diffrentes tapes. Pendant cette phase, le formateur pourra laisser les stagiaires dcouvrir par eux-mmes et corriger ou guider leurs observations. 2- La phase de dmonstration ralise par le formateur : le formateur ralise la tche point cl par point cl en expliquant chacune des phases. Tout en effectuant la tche le formateur peut questionner les stagiaires, rpondre leurs questions, afin dintresser et de les impliquer davantage ce quil est entrain de faire. 3- La phase dapplication : Chaque stagiaire reproduit au fur et mesure, tape par tape ce que le formateur lui a montr. Pour cette phase il est prfrable de laisser progressivement lautonomie aux apprenants, tout en veillant ce quils ne fassent pas derreur grave. Au cours de cette phase, le formateur observe attentivement les ralisations des stagiaires et relvent les erreurs quils ont pu faire. Une fois que ces erreurs ont t identifies, il faut les corriger. Il est important de savoir que lorsquun stagiaire se trompe, il doit pouvoir comprendre quel moment et pour quelle raison il sest tromp.
14
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
2) Conseils pratiques :
Avant de procder une dmonstration pratique le formateur doit au pralable veiller lorganisation de sa leon en fonction du nombre de stagiaires et des moyens matriels dont il dispose. Lorsque le nombre de stagiaires est trs important le formateur est oblig de repartir son groupe de stagiaires en 2 ou 3 sous-groupes. Ceci est surtout valable pour les phases de dmonstration et dapplication, la phase dobservation seffectue en gnral en grand groupe.
IV- LA MTHODE DENTRANEMENT (LE DRILL) :
Cette mthode consiste en un apprentissage par rptition jusqu' lacquisition dun comportement habitude. Des rflexes qui se dclenchent sur un signal ou stimuli et reproduisent la situation standard pour laquelle ils ont t construits. Cest par cette mthode que nous avons appris lire, que nous avons retenu les versets du Coran, la table de multiplication, le calcul mental, la dactylographie, la natation. Cette mthode permet lacquisition dimportants automatismes de base. Il faut noter par ailleurs que ltre humain par nature manifeste une aptitude certaine au conditionnement et lacquisition de comportements-habitudes.
1) Avantages de la mthode par rptition :
Cest une mthode qui permet : de gagner du temps, les apprenants sont conditionns la reproduction de modles, de rponses des stimuli bien dtermins. de faciliter le contrle des acquis, par le contrle de la conformit de la rponse au modle , par la mesure du temps de raction . de normaliser les acquis chez les personnes en formation, cest dire quelles ont toutes t formes reproduire les mmes modles.
2) Aspects ngatifs de la mthode :
Cest une mthode essentiellement fonde sur mmorisation et la reproduction de modles. La mthode ne prend pas non plus en compte les capacits du stagiaire en tant quindividu. Cest une mthode qui nie la curiosit du stagiaire, son esprit dinitiative, ses capacits imaginatives. Il est rduit des rptions de notions quil a intgres, une sorte dautomate qui ne peut ni rflchir ni donner son opinion.
15
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
B/ METHODE CENTREE SUR LACTIVITE DU STAGIAIRE :
IDFINITION :
Dans ce type mthode les stagiaires se dfinissent par la relation quils entretiennent eux-mmes avec le savoir et la relation quils entretiennent entre eux. Les stagiaires ne sont plus un collectif abstrait, mais une pluralit dindividus diffrencis qui ne sont plus seulement les destinataires de lacte pdagogique du formateur, mais les acteurs de la pdagogie. On lappelle active : Car les stagiaires ne sont plus exclusivement tributaires de lactivit du formateur ; ce quils apprennent rsulte pour une grande part de lactivit quils dploient eux-mmes. Le terme dcole active apparat en 1920 sous la plume de A. FERRIERE et depuis lexpression mthode active est couramment utilise. Ce sont des mthodes qui transforment le rle du formateur. Cependant ce nest que vers le dbut du 20 sicle que vont se dvelopper des pratiques novatrices lies ces mthodes actives. Elles restent nouvelles aujourdhui encore car elles sont peu utilises par les formateurs, parfois mme elles sont ignores ou trs peu connues.
II- CARACTRISTIQUES DE LA MTHODE :
La caractristique principale de la mthode cest de crer un milieu ducatif qui permet au stagiaire dapprendre dune manire plus directe et plus autonome, donc en mme temps plus efficace et plus attrayante.
La
production nest plus la prrogative exclusive du formateur, il lui appartient de mettre les stagiaires dans des conditions (psychologiques, relationnelles, matrielles,) o ils puissent produire par eux-mmes. La production est plus dcentralise, et le formateur dans ces conditions est plus un conseiller.
La
gestion de lactivit devient la condition essentielle de la russite de la formation. Toute activit suppose une organisation, une progression, lutilisation dun matriel et une production appropris. Il ne suffit plus pour le formateur de surveiller lhoraire et de maintenir lordre, mais de devenir lanimateur de lactivit.
16
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
La
rgulation, elle aussi, devient plus complexe, car au lieu davoir grer seulement sa relation avec le groupe classe, le formateur doit aussi grer la relation des individus avec les tches raliser, ainsi que les relations quils entretiennent entre eux pour les accomplir. Le formateur doit donc faire face des problmes daffinit, dagressivit, de conflits et il devient alors mdiateur.
III- AVANTAGES DE LA MTHODE :
et motivation : lactivit est investie par ceux qui sy livrent, elle a un sens pour eux, car elle correspond leurs besoins et leurs attentes. et linitiative : la dpendance par rapport au formateur est moindre dans lapprentissage et par consquent des relations entre les stagiaires et de relations plus riches avec le formateur.
Dveloppement Lautonomie Intrt
IV- INCONVNIENTS DE LA MTHODE :
demandent aux formateurs plus de travail tous les niveaux : celui de la prparation, celui de la ralisation, celui de lvaluation. Ce sont des mthodes coteuses en temps, compte tenu de leur approche des contenus. Elles supposent la runion dun certain nombre de conditions, parmi les quelles on peut ranger : les effectifs, lorganisation de lenseignement, la disponibilit des participants se prter ce type de formation.
Ce sont des mthodes dlicates mettre en uvre et qui
V- LES TECHNIQUES APPARTENANT AUX MTHODES ACTIVES :
1) Travail de groupe :
Cest une activit pdagogique qui consiste fournir une tche raliser des groupes de quatre huit personnes pendant une dure de trois quart dheure une heure, une heure et demie sans animateur. Chaque sous-groupe ainsi constitu choisi un rapporteur qui aura pour rle de faire part des travaux du groupe lensemble du groupe classe. Chaque sous-groupe expose les rsultats de ses travaux, il sen suit une discussion, puis le formateur procde avec le groupe de stagiaires un bilan global. Avantages de cette technique :
17
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
Elle permet "l'autonomisation" des stagiaires ; les sous-groupes choisissent leurs procdures et leur rythme de travail. Elle permet lexpression de chacun ; telle personne qui sexprime difficilement sance plnire, peut sexprimer plus librement au sein dun petit groupe.
2) Jeux pdagogiques 1-Le jeu de rle :
Cest une technique de travail qui consiste faire jouer des situations dont les caractristiques sont empruntes des situations authentiques. Cette technique a pour rle dentraner les stagiaires ragir face certaines situations professionnelles. Les participants autres que les acteurs sont placs en position de spectateurs observateurs cependant la phase dinterprtation des rles. Ils prendront part la phase danalyse mene sous la direction du formateur. Lanimation dun jeu de rle passe par plusieurs tapes : Prparer le groupe ; Distribuer les consignes crites chaque participant ; Procder linterprtation du jeu de rle en mettant les personnages en prsence ; Exploiter les rsultats du jeu.
2-La
simulation : La simulation est technique pdagogique qui vise la formation partir de situations calques sur des situations relles spcifiques un mtier, cette technique pour objectif la matrise de savoir-faire pratiques et ncessite souvent lutilisation dun matriel parfois trs spcialis. Dans cette technique les apprenants sont placs dans ne situation simulant la ralit. Cette simulation peut sapprocher autant que possible de la complexit de la situation relle soit au contraire la simplifier tout en lui gardant un caractre plausible. Les apprenants agissent sur cette situation, en prenant des dcisions et en modifiant les paramtres de la situation. Ainsi, la situation volue en fonction des dcisions des apprenants. La situation peut galement dans le cas dun simulateur, voluer en fonction de facteurs extrieurs non contrlables. Laction et les dcisions des apprenants doivent aboutir des rsultats satisfaisants ou optimums. En dehors du fait que la simulation est une reprsentation de la ralit llment essentiel est linteractivit, lapprenant la possibilit dagir directement sur la situation, pour la modifier ou la transformer.
18
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
Pratique de la simulation Dans la pratique, une simulation comprend trois phases : 1 .Une introduction o lon explique aux personnes en formation ce que lon attend delles et la manire dont les choses vont se drouler. On leur montre comment utiliser le matriel, les instruments et/ou les documents. 2 .Lexercice de simulation proprement dit pendant cette phase le formateur a pour rle de contrler sans, sans intervenir sauf lorsquil sagit de fournir des informations la demande des participants. Les stagiaires doivent assumer lentire responsabilit de leur action. 3 .Aprs lexercice proprement dit les stagiaires et le formateur participent une sance de synthse au cours de laquelle les forms reoivent un feed-back sur la qualit de leur action, la valeur du rsultat auquel ils sont arrivs et la manire dont ils auraient pu amliorer les rsultats.
3) Etudes de cas :
Il sagit l dune mthode pdagogique qui sapplique ltude dun cas. Un cas est gnralement lexpos dune situation concrte problmatique, observe dans la vie relle, quotidienne ou professionnelle et qui rclame une rsolution ou une dcision. Lanimation dune tude cas suppose plusieurs phases : Phase 1 : Ltude de cas ncessite une prparation : de lanimateur : celui-ci prpare un cas rel qui doit aboutir des prises de dcisions pour rsoudre le cas. des participants : Le cas est dabord soumis chaque participant, qui ltudiera loisir soit chez lui, soit juste avant la discussion. Toutes les informations, toutes les donnes ncessaires la mise jour et la rsolution du problme sont apportes. Phase 2 : Constitution groupes de 3 5 personnes. Chaque sous-groupe ainsi constitu tudiera le cas propos. Il sagira pour le groupe : Phase 3 : Lanalyse des rsultats : le formateur fait ou fait faire danalyse des rsultats, fait ressortir les arguments qui les justifient et proposent des voies de solution
19
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
4) Sorties ou visites ducatives :
Une visite est ducative dans le sens o elle prend place au sein dune formation, est donc prcde et suivie dactivits pdagogiques en rapport avec le thme quelle dveloppe. Lchec de bien des visites pdagogiques est d, le plus souvent, au fait quon les conoit comme des activits isoles (sans appel dinformation et sans exploitation ultrieure), comme des sortes de poses hors du programme habituel de formation. La visite ducative compte plusieurs tapes dans sa prparation et sa mise en uvre : Phase 1 : Le formateur doit tout dabord prparer la visite : Phase 2 : Le formateur prpare le groupe la visite : Phase 3 : Pendant le droulement de la visite, le formateur devra : Phase 4 : Aprs la visite, les stagiaires doivent exploiter les informations recueilles et rdiger un compte-rendu.
5) Mthode de formation par projet :
a) Dfinition: Cette mthode consiste essentiellement faire raliser aux personnes vises un travail qui rpond aux critres suivants : Lampleur : Il sagit dun problme ou dune tche qui rclame plusieurs jours et parfois mme plusieurs semaines de travail. La pertinence : L a ralisation du projet doit obliger les personnes en formation mettre en uvre les connaissances, les savoir-faire et les attitudes qui constituent les objectifs de la formation. Lacceptation par la personne forme : Le choix du projet doit faire lobjet dchanges entre la personne en formation et le formateur ou mme une ngociation, voire dun contrat formel. Le ralisme : Le projet doit tre une activit relle et utile conduisant un produit ou un rsultat susceptible dtre exploit ou utilis dans la ralit. Il doit en particulier tenir compte des contraintes et des ressources disponibles ; il doit aussi sappuyer sur lexprience et les comptences des personnes en formation.
20
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
a)
Encadrer la ralisation dun projet :
prparation du projet : La Le choix du projet seffectue par ngociation entre le formateur et la personne former, celle-ci doit tre guide. Le formateur devra tenir compte du degr dautonomie, de comptence et de responsabilit du stagiaire. Il est important que le projet ne dpasse pas le niveau de comptence du form et ne soit pas un prtexte. Le projet sappuie toujours sur un contrat soit explicite soit tacite. Il est important que les choses soient claires ds le dpart et pour cela, il faudra se mettre daccord sur le produit attendu. La personne en formation devra savoir ce quelle doit remettre au formateur.
D/ METHODE CENTREE LE TRAVAIL INDIVIDUEL:
Les mthodes de formation individuelle modifient largement le rle du formateur. Il ne donne pas de cours un ensemble de stagiaires, mais il supervise le travail et le cheminement de chaque apprenant. Il joue le rle du conseiller, cest dire quil guide lvolution pdagogique individuelle de chaque stagiaire. De son ct, le stagiaire discute des tches convenues avec le formateur. Cette mthode compte un certain nombre de techniques, dont voici, les plus connues :
I - LES TECHNIQUES APPARTENANT AUX METHODES
CENTREES SUR LE TRAVAIL INDIVIDUEL : 1 )Le didacticiel :
Un didacticiel est un logiciel conu spcifiquement pour lenseignement, il concerne lapprentissage dun certain corpus de connaissances dans une discipline donne. Le didacticiel prend habituellement une forme ramifie ; il interagit avec lutilisateur par le biais de menus et de dialogues de nombreux formateurs apprcient de plus en plus les didacticiels, car ces derniers permettent linteraction, engendrent linitiative et individualisent la formation. De plus on peut crer des didacticiels dans tous les domaines de la connaissance. Cependant, un didacticiel a une structure fixe et prdtermine par son concepteur, ce qui interdit lutilisateur, le stagiaire de crer quoi que ce soit de nouveau. Un didacticiel sert donc exclusivement lacquisition et la matrise de connaissances.
21
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
2 )Les logiciels outils :
Un logiciel outil est un logiciel laide duquel, les stagiaires produisent un travail propre une discipline donne. Pour se faire, ils doivent dabord se familiariser avec ce type de logiciel pour tre en mesure de raliser ultrieurement, laide de lordinateur, un travail quon ne faisait souvent autrefois qu la main. Il existe ainsi des logiciels outils permettant de faire du dessin darchitecture, des logiciels outils destins la conception assiste par ordinateur, des logiciels outils aptes raliser diverses oprations comptables. Un logiciel outil, contrairement un didacticiel, a une structure ouverte qui favorise les utilisations multiples. Un logiciel outil permet ainsi un stagiaire deffectuer une multitude doprations cognitives/ prendre une dcision dordre professionnel, faire des prvisions, effectuer des calculs, analyser les rsultats des calculs, effectuer des corrections, etc.
3 )Le travail individuel :
Il sagit dun enseignement modulaire, le contenu dun cours et rparti en un certain nombre dunits appeles modules dapprentissage. Un module comprend quatre lments obligatoires : un pretest, des objectifs atteindre, des activits dapprentissage et un post test. Le stagiaire doit raliser en partie ou intgralement les activits dapprentissage associes ce module. Au cours des activits raliser individuellement, si le stagiaire prouve des difficults, il peut consulter le formateur. Lorsquil pense matriser les objectifs du module il peut se prsenter la phase dvaluation. Sil russit il passe au module suivant ; sil choue, il doit reprendre son apprentissage, se prparer et passer nouveau lvaluation.
4 )Lenseignement distance :
Lenseignement distance ou le tl enseignement, est une forme volu de ce quon a appel une certaine poque les cours par correspondance . Dans un cours reposant sur cette mthode denseignement, le form travaille seul, le plus souvent chez lui. Une fois inscrit au cours de son choix, lapprenant reoit les documents du cours par courrier. Dans la majorit des cas, un guide crit lui indique le travail quil doit accomplir laide de ces documents. Ces documents, prpars par un formateur ou une quipe de formateurs, sont pour la plupart des documents crits les documents audiovisuels et informatiques sont moins rpandus. Lorsquil a termin ses travaux, le stagiaire les renvoie par courrier ltablissement concern, o des correcteurs de chargent de les annoter.
22
Dveloppement des comptences gnriques des formateurs
Dans certains cas, le form peut consulter priodiquement un professeur, dans un centre rgional ; dans dautres cas, il peut obtenir, des moments prdtermins, une consultation tlphonique avec un formateur. Aujourdhui on utilise beaucoup la messagerie informatique.
5 )Lenseignement programm :
Lenseignement programm est une mthode pdagogique qui met strictement en application la notion de conditionnement de lapprentissage propose par BF SKINNER (stimuli rponse renforcement). Il existe trois formes de programmes : 1- Les programmes linaires : Dans les cours programms conus selon les principes de SKINNER tous les apprenants suivent le mme parcours pdagogique ponctu dune multitude de questions extrmement simples. 2- les programmes branchements : Dans le but dassouplir lutilisation des cours programms linaires, des programmes branchement ou ramifis ont t mis en place. Ces programmes placs certains endroits cls du programme, permettent au form soit de suivre un itinraire normal, soit de prendre un raccourci ou de sorienter vers une squence plus dtaille. Ce choix des parcours se fait en fonction de la rponse du form, selon quil tmoigne par sa rponse dun niveau normal, suprieur ou infrieur celui du programme.
6 )Lenseignement assist par ordinateur :
Ce courant est n dans les annes 60 lors de la rencontre des thories de lenseignement programm et des possibilits des ordinateurs. Fondes sur lutilisation de logiciels pdagogiques ou didacticiels lenseignement assist par ordinateur sest trs tt diversifi. Ainsi, la notion DEAO est devenue ambigu, recouvrant de nombreux sens. Deux grandes acceptions peuvent tre distingues : Dans un sens restreint, lEAO ne concerne que les didacticiels, grant des parcours dapprentissage en se substituant partiellement lenseignant (on parle alors parfois de tutorial). Dans un sens plus large, on soutient que toutes les activits dapprentissage faisant appel des logiciels conus pour lenseignement (depuis les exercices programms jusquaux logiciels actuels) relvent de lEAO.
23
Vous aimerez peut-être aussi
- Module de Evaluation Des ApprentissagesDocument55 pagesModule de Evaluation Des ApprentissagesChoulouque innocentPas encore d'évaluation
- Etude de Cas 2 Ingénierie de La FormationDocument2 pagesEtude de Cas 2 Ingénierie de La Formationdidi100% (4)
- Cours Ingénierie de La FormationDocument42 pagesCours Ingénierie de La Formationhallami_jihade54290% (20)
- TD 8 CorrigeDocument10 pagesTD 8 Corrigefafa67% (3)
- Module Le FormateurDocument31 pagesModule Le FormateurAbdou Karim100% (1)
- Guide Sur Les Courants Pédagogiques PDFDocument25 pagesGuide Sur Les Courants Pédagogiques PDFPierre Quantin100% (2)
- Methodes, Techniques, Strategies Pedagogiques.: Françoise Raynal, Alain Rieunier, IPNETP, Abidjan, 1987Document27 pagesMethodes, Techniques, Strategies Pedagogiques.: Françoise Raynal, Alain Rieunier, IPNETP, Abidjan, 1987api-442568997100% (4)
- Extrait Guide Pratique Du Formateur PDFDocument15 pagesExtrait Guide Pratique Du Formateur PDFberdjamelPas encore d'évaluation
- Cours CAMARIfinaleDocument43 pagesCours CAMARIfinaleYassine KootPas encore d'évaluation
- 04 Neos Unit Operation-Reva FreDocument14 pages04 Neos Unit Operation-Reva FreHoussemTunisinoPas encore d'évaluation
- EntretienDocument5 pagesEntretiensnakossePas encore d'évaluation
- Module 6. Préparation D - Une Séquence de FormationDocument28 pagesModule 6. Préparation D - Une Séquence de FormationSAMIPas encore d'évaluation
- Module 9 Preparation D'une Sequence de FormationDocument15 pagesModule 9 Preparation D'une Sequence de FormationAbdou Karim100% (1)
- Module 2 Les Methodes Et Approches de FormationDocument23 pagesModule 2 Les Methodes Et Approches de FormationAbdou KarimPas encore d'évaluation
- Module 6 Preparation D'une Sequence de Formation N2Document9 pagesModule 6 Preparation D'une Sequence de Formation N2Hassan ElhaoudPas encore d'évaluation
- MODULE 11 L'Approche Par CompétenceDocument15 pagesMODULE 11 L'Approche Par Compétenceelhoussine hachlafPas encore d'évaluation
- Module 5 L' Evaluation D'une Sequence de FormationDocument24 pagesModule 5 L' Evaluation D'une Sequence de FormationAbdou KarimPas encore d'évaluation
- Améliorer sa pédagogie: Les 3 premiers outils à utiliserD'EverandAméliorer sa pédagogie: Les 3 premiers outils à utiliserPas encore d'évaluation
- L' L'EVALUATION DES COMPETENCES : UNE PLURALITE DE DEFIS: De la description à des pistes d’innovationD'EverandL' L'EVALUATION DES COMPETENCES : UNE PLURALITE DE DEFIS: De la description à des pistes d’innovationPas encore d'évaluation
- Construire des grilles d'évaluation descriptives au collégial: Guide d'élaboration et exemples de grilleD'EverandConstruire des grilles d'évaluation descriptives au collégial: Guide d'élaboration et exemples de grillePas encore d'évaluation
- La Qualité Dans La FormationDocument25 pagesLa Qualité Dans La Formationpaco100% (1)
- Thème 2 Cours Pedag Par ObectifsDocument11 pagesThème 2 Cours Pedag Par ObectifsFaya Girl100% (1)
- Approche Par CompétenceDocument90 pagesApproche Par Compétencesaidaggoun100% (4)
- APPROCHE PAR LES COMPETENCES PW OkDocument21 pagesAPPROCHE PAR LES COMPETENCES PW OkSéverine MartialPas encore d'évaluation
- Le Triangle DidactiqueDocument4 pagesLe Triangle DidactiqueCF TiaretPas encore d'évaluation
- Cours de Pedagogie 2024Document37 pagesCours de Pedagogie 2024tshibumeda839100% (2)
- Approches Et Methodes de FormationDocument39 pagesApproches Et Methodes de FormationDawn LightPas encore d'évaluation
- Approche Par ObjectifsDocument3 pagesApproche Par ObjectifsFatima Idrissi Zaki100% (2)
- Le Triangle Pédagogique de Jean HoussayeDocument8 pagesLe Triangle Pédagogique de Jean HoussayeS K100% (1)
- Guide Pédagogique Du FormateurDocument209 pagesGuide Pédagogique Du Formateurolivier_rondouin100% (1)
- 5-Animation Et Évaluation Des ActivitésDocument19 pages5-Animation Et Évaluation Des ActivitésMikael IshakPas encore d'évaluation
- Cours SI 8 Methodes PedagogiquesDocument22 pagesCours SI 8 Methodes PedagogiquesOuezna BahloulPas encore d'évaluation
- Methode ActiveDocument13 pagesMethode ActiveSagacious IvejutenPas encore d'évaluation
- Ingénierie de La FormationDocument24 pagesIngénierie de La FormationZaitri NawalPas encore d'évaluation
- Ingenierie de Formation Et Competences Professionnelles Des Enseignants de Leducation de Base Dans La Region de LAdamaoua Au CamerounDocument417 pagesIngenierie de Formation Et Competences Professionnelles Des Enseignants de Leducation de Base Dans La Region de LAdamaoua Au CamerounBasile HounsalaPas encore d'évaluation
- Andragogie Module VF 10-12-19 OUCHDocument67 pagesAndragogie Module VF 10-12-19 OUCHNihal AbbalPas encore d'évaluation
- Les Méthodes PédagogiquesDocument10 pagesLes Méthodes Pédagogiquesa montoya divardPas encore d'évaluation
- Module 1 Principes Pedagogiques de Base 1Document16 pagesModule 1 Principes Pedagogiques de Base 1Hassan ElhaoudPas encore d'évaluation
- Ingenierie de La Formation FNAC REVUDocument134 pagesIngenierie de La Formation FNAC REVUdidiPas encore d'évaluation
- Module 1 Principes Pedagogiques de BaseDocument23 pagesModule 1 Principes Pedagogiques de Basekrouma100% (3)
- L'approche Par CompétenceDocument6 pagesL'approche Par Compétencegffdu100% (1)
- Expose de La DidactiqueDocument15 pagesExpose de La DidactiqueAbdourahmanPas encore d'évaluation
- HEH Cours de Pédagogie 1re PS - 2013-2014 PDFDocument78 pagesHEH Cours de Pédagogie 1re PS - 2013-2014 PDFRachid MourabitPas encore d'évaluation
- Article Supplémentaire 1 - Objectifs Pédagogiques - KeteleDocument13 pagesArticle Supplémentaire 1 - Objectifs Pédagogiques - KeteleNarjs BelrhitPas encore d'évaluation
- Cours Didactique GeneraleDocument97 pagesCours Didactique GeneraleHoucine BousfihaPas encore d'évaluation
- 2015 Les Courants PedagogiquesDocument7 pages2015 Les Courants PedagogiquesPierre-Brice MankololoPas encore d'évaluation
- Pedagogie AndragogieDocument4 pagesPedagogie AndragogieSAKSIK0% (1)
- 1 - Approche Compétences PDFDocument72 pages1 - Approche Compétences PDFKamelozzz100% (1)
- Soutien Ped-Remediation Et AccompagnementDocument5 pagesSoutien Ped-Remediation Et Accompagnementilham pro100% (1)
- SITUATION D'Apprentissage Et Séquence Pédagogique Relu FrischDocument9 pagesSITUATION D'Apprentissage Et Séquence Pédagogique Relu FrischWilliam Ruotti100% (1)
- Ingénierie DidactiqueDocument10 pagesIngénierie DidactiquemouradgourmajPas encore d'évaluation
- Abcd de L'ingenierie de La Formation Au Mali - 2irh PDFDocument21 pagesAbcd de L'ingenierie de La Formation Au Mali - 2irh PDFSayb Sam Goïta100% (1)
- Cours PPO ESEP Agadir 2023-2024Document58 pagesCours PPO ESEP Agadir 2023-2024Rãçhida ÅfkïrPas encore d'évaluation
- Approche Par Competences de KeteleDocument35 pagesApproche Par Competences de Keteleاركيك75% (4)
- Definitions PedagogiquesDocument6 pagesDefinitions Pedagogiquesastrid navarroPas encore d'évaluation
- La Pédagogie de ProjetDocument2 pagesLa Pédagogie de Projetgeniemaroc100% (3)
- Les Méthodes PédagogiquesDocument3 pagesLes Méthodes PédagogiquesursusomnorosPas encore d'évaluation
- Cours PsychopédagogieDocument39 pagesCours PsychopédagogiebonijunkouPas encore d'évaluation
- Théories de L'apprentissage Les PédagogiesDocument5 pagesThéories de L'apprentissage Les PédagogiesabdeljebbarmPas encore d'évaluation
- Ingenierie FormationDocument184 pagesIngenierie FormationSalma Semlil100% (1)
- Introduction Didactique PDFDocument34 pagesIntroduction Didactique PDFIst Mir Egal100% (1)
- Exercice Ingenierie de La FormationDocument4 pagesExercice Ingenierie de La FormationYAO LUC DJEPas encore d'évaluation
- Exposé Sur La Gestion Du Temps Et de L'espaceDocument39 pagesExposé Sur La Gestion Du Temps Et de L'espaceNadia Benrhenia100% (1)
- Probabilite Probabilite Probabilite Probabilites S S S: Séries D'exercicesDocument4 pagesProbabilite Probabilite Probabilite Probabilites S S S: Séries D'exercicesBayrem jlklskjPas encore d'évaluation
- Vampire Mascarade - Rituel D'obténèbrationDocument12 pagesVampire Mascarade - Rituel D'obténèbrationEntité Virtuelle / TyrnisPas encore d'évaluation
- Graphes 02-03 PDFDocument27 pagesGraphes 02-03 PDFAZ3RPas encore d'évaluation
- Corrigé Du Test de Contrôle Continu - Modélisation Des Systèmes CommunicantsDocument1 pageCorrigé Du Test de Contrôle Continu - Modélisation Des Systèmes CommunicantsSel MaPas encore d'évaluation
- La Théorie D'ibn Rochd (Averroès) Sur Les Rapports de La Religion Et de La Philosophie (Léon Gauthier)Document214 pagesLa Théorie D'ibn Rochd (Averroès) Sur Les Rapports de La Religion Et de La Philosophie (Léon Gauthier)ahikar1100% (1)
- ProjetDocument2 pagesProjetAbdellatif ZanniPas encore d'évaluation
- Statistique Inférentielle-Cours CompletDocument99 pagesStatistique Inférentielle-Cours CompletbakLtr100% (1)
- Hpe-3 1Document11 pagesHpe-3 1Etudiants CFIEPas encore d'évaluation
- Ejercicios Libro de Frances Pag 118,120Document2 pagesEjercicios Libro de Frances Pag 118,120Laura CepedaPas encore d'évaluation
- GlossaireDocument10 pagesGlossaireaeroPas encore d'évaluation
- Mind Map École SystémiqueDocument1 pageMind Map École Systémiquerajae.cherkaoui45Pas encore d'évaluation
- Malik Elhouyoun Ahamadi PC m2 2010Document107 pagesMalik Elhouyoun Ahamadi PC m2 2010Ahamadi Elhouyoun100% (1)
- La Terre, La Femme Touareg - LibreDocument16 pagesLa Terre, La Femme Touareg - LibreIdir MazighPas encore d'évaluation
- Cours de PlongéeDocument7 pagesCours de PlongéecinscriptionPas encore d'évaluation
- Corrige Mines Ponts 2009Document10 pagesCorrige Mines Ponts 2009api-3834502Pas encore d'évaluation
- Manuel Blocs en BétonDocument12 pagesManuel Blocs en BétonSimohamed MorissiPas encore d'évaluation
- Comment Extraire La Sémantique D'une Image ?: Alain Boucher Et Thi-Lan LeDocument12 pagesComment Extraire La Sémantique D'une Image ?: Alain Boucher Et Thi-Lan LeaichaPas encore d'évaluation
- TP Deformation PortiqueDocument12 pagesTP Deformation PortiqueAla KhazriPas encore d'évaluation
- Classe Ouvriere Livre 1Document100 pagesClasse Ouvriere Livre 1Fernando UrreaPas encore d'évaluation
- TheseduclosDocument210 pagesTheseduclosKadoockPas encore d'évaluation
- Scaligero Massimo - Techniques de Concentration IntérieureDocument74 pagesScaligero Massimo - Techniques de Concentration IntérieureepoptaePas encore d'évaluation
- Annexe B - Exemple Annoté de Matrie Du Cadre Logique D'un ProjetDocument27 pagesAnnexe B - Exemple Annoté de Matrie Du Cadre Logique D'un Projetperico1962100% (1)
- DD 3 Ec 65Document2 pagesDD 3 Ec 65dayangPas encore d'évaluation
- Herm 002 0226 PDFDocument13 pagesHerm 002 0226 PDFJeanPas encore d'évaluation
- RPC en VBDocument8 pagesRPC en VBMarwane BelahcenPas encore d'évaluation
- En Quoi Le Lieu de Résidence D'un Individu Permet-Il de Révéler SonDocument4 pagesEn Quoi Le Lieu de Résidence D'un Individu Permet-Il de Révéler SonYanis Lescop100% (1)