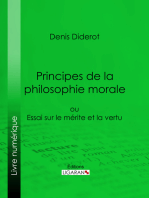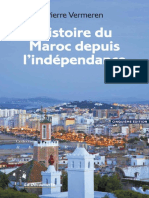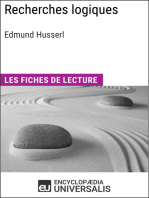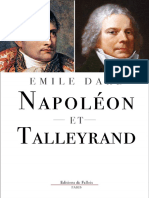Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Les Lumières Et La Dialectique, de Hegel À Adorno
Transféré par
abderrrassoulTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Lumières Et La Dialectique, de Hegel À Adorno
Transféré par
abderrrassoulDroits d'auteur :
Formats disponibles
* (Ce texte est paru dans la Revue philosophique de Louvain, No.
4/2003,
p. 568-592.)
Les Lumires et la dialectique
De Hegel Adorno et Horkheimer
Rsum
la lumire de la rception du Neveu de Rameau de Diderot par Hegel et de celle dHistoire de
Juliette du marquis de Sade par Adorno et Horkheimer, le prsent essai met en lumire la critique que la
tradition dialectique a effectue lgard de lAufklrung. Depuis Kant, il ny a pas de critique de la raison
qui ne soit pas en mme temps une dfense de la raison contre elle-mme. Comment cette exigence se
ralise-t-elle chez Hegel et chez Adorno et Horkheimer? Cest en dveloppant cette question que nous
pourrons saisir pourquoi la rponse celle-ci nengage ni loptimisme de Hegel pour la raison absolue ni
au pessimisme dAdorno et Horkheimer lgard du destin de la raison.
Abstract
By focusing on Hegels treatment of Diderots The Nephew of Rameau and that of Adorno and
Horkheimer of de Sades History of Juliette, the present essay highlights the dialectic traditions critique of
the Enlightenment. Since Kant, there has been no critique of reason which has not at the same time
provided a defense of reason against itself. How does this exchange of critique and defense of reason
manifest itself in Hegel and in Adorno and Horkheimer? By exploring this question we can come to see
that the answer commits us neither to Hegels optimism nor to Adorno and Horkheimers pessimism with
respect to the destiny of reason.
Depuis Kant la figure de la raison claire est insparable de lide que la
vritable conscience critique de la raison implique ncessairement une dfense de la
raison contre elle-mme. Dans lhorizon de la pense kantienne elle-mme, la raison
critique est explicitement accompagne par la conscience dune dialectique de la raison.
On peut mme dire que la problmatique de la dialectique chez Kant constitue en ellemme la plus belle dfense, illustration et application de la perspective critique, qui est
celle du problme soulev par les prtentions et les limites de la raison elle-mme. Dans
son uvre critique, Kant assigne la dialectique le rle dune mise en garde contre les
dangers de la raison provenant de sa propre nature, laquelle se caractrise par la
recherche de linconditionn. La qute mtaphysique de lUnbedingtes reprsente un
pril minent pour la raison dans la mesure o elle peut aveugler celle-ci sur ses propres
limites. La raison qui reprsente linstance mancipatrice par excellence, celle par
laquelle il est possible de transgresser les limites du conditionn, est aussi
paradoxalement celle-l mme qui bascule aussitt dans lirrationnel lorsque livre elle
seule elle se risque au-del des conditions de lexprience possible. Dans les chapitres
que Kant consacre la dialectique de la raison dans les domaines de la connaissance et de
la morale, la dtermination critique quil assigne la dialectique est essentiellement
dordre ngatif ou restrictif, cest--dire ayant pour fonction principale de dsavouer les
formes dun usage abusif de la raison par elle-mme.
Tout en se rclamant de lavance de Kant sur la reconnaissance dune dialectique
de la raison, la philosophie postkantienne qui lui a succd, notamment celle de Hegel
aura tt fait de constater que la philosophie critique de Kant nest pas, quant elle, une
philosophie dialectique. Selon Hegel, mme si Kant a le grand mrite davoir reconnu la
contradiction immanente de la raison avec elle-mme1, le statut de la dialectique est
rduit dans le criticisme kantien une leon de rhtorique sur des figures sophistiques de
la raison. Tout comme Aristote a limit le pouvoir de la dialectique ne jouer quun rle
1
Dans lEncyclopdie des sciences philosophiques, Hegel mentionne lapport majeur de
la philosophie kantienne pour la reconnaissance de la signification philosophique des
antithses (les antinomies comme antagonisme oppositionnel immanent de la raison) pour
la pense critique. Toutefois, Hegel reproche la philosophie kantienne de ne connatre
quune forme limite de la dialectique de la raison, pour autant que chez Kant les
antinomies de la raison sont limites au nombre de quatre selon la Critique de la raison
pure, alors quune philosophie vritablement dialectique considre limportance
constitutive des antithses au niveau de tous les objets, de toutes les reprsentations, de
tous les concepts et de toutes les ides. Voir, Enzyklopdie der philosophischen
Wissenschaften I, (Werke 8), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, 48, p.126-128;
Encyclopdie des sciences philosophiques I, (trad. Bernard Bourgeois), Paris, Vrin, 1979,
p.504-506. Mais cest surtout dans la Science de la logique que Hegel a dvelopp en
dtails le point de vue critique quil dfend lgard de Kant et sa limitation de
lextension des antinomies pour la pense dialectique. Voir, entre autres, Wissenschaft
der Logik I, (Werke 5), p.216-227. Pour un commentaire sur la critique hglienne des
propdeutique au domaine de la science, Kant ne considre pas que lon devrait accorder
la dialectique un rle fondationnel pour la philosophie. Aussi bien pour Aristote que
pour Kant, la dialectique nest pas le moteur de la dmonstration philosophique.2 Pour les
reprsentants dune philosophie dialectique, comme Hegel, lauto-contradiction de la
raison constitue, au contraire, le cur mme du dveloppement de la vrit
philosophique. En dpit de cette critique, il nen demeure pas moins que la problmatique
souleve par Kant portant sur les prtentions et les limites de la raison, dfaut de ne pas
accorder une valeur constitutive et systmatique au concept de dialectique reprsente un
impratif oprationnel auquel aucune forme de philosophie dialectique ne saurait se
soustraire sans mettre elle-mme en pril la valeur critique de la lgitimation de son
propre questionnement.
Dans la tradition philosophique post-kantienne, la philosophie dialectique sest
expose deux risques, opposs lun lautre, qui reprsentent en fait deux cueils
extrmes lgard desquels la pense critique devrait pouvoir se prmunir en
rflchissant sur les prtentions et les limites de la rationalit; celui dune surestimation
antinomies kantiennes, voir les analyses effectues par Andr Stanguennec dans son livre
Hegel critique de Kant, PUF, Paris 1985, p.151-165.
2
On se souviendra ici de la Prface de la Phnomnologie de lesprit o Hegel
constate que depuis que la dialectique a t spare de la preuve, cest en fait le concept
de dmonstration philosophique qui sest perdu. Luvre philosophique vise par cette
affirmation est bien entendue celle dAristote qui remplace largumentation dialectique
par la logique du syllogisme comme organon de la science et ne reconnat plus la
dialectique quune fonction rhtorique et pratique et non plus thorique et spculative.
Phnomenologie des Geistes, (Werke 3), Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1986, p.61;
Phnomnologie de lesprit, (trad. Jean-Pierre Lefebvre), Paris, Aubier, 1991, p.71. Dans
ce qui suit, je renvoie dabord ldition allemande des uvres de Hegel (Suhrkamp) et
ensuite la traduction franaise. Pour la Phnomnologie de lesprit, jemploierai
dsormais le sigle PdG pour dsigner ldition allemande et le sigle PdE pour ldition
franaise. Pour les Cours sur lesthtique, jutiliserai le sigle V(I,II,III) pour les tomes
de ldition allemande et le sigle CE(I,II,III) pour ceux de la traduction franaise Cours
du pouvoir critique de la raison et celui dune sous-estimation de celui-ci. Une confiance
aveugle dans le pouvoir de la raison parat aussi peu raisonnable quune mfiance
gnralise envers celui-ci. Loptimisme dmesur en la raison peut dboucher sur
lassurance surfaite dune pense, qui, se voulant absolument certaine delle-mme,
prtend abolir une fois pour toutes la dialectique de la raison dans la victoire intgrale
dune raison dleste de toutes contradictions, parce que les ayant supposment toutes
surmontes; linverse, le pessimisme dmesur en la raison peut aboutir, quant lui, sur
un constat dimpuissance de lhumanit contrer la course effrne dune raison au prise
avec sa propre volont de domination, celle par laquelle celle-ci finit par chuter
fatalement dans lirrationnel. Telle pourrait tre limage plausible, bien que caricaturale,
que lon puisse donner des formes radicalement opposes de la dialectique moderne telle
quelle se trouve incarne dans les termes de lidalisme absolu de Hegel et dans ceux de
la thorie critique dAdorno et Horkheimer. Dun ct, une raison triomphante, de lautre
une raison pernicieuse. Dune part, le rcit dune raison dont la fin est lheureux
accomplissement delle-mme; dautre part, celui dune raison qui laisse prsager une fin
dsastreuse. On peut douter que ces deux scnarios opposs du destin de la raison
puissent vritablement nous satisfaire. En effet, labsolutisation immanente qui
hypothque chacune de ces positions extrmes nous prsente le rcit de deux histoires
apparemment diffrentes, mais qui sont tonnamment ressemblantes lorsque lon
considre ce quelles ont en commun, savoir que dans le rcit de chacune delles lissue
est finalement reconnaissable ds les premires scnes.
desthtique(I,II,III), trad. J.-P. Lefebvre & V. von Schenk, Paris, Aubier, 1995, 1996,
1997.
Il est un paradoxe trs singulier de la pense dialectique qui rside en ceci que,
tout en prtendant viser et rvler quelque vrit absolue ou dmasquer et dnoncer
quelque fausset totale, celle-ci savre en fait beaucoup plus productive et significative
par le travail de la mdiation critique quelle effectue entre les termes antithtiques, cest-dire ceux qui sont extrmement opposs, du moins apparemment, les uns aux autres. Je
dis apparemment en prenant soin de souligner le mot, parce que la dialectique est aussi
lart de montrer que ce qui est apparemment oppos se rvle plutt intimement reli au
point o les positions extrmes se ressemblent plus quelles ne le supposent et sans doute
ne le voudraient elles-mmes. De ce point de vue, on pourrait dire que la dialectique est
lart de montrer des rapprochements entre ce qui apparat tout dabord irrconciliable.
Quoiquil en soit, les mdiations par lintermdiaire desquelles la dialectique institue son
travail conceptuel sont les centres nvralgiques de son activit vritablement critique. Il
faut considrer ces lieux de mdiation non pas comme tant soumis lidal datteindre,
cote que cote, un juste milieu entre les opposs ou comme tant assujettis limpratif
spculatif de raliser une rconciliation dfinitive entre ceux-ci3, mais plus ralistement et
beaucoup plus modestement comme tant la tentative de proposer des essais de rsolution
permettant de trouver des terrains dentente partir desquels il est pensable et souhaitable
que les extrmes puissent non seulement se rencontrer, mais commencent avant tout par
apprendre eux-mmes se mdiatiser par rapport la radicalit de leurs positions
respectives. Toutefois il serait aussi tmraire quillusoire de vouloir prsenter la
mdiation comme tant par elle-mme la solution miracle ou reprsentant une garantie de
3
Il faut viter ici le danger dune rconciliation extorque, qui est videmment tout le
contraire dune vritable rconciliation. titre de mise en garde contre lextorsion de la
rconciliation, je renvoie larticle significatif dAdorno contre Lukcs et Hegel. Voir
russite infaillible. Tel ne peut tre le cas, car, en effet, il ne dpend pas de celle-ci, mais
bien de la capacit des positions en cause dassumer chacune pour soi la part de
mdiation qui lui revient. Dans le cas prsent, comme il est impossible que nous
puissions attendre que chacun des partis en cause prenne sur lui une telle tche, on
devinera sans peine que celle-ci sadresse plutt nous. Dans les rflexions qui vont
suivre, jaimerais tenter de rapprocher les positions dialectiques de Hegel, dAdorno et
Horkheimer en mettant en relief ce quelles ont en commun dans leur estimation critique
respective de lAufklrung. Je me demanderai ensuite si cet lment commun ne les
rapproche pas finalement de la position de Kant plus quils ne seraient disposs
ladmettre eux-mmes.
Du point de vue de lhistoire de la modernit, la pense critique est reconnue
comme le fruit de la philosophie du XVIIIe sicle, que lon nomme parfois
significativement le sicle des philosophes, dont luvre de Kant reprsente lexpression
la plus dlibre et la plus explicite. Le sicle des Lumires se veut expressment celui de
la raison critique, celle qui, la fois, se dclare lultime juge et prtend tre aussi le
meilleur juge de soi-mme. Il va de soi que cette problmatique des Lumires ne sest pas
uniquement cristallise dans luvre philosophique de Kant. Aussi bien Hegel
quAdorno et Horkheimer ont rserv une place prpondrante des uvres littraires du
XVIIIe sicle lintrieur desquelles ils ont cru reconnatre les enjeux philosophiques de
la raison claire telle que pense dans la philosophie des Lumires. Ceci est
particulirement le cas pour Hegel dans la lecture quil effectue du Neveu de Rameau de
Diderot et pour Adorno et Horkheimer dans celle quils consacrent lHistoire de Juliette
Une rconciliation extorque dans : Notes sur la littrature, Flammarion, Paris, 1984,
p.171-199.
du marquis de Sade. Lorsque lon se situe dans loptique de la pense dialectique (jy
reviendrai bien sr), il nest pas surprenant que Hegel ait pris un intrt tout particulier au
Neveu de Rameau de Diderot et quAdorno et Horkheimer aient choisi pour leur analyse
de procder une lecture philosophique de lHistoire de Juliette de Sade. Pour mon
propos, la question ultime restera de savoir et de spcifier en quoi ces choix respectifs ont
valeur de rceptions critiques de la philosophie du XVIIIe sicle, lesquelles constituent
un terrain de rencontre possible entre Hegel, Adorno et Horkheimer sur la question de la
nature critique de la rationalit dialectique. Mon essai se divisera en trois parties: (1) la
premire concernera le rle de la rception du Neveu de Rameau dans le trajet de la
Phnomnologie de lesprit, (2) la seconde portera sur la place quAdorno et Horkheimer
ont rserve lHistoire de Juliette dans le projet de la Dialectique de la raison et (3) la
troisime partie tentera de rpondre la question que je viens linstant de formuler en
dgageant ce quont en commun pour la problmatique critique de la rationalit
dialectique les lectures proposes par Hegel, Adorno et Horkheimer propos du Neveu de
Rameau de Diderot et de lHistoire de Juliette du marquis de Sade.
(1) La Phnomnologie de lesprit et Le Neveu de Rameau
Je commencerai par un constat philologique qui servira indiquer ds le dpart
les limites de linterprtation hglienne de luvre de Diderot et celles que je
mimposerai aussi dans lexpos suivant. Hegel a trs peu parl de Diderot. Les
occurrences explicites o Diderot est voqu sont principalement de deux ordres; ou bien
Diderot est appel comme lun des reprsentants majeurs de la philosophie des Lumires
franaise4, ou bien Hegel se rfre quelques passages de son uvre littraire
lintrieur dune analyse philosophique o il fait intervenir ceux-ci titre dillustration de
ses propres thses5. En un mot, ce serait une vaine entreprise que de vouloir chercher une
interprtation intgrale et mme littrale de luvre de Diderot pour elle-mme chez
Hegel. Mais si lon veut bien reconnatre et accepter cette limite, il peut devenir
intressant, par ailleurs, de se demander ce que signifie dans lhorizon du projet de la
Phnomnologie de lesprit le rle critique que Hegel accorde au Neveu de Rameau de
Diderot. En un mot, ce qui va mintresser ici, ce nest pas luvre de Diderot pour ellemme, do les limites de ma prsentation, mais la signification philosophique de la
rfrence au Neveu de Rameau pour et selon la perspective dialectique de Hegel.6
Dans quelle partie de la Phnomnologie de lesprit Hegel voque-t-il le Neveu de
Rameau de Diderot? Pour rpondre cette question, commenons par un bref rappel de
4
Cf. Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie III, (Werke 20), p.294.
Dans un manuscrit de 1807 (donc lanne de la parution de la Phnomnologie de
lesprit) intitul Wer denkt abstract? o il est question de la dialectique du matre et de
lesclave, Hegel fait allusion explicitement Jacques le fataliste. Cf. Jenaer Schriften
1801-1807, (Werke 2), p.580. Dans ses Cours sur lesthtique, Hegel se rfre tantt la
dramaturgie de Diderot (V(II), p.224; V(III), p.491; CE(II), p.212; CE(III), p.464)
tantt son Essai sur la peinture (V(III), p.77-79; CE (III), p.70-73). Mais aucun de
ces endroits Hegel ne propose une exgse explicite de lune de ces uvres de Diderot.
6
Dans la Phnomnologie de lesprit, Hegel ne cite, en tout et partout, qu quatre
reprises le Neveu de Rameau de Diderot, quil lit dans la traduction effectue par Goethe,
mais quil modifie au moins une occasion (PdG, p.365, 387 [la seconde citation de cette
page a t modifie par Hegel] et 402 ; PdE, p.334, 353 [la seconde citation de cette page
a t modifie par Hegel] et 367). Comme lobjectif de mon interrogation est de souligner
limportance philosophique de la rfrence de Hegel au Neveu de Rameau dans le trajet
de la Phnomnologie de lesprit, il ne sera donc pas question ici dtablir un tableau
comparatif permettant de juger si linterprtation hglienne rend compte de toute la
richesse littraire de luvre de Diderot. Sur la possibilit de cette tude comparative, je
renvoie toutefois larticle incontournable de Herbert Dieckmann Diderots Le Neveu de
Rameau und Hegels Interpretation des Werkes, dans : Diderot und die Aufklrung
(Hrsg. H. Dieckman), Mnchen, 1980, p.161-173; la suite de cet article, p.175-194, le
lecteur trouvera galement une discussion critique des questions souleves par cette
contribution.
5
lobjectif densemble et de la dynamique de cet ouvrage. Dun point de vue structurel et
historique, la Phnomnologie de lesprit est construite sur le modle progressif dune
chelle sur les barreaux gradus de laquelle Hegel reconstruit la gense de la raison aussi
bien dans lordre de la rationalit thorique que dans celui de la rationalit pratique.7 La
thse clbre de Hegel selon laquelle la vrit philosophique est concevoir la fois
comme substance et comme sujet ne vaut pas simplement pour le domaine de la raison
spculative, mais aussi pour celui de la raison pratique.8 Hegel dveloppe cette thse en
prenant comme fil conducteur les expriences que la conscience fait lgard de ses
prtentions immdiates la vrit aussi bien dans le champ de ses considrations
thoriques que dans celui de ses convictions pratiques. Ainsi, la logique de la succession
des figures de lesprit se fonde, selon Hegel, sur la ncessit interne de transformations
qui simposent la conscience, chemin faisant, lorsquelle dcouvre la distance qui
spare le concept quelle se fait de la chose et la chose telle quelle est en elle-mme.9
Dans son ensemble, la Phnomnologie de lesprit retrace donc les diffrentes figures qui
constituent les cristallisations successives adoptes par la conscience de son tat naturel
7
Jemprunte cette image de lchelle au titre de louvrage monumental de H. S. Harris
Hegels Ladder consacr linterprtation intgrale de la Phnomnologie de lesprit.
Rsultat de plus de trente annes de recherche, cet ouvrage est certainement considrer
comme le plus exhaustif qui soit en ce qui concerne lexplication et le commentaire
littral de la Phnomnologie de lesprit. Cf. Hegels Ladder I : The Pilgrimage of
Reason; Hegels Ladder II : The Odyssey of Spirit, Hackett Publishing Compagny, Inc.,
Indianapolis/Cambridge, 1997.
8
Cf. PdG, p.22-23 ; PdE, p.37. Il apparat important de le souligner explicitement, si lon
considre que cette affirmation de Hegel se trouve dans la Prface de la
Phnomnologie de lesprit, dont on sait le statut particulier que Hegel lui donne dun
point de vue systmatique. Dans la prface, cette affirmation de Hegel concerne
directement le domaine de la raison spculative. Mais il ne fait pas de doute, en
considrant le contenu de la Phnomnologie de lesprit et le principe dialectique qui
anime le dveloppement de ce contenu que cette thse sapplique tout autant, sinon plus,
au domaine de la raison pratique.
9
Cf. PdG, p.76-80 ; PdE, p.87-90.
10
initial jusquau savoir philosophique ultimement abouti. Par-del laspect structurel qui
dfinit le contour distinctif de chacune de ces figures de lesprit, Hegel prend aussi en
considration lhistoricit de celles-ci en se rfrant au cours de ses analyses diffrentes
priodes historiques de la pense occidentale. En ce qui a trait la rfrence au Neveu de
Rameau, la priode historique concerne est clairement celle de la modernit dans ltat
o elle se trouve au sicle des Lumires. Hegel se rfre luvre de Diderot dans la
seconde partie de la Phnomnologie de lesprit, laquelle aborde la problmatique de la
praxis qui reprsente, comme on sait, lobjet traditionnel de la philosophie pratique. Dans
la premire partie de la Phnomnologie de lesprit, Hegel sest intress la question de
la connaissance, objet traditionnel de la philosophie thorique, o il sest consacr
dmontrer la constitution dialectique des formes lmentaires du savoir, telles la
sensation, la perception et lactivit conceptuelle de lentendement, qui se trouvent
thmatises comme les formes successives (cumulatives et inclusives) de la conscience
dun monde objectal se rvlant celle-ci de plus en plus dtermin et complexe suivant
lvolution du mode dapprhension. la diffrence de cette premire partie, la seconde
partie de louvrage ne porte plus sur la forme dune conscience consciente dun monde
dobjets, mais prend dsormais en considration une conscience consciente de soi et
consciente dautrui. Le monde des consciences de soi est le monde intersubjectif de la vie
politique, sociale et culturelle. Cest prcisment dans lhorizon de ce monde
intersubjectif que Hegel voque la figure du neveu de Rameau comme lincarnation de la
conscience de soi parfaitement consciente dexister avec autrui dans un monde constitu
par les conventions sociales, politiques et culturelles. Comme nous allons le voir
11
linstant, cest la nature de ce rapport soi et au monde qui va intresser Hegel dans sa
rfrence au Neveu de Rameau de Diderot.10
Dans les analyses que Hegel effectue au chapitre VI de la Phnomnologie de
lesprit intitul Der Geist, il sapplique diffrencier le rapport de la conscience de soi
elle-mme et son monde selon trois configurations diffrentes; la premire quil
dsigne par Lesprit vrai. La Sittlichkeit correspond du point de vue historique la
priode de lAntiquit; la seconde et la troisime, intitules respectivement Lesprit
tranger lui-mme. La Bildung et Lesprit certain de soi-mme. La Moralitt se
rapportent ltat du monde moderne. Il est important de garder lesprit que ces trois
configurations se succdent selon le mouvement dialectique que Hegel utilise comme
principe heuristique permettant dexpliquer le dveloppement de la conscience, laquelle,
au cours de la progression de ses expriences, se trouve remise en cause par lapparition
thmatique de dterminations non encore rflchies qui font natre en elle le besoin (la
ncessit) de se transformer pour rpondre aux donnes nouvelles auxquelles elle se
trouve alors expose. Cette progression dialectique se dcrit comme un enrichissement
sur deux plans diffrents mais corrlatifs lun lautre; dune part, une transformation de
lauto-comprhension de la conscience (la conscience comme sujet agissant) et dautre
part, une comprhension plus labore de la complexit du monde (le monde comme
objet dune praxis). La section particulire du chapitre VI qui doit nous intresser ici est
celle qui porte sur Lesprit devenu tranger lui-mme. La Bildung.
10
Pour viter tout malentendu, je rserverai, lavenir, les italiques strictement pour
dsigner louvrage de Diderot le Neveu de Rameau, tandis que jutiliserai sans italique la
figure du neveu de Rameau lorsquil sera fait rfrence, non pas louvrage de Diderot,
mais au personnage du neveu.
12
Dans lanalyse que Hegel a effectue dans la premire section du chapitre VI
intitule Lesprit vrai. La Sittlichkeit, il sest surtout concentr sur lide dun rapport
harmonieux, spontan et presque naturel de la conscience grecque vis--vis de la
rationalit de son monde. Lantiquit grecque ne remet pas en cause la rationalit
fondamentale du monde; au contraire, la conscience grecque, confiante en elle-mme et
certaine de la substantialit de son monde, incarne la figure dune conscience en
harmonie avec la totalit de ce qui est. Mais cette assurance initiale de la conscience de
soi antique naura dur finalement, selon Hegel, que lespace dune trs courte priode.
Dans son analyse du monde grec, Hegel sappuie sur une interprtation fameuse
dAntigone de Sophocle pour dcrire comment la dissolution de ce rapport de la
conscience de soi antique lgard de son monde sintroduit par la revendication dun
droit individuel en conflit dclar avec les lois de la cit. Il nest pas question ici de
suivre cette analyse pour elle-mme.11
Toutefois, soulignons un parallle qui simpose de lui-mme la lecture des
analyses effectues dans les deux premires sections du chapitre VI de la
Phnomnologie de lesprit ; linterprtation dAntigone de Sophocle est la description
du monde antique, ce que le rle que fait jou Hegel au Neveu de Rameau de Diderot est
la description du monde moderne.12 Certes ce paralllisme nest pas parfait, car la
figure dAntigone est pour ainsi dire une exception dans le monde grec, alors que celle du
11
ce propos, voir les analyses approfondies de Christoph Menke dans son livre
Tragdie im Sittlichen. Gerechtigkeit und Freiheit nach Hegel, Suhrkamp, Frankfurt am
Main, 1996.
12
Ce parallle a t mis en vidence, entre autres, par Bernard Sypp dans son article
intitul Die Lektren von Le Neveu de Rameau durch Hegel und Foucault, dans :
Diderot und die Aufklrung (Hrsg. H. Dieckman), Mnchen, 1980, p.139.
13
neveu de Rameau est une tendance prdominante dans le monde moderne.13 Antigone est
une tragdie qui illustre le conflit qui peut exister entre lindividuel et le collectif, mais ce
conflit est pour Hegel un phnomne isol dans le monde grec et nest pas reprsentatif
de la conscience grecque commune. Il naffecte pas, selon Hegel, la nature de la relation
fondamentalement confiante de la conscience individuelle commune par rapport la
cohsion substantielle du monde grec. Pour Hegel, cette relation nest pas encore
rflchie pour elle-mme dans le monde grec; ce qui fait que la conscience grecque nest
pas dchire en elle-mme et par rapport son monde. Or cest prcisment la nature de
cette relation qui subit une profonde mutation dans lhorizon du monde moderne. La
figure du neveu de Rameau est lillustration de lindividualit moderne typique, laquelle
est parfaitement consciente dtre la fois lorigine des conventions sociales, politiques
et culturelles et en mme temps revendique pour soi sa propre irrductibilit14.
13
Dun point de vue strictement philologique, il est remarquer que Hegel propose un
commentaire dAntigone, ce qui nest pas le cas en ce qui concerne sa rfrence au Neveu
de Rameau. Hegel labore non seulement ce commentaire dAntigone dans la
Phnomnologie de lesprit, mais il reprendra plus tard les grandes lignes de son analyse
dans le cadre de ses Cours sur lesthtique, alors quaucune rfrence nest faite au
Neveu de Rameau dans le contexte de ses rflexions esthtiques. Dans ses Cours sur
lesthtique, Hegel souligne toutefois deux reprises lapport fondamental de Diderot en
ce qui concerne la revendication pour la naturalit de lexpression au thtre (cf. ici la
note 5 pour les rfrences au texte). Dans lensemble des rfrences de Hegel luvre
littraire de Diderot, un intrt marquant se manifeste pour la problmatique du langage
aussi bien pour laspect dialogique et rflexif de celui-ci que pour la recherche dune
expression naturelle, juste et dpourvue du caractre oblig li aux conventions sociales
et culturelles. Cette admiration de Hegel pour le talent dialogique et dialectique de
lexpression littraire de Diderot sest conserve jusque dans ses derniers crits, comme
en tmoigne le manuscrit sur Solger de 1828 o Hegel reconnat les uvres de Diderot
comme Meisterwerke des dialogischen Vortrags. Cf. Berliner Schriften 1818-1831,
(Werke 11), p.269.
14
Les commentateurs ont largement soulign que les dveloppements de Hegel effectus
dans la section portant sur lAufklrung dans la Phnomnologie de lesprit visent
particulirement la philosophie des Lumires en France, comme en tmoigne, entre
autres, la priode historique de la terreur succdant la rvolution franaise. (Voir la
section intitule La libert absolue et la terreur dans la Phnomnologie de lesprit;
14
Dans ce qui suit, jaimerais montrer comment, par lintermdiaire de la figure du
neveu de Rameau, Hegel problmatise le projet philosophique de la philosophie franaise
des Lumires quil dtermine comme une philosophie ngative de la raison critique.15
Dans la mesure o la philosophie des Lumires revendique une autorit exclusive de la
raison comme ultime source de justification, elle ne libre pas seulement les individus des
dogmes traditionnels, mais elle produit en mme temps, selon Hegel, les conditions pour
diviser la conscience de soi de lindividu moderne par rapport son monde.16 Dans ses
PdG, p.431-441; PdE, p.390-398.) En fait, on saccorde pour reconnatre que lanalyse
que Hegel effectue la section B. Lesprit devenu tranger lui-mme; la culture du
chapitre VI correspond une description de la priode de transition historique dont le
point de dpart serait la culture classique du XVIIime sicle et le point darrive
lirruption et ltablissement dune nouvelle culture, celle du XVIIIime sicle. En
dautres termes; on passerait ici de la priode pr-rvolutionnaire celle de laprsrvolution. En ce qui concerne la rfrence au Neveu de Rameau dans ce contexte, elle
correspond au moment o les valeurs de la culture dune raison classique sont remises en
cause par une raison qui se veut critique. Dans cette optique, la rfrence au Neveu de
Rameau peut tre considre comme le moment o la raison classique normative est
dtrne par la raison critique rflexive. Dun point de vue philosophique, la tche qui
simpose sera donc celle de repenser nouveaux frais larticulation entre la rflexivit de
la raison critique et le pouvoir de normativit de la raison substantielle. Cest cette tche
que Hegel nous convie par ses analyses.
15
De manire gnrale, Hegel considre que la philosophie franaise des Lumires a t
plus radicale et intransigeante dans le traitement quelle a rserv lradication des
prjugs et lgard de la foi religieuse. Sur son application ngative de la raison
critique, voir ici Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie III, (Werke 20), p.294295.
16
Et entrane aussi, pourrions-nous ajouter, la division de lindividu par rapport luimme. Une imposition verticale de la raison produit invitablement un refoulement de la
sensibilit et engendre un conflit interne chez lindividu entre sa rationalit et sa
sensibilit. Lorsque la raison veut prendre toute la place, elle aline forcment celle de la
sensibilit et prpare ainsi les conditions dun soulvement de la sensibilit contre elle.
On nencourage pas une part essentielle de lhomme se rebeller contre une autre part de
lui-mme, tout aussi essentielle, sans produire en celui-ci les ressorts dune gurilla qui
va finir par mal tourner. La raison contre et sans la sensibilit ou la sensibilit contre et
sans la raison, ce sont l, selon Hegel, deux formules idales pour produire linverse
dune vie claire et russie. En labsence dune mdiation permettant une nouvelle
alliance entre la raison et la sensibilit, on ne russit qu produire une confrontation
perptuelle entre celles-ci. On se rappellera ici que Hegel considre que cest de cette
division de lunit entre les composantes essentielles de lhomme que nat proprement le
15
Cours sur lhistoire de la philosophie, Hegel professera que ce qui caractrise en
particulier la philosophie des Lumires franaise ( la diffrence des traditions anglosaxonne et allemande), cest lapplication rsolument sans rserve de la ngativit de la
raison lgard de toute positivit.17 En fait, ce que Hegel reproche la philosophie des
Lumires, cest de dfendre unilatralement le pouvoir analytique de lentendement
(diviseur) en abandonnant le rle du pouvoir synthtique de la raison (rconciliateur);
bref, davoir rduit la raison lentendement18.
La lecture que Hegel effectue du Neveu de Rameau de Diderot cherche montrer
que la figure subjective du neveu de Rameau doit tre considre non seulement comme
le produit et laboutissement de la philosophie des Lumires, mais que celle-ci reprsente
aussi une autocritique des Lumires elles-mmes, qui peut valoir comme la vrit ultime
de leurs propres limites. Pour Hegel, le neveu de Rameau est lillustration dun Aufklrer,
besoin de la philosophie. Cf. Jenaer Schriften 1801-1807, (Werke 2), p.21; La diffrence
entre les systmes philosophiques de Fichte et Schelling, p.110.
17
Cf. Vorlesungen ber die Geschichte der Philosophie III, (Werke 20), p.294-295.
18
Il est connu que Hegel adresse explicitement ce reproche Kant dans la
Differenschrift. Cf. Jenaer Schriften 1801-1807, (Werke 2), p.11; La diffrence entre les
systmes philosophiques de Fichte et Schelling, (Trad. M. Mry), Ophrys, 1964, p.102.
Pendant la priode de jeunesse, Hegel a entretenu un rapport critique diversifi lgard
de Kant. Dun ct, il a considr la philosophie pratique de Kant comme la rfrence
permettant de critiquer la positivit de la religion chrtienne, mais il a critiqu Kant dun
autre ct comme celui qui a remplac lassujettissement des hommes lgard des lois
positives extrieures que pour mieux les assujettir une loi intrieure imprative qui
introduit une division en ceux-ci entre leur raison et leur sensibilit. Lorsque Hegel
abordera la philosophie thorique de Kant ce qui chronologiquement na pas t le
premier intrt de Hegel lgard de la philosophie kantienne il condamnera sans appel
le formalisme kantien et les interdits spculatifs sur lequel celui-ci se fonde. La
Differenzschrift reprsente le premier crit de Hegel qui prend explicitement une position
critique lgard de la philosophie thorique de Kant, alors que sa rception de la
philosophie pratique kantienne est documente depuis ses tout premiers crits
philosophiques, comme cest le cas, par exemple, dans le Tbingen Fragment. Sur le
contenu diversifi de la critique hglienne de Kant tout au long de luvre de Hegel, je
renvoie, de nouveau, louvrage de A. Stanguennec, Hegel critique de Kant, PUF, Paris
1985.
16
si bien avis et conscient de soi, si bien exerc la critique rflexive, quil se met
dlibrment jouer le jeu de celui qui pourchasse non seulement les prjugs et les
superstitions de toutes sortes, mais aussi tout ce qui est pos et affirm comme normes
par les conventions sociales, politiques et culturelles. En mettant au jour le rle de la
subjectivit dans linstauration de la normativit des valeurs, le neveu de Rameau se
trouve non seulement dissoudre la confiance objective des individus qui se rapportent
habituellement aux normes sociales et culturelles comme quelque chose dtabli par
nature ou par soi, mais il produit un tat de confusion pour la conscience commune qui
comprend les valeurs comme des universaux abstraits, cest--dire aussi bien
indpendants que transcendant les situations historiques. Ainsi, la conscience simple
(einfach) que Hegel nomme aussi la conscience noble, honnte et calme
(edelmtig, ehrlich und ruhig) prend la distinction entre le bien et le mal dans sa
signification universelle comme tant claire et vidente.19 Hegel montre que cette
dtermination repose sur lassurance de la conscience noble que le monde est tel quil est
dans sa positivit. Autrement dit, pour une telle conscience, le bien est le bien et le mal
est le mal. Or, cest prcisment cette assurance qui est mise lpreuve par la ralit du
monde des conventions sociales, culturelles et historiques. Le neveu de Rameau, que
Hegel voit comme une conscience fute mais crasse (niedertrchtig), cest--dire
capable de grossiret et de bassesse, se sert de son pouvoir de rflexion pour montrer
19
On trouve un passage o Hegel nonce trs clairement le principe de lexprience quil
dveloppera dans la dialectique quil se prpare prsenter dans son analyse entre la
conscience noble qui considre le bien et le mal comme une opposition absolue et ce que
contribue faire reconnatre la conscience crasse, savoir que lexprience concrte de la
ralit montre que non seulement on ne peut considrer le bien et le mal selon une
logique exclusive, mais que lun et lautre peuvent sintervertir selon les situations de la
ralit prsente. Cf. PdG, p.366; PdE, p.335.
17
qu lgard de la ralit donne le bien nest pas toujours le bien et le mal le mal.20 Dans
son analyse, Hegel insiste fortement sur cette inversion (Verkehrung) dialectique21
pour faire comprendre que la vrit ne peut pas tre tablie sans une mdiation de
luniversalit du concept avec la ralit, surtout pas lorsque celle-ci repose sur
lextriorisation de la subjectivit concrte comme sujet agissant.
En provoquant la conscience noble dans sa conviction universelle, la conscience
crasse la place devant une vrit quelle ne peut plus rejeter ou dsormais ignorer. Tout
en demeurant hbte et perplexe, la conscience noble se sent fortement attire par ce
discours plein desprit (geistreich)22 de la conscience crasse, qui sait dresser brle
pour point des rapprochements indits entre les choses du monde qui paraissent tre les
plus loignes. Les dissonances verbales du neveu de Rameau sont paradoxalement
consonantes. De tels discours ont le pouvoir de redonner aux individus le brin
dindividualit qui leur manque lorsque ceux-ci seffacent compltement derrire leurs
obligations remplir et se conforment aux rgles de la vie sociale. Le tissu social
reprsente le lieu dune vaste alination de la vie individuelle dans la mesure o les
individus en socit ny cherchent pas vritablement tre eux-mmes, mais sintressent
plutt prendre des positions diffrentes pour mieux rpondre aux attentes variables
dautrui et en tirer un profit pour soi.23 Devant une telle situation, le neveu de Rameau ne
trouve rien de mieux que de mimer tour de rles chacune de ces positions pour mieux
dnoncer le manque desprit critique lgard du cirque de la vie sociale et culturelle
moderne. En jouant ouvertement la comdie, il dmasque lhypocrisie du monde
20
Pour tout ce dveloppement, voir PdG, p.385-388; PdE, p.351-354.
Le thme de la Verkehrung est omniprsent dans la section consacre lEsprit devenu
tranger lui-mme. Voir, en particulier, PdG, p.385-387; PdE, p.351-353.
22
Cf. PdG, p.386; PdE, p.353.
21
18
moderne se cachant derrire les apparences du convenu.24 Il pratique ainsi, avec un art
mimtique qui place autrui devant un miroir projetant limage de leur vritable situation,
une dialectique applique de la raison critique qui ne semble pas avoir de fin prvisible.
Or, pour Hegel, la vritable question que lon doit adresser la philosophie des Lumires,
le point critique ultime partir duquel cette philosophie de la raison devrait tre value,
quant son vritable pouvoir de transformation relle, est celle de savoir, une fois tout
prjug et toute superstition bannis; quest-ce quon fait maintenant?25 La question
des limites de lusage critique de la raison fait partie intgrante de la recherche et de la
lgitimation dune rationalit substantielle. Que fait-on maintenant que la raison critique
a extermin prjugs et superstitions? Was nun weiter?
Cette question critique Hegel la pose explicitement non seulement pour indiquer
que la raison constructive (substantielle) doit pouvoir succder la raison critique
(dconstructive), mais aussi pour mettre en relief le ravage produit par le fanatisme dune
raison corrosive qui refuse de prendre sur elle la responsabilit de la recherche et de la
lgitimation de ce qui peut tre reconnu comme substantiel. Dans lhorizon de lanalyse
hglienne, le neveu de Rameau incarne la figure de la conscience rflexive devenue
trangre elle-mme par un surcrot dentendement. travers sa rfrence au Neveu de
Rameau de Diderot, Hegel dcrit les effets pervers dune rationalit qui sest pour ainsi
23
Diderot, Le Neveu de Rameau, Garnier-Flammarion, Paris, 1983, p.125-126.
Selon H. S. Harris, Rameau expresses the rational comedy of the Enlightenment. Cf.
Hegels Ladder II : The Odyssey of Spirit, Hackett Publishing Compagny, Inc.,
Indianapolis/Cambridge, 1997, p. 303. Cette association entre le neveu de Rameau et la
comdie comme forme thtrale de mise en scne critique a fait rcemment lobjet du
livre de Allen Speight, Hegel, Literature and the Problem of Agency, Cambridge
University Press, New York, 2001, p. 78-84 (en particulier). Voir aussi, sur le mme
sujet, les remarques significatives de Terry Pinkard dans son livre Hegels
Phenomenology. The Sociality of Reason, Cambridge University Press, New York, 1996,
p.163-165.
24
19
dire emballe et tourne dsormais sur son propre axe sans orientation dtermine. Le
neveu de Rameau fait feu critique tous azimuts, mais sans souci dintgration et de
recherche dunit. Il exprime certes des vrits percutantes, mais elles ne sont que des
feux dartifice sans relle consistance au-del de leurs coups dclat momentans. Hegel
finira par dire quun tel individu se montre apte juger le substantiel lorsquil laperoit,
mais quil a perdu lui-mme la capacit de concevoir le substantiel.26
Pour Hegel, le monde moderne est, selon son expression devenue clbre, un
monde lenvers (verkehrte Welt). Cette dsignation ne vaut pas seulement pour le
chapitre quil consacre lentendement lorsquil aborde la problmatique de la
connaissance.27 Mais elle sapplique tout autant en ce qui concerne la problmatique de la
praxis. Alors que dans lAntiquit lindividu acquiert, selon Hegel, le savoir de
luniversel en partant de lintuition sensible du particulier, dans le monde moderne
lindividu suit le chemin inverse, tant donn que les modes dacquisition dans la
modernit passent demble par lentendement. En dautres mots : lindividu moderne
cherche lintuition sensible permettant dauthentifier le savoir de lentendement. Dun
ct, la conscience est en dbat avec la lgitimation des savoirs acquis socioculturellement, de lautre ct, elle prouve le besoin dun rapport substantiel au monde
qui puisse lui assurer une appartenance lgitime. Cette division interne de la conscience
25
Cf. PdG, p.413; PdE, p.375.
Cf. PdG, p.390; PdE, p.355. Dans son texte, Hegel joue clairement sur la smantique
de la diffrence entre le juger comme Urteilen, qui renvoie la capacit de pouvoir
reconnatre les vrits isoles et divises en parties spares et le concevoir comme
Fassen, qui fait rfrence la capacit de synthse, cest--dire le pouvoir de tenir
ensemble les vrits spares dans une perspective globale qui les saisie et les comprend.
27
Cf. PdG, p. 128-130; PdE, p.135-137. Sur la signification philosophique du monde
lenvers dans loptique phnomnologique hglienne de la problmatique de la
connaissance, je renvoie larticle de Gadamer; Hegel Die verkehrte Welt, dans :
Hegels Dialektik, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tbingen, 1980, p.31-47.
26
20
moderne se matrialise par la prsence de deux voix dissonantes en conflit dans
lindividu moderne; dun ct, lune delle affirme haut et fort le mensonge du monde, de
lautre ct, lautre revendique la ncessit dune vrit du monde. Cest cette dissonance
que Hegel nomme tantt le langage der Schmeichelei tantt le langage der
Zerrissenheit28et qui reflte les alas et les errances dune subjectivit la recherche
dun nouveau rapport substantiel au monde. Dans lhorizon dun monde lenvers,
lacquisition dun monde lendroit ne peut seffectuer que lorsque la conscience du
sujet agissant met ses prconceptions lpreuve de la praxis.
En suivant les prouesses verbales du neveu de Rameau, Hegel problmatise la
rhtorique dune raison en crise. En dcrivant le langage dune conscience manifestement
devenue trangre elle-mme et son monde, il met en vidence une excroissance de la
raison simplement formelle par rapport la raison substantielle. On pourrait dire que la
figure du neveu de Rameau sert dcrire la nature prcaire, transitoire mais aussi
exubrante et hypercritique dune conscience qui se trouve momentanment dans le no
mans land de lincertitude inhrente ltat de celle qui ne se reconnat plus dans les
formes habituelles de son monde. La raction immdiate de cette conscience est aussitt
de dnoncer le mensonge de la naturalit du langage et son rapport au monde. Entre le
mot et la chose, entre le langage et le monde, il ny a pas daccord naturel comme le croit
la conscience nave; au contraire, le fait lgard duquel le neveu de Rameau semble le
plus clair, cest qu la vrit tout est affaire de convention. Dans son chapitre sur
lesprit devenu tranger lui-mme, Hegel dcrit le comportement subreptice de cette
conscience divise en soi-mme en montrant que celle-ci utilise le langage en sachant trs
bien que si celui-ci peut noncer des vrits, cest dans la mesure o elle sait habilement
28
Cf. PdG, p.384; PdE, p.351.
21
adapter elle-mme les formes du discours aux conventions sociales et culturelles
correspondantes. Lefficacit et la versatilit des pratiques verbales du neveu de Rameau
sont celles dun individu qui produit des tincelles de vrit parce quil sait par avance
que celles-ci se produisent lorsque lon russit brancher le fil du langage dans la prise
qui lui correspond. Alors le courant passe, alors une lumire sallume.
La lecture que Hegel fait du roman de Diderot cherche dterminer les limites et
les dangers dun rationalisme qui semploie perdument dissoudre toute autre source
dautorit que celle de la raison formelle. Ce qui parat intresser Hegel, cest de montrer
quun tel concept de raison produit, in extremis, un vacuum substantiel qui a pour
consquence de produire chez lindividu un effet sophistique, lequel consiste croire que
la performance formelle de lentendement reprsente la finalit de la raison claire. La
vrit critique du Neveu de Rameau de Diderot, selon Hegel, consisterait en ceci de
proposer une rflexion explicite sur la philosophie des Lumires elle-mme en mettant en
scne ce que peut reprsenter un individu si clair qu force de tout remettre en
question il se retrouve lui-mme aux prises avec un srieux problme didentit et
dorientation individuelle, sociale, politique et culturelle. Pour Hegel, cette difficult
indique une carence fondamentale quaucune raison formelle ne peut combler par ellemme, do sa limite, savoir la recherche dun rapport soi qui soit mdiatis par une
appartenance substantielle au monde. Pour que cela puisse advenir, il faut que la raison
formelle fasse un pas au-del delle-mme, ce qui reprsente un nouveau dfi pour elle,
celui de reconstruire ses rapports au monde. Aux paroles critiques doivent pouvoir
succder les actions pratiques. Maintenant que les Lumires ont dissous lombrage des
22
prjugs et des superstitions, le temps est venu de passer au travail constructif de la raison
substantielle.
(2) La Dialectique de la raison et lHistoire de Juliette
Entre le neveu de Rameau et Juliette, je ne me risquerai pas ici tablir des liens
de parent, quoique le fruit de leur passion et sans doute t du moins on peut se
limaginer - un rejeton peu commun. En revanche, il ne me semble pas impossible, aussi
invraisemblable que cela puisse paratre dabord, de reprer des airs de famille entre la
Phnomnologie de lesprit de Hegel et la Dialectique de la raison dAdorno et
Horkheimer. Linvraisemblance dun tel rapprochement provient surtout de la critique de
Hegel quAdorno a entreprise plus tard dans la Dialectique ngative. Mais que lon
veuille bien aller relire attentivement la Dialectique de la raison et lon y dcouvrira une
autre estimation de la philosophie de Hegel. Dans la Dialectique de la raison, il est
dailleurs beaucoup moins question de Hegel que de Kant, mais ce qui est vis avant tout
par lensemble du propos, cest le positivisme moderne, la disparition de la raison
substantielle et la domination de la rationalit technique et instrumentale. Mme si
Adorno et Horkheimer critiquent Hegel ici et l, surtout pour sa reprsentation de la
rationalit systmatique, ils leur arrivent aussi ce que lon ne devrait ni oublier ni passer
sous silence - de sappuyer sur le mme Hegel pour sen prendre la rduction du penser
et de la raison au cadre restreint du concept positiviste de science. Quoiquil en soit, le
rapprochement dont je parlerai ici ne me semble pas tre affect ni compromis par la
critique quils adressent Hegel tort ou raison.
23
Que lon veuille bien comprendre quun rapprochement prsuppose dabord une
distance. Au tout dbut de cet essai, jai affirm que les deux positions en cause sont aux
antipodes lune de lautre. En effet, compare lune lautre, la position de Hegel
tmoigne dun optimisme dmesur en la raison, tandis que celle dAdorno et
Horkheimer dun pessimisme non moins extrme lgard de celle-ci. On peut exprimer
des rserves critiques lendroit de ces deux formes de radicalisme. Jaimerais le faire ici
non pas en prenant une position externe lgard de lune et lautre position, mais en
contribuant plutt faire ressortir ce quelles partagent et ont en commun, si lon veut
bien consentir non seulement relativiser leur absolutisation respective, mais
considrer surtout que leur vrit critique est ailleurs que dans laffirmation de leur
position extrme.
Et la Phnomnologie de lesprit, et la Dialectique de la raison proposent de
reconstruire la gense de la rationalit occidentale par lintermdiaire de la dialectique
entendue comme le rapport soi de la raison lgard delle-mme. Dun point de vue
externe, il est frappant de constater que les auteurs de la Dialectique de la raison adoptent
un ordre de prsentation analogue structurellement celui que Hegel a adopt dans la
Phnomnologie de lesprit. Adorno et Horkheimer commencent dabord par laborer le
pr-concept de leur critique de la raison (Le concept dAufklrung); puis ils prsentent
dans deux digressions successives, la premire portant sur le domaine de la philosophie
thorique (Ulysse, ou mythe et Raison), la seconde sur celui de la philosophie pratique
(Juliette, ou Raison et morale) comment leur thse principale, savoir que le mythe
lui-mme est dj Raison et la Raison se retourne en mythologie29, sinstancient dans
29
Adorno et Horkheimer, Dialectique de la raison. Fragments philosophiques, (trad. .
Kaufholz), Gallimard, Paris, 1974, p.18.
24
lun et lautre domaine. Dans la Phnomnologie de lesprit, Hegel, aprs avoir expos
dans lintroduction le pr-concept de la constitution de la rationalit partir du principe
dialectique des expriences de la subjectivit, dbute sa prsentation en abordant les
questions touchant la raison thorique, puis il passe la section sur la conscience de soi
o il traite des questions relatives au domaine de la philosophie pratique. Mon point ici
nest pas de chercher vouloir suggrer que Adorno et Horkheimer auraient dcid de
prendre la Phnomnologie de lesprit comme modle pour crire leur Dialectique de la
raison. Une telle suggestion serait risible et ridicule. En revanche, et cest l le lieu du
rapprochement que je crois possible dtablir et de mettre en valeur, aussi bien Hegel
quAdorno et Horkheimer proposent une thorie dialectique de la rationalit au centre de
laquelle lexposition du concept de raison nest pas coupe de lanalyse critique de la
question de lunit de ses deux lgislations, je veux dire la raison dans son usage
thorique et pratique. La vritable Aufklrung est celle qui tend rconcilier thorie et
praxis; la mauvaise les dissocier et la pire ne plus considrer la question de leur
rapport comme une question substantielle.
Comment doit-on comprendre cela? Dans loptique dune thorie dialectique de la
rationalit, la distance qui spare la thorie et la praxis constitue le moteur critique qui
motive la raison lclaircissement de nouvelles conditions de vie permettant de
transformer, ou tout le moins, damliorer une situation dalination. Lorsque les deux
sphres de la rationalit ne sont plus mdiatises dans lexprience de lindividu, il ny a
plus de communication entre la raison technique accomplissant des tches pr-donnes et
la raison pratique seule instance vritablement capable de se poser des fins au-del de la
positivit du monde. Pour Adorno et Horkheimer, cette disjonction entrane la
25
domination de la raison instrumentale, laquelle, en labsence de toute instance critique
provenant de la raison pratique, se met au service non plus dune raison suprieure, mais
demeure assujettie linstinct primaire de conservation de soi.
On chercherait en vain chez Adorno et Horkheimer une interprtation immanente
des uvres du Marquis de Sade. Tout comme chez Hegel, le recours lHistoire de
Juliette sinscrit dans un parcours philosophique qui se rapporte celle-ci comme une
illustration des thses philosophiques avances. Sans doute le contexte historique de la
rflexion dAdorno et dHorkheimer sur lAufklrung nest plus comme chez Hegel celui
de la rvolution franaise et de la terreur qui sen est suivi, mais la logique terrifiante de
la pense fasciste qui a men lHolocauste. Ce sont les vnements de la seconde guerre
mondiale qui ont forc Adorno et Horkheimer repenser les termes de la dialectique de
lAufklrung. Par consquent, ils dveloppent leurs analyses critiques lgard de
lAufklrung en sorientant sur le destin de la raison pratique lpoque de la suprmatie
de la raison instrumentale dans la socit industrielle avance. Cette poque, qui est
encore la ntre, est celle dun monde standardis et marqu, selon Adorno et Horkheimer,
par la mort et labsence de Dieu. Cest dans ce contexte gnral que lon doit situer leur
interprtation de lHistoire de Juliette du Marquis de Sade.
Dans la lecture quils font de cette uvre, Adorno et Horkheimer cherchent
montrer comment Sade a thmatis la problmatique de la disjonction entre la raison
pratique et la raison instrumentale en mettant en relief la logique des comportements dun
individu, ici ceux de Juliette, qui sont systmatiquement organiss, rflchis et orients
par lexprience de labsence de Dieu. Autrement dit : par lexprience de labolition
ultime de toute finalit. Du coup, bien entendu, cest toute la morale qui scroule,
26
puisque la mort de Dieu entrane avec elle la disparition de la diffrence entre le bien et le
mal. la diffrence de Hegel, qui analyse linversion dialectique du bien et du mal dans
son analyse de lAufklrung en suivant les comportements du neveu de Rameau, Adorno
et Horkheimer partent plutt de la ngation pure et simple de la diffrence entre le bien et
le mal quils voient oprante dans tous les comportements de Juliette. Cette abolition
signifie dans les faits que la raison pratique disparat elle-mme comme instance critique
de la finalit. Que reste-t-il? Adorno et Horkheimer rpondent avec Sade: il ne reste que
la suprmatie de linstinct de conservation de soi et la domination de lhomme par
lhomme. partir du moment o il ny a plus de finalit, il ny a plus de raison de
considrer lautre comme une fin en lui-mme. Lautre devient strictement un moyen
pouvant assurer la conservation de ma propre existence. Mais, en vrit, la question de la
finalit, que lon croyait peut-tre ainsi abolie, na pas disparu pour autant, puisque la
conservation de soi devient dsormais le dnominateur commun, le seul tlos qui persiste
aprs la disparition du substantiel, que lon nomme celui-ci Dieu, la religion ou les
traditions.
Selon Adorno et Horkheimer, lHistoire de Juliette illustre ce quentrane
lindiffrence lgard de la question des finalits suprieures. partir du moment o
cette question ne cause plus aucun dbat moral dans la conscience de lindividu,
lindividu sabsolutise lui-mme en suivant une seule rgle de conduite la conservation et
lautosatisfaction de soi. Dans la Dialectique de la raison, Adorno et Horkheimer
ironisent sur la dfinition que Kant a donne de lAufklrung lorsque celui-ci affirme
quelle reprsente le moment o lhomme sort de sa minorit dont il est lui-mme
responsable. La minorit est lincapacit de se servir de son entendement sans laide de
27
quelquun dautre30. Pour Adorno et Horkheimer, en se coupant de laide de quelquun
dautre et en ne faisant plus confiance qu lactualisation individuelle de
lentendement, on vacue tout simplement la possibilit de la mdiation de soi par autrui
et annule par le fait mme sa porte critique. Juliette a dj tout compris cela. Cest
pourquoi le seul impratif catgorique auquel elle subordonne sa raison et quelle suit
aveuglment comme la maxime de lindividu clair tient dans la formule suivante :
chacun pour soi. Dans un monde uniformis o les individus nagissent plus que pour se
sauver eux-mmes, ils paraissent clairs lorsquils dmontrent quils savent sen tirer en
utilisant leur entendement comme un outil stratgique. Mais, en ralit, on se mprend
compltement en croyant que lAufklrung serait le processus dcrivant lutilisation
correcte de lentendement dans le choix des meilleurs moyens employer pour les fins
pr-donnes, alors quelle reprsente le processus de rflexion de la raison critique
lgard des fins suprieures dterminer pour une vie plus juste. La question est de savoir
si une telle forme de vie est encore possible pour Juliette qui a dj abandonn toute
rflexion morale.
Mais il y a plus. Non seulement Juliette a-t-elle abandonn toute rflexion morale,
mais elle sexerce avec minutie et calcul purger son plaisir de toute contamination avec
la sphre motive des sentiments, lesquels reprsentent le dernier refuge de la moralit
lorsque lon ne veut pas reconnatre que celle-ci peut tre enracine dans le fait de la
raison. Selon Adorno et Horkheimer, luvre du marquis de Sade doit tre considre
comme la critique intransigeante de la raison pratique31, cest--dire non seulement
comprise comme lmancipation de lentendement par rapport autrui, mais dtermine
30
31
Cf. Ibid., p.92.
Cf. Ibid., p.104.
28
comme le plaisir de la destruction active des valeurs morales. ct de cette forme de
critique, la critique de la raison pratique kantienne apparat plutt comme une critique
accommodante de la raison pratique; en effet, Kant, dans la Critique de la raison pure, a
d restreindre, cest lui-mme qui le dit, la porte critique de la raison pour laisser une
place la croyance et la foi.32 La radicalit de luvre de Sade se montre, quant elle,
par son refus systmatique de poser une restriction lentendement dsormais libr de
limpratif de devoir considrer les autres dans la planification menant son plaisir. Mais
il resterait encore, malgr tout, la possibilit que les sentiments prennent le relais et
deviennent le dernier support de la moralit. Or, cette possibilit est prvue par le
marquis de Sade et elle est mise en chec par leffort de Juliette purer
systmatiquement de son plaisir tout relent dmotivit toute sentimentalit. Juliette nest
pas une romantique, cest une stocienne qui pratique activement lapathie pour ne pas
avoir souffrir dune exposition aux sources sensibles de la moralit.33 La loi morale
kantienne reprsente, elle aussi, une restriction de la raison par rapport aux passions et
aux motions, mais le respect kantien de la loi morale est fondamentalement le respect de
lhumanit en autrui comme en soi-mme. Or cest cette humanit que Juliette prend
plaisir liminer. Dans sa famille, la vritable kantienne, la sur vertueuse, cest Justine,
cette martyre de la loi morale34. Juliette est plutt convaincue que sil fallait que les
citoyens prennent le motif kantien du respect pour la forme de la loi morale, cela
produirait non pas des gens clairs, mais des dsquilibrs, des fous35. Elle prfre
32
Kant, Critique de la raison pure, (Trad.Tremesaygues et Pacaud), PUF, Paris, 1984,
p.24.
33
Cf. Dialectique de la raison, p.106, 111.
34
Cf. Ibid., p.104.
35
Cf. Ibid., p.96.
29
donc la matrise de soi36 par-dessus tout, car le don de soi autrui, comme dans
lamour, nest quune autre forme didoltrie37 o le moi sabandonne encore
lillusion. Tant qu tre claire, Juliette ne veut pas ltre demie. Cest pourquoi son
ultime credo est celui de la science38, cest--dire lapplication planifie et
systmatique de lentendement comme instrument de dissolution active de toutes les
illusions et les superstitions non seulement relatives lunivers de la thorie, mais aussi
celui de la praxis. Pour Adorno et Horkheimer, Juliette incarne le triomphe de la raison
positiviste dsormais affranchie de la dpendance lgard de toute autorit morale et
religieuse. Cest pourquoi aussi, en toute consquence de cause, Juliette pratique
ouvertement, sans scrupule ni culpabilit, la transgression de tous les tabous et interdits.39
Il ny a pas de limites au plaisir quelle ressent dtruire la civilisation avec ses propres
armes40.
(3) Comment dfendre la raison contre ses apologistes et ses dtracteurs?
Langlisme et le dmonisme de la raison reprsentent deux dangers qui menacent
sournoisement la rationalit critique. Lun et lautre sactualisent par le biais de
linconditionnalit radicale des apologistes et des dtracteurs de la raison elle-mme. Le
36
Le thme de la discipline de soi est explicitement abord par Adorno et Horkheimer
comme une rfutation concrte de lide que lautodiscipline de lindividu devrait
ncessairement prdisposer lattitude morale. Comme le montre Juliette, la dlinquance
aussi repose sur lautodiscipline. Cf. Dialectique de la raison, p.105.
37
Cf. Ibid., p.122.
38
Cf. Ibid., p.106.
39
Sur cet aspect de la transgression des tabous et des interdits chez Sade, on consultera,
bien videmment, les travaux incontournables de George Bataille dans son livre
Lrotisme, Les ditions de Minuit, Paris, 1957.
40
Cf. Dialectique de la raison, p.104.
30
dogmatisme de chacun de ces derniers ressemble trangement celui de joueurs dchec
qui senttent lun et lautre ne jouer toujours que la mme pice pour ne donner aucun
avantage ladversaire. Mais, en ralit, leur enttement respectif rend impossible lissue
de la partie. Plus personne dailleurs ne veut attendre pour assister au dnouement de
celle-ci, tellement il parat peu raisonnable de vouloir dfendre une position extrme qui
ne mne nulle part. Car cette dfense seffectue la fin non pas pour lacquisition dune
meilleure position, mais par pur principe pour la conservation de la sienne. Ainsi, la
raison tout prix ou sa dnonciation cote que cote deviennent rapidement deux formes
de radicalisme impatientes lgard des conditions et des limites lintrieur desquelles
le travail de la raison reoit sa vritable source de motivation et peut accomplir une
fonction critique dtermine en prservant la perspective mancipatrice de la rationalit.
La force de la rationalit critique ne repose pas dans la prise de position extrme, mais
bien plutt dans la prise en considration des limites du conditionn et celle-ci sactualise
en prenant sur elle linitiative dentreprendre un travail de mdiation permettant
lexercice critique dune rationalit assumant la particularit des situations. Pour le dire
dans le vocabulaire de la pense dialectique, seul le travail de la ngation dtermine
semble assurer une lgitimation vritable au pouvoir mancipateur de la raison. Doit-on
pousser la raison au-del de cette limite? Dans quelle mesure celle-ci peut-elle demeurer
salvatrice en dehors des conditions et des situations qui rendent son intervention
indispensable? Si la raison substantielle doit succder la raison critique, quelles figures
doit-elle prendre pour ne pas retomber dans les piges redoutables dune raison
dogmatique? Par-del langlisme et le dmonisme de la raison, ces questions sadressent
encore nous.
31
Tout en refusant consciemment de faire lange ou la bte, il reste que le vritable
intrt philosophique que lon doit porter aux reconstructions dialectiques de Hegel,
Adorno et Horkheimer se trouve dans ces analyses o ils nous appellent ne pas prendre
les apparences pour la ralit mais redoubler de vigilance lgard de ceux qui se
proclament dj des gens parfaitement clairs. Cest l, me semble-t-il, le sens critique
de la lecture philosophique quils proposent respectivement en voquant les figures cls
mais problmatiques de lAufklrung que sont le neveu de Rameau et Juliette. Dans les
deux cas, Hegel, Adorno et Horkheimer se sont attachs linterprtation de figures
extrmes, mais ils cherchent montrer, sparment, que le radicalisme en cause dans
chacune de celles-ci est lindice dune faille. Le neveu de Rameau est certes brillant, mais
il cache un srieux problme didentification et dorientation; quant elle, Juliette
reprsente la lucidit incarne, mais elle se perd corps et me dans le ddale dune
logique qui a fini par prendre le contrle sur sa vie. Face la philosophie des Lumires,
lclairage que Hegel, Adorno et Horkheimer projettent par lintermdiaire de leurs
traitements du Neveu de Rameau et de lHistoire de Juliette, cest de dvoiler contre
lidentit apparente le ferment dune tendance oppose au sein du mme. Lidentit
apparente du sicle des Lumires, cest le triomphe dclar de la raison. Dun ct,
Hegel, Adorno et Horkheimer prsentent le neveu de Rameau et Juliette comme les
figures progressistes de lautonomie et de la libert caractrisant lidal du sicle des
Lumires, mais de lautre ct, ils montrent aussi travers celles-ci des lments
rgressifs et critiques qui problmatisent les limites dune philosophie de la raison pure
pour laquelle le projet de lAufklrung serait dsormais une affaire accomplie.
32
Par un hasard qui nen est peut-tre pas un, Hegel, Adorno et Horkheimer ne se
trouvent-ils pas revenir ainsi dans les parages philosophiques de la position de Kant? La
Critique de la raison pure ne reprsente-t-elle pas justement cette critique dune
philosophie de la raison pure? Kant na-t-il pas mis en vidence quune raison se
considrant sans limite reprsente dj ltat dune raison hors delle-mme? Assurment.
Avec Kant, Hegel, Adorno et Horkheimer partagent lexigence critique qui sexprime
dans limpratif de procder une enqute sur les conditions de possibilit et les limites
de la rationalit. la diffrence de Kant, toutefois, ceux-ci pensent que la question de la
lgitimation de la raison par elle-mme nest pas crdible si elle ne seffectue strictement
et seulement quau niveau de la sphre de lidalit. Car, ce faisant, la raison ne sadresse
qu la raison en faisant abstraction du monde rel partir duquel les revendications
idales de celle-ci doivent pourtant tre juges. Il nest donc pas certain que la raison
puisse tre dclare le meilleur juge delle-mme. Cest pourquoi, de Hegel Adorno et
Horkheimer, la dialectique de la raison sinterrogera dsormais sur les conditions et les
formes historiques de la rationalit, ce qui a pour consquence que lvaluation critique
de la porte et de la signification de lidalit demeurera ici fondamentalement relative
ltat historique de la ralisation concrte de la raison elle-mme. Cest aussi la raison
pour laquelle la mdiation entre thorie et praxis se prsente comme le seul vritable
antidote critique contre les errances absolutistes de la raison pure, laquelle nest jamais
immunise par elle-mme contre sa propre tendance aux radicalismes.
Claude Thrien
Universit du Qubec Trois-Rivires
Vous aimerez peut-être aussi
- Requiem Pour Le Monde Occidenta - Pascal BonifaceDocument117 pagesRequiem Pour Le Monde Occidenta - Pascal Bonifaceabderrrassoul100% (1)
- La Fin Des Empires - Patrice Gueniffey PDFDocument457 pagesLa Fin Des Empires - Patrice Gueniffey PDFabderrrassoul100% (3)
- Attali Jacques - Karl Marx Ou L4esprit Du Monde - 2005Document337 pagesAttali Jacques - Karl Marx Ou L4esprit Du Monde - 2005abderrrassoul100% (6)
- Michel Foucault Préface Histoire de La Folie 1961Document9 pagesMichel Foucault Préface Histoire de La Folie 1961Michel GalabruPas encore d'évaluation
- Critique de l’économie politique classique: Marx, Menger et l’Ecole historique allemandeD'EverandCritique de l’économie politique classique: Marx, Menger et l’Ecole historique allemandePas encore d'évaluation
- De l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandDe l'âme d'Aristote: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Figaro Magazine - 21 D Cembre 2018bDocument124 pagesLe Figaro Magazine - 21 D Cembre 2018babderrrassoulPas encore d'évaluation
- Principes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuD'EverandPrincipes de la philosophie morale: ou Essai sur le mérite et la vertuPas encore d'évaluation
- Histoire Du Maroc Depuis L'inde - Vermeren, PierreDocument243 pagesHistoire Du Maroc Depuis L'inde - Vermeren, Pierreabderrrassoul100% (1)
- Georg Lukacs. Responsabilité IntellectuelsDocument15 pagesGeorg Lukacs. Responsabilité IntellectuelsJean-Pierre Morbois100% (3)
- Aglietta Michel, Transformer Le Regime de Croissance, Octobre 2018Document365 pagesAglietta Michel, Transformer Le Regime de Croissance, Octobre 2018abderrrassoul100% (2)
- Le Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Gai Savoir de Friedrich Nietzsche: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Essais et Conférences de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandEssais et Conférences de Martin Heidegger: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Le Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et DiltheyDocument43 pagesLe Paradigme de L Interpretation Chez Schleiermacher Et Diltheyamine1331Pas encore d'évaluation
- Le Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFDocument125 pagesLe Loup Dans La Bergerie - Droi - Jean-Claude Michea PDFabderrrassoul100% (2)
- Cours M1 Paris IDocument62 pagesCours M1 Paris IBernardo JeanPas encore d'évaluation
- Chapitre 10 Didier AnzieuDocument4 pagesChapitre 10 Didier AnzieuAibPas encore d'évaluation
- AsdfDocument278 pagesAsdfMPas encore d'évaluation
- L'etre Politique Chez HarendtDocument34 pagesL'etre Politique Chez Harendtlaotrasociologia129Pas encore d'évaluation
- Biblio Agrég Nietzsche 2019 - Mai LequanDocument11 pagesBiblio Agrég Nietzsche 2019 - Mai LequanBaver BaverPas encore d'évaluation
- Franck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFDocument174 pagesFranck Fischbach - La Production Des Hommes Marx Avec Spinoza (2014, Vrin) PDFEser KömürcüPas encore d'évaluation
- La Croissance Economique de L'afriqueDocument34 pagesLa Croissance Economique de L'afriqueabderrrassoul100% (1)
- Recherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandRecherches logiques d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- HEGEL Textes Et Debats, Par Jacques D'hondt, Le Livre de Poche, Paris 1984Document382 pagesHEGEL Textes Et Debats, Par Jacques D'hondt, Le Livre de Poche, Paris 1984francis batt100% (4)
- Heraclite Le Temps Est Un Enfant Qui JouDocument17 pagesHeraclite Le Temps Est Un Enfant Qui JouNoël PécoutPas encore d'évaluation
- Diderot, Seneque Et Jean-Jacques, Un Dialogue A Trois Voix - RodopiDocument400 pagesDiderot, Seneque Et Jean-Jacques, Un Dialogue A Trois Voix - Rodopi140871raph100% (2)
- La Construction de L'histoire Chez Walter BenjaminDocument25 pagesLa Construction de L'histoire Chez Walter BenjaminAndré Constantino YazbekPas encore d'évaluation
- Aron R Introduction A La Phi Lo Sophie de L HistoireDocument293 pagesAron R Introduction A La Phi Lo Sophie de L Histoireegonschiele9Pas encore d'évaluation
- Detective de L'histoire - Tulard, JeanDocument275 pagesDetective de L'histoire - Tulard, Jeanabderrrassoul100% (2)
- Traces Ernst BlochDocument18 pagesTraces Ernst Blochflorakh100% (1)
- Agrégation Externe 2012 - Conférences D'esthétique - Judith MichaletDocument56 pagesAgrégation Externe 2012 - Conférences D'esthétique - Judith MichaletCaravagePas encore d'évaluation
- Anne de Bretagne - Claire L'HoerDocument273 pagesAnne de Bretagne - Claire L'Hoerabderrrassoul100% (2)
- J. Wahl, Du Rôle de L'idée de L'instant Dans La Philosophie de Descartes, 1920.Document64 pagesJ. Wahl, Du Rôle de L'idée de L'instant Dans La Philosophie de Descartes, 1920.JeanPas encore d'évaluation
- Postmodernisme - Memoire - Kirill Gulevsky-Obolonsky (Revu) - LibreDocument23 pagesPostmodernisme - Memoire - Kirill Gulevsky-Obolonsky (Revu) - LibreManoel AlencarPas encore d'évaluation
- p2024 Agreg Ext Philo 1430464 PDFDocument2 pagesp2024 Agreg Ext Philo 1430464 PDFJeanPas encore d'évaluation
- Henri Atlan: L'esprit Et Le Corps Sont Unis Quelle Que Soit La Façon D'en Parler Henri AtlanDocument9 pagesHenri Atlan: L'esprit Et Le Corps Sont Unis Quelle Que Soit La Façon D'en Parler Henri AtlanAnonymous VNwWDqlrPas encore d'évaluation
- Mémoires Pour Servir À L'histoire Du Jacobinisme PDFDocument185 pagesMémoires Pour Servir À L'histoire Du Jacobinisme PDFabdel1970Pas encore d'évaluation
- Ecce - Homo Cours de François Fédier, Professé Pendant L'année 1977-1978Document49 pagesEcce - Homo Cours de François Fédier, Professé Pendant L'année 1977-1978nabotmaPas encore d'évaluation
- Sur HyppoliteDocument21 pagesSur HyppolitefonsiolaPas encore d'évaluation
- Pierre Macherey Querelles CartésiennesDocument49 pagesPierre Macherey Querelles CartésiennesKhouloud AdouliPas encore d'évaluation
- Jullien, Francois - La Propension Des ChosesDocument316 pagesJullien, Francois - La Propension Des ChosesusfetcPas encore d'évaluation
- Jullien, Francois - Un Sage Est Sans Idée. Ou Lautre de La PhilosophieDocument208 pagesJullien, Francois - Un Sage Est Sans Idée. Ou Lautre de La PhilosophieusfetcPas encore d'évaluation
- Nietzsche - Le Gai Savoir - 1&2 PDFDocument87 pagesNietzsche - Le Gai Savoir - 1&2 PDFscrazed100% (1)
- Entretien D'emmanuel Faye Avec Philippe Lacoue-LabartheDocument9 pagesEntretien D'emmanuel Faye Avec Philippe Lacoue-LabartheprisissiPas encore d'évaluation
- Georg Lukacs. EichendorffDocument35 pagesGeorg Lukacs. EichendorffJean-Pierre MorboisPas encore d'évaluation
- NRP Lycee Sept 2017 PDFDocument72 pagesNRP Lycee Sept 2017 PDFJipa IoanaPas encore d'évaluation
- Andler - Nietzsche Et DostoievskiDocument28 pagesAndler - Nietzsche Et Dostoievskidaniel_stanciu244666Pas encore d'évaluation
- Henri Lefebvre - Sociologie de Marx (1974, Presses Universitaires de France PUF)Document174 pagesHenri Lefebvre - Sociologie de Marx (1974, Presses Universitaires de France PUF)AhmedZaidiPas encore d'évaluation
- Les Philosophes Des Lumieres PDFDocument44 pagesLes Philosophes Des Lumieres PDFSYLVIE R.100% (1)
- Les Lumières Et La Dialectique, de Hegel À AdornoDocument32 pagesLes Lumières Et La Dialectique, de Hegel À AdornoabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Paul Henri Thiry, Baron D'holbachDocument207 pagesPaul Henri Thiry, Baron D'holbachmartinPas encore d'évaluation
- Napoleon Et Talleyrand - Dard, EmileDocument432 pagesNapoleon Et Talleyrand - Dard, Emileabderrrassoul100% (1)
- Nietzsche Contra HeideggerDocument129 pagesNietzsche Contra Heideggerdapayne80100% (2)
- En Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFDocument423 pagesEn Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- En Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFDocument423 pagesEn Attendant Les Robots - Enque - Antonio A. Casilli PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- L Express - 19 D Cembre 2018bDocument132 pagesL Express - 19 D Cembre 2018babderrrassoulPas encore d'évaluation
- Les Intellectuels Français Ont-Ils Perdu La Raison Pascal Engels Roger PuivetDocument7 pagesLes Intellectuels Français Ont-Ils Perdu La Raison Pascal Engels Roger Puivetbritocosta100% (1)
- Valeur Morale Joie SpinozaDocument7 pagesValeur Morale Joie SpinozasantseteshPas encore d'évaluation
- Méditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations cartésiennes d'Edmund Husserl: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Berkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineDocument8 pagesBerkeley - Des Principes de La Connaissance HumaineStephanie Hernandez100% (1)
- Gérard Lebrun, L'envers de La Dialectique - Actu PhilosophiaDocument9 pagesGérard Lebrun, L'envers de La Dialectique - Actu Philosophiamguimaraeslima6536Pas encore d'évaluation
- Esthétique de Hegel: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandEsthétique de Hegel: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Feuerbach Lecteur de Fichte PDFDocument18 pagesFeuerbach Lecteur de Fichte PDFgdupres66Pas encore d'évaluation
- Weber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeDocument155 pagesWeber Max L Ethique Protestante Et L Esprit Du CapitalismeindiigenaisPas encore d'évaluation
- La Convivialite Ivan IllichDocument19 pagesLa Convivialite Ivan IllichGarnierPas encore d'évaluation
- Exposé Lettre 52Document6 pagesExposé Lettre 52Sergiu Florin AndreiPas encore d'évaluation
- Berdiaev - L Esprit Religieux de La Philosophie Russe PDFDocument17 pagesBerdiaev - L Esprit Religieux de La Philosophie Russe PDFbergzauberPas encore d'évaluation
- Luigi Pareyson - Ontologie de La LiberteDocument125 pagesLuigi Pareyson - Ontologie de La LiberteLucretia DaniPas encore d'évaluation
- Histoire de La Philosophie - Temps ModernesDocument61 pagesHistoire de La Philosophie - Temps Moderneseris_lashtamPas encore d'évaluation
- Marcel Gauchet Textes ChoisisDocument10 pagesMarcel Gauchet Textes ChoisisNICOMAQUE IIPas encore d'évaluation
- Gilles Deleuze - Les Conditions de La Question: Qu'est-Ce Que La Philosophie ?Document5 pagesGilles Deleuze - Les Conditions de La Question: Qu'est-Ce Que La Philosophie ?loran34100% (4)
- Ouvrage ErhenbergDocument3 pagesOuvrage ErhenbergSandy MandinPas encore d'évaluation
- Les Pires Ennemis - LivreDocument240 pagesLes Pires Ennemis - LivreLuiz Eduardo Prado100% (1)
- Colloque NietzscheDocument1 pageColloque NietzscheEmmanuel SalanskisPas encore d'évaluation
- Catherine Halpern-La Philosophie Un Art de VivreDocument22 pagesCatherine Halpern-La Philosophie Un Art de VivreAbdoul JalilPas encore d'évaluation
- Esprit HegelDocument68 pagesEsprit HegelAliceHopePas encore d'évaluation
- Jean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Document11 pagesJean Hyppolite - Genèse Et Structure de La Phénoménologie de L'esprit de Hegel - CHAPITRE 1Calac100% (1)
- Entre Mania Et Sophrosyne - Marianne MassinDocument10 pagesEntre Mania Et Sophrosyne - Marianne Massinvordevan100% (1)
- Pourquoi Michel Foucault Est PartoutDocument5 pagesPourquoi Michel Foucault Est PartoutDoriana VictoriaPas encore d'évaluation
- Spinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzeDocument13 pagesSpinoza Et La Méthode Générale de M. Gueroult - DeleuzedekknPas encore d'évaluation
- 82 - 21 - Le Sens de La Phénoménologie Dans Le Visible Et L'invisibleDocument24 pages82 - 21 - Le Sens de La Phénoménologie Dans Le Visible Et L'invisibleAnonymous gjnlEwb2oPas encore d'évaluation
- 1962 Nietzsche Et La PhilosophieDocument118 pages1962 Nietzsche Et La PhilosophieGeo BertazzoPas encore d'évaluation
- En Finir Avec Les Idees Fausses - AtdDocument205 pagesEn Finir Avec Les Idees Fausses - AtdabderrrassoulPas encore d'évaluation
- L Afrique-Defis Enjeux - Et.perspectives - En.40.fiches - Pour.comprendre.l ActualiteDocument178 pagesL Afrique-Defis Enjeux - Et.perspectives - En.40.fiches - Pour.comprendre.l ActualiteabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Term S Maths Reperes Livre Du Professeur 2011Document28 pagesTerm S Maths Reperes Livre Du Professeur 2011abderrrassoulPas encore d'évaluation
- Allais Maurice - Pour La Réforme de La FiscalitéDocument66 pagesAllais Maurice - Pour La Réforme de La FiscalitéabderrrassoulPas encore d'évaluation
- L'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFDocument100 pagesL'economie Mondiale, 2019, Cepii PDFabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Rapport GADREY Indicateurs Richesse DeveloppementDocument179 pagesRapport GADREY Indicateurs Richesse Developpementabderrrassoul100% (1)
- Regards Épist. GestionDocument15 pagesRegards Épist. GestionabderrrassoulPas encore d'évaluation
- National Geographic Hors-Série N°25Document112 pagesNational Geographic Hors-Série N°25abderrrassoulPas encore d'évaluation
- DIDEROTDocument3 pagesDIDEROTSalome MkPas encore d'évaluation
- 1.les Lumières - 1ère AnnéeDocument5 pages1.les Lumières - 1ère AnnéeTamara Taska ZajicPas encore d'évaluation
- Madelin - La RevolutionDocument378 pagesMadelin - La RevolutionpPas encore d'évaluation
- Le Siècle Des LumièresDocument5 pagesLe Siècle Des LumièresSabri alkassasPas encore d'évaluation
- Denis Diderot FinalDocument2 pagesDenis Diderot FinalSarkis KanaanPas encore d'évaluation
- Diderot Et La Religieuse en ChemiseDocument8 pagesDiderot Et La Religieuse en ChemiseNadhirPas encore d'évaluation
- Dupont-Chatelain - Les Encyclopedistes Et Les FemmesDocument194 pagesDupont-Chatelain - Les Encyclopedistes Et Les FemmesdifferenttraditionsPas encore d'évaluation
- L'Encyclopédie (1747-1765)Document2 pagesL'Encyclopédie (1747-1765)saidPas encore d'évaluation
- Erotisme Et Philosophie Chez Diderot (24 P.)Document25 pagesErotisme Et Philosophie Chez Diderot (24 P.)Jessyca kimberly RowlingPas encore d'évaluation
- Grimm - Correspondance LittéraireDocument85 pagesGrimm - Correspondance Littérairejose100% (1)
- Salon 3 - L'encyclopédieDocument31 pagesSalon 3 - L'encyclopédiezazPas encore d'évaluation
- Les Configurations Dialogiques DansDocument5 pagesLes Configurations Dialogiques DansSiham BouhaPas encore d'évaluation
- Fiche D'identité de L'œuvreDocument2 pagesFiche D'identité de L'œuvreTejenMootinPas encore d'évaluation
- Notes On BooksDocument17 pagesNotes On BooksGoutagnyPas encore d'évaluation
- Contexte Idéologique Et Esthétique Du Siècle Des LumièresDocument16 pagesContexte Idéologique Et Esthétique Du Siècle Des LumièresGissel Viviana100% (1)
- Lareligiondejjro 02 MassuoftDocument320 pagesLareligiondejjro 02 MassuoftSisifo FuentesPas encore d'évaluation
- Los Sociétés de Pensée Et La Démocratie Études D'histoire Révolutionnaire PDFDocument310 pagesLos Sociétés de Pensée Et La Démocratie Études D'histoire Révolutionnaire PDFLuciano BroboskiPas encore d'évaluation
- GrimmDocument533 pagesGrimmveraPas encore d'évaluation
- Ag 2016 Compte Rendu SiteDocument9 pagesAg 2016 Compte Rendu Siteapi-263608149Pas encore d'évaluation
- HTTPSWWW - halwar.snIMGpdfle Siecle Des Lumiere Xviii Siecle PDFDocument3 pagesHTTPSWWW - halwar.snIMGpdfle Siecle Des Lumiere Xviii Siecle PDFBrandly GervaisPas encore d'évaluation
- 10 Sujet10Document3 pages10 Sujet10jeo TopPas encore d'évaluation
- Diderot Cours 7Document3 pagesDiderot Cours 7Cherry MohamedPas encore d'évaluation