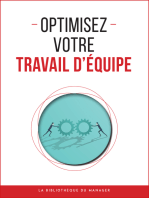Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Approche Actionnarial
Approche Actionnarial
Transféré par
Mazen KoukiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Approche Actionnarial
Approche Actionnarial
Transféré par
Mazen KoukiDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les différentes théories sur la gouvernance se sont d'abord construites autour des travaux sur la
séparation entre les fonctions de gestion et de contrôle (Berle et Means 1932) et de l'analyse
contractuelle du firme, en particulier la théorie des coûts de transaction (Coase 1937) et la théorie de
l'agence (Jensen et Meckling 1976). Le courant dominant de la gouvernance est donc essentiellement
de nature contractuelle et principalement centré sur la question de savoir comment résoudre les
conflits d’intérêts et en particulier comment minimiser les coûts d'agence associés au couple
actionnaire/dirigeant (Shleifer et Vishny 1997) L'objectif du système de gouvernance est ici de mettre
en place un certain nombre de mécanismes pour discipliner le dirigeant et réduire son espace
discrétionnaire , afin d'assurer l'investissement financier des actionnaires. L'objectif est de minimiser
les coûts d'agence résultant de l'asymétrie d'information entre la direction et les actionnaires, de
l'existence de comportements opportunistes et d'intérêts divergents. En conséquence, le système de
gouvernance des actionnaires se limite principalement à un rôle disciplinaire de supervision du
comportement des gestionnaires dans le but d'aligner leur comportement sur les seuls intérêts des
actionnaires. Le critère de performance est la valeur actionnariale, par un meilleur contrôle du
processus de création et de distribution de la richesse en faveur des principaux constituants de
l'entreprise. Un système de gouvernance performant est donc un système qui limite les risques
d'appropriation de la valeur par le dirigeant et de dégradation de la valeur actionnariale.
Enfin on critique le modèle de l'actionnaire qui ne prend pas en compte les relations entre tous les
partenaires, ce qui est restrictif pour se réclamer être l'approche dominante dans le domaine de la
gouvernance d'entreprise. C'est exactement sur le deuxième point critiqué que se concentre la
tentative de prolonger la théorie de l'agence positive. Principalement menée par des spécialistes du
management et de la gestion, elle vise à dépasser l’insuffisance lié à la perspective moniste de la
version traditionnelle, à travers l'étude du modèle de gouvernance partenariale.
A. Berle et G.C. Means (1932), The modern Corporation and Private Property, MacMillan, New
York.
G. Charreaux and Ph. Desbrières (1998), "Gouvernance des entreprises : valeur partenariale
contre valeur actionnariale",
A. Shleifer et R.W. Vishny (1997), " A Survey of Corporate Governance ", Journal of Finance
Vous aimerez peut-être aussi
- Didactique Des Disciplines - VF - Juillet 09Document90 pagesDidactique Des Disciplines - VF - Juillet 09Camou Elevage Icam100% (5)
- Synthèse de La Théorie D'agenceDocument7 pagesSynthèse de La Théorie D'agenceMeryem MalihPas encore d'évaluation
- Théorie de L'agenceDocument20 pagesThéorie de L'agenceAmina Zohir94% (16)
- Rapport Théorie D'agenceDocument6 pagesRapport Théorie D'agencekokou05Pas encore d'évaluation
- Les Mécanismes de GouvernanceDocument5 pagesLes Mécanismes de GouvernanceMazen Kouki100% (1)
- NOUARA Aziza, Dr. MEFTAH Salah: Strategy and Development Review Volume:08 / N°: 15 Bis (2018), P 26-43Document18 pagesNOUARA Aziza, Dr. MEFTAH Salah: Strategy and Development Review Volume:08 / N°: 15 Bis (2018), P 26-43dhahri nourhenPas encore d'évaluation
- Deslauriers, J.-P. (1991) - Recherche Qualitative, Guide Pratique by Jean-Pierre Deslauriers PDFDocument158 pagesDeslauriers, J.-P. (1991) - Recherche Qualitative, Guide Pratique by Jean-Pierre Deslauriers PDFFrank Eric Ciatchoua Ngoundjo100% (1)
- Les Modèles de Gouvernance de L'entrepriseDocument17 pagesLes Modèles de Gouvernance de L'entrepriseSoufiane KarmimPas encore d'évaluation
- La Théorie D'agenceDocument6 pagesLa Théorie D'agenceSara alaoui100% (1)
- Theorie Des Organisations Chap 4 Lecon 5 Cours v4Document6 pagesTheorie Des Organisations Chap 4 Lecon 5 Cours v4SINI DELIPas encore d'évaluation
- Théoire D'agenceDocument28 pagesThéoire D'agenceRachid Echarif100% (1)
- Théorie de L'agenceDocument14 pagesThéorie de L'agencexelox1100% (9)
- Théorie de L'agence Et La Prise en Compte Des Coûts D'agence Par Le Marché FinancierDocument14 pagesThéorie de L'agence Et La Prise en Compte Des Coûts D'agence Par Le Marché FinancierHamza GanfoudPas encore d'évaluation
- La Theorie D - AgenceDocument23 pagesLa Theorie D - AgenceZouhir NmiliPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Théories Économiques de LentrepriseDocument11 pagesLes Nouvelles Théories Économiques de LentrepriseZakaria AchirPas encore d'évaluation
- Theorie de L AgenceDocument20 pagesTheorie de L Agencekaidi chaimaa100% (2)
- EMagazine Liberte 2eedition Digital 2juinDocument44 pagesEMagazine Liberte 2eedition Digital 2juingigliaPas encore d'évaluation
- Théorie de L'agenceDocument6 pagesThéorie de L'agenceCylia Ait AhcenePas encore d'évaluation
- Contexte D'étudeDocument3 pagesContexte D'étudeFatine Fatima EzzahraPas encore d'évaluation
- 001201Document16 pages001201Doukoure MAHAMADOUPas encore d'évaluation
- 537 F 2 FB 9 A 0981Document14 pages537 F 2 FB 9 A 0981Hadyl ChokriPas encore d'évaluation
- 43-Article Text-139-1-10-20200809Document11 pages43-Article Text-139-1-10-20200809Elmahdi laaroussiPas encore d'évaluation
- La Théorie Des Parties Prenantes Est Un Concept en Gestion Et en Éthique Des Affaires Qui Suggère Que Les Entreprises Ne Sont Pas Seulement Responsables Envers Leurs ActionnairesDocument2 pagesLa Théorie Des Parties Prenantes Est Un Concept en Gestion Et en Éthique Des Affaires Qui Suggère Que Les Entreprises Ne Sont Pas Seulement Responsables Envers Leurs Actionnaireshouda elaydiPas encore d'évaluation
- 4683 12929 1 SM PDFDocument19 pages4683 12929 1 SM PDFYoussPas encore d'évaluation
- Chapitre II IIIDocument23 pagesChapitre II IIIRayan BenPas encore d'évaluation
- Cours - Théorie Des Organisations - Les Nouvelles Théories Économiques de L EntrepriseDocument4 pagesCours - Théorie Des Organisations - Les Nouvelles Théories Économiques de L EntrepriseArnaud KambirePas encore d'évaluation
- Theorie Gouvernance Charreaux CopieDocument16 pagesTheorie Gouvernance Charreaux CopieBERBOUCHA SyliaPas encore d'évaluation
- Le Conseil D'administration Dans Les Théories de La GouvernanceDocument17 pagesLe Conseil D'administration Dans Les Théories de La GouvernanceYasmine BouattourPas encore d'évaluation
- Black and White Trash Sign (A4 Document)Document28 pagesBlack and White Trash Sign (A4 Document)Oumayma TahiriPas encore d'évaluation
- Exposé Groupe 3 - TEF - M. JENSEN - Théorie Positive de L'agenceDocument10 pagesExposé Groupe 3 - TEF - M. JENSEN - Théorie Positive de L'agencePatrice DONGOUTIOPas encore d'évaluation
- TheoriemanagerialeDocument5 pagesTheoriemanagerialeMounir DrouziPas encore d'évaluation
- Mémoire ActionnariatDocument13 pagesMémoire ActionnariatPerezPas encore d'évaluation
- ENSET-DE-EE 3.0 Final-2Document14 pagesENSET-DE-EE 3.0 Final-2Edlove VINGAPas encore d'évaluation
- Gouvernance D 'Entreprise Et Performance Unetatdel 'Art: Corporate Governance and Performance, A State of The ArtDocument10 pagesGouvernance D 'Entreprise Et Performance Unetatdel 'Art: Corporate Governance and Performance, A State of The ArtchaymaedouhidPas encore d'évaluation
- Ficher de LectureDocument6 pagesFicher de LectureMOUNIR KRIRPas encore d'évaluation
- 08b+RMd 169Document29 pages08b+RMd 169Soukeina SnPas encore d'évaluation
- 562-Article Text-961-1-10-20230505Document17 pages562-Article Text-961-1-10-20230505Othman ShonePas encore d'évaluation
- Rapport Final de La Gouvernance D'entrepriseDocument14 pagesRapport Final de La Gouvernance D'entrepriseibtissam houriPas encore d'évaluation
- Contexte de La Théorie de L'agenceDocument7 pagesContexte de La Théorie de L'agencemed55555Pas encore d'évaluation
- Devoir D'économieDocument8 pagesDevoir D'économiebk9cdjk46jPas encore d'évaluation
- Théorie Financière-Partie 1Document46 pagesThéorie Financière-Partie 1Ouade Fatima zahraPas encore d'évaluation
- Cognitive PDFDocument27 pagesCognitive PDFMazen KoukiPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Thème 3Document3 pagesFiche de Lecture Thème 3Hassna RaqiPas encore d'évaluation
- 5626 15249 1 PBDocument16 pages5626 15249 1 PBMalika HartPas encore d'évaluation
- Theorie de L AgenceDocument20 pagesTheorie de L AgenceHamza El MrabetPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Les Theories de La FirmeDocument3 pagesFiche de Lecture Les Theories de La Firmemido78100% (1)
- Chapitre 1 Le Cadre Theorique de La GouvDocument36 pagesChapitre 1 Le Cadre Theorique de La GouvChaymae KoualilPas encore d'évaluation
- Nature Des Detenteurs de Blocs de Controle, Mecanismes de Controle Et Performance Financiere Des Entreprises TunisiennesDocument24 pagesNature Des Detenteurs de Blocs de Controle, Mecanismes de Controle Et Performance Financiere Des Entreprises TunisiennesL'auditeurJunior100% (1)
- Fiche de Lecture Thème 3Document3 pagesFiche de Lecture Thème 3Hassna RaqiPas encore d'évaluation
- 1-Divergence D'intérêt:: Kirmi Ibrahim Page 139 Publication 2012Document6 pages1-Divergence D'intérêt:: Kirmi Ibrahim Page 139 Publication 2012chendoudioussama6Pas encore d'évaluation
- Gouvernance Des OrganisationsDocument6 pagesGouvernance Des OrganisationsWassima El AttarPas encore d'évaluation
- Théorie DagenceDocument24 pagesThéorie DagenceabdelkrimkhouloudPas encore d'évaluation
- Expose D'ogeDocument8 pagesExpose D'ogeKatcha nanklan enock hiliPas encore d'évaluation
- Cours II - La Thã©orie de L'agenceDocument41 pagesCours II - La Thã©orie de L'agenceFalling Star100% (1)
- CatelDocument26 pagesCatelNassim bakouchePas encore d'évaluation
- Pilotage Des PerformancesDocument21 pagesPilotage Des PerformancesMINTOU NSOCKA Marcel BerengerPas encore d'évaluation
- TunisDocument7 pagesTunisdhahri nourhenPas encore d'évaluation
- Théorie D'agenceDocument2 pagesThéorie D'agenceSoufianovich Soufiane0% (3)
- EL-HARTI BN GouverDocument17 pagesEL-HARTI BN GouverSimo EL KhomssiPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture 1 Texte 1 Khatir ChaimaDocument2 pagesFiche de Lecture 1 Texte 1 Khatir ChaimaChaima KHATIRPas encore d'évaluation
- Théorie D'agence Et Contrat Social, RSEDocument21 pagesThéorie D'agence Et Contrat Social, RSEmeryemessafii34Pas encore d'évaluation
- Résumé EpistemeDocument8 pagesRésumé EpistemeAbdelilah ChedadiPas encore d'évaluation
- Les Fondements de la Gestion d'Entreprise : Un Guide Complet pour les Managers ModernesD'EverandLes Fondements de la Gestion d'Entreprise : Un Guide Complet pour les Managers ModernesPas encore d'évaluation
- Cognitive PDFDocument27 pagesCognitive PDFMazen KoukiPas encore d'évaluation
- Spécifité Des Entreprise FamilialesDocument3 pagesSpécifité Des Entreprise FamilialesMazen Kouki100% (1)
- DefinitionDocument2 pagesDefinitionMazen Kouki100% (1)
- Theories ContractuellesDocument5 pagesTheories ContractuellesMazen KoukiPas encore d'évaluation
- Théorie de L'enracinementDocument3 pagesThéorie de L'enracinementMazen Kouki100% (2)
- QQOQCP FicheDocument4 pagesQQOQCP FicheIbtissam HmPas encore d'évaluation
- Syllabus ISM - MSAAL 2212Document3 pagesSyllabus ISM - MSAAL 2212nidaaamrPas encore d'évaluation
- L'expression EcriteDocument10 pagesL'expression EcriteCindy Duarte0% (1)
- Nombres Relatifs Resume de Cours FRDocument2 pagesNombres Relatifs Resume de Cours FRmqsiPas encore d'évaluation
- Appel Recrutement Enqueteurs Projet Doing Research GDNDocument11 pagesAppel Recrutement Enqueteurs Projet Doing Research GDNouedraogomohamedlamine941Pas encore d'évaluation
- Le Tourisme Culturel Durable Une Opportunité de Mise en Valeur Du Patrimoine Algérien (Le Cas de La Ville Historique de Tlemcen)Document9 pagesLe Tourisme Culturel Durable Une Opportunité de Mise en Valeur Du Patrimoine Algérien (Le Cas de La Ville Historique de Tlemcen)sam mirouPas encore d'évaluation
- RapportDocument231 pagesRapportMEONEPas encore d'évaluation
- Catalogue CampusUCharleroiDocument21 pagesCatalogue CampusUCharleroiManuelGonzalezAnidoPas encore d'évaluation
- PV de Deliberation Session2 Rjuin A70 15 2021 A 11h41m48sDocument8 pagesPV de Deliberation Session2 Rjuin A70 15 2021 A 11h41m48sSidali BmrPas encore d'évaluation
- Séneca de IraDocument17 pagesSéneca de IravieiradarosaPas encore d'évaluation
- Dil 7 4 10 PDFDocument11 pagesDil 7 4 10 PDFATTAH Régis Patrick AusséPas encore d'évaluation
- Annexe 9 - Regime IndemnitaireDocument1 pageAnnexe 9 - Regime IndemnitaireTennis de Table USV 89500Pas encore d'évaluation
- Operations Racines Carrees 1Document2 pagesOperations Racines Carrees 1AYouB LmPas encore d'évaluation
- EMPLOI DU TEMPS 5AEP Adapté Au Curriculum 2020Document2 pagesEMPLOI DU TEMPS 5AEP Adapté Au Curriculum 2020Fyrdaous FyrdaousPas encore d'évaluation
- ParallélogrammesDocument31 pagesParallélogrammesdynamicmultiservices1Pas encore d'évaluation
- Revue Jésuites 2012 #4Document64 pagesRevue Jésuites 2012 #4EddiePas encore d'évaluation
- DTP 1Document13 pagesDTP 1asmabenkhalifa330Pas encore d'évaluation
- Appel À CandidatureDocument2 pagesAppel À CandidatureGildas Bénin BuildingPas encore d'évaluation
- Histoire Du Sport - Thierry TerDocument31 pagesHistoire Du Sport - Thierry TerÉric TonkaPas encore d'évaluation