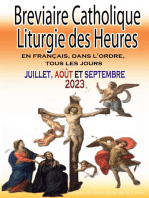Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Fiche Radionavigation1
Transféré par
lina derbikhTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Fiche Radionavigation1
Transféré par
lina derbikhDroits d'auteur :
Formats disponibles
Les Ailes Virtuelles
LES BALISES DE RADIONAVIGATION
Nom de la Signification Instrument du tableau de Symbole sur les
balise bord associé cartes
NDB Non directionnal beacon ADF : Automatic Direction Finder
1 Radiophare non directionnel / trouveur automatique de
direction. Radiocompas
VOR VHF Omnidirectionnal Range HSI : Horizontal Situation
2 Radiophare omnidirectionnel Instrument / instrument de
VHF situation horizontale
DME Distance Measuring DME
Instrument
3
Instrument de mesure de
distance
VOR / VHF Omnidirectionnal Range / HSI + DME
Distance Measuring
DME Instrument
4
Radiophare omnidirectionnel
VHF / Instrument de mesure
de distance
Marqueurs OM : Outer Marker / Trois voyants Bleu (O), orange
marqueur extérieur (M), gris (I)
MM : middle marker /
5
marqueur intermédiaire
IM : Inner Marker / marqueur
intérieur
ILS Instrument Landing System / HSI : Horizontal Situation
6 système d’aterrissage aux Instrument / instrument de
instruments situation horizontale
Tous les symboles des cartes sont sur https://www.sia.aviation-
civile.gouv.fr/aip/enligne/PDF_AIPparSSection/IAC/AVP/1/1213_AVP-1.1.pdf
Ressources :
Livre : Initiation à l’aéronautique, éd. Cépaduès. ISBN 978.2.85428.983.1
Sites web : Les tutoriels de Jean-Pierre Rabine : http://jpair.fr/tutoriels/cadre_tutoriels.htm
Les instruments de navigation : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-
FR_V2/pdf/PIL_NAV.pdf
De nombreuses animations en Flash sur le site canadien airinstruction.com :
http://www.airinstruction.com/
Site général sur l’aviation : http://home.nordnet.fr/dmorieux/radiogoniometrie.htm
Et d’innombrables autres, dans toutes les langues…
Les balises de radionavigation Page 1 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises NDB
Voir : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/INST_NDB.pdf
Les balises NDB sont parmi les plus vieux types d'aide à la navigation par onde radio. Une balise NDB est
un radiophare non directionnel NDB (Non Directional Beacon), l’équivalent d’un phare dans la marine.
Ce système utilise, à bord de l’avion, un récepteur radio ADF (automatic direction finder), qui permet de
naviguer vers une station NDB et de suivre une route.
Un ADF a beaucoup d'avantages :
Faible coût d’installation et d’entretien pour la station au sol.
Avec l’installation peu coûteuse des NDB, beaucoup de petits aérodromes peuvent fournir des
approches aux instruments IFR.
Le NDB permet la navigation dans les régions non équipées de couverture VOR.
La station émettrice au sol
Le NDB transmet grâce à une antenne verticale une onde radio en modulation d’amplitude sur une
fréquence entre 200 à 400 kHz, comme les émetteurs de radiodiffusion en Ondes Moyennes (Radio
Monte-Carlo par exemple). L'onde suit la courbure de la terre, ce qui permet une bonne réception à
basse altitude et sur de grandes distances. Le signal ne nécessite pas une portée optique pour être reçu.
La puissance d’émission d’un NDB va de 50 W à 2 kW selon son type. Un émetteur de radiodiffusion a
une puissance beaucoup plus grande (jusqu’à 100 kW).
Les antennes à bord de l’avion
L’ADF reçoit les signaux de deux antennes de l’avion : l’antenne cadre et l’antenne de lever de doute.
L’antenne cadre est une boucle de fils électriques. Placé verticalement, ce cadre est un collecteur
d'ondes à effet directif. C’est un peu comme un petit poste à transistors qu’on oriente pour capter une
station le mieux possible. La tension induite par l'onde électromagnétique qui provient du NDB est
captée par le cadre et acheminée vers le récepteur. Ce récepteur, par un système électronique pas trop
complexe, transmet la position du cadre à l'aiguille de l'ADF. Ci-dessous une antenne cadre qu’on faisait
tourner à la main, sur un Dornier Do17Z :
L’antenne cadre indique la direction de la balise par rapport à l'axe de l'avion. Mais elle ne permet pas
de déterminer si on se dirige ou si on s’éloigne d’une station NDB.
L’antenne de lever de doute fournit cette information et aussi la réception audio lorsque la fonction ADF
n’est pas requise. Cette antenne est en général un long fil qui va de l’arrière de la canopée (ou d’un mât)
au haut de l’empennage vertical.
Sur les avions modernes, et ce depuis assez longtemps, l’antenne cadre a été réduite considérablement
en dimensions, et elle inclut une antenne de lever de doute.
Les balises de radionavigation Page 2 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Le récepteur ADF
C’est un récepteur radio que l’on règle pour recevoir la fréquence du NDB choisi. Il faut connaître cette
fréquence, et pour ça, il faut avoir préparé le vol en consultant les cartes. Voici le récepteur du Baron 58,
réglé pour recevoir un NDB à 369,0 KHz :
Une recherche via Google permet d'obtenir la liste des NDB existants et de leur fréquence. Le site du SIA
donne aussi ces informations.
Les instruments du NDB / ADF
ADF d’un Cessna Trois instruments ADF différents, combinant l’aiguille de l’ADF (jaune) et celle du VOR 2
(verte).
Equipement ED/EHSI d’un
Boeing
Ici, la flèche bleue pointe vers
le NDB dont le nom et la
fréquence sont indiqués en
haut à gauche du cadran : CM,
à 369,0 KHz.
Source des images : site IVAO : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/PIL_NAV.pdf
Défauts du système NDB / ADF
Sensibilité aux orages : l'ADF s'oriente vers la source des éclairs au lieu de la station. Lors
d'orages électriques, l'aiguille aura tendance à se diriger par intermittence vers la source
orageuse. Ignorer ces fluctuations.
Effet côtier : en vol au dessus de la mer, les signaux émis depuis la côte à un angle inférieur à 30°
ne sont pas fiables.
Erreur de roulis : erreur de l'antenne réceptrice pendant les virages
Effet de nuit : mauvaise fiabilité des signaux juste avant le coucher et juste avant le lever du
soleil.
Les balises de radionavigation Page 3 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Effet de montagne: réflexion et déviation des signaux. Peut aussi être produit par la réflection
des signaux contre des falaises. Ne pas utiliser des stations au sol obturées par une montagne
ou une falaise.
L'erreur quadrantale : l'aéronef, faisant office d'antenne, au cap 270 et au cap 90, l'erreur est
moindre.
Réception d’un signal du NDB
La porteuse de l’émetteur est émise en continu, seulement interrompue, à intervalles réguliers, par
l'identification en code Morse de la balise. Ceci permet de déterminer avec certitude l’origine du
signal reçu. Par exemple, le NDB November Charlie de Cagnes sur Mer émet sur 338,0 KHz le code
« NC » qui s’écrit en Morse : « - . - . - . ». Pour entendre ce signal, utiliser la touche ADF du récepteur
radio. Voir l’utilisation des radios en page 16.
Accessoirement la porteuse d'un NDB peut aussi servir à transmettre :
ATIS : Automatic Terminal Information Service.
AWIS : Automatic Weather Information Service.
AWOS : Automated Weather Observation System.
ASOS : Automated Surface Observation System
VOLMET : Meteorological Information Broadcast
TWEB : Transcribed Weather Broadcast
PIP : Code morse supplémentaire indiquant une mal fonction du NDB
Les balises de radionavigation Page 4 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises VOR
Voir : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/INST_VOR1.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/VHF_Omnidirectional_Range
Le VOR (VHF Omnidirectional Range) est un système de positionnement radioélectrique utilisé en
navigation aérienne depuis 1947 et fonctionnant, comme son nom l'indique, avec les fréquences de
la bande VHF. Cette bande est juste au dessus de celle utilisée par la radiodiffusion en FM. Le VOR
émet, lui, en modulation d’amplitude.
Un système VOR se compose de deux élements :
Au sol : un émetteur
Dans l’avion : un récepteur associé à un instrument qui affiche où l’avion se situe,
angulairement, par rapport à l’émetteur.
Un récepteur de navigation VOR (NAV-
COM), permet de déterminer le
relèvement magnétique d’un aéronef
par rapport à une station radioélectrique
au sol (balise émetteur VOR), dont la
position est connue. Le relèvement
magnétique d’un aéronef par rapport à
un VOR s'exprime par le rayon issu du
VOR, sur lequel l’aéronef se trouve.
Chaque rayon issu de la balise est appelé
un radial.
Les avantages du VOR :
Un relèvement magnétique de position par rapport à la balise.
Une précision angulaire de 1° à 5°.
Une consommation électrique moindre que celle d'une balise NDB.
Les inconvénients du VOR :
La portée est plus réduite que les stations NDB (le signal ne suit pas la courbure terrestre).
Le rayonnement est stoppé par les montagnes et les gros obstacles.
Sa mise en place au sol est plus complexe et nettement plus coûteuse que celle d'un NDB
(cependant, la consommation en énergie étant plus faible, l'amortissement se fera à moyen
terme).
Les balises de radionavigation Page 5 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
L’émetteur du VOR
Les VOR sont implantés à des points stratégiques, en campagne pour la navigation en croisière et à
proximité des aérodromes principaux, pour le guidage sur certaines approches IFR.
On rencontre donc deux types de VOR :
Le VOR en-route a une puissance moyenne de 200 Watts et transmet sur des fréquences
comprises entre 108,00 MHz et 117,95 MHz, avec des canaux espacés de 25 kHz. Le rayon
d'action est approximativement de 200 Nm.
Le VOR Terminal (appelé aussi T-VOR) des aérodromes émet avec une puissance de 50 Watts
environ, sur des fréquences comprises entre 108,00 MHz à 111,85 MHz dont la première
décimale est paire, avec des canaux au pas de 25kHz (Ex : 108,00 MHz, 108,25 MHz). Il a une
portée plus limitée, de l'ordre de seulement 40 à 50 Nm (du fait, déjà, de la puissance plus
faible, mais aussi du positionnement, pas forcément optimal, pour une réception à longue
distance).
L’antenne au sol
On peut voir une balise VOR à Cagnes sur Mer, sur le bord de mer, au niveau de l’hippodrome. C’est
la balise CGS à 109,2 MHz.
L’antenne se compose
d’un élément central, qui émet dans toutes les directions à la fréquence indiquée sur les cartes.
C’est cette fréquence qui doit être affichée sur le récepteur dans l’avion.
48 petites antennes périphériques disposées sur un cercle de 6,8 m de rayon.
L’électronique du système fait en sorte que les 48 petites antennes émettent chacune à son tour en
tournant à 30 tours par seconde. Les antennes sont fixes. Elle ne tournent pas mécaniquement. C’est un
peu comme le faisceau d’un phare maritime, qui est directionnel et tourne en permanence.
Le récepteur dans l’avion
Dans l’avion, il y a souvent deux récepteurs séparés, appelés VOR1 et VOR2. Chaque récepteur doit
être réglé à la fréquence choisie. On peut fort bien n’en utiliser qu’un.
L’instrument permettant de visualiser où se situe angulairement l’avion par rapport au VOR
sélectionné peut se présenter sous diverses formes : CDI, CDI/GS, HSI, EHSI, Navigation Display ND,
etc.
Les balises de radionavigation Page 6 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
CDI CDI/GS
HSI
EHSI ND de Boeing 737
Portée du VOR :
ou bien
Ainsi, un avion volant à 10 000 pieds reçoit le signal du VOR à environ 123 nm de distance.
Réception du signal audio d’un VOR
Comme le fait un NDB, un VOR émet un code Morse permettant l'identification de la balise.
En plus, il peut transmettre un message modulé en phonie en cas de nécessités (panne des moyens
de radiocommunication d'un ATC, par exemple).
Tous ces signaux « basse-fréquence » modulent une porteuse VHF, qui est la fréquence indiquée
sur les cartes aéronautique et syntonisée sur les instruments de navigation.
Pour l’écoute des codes Morse, voir à la page 16.
Les informations To et From
Il y a une difficulté dans l’interprétation des symboles To et From affichés dans l’instrument du
récepteur du VOR. Bien que « To » veuille dire « vers » et « From » veuille dire « de », on peut fort bien
voir affiché From et se rapprocher d’une balise VOR, ou voir To et s’en éloigner. C’est comme ça, je ne
sais pas pourquoi, et c’est illustré par les simulations ci-dessous, tirées du site airinstruction.com.
Les balises de radionavigation Page 7 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
On est dans la zone TO et on se rapproche du VOR On est dans la zone TO et on s’éloigne du VOR
On est dans la zone FROM et on se rapproche du VOR
Les balises de radionavigation Page 8 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises DME
Voir : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/INST_DME.pdf
Le système DME permet d’afficher dans un avion la distance oblique qui le sépare de l'antenne DME au
sol.
Les DME sont, en général, aux mêmes endroits que les balises VOR. Grâce à un DME couplé à un VOR,
on peut connaître la position exacte de l'aéronef : le VOR indique sa position angulaire par rapport à la
balise, et le DME donne la distance oblique par rapport à la même balise.
On voit ici que plus l’avion est loin de la balise, plus la distance affichée est proche de la distance au sol.
Plus l’avion se rapproche de la station, plus la distance affichée est différente de la distance au sol. Par
exemple, à la verticale de la station DME, la distance au sol est nulle. Mais l’afficheur indique 1,2 nm si
l’avion est à 7000 pieds. La distance oblique est toujours plus grande que la distance au sol.
L’émetteur DME
L’émetteur DME utilise la gamme de fréquence de 962 Mhz à 1213 Mhz. C’est beaucoup plus haut que
la fréquence du VOR.
Le principe est simple, même si sa réalisation est complexe : l’avion envoie un message codé à la station
au sol. La station le lui renvoie. Le récepteur dans l’avion mesure le temps aller-et-retour mis par le
message. Il en déduit par calcul la distance entre l’avion et la balise. Le codage du message sert à l’avion
à s’assurer que le message qu’il reçoit est bien celui qui le concerne, parce que la station au sol traite en
même temps de très nombreux messages provenant de très nombreux avions (environ une centaine.
Au-delà, la station au sol est saturée).
Le récepteur DME
Ce récepteur (ici celui du Baron 58) affiche la distance
oblique jusqu’à la balise et la vitesse (oblique) de l’avion
en nœuds . Certains récepteurs affichent aussi le temps
restant pour atteindre la verticale de la balise DME.
L’interrupteur à glissière permet de choisir le récepteur R1
ou R2, correpondant à VOR1 ou à VOR2.
Les balises de radionavigation Page 9 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Le récepteur peut afficher ses informations sur un EHSI.
Elles sont données pour les deux VOR/DME : en bas à
gauche, la distance de la balise AN (110,50 MHz) est de
0,5 nm. La distance de la balise AVN (112,30 MHz) n’est
pas affichée. Cette balise est hors de portée.
Les afficheurs modernes, du type Glass Cockpit,
présentent une multitude d’informations, dont les
distances, vitesses, et temps.
La porteuse de l’émetteur est émise en continu, seulement interrompue, à intervalles réguliers, par
l'identification en code Morse de la balise. Ceci permet de déterminer avec certitude l’origine du
signal reçu. Pour entendre ce signal, utiliser la touche DME du récepteur radio. Voir l’utilisation des
radios en page 16.
Les balises de radionavigation Page 10 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises VOR/DME
Il existe des balises VOR, des balises DME et des balises couplées VOR/DME.
Les balises couplées VOR/DME sont des balises DME installées aux mêmes endroits que les balises VOR.
Grâce à un VOR/DME, un avion peut connaître sa position exacte : le VOR indique la position angulaire
par rapport à la balise, et le DME donne la distance oblique par rapport à la même balise.
Le plus souvent, on ne règle pas la fréquence du DME dans le récepteur de l’avion. Cette fréquence est
réglée automatiquement quand on règle celle du VOR.
Le reste du fonctionnement est exactement identique à celui des VOR et DME.
La réception du signal radio d’une balise VOR/DME peut se faire en commutant les récepteurs radio
sur VOR ou sur DME. Normalement, les codes Morse reçus sont les mêmes. Voir l’utilisation des
radios en page 16.
Les balises de radionavigation Page 11 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises Marker
Voir : http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/INST_MARKER.pdf
Les MARKERs sont des émetteurs radio dont les antennes ont un rayonnement vertical, et sont
implantées tout le long de l'axe d'approche, à des distances variables du seuil. Les émissions des
Marker forment des cônes d’émission verticaux étroits.
Leur rôle est de renseigner le pilote du passage de l'appareil à leur verticale et ainsi de suivre
parfaitement le plan de descente.
Il y a 3 types de Marker :
Outer Marker
Middle Marker
Inner Marker
Les MARKERs sont de plus en plus souvent abandonnés au profit des systèmes DME. Parfois l'Outer
Marker est remplacé par un NDB de faible puissance.
L’instrument du tableau de bord qui permet d’afficher le signal marker est composé de 3 voyants
marqués des lettres O-M-I. Chaque lettre est éclairée lors de la réception du signal correspondant
et possède une couleur particulière :
Au passage de la verticale de l’OUTER
MARKER, le voyant « O » de couleur bleue
s'allume au tableau de bord et une
tonalité de 400 Hz, pulsée en code Morse,
se fait entendre dans le cockpit : deux
traits par seconde.
Au passage de la verticale du MIDDLE
MARKER, un voyant «M » de couleur
ambre s'allume au tableau de bord et une
tonalité de 1,3 Khz, pulsée en code Morse,
se fait entendre dans le cockpit : un point
et un trait par seconde.
Au passage à la verticale de l’INNER
MARKER, un voyant « I » de couleur
blanche s'allume au tableau de bord et
une tonalité de 3KHz, pulsée en code
Morse, se fait entendre : points en
continu.
Pour entendre les bips au passage à la verticale des markers, il faut avoir commuté le bouton d’écoute
correspondant sur la radio. Voir en page 16.
Les balises de radionavigation Page 12 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Les balises ILS
Voir : http://www.vatfrance.org/documents/pilotes/temp/Approche_ILS.pdf
http://www.ivao.fr/dep/instruction/Manuels/Ipack-FR_V2/pdf/INST_ILS.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Instrument_Landing_System
L’ILS (Instrument Landing System) est un système automatique d’aide à l’atterrissage, utilisé dans
l'aviation civile. Il permet une approche de précision compatible avec des conditions météorologiques
dégradées, en offrant un guidage dans les plans vertical et horizontal jusqu’au seuil.
L’ILS comprend :
Un système de guidage horizontal appelé LOCALIZER. Permet de savoir si on est bien dans l’axe
de la piste (trop à droite ou trop à gauche). Il émet, grâce à un réseau d’antennes directrices
situées dans le prolongement de la piste, un faisceau radioélectrique permettant de fournir au
pilote une indication d’écart horizontal par rapport à l’axe de piste.
Un système de guidage vertical appelé GLIDE SLOPE (ou Glide Path, ou encore Glide). Permet de
savoir si on descend avec le bon angle (trop haut ou trop bas). Il émet des faisceaux
radioélectriques dans le prolongement de l’axe de piste permettant de fournir au pilote une
indication d’écart vertical par rapport à la pente de descente nominale.
Un système d’identification par code morse attaché au glide. Permet de savoir si on approche
du bon aéroport, et si l’ILS fonctionne correctement. Voir en page 16.
La plupart des ILS en France sont couplés avec un DME qui permet de connaître la distance à parcourir
pour atteindre le seuil de piste (elle représente la 3e composante de guidage pour une approche de
précision).
Les émetteurs de l’ILS
Il y en a deux : un pour le Localizer (guidage horizontal), et un pour le Glide (guidage vertical).
Emetteur du Localizer : travaille dans la bande VHF, en modulatuon d’amplitude. La fréquence
d’émission est fixe et va de 108,10 MHz à 111,95 MHz avec la première décimale impaire (Ex: 108,10 –
108,15 – 108,30 – 108,35 etc...). C’est cette fréquence que l’on règle sur le récepteur dans l’avion. Les
antennes de l’émetteur sont assez directives, et émettent dans la direction de l’arrivée de l’avion.
On voit ici le diagramme de rayonnement
des antennes du Localizer, vu de dessus. On
comprend que si l’avion est en dehors des
deux lobes de rayonnement, il ne reçoit pas,
ou pas suffisamment, de signal, et ne peut
pas utiliser l’ILS.
Quand l’avion est à l’intérieur des lobes, le
signal reçu est suffisant pour que
l’électronique de bord affiche l’écart de
l’avion par rapport à l’axe de la piste.
Les antennes rayonnent aussi un peu vers l’arrière. On peut donc approcher une piste en sens inverse, avec
une précision réduite. Ça s’appelle l’approche en back-course. Ce n’est disponible que si c’est publié sur les
fiches des aéroports. Les approches back-course sont interdites en France.
Les balises de radionavigation Page 13 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Emetteur du Glide : travaille dans une bande de fréquence beausoup plus haute : en UHF, entre 328,65
et 335,40 MHz. Ces fréquences sont appariées aux fréquences des localizer et sont
automatiquement définies en interne dans l’avion, de façon transparente. Le pilote n’a qu’à entrer
la fréquence du localizer pour que la fréquence du glide se règle toute seule.
Le glide est composé de deux ou trois antennes polarisées horizontalement, disposées
verticalement sur un pylône situé sur l'un des côtés au travers de la zone de toucher des roues.
On voit ici le diagramme de rayonnement des
antennes du Glide, vu de côté. On comprend que si
l’avion est en dehors des deux lobes de
rayonnement, il ne reçoit pas, ou pas suffisamment,
de signal, et ne peut pas utiliser l’ILS.
Quand l’avion est à l’intérieur des lobes, le signal
reçu est suffisant pour que l’électronique de bord
affiche l’écart de l’avion par rapport à la pente de
descente normale.
Il n’y a pas d’émission vers l’arrière, donc pas de
possibilité d’utiliser le glide en approche back-
course.
L’équipement à bord de l’avion
Le récepteur radio
On doit régler la fréquence de réception
de l’ILS d’après ce qu’on a lu sur la carte
d’approche de l’aéroport. On règle cette
fréquence sur le récepteur NAV1, qui est
utilisé pour l’ILS. Ici, on l’a réglé sur
113,70 MHz. C’est la fréquence du LOC
(Localizer). La fréquence du Glide se règle
toute seule. On n’a jamais à s’en
préoccuper.
L’afficheur
L’instrument permettant de visualiser où se situe l’avion par rapport à l’ILS sélectionné est le même
que celui utilisé pour la navigation avec les VORs. Il peut donc se présenter sous les mêmes formes :
CDI, CDI/GS, HSI, EHSI, Navigation Display ND, etc. En voici trois exemplaires classiques.
Pour atterrir sur une piste avec l’ILS, il faut, en plus de régler sa fréquence, régler la course. Cette
course est l’orientation de la piste par rapport au Nord Magnétique, indiquée sur les cartes. Cette
orientation s’appelle le QFU. Elle est donnée en degrés, en tournant dans le sens horaire. Par
exemple le QFU de la piste 04L de l’aéroport de Nice est 39°.
Les balises de radionavigation Page 14 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
Le CDI Le CDI/GS Le HSI
L’aiguille pivote autour d’un axe Appareil plus moderne, aux
situé à son extrémité haute. Elle Même principe que le CDI, avec fonctions identiques. C’est cet
représente le radial de l’ILS, donc en plus une aiguille horizontale, appareil qui équipe le Baron 58.
l’axe de la piste. Il y a une rose des représentant le plan de descente. Ici, l'aiguille de suivi de route est
vents mobile et deux repères, à Si cette aiguille est en dessous de articulée par son centre et non par
douze heures et à six heures, pour l’avion, c’est que l’avion est trop son extrémité supérieure. Elle
ajuster la course. On sélectionne haut. Il faut descendre, donc se indique donc un relèvement direct,
cette dernière grâce au bouton diriger vers l’aiguille. superposable à un cap. Elle est
OBS (Omni Bearing Selector), qui va
composée de trois parties : la
faire tourner la couronne de la rose
flèche, la barre centrale et la
des vents graduée jusqu'à ce que
l'un des repères coïncide avec la
queue.
valeur désirée. La barre centrale se décale à droite
L’avion est supposé au centre du ou à gauche, indiquant ainsi la
cadran, fixe. Si l’aiguille est à droite déviation entre le radial et la
de l’avion, c’est que l’avion est à position de l'aéronef.
gauche de la piste. Il doit tourner Cet appareil affiche aussi le cap
vers la droite, donc vers l’aiguille. fixé sur le PA.
L’avion est trop haut et trop à gauche. L’avion est pile dans l’axe de la piste et
sur le bon plan de descente.
L’écoute de la balise ILS
L’écoute du code Morse émis par l’ILS se fait comme pour celle d’une balise VOR. Pour entendre ce
signal, utiliser la touche VOR1 du récepteur radio. Généralement, c’est VOR1 qui est associé à la
réception de l’ILS. Voir en page 16 l’utilisation de la radio.
Les balises de radionavigation Page 15 de 16 Version du 24 novembre 2012
Les Ailes Virtuelles
L’écoute des balises
Pour écouter dans l’avion les signaux émis par les balises, il faut
commuter les récepteurs sur la radio de bord.
Sur l’image ci-contre, on voit la radio du Baron 58. D’autres
récepteurs sur d’autres avions peuvent se comporter
différemment.
Ici, on a allumé les récepteurs
de COM1 (communication avec le sol, à la fréquence
128,30 MHz),
de NAV1 (code Morse de la balise sélectionnée par sa
fréquence, ici 116,50 MHz),
des Markers.
On peut écouter COM1 ou COM2, ou bien les deux en même
temps (touche BOTH), mais pas aucun des deux.
On peut écouter le code Morse de la balise VOR sélectionnée
sur VOR1, ou bien celle sélectionnée sur VOR2, ou bien les
deux, ou bien aucune.
Le bouton ADF permet d’écouter le code Morse de la balise
NDB sélectionnée.
Le bouton DME permet d’écouter le code Morse de la balise
VOR/DME sélectionnée.
Il n’est pas nécessaire de connaître le Morse pour identifier les balises. Avec un peu d’habitude, on
arrive facilement à reconnaître les suites de traits et de points et à les comparer avec le code écrit sur la
carte.
Jean-Paul Corbier
24 novembre 2012
Les balises de radionavigation Page 16 de 16 Version du 24 novembre 2012
Vous aimerez peut-être aussi
- Fiche Radionavigation2Document14 pagesFiche Radionavigation2Anonymous GNBs2mXX0DPas encore d'évaluation
- La RadionavigationDocument33 pagesLa RadionavigationSteven MishaPas encore d'évaluation
- Cours-Vol Aux InstrumentsDocument15 pagesCours-Vol Aux InstrumentsrabehPas encore d'évaluation
- Radionavigation ATE 1 TRIM 19Document86 pagesRadionavigation ATE 1 TRIM 19Ahmed LaibiPas encore d'évaluation
- Radionavigation Ed11 Lpbugeat - OriginalDocument10 pagesRadionavigation Ed11 Lpbugeat - OriginalNaguibPas encore d'évaluation
- Balises de RadionavigationDocument39 pagesBalises de Radionavigationsarra ram100% (2)
- Chapitre 8 Radar Meteo de Bord PDFDocument40 pagesChapitre 8 Radar Meteo de Bord PDFArbi Machraoui100% (1)
- 5 VorDocument16 pages5 VorSim Hlr100% (1)
- Chap 5Document78 pagesChap 5Hanane NasrPas encore d'évaluation
- A4 Communications 1 2019 01 24Document40 pagesA4 Communications 1 2019 01 24AndrePas encore d'évaluation
- Gns430 GuideDocument19 pagesGns430 GuideThierry TarnusPas encore d'évaluation
- Guide GNS430 v2Document16 pagesGuide GNS430 v2Anonymous ZJOuws50DPas encore d'évaluation
- C150 FR DescripDocument15 pagesC150 FR DescripEdwin SenPas encore d'évaluation
- Prepanav A5Document34 pagesPrepanav A5GAPas encore d'évaluation
- Cours 5 Nav NDB Vor IlsDocument16 pagesCours 5 Nav NDB Vor Ilszineb-841429100% (4)
- FRENCH Air Navigation Pro 5 2 User ManualDocument75 pagesFRENCH Air Navigation Pro 5 2 User Manualchristox01100% (1)
- NavRoute Et DistanceDocument43 pagesNavRoute Et DistanceAaronPas encore d'évaluation
- Breviaire Catholique Liturgie des Heures: En Français, Dans L'ordre, Tous Les Jours Pour Juillet, Août Et Septembre 2023D'EverandBreviaire Catholique Liturgie des Heures: En Français, Dans L'ordre, Tous Les Jours Pour Juillet, Août Et Septembre 2023Pas encore d'évaluation
- 1ere Partie - Etude en Detail Du Poste de Pilotage - Airbus A320Document35 pages1ere Partie - Etude en Detail Du Poste de Pilotage - Airbus A320Rnav rnav100% (2)
- Approche VORDocument7 pagesApproche VORJulien BctPas encore d'évaluation
- Cours Meteo D Boutonnet Dossier de Vol - OriginalDocument54 pagesCours Meteo D Boutonnet Dossier de Vol - OriginalSteve Fongang100% (1)
- Exercice 24.11 - Vol Aux Instruments - Aides À La Radionavigation - ADFDocument481 pagesExercice 24.11 - Vol Aux Instruments - Aides À La Radionavigation - ADFTasha Velasquez100% (2)
- 9d. Navigation Exercice Pratique Air EvasionDocument44 pages9d. Navigation Exercice Pratique Air EvasionSam MogsamPas encore d'évaluation
- Fiche 050-MétéorologieDocument10 pagesFiche 050-MétéorologieHugo GaubertPas encore d'évaluation
- Calcul Mental Triangle Des Vitesses - OriginalDocument35 pagesCalcul Mental Triangle Des Vitesses - OriginalFatma BenbrahimPas encore d'évaluation
- Checklist DR 250Document11 pagesChecklist DR 250izabazPas encore d'évaluation
- ATCfrequency MoroccoDocument11 pagesATCfrequency Moroccobabatoto21Pas encore d'évaluation
- Rapport de Stage ENNADocument17 pagesRapport de Stage ENNA43014091Pas encore d'évaluation
- Micro Simulateur - Septembre 2023Document52 pagesMicro Simulateur - Septembre 2023Laurent Rivière100% (1)
- Base Alt2Document10 pagesBase Alt2Yvan WandjiPas encore d'évaluation
- Cours N°3 Comment Naviguer PDFDocument54 pagesCours N°3 Comment Naviguer PDFNaguib100% (1)
- Cahier Des Charges ChamsDocument2 pagesCahier Des Charges ChamsHazem BoukedPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 1 ComDocument8 pagesCHAPITRE 1 ComBoukhariPas encore d'évaluation
- Tuto Sid StarsDocument9 pagesTuto Sid Starsfrantic69Pas encore d'évaluation
- Le SMDSMDocument95 pagesLe SMDSMsailor21316Pas encore d'évaluation
- Manuel de Vol - 4 - Procédures D'urgenceDocument3 pagesManuel de Vol - 4 - Procédures D'urgencejmlezcanoPas encore d'évaluation
- Systèmes Globaux de Navigation Par SatelliteDocument1 pageSystèmes Globaux de Navigation Par SatelliteFlorence Nga NdzanaPas encore d'évaluation
- Cours Nav1Document21 pagesCours Nav1nessus123Pas encore d'évaluation
- DME PresentationDocument88 pagesDME Presentationchouchou chamaPas encore d'évaluation
- Guide 4 - Vol Ifr Complet A320Document9 pagesGuide 4 - Vol Ifr Complet A320Jules TemimePas encore d'évaluation
- Guide Instructeur VFR NuitDocument76 pagesGuide Instructeur VFR Nuitbla100% (1)
- Le Radar Secondaire Monopulse (MSSR)Document38 pagesLe Radar Secondaire Monopulse (MSSR)Charbel Quenum100% (1)
- Questions GMDSS PDFDocument30 pagesQuestions GMDSS PDFsailor21316100% (1)
- Pilote Automatique - WikipédiaDocument14 pagesPilote Automatique - WikipédiaMonaPas encore d'évaluation
- TransmissionDocument76 pagesTransmissionBRANDON PEWAHOPas encore d'évaluation
- Cours N°6 RèglementationDocument47 pagesCours N°6 RèglementationNaguibPas encore d'évaluation
- Manuel de Formation Pratique PPL Ed1 Juillet 2013Document12 pagesManuel de Formation Pratique PPL Ed1 Juillet 2013tipiak1100% (1)
- FS Academy - IFRDocument47 pagesFS Academy - IFRPhilippe CADRALPas encore d'évaluation
- Radio NavigationDocument216 pagesRadio NavigationCaesar video100% (1)
- Mto Metar PDFDocument13 pagesMto Metar PDFamine mekhezzemPas encore d'évaluation
- Guide Pratique Pilote Bertin PDFDocument15 pagesGuide Pratique Pilote Bertin PDFAnonymous uKHRXkN7Pas encore d'évaluation
- Avionique 125 PDFDocument72 pagesAvionique 125 PDFMehdi SerkestiPas encore d'évaluation
- Fiche 17 Cours Meteo 3 L-Origine Du Vent - Les Vents.Document12 pagesFiche 17 Cours Meteo 3 L-Origine Du Vent - Les Vents.zack3443amcPas encore d'évaluation
- Projet NavDocument11 pagesProjet NavHamza MohamedPas encore d'évaluation
- Cours Radionavigation - Télécom 2021Document82 pagesCours Radionavigation - Télécom 2021Richard Mbusa100% (2)
- Radio NavigationDocument30 pagesRadio NavigationMoussa Tondi IssaPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage EnnaDocument5 pagesRapport de Stage EnnaMo Garidi100% (2)
- CH3-systemes de Radio NavigationDocument52 pagesCH3-systemes de Radio Navigationmayssahadjhassen26Pas encore d'évaluation
- MA 06 2012 Accessibilite-SezDocument110 pagesMA 06 2012 Accessibilite-Seznicolae adrian DincaPas encore d'évaluation
- Valise de Preparation Cable Fibre Optique 687611924Document1 pageValise de Preparation Cable Fibre Optique 687611924lina derbikhPas encore d'évaluation
- Valise de ConnexionDocument1 pageValise de Connexionlina derbikhPas encore d'évaluation
- Logiciel FiberCable 2Document242 pagesLogiciel FiberCable 2lina derbikh100% (1)
- Chapitre 3 GSM VDocument10 pagesChapitre 3 GSM Vlina derbikhPas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Supports de TransmissionDocument9 pagesChapitre 2 Supports de Transmissionlina derbikhPas encore d'évaluation
- RÈGLES DE CONTRÔLE OtdrDocument19 pagesRÈGLES DE CONTRÔLE Otdrlina derbikhPas encore d'évaluation
- 0000 Utilisation OTDRDocument11 pages0000 Utilisation OTDRlina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap7 Ex Cable CoaxialDocument12 pagesChap7 Ex Cable Coaxiallina derbikhPas encore d'évaluation
- TP Traitement D ImageDocument5 pagesTP Traitement D Imagelina derbikh100% (1)
- Radicom Chapitre3Document7 pagesRadicom Chapitre3lina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap1 ExDocument3 pagesChap1 Exlina derbikhPas encore d'évaluation
- TP03Document20 pagesTP03lina derbikhPas encore d'évaluation
- Réseaux Mobiles 5GDocument10 pagesRéseaux Mobiles 5Glina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap4 ExDocument6 pagesChap4 Exlina derbikhPas encore d'évaluation
- Orca Share Media1581531446950Document20 pagesOrca Share Media1581531446950lina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap5 ExDocument10 pagesChap5 Exlina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap7 Ex BifilaireDocument11 pagesChap7 Ex Bifilairelina derbikhPas encore d'évaluation
- Chap12 PB 2 CorrigeDocument10 pagesChap12 PB 2 Corrigelina derbikhPas encore d'évaluation
- TP ProtocoleDocument8 pagesTP Protocolelina derbikh100% (1)
- Chapitre 1Document3 pagesChapitre 1lina derbikhPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 CNADocument34 pagesChapitre 1 CNAlina derbikhPas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document8 pagesChapitre 2lina derbikhPas encore d'évaluation
- TP 1 CnaDocument9 pagesTP 1 Cnalina derbikhPas encore d'évaluation
- TP COM OptiDocument25 pagesTP COM Optilina derbikh100% (3)
- Capteur de SécuritéDocument22 pagesCapteur de SécuritéNouhayla ChakboubPas encore d'évaluation
- Mémoire MasterDocument70 pagesMémoire MasterHakim TayakoutPas encore d'évaluation
- CATLine CAT 6A DR CATLine CAT 7A DR CabDocument1 pageCATLine CAT 6A DR CATLine CAT 7A DR CabGRAYAAPas encore d'évaluation
- Rapport Travaux PratiquesDocument7 pagesRapport Travaux PratiquesOussama SadkiPas encore d'évaluation
- Mélangeurs PDFDocument7 pagesMélangeurs PDFanes bendjemaiPas encore d'évaluation
- Fondamentale Licence EEA Tronc Commun S3: Electricité, Mesures, ElectroniqueDocument1 pageFondamentale Licence EEA Tronc Commun S3: Electricité, Mesures, ElectroniqueKorbi AmiraPas encore d'évaluation
- Monitorat Maintenance BTS HUAWEIDocument67 pagesMonitorat Maintenance BTS HUAWEIpacoman1982100% (1)
- Memoire OMEICHE SELMA PDFDocument67 pagesMemoire OMEICHE SELMA PDFSana ZtPas encore d'évaluation
- NP 2022 CHAP2 P2 EtudiantsDocument16 pagesNP 2022 CHAP2 P2 Etudiantsabdelhak bouslimaniPas encore d'évaluation
- Les DecibelsDocument5 pagesLes DecibelsAnonymous 1XnVQmPas encore d'évaluation
- TD 3 - Electronique Des Systèmes - Filtres ActifsDocument4 pagesTD 3 - Electronique Des Systèmes - Filtres ActifsIhssan KHPas encore d'évaluation
- TD Chap1 TV NumDocument3 pagesTD Chap1 TV NumWalter FopaPas encore d'évaluation
- PLL OscillateursDocument52 pagesPLL OscillateursImane LaasriPas encore d'évaluation
- (PE Cable) EUPEN - H07Z1-R - Cca-S1d2a1 - 450-750V - Ed - 11 - 2020-02-13Document2 pages(PE Cable) EUPEN - H07Z1-R - Cca-S1d2a1 - 450-750V - Ed - 11 - 2020-02-13thaisPas encore d'évaluation
- Mémoire-Liaisons Radio 4G M2-2018Document56 pagesMémoire-Liaisons Radio 4G M2-2018Mohamed CHARIF100% (1)
- Samir ATHMANIDocument96 pagesSamir ATHMANImissaoui nadjlaPas encore d'évaluation
- Multiplex AgeDocument28 pagesMultiplex AgeMD. DPas encore d'évaluation
- NSR 8Document1 pageNSR 8luka_estPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Cours PLLDocument10 pagesChapitre 4 Cours PLLpc hpPas encore d'évaluation
- Bandes Et Canaux Sans FilDocument4 pagesBandes Et Canaux Sans FilVan NtsilouatPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 M1Document9 pagesChapitre 1 M1Ibtissem DERRARPas encore d'évaluation
- TP E6 Cascade-FiltreDocument3 pagesTP E6 Cascade-Filtrebouchra erramliPas encore d'évaluation
- Philips TAM6805Document26 pagesPhilips TAM6805Christian AlbertiniPas encore d'évaluation
- 7800MDocument14 pages7800MYasmine ÂtfPas encore d'évaluation
- Titre Xvi Connaissance Et Entretien Des MatEriels S I CDocument48 pagesTitre Xvi Connaissance Et Entretien Des MatEriels S I CSmauelPas encore d'évaluation
- Devoir de Synthèse N°3 Avec Correction 2013 2014 (Zgued Hichem)Document7 pagesDevoir de Synthèse N°3 Avec Correction 2013 2014 (Zgued Hichem)Dick wydadPas encore d'évaluation
- OS6-Regime Sinusoidal Force CoursDocument18 pagesOS6-Regime Sinusoidal Force CoursabdoulalifinaPas encore d'évaluation
- BGFT DS FR V14Document2 pagesBGFT DS FR V14mohamed anasPas encore d'évaluation
- Catalogue ZR 2008Document36 pagesCatalogue ZR 2008Arsel BIKECKPas encore d'évaluation
- PHYSIQUE L'optique: Chapitre 1 Les Ondes Et La Lumière 1.1 Les OndesDocument8 pagesPHYSIQUE L'optique: Chapitre 1 Les Ondes Et La Lumière 1.1 Les OndesImane BouatlaouiPas encore d'évaluation