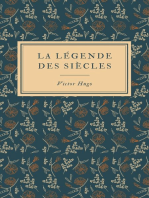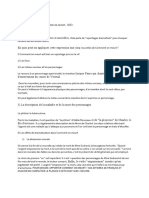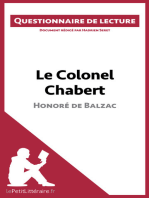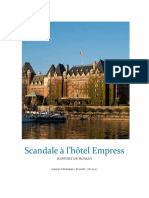Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Germinal
Germinal
Transféré par
barka bouchra0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues10 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
10 vues10 pagesGerminal
Germinal
Transféré par
barka bouchraDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 10
Extrait du Germinal
Germinal, fameuse œuvre écrite par Emile Zola
(1840-1902), a été publié en 1884 et appartient à la
série des « Rougon-Macquart » englobant vingt
romans au total. Les dures conditions de travail
dans les mines de Montsou y sont relatées avec
exactitude formant ainsi un quasi-témoignage de la
vie des mineurs à cette époque. Comme son titre
l’indique, Germinal, en tant que premier mois du
printemps dans le calendrier révolutionnaire, met
en scène l’idée de renouveau. Dans ce contexte-ci, à
savoir la révolte des mineurs, il s’agit d’une
redéfinition des valeurs et du combat pour l’égalité
entre les hommes mené par le protagoniste
Etienne Lantier. Dans notre extrait, situé au
chapitre IV de la première partie du roman, les
conditions de travail effroyables des haveurs et des
herscheurs dans la mine sont décrites en détails
insistant sur l’aspect réaliste de la scène. Les
moyens permettant la mise en scène du supplice
des mineurs sont nombreux mais peuvent être
distingués les uns des autres par rapport à leurs
thèmes. Nous verrons donc, dans notre explication,
d’une part, en quoi la description détaillée de la
mine incarne un véritable enfer et, d’autre part, les
moyens mis en œuvre pour nous permettre de
l’imaginer en tant que telle. Puis, dans un second
temps, nous analyserons plus précisément la
souffrance dans son aspect collectif, soit que tous
mineurs sans exception souffrent le martyr ce qui
créé un regard homogène de leur situation. Enfin,
nous étudierons plus précisément l’émergence du
personnage d’Etienne dans l’extrait en tant
qu’individu à part au regard différent, et, plus
largement, en tant que symbole de l’individualité.
La mine est mise en avant comme lieu cadre du
récit dès le début de notre extrait et en particulier
au paragraphe quatre. Dans les premiers
paragraphes, la mine, et plus précisément, la veine
dans laquelle les mineurs havent est décrite avec
exactitude à plusieurs niveaux. Le premier niveau
concerne le langage. En effet, on constate l’emploi
du réseau lexical de la mine par la présence de
termes spécifiques tels que « haveur » (l.1), « veine
» (l.3), « houille » (l.5) et « rivelaine » (l.6), etc.
Dans un souci de compréhension, le terme «
rivelaine » nous est même défini comme étant « le
pic à manche court » (l.6). Ce vocabulaire
spécifique montre la volonté de Zola de décrire
avec la plus grande précision possible le milieu
dans lequel ses personnages évoluent. Le second
niveau de description concerne la perspective
narrative dans ces premiers paragraphes. La
focalisation zéro est à noter étant donné que le
narrateur en sait plus que ses personnages et est
même capable de restituer les pensées et faits et
gestes de chacun. Le narrateur semble également
être omniscient, hétérodiégétique et
extradiégétique car il ne fait pas partie intégrante
de l’histoire, ne correspond ni à un personnage, ni
à un spectateur de la scène et en sait plus que les
personnages. En exemple, il est important de
souligner des termes annonciateurs et récurrents
de l’extraits qui donnent des indices à la suite des
évènements: la présence de l’humidité en «
ruisseaux et en mares » (l.53) annoncent la future
inondation. Nous notons malgré tout la présence
de nombreux déictiques tels que « là » (l.3), « en
bas » (l.7), « au-dessus » (l.7), « tout en haut »
(l.7), etc. qui contribuent au réalisme et à
l’imagination de la scène décrite. Contribuant au
réalisme, la description détaillée de la veine et des
actions des personnages dans des termes évoquant
la précision est à noter, par exemple au paragraphe
un, aux lignes deux et trois, la précision
géométrique des lieux « quatre mètres environ » et
« cinquante centimètres ». Cette foule de détails
renforce l’impression d’horreur qu’évoque la mine
transcrite au paragraphe quatre. La description de
la mine en termes péjoratifs et associés à la mort
renforce l’idée que quelque chose de grave se
produira dans ces lieux, en association avec la
souffrance et les mauvaises conditions de travail.
La présence d’un lexique se rapportant à la mort et
à l’enfer confirme, en effet, cette idée de mauvais
présage, notons: « mort » (l.21), « ténèbres » (l.21),
« spectrales » (l.26) et « crime » (l.27). Le choix
des mots et des couleurs pour décrire la mine est
également important. La présence du noir de
l’obscurité dans une mesure majoritaire, de la
couleur rouge « rougeâtres » (l.24) ainsi que les
faibles lueurs évanescentes renforce également
l’idée de malaise et de mauvais présage. Notons
que l’association de ces couleurs précises et de
leurs significations sont récurrentes dans la
littérature fantastique et souvent synonyme de
l’introduction d’un élément surnaturel dans le
récit. Il ne va pas sans dire que toutes ces
associations au sein de ce paragraphe contribuent
fortement à rendre la scène singulière. L’étrangeté
de la mine et son aspect effrayant sont accentués
par la faible visibilité et la perception réduite. Ainsi
deux sens apparaissent et amplifient ce sentiment
d’insécurité, le premier étant la vue qui ne permet
de voir que des parties de corps humains et non les
individus dans leur intégralité: « une rondeur de
hanche, un bras noueux, une tête violente » (l.26),
le deuxième sens concerne l’ouïe, de même que
pour la vue, des sons proviennent de part et
d’autres mais ne peuvent être attribués à un
individu en particulier: « le halètement des
poitrines », « le grognement de gêne et de fatigue »
(l.29) et ces sons sont, en plus, transformés par la
mine: « les bruits prenaient une sonorité rauque,
sans un échos dans l’air mort » (l.21). Cette
association de parties de corps humains multiples
avec des sons venant de toute part renforce l’idée
de nombre importante dans l’extrait.
Nous en venons donc à notre seconde partie qui se
basera sur le thème de la souffrance collective.
Comme nous l’avons précédemment évoqué, l’idée
de nombre est renforcée par la multitude sous tous
ces aspects et, naturellement, par l’utilisation
récurrente du pluriel: « les quatre haveurs» (l.l),
«les uns au-dessus des autres» (l.l), «ils» (l.2), etc.
On insiste également sur le groupe plutôt que sur
l’individu du fait que la description concerne dans
un premier temps le plan d’ensemble soit le
positionnement des individus et non leurs
caractéristiques particulières et spécifiques. Ils
connaissent tous le manque de place et le même
travail dans des conditions extrêmes. Ils sont
d’ailleurs représentés par leur fonction au début de
l’extrait, par le titre «haveur» et non par leurs
prénoms relatifs. Ce n’est qu’au deuxième
paragraphe qu’ils possèdent des prénoms sans
pour autant entrer dans les détails. Nous n’avons
aucune information sur leurs caractéristiques
spécifiques hormis le fait qu’à la ligne 49, il nous
est dit que Maheu est le père de Zacharie. Là
encore s’impose la notion de famille par
l’introduction des liens de parenté qui selon la
définition-même évoque l’idée de groupe. Nous
savons, de plus, que dans l’œuvre, la famille Maheu
est importante ce qui explique le fait que le lien de
parenté entre Maheu le père et son fils Zacharie
soit explicité alors qu’aucun autre élément
identitaire n’est indiqué dans l’extrait. Si la
souffrance apparaît comme collective, elle est
néanmoins montrée sous son aspect individuel par
la description au paragraphe trois qui montre
Maheu comme celui qui « souffrait le plus », ce qui
indique que les autres souffrent également.
L’exemple de la souffrance de Maheu ne vise
néanmoins pas à l’humaniser et à marquer son
individualité, étant donné la comparaison à un
puceron à la ligne 19. Il ne s’agit donc que d’un
exemple de la souffrance à son paroxysme visant à
montrer le pire sort parmi le groupe d’individus.
Notons que les quatre haveurs ont tous une
position inconfortable dans la même veine. De
plus, les quatre éléments naturels sont présents
dans cette partie de l’extrait et annoncent la fin
tragique de Maheu (et celles de nombreux autres
haveurs): la chaleur associée au feu et à la mort,
l’humidité annonciatrice de l’inondation, l’air lourd
et pesant associé à la mort (« mortel » l.13) ainsi
que la terre par la présence de la houille et du
schiste. Ces quatre éléments présentent un danger
mortel et causent la souffrance des haveurs par
leur hostilité au sein de la mine. Ces éléments
s’opposant et se différenciant dans la nature ont
cette caractéristique commune qu’est la souffrance.
Cependant, d’autres oppositions sont à observer et
notamment celle entre les hommes résignés qui ne
voient plus que l’argent qui découle du travail
fourni, explicité à la ligne 33 « avares de leur temps
» et la nouvelle génération qui a peur des
conséquences, à la ligne 48 « peur que ça n’éboule
». Dans cette série d’oppositions s’inscrit
également la figure d’Etienne.
Tandis que dans notre deuxième partie, nous avons
accentué notre analyse sur la souffrance collective,
cette troisième partie traitera plus particulièrement
de la naissance de l’individualité dans le récit avec
l’apparition du personnage d’Etienne à la ligne 35.
Nous constatons que les personnages sont
essentiellement présentés selon leur rôle dans la
mine et leurs actions liées au travail, concernant
Etienne il en est autrement. Il est le seul possédant
un surnom « l’aristo » qui est mis en relation avec
un statut social, même s’il ne présente pas la réalité
étant donné qu’Etienne n’est pas un aristocrate
mais nous supposons qu’il est considéré comme tel
par le raffinement de ses manières et son
inexpérience dans les mines. C’est ainsi qu’il se
distingue des autres, il n’est pas né dans la région,
il est étranger aux coutumes et au travail qui est
réalisé ici. Son manque d’expérience est d’ailleurs
souligné dans l’extrait puisqu’il n’est que
«herscheur» (l.70) et est en formation avec
Catherine. Cette opposition entre « haveurs » et «
herscheur » est nettement visible autant dans la
structure du récit que dans la forme de son
énonciation : tout d’abord « haveurs » n’apparaît
qu’au pluriel tandis que «herscheur» lui n’apparaît
qu’au singulier. Leurs tâches ne sont pas les mêmes
mais permettent le bon fonctionnement de la mine
et sont donc complémentaires ce qui met l’accent
sur la valeur du travail en groupe plutôt que sur
l’individu en lui-même. Ainsi, nous en déduisons
que l’individu dans ce contexte ne se définit que
par son travail en groupe et qu’Etienne se
différencie également d’une autre manière que par
son statut de nouveau, d’apprenti en formation.
Cette différence se remarque par son apparition
dans le texte, c’est Zacharie qui s’adresse à lui dans
un discours direct ce qui rend la scène plus vivante
et donc, par extension, le personnage d’Etienne
également. En échos au personnage d’Etienne
apparaît Catherine qui se charge de sa formation. A
la ligne 59, on constate un changement de
perspective, il s’agit d’une focalisation interne qui
permet de transcrire ce que Catherine a
précédemment expliqué à Etienne. A partir de la
ligne 61, la focalisation change à nouveau et nous
permet de voir la scène par les yeux d’Etienne, les
termes « s’habituaient », « n’aurait pu dire son âge
», etc. restituent les pensées intérieures d’Etienne
et nous permettent de visualiser le personnage de
Catherine sous l’angle de perception d’Etienne. Les
marques de jugement insistent sur cette vision de
la jeune femme: « gamine », « la force de cette
enfant », etc. Ce passage en focalisation interne
s’arrête à la ligne 68 et laisse place à la focalisation
zéro. La focalisation change à nouveau à la ligne 72
et restitue cette fois-ci la pensée des haveurs: « il
fallait prendre garde..., on se coulait à plat ventre,
avec la sourde inquiétude d’entendre brusquement
craquer son dos ». Ces changements de focalisation
permettent de restituer l’individualité des
personnages qui ne sont plus seulement définis par
leurs tâches mais également par leurs inquiétudes.
Cette partie de l’extrait permet d’insister davantage
sur les pensées d’Etienne quijuge la scène d’un œil
neuf et s’étonne même de la force de Catherine qui
malgré son apparence est une femme forte. Sa
manière de détailler Catherine traduit une certaine
admiration qui est annonciatrice de la suite des
évènements (de sa future relation avec cette
dernière) bien qu’elle soit également vue comme «
une de ces bêtes naines qui travaillaient dans les
cirques » qui vise bel et bien à la déshumaniser.
Etienne est donc le seul à apparaître comme un
individu à part entier capable de penser, de juger
son environnement avec un regard neuf.
Ainsi, cet extrait met en scène la souffrance et les
conditions de travail déplorables des mineurs en
insistant sur l’aspect diabolique de la mine. La
description détaillée de la mine, le manque d’air, sa
chaleur, son humidité et le danger qu’elle évoque
font place à l’inquiétude aussi bien chez certains
haveurs que chez le lecteur qui se sent pris par
l’atmosphère obscure et la mise en scène des lieux.
La présence de focalisations zéro et interne dans le
récit favorise la mise en image et en condition.
Nous constatons ainsi au sein d’un groupe
l’émergence d’un individu particulier, Etienne, qui
annonce le changement aussi bien par ses
différences en comparaison avec les autres que par
son propre point de vue.
Vous aimerez peut-être aussi
- Phrase ÉtendueDocument19 pagesPhrase Étenduebarka bouchra100% (1)
- Yasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Document3 pagesYasmina Reza - Le Dieu Du Carnage - Extrait N°3Kévin Dumanoir100% (1)
- Joachim Du BellayDocument7 pagesJoachim Du Bellayapi-243769110Pas encore d'évaluation
- Le Romancier Et Son Personnage - DossierDocument10 pagesLe Romancier Et Son Personnage - DossierpattybellaPas encore d'évaluation
- Dyingearthquickrules VFDocument32 pagesDyingearthquickrules VFangedesjolisbasPas encore d'évaluation
- Commentaire Composé Sur GerminalDocument2 pagesCommentaire Composé Sur GerminalFaten Rezaigui50% (2)
- Texte - DissertationDocument7 pagesTexte - DissertationLzarolhfPas encore d'évaluation
- Initiation A La TraductionDocument19 pagesInitiation A La Traductionbarka bouchra100% (1)
- L'homme Qui Aimait Les FemmesDocument24 pagesL'homme Qui Aimait Les FemmesSubroto Khan100% (1)
- Dissertation - Juste La Fin Du MondeDocument3 pagesDissertation - Juste La Fin Du Mondetheoroland20070% (1)
- Differentes SubordonneesDocument5 pagesDifferentes SubordonneesKhalidBouhloubaPas encore d'évaluation
- Commentaire Meurtre de CamilleDocument5 pagesCommentaire Meurtre de CamilleabbaraPas encore d'évaluation
- Fiche A QUI DONC SOMMES NOUSDocument6 pagesFiche A QUI DONC SOMMES NOUSAmina Belarouci100% (1)
- Sémantique - Présentation Mme Kaaouas 9, 10Document40 pagesSémantique - Présentation Mme Kaaouas 9, 10barka bouchra100% (1)
- L'Image de La Femme Dans Le Roman D'afrique Francophone À Travers Le Thème de La Polygamie (Littérature Africaine D'expression Française)Document275 pagesL'Image de La Femme Dans Le Roman D'afrique Francophone À Travers Le Thème de La Polygamie (Littérature Africaine D'expression Française)Farouk Haraz33% (3)
- Jacques PrevertDocument3 pagesJacques PrevertElena ContrasPas encore d'évaluation
- WFB8 - Le Coatl - Armé Hommes Lézard (FanMade by Vlast de Naggarond)Document1 pageWFB8 - Le Coatl - Armé Hommes Lézard (FanMade by Vlast de Naggarond)Vlast de NaggarondPas encore d'évaluation
- 1912 DR Marc Haven-Le Maitre Inconnu CagliostroDocument353 pages1912 DR Marc Haven-Le Maitre Inconnu Cagliostrowebinato100% (3)
- Mort Mourant LAFDocument9 pagesMort Mourant LAFHoucine OsltPas encore d'évaluation
- EL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes AffairésDocument3 pagesEL 3 Il Fait Un Temps d' Insectes Affairésanabelle.allard43100% (1)
- La Crise A D J Eu LieuDocument3 pagesLa Crise A D J Eu LieupalomabaronPas encore d'évaluation
- Dissertation Sur Juste La Fin Du MondeDocument4 pagesDissertation Sur Juste La Fin Du Mondebensaidyassine94Pas encore d'évaluation
- "MORS" in Les Contemplations, Livre IV, 16, Victor HugoDocument5 pages"MORS" in Les Contemplations, Livre IV, 16, Victor HugoMaxim JaumePas encore d'évaluation
- Cath Leroux1Document11 pagesCath Leroux1Cherif Cheikh Sidya AidaraPas encore d'évaluation
- La Mort Et Le BûcheronDocument4 pagesLa Mort Et Le Bûcheronmargaux.morel07Pas encore d'évaluation
- Fiche LES FEUILLETS D HYPNOSDocument10 pagesFiche LES FEUILLETS D HYPNOSAsmaa AssoumaPas encore d'évaluation
- Baudelaire Paola LongoDocument3 pagesBaudelaire Paola LongopepessitoPas encore d'évaluation
- Commentaire IncipitDocument5 pagesCommentaire IncipitRém'Alex BalsamoPas encore d'évaluation
- Explication Linéaire Mors-1Document4 pagesExplication Linéaire Mors-1Clo05Pas encore d'évaluation
- Sujet N°1Document3 pagesSujet N°1aylinkd1610Pas encore d'évaluation
- Femmes Tissage MythologieDocument19 pagesFemmes Tissage MythologieLuisina BarriosPas encore d'évaluation
- Analyse LeRougeetleNoirDocument5 pagesAnalyse LeRougeetleNoirSisso CheriefPas encore d'évaluation
- Dissertation - Juste La Fin Du Monde2Document3 pagesDissertation - Juste La Fin Du Monde2theoroland2007Pas encore d'évaluation
- Texte N°9 - PrologueDocument3 pagesTexte N°9 - Prologuenatacha.levetPas encore d'évaluation
- FOUQUES Bernard, Carlos Fuentes Ou La Traversée de L'écritureDocument11 pagesFOUQUES Bernard, Carlos Fuentes Ou La Traversée de L'écritureMartonaPas encore d'évaluation
- 2022 Metropole Techno CorrigeDocument6 pages2022 Metropole Techno CorrigeA.- A.YPas encore d'évaluation
- FC Analyse Lagarce Juste 200221v2Document10 pagesFC Analyse Lagarce Juste 200221v2ouiza.sabrina01Pas encore d'évaluation
- L.L 10Document3 pagesL.L 10Issam AlounePas encore d'évaluation
- Explication Linéaire Baudelaire, Spleen 78Document4 pagesExplication Linéaire Baudelaire, Spleen 78ChachaPas encore d'évaluation
- MorsDocument3 pagesMorsMathisPas encore d'évaluation
- Victor Hugo Est Un EcrivainDocument3 pagesVictor Hugo Est Un Ecrivainacer pcPas encore d'évaluation
- Apparitions, Dans La "Vita Nuova"Document23 pagesApparitions, Dans La "Vita Nuova"Nicolás Bernal LeongómezPas encore d'évaluation
- Inbound 6486003532726826485Document3 pagesInbound 6486003532726826485Mohamed NejibPas encore d'évaluation
- Ob - Beb369 - Version Magistrale ll1 Juste La Fin DuDocument4 pagesOb - Beb369 - Version Magistrale ll1 Juste La Fin DuKenzo YeghiazarianPas encore d'évaluation
- Correction LangueDocument15 pagesCorrection Languemacairensangou2Pas encore d'évaluation
- FRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietDocument11 pagesFRA Supp - Cours Lambeaux, Charles JulietjoshPas encore d'évaluation
- BAC Dormeur Du ValDocument4 pagesBAC Dormeur Du Valceleste.buatoisPas encore d'évaluation
- Pénélope Laurent - Glosa Ou L'art de L'imposture PDFDocument7 pagesPénélope Laurent - Glosa Ou L'art de L'imposture PDFJuan José GuerraPas encore d'évaluation
- LL Définitive Rimbaud OphélieDocument3 pagesLL Définitive Rimbaud OphélieziedcheikrouhouPas encore d'évaluation
- El 7balzacDocument4 pagesEl 7balzacA A APas encore d'évaluation
- 10Document2 pages10sc8x6bxdhpPas encore d'évaluation
- Claude Seassau Le RealismeDocument3 pagesClaude Seassau Le RealismeCatalina Georgiana MaximPas encore d'évaluation
- Étude Linéaire Prologue Juste La Fin Du MondeDocument5 pagesÉtude Linéaire Prologue Juste La Fin Du Mondevimond.devaPas encore d'évaluation
- Texte 3Document8 pagesTexte 3augustedantin75Pas encore d'évaluation
- Prologue JFMDocument4 pagesPrologue JFMkrrm270Pas encore d'évaluation
- Cours FR 12 05 21Document2 pagesCours FR 12 05 21adam naouiPas encore d'évaluation
- Texte1 - Les Grenouilles Qui Demandent Un RoiDocument3 pagesTexte1 - Les Grenouilles Qui Demandent Un Roiccarote0% (1)
- s04 Lejeune Pacte Autobiographique Pacte 1 PDFDocument19 pagess04 Lejeune Pacte Autobiographique Pacte 1 PDFClaudia GordilloPas encore d'évaluation
- Horace (Corneille Pierre) (Z-Library)Document210 pagesHorace (Corneille Pierre) (Z-Library)Ziz PhilztryPas encore d'évaluation
- Jean Luc Lagarce Oral Texte 1 Prologue + CorrigéDocument4 pagesJean Luc Lagarce Oral Texte 1 Prologue + Corrigétemuulen.batdjargalPas encore d'évaluation
- 3 LL FDM La Cloche FêléeDocument4 pages3 LL FDM La Cloche FêléeNokqtoPas encore d'évaluation
- Litts 0563-9751 2009 Num 61 1 2102Document17 pagesLitts 0563-9751 2009 Num 61 1 2102Kellia Le BrasPas encore d'évaluation
- Explication Texte 3 Juste La Fin Du Monde - Copie - CopieDocument2 pagesExplication Texte 3 Juste La Fin Du Monde - Copie - CopiewbthbacPas encore d'évaluation
- Le Dormeur Du ValDocument5 pagesLe Dormeur Du Valaairouche11Pas encore d'évaluation
- Texte 4Document2 pagesTexte 4Jade SalendresPas encore d'évaluation
- Lectures Analytiques Bel AmiDocument10 pagesLectures Analytiques Bel Amileilasakhri9Pas encore d'évaluation
- 4LA32TEWB6123C01 CorrigeCoursLatin-U01Document10 pages4LA32TEWB6123C01 CorrigeCoursLatin-U01Lisa JewellPas encore d'évaluation
- Le Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo: Questionnaire de lectureD'EverandLe Dernier Jour d'un condamné de Victor Hugo: Questionnaire de lecturePas encore d'évaluation
- Fonctionnement Du LevierDocument20 pagesFonctionnement Du Levierbarka bouchraPas encore d'évaluation
- Sémantique - Présentation Mme Kaaouas 11, 12Document55 pagesSémantique - Présentation Mme Kaaouas 11, 12barka bouchraPas encore d'évaluation
- Fiche 29 Connaitre Les Multiples Et Les Diviseurs de Certains Nombres CorrectionDocument2 pagesFiche 29 Connaitre Les Multiples Et Les Diviseurs de Certains Nombres Correctionbarka bouchraPas encore d'évaluation
- Madame Bovary, Flaubert (Étude 2nde)Document2 pagesMadame Bovary, Flaubert (Étude 2nde)L0ck0utPas encore d'évaluation
- Titan Primordiaux Cuirasse - Recherche GoogleDocument1 pageTitan Primordiaux Cuirasse - Recherche GoogleGabriel DuflotPas encore d'évaluation
- MLTF40F - Anouilh - M. Di M-ODocument14 pagesMLTF40F - Anouilh - M. Di M-OPapa SarrPas encore d'évaluation
- 8 Textes BacDocument9 pages8 Textes BaclowlawdidiopPas encore d'évaluation
- Résumé Une Vie.Document11 pagesRésumé Une Vie.bramito100% (1)
- 1 Asimov, Wikipedia (Pour Comp Rend Re Les Cycles)Document13 pages1 Asimov, Wikipedia (Pour Comp Rend Re Les Cycles)SM977Pas encore d'évaluation
- Gouverneurs de La Rosée ch11 - 12Document2 pagesGouverneurs de La Rosée ch11 - 12AuroraPas encore d'évaluation
- 08 FR - Sc.tech - Lettre RsDocument2 pages08 FR - Sc.tech - Lettre Rsعبدالعلي أيت بريكPas encore d'évaluation
- Mémoires D'hadrien de Yourcenar - Analyse Du RomanDocument7 pagesMémoires D'hadrien de Yourcenar - Analyse Du RomanghadaPas encore d'évaluation
- TextesDocument1 pageTextesfiscaPas encore d'évaluation
- These Mamadou KOUYATEDocument498 pagesThese Mamadou KOUYATEPaulo MotaPas encore d'évaluation
- (FR) Séance 2Document4 pages(FR) Séance 2NecrOasixPas encore d'évaluation
- Rapport Du RomanDocument3 pagesRapport Du Romanmoerlaur110Pas encore d'évaluation
- Les Djinns ComentaireDocument2 pagesLes Djinns ComentaireMoraruElenaPas encore d'évaluation
- Programme de Retraite CiviqueDocument2 pagesProgramme de Retraite CiviqueScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Chapitre 16Document8 pagesChapitre 16Jonathan FhimaPas encore d'évaluation
- Corrigé Des Exercices de RattrapageDocument2 pagesCorrigé Des Exercices de Rattrapagerhalaster4420Pas encore d'évaluation
- La II - Le Petit Malade de CourtelineDocument1 pageLa II - Le Petit Malade de CourtelineMONTEIROPas encore d'évaluation
- Captain America Civil War TelechargerDocument2 pagesCaptain America Civil War Telechargercamillecollier99Pas encore d'évaluation
- Questionnaire Un Rival Pour Sherlock HolmesDocument27 pagesQuestionnaire Un Rival Pour Sherlock HolmesvicenteleslyPas encore d'évaluation
- Affiches Regles de Classe-2Document86 pagesAffiches Regles de Classe-2MarilouGagnéPaquettePas encore d'évaluation
- Procedures Pour Faire Des Passages AlcesteDocument7 pagesProcedures Pour Faire Des Passages AlcestetintinPas encore d'évaluation