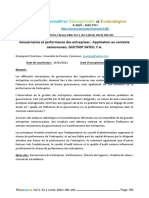Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Rimhe 027 0090
Rimhe 027 0090
Transféré par
Fabrice GUETSOPTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Rimhe 027 0090
Rimhe 027 0090
Transféré par
Fabrice GUETSOPDroits d'auteur :
Formats disponibles
Auteur invité
LA DIVULGATION VOLONTAIRE EN MATIÈRE DE PERFORMANCE
ORGANISATIONNELLE : MESURE, SUPPORTS ET MOTIVATIONS
Félix Zogning
ARIMHE | « RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise »
2017/3 n° 27, vol. 6 | pages 90 à 102
ISSN 2259-2490
DOI 10.3917/rimhe.027.0090
Article disponible en ligne à l'adresse :
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
https://www.cairn.info/revue-rimhe-2017-3-page-90.htm
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribution électronique Cairn.info pour ARIMHE.
© ARIMHE. Tous droits réservés pour tous pays.
La reproduction ou représentation de cet article, notamment par photocopie, n'est autorisée que dans les
limites des conditions générales d'utilisation du site ou, le cas échéant, des conditions générales de la
licence souscrite par votre établissement. Toute autre reproduction ou représentation, en tout ou partie,
sous quelque forme et de quelque manière que ce soit, est interdite sauf accord préalable et écrit de
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
l'éditeur, en dehors des cas prévus par la législation en vigueur en France. Il est précisé que son stockage
dans une base de données est également interdit.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Auteur invité
La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations
Félix ZOGNING31
La divulgation volontaire consiste essentiellement en la communication libre
d’informations autres que celles légalement ou statutairement exigées, et en général en
marge des états financiers. Cette divulgation volontaire peut d’une part détailler et
approfondir la divulgation obligatoire, pour améliorer son exhaustivité et accroitre sa
crédibilité. Dans ce sens, Healy et Palepu (1993) avancent que la divulgation
volontaire des entreprises contribue largement à convaincre les analystes financiers
quant à la fiabilité de l’information obligatoire et formelle auxquelles celles-ci sont
soumises. D'autre part, la divulgation volontaire peut compléter et élargir la
divulgation obligatoire, dans le dessein d’aboutir à une divulgation d’informations plus
complète, diversifiée et systématique. C’est dans cette optique qu’elle est capitale pour
communiquer efficacement avec les parties prenantes et leur décrire plus clairement
les perspectives de l’entreprise. Comme le précisent Grüning et Stockmann (2004), en
plus de l’information financière obligatoire qui est minimalement requise pour tous,
les marchés financiers, en vue de la prise de décisions d'investissement, exigent de
plus en plus d’informations complémentaires. Ceci montre en outre comme nous
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
l’avons souligné dans de précédents travaux (Zogning, 2015) que la divulgation
volontaire, dans ce second cas de figure, pourrait en général porter sur des
informations non financières.
1. Théories de la divulgation
La divulgation, et précisément la divulgation volontaire constitue l’un des plus
importants thèmes de recherche en comptabilité financière. Un large éventail d’études
a été consacré à cette question, dans plusieurs pays, plusieurs secteurs d’activités,
plusieurs contextes ; avec un regard sur les supports et les canaux de divulgation, la
qualité et la quantité des informations divulguées, les incitatifs et avantages inhérents à
cette pratique, les coûts et inconvénients qui y sont associés, les publics ciblés, et bien
sûr sa capacité à satisfaire les besoins informationnels des diverses parties prenantes,
entre autres. Selon les contextes, différentes théories ont été mises en avant pour
expliquer le choix de certaines entreprises à divulguer volontairement à un moment ou
31
Professeur, Département des Sciences comptables, Université du Québec en Outaouais -
Felix.zogning@uqo.ca
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 90 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
un autre. Initialement, la théorie de l’agence présente la divulgation volontaire comme
étant un moyen de compléter la reddition des comptes qui est requise dans la relation
d’agence, et permettrait par ailleurs de réduire les coûts d’agence. Avec l’avènement et
le développement du concept de responsabilité sociale de l’entreprise, la théorie des
stockholders (parties prenantes) explique que l’entreprise (ou le dirigeant) ne rend pas
compte uniquement aux propriétaires, mais aussi à tous les partenaires d’affaires et les
institutions légales (Etat, fournisseurs, clients, employés etc.). La divulgation
volontaire serait donc dans ce cas, un moyen de renseigner toutes ces parties
intéressées, dont les préoccupations ne sont pas toujours intégrées aux exigences
légales de reporting. Plus proches de ce raisonnement, la théorie institutionnelle
(Shocker et Sethi, 1973) et la théorie de la légitimité éclairent elles aussi sur les
incitatifs à la divulgation volontaire. Communiquer volontairement à ces parties
prenantes aurait pour but de se présenter comme étant conforme au consensus social,
et préserver une légitimité qui est essentielle à la survie de l’entreprise. Dans un
contexte de marché, la théorie des signaux explique également le but et l’impact d’une
politique de communication délibérée. Pour Vernimmen, Quiry et le Fur (2012, p.
669), elle postule que « l’information est inégalement partagée ou asymétrique, les
dirigeants d'une entreprise disposant notamment d'une information supérieure à celle
de ses pourvoyeurs de fonds. Dès lors, une politique de communication efficace est
nécessaire : les dirigeants doivent non seulement prendre des décisions justes, mais
aussi en convaincre le marché. Pour ce faire, ils ont recours au signal ». Le signal dans
ces travaux est alors présenté comme un indicateur perceptible des qualités
intrinsèques difficilement observables. L’hypothèse de l’efficience des marchés est
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
naturellement l’objet en toile de fond de ce raisonnement. De tout ce qui précède, il est
quasiment évident de noter que la réduction de l’asymétrie de l’information reste le
principal but de la divulgation volontaire, comme l’énoncent Lang et Lundholm
(2000). Depuis quelques années, un essai de théorisation formelle de la divulgation
volontaire se dessine au fil des études, avec les intérêts économiques des entreprises
comme but ultime.
Loin d’être aléatoire, la divulgation volontaire de l’information corporative est en
général le fruit d’un exercice plutôt mesuré et soigneusement pensé, comme le
soulignent grand nombre de travaux. Grossman (1981) et Milgrom (1981) ont amorcé
le cadre théorique initial pour expliquer les divulgations volontaires, fondé sur le fait
que l’incitatif principal pour une entreprise à divulguer de façon volontaire est relié à
un éventuel avantage compétitif. Pour ces auteurs, il ne peut y avoir aucune situation
de neutralité en termes d’avantages où aucun dirigeant n’aurait intérêt à divulguer au-
delà de ce qui est exigé, car il existera toujours au moins une entreprise au-dessus de la
moyenne, qui ne pourra s’empêcher de le faire savoir, et qui communiquera au sujet de
son avantage comparatif ou de sa performance exceptionnelle, pour être mieux
valorisée. Verrecchia (1983) et Dye (1985) poursuivent dans la même voie, tout en
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 91 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
relevant, pour peaufiner le modèle, que certaines contraintes pourraient dissuader
l’entreprise de divulguer, y compris dans les cas où cela lui serait salutaire de prime
abord. Il s’agit en l’occurrence des coûts associés à l’information, entre autres. Dans la
même veine, toute information négative pour l’entreprise ou son image, même si elle
semble déterminante pour l’investisseur, pourrait être retenue par le dirigeant.
Quelques recherches parmi lesquelles Botosan (1997), Choi (1999), Healy et Palepu
(1993, 2001) ou encore Scott (1994) ont balisé le chemin pour la recherche en matière
de divulgation dans les 15 dernières années. Choi (1999) indique qu’en général, les
dirigeants pensent que le coût de la divulgation volontaire est plus élevé que son
rendement. Il faut donc un important motif économique comme une forte demande de
capitaux, pour amener ces dirigeants conservateurs à changer de comportement en ce
qui concerne la divulgation. Botosan (1997) trouve que cette divulgation réduit le coût
du capital, et Sengupta (1998) démontre qu’une politique de divulgation volontaire
exhaustive et en instantanée contribue à une baisse du coût de la dette de l'entreprise.
La crédibilité de cette divulgation est étroitement liée au niveau professionnel des
organismes intermédiaires, précisent Healy et Palepu (1993). Pour un échantillon de
97 entreprises, Healy, Hutton et Palepu (1999) montrent que pour une divulgation
accrue, les cours des actions de ces compagnies augmentent de 7% en moyenne la
première année, avant d’atteindre un taux de croissance moyen entre 12 et 24 % au
cours des trois années subséquentes. En plus d’une liquidité plus élevée et d’une
incertitude plus faible à l’égard de leurs titres, ces compagnies sélectionnées sont pour
la plupart très appréciés des analystes financiers.
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
2. La divulgation volontaire en contexte de marches de capitaux
La plupart des recherches en matière de divulgation volontaire ont été menées dans le
cadre des marchés des capitaux. Il existe dans ce cadre une asymétrie d'information
entre demandeurs (entreprises) et offreurs de capitaux (investisseurs, créanciers) qui
peut provoquer un déséquilibre du système. La divulgation volontaire intervient alors,
selon Healy et Palepu (2001) pour faciliter la communication entre les gestionnaires,
créanciers et autres investisseurs, et atténuer ce problème qui se veut majeur, du
moment où le défi essentiel pour toute économie est la répartition optimale de
l'épargne aux opportunités d'investissement.
Scott (1994) a simultanément utilisé la théorie des coûts exclusifs (Verrecchia, 1983),
la théorie des coûts d’acquisition de l’information (Diamond, 1985) et la théorie de
l’agence pour expliquer le niveau de divulgation volontaire des firmes sur les pensions
de retraites. Le contexte canadien a semblé être approprié notamment en raison du fait
qu’en la matière, il y a au Canada beaucoup moins de divulgations obligatoires qu’aux
Etats-Unis par exemple. Si l’auteur ne trouve pas de lien significatif entre le niveau de
divulgation et les coûts d’acquisition, il constate cependant qu’en présence de coûts
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 92 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
exclusifs, les entreprises divulguent moins d’informations au sujet des coûts et intérêts
des fonds de pension, et moins de détails relatifs à ces régimes.
Baginski, Hassel et Kimbrough (2002) présentent la responsabilité juridique comme
étant une explication partielle de la réticence des gestionnaires à divulguer
volontairement des prévisions de bénéfices. Ils notent par contre une plus grande
fréquence dans ces divulgations en période de difficultés ou de mauvaises nouvelles.
Dans une comparaison entre le Canada et les Etats-Unis, ils affirment que les lois
canadiennes sur les valeurs mobilières étant plus souples et moins litigieuses qu’aux
Etats-Unis, on peut noter une plus grande fréquence dans la diffusion des prévisions de
résultats au Canada par rapport aux Etats-Unis, des prévisions à plus long terme et en
général plus précises aussi. Ces auteurs montrent ainsi, comme Scott (1994), que le
facteur légal et institutionnel affecte grandement la propension des entreprises à
divulguer délibérément certaines informations.
Bushee et Noe (2000) s’interrogent sur les effets des pratiques de divulgation des
entreprises sur le niveau de participation des investisseurs institutionnels et sur la
volatilité du rendement de leurs actions. En s’appuyant sur l’indice de divulgation de
l’AIMR (Association for Investment Management and Research) pour un échantillon
de 4 314 entreprises-années, et sur des supports tels que le rapport annuel, les rapports
intermédiaires et les notes d’activités avec les investisseurs, les auteurs procèdent par
régression à un rapprochement entre la participation institutionnelle (types
d’investisseurs institutionnels) et la divulgation organisationnelle. Ils arrivent à la
conclusion que, si l’amélioration des pratiques de divulgation entraîne des coûts
indirects en attirant des investisseurs institutionnels dont la stratégie axée sur le court
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
terme favorise la volatilité du rendement des actions, elle entraîne néanmoins la
participation plus importante des acteurs dont la stratégie est axée sur le moyen et le
long terme. L’effet combiné de l’attraction de ces deux types d’investisseurs sur le
rendement des actions serait nul. Ce qui devrait alors inciter les dirigeants à s’assurer
que les bénéfices attendus de l’amélioration des pratiques de divulgation puissent
couvrir les coûts y afférents.
Wang et ses coauteurs (2004) examinent de façon empirique les déterminants de la
divulgation volontaire dans les rapports annuels des sociétés chinoises cotées à la fois
sur le plan national et étranger, afin de déterminer si le coût du capital et de la dette est
lié à l'étendue de cette divulgation. S’ils trouvent que le niveau de divulgation
volontaire est positivement corrélé à la proportion de la propriété publique, de la
propriété étrangère, de la performance des entreprises (mesurée par la rentabilité des
capitaux propres, RCP) et de la réputation de la firme de vérification, ils n’en
ressortent avec aucune évidence solide de la réduction du coût du capital et de la dette.
Kothari, Li et Short (2009) procèdent à une analyse de contenu d’environ 100 000
supports de divulgation issus des directions d’entreprises, analystes financiers et
médias, (notamment la presse économique), parvenant ainsi à recouper des
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 93 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
informations pour 889 compagnies. Leurs constats révèlent que lorsque l'analyse de
contenu indique des divulgations favorables, le risque de l'entreprise, représenté par le
coût du capital, la volatilité des rendements boursiers, et la dispersion prévisions des
analystes, diminue de façon importante. Par contre, les divulgations défavorables sont
accompagnées d'augmentations importantes dans ces différentes mesures du risque
d'entreprise. Une analyse par sources d’informations montre que des divulgations
défavorables de la presse économique affectent plus rapidement et négativement le
coût du capital et la volatilité des rendements.
3. Divulgation sur le Web
L’avènement de l’internet a offert aux entreprises un support de communication
supplémentaire d’une immense portée, d’une flexibilité et d’une rapidité sans
précédent. Quasiment toutes les entreprises cotées sur les principales places boursières
du monde sont aujourd’hui dotées d’un site web. Le web procure aux dirigeants
d’entreprise une marge de manœuvre beaucoup plus grande, étant donné qu’il n’existe
en général aucune réglementation formelle des divulgations véhiculées par ce média
qui existe depuis maintenant une vingtaine d’années. Les entreprises ont donc la
possibilité d’y reproduire leurs états financiers et d’autres types de divulgations à
caractère obligatoire en vue d’en étendre la portée et toucher un maximum de cibles,
ou d’y véhiculer de façon volontaire d’autres types d’informations non légalement
exigées, mais qui pourraient intéresser plusieurs de ses partenaires réels ou potentiels.
Dans les deux cas, les dirigeants y voient au moins un double intérêt : ils ont le choix
de la nature des informations qu’ils y divulguent et sous la forme qui leur convient, et
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
ils bénéficient d’un plus grand écho, les sites web étant naturellement consultables à
tout point du monde. Par ailleurs, la diffusion est plus rapide et la mise à jour des
informations beaucoup moins contraignante. Ce qui fait du web le média idéal pour
véhiculer en temps réel des informations qui procurent un avantage concurrentiel à
l’organisation.
Des études de la divulgation sur le web se sont multipliées ces dernières années, et
montrent en général que le web est une importante source d’informations pour divers
intervenants des marchés de capitaux ou des biens et services.
Aerts, Cormier et Magnan (2007) évaluent et comparent comment les entreprises nord-
américaines et d’Europe continentale choisissent la qualité de leurs divulgations de
performance véhiculées par le web, et comment ces divulgations affectent le
comportement des analystes financiers. Le régime de gouvernance (Shareholders en
Amérique du Nord et Stakelholders en Europe continentale) y joue un rôle de facteur
de contingence. Ces auteurs avancent que les analystes étant considérés comme des
utilisateurs sophistiqués de l’information corporative, leurs attentes sont directement
observables, contrairement aux attentes du marché. Le degré de dispersion des
prévisions des analystes est alors perçu comme un indicateur de la qualité de
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 94 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
l'information sur la valeur d’entreprise. Ainsi, la qualité des divulgations par
l’entreprise est de nature à inciter les analystes à fournir plus d'efforts, qui se traduiront
par des analyses de meilleure qualité. Leur étude empirique fournit un examen intégré
de la stratégie globale de « cyber-divulgation » adoptée par les firmes nord-
américaines et européennes exerçant dans divers secteurs d’activité. Les éléments de
divulgations ont été relevés sur les sites web des firmes et codifiées sur l’année 2002
(Format web ou HTML). Les données financières sont prélevées sur Worldscope et les
sites web des entreprises. Les estimations de prévisions de bénéfices et le suivi des
analystes proviennent de la base de données IBES (Institutional Brokers Estimate
System).
En assumant que la stratégie globale touche simultanément la divulgation sur la
performance, le suivi des analystes et les propriétés de leurs prévisions financières, un
test est réalisé d’abord sur l’ensemble de l’échantillon et ensuite sur chacun des deux
groupes séparément, avec le modèle de triples moindres carrées (3SLS ou modèle
d’équations simultanées), pour contrôler la présence d’endogénéité entre ces trois
variables. Les résultats indiquent que la « cyber-divulgation » portant sur la
performance est associée à la réduction de la dispersion des prévisions des analystes en
Amérique du Nord. Cette divulgation se révèle moins pertinente pour expliquer la
dispersion des prévisions en Amérique du Nord lorsque les firmes sont suivies par de
nombreux analystes, et a moins d’effets sur la dispersion des analystes en Europe
continentale qu’en Amérique du Nord ; de même que le suivi des analystes a peu
d’effet sur elle. Les auteurs découvrent en outre que la « cyber-divulgation » est un
facteur déterminant du suivi des analystes en Amérique du Nord, mais pas en Europe ;
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
et que pour tous ces analystes, l’information quantitative semble être plus intéressante
que l’information descriptive ou qualitative.
Cette étude confirme l’usage du Web comme outil de communication stratégique, avec
une utilisation croissante par les entreprises pour diffuser une variété d’informations
financières et non financières. Elle tranche avec le caractère descriptif de la plupart des
recherches publiées antérieurement à ce sujet.
4. La divulgation environnementale
Si Friedman (1970) qualifiait la responsabilité sociale de l’entreprise de « doctrine
fondamentalement subversive » avant d’avancer que la seule responsabilité de
l’entreprise est de faire des profits, il faut tout de même reconnaitre que le concept a
considérablement évolué depuis lors, ajoutant à la responsabilité économique de
l’entreprise, une responsabilité juridique, une responsabilité éthique et une
responsabilité discrétionnaire (Caroll, 1979). Avec la révolution numérique, la
révolution écologique est l’une des plus fulgurantes des vingt-cinq dernières années.
Le public est de plus en plus intéressé par les problèmes environnementaux et la
question du développement durable. Aussi, il veille à ce que les activités des
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 95 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
entreprises ne se fassent pas au détriment de l’environnement. Compte tenu de l’intérêt
marqué pour cette question et qui va grandissant, les entreprises sont donc tenues, à
défaut de réaliser d’excellentes performances environnementales, de divulguer
efficacement sur cette question, afin que leurs activités paraissent comme convenables,
dans la logique de la théorie institutionnelle, telle qu’illustrée par Shocker et Sethi
(1973).
Au nombre des études qui traitent de la divulgation environnementale, figure celle de
Neu, Warsame et Pedwell (1998) qui démontre comment la publication d’informations
sur la responsabilité sociale et environnementale des entreprises peut être indiquée
pour résoudre des problèmes de légitimité, en fournissant aux dirigeants la possibilité
de gérer ou conditionner l’opinion. L’étude est menée sur la base des rapports annuels
(publiés entre 1982 et 1991) par 33 entreprises cotées au Canada, et qui évoluent dans
des secteurs ayant des impacts sensibles sur l’environnement. Elle vise à mettre en
évidence le lien entre la teneur des informations à caractère environnemental publiées
dans les rapports annuels et les diverses pressions exercées par les différents publics.
Ceci dans le but évident de démontrer qu’il existe une stratégie de conditionnement de
l’opinion publique à travers la publication délibérée d’informations
environnementales. Déterminés à partir d’une régression multiple, les résultats
montrent que la quantité d’informations à tonalité environnementale publiées par ces
firmes est plus élevée en période de déficit, et que les préoccupations des créanciers
n’influencent pas beaucoup le niveau de publication, confirmant ainsi l’hypothèse qui
veut que les intérêts des actionnaires déterminent fondamentalement le degré de
publication.
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
Par ailleurs, la couverture médiatique accordée aux infractions environnementales tend
à accroître le niveau de publication d’informations environnementales, tandis que la
couverture médiatique, accordée aux critiques écologistes, semble produire l’effet
inverse. Une confirmation de l’hypothèse selon laquelle les dirigeants répondent
davantage aux attentes et intérêts des parties prenantes les plus importantes
(notamment les actionnaires et l’Etat dans ce cas de figure). Les auteurs avancent aussi
en conclusion, mais sans le vérifier empiriquement, que l’information
environnementale est complétée par l’information sociale. L’étude de Neu et de ses
coauteurs (1998) a le mérite d’être l’une des premières à explorer comment les parties
non vérifiées des rapports annuels pouvaient servir à communiquer des données
sociales et environnementales dans le but d’acquérir, maintenir ou restaurer la
légitimité d’une firme.
Ses lacunes empiriques amèneront d’autres auteurs à investiguer dans ce sens, avec
des modèles plus raffinés et plus robustes. Clarkson et ses coauteurs (2008) ou Aerts et
Cormier (2009) en font partie. Les premiers concluent à une relation positive entre le
niveau de performance environnementale et le niveau de divulgation discrétionnaire, et
trouvent que la divulgation environnementale est davantage déterminée par des raisons
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 96 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
économiques que par des raisons sociopolitiques. Les seconds observent que la
légitimité est positivement affectée par la mesure et la qualité des fondements
économiques des divulgations environnementales contenues dans le rapport annuel et
les communiqués de presse. Il est également noté une association significative entre
les divulgations dans rapports annuels et des communiqués de presse réactifs d’une
part, avec la légitimité (médiatique) environnementale d’autre part. Le degré de
divulgation environnementale est fonction du secteur d’activité, ce qui laisse présumer
que le niveau de légitimité pourrait être lui aussi fonction du registre d’activité.
Cho et Patten (2007) font un appariement de groupes composés d’une part de firmes
ayant une bonne performance environnementale, et de firmes ayant de très mauvaises
performances environnementales d’autre part, dans le but avéré de cerner les
différences notables dans leurs politiques de divulgation en matière environnementale.
Les résultats indiquent que l'utilisation des composantes monétaires fait toute la
différence : les renseignements monétaires, notamment au sujet des éventuels litiges
sont moins présents chez les entreprises ayant les pires performances
environnementales. En général, les résultats fournissent un soutien supplémentaire à
l'argument selon lequel les entreprises utilisent la communication volontaire
d’informations environnementales comme outil de légitimation.
Liu et Anbumozhi (2009) trouvent par contre que le niveau de divulgation en matière
environnementale est marginal est Chine, les entreprises qui opèrent dans des régions
côtières orientales où l'économie a été relativement développée, et celles qui lèvent des
fonds sur les marchés internationaux étant de celles qui sont les plus susceptibles de
divulguer des données liées aux émissions polluantes. Un contraste saisissant par
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
rapport aux politiques des firmes occidentales, contraste que nous pouvons en partie
expliquer par l’indice de développement humain ou la culture.
5. Divulgation et culture
Les différences dans les niveaux et la nature des divulgations volontaires ont souvent
été examinées dans des contextes nationaux afin de déterminer dans quelle mesure les
facteurs culturels pouvaient les affecter. Les facteurs perçus comme moteurs de la
divulgation volontaires sont alors testés pour certaines cultures en particuliers, afin de
déterminer si celles-ci les atténuent ou non. Zaman Mir, Chatterjee et Siraz Rahaman
(2009) ont conduit une étude comparative entre l’Inde et la Nouvelle Zélande afin de
déterminer l’étendue des divulgations dans le rapport annuel. Ils ont découvert que,
contrairement à la culture du secret qui caractérise l’Inde selon le modèle d’Hofstede
(1980), les rapports annuels indiens sont pour chaque section plus riches
d’informations que ceux des néo-zélandais. Les entreprises indiennes se sont
également révélées plus transparentes, car ayant fourni plus d'informations au sujet de
leurs produits, le souci de l'environnement et la performance financière. Une preuve
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 97 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
que la nature, l’étendue ou la teneur de la divulgation volontaire peut varier également
en fonction des pays ou des cultures.
6. Gouvernance et divulgation
Cheng et Courtenay (2005) ont examiné l'association entre la surveillance du conseil et
le niveau de divulgation volontaire, sur la base d’un échantillon de 104 entreprises
cotées à la Bourse de Singapour. Leurs résultats indiquent que les entreprises avec des
conseils d’administration majoritairement constitués d'administrateurs indépendants
présentent des niveaux plus élevés de divulgation volontaire que celles dont les
conseils connaissent une moindre participation d'administrateurs indépendants.
Ajinkya et ses coauteurs (2005) mettent l'accent sur l'impact de la structure du conseil
à la fois sur la qualité et sur la quantité de la divulgation d'informations corporatives.
Ils signalent en conclusion que les entreprises qui possèdent les conseils les plus
efficaces affichent les plus grandes fréquences dans les prévisions de bénéfices, ainsi
qu’une plus grande précision dans leurs prévisions. L’asymétrie d'information autour
des annonces de résultats s’en trouve ainsi considérablement réduite. Ils constatent
également que la structure du conseil, l'activité du conseil et la proportion du
portefeuille d'actions détenu par les administrateurs et les dirigeants déterminent
significativement le niveau de la divulgation. Ils montrent par là qu’une bonne
gouvernance d'entreprise permet de réduire l'asymétrie d'information entre les
annonces trimestrielles de résultats. Bujaki et McConomy (2002) intègrent le
paramètre de la taille, en montrant que les entreprises de grande taille ne devraient en
général pas avoir de difficulté à s’adapter aux exigences de gouvernance comme les
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
petites et moyennes entreprises, celles-ci pouvant dans plusieurs cas adopter des
structures de gouvernance qui s'écartent considérablement des exigences cardinales.
En conséquence, il est clairement à prévoir que la teneur, l’étendue et la fréquence de
la divulgation des grandes entreprises soient plus élevés que celles des entreprises de
plus petite taille.
7. L’indice de divulgation
Le plus grand défi d’une étude portant sur la divulgation est fort probablement la
mesure du niveau de la divulgation. De nombreux indices de divulgation sont repris
dans des recherches, certains d’entre eux faisant partie de standards internationaux, et
d’autres étant développés par des chercheurs selon les contextes spécifiques de leurs
études. Botosan (1997) est parmi ceux qui ont développé leur propre indice. Alors
qu’elle voulait mettre en relation le niveau de divulgation de l’entreprise et le coût du
capital, elle a estimé que l’indice de l’AIMR (Association for Investment and
Management Research) était beaucoup trop orienté vers les grandes entreprises. Son
indice est composé de cinq types d’informations pondérés chacun à 20%, et qui
concernent la présentation générale de l’entreprise, le sommaire de ses résultats
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 98 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
historiques, les données statistiques clés au sujet des éléments non financiers,
l’information prospective, ainsi que l’analyse et les commentaires de la direction.
D’autres chercheurs, Neu, Warsame et Pedwell (1998) notamment, ont employés le
nombre de mots en rapport avec l’activité environnementale pour appréhender le
niveau de la divulgation environnementale volontaire. Clarckson et ses coauteurs
(2008) font une classification binaire des informations. En informations « Hard »,
elles font état de la structure de gouvernance, les systèmes de gestion, la crédibilité, les
indicateurs de performance environnementale et les dépenses environnementales. En
informations « Soft », elles évoquent la vision et la stratégie, le profil environnemental
et les initiatives environnementales. La première catégorie reçoit une pondération plus
élevée que la seconde. Cho et Patten (2007) poursuivent dans la même lancée en
opposant les informations à caractère monétaire et les données à caractère non
monétaire. Les premières étant toujours mieux pondérées que les secondes. Aerts et
Cormier (2009) prennent en considération l’ampleur des informations en plus de leur
teneur, en définissant une grille de codification qui attribue différents poids selon la
nature des informations : un point si elles sont indicatives, deux points si elles sont
qualitatives ou descriptives, et enfin trois points si elles sont d’ordre quantitatif et
numéraire. Une mesure que nous avons reprise (Zogning, 2015) pour estimer le niveau
de la divulgation des entreprises de l’indice boursier TSX60, regroupant les soixante
valeurs les plus importantes de la bourse de Toronto.
Dans tous ces cas de figure, la mesure demeure quelque peu subjective, étant donné
qu’il s’agit essentiellement d’une codification qui relève de l’analyse documentaire. La
perception de la nature ou de la teneur d’une information peut alors varier selon le
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
chercheur. Cette subjectivité est en général balisée par une forme de triangulation de
chercheurs, selon laquelle la codification doit être menée par deux ou plusieurs
chercheurs, et les résultats de leurs observations une fois rapprochés, doivent fournir
un Alpha de Cronbach élevé (supérieur à 70%) afin d’attester de la fidélité de
l’instrument de mesure.
Conclusion
Avec le développement, la diversification et la complexité des activités économiques,
la divulgation de l'information obligatoire des entreprises peine à satisfaire les besoins
des investisseurs, et plus largement des autres parties prenantes à leurs activités, dont
le besoin en informations fiables et pertinentes va croissant. Ces contraintes sont
davantage prononcées pour des entreprises cotées, qui sont généralement les plus
enclines à divulguer volontairement des informations au sujet de leurs activités. Avec
la mondialisation des économies et l’internationalisation des marchés, la nécessité de
recourir à la divulgation volontaire s’est davantage accentuée, tant pour les marchés
domestiques que pour les marchés étrangers, compte tenu des effets bénéfiques
escomptés d’une telle pratique.
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 99 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
Références
Aerts W., Cormier D. (2009), Media legitimacy and corporate environmental
communication, Accounting, organizations and society, Vol. 34, N°1, p. 1-27.
Aerts W., Cormier D., Magnan M. (2007), The Association Between Web‐Based
Corporate Performance Disclosure and Financial Analyst Behaviour Under Different
Governance Regimes, Corporate Governance, Vol. 15, N°6, p. 1301-1329.
Ajinkya B., Bhojraj S., Sengupta P. (2005), The association between outside directors,
institutional investors and the properties of management earnings forecasts, Journal of
accounting research, Vol. 43, N°3, p. 343-376.
Baginski S.P., Hassell J.M., Kimbrough M.D. (2002), The effect of legal environment
on voluntary disclosure: Evidence from management earnings forecasts issued in US
and Canadian markets, The Accounting Review, Vol. 77, N°1, p. 25-50.
Botosan C.A. (1997), Disclosure level and the cost of equity capital, Accounting
review, Vol. 72, N°3, p. 323-349.
Bujaki M., McConomy B.J. (2002), Corporate governance: Factors influencing
voluntary disclosure by publicly traded Canadian firms, Canadian Accounting
Perspectives, Vol. 1, N°2, p.105-139.
Bushee B.J., Noe C.F. (2000), Corporate disclosure practices, institutional investors,
and stock return volatility, Journal of accounting research, Vol. 38, p. 171-202.
Carroll A.B. (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate performance,
Academy of management review, Vol.4, N°4, p.497-505.
Cheng E., Courtenay S. (2005), Board composition, regulatory regime and disclosure,
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
Paper presented at the Illinois International Summer Accounting conference, Japan.
Cho C.H., Patten D.M. (2007), The role of environmental disclosures as tools of
legitimacy: A research note, Accounting, organizations and society, Vol.32, N°7,
p.639-647.
Choi J.-S. (1999), An investigation of the initial voluntary environmental disclosures
made in Korean semi-annual financial reports, Pacific Accounting Review, Vol. 11,
N°1, p. 73-102.
Clarkson P.M., Li Y., Richardson G.D., Vasvari F.P. (2008), Revisiting the relation
between environmental performance and environmental disclosure: An empirical
analysis, Accounting, organizations and society, Vol. 33, N°4, p. 303-327.
Diamond D.W. (1985), Optimal release of information by firms, The journal of
finance, Vol. 40, N°4, p. 1071-1094.
Dye R.A. (1985), Disclosure of nonproprietary information, Journal of accounting
research, Vol.23, N°1, p. 123-145.
Friedman M. (1970), The social responsibility of business is to increase its profits,
New York Times Magazine - http://www.colorado.edu/studentgroups/libertarians/issues/friedman-
soc-resp-business.html.
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 100 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
Grossman S.J. (1981), The informational role of warranties and private disclosure
about product quality, The Journal of Law & Economics, Vol. 24, N°3, p. 461-483.
Grüning M., Stöckmann K. (2004), Corporate disclosure policy of German DAX-30
companies, Aachen University, Fakultät Wirtschaftswissenschaften.
Healy P.M., Hutton A.P., Palepu K.G. (1999), Stock performance and intermediation
changes surrounding sustained increases in disclosure, Contemporary accounting
research, Vol. 16, N°3, p. 485-520.
Healy P.M., Palepu K.G. (1993), The effect of firms’ financial disclosure strategies on
stock prices, Accounting Horizons, Vol. 7, N°1, p.1-11.
Healy P.M., Palepu K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and
the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, Journal of
accounting and economics, Vol. 31, N°1, p. 405-440.
Hofstede G. (1980), Culture and organizations, International Studies of Management
& Organization, Vol. 10, N°4, p. 15-41.
Kothari S., Li X., Short J.E. (2009), The effect of disclosures by management,
analysts, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts:
A study using content analysis, The Accounting Review, Vol. 84, N°5, p. 1639-1670.
Lang M.H., Lundholm R.J. (2000), Voluntary disclosure and equity offerings:
reducing information asymmetry or hyping the stock?, Contemporary accounting
research, Vol. 17, N°4, p. 623-662.
Liu X., Anbumozhi V. (2009), Determinant factors of corporate environmental
information disclosure: an empirical study of Chinese listed companies, Journal of
Cleaner Production, Vol. 17, N°6, p. 593-600.
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
Milgrom P.R. (1981), Good news and bad news: Representation theorems and
applications, The Bell Journal of Economics, Vol. 12, N° 2, p. 380-391.
Neu D., Warsame H., Pedwell K. (1998), Managing public impressions:
environmental disclosures in annual reports, Accounting, organizations and society,
Vol. 23, N°3, p. 265-282.
Scott T.W. (1994), Incentives and disincentives for financial disclosure: Voluntary
disclosure of defined benefit pension plan information by Canadian firms, Accounting
review, Vol.69, N°1, p. 26-43.
Sengupta P. (1998), Corporate disclosure quality and the cost of debt, Accounting
review, Vol. 73, N°4, p. 459-474.
Shocker A.D., Sethi S.P. (1973), An approach to incorporating action preferences in
developing corporate action strategies, California Management Review, Vol.15, N°4,
p. 97-105.
Vernimmen P., Quiry P., Le Fur Y. (2012), Finance d'entreprise 2013, Paris, Dalloz.
Verrecchia R.E. (1983), Discretionary disclosure, Journal of accounting and
economics, N° 5, p. 179-194.
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 101 -
Auteur invité : La divulgation volontaire en matière de performance
organisationnelle : mesure, supports et motivations - Félix ZOGNING
Wang H., Bi J., Wheeler D., Wang J., Cao D., Lu G., Wang Y. (2004), Environmental
performance rating and disclosure: China's GreenWatch program, Journal of
Environmental management, Vol. 71, N°2, p. 123-133.
Zaman Mir M., Chatterjee B., Shiraz Rahaman A. (2009), Culture and corporate
voluntary reporting: A comparative exploration of the chairperson's report in India and
New Zealand, Managerial Auditing Journal, Vol. 24, N°7, p. 639-667.
Zogning F. (2015), Divulgation volontaire d’informations non-financières et
valorisation boursière des firmes, Journal of Professional Communication, Vol. 4,
N°1, p. 157-174.
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
© ARIMHE | Téléchargé le 13/09/2022 sur www.cairn.info (IP: 129.0.76.180)
RIMHE - Revue Interdisciplinaire Management, Homme & Entreprise
n°27 - Eté 2017
- 102 -
Vous aimerez peut-être aussi
- Politique Linguistique - Liste Des Manuels en Français 2017 Faculté D'administrationDocument42 pagesPolitique Linguistique - Liste Des Manuels en Français 2017 Faculté D'administrationMarcus BlackPas encore d'évaluation
- LivreblancDocument12 pagesLivreblancapi-3831116Pas encore d'évaluation
- Tecno-Logique and TechnologieDocument259 pagesTecno-Logique and TechnologieFederico Pérez100% (1)
- Vse 195 0077Document23 pagesVse 195 0077bernadette-cynthia.koutsing-kuitchePas encore d'évaluation
- GFP 1703 0099Document6 pagesGFP 1703 0099KARIMPas encore d'évaluation
- Rimhe 001 0007Document13 pagesRimhe 001 0007Amira DahirPas encore d'évaluation
- RFG 157 0009Document19 pagesRFG 157 0009Roldy OtesPas encore d'évaluation
- Approche Institutionnaliste de La Syndication ...Document19 pagesApproche Institutionnaliste de La Syndication ...Nour El houdaPas encore d'évaluation
- Rimhe 017 0045Document20 pagesRimhe 017 0045Ikram Chani El MarzoukiPas encore d'évaluation
- Dossier TD N°01Document13 pagesDossier TD N°01Lyly CocoPas encore d'évaluation
- RFG 198 0059Document18 pagesRFG 198 0059Emma RobertPas encore d'évaluation
- RFG 174 0043Document18 pagesRFG 174 0043Nadir MontanaPas encore d'évaluation
- Les Freins Et Obstacles À L'entrepreneuriat FémininDocument52 pagesLes Freins Et Obstacles À L'entrepreneuriat Fémininsimplice tene penkaPas encore d'évaluation
- RIMHE 007 0043aDocument21 pagesRIMHE 007 0043aUptodate TnPas encore d'évaluation
- Rimhe 006 0036Document17 pagesRimhe 006 0036leguedekodjochristophePas encore d'évaluation
- La Video Marketing Pour Les NulsDocument56 pagesLa Video Marketing Pour Les NulsJoel DJENGUEPas encore d'évaluation
- Nicolas Moinet 2007Document15 pagesNicolas Moinet 2007farouk ben salahPas encore d'évaluation
- Mav 034 0216Document18 pagesMav 034 0216ayarida285Pas encore d'évaluation
- Rfap 160 1227Document14 pagesRfap 160 1227Fedia GasmiPas encore d'évaluation
- Femmes DirigeanteDocument19 pagesFemmes DirigeanteMustapha DJOUABPas encore d'évaluation
- Mav 045 0297Document17 pagesMav 045 0297BOUKRIAPas encore d'évaluation
- Expose Intelligence Économique en Négociation CommercialeDocument18 pagesExpose Intelligence Économique en Négociation CommercialealiPas encore d'évaluation
- Caracteristique InformationDocument5 pagesCaracteristique InformationFACTURE TUNISIEPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Reseau de FranchiseDocument14 pagesLivre Blanc Reseau de FranchiseHamid Ahmed HamidPas encore d'évaluation
- Interaction Entre Le Comité D'audit Et La Fonction D'audit Interne Sur L'efficacité de L'audit InterneDocument22 pagesInteraction Entre Le Comité D'audit Et La Fonction D'audit Interne Sur L'efficacité de L'audit Internegeorgelinbatona2Pas encore d'évaluation
- A Les Engeux Du Marche de L'auditDocument18 pagesA Les Engeux Du Marche de L'auditKERDOUHPas encore d'évaluation
- Mark 2Document11 pagesMark 2Yasmine SanaPas encore d'évaluation
- RFG 192 0091Document5 pagesRFG 192 0091andre beni djahPas encore d'évaluation
- VSE_200_0049 (2)Document29 pagesVSE_200_0049 (2)siham oulmoudenPas encore d'évaluation
- Business Model Et Creation D'entreprise L3 SegDocument24 pagesBusiness Model Et Creation D'entreprise L3 SegRomaric YapoPas encore d'évaluation
- Sestr 012 0056Document10 pagesSestr 012 0056P3003859 PQUBEPas encore d'évaluation
- III 5 - FLORNOY - Procedure de Marketing Dutilisation Des Media Sociaux Et Du Site Internet - 210819Document6 pagesIII 5 - FLORNOY - Procedure de Marketing Dutilisation Des Media Sociaux Et Du Site Internet - 210819Noa MorinPas encore d'évaluation
- Reof 074 0103Document51 pagesReof 074 0103Youssef ElhamdaniPas encore d'évaluation
- Ecofi 122 0255Document19 pagesEcofi 122 0255MOHAMED AFERIADPas encore d'évaluation
- Cca 141 0093Document27 pagesCca 141 0093me & youPas encore d'évaluation
- Cca 112 0083Document26 pagesCca 112 0083Aicha Ben TaherPas encore d'évaluation
- Une Approche Typologique de L'entrepreneuriat de PDFDocument20 pagesUne Approche Typologique de L'entrepreneuriat de PDFWajih Ben GaiedPas encore d'évaluation
- DA Guide Des Procedures Internes ONGDocument7 pagesDA Guide Des Procedures Internes ONGJoe DouillyPas encore d'évaluation
- Livre Blanc Performance AchatsDocument16 pagesLivre Blanc Performance Achatsferhat dourmanePas encore d'évaluation
- RFG_251_0131Document18 pagesRFG_251_0131Ghalia ChalbiPas encore d'évaluation
- La Théorie FinanacièreDocument30 pagesLa Théorie FinanacièreSara MouhliPas encore d'évaluation
- Hume 286 0045Document15 pagesHume 286 0045Ramy CherifPas encore d'évaluation
- Rfas 174 0141Document10 pagesRfas 174 0141Faiza DarinePas encore d'évaluation
- RFSP 663 0461Document23 pagesRFSP 663 0461NDF93 OfficialPas encore d'évaluation
- Resg 127 0107Document27 pagesResg 127 0107Jasmin MbassianPas encore d'évaluation
- RSG 261 0167Document9 pagesRSG 261 0167Mouna Jegham BellalahPas encore d'évaluation
- RSG 241 0055Document8 pagesRSG 241 0055Tommy HelsonPas encore d'évaluation
- Intelligence Collective-Regards CroisésDocument32 pagesIntelligence Collective-Regards Croiséssahla amriPas encore d'évaluation
- Intelligence Juridique Pour Le Dircteur Du Système InformatiqueDocument53 pagesIntelligence Juridique Pour Le Dircteur Du Système InformatiqueZineb EloumaryPas encore d'évaluation
- Cinq Problématiques Clef Pour Impliquer Les Fournisseurs Dans Un Projet D'innovationDocument12 pagesCinq Problématiques Clef Pour Impliquer Les Fournisseurs Dans Un Projet D'innovationeymed2588Pas encore d'évaluation
- Hume 297 0013Document21 pagesHume 297 0013mouadnacifPas encore d'évaluation
- Fusion AcquisitionDocument27 pagesFusion AcquisitionAbdlghni RahmouniPas encore d'évaluation
- Externalisation AchatDocument21 pagesExternalisation AchatSoukaina SaddoukPas encore d'évaluation
- RFG 144 0023Document20 pagesRFG 144 0023Maha El alaouiPas encore d'évaluation
- REPENSER LES LIENS ENTRE LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN ET LA Marque Employeur Perçue en Contexte de Mutation OrganisationelleDocument20 pagesREPENSER LES LIENS ENTRE LA GESTION DU CAPITAL HUMAIN ET LA Marque Employeur Perçue en Contexte de Mutation OrganisationelleRachid BenhmidouPas encore d'évaluation
- De La Stratégie Au Processus StratégiquesDocument23 pagesDe La Stratégie Au Processus Stratégiqueslaila akrioPas encore d'évaluation
- Lemaire Celia 2021 CCA 273 0007Document36 pagesLemaire Celia 2021 CCA 273 0007Boudou MedPas encore d'évaluation
- RFG 147 0235Document13 pagesRFG 147 0235by dohaPas encore d'évaluation
- RFG 198 0095Document30 pagesRFG 198 0095Victor AckerPas encore d'évaluation
- 7 Raisons De: de Passer Par ParisDocument35 pages7 Raisons De: de Passer Par ParisSaida BekriPas encore d'évaluation
- Le benchmarking: S'inspirer des plus grands pour évoluerD'EverandLe benchmarking: S'inspirer des plus grands pour évoluerPas encore d'évaluation
- MED Intructions Auteurs 2017-04-27Document1 pageMED Intructions Auteurs 2017-04-27Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 12-Stakeholders and Corporate Environmental Responsability of Banks Groups in Africa A Regional AnalysisDocument21 pages12-Stakeholders and Corporate Environmental Responsability of Banks Groups in Africa A Regional AnalysisFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 118 0097Document27 pagesResg 118 0097Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 134 0111Document22 pagesResg 134 0111Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 931-Article Text-3325-1-10-20220503Document24 pages931-Article Text-3325-1-10-20220503Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 116 0025Document26 pagesResg 116 0025Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 118 0065Document30 pagesResg 118 0065Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 118 0045Document20 pagesResg 118 0045Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 118 0131Document22 pagesResg 118 0131Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 611-Article Text-2210-1-10-20210513Document20 pages611-Article Text-2210-1-10-20210513Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Resg 118 0023Document20 pagesResg 118 0023Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Cae Focus051Document9 pagesCae Focus051Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 229-Article Text-774-1-10-20210829Document16 pages229-Article Text-774-1-10-20210829Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 171-Article Text-573-1-10-20210517Document23 pages171-Article Text-573-1-10-20210517Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- OFCEpbrief 73Document22 pagesOFCEpbrief 73Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 432-Article Text-1613-1-10-20201111Document25 pages432-Article Text-1613-1-10-20201111Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 765-Article Text-2866-1-10-20211226Document20 pages765-Article Text-2866-1-10-20211226Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument23 pages1 PBFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- La Recherche Francaise en Gouvernance DentrepriseDocument39 pagesLa Recherche Francaise en Gouvernance DentrepriseFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 191-Texte de L'article-537-1-10-20210201Document23 pages191-Texte de L'article-537-1-10-20210201Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument11 pages1 PBFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- La Gouvernance Hospitaliã Re: Quelques Rã© Exions à Partir de La Gouvernance D'EntrepriseDocument16 pagesLa Gouvernance Hospitaliã Re: Quelques Rã© Exions à Partir de La Gouvernance D'EntrepriseFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument18 pages1 PBFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Classemnt Revues 2019 v2Document62 pagesClassemnt Revues 2019 v2Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- RFG 157 0215Document25 pagesRFG 157 0215Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- QDM 161 0061Document15 pagesQDM 161 0061Fabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument19 pages1 PBFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument22 pages1 PBFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- La Transparence de L'entreprise Et La Structure de Propriété - Cas Des Entreprises FrançaisesDocument30 pagesLa Transparence de L'entreprise Et La Structure de Propriété - Cas Des Entreprises FrançaisesFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Controle de GestionDocument19 pagesControle de GestionFabrice GUETSOPPas encore d'évaluation
- Diversite Genetique EbookDocument2 pagesDiversite Genetique EbookSangaré soungaloPas encore d'évaluation
- Guide Diagnostics UPDS 1684481295Document260 pagesGuide Diagnostics UPDS 1684481295elberrichiPas encore d'évaluation
- Cours Politiques PubliquesDocument73 pagesCours Politiques PubliquesAnonymous eCzQT4tiPas encore d'évaluation
- NXNS 00077 V01Document12 pagesNXNS 00077 V01Abdo AbdoPas encore d'évaluation
- Correction de L'évaluationDocument2 pagesCorrection de L'évaluationLudivine MauchausséePas encore d'évaluation
- zafimaniryDocument7 pageszafimaniryMahery MBOANYPas encore d'évaluation
- 2016 20 19000000 1-Rapport-Du-Pfe-FinalDocument61 pages2016 20 19000000 1-Rapport-Du-Pfe-FinalYahya FRIDPas encore d'évaluation
- PascalleSmith PHD 2008 PDFDocument282 pagesPascalleSmith PHD 2008 PDFOmar Ushiñahua RucobaPas encore d'évaluation
- Exposé de DéchetDocument19 pagesExposé de DéchetSalma ADAIDAPas encore d'évaluation
- Livre D'espagnolDocument62 pagesLivre D'espagnolquentin50% (2)
- Veolia Environnement: Profil de La Plus Grande Entreprise de Services D'eau Au MondeDocument20 pagesVeolia Environnement: Profil de La Plus Grande Entreprise de Services D'eau Au MondeFood and Water WatchPas encore d'évaluation
- Mad 191479Document39 pagesMad 191479Victorien Henri RazafimandimbyPas encore d'évaluation
- Azzouz - Karima Esthétique Poétique Des Couleur de L'architecture PDFDocument450 pagesAzzouz - Karima Esthétique Poétique Des Couleur de L'architecture PDFYousrita YouPas encore d'évaluation
- Crise Écologique en Côte D'ivoire: Tendances, Causes Et Impacts Des Feux de VégétationDocument17 pagesCrise Écologique en Côte D'ivoire: Tendances, Causes Et Impacts Des Feux de Végétationjean_luc_kouassiPas encore d'évaluation
- Elaboration Du BP - RéstaurantDocument38 pagesElaboration Du BP - RéstaurantSaad BenjarPas encore d'évaluation
- Animation Communautaire en Haiti - La Methode ReflectDocument21 pagesAnimation Communautaire en Haiti - La Methode ReflectMessi Lio100% (1)
- Chap 7 Réseaux D'égout Pluvial COURSDocument26 pagesChap 7 Réseaux D'égout Pluvial COURSMarie NDOURPas encore d'évaluation
- GFW Congo Atlas v1 FrancaisDocument39 pagesGFW Congo Atlas v1 FrancaisITOBA DinaPas encore d'évaluation
- CORRECTION EFM REGIONNAL RSE MARRAKECH SAFI Et de MarrakechDocument14 pagesCORRECTION EFM REGIONNAL RSE MARRAKECH SAFI Et de MarrakechOussama AgoumiPas encore d'évaluation
- AFD 2018 Mécanisation Agricole Et Politiques PubliquesDocument24 pagesAFD 2018 Mécanisation Agricole Et Politiques PubliquesChabi Bienvenu d'Emile SounonPas encore d'évaluation
- Les Formations Superficielles Et Les Risque AnthropiquesDocument19 pagesLes Formations Superficielles Et Les Risque Anthropiquesislem.naitsaidiPas encore d'évaluation
- Thése de Doctorat Merdaci - pdf-NDVIIDocument103 pagesThése de Doctorat Merdaci - pdf-NDVIISarah MaskerPas encore d'évaluation
- 2020-2021 - Janv - E&D Physique - SCUIO - VFDocument20 pages2020-2021 - Janv - E&D Physique - SCUIO - VFafif.karim.wilayaPas encore d'évaluation
- Thème 1-2 Economia Turismului FRDocument17 pagesThème 1-2 Economia Turismului FRNadea ChPas encore d'évaluation
- Fiches Pratiques: Versions 2015Document1 pageFiches Pratiques: Versions 2015REMYPas encore d'évaluation
- Les Impacts Du NumériqueDocument5 pagesLes Impacts Du NumériqueYoucef AttallahPas encore d'évaluation
- Techniques de Rédaction Mind MappingDocument4 pagesTechniques de Rédaction Mind MappingHanae Sqalli100% (1)
- MemoireDocument196 pagesMemoirenuit_claire002Pas encore d'évaluation