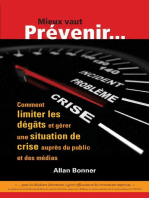Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
COMMUNICATION DE CRISE UN OUTIL DE GESTION AU SERVICE DE l'IMAGE DE MARQUE DE l'ENTREPRISE
Transféré par
Said BegricheTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
COMMUNICATION DE CRISE UN OUTIL DE GESTION AU SERVICE DE l'IMAGE DE MARQUE DE l'ENTREPRISE
Transféré par
Said BegricheDroits d'auteur :
Formats disponibles
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
COMMUNICATION DE CRISE : UN OUTIL DE GESTION AU SERVICE DE
L’IMAGE DE MARQUE DE L’ENTREPRISE
CRISIS COMMUNICATION : A MANAGEMENT TOOL SUPPORTING
COMPANY’S BRAND IMAGE
NAJIA BEDOUI
Enseignant chercheur à l’ENCG El Jadida Université Chouaïb Doukkali,
Laboratoire d’Etudes et de Recherches en Sciences Economiques et de Management
Consultante Maître Formateur International et Coach certifiée.
najia-bedoui@hotmail.com
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 514
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Résumé
Sans être une science exacte, la communication de crise et le rapport d’une organisation aux
médias lorsque celle-ci survienne, exige beaucoup de technicité et de rigueur. Elle doit être
traitée par des professionnels, qui dans un souci de surprotection de leur entité, vont essayer
de cerner la problématique et ne laisser aucune défaillance qui pourrait porter préjudice à
l’entreprise. Il s’agit en effet, des risques auxquels sont exposés la relation de l’entreprise
avec ses parties prenantes, les porteurs d’enjeux, sa réputation et son devenir. Cette
communication n’existe pas de manière isolée, elle est imbriquée de manière transversale
dans la communication interne, la communication financière, environnementale, juridique ou
celle en rapport avec les médias.
La communication est illustrée par des exemples de crises impactant différents secteurs et
comporte deux études de cas, d’abord pour une communication ratée du leader automobiliste
mondial Toyota et une approche communicationnelle réussie concernant le mouvement du 20
févier.
Mots-clés : Incident, Risque, Crise, Communication de crise, Management de crise
Abstract :
Without being an exact science, crisis communication is the relationship between an
organization and the media in a crisis situation. It requires technicality and rigor. It should be
managed by professionals, who in order to protect the entity, will try to define the issues and
leave no flaws that could make the company prejudicial. It thus involves risks that expose the
relation between the company and the stakeholders involved, as well as the company’s
reputation and its future. This type of communication is not isolated. It is imbricating in a
transversal manner into internal, financial, environmental and legal communication in
addition to the one related to the Medias. This paper will be illustrating its arguments using
case studies from different fields of activities. Two particular cases are explored, with first the
failed communication strategy of the worldwide car manufacturer Toyota and then the
successful communication case of Moroccan authorities related to the 20 February movement.
Keywords : Incident, Risk, Crisis, Crisis Communication, Crisis Management
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 515
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Introduction
Dans un monde de démesure, de haute technologie, de contexte politique, économique, social,
environnemental en perpétuelle effervescence, les organisations, qu’elles soient publiques ou
privées, tout secteur confondu, vivent t-ils des situations de crises ou des crises de
communication ? Sont-elles préparées pour gérer ces « incidents », « accidents » ou attendent
ils « l’événement » pour improviser ? Qui gèrent les crises ? Qui décident de la prise de
parole ? Comment sont structurés les messages transmis ? S’agit-il d’une spécialité qui a ses
codes et ses stratégies à part ou d’une communication ponctuelle qui change et s’adapte selon
les contextes ? Quel est le rôle des médias dans l’amplification ou l’atténuation des crises
survenues ? Est-il facile de communiquer dans l’incertitude, la pénurie de l’information ou la
surinformation ? Le choc et l’affolement des premiers instants, premières heures qui suivent
le début d’une crise ? Quels sont les retombées du déni ? L’évitement ou une communication
tronquée et mal gérée?
Cet essai apportera des réponses synthétiques à ces interrogations et distinguera, selon le
contexte et les cas étudiés, entre une communication de crise économique, sociale et politique.
Mais avant cela, il importe de délimiter le champ de « la crise ».
1- De l’incident à la crise : Comment s’est opérée la mutation ?
Pour répondre à ces interrogations, il est nécessaire de délimiter le concept de crise. Souvent
confondue avec la notion de « risque », risque « majeur » et « catastrophe ».
La notion de risque a été introduite pour la première fois en France en 1981 par Patrick
LAGADEC dans son ouvrage : La civilisation du risque : Catastrophes technologiques et
responsabilité sociale.
Longuement débattu et faisant l’objet de plusieurs études scientifiques, ce concept va se
développer et muter vers le risque « majeur » jusqu’à devenir « une catastrophe »
Le risque « majeur », revêt deux formes le risque technologique (hacker, piratage,
espionnage…) et le risque naturel (séisme, inondation, criquet…). La conjonction de ces deux
formes de risque, s’ils surviennent simultanément, donne lieu à des catastrophes de grandes
envergures que les spécialistes nomment risque «d’événements ».
Le risque relève de l’incertitude et de la probabilité. Il intervient lorsque les enjeux qu’ils
soient matériels ou immatériels, humains ou sécuritaires se trouvent exposés ou menacés. Il
peut aboutir dans l’immédiat à une catastrophe et fragiliser une organisation présentant une
certaine vulnérabilité (BEUCHER, REGHEZZA et VEYRET, 2004, pp23-24).
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 516
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Jusqu’aux années 70, la notion de catastrophe, désignait chez les américains quelque chose
qui s’abat sur une communauté, laissant derrière elle plus de 30 victimes et par rapport à
laquelle il faut réagir. Il s’agit donc, d’un événement inattendu, brutal et réel, causant des
dommages qui dépassent un seuil acceptable par la société.
A cette panoplie va s’ajouter deux nouveaux éléments majeurs : la « crise »et « l’accident » et
ce, dans les années 80.
Cette appellation va durer jusqu’aux années 90 où on va assister à une mutation du terme. On
passe en effet de la crise en tant qu’incident produit par la providence et donc une fatalité, à
un processus bien rôdé et des stratégies hautement réfléchies. En effet, des professionnels
avérés vont « manager » la crise, l’anticiper, amortir son impact lors de sa production, prendre
la ou les « décisions » appropriées au moment opportun et vont jusqu’à tirer bénéfice de la
turbulence qu’elle peut provoquer.
Depuis plus de 10 ans, certains chercheurs en science de l’information et communication ont
mis l’accent sur le rôle prépondérant que joue la communication dans des situations de crise.
Ceci explique notre souhait, d’aborder cette notion sous l’angle de la communication.
2- De la crise à une communication de crise
Utiliser pour désigner des évènements ou des phénomènes divers, on s’interroge si le terme de
« crise » de part « sa généralisation n’a pas aussi pour fonction idéologique d’occulter des
problématiques complexes et nouvelles » (Barus-Michel, Giust-Desprairies, Ridel, 1996, p.
12).
Cependant, il n’existe pas une mais des crises. La réduction de leur diversité à une notion
abstraite fait obstacle à leur compréhension. Seule leur rattachement à des contextes définis
peut nous rapprocher davantage de cette notion et expliquer, comme on va le voir un peu plus
loin, leur tenant et aboutissant. Ceci dit, on reste fidèle à la vision qui fait de la crise un
processus qui met la lumière sur une série de dysfonctionnements remuant durablement ou
provisoirement un ou plusieurs aspects dans l’entreprise. Il peut menacer l’existence même de
celle-ci.
Crise et décision sont indissociables, l’étymologie du terme en dit long sur cette fusion. Issue
du terme grec Krisis signifiant « décision » c’est-à-dire une réponse à une situation
particulière, le terme « crise » a progressivement perdu son sens premier pour décrire
aujourd’hui la situation elle-même.
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 517
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
L’origine de la crise peut être tantôt due à une perturbation plus ou moins brusque, à
l’intérieur ou à l’extérieur de l’organisation, ou résulter de phénomènes nocifs, difficilement
perceptibles qui finissent par occasionner de graves perturbations. A. Maurois la compare à
une maladie…« Il y a des maladies qui commencent lentement, par des malaises légers et
convergents. D’autres éclatent en une soirée, dans un accès de fièvre violant » Climats, 1.8
cité par Robert, Accès donné comme synonyme de Crise
Sous l’effet d’un évènement déclencheur, qu’il soit interne ou externe, le processus de crise
va être mis en évidence par une série de dysfonctionnement affectant l’entreprise, la santé
humaine, le produit, la pérennité, l’environnement…
Si l’un des facteurs1 suivant apparait, l’entreprise doit mettre en œuvre rapidement une
communication de crise :
- La répétition d’actes relativement graves, créant un climat de tension et turbulence
- Un incident grave provoquant une situation de rupture : suicide, séisme, accident..
- Atteinte aux personnes ou l’environnement,
- Perturbation du mode de fonctionnement de l’entreprise,
- Intérêt croissant des médias
- Atteinte à l’entreprise et son image de marque, etc.
Les objectifs
La communication de crise est amenée à répondre à une multitude d’objectifs :
- Anticiper les crises et les éviter,
- Empêcher un incident de muter vers une crise,
- Atténuer la crise,
- Empêcher une crise de devenir une catastrophe
- Offrir l’opportunité d’un dénouement favorable à une crise
- Préserver la crédibilité de l’entreprise et son image de marque.
Une communication de crise est une communication étudiée. Rien n’est laissé au hasard, les
techniques et les stratégies sont bien réfléchies. Elle est faite par des professionnels et répond
aux exigences de la rigueur et du pragmatisme d’où la diversité des approches qu’elles l’ont
traitée.
1
Catherine Guillaume, Allocution lors du colloque sur les Risques Majeurs, organisé par l’université de
Nouvelle-Calédonie et la province sud, Octobre 2010. Article en ligne
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 518
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
3- Les approches de la notion de crise2
3.1 Approche par le rôle :
Quand la communication est considérée comme le seul moyen de gestion de la crise en
présence et permettant à l’entreprise d’en sortir rapidement, avec les moindres dégâts et d’en
tirer profit en redorant son image de marque. La crise du Tyleno survenue aux USA est la
meilleure illustration de cette approche. Quand un déséquilibré a ajouté du cyanure dans les
capsules de ce médicament il y a eu 7 cas de décès. La firme a aussitôt reconnu son erreur, a
retiré tous les produits du marché et la Direction a demandé des excuses aux familles des
victimes. Elle a même installé un système d’inviolabilité sur les capsules.
3.2 Approche par la stratégie
Il s’agit des rapports satisfaisants qu’entretient l’entreprise avec ses partenaires : les
employés, les consommateurs, les clients, les usagers, les partenaires, les politiques, les
autorités compétentes, les médias, les actionnaires…Si au moment de crise, l’entreprise les
dote des informations qu’ils attendent et joue la carte de la transparence la crise va s’éteindre
d’elle-même.
3.3 Approche par les défis
L’exemple de la compagnie Air France et le crash du vol Rio/Paris en 2009 illustre
parfaitement cette approche. L’avion disparaît des radars et personne ne savait où il se
trouvait. Les parties prenantes, en l’occurrence les familles en détresse attendaient une
communication de compassion et surtout des informations. Or, la compagnie, en pleine
recherche de l’appareil n’en disposait pas et ne pouvait pas non plus avancer des thèses
qu’elles ne contrôlaient pas. Cette difficulté à répondre aux exigences des pouvoirs publiques
a aggravé les choses et la crise s’est enlisée.
3.4 Approche par la catégorie
Il s’agit de considérer la communication de crise au même titre que les autres types de
communication existant dans l entreprise : communication interne, communication média,
communication financière, communication environnementale, communication juridique, etc.
C’est une communication qui va permettre d’anticiper les crises, analyser les différents
processus en jeu et mettre en place des stratégies préventives, avec des simulations et des
rapports professionnels aux médias.
2
Idem
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 519
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Il est primordial pour l’entreprise de réagir rapidement lors d’un incident, être la première à
en communiquer et le seul interlocuteur avec les médias et le public. Il s’agit de leur apporter
les réponses correctes et précises aux interrogations qui les taraudent. L’information Zéro, le
déni, l’évitement ne feront qu’aggraver la situation d’où le rôle important de la
communication de crise.
4- Les Rôles de la communication de crise
La communication de crise peut avoir plusieurs rôles notamment :
4.1 Le rôle d’anticipation :
Mettre en place une communication de crise c’est offrir à l’entreprise des moyens et outils
pour analyser et gérer, en amont, les risques liés à chaque partie prenante de l’entreprise. Il
s’agit d’identifier leurs besoins, attentes et les risques qui s’y rattachent dans une perspective
préventive afin de ne pas transformer un incident en crise déclarée.
4.2 Le rôle d’information :
L’exemple des 33 mineurs chiliens3, bloqués au fond d’une mine pendant plusieurs semaines
en 2010, illustre parfaitement ce rôle. Quoique dramatique, cette situation aurait pu être pire si
le gouvernement chilien avait passé sous silence cet incident. Au contraire, dès les premières
minutes, les responsables ont pris la parole et ont informé les familles, les médias et tout le
chili : « les mineurs sont bloqués mais ils sont vivants…nous allons tout faire pour les en
sortir, mais cela va prendre beaucoup de temps ». Ils ont choisi de rassurer, de donner et
diffuser la bonne information, le bon message, au bon moment et aux bonnes parties
prenantes. Les médias internationaux ont joué un rôle de soutien essentiel aux familles des
sinistrés.
4.3 Assurer la veille sur les réseaux sociaux :
Ils prennent de plus en plus d’importance et permettent une diffusion rapide des informations.
Il présente le risque de la désinformation des publics et offre aux rumeurs l’opportunité de
fleurir. Les utilisateurs de la toile croient, sans discernement à tous qu’ils lisent. Cette
évolution représente des risques majeurs et de nouvelles fragilités dont l’entreprise doit tenir
compte.
3
Le figaro, 13 octobre 2010
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 520
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Comme pour chaque type de crise correspond une stratégie de communication définie,
imposée par sa nature, les publics concernés et la sensibilité des incidents. Les exemples ci
après vont se pencher sur l’analyse de deux types de : une économique avec comme cas la
Firme Toyota, la seconde est politique, concernant le Maroc et le Mouvement du 20 février.
5- Etude de cas : Analyse de communication de crise
Quel que soit la littérature qui a abordé la communication de crise, celle-ci reste relative. A
chaque crise ses spécificités et son contexte culturel, économique, social, politique…
5.1 Crise économique : cas Toyota
Toyota, le leader mondial de l’automobile s’est taillé une réputation exemplaire en matière de
fiabilité de ses véhicules. Mais, durant la période 2009/2010, le constructeur japonais va
traverser une crise s’aggravant au fil des mois et ce, pour deux raisons essentielles :
5.1.1 Problèmes techniques :
- Tapis de sols défectueux en septembre,
- Pédales d'accélérateurs bloquées en décembre,
- Problèmes de freinage sur la Prius.
Le bilan de ses défaillances techniques fut lourd: 19 morts, et 9 millions de véhicules rappelés
dans le monde. Cette décision a coûté au groupe une perte de près de 400 millions d’euros par
mois. La responsabilité du groupe est avérée mais il a choisi une autre voie pour gérer la crise.
5.1.2 Défaillances communicationnelles
Face à la crise, le groupe japonais a d’abord choisi de se taire, rejeter la responsabilité,
s’excuser puis rappeler ses véhicules.
Le silence
Dans un premier temps, le leader japonais a choisi le silence puis de minimiser sa
responsabilité. Fin septembre, le porte parole du groupe avait indiqué « …les tapis de sol
n'étaient pas défectueux …les automobilistes américains ont tendance à surprotéger la
moquette de sol de leur voiture, notamment dans les régions pluvieuses » (Le Figaro,
septembre 2009).
Deux mois plus tard (novembre 2009), la Direction espérait étouffer l’affaire et persistait
toujours dans le silence. Cette stratégie de silence se base sur l’espoir que « faute de
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 521
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
combustible, le feu s’éteint » (Jean Piottet, Communication de crise, quelle stratégies ?).
Néanmoins, elle a procédé au rappel de véhicules mais, uniquement pour les tapis de sol.
Cette attitude a fait du groupe la cible N1 à abattre par les médias, les consommateurs et le
gouvernement américain qui avait les japonais dans sa ligne de mir. L’affaire est devenue plus
politique qu’économique.
Rejet de responsabilité
« Nous prenons l'entière responsabilité de cette affaire. Même si elle provient de la pièce
d'un fournisseur et non pas d'un problème à l'assemblage » (Le Monde, 10.10). Le groupe
essaye par cette déclaration d’ouvrir un nouveau front et rejeter la responsabilité sur son
équipementier américain CTS. Il reconnaît ainsi sa part de responsabilité mais ne l’assume
pas entièrement. Mais, cette déclaration a exposé le groupe à un autre type de critiques portant
sur sa responsabilité en tant que leader mondial de veiller sur la qualité de ses prestations et la
conformité de ses produits aux normes de qualité même s’il externalise ses activités.
Les excuses
Février 2010, devant la pression des médias et la pérennité de la crise, le groupe Toyota a
commencé à prendre réellement les choses en main. Il a enfin assumé son rôle dans la crise et
annonce le rappel de 400.000 Prius dans le monde. Akio Toyoda, PDG du groupe a tenu une
conférence de presse où il s’est dit « profondément désolé » pour les millions de véhicules
rappelés. « C'est une période de crise pour Toyota, mais afin de regagner la confiance
des clients, Toyota va devoir resserrer les rangs et coopérer de façon étroite avec ses
concessionnaires…Nous tentons de rendre nos produits meilleurs. Donc ce genre de
procédé est bon pour les consommateurs…Je vous en prie, croyez-moi, nos clients sont
notre première priorité ». Dans une culture où s’incliner est un signe d’excuse, le PDG
japonais a manqué à cette tradition, le « non geste » fut interprété comme un manque de
sincérité de sa part.
Enfin la transparence
Aux USA, Jim Lentz, patron de Toyota sur le territoire américain, a mis en ligne une vidéo
d’excuses larmoyante.
En France, le groupe lance un communiqué de presse qui se voulait rassurant et ce, dans
plusieurs journaux.
Et les automobilistes…
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 522
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Il est clair que l’attitude de Toyota vis-à-vis du consommateur n’était pas à la hauteur de ses
attentes. C’est lui qui a fait de cette marque le N1 mondial mais lors de la crise le groupe n’a
pas montré qu’il fait de lui sa première préoccupation. Le groupe va peiner après cette crise
pour redorer son image et l’expression « c’est une Toyota » semble désormais désigner un
fiasco industriel. La marque va connaitre une véritable baisse de vente même avec le
lancement de ses nouvelles marques
Le cas Toyota permet de rendre compte de l’importance des médias et de la communication
dans la gestion de la crise. En effet, la forte médiatisation des défauts de fabrication vont
inéluctablement contribuer à la dégradation de l’image de marque, la baisse des ventes et les
pertes financières vont obliger le constructeur à effectuer des licenciements, externaliser ses
prestations sans oublier la diminution de la qualité des produits. Quant aux déboires de la
communication concernant cette affaire, ils ont été avérés et ont largement contribué à la
démolition de l’image de marque de ce groupe.
5.2 Crise politique : Le printemps arabe, cas du Maroc
Dès l’éclatement des premières émeutes, les premières revendications, les régimes arabes ont
opté pour une approche sécuritaire et répressive terrorisantes. La réalité des rues et les faits
on démontré qu’ils étaient loin de toute vision de gestion de crise par la communication. Ils
ont essayé, dans un premier temps, de se dégager de toute responsabilité et ont mis en cause
les journalistes et les médias. Ensuite, ils ont alimenté les rumeurs et la théorie des complots.
Ils ont fait preuve également d’une grande ignorance en matière des rôles que peuvent jouer la
technologie et les réseaux sociaux dans la mobilisation. En sous-estimant la capacité des
activistes à mener une guerre numérique, ils leur ont permis de mener une contre guerre
acharnée qui a fait basculer des régimes enracinés par la dictature et la réprimande. La
contagion a atteint le Maroc qui a approché la descente des activistes du 20 Février aux rues
du royaume avec beaucoup de sagesse, pragmatisme et surtout une approche communicative
efficace.
De la Reconnaissance au management de la crise
Dans le communiqué de presse publié par la MAP en Février 2011, le Ministre de la
communication affirme : « Le Maroc…s’est engagé il y a longtemps dans un processus
irréversible de démocratie et d’élargissement des libertés publiques » il a joutera « Que
les citoyens puissent s’exprimer librement ne nous trouble pas ». Ce discours qui se veut
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 523
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
responsable, rassurant et faisant preuve de confiance en la maturité des citoyens a apaisé les
esprits. Les chaînes publiques comme 2M et Al Oula, Medi1 Sat ont même couvert les
manifestations. On invitait sur les plateaux télévisés les représentants du mouvement du 20
février pour débattre. La communication et les échanges ont été sciemment retournés contre la
partie adverse et débouchait sur « l’incrédibilité de la cause politique des contestataires ».
Proie aux rumeurs, l’opinion publique aspirant aux changements, est déstabilisée par
l’incertitude. Ce qui se passe en Egypte, la Tunisie, la Libye ne rassure pas. Moubarak
abdique, Ben Ali se sauve, Kaddafi menace, les mouvements islamistes se radicalisent, le
désordre, le pillage, les viols ont pris le pas sur la volonté de changer et se démocratiser. Le
printemps arabe se transformait en des bains de sang et guérilla. Le discours Royal du 9
Mars 2011 est tombé pile à l’heure. Il est venu comme une réponse aux interrogations des
médis et leur besoin en information. Il a permis également d’apaiser les esprits, dissiper les
inquiétudes et freiner les ardeurs. Dans son discours, le Roi s’est porté « garant de la
confiance pour relancer de nouvelles réformes globales ». Il a présenté la réforme
constitutionnelle comme une feuille de route à discuter dans le cadre d’une démarche
participative et une large concertation avec tous les acteurs de la nation : « nous invitons par
ailleurs, la commission à être à l’écoute et à se concerter avec les partis politiques, les
syndicats, les organisations de jeunes et les acteurs associatifs, culturels, et scientifiques
qualifiés en vue de recueillir leur conceptions et point de vue à ce sujet ».
Le Roi a appelé à l’engagement, la confiance, le patriotisme et la mobilisation pour un Maroc
meilleur tout en insistant sur son rôle de « Garant de la cohésion nationale et commandant
des croyants ». Ce discours a permis non seulement de renouer la confiance entre l’opinion
publique et le Roi mais, de restaurer la confiance qui commençait à s’effriter. Il a également
accentué la légitimité de la monarchie en tant que symbole de stabilité, réformes et
modernisation.
La communication de crise est utilisée dans ce cas avec beaucoup d’habilité, fermeté et
efficacité. L’objectif étant de rétablir la confiance et la consolider tout en veillant sur la
stabilité du pays. En commençant par la reconnaissance du problème, la volonté de changer,
l’implication de tous les acteurs de la nation dans le processus de changement, la réussite et
l’efficacité de la communication de crises est confirmée. Elle a permis au pays d’éviter le
pire.
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 524
Revue du Contrôle de la Comptabilité et de l’Audit
ISSN: 2550-469X
Numéro 6 : Septembre 2018
Conclusion
La notion de crise a évolué dans sa définition, les champs qu’elle couvre et son mode de
fonctionnement. Considéré auparavant comme une fatalité, la crise est actuellement
prévisible. On peut l’anticiper et mobilier tous les moyens pour la gérer et limiter ses dégâts
auparavant néfastes pour l’entreprise et ses partenaires. La communication de crise s’avère un
outil efficace qui a fait ses preuves dans plusieurs situations délicates. Par contre, la non
communication peut entrainer les organisations dans les aléas de la rumeur et laisserait la
porte grande ouverte aux pronostics et spéculations des réseaux sociaux, d’où la nécessité
vitale pour l’entreprise, de mettre en place une cellule de crise toujours en veille pour gérer les
risques auxquels elle est exposée.
Bibliographie :
Ouvrages consultés:
LAGADEC P 1988: La civilisation du risque : Catastrophes technologiques et responsabilité
sociale. Le Seuil, coll. « Science ouverte! », Paris
LAGADEC P, 1993 Apprendre à gérer les crises : société vulnérable, acteurs responsables,
Paris, Editions d’organisation
LIBAERT T, 1995, La communication de crise : les conditions d’une conduite efficace, Paris,
les Editions d’Organisation.
PIOTET J.P, 1991, Communication de crise : Quelles stratégies ? Mc-Grawhill
SICARD M.N, 1998 Entre médias et crises technologiques, Edition du Septentrion
Articles en ligne
Catherine GUILLAUME, Les risques majeurs, allocution au colloque organisé par
l’université de Nouvelle-Calédonie et la province sud, Octobre 2010
Si Mohammed BEN MASSOU, Introduction sur la gestion des risques et des catastrophes.
Journaux en ligne
La tribune Septembre 2009/ février 2010
Le figaro
Communiqué de la MAP, Mars 2011
Vidéo
Discours royal du 06 et 09 Mars 2011
Hosting by COPERNICUS & IMIST Revue CCA Page 525
Vous aimerez peut-être aussi
- La DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalyseD'EverandLa DDA et les nouvelles règles en matiere de distribution d' assurances: AnalysePas encore d'évaluation
- Communication de Crise IOGA Tronc Du Cours 1 5Document5 pagesCommunication de Crise IOGA Tronc Du Cours 1 5SamPas encore d'évaluation
- Plan Média de CriseDocument7 pagesPlan Média de CriseKendy K. Sen.Pas encore d'évaluation
- La Communication de CriseDocument136 pagesLa Communication de Crisem.rouabhi40100% (2)
- GCC 2020Document38 pagesGCC 2020Koffi Toyo AGBEKPONOU100% (1)
- Communication Et Gestion de Crise-1Document41 pagesCommunication Et Gestion de Crise-1Étudiant ChercheurPas encore d'évaluation
- Communication de CriseDocument8 pagesCommunication de CriseKhadija IbouPas encore d'évaluation
- De La Crise de Communication À La Communication de CriseDocument18 pagesDe La Crise de Communication À La Communication de CriseSaïdaBelazizPas encore d'évaluation
- La Communication de CriseDocument26 pagesLa Communication de CriseSoumia Benbahia100% (2)
- La Communication de Crise PDFDocument24 pagesLa Communication de Crise PDFayoub dahbiPas encore d'évaluation
- La néo-gociation 4-10-10 pour les professionnels de l'administration publiqueD'EverandLa néo-gociation 4-10-10 pour les professionnels de l'administration publiquePas encore d'évaluation
- La communication de crise à l'ère des médias socionumériquesD'EverandLa communication de crise à l'ère des médias socionumériquesPas encore d'évaluation
- Med-chains & Covid -19: Solutions innovantes pour les pandémiesD'EverandMed-chains & Covid -19: Solutions innovantes pour les pandémiesPas encore d'évaluation
- A39 Memoire Georgette Kabore Version FinaleDocument100 pagesA39 Memoire Georgette Kabore Version FinaleAlfred AdanlessossiPas encore d'évaluation
- Relations Publiques de CriseDocument19 pagesRelations Publiques de CriseRiadh NabilPas encore d'évaluation
- CommunicationcriseDocument14 pagesCommunicationcriseSara MasmarPas encore d'évaluation
- Lectures Com de Crise 2014Document48 pagesLectures Com de Crise 2014Thierry LibaertPas encore d'évaluation
- Cours de MR Cailler Épistémologie de La Communication Des OrganisationsDocument30 pagesCours de MR Cailler Épistémologie de La Communication Des OrganisationsNicolasAPas encore d'évaluation
- Génération BDDP, L'histoire DuDocument5 pagesGénération BDDP, L'histoire DuDonahueRoberts5Pas encore d'évaluation
- Enquete Impact Covid-19Document23 pagesEnquete Impact Covid-19Salma IdrissiPas encore d'évaluation
- Contenu Communication ExterneDocument2 pagesContenu Communication ExterneThierry KOUAME100% (1)
- La CommunicationDocument17 pagesLa CommunicationAbdelkarim ZaaimPas encore d'évaluation
- Gestion Dune E Crise Sur Les Reseaux SocDocument28 pagesGestion Dune E Crise Sur Les Reseaux SocGeraud Ouraga DoutoPas encore d'évaluation
- Communication de Crise, Médias Et Gestion Des Risques Du Covid-19 - REFSICOMDocument6 pagesCommunication de Crise, Médias Et Gestion Des Risques Du Covid-19 - REFSICOMCosmasPas encore d'évaluation
- Guide Communication Publique 09022021 FRDocument24 pagesGuide Communication Publique 09022021 FRSamira HadiPas encore d'évaluation
- Theme Iii La Communication Des OrganisationsDocument24 pagesTheme Iii La Communication Des OrganisationsARIF LO100% (1)
- Cours Licence Pro 3 Bgte-1Document7 pagesCours Licence Pro 3 Bgte-1Cyrille KonoPas encore d'évaluation
- Communication Institutionnelle Iftic-1Document29 pagesCommunication Institutionnelle Iftic-1Alhassane SarkiPas encore d'évaluation
- Memoire Cnps N'guetta Wilfried FinalDocument86 pagesMemoire Cnps N'guetta Wilfried FinalWilly FlorisPas encore d'évaluation
- Communication PolitiqueDocument3 pagesCommunication PolitiqueHIBA HADDAR100% (1)
- Processus de Production Dans Les Medias: Samson Mariano LALEYE 75764003 / 73401919 / 79319716Document120 pagesProcessus de Production Dans Les Medias: Samson Mariano LALEYE 75764003 / 73401919 / 79319716SamPas encore d'évaluation
- RisqueDocument24 pagesRisqueSoukaina TadlaouiPas encore d'évaluation
- La Gestion de Crises Dans Le Secteur Du Tourisme PDFDocument17 pagesLa Gestion de Crises Dans Le Secteur Du Tourisme PDFomu.cu.idei123Pas encore d'évaluation
- Progression de Cours de BTS 2 Techno Media PDFDocument75 pagesProgression de Cours de BTS 2 Techno Media PDFJoel TanguyPas encore d'évaluation
- Media Et SociétéDocument36 pagesMedia Et SociétéAl AkhPas encore d'évaluation
- Roy Catherine 2017 MemoireDocument129 pagesRoy Catherine 2017 MemoireMariana BPas encore d'évaluation
- La Communication de Crise 1Document19 pagesLa Communication de Crise 1betyPas encore d'évaluation
- Cahier Nâ°3 Gestion Des Crises PDFDocument59 pagesCahier Nâ°3 Gestion Des Crises PDFdonguiePas encore d'évaluation
- Importance de La Com Entreprise PDFDocument13 pagesImportance de La Com Entreprise PDFIkundji Amone EddyPas encore d'évaluation
- Corrigé METHODOLOGIE de L'etude de L'audience OkokokDocument27 pagesCorrigé METHODOLOGIE de L'etude de L'audience Okokokgninlgninrinacklan100% (1)
- Publics Relations PDFDocument11 pagesPublics Relations PDFTéclaire BigerthPas encore d'évaluation
- Pfe VFDocument53 pagesPfe VFOumaimaPas encore d'évaluation
- Communication de Masse PDFDocument2 pagesCommunication de Masse PDFJackiePas encore d'évaluation
- These Beyon Luc Adolphe TIAO PDFDocument338 pagesThese Beyon Luc Adolphe TIAO PDFKevinPas encore d'évaluation
- Examen Relations Publiques Presse Par Alioune NDiayeDocument12 pagesExamen Relations Publiques Presse Par Alioune NDiayelittlebouddha100% (2)
- Communication Publicitaire PDFDocument2 pagesCommunication Publicitaire PDFStevePas encore d'évaluation
- Le Plan de CommunicationDocument7 pagesLe Plan de CommunicationBelhout AghilasPas encore d'évaluation
- Communication InstitutionnelleDocument2 pagesCommunication InstitutionnelleSoufiane SegPas encore d'évaluation
- Mémoire Marketing Des ONGDocument43 pagesMémoire Marketing Des ONGomariPas encore d'évaluation
- Rapport Evaluation IA AfriqueDocument82 pagesRapport Evaluation IA AfriqueHoussein AhmedPas encore d'évaluation
- Communication Institutionnelle PDFDocument16 pagesCommunication Institutionnelle PDFAlexandra YameogoPas encore d'évaluation
- Participation Des ONG À La Promotion Du Développement DurableDocument26 pagesParticipation Des ONG À La Promotion Du Développement DurableEmpire DigitalPas encore d'évaluation
- Mémoire PDFDocument95 pagesMémoire PDFhlel imenPas encore d'évaluation
- Derwich Oussama La Communication FinancièreDocument4 pagesDerwich Oussama La Communication FinancièreOussama DerwichPas encore d'évaluation
- Personal BrandingDocument42 pagesPersonal BrandingFadilah NdamPas encore d'évaluation
- Cash AssurancesDocument47 pagesCash Assurancesriad100% (1)
- Cellules CriseDocument122 pagesCellules CriseAl L'AlchimistePas encore d'évaluation
- MemoireDocument31 pagesMemoireKatia Benanoune100% (1)
- Medias Sociaux Et Responsabilité Sociale Une Relation en Construction PDFDocument3 pagesMedias Sociaux Et Responsabilité Sociale Une Relation en Construction PDFRisalaPas encore d'évaluation
- Comment Utiliser Les Réseaux Sociaux en Gestion de CriseDocument110 pagesComment Utiliser Les Réseaux Sociaux en Gestion de CriseSaid Begriche100% (1)
- Communicationorganisation 9056Document6 pagesCommunicationorganisation 9056Said BegrichePas encore d'évaluation
- Lentretien de Recherche Et Ses Conditions de RealDocument12 pagesLentretien de Recherche Et Ses Conditions de RealSaid BegrichePas encore d'évaluation
- Un Traité de Lexistence MoraleDocument10 pagesUn Traité de Lexistence MoraleSaid BegrichePas encore d'évaluation
- Crise Air FranceDocument9 pagesCrise Air FranceSaid BegrichePas encore d'évaluation
- L'impact de La Règlementation Prudentielle Internationales Sur Les Stratégies BancairesDocument268 pagesL'impact de La Règlementation Prudentielle Internationales Sur Les Stratégies Bancaireshatem83% (6)
- Note de La Banque de France Sur La Dette Étudiante AméricaineDocument12 pagesNote de La Banque de France Sur La Dette Étudiante AméricaineFT4118Pas encore d'évaluation
- Loren Goldner - LE CAPITAL FICTIF ET LA REPRODUCTION SOCIALE CONTRACTEE AUJOURD'HUIDocument20 pagesLoren Goldner - LE CAPITAL FICTIF ET LA REPRODUCTION SOCIALE CONTRACTEE AUJOURD'HUInopePas encore d'évaluation
- Finance InternationaleDocument53 pagesFinance InternationaleHajarLahrimPas encore d'évaluation
- La Communication InstitutionnelleDocument46 pagesLa Communication InstitutionnelleYASMEROPas encore d'évaluation
- Thème 1212 - Les Fluctuation ÉconomiquesDocument37 pagesThème 1212 - Les Fluctuation ÉconomiquesjaysesblogsPas encore d'évaluation
- Ic48 2Document36 pagesIc48 2GRADUATEPas encore d'évaluation
- Globalisation FinancièreDocument65 pagesGlobalisation FinancièreKamel Garfa0% (1)
- 2012arto0105 PDFDocument268 pages2012arto0105 PDFVivianelPas encore d'évaluation
- DROITdocxDocument10 pagesDROITdocxSara BouaklainePas encore d'évaluation
- La Communication Gouvernementale Camerounaise À L'épreuve de La Crise Anglophone.Document20 pagesLa Communication Gouvernementale Camerounaise À L'épreuve de La Crise Anglophone.SympliceB.MvondoPas encore d'évaluation
- Elements de Preparation Aux Concours de La Fonction Publique Maroc 2015-2016Document123 pagesElements de Preparation Aux Concours de La Fonction Publique Maroc 2015-2016Nihad NinaPas encore d'évaluation
- La Guerre FroideDocument30 pagesLa Guerre FroideSiMohamed Sadiki100% (1)
- Management de CrisesDocument14 pagesManagement de CrisesKawtar El Houti100% (1)
- Théorie de Portefeuille - 220212Document16 pagesThéorie de Portefeuille - 220212Lynda SyPas encore d'évaluation
- Groupe Ariel S. A. - Case SolutionDocument4 pagesGroupe Ariel S. A. - Case SolutionAnand0% (1)
- Répercussions de La Crise Du SubprimeDocument2 pagesRépercussions de La Crise Du SubprimeB.IPas encore d'évaluation
- Bac STMG 2015 - Histoire-GéographieDocument9 pagesBac STMG 2015 - Histoire-GéographieLe MondePas encore d'évaluation
- Cours HFDocument12 pagesCours HFDavid CanutoPas encore d'évaluation
- 53 C 7 Abca 2 F 0 C 1Document54 pages53 C 7 Abca 2 F 0 C 1JM KoffiPas encore d'évaluation
- Comment La Crise Étatsunienne de 1929 Est-Elle Devenue Une Dépression Économique Mondiale ?Document5 pagesComment La Crise Étatsunienne de 1929 Est-Elle Devenue Une Dépression Économique Mondiale ?olfaPas encore d'évaluation
- Sujets Bac SES ES Spé G1Document13 pagesSujets Bac SES ES Spé G1Anonymous pt601aHPas encore d'évaluation
- Flexibilisation de Regime de Change PDFDocument43 pagesFlexibilisation de Regime de Change PDFAbdelmalek BOUMDIRPas encore d'évaluation
- Crise Economique de 2008 2009Document11 pagesCrise Economique de 2008 2009Taghrout Mohamed100% (1)
- Dictature US - Camps de Concentration de La FEMA - Contrôle Population - Le Blog D' Eva, R-Sistons À La CriseDocument3 pagesDictature US - Camps de Concentration de La FEMA - Contrôle Population - Le Blog D' Eva, R-Sistons À La Criseem13freefrPas encore d'évaluation
- Management Risque Social 2Document9 pagesManagement Risque Social 2aout1126Pas encore d'évaluation
- La Communication de CriseDocument54 pagesLa Communication de CriseOverDoc100% (1)
- 1873Document3 pages1873ab2o100% (1)
- Gestion Du Risque de Crédit Dans La Banque Cas de CBAO, Groupe Attijari Wafa BankDocument108 pagesGestion Du Risque de Crédit Dans La Banque Cas de CBAO, Groupe Attijari Wafa Bankmogigi70% (20)
- Jeu de Ponzi Et Limite A La SpeculationDocument11 pagesJeu de Ponzi Et Limite A La SpeculationJosé Christian SIEHI100% (2)