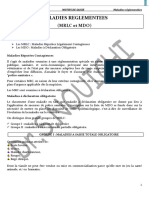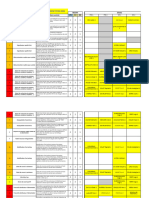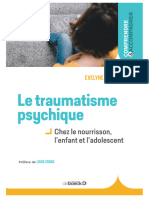Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
QR Tuberculose Bovine 12627 Cle027cad
Transféré par
MichelCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
QR Tuberculose Bovine 12627 Cle027cad
Transféré par
MichelDroits d'auteur :
Formats disponibles
Ministère de l’agriculture de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Direction générale de l’alimentation
29/06/2012
Questions - Réponses sur la tuberculose bovine
Qu’est ce que la tuberculose bovine ?
La tuberculose est une maladie contagieuse due à des bactéries qui sont plus ou moins adaptées à
certaines espèces. Il existe une souche bovine (Mycobacterium bovis), responsable de la tuberculose
bovine, qui peut être transmise à l’homme dans certaines conditions mais qui touche principalement
les bovins.
En France, plus de 99% des cas de tuberculose chez les humains sont dûs à la souche humaine de la
maladie (Mycobacterium tuberculosis).
Cette maladie est-elle présente en France ?
Depuis quelques années, les autorités sanitaires font face à une augmentation progressive du nombre
de cas qui est passé d’une cinquantaine à une centaine par an avec une concentration des cas dans
certaines zones localisées en Côte d’Or, en Dordogne, en Camargue et dans le Sud-Ouest. La
maladie s’est également développée chez certaines espèces d’animaux sauvages (sangliers, cerfs et
blaireaux), ce qui rend son éradication plus complexe.
Comment la maladie se transmet-elle aux animaux?
• Par inhalation de gouttelettes émises lors de la toux ou d'aérosols contaminés (lorsque les
bovins se reniflent de muffle à muffle par exemple).
• Par ingestion, inhalation ou léchage de matières contaminées : lait, eau d'abreuvement,
fourrage, pierres à lécher, etc.
• Certaines sécrétions comme le sperme ou l’urine peuvent également être contaminantes.
Comme la maladie évolue lentement, pendant des mois, voire des années, avant qu’elle ne tue un
animal atteint, celui-ci peut la transmettre à de nombreux autres animaux de l’élevage avant de
commencer à présenter des signes cliniques.
Comment les hommes se contaminent-ils ?
Les hommes, qui semblent moins sensibles que les bovins à cette souche de la bactérie, se
contaminent principalement par ingestion de produits contaminés (lait, viande mal cuite) dans les pays
où la prévalence de la maladie est importante ce qui n’est plus le cas de la France. La grande majorité
des cas humains détectés ces dernières années sont dus à la contamination à l’étranger par des
souches exotiques qui sévissent dans des pays où la maladie est mal contrôlée.
L’inhalation d’aérosols provenant de carcasses présentant des lésions importantes ou les coupures
avec des instruments tranchants ayant servi à l’inspection de carcasses présentant des lésions
importantes peut constituer une voie de contamination pour les personnels d’abattoirs et les
chasseurs pratiquant l’éviscération des carcasses infectées.
Quels sont les symptômes de la maladie chez l’animal ?
Les animaux infectés ne présentent pas, le plus souvent, de signes ou de symptômes
caractéristiques ; leur état général peut être altéré (maigreur, baisse de production) de façon plus ou
moins prononcée. Ce n’est qu’après leur mort (ou leur abattage) que peuvent être identifiées à
l’autopsie (ou au cours de l’inspection sanitaire) les lésions, de type abcès, évocatrices « signant »
l’action de Mycobacterium bovis.
Comment la maladie est-elle diagnostiquée ?
La méthode standard de détection de la tuberculose bovine, du vivant de l’animal est, comme chez
l’homme, le test cutané à la tuberculine, qui consiste à injecter par voie intradermique (tests
d’intradermotuberculination simple, IDS, ou d’intradermotuberculination comparative IDC)une petite
quantité d’allergène (extraits de mycobactéries) et à mesurer la réaction immunitaire éventuelle qui
révèle une sensibilisation antérieure à une mycobactérie. Ce diagnostic est peu spécifique (une
réaction positive n’est pas toujours due à la maladie) et il doit être complété par d’autre méthodes.
Récemment un test basé sur la mesure d’un peptide, l’interféron gamma, a été mis au point. Ce test
mesure in vitro le même phénomène que celui mesuré par le test cutané mais il est permet une
détection plus précoce et dans certaines conditions plus spécifique.
Aucun test sérologique n’est actuellement validé.
A la mort de l’animal, l’inspection de la carcasse, qui est systématique à l’abattoir, permet de détecter
la présence de lésions suspectes qui font l’objet d’examens complémentaires notamment la culture et
la PCR.
Le diagnostic définitif repose sur la culture de la bactérie en laboratoire, technique qui nécessite au
moins trois mois pour obtenir une réponse négative, la culture de Mycobacterium bovis étant
particulièrement lente, dans certains cas un diagnostic par analyse PCR permet de réduire le délai
d’obtention des résultats à environ une semaine.
Quelles précautions doivent-être prises pour éviter la transmission à l’homme ?
• A partir d’animaux
En règle générale, pour les personnes amenées à entrer en contact avec des animaux suspects
(issus de cheptels infectés ou des animaux sauvages présentant des abcès suspects), les règles
d’hygiène générales suivantes doivent être respectées :
- Se laver les mains (eau potable et savon) systématiquement :
o Après contact avec les animaux, les déchets ou les déjections animales.
o Avant les repas, les pauses, en fin de journée de travail.
- En cas de plaie : laver, savonner, puis rincer. Désinfecter et recouvrir d'un pansement imperméable,
en cas de signe de surinfection, consulter un médecin.
• A partir des aliments
Le risque de transmission au consommateur est tout d’abord maîtrisé par les mesures de sécurité
sanitaires des aliments mises en œuvre sous le contrôle de l’Etat :
- pour la viande, il s’agit de l’inspection systématique de salubrité des carcasses des espèces
sensibles mises sur le marché et qui permet de détecter les lésions et d’écarter la viande qui
présente un risque pour la santé publique,
- pour le lait, dont l’Anses a évalué en 2010 que le risque pour la santé publique en France était
négligeable, grâce au contrôle périodique des élevages livrant directement du lait cru pour la
consommation humaine et au traitement thermique du lait (pasteurisation) dans les troupeaux
Suspects.
- Pour les venaisons de gros gibier, un examen initial est rendu obligatoire pour toute carcasse qui
n’est pas consommée dans le cadre familial.
Lors de déplacements dans des pays où la maladie est mal ou peu contrôlée, les mesures suivantes
permettent de réduire les risques de contamination :
- Ne consommer que des produits au lait pasteurisé.
- Ne consommer que de la viande cuite à cœur à une température suffisante pour tuer les
bactéries (la bactérie est sensible à la chaleur humide à 121°)
Quelles sont les mesures de surveillance et de lutte existantes ?
Les mesures de surveillance et de lutte mises en œuvre sont le dépistage précoce au moyen d’un test
cutané sur les animaux du troupeau, selon des rythmes définis suivant le risque, et l’inspection
systématique des carcasses dans les abattoirs.
Les troupeaux suspects font l’objet de mesures de blocage parfois longues compte tenu des difficultés
techniques pour établir un diagnostic. L’assainissement des troupeaux infectés se fait par abattage
total ou partiel des animaux du troupeau infecté, qui doit être suivi d’un nettoyage-désinfection des
locaux.
Des mesures de surveillance de la faune sauvage sont également en place au plan national dans le
cadre du réseau de surveillance Sylvatub.
La présence de la maladie sur le territoire doit être déclarée à l’Organisation mondiale de la santé
animale (OIE) mais les cas n’ont pas à faire l’objet de déclaration systématique.
La vaccination est pratiquée en médecine humaine mais elle est interdite en France et dans le reste
de l’Union européenne chez les bovins : les vaccins à usage vétérinaire existants sont d’une efficacité
variable et ils entravent le diagnostic de la maladie et donc son éradication. Un certain nombre de
nouveaux vaccins candidats sont en cours d’essai, notamment pour la faune sauvage.
Le traitement des animaux par antibiotique est également interdit en France et dans le reste de l’Union
européenne pour des raisons de santé publique, car le traitement étant très long, il induirait des
risques de présence de résidus d’antibiotiques dans les produits animaux et des risques de sélection
de souches résistantes aux antibiotiques.
La DGAL a mis en place en novembre 2010 un plan d’action national afin de renforcer le dispositif de
surveillance. Ce plan prévoit notamment des actions de sensibilisation et de formation des éleveurs
dans certaines régions et l’intensification des mesures de surveillance et de lutte.
Un nouveau plan pluriannuel est mis en vigueur depuis mai 2012. Cette nouvelle version renforce
particulièrement les aspects concernant la faune sauvage, l’harmonisation des mesures de lutte sur le
territoire et le pilotage rapproché du plan.
Vous aimerez peut-être aussi
- Fiche BrucelloseDocument5 pagesFiche BrucellosedadygoodPas encore d'évaluation
- CandidoseDocument2 pagesCandidoseCamou Elevage IcamPas encore d'évaluation
- Cours QSA Infection Alimentaire M2Document55 pagesCours QSA Infection Alimentaire M2Ouiam OuiamPas encore d'évaluation
- Les Intoxications AlimentairesDocument9 pagesLes Intoxications AlimentairesPęrlã DìãmęntinãPas encore d'évaluation
- Conference1 2Document41 pagesConference1 2Abderrahim MzoughPas encore d'évaluation
- 1 - Le Statut SanitaireDocument4 pages1 - Le Statut SanitaireJTPas encore d'évaluation
- Brucelloses Animales PowerDocument52 pagesBrucelloses Animales PowerHouda 98Pas encore d'évaluation
- Les Maladies Épizootique Qui Ont Touchée L'algérie: Expose SurDocument9 pagesLes Maladies Épizootique Qui Ont Touchée L'algérie: Expose Surbekiri abderahmanePas encore d'évaluation
- Analyses Bacteriologiques AlimentairesDocument5 pagesAnalyses Bacteriologiques AlimentairesKenz L'Aïd100% (2)
- Fievre CharbonneuseDocument5 pagesFievre CharbonneuseMouhcine InstitutPas encore d'évaluation
- 04 Q-A-Rage-FrDocument6 pages04 Q-A-Rage-Frberami1009Pas encore d'évaluation
- BrucelloseDocument16 pagesBrucelloseAnonymous nzEFPlPvxJPas encore d'évaluation
- Tuberculose Bovine-Lors-Controle-Des-ViandesDocument22 pagesTuberculose Bovine-Lors-Controle-Des-Viandessv.abattoirsPas encore d'évaluation
- Trichinellose - OIEDocument6 pagesTrichinellose - OIEAlexandre Arenales TorresPas encore d'évaluation
- Moins D'antibiotiques À La Mise-Bas - 1633754641828Document3 pagesMoins D'antibiotiques À La Mise-Bas - 1633754641828Huguette LamegniPas encore d'évaluation
- Organisation Des Services Vétérinaires EN ALGERIEDocument5 pagesOrganisation Des Services Vétérinaires EN ALGERIERIHANI Mohamed100% (1)
- Paratuberculose Troupeaux Ovins Du Quebec - OQ - Ete - 2019Document2 pagesParatuberculose Troupeaux Ovins Du Quebec - OQ - Ete - 2019Abdoul Djalilou SoumanaPas encore d'évaluation
- Maladies de La Peau Version 26dec22 Partie II PDFDocument58 pagesMaladies de La Peau Version 26dec22 Partie II PDFchakibparis15Pas encore d'évaluation
- Urgence Veterinaire GeneveDocument5 pagesUrgence Veterinaire Geneveveterinairegeneve3Pas encore d'évaluation
- Maitriser La Diarrhée Des VeauxDocument4 pagesMaitriser La Diarrhée Des VeauxSARAH SAOIABIPas encore d'évaluation
- Laboratoire NationalDocument17 pagesLaboratoire Nationalbagui àbdoulPas encore d'évaluation
- 11 - BrucellaDocument10 pages11 - BrucellaMalki kawtarPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument10 pagesIntroductionKally Saleh Togou BarkaïPas encore d'évaluation
- Power Pointe MOIDocument30 pagesPower Pointe MOIHouda 98Pas encore d'évaluation
- Jali LLLLLDocument9 pagesJali LLLLLisma hanPas encore d'évaluation
- La Gestion Des Animaux Et Des TroupeauxDocument29 pagesLa Gestion Des Animaux Et Des TroupeauxErnst FlorivalPas encore d'évaluation
- BIORISK2016SA0077Fi PDFDocument4 pagesBIORISK2016SA0077Fi PDFNõúr ËlhőuĐãPas encore d'évaluation
- BIORISK2016 SA0081 FiDocument4 pagesBIORISK2016 SA0081 Fimelalami947Pas encore d'évaluation
- Maladies ReglémentéesDocument18 pagesMaladies ReglémentéesSihem NouichiPas encore d'évaluation
- 05-La Leptospirose v2bDocument14 pages05-La Leptospirose v2bClaude DanglotPas encore d'évaluation
- Coqueluche PDFDocument9 pagesCoqueluche PDFSafa BouhPas encore d'évaluation
- Les Colibacilloses Des LapinsDocument3 pagesLes Colibacilloses Des Lapinsmamadoumacodoundione2018Pas encore d'évaluation
- 622 Toxi Infections AlimentairesDocument10 pages622 Toxi Infections Alimentaires02021989safi100% (1)
- Nous Sommes Plusieurs Milliers de Personnes À Souffrir Chaque Année en France DDocument8 pagesNous Sommes Plusieurs Milliers de Personnes À Souffrir Chaque Année en France DBenmerad SaraPas encore d'évaluation
- BIORISK2016 SA0078 FiDocument4 pagesBIORISK2016 SA0078 FiHamou ChabourPas encore d'évaluation
- ColibacillosesDocument5 pagesColibacillosesIancu SebastianPas encore d'évaluation
- IntoxicationDocument9 pagesIntoxicationKenz L'Aïd100% (1)
- F2 StaphDocument2 pagesF2 StaphDado MiriPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument9 pagesIntroductionBldjl HichemPas encore d'évaluation
- Pathologie: Chapitre 5Document33 pagesPathologie: Chapitre 5solitokekoffi9Pas encore d'évaluation
- Diarrhee Virale Bovine BVD MDDocument4 pagesDiarrhee Virale Bovine BVD MDhasselhanPas encore d'évaluation
- Le Genre Campylobacter Et Campylobacter Thermo-TolerantsDocument21 pagesLe Genre Campylobacter Et Campylobacter Thermo-Tolerantsstagfire17Pas encore d'évaluation
- SVT - La ToxoplasmoseDocument5 pagesSVT - La Toxoplasmosesara.collotPas encore d'évaluation
- ViandeDocument15 pagesViandeSabrine YaakoubiPas encore d'évaluation
- ViandeDocument15 pagesViandenaw67% (3)
- Histoire de L'alimentation AnimaleDocument260 pagesHistoire de L'alimentation AnimaleNdiaye100% (1)
- ALIMENTATIOn Et Microbiote Sain Contre MALADIESDocument17 pagesALIMENTATIOn Et Microbiote Sain Contre MALADIESANCHISI100% (1)
- Toxi Infection Alim CollDocument3 pagesToxi Infection Alim CollÉmna GhribiPas encore d'évaluation
- Les Facteurs Responsables Des Toxi-Infections AlimentairesDocument18 pagesLes Facteurs Responsables Des Toxi-Infections AlimentairesBasma BoulmalPas encore d'évaluation
- EPIDEMIOLOGIEDocument5 pagesEPIDEMIOLOGIELAALAM MOHAMMED AMINEPas encore d'évaluation
- Sécurité Sanitaire Des AlimentsDocument12 pagesSécurité Sanitaire Des Alimentslollipop lollipopPas encore d'évaluation
- ViandeDocument15 pagesViandeIlyasse Ait Haddou100% (1)
- CyclosporoseDocument3 pagesCyclosporosevague2000Pas encore d'évaluation
- Que Sont Les StaphylocoquesDocument3 pagesQue Sont Les StaphylocoquesDado MiriPas encore d'évaluation
- Intoxinations Et Toxi Infections Alimentaires 6Document6 pagesIntoxinations Et Toxi Infections Alimentaires 6Stambouli MoniaPas encore d'évaluation
- Les Mycotoxines ToxDocument17 pagesLes Mycotoxines ToxDiana Paierele0% (1)
- Article Djebir Ras-S-A-Numero-4-Janvier-2020Document6 pagesArticle Djebir Ras-S-A-Numero-4-Janvier-2020قصوري سميرPas encore d'évaluation
- Intoxication Paralysante Par Les MollusquesDocument6 pagesIntoxication Paralysante Par Les MollusquesDINO ECOPas encore d'évaluation
- Mesures Diététiques Anti- Inflammatoires et Anti- NéoplasiquesD'EverandMesures Diététiques Anti- Inflammatoires et Anti- NéoplasiquesPas encore d'évaluation
- Les maladies de l'abeille: Éviter, Détecter, Identifier, SoignerD'EverandLes maladies de l'abeille: Éviter, Détecter, Identifier, SoignerÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Titre: TheseDocument120 pagesTitre: TheseYacouba DembelePas encore d'évaluation
- Pfe EpsDocument1 pagePfe Epsacademy infoPas encore d'évaluation
- NovalginDocument2 pagesNovalginakpecedrichermannPas encore d'évaluation
- Serie N1Document3 pagesSerie N1YASSINE 18Pas encore d'évaluation
- LEROUX - SALES - Examen Langue-DiabeteDocument53 pagesLEROUX - SALES - Examen Langue-DiabeteMélody Nelson100% (1)
- Loi 21 - Yvan PhaneufDocument4 pagesLoi 21 - Yvan PhaneufLazare KPLOYAPas encore d'évaluation
- Voeux ElevesDocument9 pagesVoeux Eleveslaban.keka07Pas encore d'évaluation
- Min 31 OctDocument27 pagesMin 31 Octyoussef elmoudenPas encore d'évaluation
- 11-Offres de Soin Et DemocratisationDocument24 pages11-Offres de Soin Et DemocratisationN'DRI Yao GaelPas encore d'évaluation
- PassSanitaire01 01 2022 09 - 56Document1 pagePassSanitaire01 01 2022 09 - 56Yassine DhajiPas encore d'évaluation
- TD1 ProbaDocument2 pagesTD1 ProbaZayneb MessaoudiPas encore d'évaluation
- Psy - Le Traumatisme Psychique. Chez Le Nourrisson, L'enfant Et L'adolescentDocument235 pagesPsy - Le Traumatisme Psychique. Chez Le Nourrisson, L'enfant Et L'adolescentboualem.benhamouda100% (1)
- Comptences-Éducation TherapeutiqueDocument2 pagesComptences-Éducation TherapeutiqueVertigohPas encore d'évaluation
- 1 - Guide Cellule Ecoute (Final)Document24 pages1 - Guide Cellule Ecoute (Final)Eladdouli Jamal100% (1)
- Hémorragies Du Premier Trimestre de GrossesseDocument28 pagesHémorragies Du Premier Trimestre de GrossesseDENISA100% (5)
- FT Cqi 1Document2 pagesFT Cqi 1Delondon AlasckoPas encore d'évaluation
- ANTHROPOMETRIE (PB de L'enfant)Document10 pagesANTHROPOMETRIE (PB de L'enfant)coulibaly NadinePas encore d'évaluation
- 20.05.secret Médical 2eme PartieDocument6 pages20.05.secret Médical 2eme PartieKazuhaPas encore d'évaluation
- Bref PDFDocument4 pagesBref PDFAymen DabboussiPas encore d'évaluation
- Le Rôle de La Fenêtre de JOHARI Dans Lefficacité de La CommunicationDocument13 pagesLe Rôle de La Fenêtre de JOHARI Dans Lefficacité de La CommunicationFATIMA EL OMARIPas encore d'évaluation
- Article2 d177Document3 pagesArticle2 d177Hanina mamiPas encore d'évaluation
- Schistosomes Et SchistosomiasesDocument13 pagesSchistosomes Et Schistosomiasesmdlmdl100% (1)
- Prevention Risques Psychosociaux Intervention AlixioDocument20 pagesPrevention Risques Psychosociaux Intervention AlixioaliovitchPas encore d'évaluation
- Cours TACQ S1 2014 Assurance QualiteDocument346 pagesCours TACQ S1 2014 Assurance QualiteYoussefPas encore d'évaluation
- Bio20201226 C01226B1117 MesanalysesDocument3 pagesBio20201226 C01226B1117 MesanalysesMathieu 777Pas encore d'évaluation
- Femme Désirée, Femme Désirante-2011Document162 pagesFemme Désirée, Femme Désirante-2011Sinem ÖzenPas encore d'évaluation
- Demande Dexemption DemandeDocument2 pagesDemande Dexemption DemandeScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Item 163 Leucemies Lymphoïdes Chroniques PDFDocument1 pageItem 163 Leucemies Lymphoïdes Chroniques PDFAmine DounanePas encore d'évaluation
- Habilitation BacteriologieDocument2 pagesHabilitation BacteriologieToto FollyPas encore d'évaluation