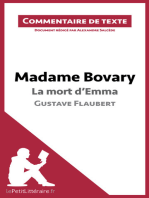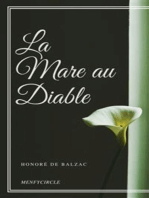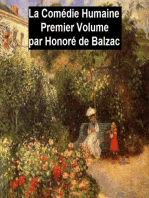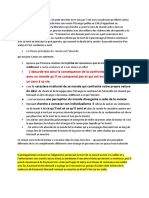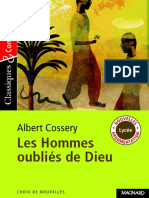Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Farjallah Haïk Et Albert Camus
Transféré par
Gérard BejjaniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Farjallah Haïk Et Albert Camus
Transféré par
Gérard BejjaniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Farjallah Haïk et Albert Camus
Pr Gérard BEJANI
Texte lu lors d’une réunion autour de Farjallah Haïk, à Beit Chabeb
« Nous portons en nous trop de choses dont nous ne voulons pas ».
« Nous portons » : la formule est claire, elle renvoie à Sisyphe qui « porte », depuis les
Enfers, le rocher dont il ne veut pas, cette « pierre » qu’il regarde, comme dit Camus,
« dévaler en quelques instants vers ce monde inférieur dont il faudra la remonter vers les
sommets ». Mais ce n’est pas de Sisyphe qu’il s’agit ici. « Nous portons », « nous autres,
Orientaux », se dépêche de préciser Farjallah Haïk dès la première page de son Envers de
Caïn. C’est en fait Basile le « bâtard » qui écrit ces mots à Chadia au début du roman.
Basile le bâtard. Basile, l’avatar de Caïn ou de Sisyphe, le parallélisme s’impose entre les
deux suppliciés de la Bible et de la mythologie. Tout comme entre leurs auteurs.
Rien d’étonnant donc que mon propos retrace une succincte comparaison entre les
deux écrivains, nés sur la Méditerranée, l’un en Afrique du Nord, l’autre dans ce village où
nous sommes, et qu’il appelle son « nid d’hirondelles » d’où il puise cette « puissance »
que lui reconnaît son confrère. Car, pour Haïk, « l’homme est mystiquement attaché au
sol » et « quand il perd son contact avec le sol, il perd aussi sa force ». Rien d’étonnant, en
effet, dans ce rapprochement puisque Haïk dédie L’Envers de Caïn à Camus et que celui-ci,
alors directeur de la collection « Espoir », lui répond dans une lettre pleine d’admiration,
datée du 8 mai 1955. Je ne parlerai donc que de L’Envers de Caïn puisque c’est autour de
ce roman que se confirme l’estime mutuelle entre Farjallah Haïk et Albert Camus et, faute
de temps, je ne ferai qu’esquisser des pistes de comparaison entre les deux auteurs.
Premier élément de comparaison : le type de personnage sur la scène romanesque des
deux auteurs. Ce personnage, on l’appellera « l’étranger » pour reprendre le titre du
roman le plus lu d’Albert Camus. Étranger non seulement parce qu’il ne pleure pas à
l’enterrement de sa mère et qu’il reste en marge des convenances sociales, ou encore
1
parce qu’il se parle seul dans un bar d’Amsterdam, le Mexico-City où il dénonce la
culpabilité universelle, mais parce qu’il est, au sens romantique du terme, un inadapté au
monde. Comme Caligula, qui a « besoin de la lune, de quelque chose de dément peut-être
mais qui ne soit pas de ce monde », comme Jean-Baptiste Clamence qui « clame » seul
dans le désert, Basile et Lazare, les deux héros de L’Envers de Caïn, sont eux aussi des
albatros exilés, des hommes du « caniveau », des « fruits pourris », illégitimes. Basile, qui
se définit comme « l’ivraie de l’Évangile », a la sensation d’avoir toujours « des épines
dans le derrière », ou encore le sentiment que « la terre tout entière » est « un lieu de
châtiment ». Lazare, son frère adoptif, alors qu’en joueur virtuose il rejoint la fanfare de
l’orphelinat, « trébuche sur une pierre et tombe à plat ventre » au moment de sa
première sortie. On comprend le sens symbolique de cette chute dont Camus fait
d’ailleurs le titre de son célèbre récit à une voix : Lazare tombe en jouant de la musique,
comme s’il lui était impossible d’être en harmonie avec le céleste, le pur. Il est une fausse
note dans l’harmonie du monde. Il tombe au moment où les yeux se braquent sur lui, où
le « troupeau » humain impitoyable le transforme en un monstre, à cause de sa
différence, l’enferme dans le regard des préjugés, lui donne le statut de l’être dangereux
pour l’intérêt public. C’est alors Basile qui va exprimer, pour lui, ou plutôt contre l’autisme
de son frère, contre le mutisme d’un Meursault, son défi à cette volonté cruelle des
hommes de les « tenir en marge comme des bêtes malfaisantes ».
On en arrive ainsi au deuxième élément de comparaison : la révolte dans l’action, la
transgression, ou encore le besoin métaphysique de saisir sa vie comme un destin. Les
personnages de Camus et de Haïk correspondent ainsi à la définition du héros tragique
selon Lucien Goldmann, celui qui ne se contente pas du plus ou moins, du monde relatif,
mais qui est soit dans le tout soit dans le rien. Pour Camus, le roman offre des
personnages qui nous ressemblent à cette différence près qu’ils « courent jusqu’au bout
de leur destin » et Haïk, définissant son œuvre, affirme : « Ma ligne de conduite générale
depuis que j’existe et depuis que j’écris est la tentation de l’Absolu ». Même s’il faut
2
passer par la transgression la plus scandaleuse, s’il faut se faire criminel ou hors la loi :
Meursault tue, il est responsable d’un arabicide, d’un matricide même selon ses juges,
Clamence tue aussi à sa manière ou laisse mourir puisqu’il assiste, indifférent, à la chute
d’une ombre dans la Seine, une noyade ou un suicide que ses yeux lâches et veules font
semblant de ne pas avoir remarqués, Caligula assassine impunément, la peste répand la
terreur à Oran et fauche les vivants l’un après l’autre. Dans L’Envers de Caïn, Lazare
s’exerce lui aussi au crime en tuant d’abord l’oiseau, le prolongement symbolique de
Basile parce qu’il ne supporte pas de le voir enfermé dans sa cage. Pour Lazare, Basile ne
peut qu’incarner son rêve libérateur, la puissance de l’action, de l’aventure, de la révolte
pour prendre en charge son destin. Puis Lazare tue Nausicaa, la maîtresse de Basile,
l’homicide se déroule dans une « inconscience totale ». Basile ne trouve alors d’autre
issue que de tuer son frère, parce que, dit-il, « seule la mort pourra sceller (leur)
fraternité », la mort « comme la grande matrice de l’univers ». « Nous vivrons peut-être
mieux de l’autre côté », lui dit-il d’une voix calme en le serrant contre lui. Le fratricide
devient l’unique moyen de recomposer l’unité du Moi, de se rallier à son frère vertueux, à
sa part de lumière.
Voici le paradoxe de ce troisième élément de comparaison : dans le fratricide, dans la
chute, en prison comme aux Enfers, la transcendance est possible. Les deux œuvres de
Camus et de Haïk, subversives et tragiques, placées sous un ciel gris et sans colombe,
comme celui que décrit Clamence au-dessus de La Hollande, sont en même temps et
paradoxalement purificatrices, elles permettent une catharsis par le mal et par la chute.
Elles sont « correctrices » au sens où l’entend Camus pour qui « le monde romanesque
n’est que la correction de ce monde-ci ». Pour Haïk, « on s’accomplit par le crime tout
aussi bien que par la vertu » car « vivre son crime ou sa vertu, c’est également affronter
son destin ». C’est surtout « revenir au Tout par cette dilatation de nous-mêmes ». Tout le
parcours de Basile aura été une tentative de passer de la division à l’unité, de dépasser
donc la fracture première, la séparation d’avec la mère, d’avec la terre où nous sommes
3
censés vivre, d’avec le frère comme allégorie de toute la fratrie humaine. L’homme est
certes une « épave », mais une épave « où brasillent encore bien des vertus humaines ».
Car « plus l’homme descend, plus il devient grand » chuchote Basile à son frérot. Le salut
est dans cette acceptation de notre part d’ombre, de la « bête qui nous rabaisse au-
dessous de nous-mêmes pour nous affirmer. » La vertu consiste dans le fait de tirer quatre
fois sur un corps inerte comme l’a fait Meursault, elle réside dans le fait de porter sa
pierre comme Sisyphe, d’assumer sa démence comme Caligula, de surmonter sa peur, de
tenter l’Absolu. Dans cette « soif de départ qui », dit Basile, « n’a jamais cessé de (le)
ronger », tout comme Lazare qui « poursuivait au fond de lui (on) ne sai(t) quel rêve
lointain. »
La vertu consiste, oui, à porter sa pierre. Sa pierre ou sa croix, car aussi bien Haïk que
Camus ont leurs nuits de Gethsémani et leurs matins de rédemption. Même si Albert
Camus est agnostique et Haïk anticlérical, même si Meursault regarde indifféremment le
prêtre venu lui « pardonner ses fautes » dans sa cellule et si Basile a horreur des leçons
de catéchisme à l’Orphelinat, même si donc les deux auteurs n’ont jamais eu de la
sympathie pour les hommes de religion ou les « sœurs à l’haleine fétide » qui veulent
nous faire « vivre en grappes », nous conduire comme un troupeau. Il n’en demeure pas
moins que Camus comme Haïk « portent » au monde, dans la pierre ou la croix, leur
demande d’amour insatiable, et avec elle, une leçon de foi, de bonheur et d’espoir : « Il
faut imaginer Sisyphe heureux », bien sûr, car, répond Haïk comme en écho, « l’homme
fataliste est plus ouvert à l’espoir qu’on ne le pense ». Et lui certainement plus ouvert à
Dieu qu’il ne le pense, surtout quand il écrit : « Le royaume de Dieu est à tous. Nous y
pénètrerons tous nus comme au jour de notre naissance. »
Vous aimerez peut-être aussi
- L'HôteDocument6 pagesL'HôteAndreea CerneaPas encore d'évaluation
- Erasme - Eloge de La FolieDocument95 pagesErasme - Eloge de La Foliecarlo100% (1)
- Madame Bovary - La mort d'Emma - Gustave Flaubert (Commentaire de texte): Commentaire et Analyse de texteD'EverandMadame Bovary - La mort d'Emma - Gustave Flaubert (Commentaire de texte): Commentaire et Analyse de textePas encore d'évaluation
- Martinez-Gros GMG L'Amour-Trace Réflexions Sur Le Collier de La Colombe PDFDocument47 pagesMartinez-Gros GMG L'Amour-Trace Réflexions Sur Le Collier de La Colombe PDFsebastiengarnier5751Pas encore d'évaluation
- Jean Grenier de L$27intime Au SecretDocument12 pagesJean Grenier de L$27intime Au SecretGennaro BasilePas encore d'évaluation
- Biographie Albert Camus FRDocument3 pagesBiographie Albert Camus FRlucia100% (3)
- Le massacre des amazones: études critiques sur deux cents bas-bleus contemporainsD'EverandLe massacre des amazones: études critiques sur deux cents bas-bleus contemporainsPas encore d'évaluation
- Tremblement de Bataille - Philippe Sollers LEIDO (2002)Document4 pagesTremblement de Bataille - Philippe Sollers LEIDO (2002)Diego Luis SanrománPas encore d'évaluation
- Joseph Majault - Camus - Révolte Et LibertéDocument168 pagesJoseph Majault - Camus - Révolte Et LibertéMarcelo CordeiroPas encore d'évaluation
- Didier, Béatrice - Introduction À Madame BovaryDocument16 pagesDidier, Béatrice - Introduction À Madame BovaryNicolas MasvaleixPas encore d'évaluation
- La Metamorphose - Kafka FranzDocument87 pagesLa Metamorphose - Kafka FranzonzePas encore d'évaluation
- Folie de VoirDocument65 pagesFolie de VoirAlessandra FrancescaPas encore d'évaluation
- Salammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandSalammbo de Gustave Flaubert: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- 1re Francais Charles Baudelaire Les Fleurs Du Mal Alchimie PoetiqueDocument3 pages1re Francais Charles Baudelaire Les Fleurs Du Mal Alchimie PoetiqueYasmine El AlamiPas encore d'évaluation
- Balzac Et La Comédie HumaineDocument23 pagesBalzac Et La Comédie Humainebeebac2009Pas encore d'évaluation
- Le Desespere - Leon Bloy - 11319Document1 262 pagesLe Desespere - Leon Bloy - 11319Achouri AtefPas encore d'évaluation
- L'Aventure Ambiguë - WikipédiaDocument3 pagesL'Aventure Ambiguë - WikipédiaAïda MillogoPas encore d'évaluation
- Mishima Ou La Vision Du Vide by Yourcenar, MargueriteDocument74 pagesMishima Ou La Vision Du Vide by Yourcenar, MargueriteYes no100% (1)
- Jean-Claude Lebensztejn, Seuil (Notes Sur Kafka, 1), "Vacarme", N. 42, Hiver 2008.Document4 pagesJean-Claude Lebensztejn, Seuil (Notes Sur Kafka, 1), "Vacarme", N. 42, Hiver 2008.Enrico CamporesiPas encore d'évaluation
- Le Vide Dans Le Theatre CamusienDocument12 pagesLe Vide Dans Le Theatre CamusienAlberto Herrera PinoPas encore d'évaluation
- 1reT-Texte3-La Vieille Et Les Deux Servantes-ExplicationDocument3 pages1reT-Texte3-La Vieille Et Les Deux Servantes-Explicationvictor.cisloniePas encore d'évaluation
- Albert Camus: Bibliographie SélectiveDocument14 pagesAlbert Camus: Bibliographie SélectiveFina OkomboPas encore d'évaluation
- SArrasine de Balzac Une Poétique de ContresensDocument13 pagesSArrasine de Balzac Une Poétique de Contresenskamal achikePas encore d'évaluation
- Albert Camus Le Mythe de Sisyphe Resume Personnages Et AnalyseDocument6 pagesAlbert Camus Le Mythe de Sisyphe Resume Personnages Et AnalyseAboubacar IbrahimPas encore d'évaluation
- Grand Entretien (LITTERATURE)Document10 pagesGrand Entretien (LITTERATURE)Vernes WuteziPas encore d'évaluation
- BalzacDocument3 pagesBalzacLessica3Pas encore d'évaluation
- Commentaire LectriceDocument3 pagesCommentaire LectriceSiham BouhaPas encore d'évaluation
- Cinquieme Partie Dernier ChapitreDocument2 pagesCinquieme Partie Dernier ChapitreCracana RoxanaPas encore d'évaluation
- Bibliographie Chammam Part 6Document3 pagesBibliographie Chammam Part 6hownowproPas encore d'évaluation
- 10 Poèmes Des Fleurs Du MalDocument3 pages10 Poèmes Des Fleurs Du MalAndréane VillandPas encore d'évaluation
- Résumé de CaligulaDocument3 pagesRésumé de CaligulaSandra HulecPas encore d'évaluation
- Carmen de Prosper Mérimée (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreD'EverandCarmen de Prosper Mérimée (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- PleinsFeux SapphoDocument22 pagesPleinsFeux SapphoRonney el-GemayelPas encore d'évaluation
- 915 Baudelaire La GeanteDocument4 pages915 Baudelaire La GeanteNadia El HnaouiPas encore d'évaluation
- Michel Butor Au Feu Des PagesDocument8 pagesMichel Butor Au Feu Des PagesraymondnomyarPas encore d'évaluation
- MadameBovary (GustaveFlaubert) (Z Lib - Org)Document451 pagesMadameBovary (GustaveFlaubert) (Z Lib - Org)cecilePas encore d'évaluation
- Voulet Chanoine - OBS0611 - 19760726 - 049Document1 pageVoulet Chanoine - OBS0611 - 19760726 - 049Yves MonteilPas encore d'évaluation
- Le Cousin Pons d'Honoré de Balzac: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandLe Cousin Pons d'Honoré de Balzac: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- L'Exil Et Le Royaume D'albert Camus. L'Algerie Comme Chair de La PoesieDocument10 pagesL'Exil Et Le Royaume D'albert Camus. L'Algerie Comme Chair de La Poesienadina.iacob7168Pas encore d'évaluation
- BALZACDocument2 pagesBALZACAntonio PetrafesaPas encore d'évaluation
- La comédie humaine volume I — Scènes de la vie privée tome ID'EverandLa comédie humaine volume I — Scènes de la vie privée tome IÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Saut Du Tremplin - Commentaire ComposéDocument3 pagesSaut Du Tremplin - Commentaire ComposéAlliance ScolairePas encore d'évaluation
- Albert Beguin - Balzac-Lu-Et-ReluDocument108 pagesAlbert Beguin - Balzac-Lu-Et-ReluLiliana OnucPas encore d'évaluation
- Joseph Delorme Ou Les Fleurs Du Mal de La Veille PDFDocument16 pagesJoseph Delorme Ou Les Fleurs Du Mal de La Veille PDFFrédéric DautremerPas encore d'évaluation
- LL QuasimodoDocument2 pagesLL QuasimodoCatherine GarnierPas encore d'évaluation
- Cinq Romanciers Nord-Américains Face Aux TénèbresDocument14 pagesCinq Romanciers Nord-Américains Face Aux TénèbresJuan AsensioPas encore d'évaluation
- La Femme Manquée 1 2Document11 pagesLa Femme Manquée 1 2Ibayatou DialloPas encore d'évaluation
- Gustave Flaubert WordDocument6 pagesGustave Flaubert WordBalan MirelaPas encore d'évaluation
- Itineraires 2147Document10 pagesItineraires 2147Hamza٨٣٩٣Pas encore d'évaluation
- Oeuvres de Arthur Rimbaud: Vers et proses: Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon; poèmes retrouvésD'EverandOeuvres de Arthur Rimbaud: Vers et proses: Revues sur les manuscrits originaux et les premières éditions mises en ordre et annotées par Paterne Berrichon; poèmes retrouvésPas encore d'évaluation
- Naissance de L'Odyssée LADocument7 pagesNaissance de L'Odyssée LAGérard BejjaniPas encore d'évaluation
- Esther - PlanDocument3 pagesEsther - PlanGérard BejjaniPas encore d'évaluation
- 12 Octobre 2019 - Il N'y A Que Les Femmes Qui Savent AimerDocument10 pages12 Octobre 2019 - Il N'y A Que Les Femmes Qui Savent AimerGérard BejjaniPas encore d'évaluation
- Liban Messages Pour Un PaysDocument3 pagesLiban Messages Pour Un PaysGérard BejjaniPas encore d'évaluation
- Albert Camus Le Mythe de Sisyphe Resume Personnages Et AnalyseDocument6 pagesAlbert Camus Le Mythe de Sisyphe Resume Personnages Et AnalyseAboubacar IbrahimPas encore d'évaluation
- Controle II LitteratureDocument13 pagesControle II LitteratureJoel CruzPas encore d'évaluation
- L'etangerDocument2 pagesL'etangeranon_976351358Pas encore d'évaluation
- Albert Camus EXTRAIT L ETRANGERDocument1 pageAlbert Camus EXTRAIT L ETRANGERPaul Henry PayenPas encore d'évaluation
- L'Ordre Libertaire - La Vie Phil - Michel OnfrayDocument835 pagesL'Ordre Libertaire - La Vie Phil - Michel OnfrayCarly Davis100% (3)
- Lecture Sans TitreDocument193 pagesLecture Sans TitreAziz mohamed100% (3)
- L Étranger. Fiche Pédagogique. Classiques. L Étranger - Albert Camus 1. Les RéférencesDocument10 pagesL Étranger. Fiche Pédagogique. Classiques. L Étranger - Albert Camus 1. Les RéférencesKillmeSarah KmsPas encore d'évaluation
- Catalogue 26Document107 pagesCatalogue 26waldennoticesPas encore d'évaluation
- Lettres Ami AllemandDocument39 pagesLettres Ami AllemandmakiavelliPas encore d'évaluation
- Lhomme RevolteDocument9 pagesLhomme RevolteVictoria MaximencoPas encore d'évaluation
- HLP - Question Interprétation CamusDocument2 pagesHLP - Question Interprétation CamuslyblancPas encore d'évaluation
- L'Homme Révolté - Albert CamusDocument10 pagesL'Homme Révolté - Albert CamusRol RaphaëlPas encore d'évaluation
- Teaching Franceza BDocument12 pagesTeaching Franceza BLarisuk90Pas encore d'évaluation
- Sartre - Nécrologie de Camus (1960)Document2 pagesSartre - Nécrologie de Camus (1960)RaphaelPas encore d'évaluation
- Séquence 1 L'homme Et Son Rapport Au Monde Doc ProfDocument8 pagesSéquence 1 L'homme Et Son Rapport Au Monde Doc ProfhafidPas encore d'évaluation
- Le Suicide de Lespèce (French Edition) (Jean-David Zeitoun)Document229 pagesLe Suicide de Lespèce (French Edition) (Jean-David Zeitoun)ahcenePas encore d'évaluation
- Le Premier Homme DAlbert Camus Roman AuDocument18 pagesLe Premier Homme DAlbert Camus Roman AuBianca Lorenza RitaPas encore d'évaluation
- Littérature Resume de La ChuteDocument2 pagesLittérature Resume de La Chutelibrexport2476Pas encore d'évaluation
- Les Hommes Oubliés de Dieu - Cossery AlbertDocument92 pagesLes Hommes Oubliés de Dieu - Cossery Albertmehdi ber0% (1)
- Francais CDocument6 pagesFrancais CAziz ChaouchPas encore d'évaluation
- Rachida Hammouche Bey Omar Camus Feraoun en FrancésDocument28 pagesRachida Hammouche Bey Omar Camus Feraoun en FrancésGaïa Ait AghilasPas encore d'évaluation
- Pierre Michel, Mirbeau Et Camus - Éthique Et AmbiguïtéDocument13 pagesPierre Michel, Mirbeau Et Camus - Éthique Et AmbiguïtéAnonymous 5r2Qv8aonf100% (1)
- Question Sur L'absurde de CamusDocument3 pagesQuestion Sur L'absurde de CamusRodney ElmirePas encore d'évaluation
- MON Fascicule Litteraire TERMINALEDocument61 pagesMON Fascicule Litteraire TERMINALEAblaye DiaPas encore d'évaluation
- Sa Réception Du Prix Nobel de Littérature Le 10 Décembre 1957, Discours Sur L'idée Que Camus Se Fait de Son Art Et Du Rôle de L'écrivainDocument6 pagesSa Réception Du Prix Nobel de Littérature Le 10 Décembre 1957, Discours Sur L'idée Que Camus Se Fait de Son Art Et Du Rôle de L'écrivainFrédéric SingnibePas encore d'évaluation
- Camus Rejet de DieuDocument11 pagesCamus Rejet de DieubrahmiPas encore d'évaluation
- Albert Camus Et Sa Pensee PDFDocument319 pagesAlbert Camus Et Sa Pensee PDFrevedepierrePas encore d'évaluation