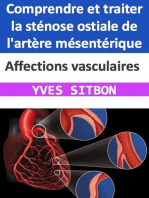Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Coro Et ATL Par Voie Radiale
Coro Et ATL Par Voie Radiale
Transféré par
belaouchi icvtCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Coro Et ATL Par Voie Radiale
Coro Et ATL Par Voie Radiale
Transféré par
belaouchi icvtDroits d'auteur :
Formats disponibles
mise au point
Les coronarographies
et les angioplasties coronaires par
voie radiale : l’approche de choix ?
La voie radiale en cardiologie interventionnelle est utilisée de
façon très hétérogène à travers le monde. Pourtant, cette ap-
proche diminue significativement les complications vasculaires
et hémorragiques et améliore le confort des patients. Tous les
sous-groupes de patients bénéficient de cette approche, par-
ticulièrement les patients avec un syndrome coronarien aigu
où le risque de saignement est majoré en raison d’une anti-
Rev Med Suisse 2011 ; 7 : 528-32
coagulation et d’une antiagrégation agressives. La voie radiale
nécessite une courbe d’apprentissage plus longue que la voie
C. Frangos Noble fémorale en rapport avec des difficultés techniques spécifi-
E. De Benedetti ques qui sont souvent surmontées avec l’expérience. En raison
de ses bénéfices indiscutables, la voie radiale devrait devenir
S. Noble l’approche de choix aussi bien pour la coronarographie diag-
nostique que pour les angioplasties coronaires.
Drs Caroline Frangos Noble
et Edoardo De Benedetti
Département cardiovasculaire
Hôpital de La Tour
Avenue J.-D. Maillard, 3 introduction
1217 Meyrin (Genève)
c.frangos@bluewin.ch Les complications vasculaires et les saignements associés à
edb@latour.ch l’accès vasculaire fémoral représentent une cause importante
Dr Stéphane Noble de morbidité et de mortalité, spécialement chez les patients
Service de cardiologie bénéficiant d’une angioplastie coronaire. Théoriquement, la
Département des spécialités
de médecine voie radiale diminue les complications vasculaires car l’artère
HUG, 1211 Genève 14 radiale est aisément compressible, ce qui permet ainsi de
stephane.noble@hcuge.ch
contrôler facilement les saignements et, par conséquent, de
réduire les complications hémorragiques. Ces dernières années,
une abondante littérature confirme les avantages théoriques
de cette technique. Nous vous proposons une mise au point
Transradial approach for coronary sur la voie radiale considérée par certains opérateurs comme une simple alterna
angiography and angioplasty : the gold
standard ? tive à la voie fémorale et par d’autres opérateurs, de plus en plus nombreux,
Transradial approach in interventional car comme l’approche de choix.
diology is performed heterogenously around
the world. Nevertheless, this technique allows
to decrease access site complications and historique de la voie radiale
major bleeding, and increases patient’s com
La première série de 100 cas de coronarographie diagnostique par voie radiale
fort. All patient subgroups beneficiate from
est rapportée en 1989 par Campeau de l’Institut de cardiologie de Montréal,1 qui
this approach, especially in the case of acute
coronary syndromes in which the bleeding conclut que la voie radiale est plus sûre que la voie brachiale. Par la suite, en
risk is the highest, in relation to aggressive 1992, Kiemeneij et Laarman effectuent à Amsterdam la première angioplastie coro
anticoagulation and platelet antiaggregation naire au ballon par voie radiale. Cette même équipe rapporte la réalisation de la
treatment. Transradial approach requires a première implantation d’un stent coronaire par voie radiale en 1993.
longer learning curve than transfemoral ap
proach due to specific technical challenges
that are often overcome with experience. Be situation à travers le monde
cause of its clear benefits, transradial access
should become the gold standard approach Même si l’approche radiale est décrite depuis plus de vingt ans, son utilisation
for coronary diagnostic and interventional pro est très hétérogène à travers le monde avec seulement 10% des procédures mon
cedures. diales actuellement réalisées par cette voie.
L’approche radiale s’est développée essentiellement en Europe, au Canada et
en ExtrêmeOrient, alors qu’aux EtatsUnis, selon le registre national qui recense
l’activité de plus de 600 centres, seulement 1,3% des angioplasties est effectuée
528 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 0
08_12_35510.indd 1 03.03.11 09:02
avantages/désavantages et limitations
par voie radiale.2,3 De nos jours, certains centres euro
de la voie radiale
péens ou canadiens dépassent les 95% de procédures par
voie radiale. En Suisse, une minorité d’opérateurs, princi Les avantages et désavantages de la voie radiale sont
palement en Suisse romande, utilisent la voie radiale en décrits dans le tableau 1 alors que les limitations sont pré
première intention de routine. sentées dans le tableau 2.
sélection des patients et test d’allen voie radiale vs fémorale
Avant une approche radiale, il est recommandé de faire Saignements
une évaluation clinique de l’arc ulnopalmaire afin d’éviter L’avantage majeur de la voie radiale comparé à la voie
des complications ischémiques en cas d’occlusion de l’ar fémorale est de réduire les complications vasculaires et
tère radiale en postprocédure, complication survenant dans hémorragiques. Les complications principales de l’accès
3 à 10% des cas selon les séries. fémoral sont l’hématome, la fistule artérioveineuse, le pseu
En 2004, Barbeau et coll.4 publient une étude qui fait ré doanévrisme et l’hématome rétropéritonéal, pouvant at
férence sur l’évaluation de l’arc ulnopalmaire en compa teindre jusqu’à 14% lors de procédures complexes, alors que
rant le test d’Allen clinique avec l’utilisation des courbes pour l’accès radial, la fistule artérioveineuse et le pseudo
de saturométrie et l’oxymétrie chez 1010 patients. Les au anévrisme sont anecdotiques. Quant aux saignements ma
teurs concluent que la méthode qui combine les courbes jeurs, ils surviennent classiquement dans l 1% pour l’accès
de saturométrie et l’oxymétrie est plus objective et sen radial vs 2 à 6% pour l’accès fémoral.
sible pour évaluer la circulation collatérale de la main et Deux grandes métaanalyses d’études randomisées com
permet un accès radial chez plus de patients que le test parent les voies radiale et fémorale lors de procédures diag
d’Allen (normal si recoloration de la main m 9 secondes). nostiques et thérapeutiques. La première, publiée en 2004
En effet, sur la base d’un type D à la saturométrie (pas de par Agostoni et coll.,5 incluait douze études randomisées
récupération de la courbe après deux minutes de com réalisées entre 1989 et 2003 avec au total 3224 patients.
pression de l’artère radiale, figure 1), seulement 1,5% de la Les résultats montrent que la voie radiale est associée à
cohorte entière était exclu pour un accès radial droit ou une diminution significative des complications liées au
gauche, dont 2% d’hommes et 0,3% de femmes (vs 6,4%, point de ponction (0,3% vs 2,8% ; p l 0,0001).
8,4% et 2,2% respectivement sur la base du test d’Allen). En 2009, Jolly et coll.6 publient une deuxième métaana
lyse incluant 23 études randomisées réalisées entre 1994
et 2008 pour un total de 7020 patients. Dans cette analyse,
Radial artery compression
Tableau 1. Avantages et désavantages de la voie
Type Start After 2 min. radiale
Oxymetry Oxymetry Avantages
A + +
• Réduction des complications vasculaires et hémorragiques
• Amélioration du confort du patient
• Mobilisation plus rapide
• Diminution des coûts hospitaliers
B + + • Diminution de la morbidité (études randomisées) et de
la mortalité (études non randomisées)
Désavantages
C – + • Courbe d’apprentissage plus longue
• Irradiation plus importante surtout pendant la courbe
d’apprentissage
• Temps de procédure plus long surtout pendant la courbe
d’apprentissage
D – –
Tableau 2. Limitations de la voie radiale
Figure 1. Evaluation de l’arc ulno-palmaire par la
courbe de saturométrie et l’oxymétrie faite au • Un test d’Allen pathologique ou type D à la saturométrie
niveau du pouce en comprimant l’artère radiale • Des variations anatomiques ou tortuosités importantes
pendant deux minutes (défis surmontables par des opérateurs confirmés)
(Adaptée de réf.4).
• Un patient avec double pontage mammaire (faisable mais peut
Type A : pas d’amortissement de la courbe avec oxymétrie positive. être un réel défi technique)
Type B : amortissement de la courbe avec oxymétrie positive. Type C : • Un patient en choc cardiogène car le pouls radial est souvent
disparition de la courbe puis réapparition dans les deux minutes de com- non palpable
pression grâce au recrutement de collatérales de la main. L’oxymétrie
initialement négative devient positive. Type D : disparition de la courbe • Un patient candidat pour une hémodialyse (volonté de garder
qui ne réapparaît pas dans les deux minutes de compression avec oxy- l’artère radiale intacte pour une éventuelle fistule artério-
métrie qui reste négative. veineuse)
0 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 529
08_12_35510.indd 2 03.03.11 09:02
seuls les saignements majeurs (saignement fatal, chute de des tortuosités et calcifications vasculaires plus fréquentes
l’hémoglobine M 3 g/dl, transfusion, chirurgie indiquée, hé avec l’âge. OCTOPLUS,14 étude multicentrique randomisée
morragie intracrânienne) sont pris en considération. Les incluant 377 octogénaires, montre, lors d’un accès radial,
résultats sont à nouveau en faveur de la voie radiale avec une diminution significative des complications vasculaires
une diminution de 73% des saignements majeurs (0,05% vs (1,6% vs 6,5% ; p = 0,029), définies comme des complications
2,3% ; p l 0,01) et une tendance à la réduction des évé nécessitant une chirurgie, une transfusion, une prolonga
nements majeurs cardiovasculaires (décès, infarctus du tion de l’hospitalisation ou étant associées à une ischémie
myocarde ou accident cérébral vasculaire) (2,5% vs 3,8% ; du membre concerné. Hormis un hématome radial sans con
p = 0,058). La voie radiale diminue le risque absolu de sai séquences, toutes les complications vasculaires du groupe
gnement majeur respectivement de 1,4% (p = 0,02) et 1,8% radial concernent la voie fémorale et sont survenues après
(p = 0,001) lors d’une coronarographie et d’une angioplastie crossover d’un accès radial vers fémoral. Dans cette étude, il
coronaire. Il faut effectuer 56 angioplasties coronaires par est intéressant de remarquer qu’un crossover de la voie ra
voie radiale pour éviter un saignement majeur (NNT 56). diale à fémorale a été réalisé dans 8,9% et de la fémorale à
La diminution la plus importante du risque absolu de sai la radiale dans 8,1% (p = NS).
gnement majeur (3,1% ; p = 0,001) est observée lors d’infarc Une deuxième étude randomisée plus récente15 in
tus du myocarde avec élévation du segment ST (STEMI). cluant 307 patients de L 75 ans montre également des ré
sultats en faveur de la voie radiale avec un taux de compli
Impact sur la mortalité cations majeures (saignement nécessitant une chirurgie ou
La littérature rapporte une forte association entre les transfusion, accident vasculaire cérébral – AVC) de 0% pour
saignements en cas de syndrome coronarien aigu et l’aug la radiale vs 3,2% pour la fémorale (p l 0,001).
mentation de la mortalité.7,8 En effet, lors d’un saignement
dit majeur dans un collectif de plus de 34 000 patients issus Femme
de trois grandes études, le taux de décès à 30 jours est cinq Les femmes constituent une population à haut risque
fois plus élevé qu’en son absence et l’augmentation (1,5 x) de saignement et la voie radiale permet de réduire ce
des décès est toujours présente à six mois (4,6 % vs 2,9% ; risque. Cependant comme l’artère radiale est souvent plus
p < 0,002). petite chez la femme, l’opérateur doit parfois, pour effec
Le risque de complications vasculaires et la nécessité tuer une angioplastie coronaire, se limiter à des cathéters
d’avoir recours à une transfusion sont impliqués dans la plus petits de 5 French (F) au lieu du 6F (1F = 0,33 mm) ha
survenue d’une surmortalité à court et moyen termes après bituels qui laissent plus de choix dans les techniques in
une angioplastie coronaire.9,10 L’étude MORTAL11 a examiné terventionnelles. L’alternative est de recourir aux cathéters
de manière rétrospective l’association entre le site d’accès, hydrophiliques sheathless (Asahi) qui permettent d’utiliser
le taux de transfusions et la mortalité chez 32 822 patients un cathéter de dilatation 6F sans introducteur et dont le
consécutifs qui ont bénéficié d’une angioplastie coronaire diamètre externe correspond à un introducteur 5F.
dans la province canadienne de ColombieBritannique. Les Pristipino et coll. ont publié en 2007 un registre pros
auteurs ont montré qu’en diminuant les complications vas pectif de 2919 patients qui représente la plus grande série
culaires, la voie radiale est associée à une diminution de rapportant l’influence du sexe sur les saignements lors de
50% du taux de transfusions (1,4% vs 2,8%) et à une réduc procédures coronaires percutanées.16 Pour les 838 femmes
tion relative de la mortalité à 30 jours de 29% et à un an de (33% de procédures radiales), aucun saignement majeur
17% (p l 0,001), correspondant à une réduction du risque n’est survenu après un accès radial vs 4,1% après un accès
absolu de 1% à un an. fémoral (p = 0,0008). Les saignements mineurs sont égale
L’étude RIVIERA12, registre international prospectif in ment moins fréquents après une approche radiale (6,4% vs
cluant 7962 patients qui ont bénéficié d’une angioplastie 39,4% ; p = 0,00001). En analyse multivariée, les facteurs pré
coronaire, montre que la voie radiale est associée à une di dictifs indépendants de saignements majeurs sont la voie
minution significative du risque de mortalité ou d’infarctus fémorale, le sexe féminin, l’âge L 70 ans, l’utilisation d’in
du myocarde. Des résultats similaires sont retrouvés dans hibiteurs de la glycoprotéine IIb/IIIa et les syndromes coro
l’étude PREVAIL.13 nariens aigus.
Quel sous-groupe de patients peut bénéficier Patient obèse
de cette technique ? Une troisième population à haut risque de complica
Tous les patients vont bénéficier de cette technique, tions vasculaires est le patient obèse. Il est démontré que
mais plus particulièrement les populations à haut risque les saignements lors d’un accès fémoral sont plus fré
de complications vasculaires : les patients âgés, obèses, quents dans ce sousgroupe (difficultés d’atteindre l’artère
maigres, hypertendus, insuffisants rénaux, anticoagulés, les et d’obtenir une hémostase postprocédure, délai dans la
femmes ainsi que les patients présentant un syndrome coro reconnaissance d’une hémostase sousoptimale). Le re
narien aigu/STEMI. gistre prospectif TROP17 incluant 555 patients avec un IMC
L 35 kg/m2 montre que la voie radiale peut diminuer de
Patient âgé manière significative le taux de complications vasculaires
L’âge avancé est un facteur de risque pour les complica (0,8% vs 5,1% ; p = 0,0009) et les hématomes (1,8% vs 10,2% ;
tions vasculaires. La voie radiale peut parfois être techni p l 0,0001) chez les patients obèses. Les durées de procé
quement plus difficile chez ce groupe de patients en raison dure et du séjour hospitalier sont significativement plus
530 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 0
08_12_35510.indd 3 03.03.11 09:02
complications
courtes dans le groupe radial. Cette étude montre égale
ment la faisabilité de la voie radiale chez des patients Spasme de l’artère radiale
obèses, avec un taux de succès de 96% par des opérateurs Il est essentiel que le patient soit confortable et détendu
expérimentés. afin de prévenir le spasme de l’artère radiale, d’où l’impor
tance de la prémédication et de l’anesthésie locale. L’admi
Angioplastie primaire nistration intraartérielle de vasodilateur (vérapamil 2,5 mg
Les avantages de la voie radiale sont majorés dans le le plus souvent) diminue de manière significative la surve
cadre d’une angioplastie primaire pour STEMI où le risque nue d’un spasme.21 L’utilisation de cathéters plus petits
de saignement est augmenté en raison d’une anticoagula (5F vs 6 F) en présence d’une artère radiale de petit dia
tion et antiagrégation plaquettaire agressives. Plusieurs étu mètre permet également de diminuer la survenue d’un
des ont montré un bénéfice significatif de la voie radiale spasme. L’expérience de l’opérateur permet de raccourcir
chez ces patients sans prolongation du temps de reperfu le temps de la procédure et de diminuer les manipulations
sion/revascularisation.18 de cathéter, ce qui se traduit par un taux de spasme habi
Dans la métaanalyse de Vorobcsuk et coll.19 incluant tuellement très faible.
douze études randomisées et 3324 patients, la voie radiale
réduit de manière significative les saignements majeurs Occlusion de l’artère radiale
(0,77% vs 2,61% ; p = 0,0001), les événements majeurs car L’occlusion de l’artère radiale postprocédure (3 à 10% des
diovasculaires, composés de décès, infarctus du myocarde cas selon les séries) reste asymptomatique si le test d’Allen
ou AVC (3,65% vs 6,55% ; p = 0,001), et la mortalité (2,04% vs avec oxymétrie n’est pas pathologique (type D). Les facteurs
3,06% ; p = 0,01) par rapport à la voie fémorale. Les temps prédictifs de l’occlusion radiale sont le dosage d’héparine,22
de procédure et de reperfusion sont similaires entre les facteur le plus important, la durée de la procédure, le ratio
deux groupes. De même, dans la récente étude prospec taille du cathéter/taille de la lumière de l’artère, la courbe
tive d’Arzamendi et coll.,20 la voie radiale est associée à d’apprentissage et la durée de la compression postprocé
une diminution significative des saignements majeurs sans dure. Il est recommandé d’administrer 5000 UI d’héparine
compromission du temps de revascularisation et à une ré lors d’une procédure par voie radiale. L’hémostase du site de
duction significative des événements majeurs cardiaques ponction se fait aisément à l’aide d’un bracelet de compres
à douze mois (décès cardiaque, infarctus du myocarde ou sion, habituellement laissé en place durant environ trois
revascularisation du vaisseau coupable). heures avec une pression dégressive.
Radiale
Cubitale
5 cm 1
10 cm 11
avant-bras 111
bras 1V
Grade 1 11 111 1V V
Définition Hématome local, Hématome et Hématome et Hématome et Menace ischémique
superficiel infiltration musculaire infiltration musculaire infiltration musculaire du membre supérieur
modérée de tout l’avant-bras remontant au-delà
du coude
Traitement • Antalgiques • Antalgiques • Antalgiques • Antalgiques Envisager la chirurgie
• Garrot supplémentaire • Garrot supplémentaire • Garrot supplémentaire • Garrot supplémentaire
• Glace locale • Glace locale • Glace locale • Glace locale
• Brassard pneumatique • Brassard pneumatique
Notes Aviser le médecin Aviser le médecin Aviser le médecin • Aviser le médecin
• Consultation en
chirurgie STAT
Remarques • Il faut corriger rapidement toute hypertension et envisager de cesser et de renverser rapidement l’anticoagulation ou les antiplaquettaires.
• Suivre le diamètre du bras et de l’avant-bras pour juger du retrait des garrots supplémentaires et/ou du brassard pneumatique.
• Les garrots supplémentaires sont placés en ligne avec l’artère ponctionnée.
• Des cubes de glace sont placés dans un gant de toilette qui est ensuite appliqué sur la zone à traiter.
• Installer un saturomètre au pouce pour juger de la bonne perfusion du membre malgré la contention (saturation M 90%).
• Si l’on utilise un brassard pneumatique, mettre une pression = pression systolique - 20 mmHg et dégonfler toutes les 15 minutes.
• Au retrait des garrots, enrouler l’avant-bras et/ou le bras de bandes «velpeau» pour maintenir une pression positive modérée.
Classification développée par le laboratoire de cathétérisme cardiaque de l’Hôpital Laval
Il est interdit de reproduire ce document en tout ou en partie sans l’autorisation de l’Hôpital Laval. ©Hôpital Laval 2002
Figure 2. Classification des hématomes postcathétérisme par voie radiale/cubitale
(Tableau fourni par le Dr O. Bertrand, Hôpital Laval, Québec et réalisé pour standardiser l’évaluation des hématomes postprocédure dans le cadre de
l’étude EASY 23).
0 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 531
08_12_35510.indd 4 03.03.11 09:02
Hématome radial plus longue que pour la voie fémorale, de nos jours, le taux
Les complications vasculaires lors d’une procédure ra de succès d’une procédure par voie radiale réalisée par
diale sont très rares. Néanmoins, il faut identifier rapide des opérateurs expérimentés est similaire au taux obtenu
ment la présence d’un hématome du bras (secondaire le par voie fémorale. Compte tenu de ses bénéfices indiscu
plus souvent à une perforation d’une petite branche lors tables, la voie radiale, bien qu’actuellement sousutilisée,
de la montée du guide) et le traiter de manière rapide et devrait s’imposer comme l’approche de choix.
efficace avec une manchette à pression gonflée 20 mmHg
en dessous de la pression artérielle systolique pendant
quinze minutes, à répéter si nécessaire. En cas de prise en
charge tardive, l’hématome du bras peut être responsable Implications pratiques
d’un syndrome des loges dont l’incidence est heureuse
ment très faible (l 0,01%). Une intervention chirurgicale de > L’approche radiale diminue de façon significative les compli-
décompression peut alors être nécessaire. Bertrand et cations vasculaires et hémorragiques par rapport à l’approche
coll.23 ont publié une classification simple en cinq grades fémorale
de l’hématome du membre supérieur avec le traitement
approprié pour chaque grade (figure 2). > L’approche radiale améliore le confort des patients et permet
une mobilisation plus rapide
conclusion > La très grande majorité des patients (obèses, âgés, syndrome
coronarien aigu/STEMI) bénéficient d’une approche radiale
Plusieurs études et métaanalyses ont démontré que la
voie radiale est associée à une réduction significative des > Le test d’Allen ou l’évaluation de l’arc ulno-palmaire par la
complications vasculaires et par ce biais diminue la morbi courbe de saturométrie est recommandé dans l’évaluation
clinique avant une procédure par voie radiale
dité et potentiellement la mortalité après coronarographie
et/ou angioplastie. Cette technique améliore de manière > La courbe d’apprentissage est plus longue que pour l’approche
considérable le confort des patients et permet une mobili fémorale
sation plus rapide. Même si la courbe d’apprentissage est
Bibliographie
1 Campeau L. Percutaneous radial artery approach taneous coronary intervention : Implications for contem- centre comparison of transradial and transfemoral ap-
for coronary angiography. Cathet Cardiovasc Diagn porary practice. J Am Coll Cardiol 2009;53:2019-27. proaches for coronary angiography and PTCA in obese
1989;16:3-7. 10 Kinnaird TD, Stabile E, Mintz GS, et al. Incidence, patients : The TROP registry. EuroInterv 2007;3:327-32.
2 Rao SV, Ou F, Wang TY, et al. Trends in the preva- predictors, and prognostic implications of bleeding and 18 Pancholy S, Patel T, Sanghvi K, Thomas M, Patel T.
lence and outcomes of radial and femoral approaches blood transfusion following percutaneous coronary Comparsion of door-to-balloon times for primary PCI
to percutaneous coronary intervention. J Am Coll Car- interventions. Am J Cardiol 2003;92:930-5. using transradial versus transfemoral approach. Cathet
diol Interv 2008;1:379-86. 11 * Chase AJ, Fretz EB, Warburton WP, et al. Asso- Cardiovasc Interv 2010;75:991-5.
3 Louvard Y, Kumar S, Lefèvre T. Pénétration de ciation of the arterial access site at angioplasty with 19 * Vorobcsuk A, Konyi A, Aradi D, et al. Transradial
l’approche radiale dans le monde et apprentissage de transfusion and mortality : The MORTAL study (Mor- versus transfemoral percutaenous coronary interven-
la technique. Ann Cardiol Angeiol 2009;58:327-32. tality benefit Of Reduced Transfusion after percuta- tion in acute myocardial infarction : Systematic over-
4 * Barbeau GR, Arsenault F, Dugas L, et al. Evaluation neous coronary intervention via the Arm or Leg). Heart view and meta-analysis. Am Heart J 2009;158:814-21.
of the ulnopalmar arterial arches with pulse oxymetry 2008;94:1019-25. 20 * Arzamendi D, Ly HQ, Tanguay JF, et al. Effect on
and plethysmography : Comparison with the Allen’s 12 Montalescot G, Ongen Z, Guindy R, et al. Predic- bleeding, time to revascularization, and one-year clini-
test in 1010 patients. Am Heart J 2004;147:489-93. tors of outcome in patients undergoing PCI. Results of cal outcomes of the radial approach during primary
5 Agostoni P, Biondi-Zoccai GGL, De Benedictis I, et the RIVIERA study. Int J Cardiol 2008;129:379-87. percutaneous coronary intervention in patients with
al. Radial versus femoral approach for percutaneous 13 Pristipino C, Trani C, Nazzaro MS, et al. Major im- ST-segment elevation myocardial infarction. Am J Car-
coronary diagnostic and interventional procedures. J provement of percutaneous cardiovascular procedures diol 2010;106:148-54.
Am Coll Cardiol 2004;44:349-56. outcomes with radial artery catheterisation : Results 21 Varenne O, Jégou A, Cohen R et al. Prevention of
6 ** Jolly SS, Amlani S, Hamon M, Yusuf S, Mehta SR. from the PREVAIL study. Heart 2009;95:476-82. arterial spasm during percutaneous coronary interven-
Radial versus femoral access for coronary angiography 14 Louvar Y, Benamer H, Garot P, et al. Comparison tions through radial artery : The SPASM study. Cathet
or intervention and the impact on major bleeding and of transradial and transfemoral approaches for coro- Cardiovasc Interv 2006;68:231-5.
ischemic events : A systematic review and meta-analy- nary angiography and angioplasty in octogenarians (the 22 Spaulding C, Lefèvre T, Funk F. Left radial approach
sis of randomized trials. Am Heart J 2009;157:132-40. OCTOPLUS study). Am J cardiol 2004;94:1177-80. for coronary angiography : Results from a prospective
7 Manoukian S, Feit F, Mehran R, et al. Impact of ma- 15 Achenbach S, Ropers D, Kallert L, et al. Transradial study. Cathet Cardiovasc Diagn 1996;39:365-70.
jor bleeding on 30-days mortality and clinical out- versus transfemoral approach for coronary angiogra- 23 Bertrand OF, De Larochellière R, Rodés-Cabau J,
comes in patients with acutes coronary syndromes. An phy and intervention in patients above 75 years of age. et al. A randomized study comparing same-day home
analysis from the ACUITY trial. J Am Coll Cardiol Cathet Cardiovasc Interv 2008;72:629-35. discharge and abciximab bolus only to overnight hos-
2007;49:1362-8. 16 Pristipino C, Pelliccia F, Granatelli A. Comparison pitalization and abciximab bolus and infusion after trans-
8 Eikelboom JW, Mehta SR, Anand SS, et al. Adverse of access-related bleeding complications in women ver- radial coronary stent implantation. Circulation 2006;114:
impact of bleeding on prognosis in patients with acute sus men undergoing percutaneous coronary catheteri- 2636-43.
coronary syndromes. Circulation 2006;114:774-82. zation using the radial versus femoral artery. Am J Car-
9 Doyle BJ, Rihal CS, Gastineau DA, et al. Bleeding, diol 2007;99:1216-21. * à lire
blood transfusion, and increased mortality after percu- 17 Benamer H, Louvard Y, Sanmartin M, et al. A multi- ** à lire absolument
532 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 Revue Médicale Suisse – www.revmed.ch – 9 mars 2011 0
08_12_35510.indd 5 03.03.11 09:02
Vous aimerez peut-être aussi
- Révision D'examenDocument5 pagesRévision D'examenAmina100% (2)
- Chirurgie Carotidienne Techniques Stratégie de TraitementDocument19 pagesChirurgie Carotidienne Techniques Stratégie de TraitementaysarPas encore d'évaluation
- C 1 FebaDocument7 pagesC 1 FebaAhmadou Bamba MbodjPas encore d'évaluation
- APSODocument5 pagesAPSOSirine ChaariPas encore d'évaluation
- Le Doppler Transcrânien en NeurochirurgieDocument8 pagesLe Doppler Transcrânien en NeurochirurgieAmina HasnaouiPas encore d'évaluation
- Imagerie Et Cardiologie Interventionnelle: SciencedirectDocument2 pagesImagerie Et Cardiologie Interventionnelle: SciencedirectMoncef PechaPas encore d'évaluation
- Mlavillonniere,+13546 2013 Article 684Document10 pagesMlavillonniere,+13546 2013 Article 684Chonlathorn CaptainPas encore d'évaluation
- Hémochromatose Cardiaque Chez DrépanocytaireDocument3 pagesHémochromatose Cardiaque Chez DrépanocytaireHenry TraoréPas encore d'évaluation
- ThermodilutionDocument6 pagesThermodilutionahmed AlayoudPas encore d'évaluation
- 1-s2.0-S002837701500079X-main.en.frDocument13 pages1-s2.0-S002837701500079X-main.en.frAllal SalimPas encore d'évaluation
- Anesthesie Pour Chirurgie CarotidienneDocument15 pagesAnesthesie Pour Chirurgie CarotidienneLiliana SilvaPas encore d'évaluation
- IRM Trunchiuri SupraaoDocument13 pagesIRM Trunchiuri SupraaoAndreea MunteanuPas encore d'évaluation
- Canal ArterielDocument7 pagesCanal ArterielLyse lily100% (1)
- ImagerieDocument8 pagesImagerieakremcoolPas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S1279796022000456 MainDocument5 pages1 s2.0 S1279796022000456 MainAllal SalimPas encore d'évaluation
- Coro ModifierDocument104 pagesCoro ModifierYoucef Osmani100% (2)
- Fermeture D'auricule Chez Le Patient ValvulaireDocument3 pagesFermeture D'auricule Chez Le Patient ValvulaireSarah HouasniaPas encore d'évaluation
- ED TSA Pour Le Chirurgien VasculaireDocument18 pagesED TSA Pour Le Chirurgien VasculaireSFA_ANGEIOLOGIEPas encore d'évaluation
- RMS idPAS D ISBN Pu2009-20s Sa07 Art07Document9 pagesRMS idPAS D ISBN Pu2009-20s Sa07 Art07Gabrielle RizziPas encore d'évaluation
- Place de Lechographie Pour Les Abords Vasculaires 10 Zetlaoui 1442329722Document20 pagesPlace de Lechographie Pour Les Abords Vasculaires 10 Zetlaoui 1442329722fouad tabetPas encore d'évaluation
- Stratégie de La Conduite Des Examens Chez Le Patient PolyvasDocument10 pagesStratégie de La Conduite Des Examens Chez Le Patient PolyvasElbordjiPas encore d'évaluation
- Emc CoronairesDocument30 pagesEmc CoronairesRedha Farid100% (1)
- Chirurgie Carotidienne (GénéralitésDocument12 pagesChirurgie Carotidienne (GénéralitésaysarPas encore d'évaluation
- Anesthesie Pour Chirurgie Du RachisDocument31 pagesAnesthesie Pour Chirurgie Du Rachislun pourlautrePas encore d'évaluation
- Indication de La Coronarographie SMCDocument13 pagesIndication de La Coronarographie SMCbelaouchi icvtPas encore d'évaluation
- La Fibrillation Atriale Non Valvulaire A Propos de 118 Observations Colligées Au CHU de DakarDocument6 pagesLa Fibrillation Atriale Non Valvulaire A Propos de 118 Observations Colligées Au CHU de Dakarsouleumanesall84Pas encore d'évaluation
- Pathologie Chirurgicale - Copie-1Document49 pagesPathologie Chirurgicale - Copie-1kimsurmjiPas encore d'évaluation
- 03 Herz 02-18 IRMcard PDFDocument4 pages03 Herz 02-18 IRMcard PDFsweet girlPas encore d'évaluation
- Quantification Et Traitement: Du Syndrome CongestifDocument5 pagesQuantification Et Traitement: Du Syndrome CongestifYouyouPas encore d'évaluation
- CholangiocarcinomeDocument4 pagesCholangiocarcinomeNDAYIRAGIJE RévérienPas encore d'évaluation
- La Rupture Traumatique de L'isthme Aortique - À Propos de Trois CasDocument3 pagesLa Rupture Traumatique de L'isthme Aortique - À Propos de Trois CasGhost ProPas encore d'évaluation
- Traitement Selon Cours PR MahiDocument40 pagesTraitement Selon Cours PR MahiABDELLAH REZZIKIPas encore d'évaluation
- Shot Ar 2017Document4 pagesShot Ar 2017Elena-Dana OpreaPas encore d'évaluation
- Présentation Du Sujet Du PFE MAV CRBDocument8 pagesPrésentation Du Sujet Du PFE MAV CRBLamine El mehdiPas encore d'évaluation
- Coronaropathie StableDocument10 pagesCoronaropathie StableraabePas encore d'évaluation
- Sarcome 3Document5 pagesSarcome 3asialoren74Pas encore d'évaluation
- Généralités & Particularités en Imagerie Abdominale Et Thoracique Cec Geriatrie 2022Document15 pagesGénéralités & Particularités en Imagerie Abdominale Et Thoracique Cec Geriatrie 2022Rahmani SouadPas encore d'évaluation
- Angiographie Cérébrale NormaleDocument21 pagesAngiographie Cérébrale Normaleskyclad_21Pas encore d'évaluation
- AVC Anaes2002imagerie AVC SynthDocument10 pagesAVC Anaes2002imagerie AVC SynthHadjer AliouiPas encore d'évaluation
- Duodénopancréatectomie Céphalique PDFDocument25 pagesDuodénopancréatectomie Céphalique PDFDoria OuahraniPas encore d'évaluation
- Infective Endocarditis Revealing Retroperitoneal Extension LeiomyosarcomaDocument4 pagesInfective Endocarditis Revealing Retroperitoneal Extension LeiomyosarcomaIJAR JOURNALPas encore d'évaluation
- Angiograhie ElkhalladiDocument112 pagesAngiograhie ElkhalladiEssalka N'dahPas encore d'évaluation
- Coeur en TDM PDFDocument19 pagesCoeur en TDM PDFconception hiverPas encore d'évaluation
- ANGIOGRAPHIEDocument21 pagesANGIOGRAPHIEMaxence KouessiPas encore d'évaluation
- Anticoagulants Relais AVKDocument9 pagesAnticoagulants Relais AVKMohand SadiniPas encore d'évaluation
- Sténose Carotide Et UltrasonsDocument10 pagesSténose Carotide Et UltrasonsSFA_ANGEIOLOGIEPas encore d'évaluation
- Artériopathies Des MI Et IRMDocument9 pagesArtériopathies Des MI Et IRMAngelina DarinePas encore d'évaluation
- Fiche Additive - HémorroïdesDocument4 pagesFiche Additive - HémorroïdesElbordjiPas encore d'évaluation
- 1311 Reanimation Vol22 N6 p624 - p633Document10 pages1311 Reanimation Vol22 N6 p624 - p633PoochaiPas encore d'évaluation
- Chirurgie de L'artere Rénale IIIDocument18 pagesChirurgie de L'artere Rénale IIIkassem989Pas encore d'évaluation
- Place de L'imagerie Multimodale Dans L'insuffisance AortiqueDocument5 pagesPlace de L'imagerie Multimodale Dans L'insuffisance AortiqueSarah HouasniaPas encore d'évaluation
- Cours CORONAROGRAPHIE 2021Document24 pagesCours CORONAROGRAPHIE 2021Ali BadreddinePas encore d'évaluation
- Insuffisance Tricuspide en 2023 PDFDocument8 pagesInsuffisance Tricuspide en 2023 PDFC GtPas encore d'évaluation
- Profil Scanographique Des Tumeurs Du PancreasDocument8 pagesProfil Scanographique Des Tumeurs Du PancreasKarim TorressPas encore d'évaluation
- Préparation Et Initiation de L'épuration Extra-Rénale - NephrohusDocument5 pagesPréparation Et Initiation de L'épuration Extra-Rénale - NephrohusMansour MbenguePas encore d'évaluation
- Congenitaux Adule SmailDocument10 pagesCongenitaux Adule Smailalex mihneaPas encore d'évaluation
- J Jradio 2013 04 010Document14 pagesJ Jradio 2013 04 010sophiePas encore d'évaluation
- 1 s2.0 S1878648012708285 MainDocument8 pages1 s2.0 S1878648012708285 MainSi LaPas encore d'évaluation
- Conduit Choice in CABGDocument29 pagesConduit Choice in CABGNora AL-BogamiPas encore d'évaluation
- Presentation M - Aubert IRSN Cle01813dDocument29 pagesPresentation M - Aubert IRSN Cle01813dpcharaladPas encore d'évaluation
- Affections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériqueD'EverandAffections vasculaires : Comprendre et traiter la sténose ostiale de l'artère mésentériquePas encore d'évaluation
- Appareil Cardio-Vasculaire-2Document21 pagesAppareil Cardio-Vasculaire-2Youcef HoualefPas encore d'évaluation
- Méthodes D'enregistrement Ambulatoire de L'électrocardiogrammeDocument8 pagesMéthodes D'enregistrement Ambulatoire de L'électrocardiogrammeBongokPas encore d'évaluation
- Sindrom Coronarian AcutDocument6 pagesSindrom Coronarian AcutIlie RoxanaPas encore d'évaluation
- Anest Pediatrique. B. HaddadDocument99 pagesAnest Pediatrique. B. Haddadkhalil ben lazregPas encore d'évaluation
- Thã©rapie Viscã©rale 2023 2Document208 pagesThã©rapie Viscã©rale 2023 2morgana59Pas encore d'évaluation
- AnapathDocument19 pagesAnapathrahaf.sialiPas encore d'évaluation
- Convulsion Etat de Mal ConvulsifDocument6 pagesConvulsion Etat de Mal Convulsifkaoutar blcPas encore d'évaluation
- Guide de Poche D Echographie Cardiaque 2 Ed - SommaireDocument14 pagesGuide de Poche D Echographie Cardiaque 2 Ed - SommaireSara Goss0% (1)
- PR Bouziane - Anatomie Chirurgicale Du Duodénum Et Pancréas - CM PDFDocument83 pagesPR Bouziane - Anatomie Chirurgicale Du Duodénum Et Pancréas - CM PDFmomoPas encore d'évaluation
- 1 - Rétrécissement MitralDocument59 pages1 - Rétrécissement MitralosasenaseiPas encore d'évaluation
- Insuffisance Rénale. Définition. o Insuffisance Rénale AiguëDocument11 pagesInsuffisance Rénale. Définition. o Insuffisance Rénale AiguëKungfudjusuModerneWushu0% (1)
- Cours HTADocument30 pagesCours HTAmeusmilson33Pas encore d'évaluation
- Étalon-Or Pour NclexDocument124 pagesÉtalon-Or Pour NclexScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Pancreatite ÉemDocument8 pagesPancreatite ÉemInfirmier Santé PubliquePas encore d'évaluation
- Anémies Du NNéDocument3 pagesAnémies Du NNéKhaled BouakkazPas encore d'évaluation
- Région CarotidienneDocument2 pagesRégion CarotidienneRania APas encore d'évaluation
- Diagnostic Des CancersDocument53 pagesDiagnostic Des Cancersy56hkwb555Pas encore d'évaluation
- Item 23 DyslipidemiesDocument22 pagesItem 23 Dyslipidemiessafa HADFIPas encore d'évaluation
- 1) CardiologieDocument5 pages1) Cardiologiemehdi bhjPas encore d'évaluation
- Effets Indésirables LOXAPAC 25 MGDocument2 pagesEffets Indésirables LOXAPAC 25 MGbarroPas encore d'évaluation
- 08 Hypertension Intracrânienne - Collège Neurochirurgie 19Document11 pages08 Hypertension Intracrânienne - Collège Neurochirurgie 19boukrimimeryPas encore d'évaluation
- Éthique Dossier N°4Document4 pagesÉthique Dossier N°4nina.pigottPas encore d'évaluation
- 2015 Desequilibre HydroelectrolytiqueDocument85 pages2015 Desequilibre HydroelectrolytiqueJudeline MorilPas encore d'évaluation
- Ciprofloxacine Pour Injection PM FRDocument65 pagesCiprofloxacine Pour Injection PM FRHonoré IrengePas encore d'évaluation
- NT ProBNPDocument8 pagesNT ProBNPLaboratoire Dr Mansouri Reghaia AlgerPas encore d'évaluation
- DT2Document7 pagesDT2EmanPas encore d'évaluation
- Anatomie Du Pédicule Hépatique: Matthieu FaronDocument36 pagesAnatomie Du Pédicule Hépatique: Matthieu FaronSafaa MedPas encore d'évaluation
- 5.a.medication Arythmie Version TuteurDocument6 pages5.a.medication Arythmie Version TuteurHenry TraoréPas encore d'évaluation
- Full Download Guide de Poche D Echographie Cardiaque Thomas Bohmeke Ralf Doliva Online Full Chapter PDFDocument69 pagesFull Download Guide de Poche D Echographie Cardiaque Thomas Bohmeke Ralf Doliva Online Full Chapter PDFmdxinesintmddrten339100% (4)