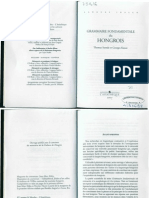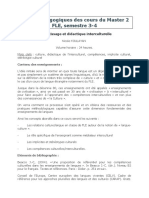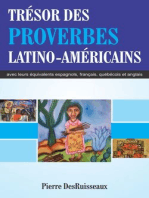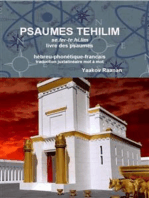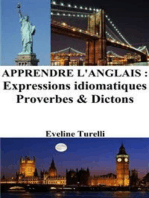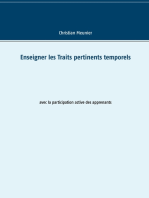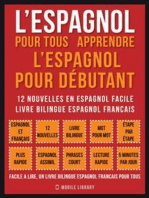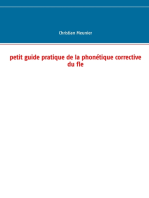Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Hel 457
Transféré par
Ibrahim PachimoTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Hel 457
Transféré par
Ibrahim PachimoDroits d'auteur :
Formats disponibles
Histoire Épistémologie Langage
42-1 | 2020
La grammaire arabe étendue
Jean-Patrick Guillaume (dir.)
Édition électronique
URL : https://journals.openedition.org/hel/457
DOI : 10.4000/hel.457
ISSN : 1638-1580
Éditeur
Société d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage
Édition imprimée
Date de publication : 28 septembre 2020
ISSN : 0750-8069
Référence électronique
Jean-Patrick Guillaume (dir.), Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020, « La grammaire arabe
étendue » [En ligne], mis en ligne le 28 octobre 2021, consulté le 29 octobre 2021. URL : https://
journals.openedition.org/hel/457 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hel.457
Ce document a été généré automatiquement le 29 octobre 2021.
HEL is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0
International License
1
SOMMAIRE
Hommage
Valérie Raby
(1967-2019)
Jean-Marie Fournier
Dossier thématique : la grammaire arabe étendue
Présentation
Jean-Patrick Guillaume
Extended grammar: Malay and the Arabic tradition
Kees Versteegh
Sur les traces de la racine trilitère dans la grammaire hébraïque
Judith Kogel
Le modèle arabe en grammaire copte. Une approche des muqaddimāt copto-arabes du
Moyen Âge
Adel Y. Sidarus
Transitivité et intransitivité dans la grammaire de Bar Hebræus
Georges Bohas
Turkic morphology seen by the Arabic grammarians. The passive
Robert Ermers
Entre grammaire arabe et grammaires arabisantes. Heurs et malheurs de la phrase
nominale
Jean-Patrick Guillaume
Varia
Le problème des mots simples issus de composés privatifs.
Contribution à l’étude sur la formation des mots chez les grammairiens anciens
Lionel Dumarty
Les options de catégorisation du participe des temps composés dans les grammaires des
langues romanes (XVe-XVIIIe siècles)
Alejandro Díaz Villalba
Lettres d’Émile Benveniste à Claude Lévi-Strauss (1948-1967)
John E. Joseph, Chloé Laplantine, Georges-Jean Pinault, Emile Benveniste et Claude Lévi-Strauss
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
2
Lectures et critiques
Sériot, Patrick, dir. 2019. Le nom des langues en Europe centrale, orientale et
balkanique
Limoges : Lambert-Lucas. 304 p.
Émilie Aussant
Hirschkop, Ken. 2019. Linguistic turns. 1890-1950
Oxford : Oxford University Press. xiv-323 p.
Nick Riemer
Gambier, Yves et Stecconi, Ubaldo, dir. 2019. A world atlas of translation
Amsterdam/Philadelphie : Benjamins. vii-493 p.
Jacqueline Léon
Ouvrages de collaborateurs d’HEL
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
3
Hommage
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
4
Valérie Raby
(1967-2019)
Jean-Marie Fournier
Valérie Raby
1 La disparition brutale de Valérie nous laisse en état de choc et de sidération.
2 Le vide qu’elle laisse est immense et les mots sont insuffisants pour dire qui elle était,
ce qu’elle représentait pour nous et ce qu’elle a accompli.
3 Il y a surtout une cruauté insoutenable à devoir aujourd’hui retracer son parcours
académique interrompu parce que l’ordre des choses aurait dû être qu’il se prolonge
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
5
longtemps et qu’elle accomplisse les projets qu’elle dessinait dans sa vie de chercheuse
et de professeure récemment élue à la Sorbonne Nouvelle.
4 Il y a une ironie tragique à devoir prononcer les mots convenus du deuil, pour elle qui
l’était si peu, qui déjouait toujours d’un trait d’ironie souriante, jamais blessant, ou d’un
éclat de rire aux notes graves, ce qui précisément est convenu ou empesé dans les
discours et les postures.
5 Valérie a été secrétaire de la SHESL de 2008 à 2014, elle en était la vice-présidente
depuis 2014.
6 Elle a commencé à codiriger HEL avec Jean-Luc Chevillard en juin 2012, puis elle en a
assuré seule la direction à partir de janvier 2015. Elle s’est acquittée de cette direction
impeccablement, insufflant avec une fermeté et une efficacité tranquilles vigueur et
stabilité à notre revue.
7 Son parcours était celui, classique, de plusieurs d’entre nous : elle avait obtenu
l’agrégation de lettres modernes de 1990 et occupé différents postes dans
l’enseignement secondaire en collège puis en lycée pendant une dizaine d’années.
8 Parallèlement, elle a suivi la formation en sciences du langage de l’université Paris 7 où
elle a d’abord obtenu une maîtrise (1995), puis un DEA de linguistique théorique et
formelle avant de s’inscrire en doctorat sous la direction de Sylvain Auroux en 1997 et
soutenir sa thèse trois ans plus tard en 2000 (une thèse en histoire des théories
linguistiques bouclée en trois ans c’est rare !). C’est à partir de cette date qu’elle a donc
été accueillie dans le laboratoire HTL et que nous l’avons croisée régulièrement au
séminaire de Sylvain Auroux au septième étage de la tour centrale de Jussieu.
9 Elle a été recrutée l’année suivante en 2001 comme maître de conférences à l’université
de Champagne-Ardennes où elle a occupé ce poste jusqu’en 2008 ; date à laquelle elle a
obtenu sa mutation pour l’université Paris Sorbonne.
10 Enfin elle a soutenu son HDR en 2017 et a été recrutée comme professeure de
linguistique française à la Sorbonne Nouvelle en 2018.
11 Pendant une vingtaine d’années, elle a donc été partie prenante, comme participante
ou comme coordinatrice non seulement de tous les projets du laboratoire inscrits dans
le champ de la grammatisation du français et des vernaculaires européens, mais
également de plusieurs programmes transversaux comme le programme « Grammaires
étendues » de l’axe 7 du Labex sous la direction d’Émilie Aussant ; ou le programme
« Énoncé » qu’elle a coordonné ; ou encore l’axe « Grammaires et outils linguistiques »
de l’organigramme du laboratoire qu’elle a codirigé avec Bernard Colombat.
12 Elle a été en particulier une cheville ouvrière infatigable et rigoureuse de ces projets
éditoriaux de longue haleine et de grande ampleur que sont la base de données des
grammaires françaises chez Garnier, l’édition critique des grammaires de la tradition
française (elle a conduit à bien l’édition d’un des premiers ouvrages paru dans la
collection mise en place chez Garnier), ou encore le Dictionnaire historique de la
terminologie linguistique (DHTL), pour n’en citer que les principaux.
13 Elle a dirigé de nombreux numéros de revues et ouvrages collectifs.
14 Elle a publié un grand nombre d’articles sur des sujets très variés, dans lesquels on peut
distinguer deux ensembles principaux :
i. d’un côté, des questions d’histoire des théories grammaticales, relatives notamment à la
syntaxe dans les grammaires françaises (en particulier autour des notions de phrase et
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
6
d’énoncé auxquelles elle a consacré sa thèse, plusieurs articles, un numéro de la revue
Langages qu’elle a dirigé et une monographie de synthèse dont Jacques François a préparé le
compte rendu dans le BSL ; ou encore l’impersonnel, les complétives, l’interjection etc.) ;
ii. de l’autre, des questions d’épistémologie de la grammaire et de la linguistique : la
rétrospection et ses enjeux, l’usage du discours historiographique par les grammairiens ;
l’écriture de l’histoire, la place des langues « rares » dans l’exemplification au XVIIIe siècle ; la
question de l’extension du modèle latin dans la description des vernaculaires.
15 L’articulation dynamique de ces deux moments de son travail caractérise bien la
démarche qui était la sienne et le développement de ses intérêts de recherche : d’une
part, l’exploration approfondie d’un corpus et d’une tradition, l’exigence d’une
documentation très précise et d’une érudition sans faille ; de l’autre, ensuite, la prise en
charge de questions théoriques plus générales, cette réflexion étant elle-même nourrie
du contact avec les travaux des collègues du laboratoire, dans ce contexte particulier
d’interdisciplinarité et de cohésion théorique forte qui lui est propre et qu’elle avait
singulièrement à cœur de contribuer à faire fructifier, convaincue que là s’édifiait une
pensée originale de l’histoire et de l’épistémologie des sciences du langage.
16 Elle attachait ainsi une grande importance aux activités et aux projets collectifs du
laboratoire et de la SHESL ; elle a participé de façon décisive à la plupart de ceux qui en
ont rythmé et structuré la vie depuis vingt ans (la revue et l’administration de la SHESL
elle-même, une bonne part des colloques de la SHESL, les éditions successives des écoles
d’été, la préparation d’ICHOLS 14 bien sûr). Elle était de celles et ceux sur qui on peut
compter, toujours.
17 Elle était aussi une amie précieuse, unique, centrale dans la vie de plusieurs d’entre
nous. Je lui dois personnellement beaucoup. Nous avons écrit en collaboration de
nombreux articles. Rien de plus aisé, de plus plaisant, de plus simple que de travailler
avec Valérie. Nous avions l’habitude presque chaque jour de réfléchir et d’aborder
ensemble tous les sujets du quotidien académique, plus étroitement encore depuis son
arrivée à la Sorbonne Nouvelle. La rigueur, la précision, le sérieux… sans esprit de
sérieux, la simplicité, la justesse, l’élégance morale et intellectuelle caractérisaient sa
manière d’être, d’agir, de penser et d’écrire.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
7
Dossier thématique : la grammaire
arabe étendue
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
8
Présentation
Jean-Patrick Guillaume
1 Issu d’une journée d’études organisée le 17 novembre 2017 par le laboratoire HTL en
partenariat avec le Labex EFL, ce dossier entend apporter une première contribution à
une question encore peu étudiée : celle de la « grammaire arabe étendue », c’est-à-dire
de la manière dont le système grammatical arabe traditionnel a été réemployé et
adapté à la description d’autres langues. De fait, en dehors de quelques chapitres dans
Auroux et al. (2000), traitant de l’influence de la grammaire arabe sur d’autres
traditions (p. 321‑336), cette problématique n’a guère retenu l’attention jusqu’à
présent. En raison du cloisonnement des disciplines et de la rareté des contacts entre
des chercheurs eux-mêmes peu nombreux, les traditions concernées ont été le plus
souvent abordées isolément les unes des autres, ce qui ne favorisait guère l’émergence
de problématiques communes et nuisait à la visibilité des travaux existants en dehors
des spécialistes de l’aire culturelle concernée.
2 Les contributions rassemblées ici couvrent la majeure partie de ce que l’on pourrait
nommer l’aire de grammatisation arabe2. Aire passablement étendue dans l’espace et le
temps, puisqu’elle va de l’Andalousie des IXe-Xe siècles, avec la première grammatisation
de l’hébreu, à l’Insulinde du XIXe, où paraissent les premières grammaires autochtones
du malais. La diversité génétique et typologique des langues concernées n’est pas moins
considérable ; elle n’est pas pour autant exceptionnelle et se situe dans le même ordre
d’idées que celle de la grammaire sanskrite étendue (voir Aussant 2017). À l’intérieur de
cette diversité, on peut toutefois tenter de proposer quelques remarques générales.
3 Tout d’abord, l’ensemble des langues grammatisées à partir du modèle arabe sont des
langues savantes, ou à tout le moins des langues de culture. Certaines le sont depuis
fort longtemps, comme le copte, qui a plus d’un millénaire d’existence au moment de sa
grammatisation ; certaines au contraire sont émergentes, comme le turc, qui, avec
l’avènement de l’Empire seldjoukide (milieu du XIe siècle), se développe comme langue
de cour, à côté de l’arabe et du persan. Il faut également remarquer le cas particulier du
syriaque, grammatisé dès le VIe siècle sur le modèle grec, où Bar Hebraeus se borne à
introduire quelques outils empruntés à la grammaire arabe, tels que la notion de
transitivité, étudiée ici par Georges Bohas.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
9
4 On peut également remarquer que, dans la quasi-totalité des cas, on a affaire à des
processus d’endogrammatisation, au sens où leurs auteurs, s’ils ne sont pas à
proprement parler des locuteurs natifs des langues en question – ce qui, pour des
langues savantes, n’a guère de sens –, en sont au moins des usagers, et où elles sont un
élément essentiel de leur identité, ethnique ou confessionnelle ; le cas de l’Andalou Abū
Ḥayyān al-Andalusī (ou al-Ġarnāṭī, mort en 1344), auteur d’une grammaire du turc
rédigée en arabe3, fait figure d’exception qui confirme la règle. D’une manière générale,
les grammairiens arabes, du moins dans l’exercice de leur profession, ne se sont jamais
intéressés aux langues autres que l’arabe, y compris à celle qui, dans bien des cas, était
leur langue maternelle : elles n’auraient rien eu à leur apprendre, puisque l’arabe,
affirmaient-ils, était supérieure aux autres par la « sagesse » (ḥikma) qui se manifestait,
à tous les niveaux, dans son organisation. De ce fait, la grammaire, qui cherche à
dégager cette « sagesse » inhérente à la langue, ne saurait se limiter à une discipline
purement utilitaire, mais peut se poser en science spéculative 4.
5 Cet aspect spéculatif n’était sans doute pas le plus facile – ni le plus immédiatement
utile – à transposer dans la description d’autres langues ; il n’en reste pas moins que,
dans la plupart des cas considérés ici, la grammatisation s’accompagne d’une volonté,
plus ou moins clairement assumée, de promotion, d’« illustration » de la langue
concernée, parfois liée à une période de renouveau culturel et littéraire, comme c’est le
cas pour l’hébreu dans l’Andalousie du Xe siècle, avec l’émergence d’une poésie profane
(Itzhaki 2013), ou pour le copte au XIIIe, comme le souligne ici même Adel Sidarus. De
même, le premier chapitre du Qavâʾed-e fârisyyat de ʿAbd al-Karīm Iravānī, l’une des
premières grammaires autochtones du persan, publiée en 1846, commence par un
chapitre intitulé « Du mérite éminent du persan et de l’éloge des Persans » (Jeremiás
1993), qui fait pendant à l’éloge de la langue arabe par lequel s’ouvrent certains traités
de grammaire arabe dus à des auteurs persophones, tel le Mufaṣṣal d’al-Zamaḫšarī
(mort en 1144). Dans le cas du malais, enfin, comme le souligne Kees Versteegh, la
motivation de l’auteur est plutôt de préserver le bon usage d’une langue écrite contre
les erreurs propagées par les locuteurs allophones qui usent du malais comme langue
de communication ; ici encore, on retrouve un thème familier aux grammairiens
arabes, qui ont toujours présenté la lutte contre la « corruption de la langue » (fasād al-
luġa) consécutive à l’expansion de l’arabe hors de la péninsule Arabique comme le
principal enjeu de la grammatisation de l’arabe.
6 Un dernier ordre d’observations concerne la langue de description, qui peut être soit
l’arabe, dans les premières grammaires de l’hébreu (Valle 2000) ainsi que dans celles du
copte et du turc, soit la langue décrite elle-même, comme pour le syriaque, le persan et
le malais. Dans le premier cas, le grammairien dispose d’une terminologie toute faite ;
ce qui ne veut pas dire qu’elle soit directement utilisable telle quelle, et qu’il ne faille
pas l’adapter aux besoins de la langue décrite, ce qui est parfois acrobatique (voir dans
la contribution d’Adel Sidarus ce que deviennent les ḥurūf al-ziyāda) ; le second suppose
d’élaborer une terminologie vernaculaire, par emprunt et/ou par calque de l’arabe.
Cette terminologie, au demeurant, peut être antérieure à la grammatisation
proprement dite et s’être constituée par le biais de traductions ou de gloses en langue
vernaculaire utilisées dans l’enseignement, comme le note Kees Versteegh à propos du
malais. On notera ici encore le cas particulier de la grammaire syriaque, pour lequel il
existait déjà une terminologie inspirée du modèle grec, sur laquelle se sont seulement
greffés quelques emprunts ponctuels à la tradition arabe.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
10
7 Ces quelques remarques, nécessairement générales et partielles, ne sauraient
évidemment épuiser la richesse de ce dossier, dont on pourra mesurer quelle quantité
de compétences et d’érudition il met en jeu et combien de questions nouvelles il
soulève. Tout au plus voudraient-elles, très modestement, mettre en perspective les
contributions que l’on va lire.
8 La première d’entre elles est consacrée au domaine en un sens le plus excentré de l’aire
de grammatisation arabe, puisqu’il s’agit de la grammaire du malais. Après avoir
replacé la question dans le cadre général de l’enseignement des langues savantes en
général et de l’arabe en particulier, et évoqué le statut de langue véhiculaire du malais
dans toute l’Asie du Sud Est, Kees Versteegh analyse la plus importante des grammaires
de cette langue, le Bustān al-Kātibīn de Raja Ali Haji (mort vers 1873), dont l’organisation
est apparemment inspirée de deux abrégés de grammaire arabe très répandus dans le
monde musulman, la Alfiyya d’Ibn Mālik (mort en 1274) et la Muqaddima Ājurrūmiyya
d’Ibn Ājurrūm (mort en 1327). L’un des traits caractéristiques de ce court traité est
l’emploi d’une terminologie vernaculaire. Tout aussi significatif est l’emploi de la
terminologie arabe des marques casuelles (iʿrāb) pour décrire une langue qui en est
dépourvue ; c’est également un trait que l’on retrouve dans les premières grammaires
des vernaculaires européens.
9 Les trois contributions suivantes abordent, quant à elles, des questions plus
ponctuelles, relatives à l’emprunt et à l’adaptation de tel ou tel outil particulier. À
propos des grammaires de l’hébreu, Judith Kogel examine les problèmes nouveaux
créés par la notion de racine trilittère, reprise à la tradition grammaticale et
lexicographique arabe, où elle fait figure à l’origine de simple moyen technique
permettant de classer le lexique. Relativement facile à utiliser en arabe, en raison du
caractère hautement régulier et prédictible de la morphologie, il est en revanche plus
complexe dans le cas de l’hébreu, où la racine n’apparaît pas toujours clairement, ce qui
conduit le grammairien Profiat Duran, au XIVe siècle à élaborer un système de règles
didactiques permettant d’identifier les racines « faibles ».
10 C’est le domaine syriaque qu’aborde ensuite Georges Bohas ; on a signalé plus haut la
particularité de cette tradition, qui s’est constituée sur le modèle grec, à travers
l’adaptation de la Tekhnè de Denys le Thrace – ce qui explique, par parenthèse, qu’elle
n’a jamais adopté la notion de racine trilittère. C’est donc dans un système déjà
construit que Bar Hebraeus, au XIIIe siècle, importe la notion de transitivité5, ou plus
exactement de « transitivation » (taʿdiya), au moyen de laquelle les grammairiens
arabes rendent compte de la relation sémantique entre la forme simple du verbe et ses
deux formes causatives-factitives, faʿʿala et ʾafʿala, pour lesquelles il existe des
équivalents en syriaque, l’idée étant que le redoublement de la consonne médiane ou
l’ajout du préfixe ʾa- rend transitifs les verbes intransitifs (e.g. ḫaraja ‘sortir’ et ʾaḫraja
‘faire sortir quelqu’un’) et doublement transitifs les verbes transitifs. Il s’agit donc d’un
emprunt ponctuel, qui permet d’affiner la présentation de la morphologie verbale, le
système général de la grammaire restant inchangé.
11 C’est également une question de morphologie verbale qu’aborde Robert Ermers, avec la
construction du passif en turc. Question relativement difficile, dans la mesure où
l’arabe présente deux formes de passif : un passif apophonique, qui est le passif
proprement dit (e.g. kasara ‘il a cassé’ vs kusira ‘il a été cassé’) et un réfléchi-passif à
préfixe (kasara ‘il a cassé’ vs inkasara ‘il s’est cassé’). De son côté, le turc a lui aussi deux
marqueurs de passif, dont la distribution répond à des critères différents : le problème,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
11
pour des grammairiens raisonnant à partir de l’arabe, est de savoir si, et dans quelle
mesure, il est possible de faire coïncider les deux systèmes.
12 Nous abordons le domaine copte avec la contribution d’Adel Sidarus, tout
particulièrement centrée sur la question de l’adaptation de la terminologie
grammaticale arabe à la description de cette langue. Après une présentation détaillée
des grammaires existantes et de leur organisation, l’exposé aborde le traitement de la
morphologie, et notamment les problèmes posés par le caractère agglutinant du copte,
très différent en cela de l’arabe. La question de la phonographématique retient
également l’attention : contrairement aux autres langues abordées ici, qui ont toutes
des systèmes graphiques de type sémitique ne notant pas les voyelles 6, le copte a un
alphabet dérivé du grec, ce qui a de curieuses implications terminologiques.
13 Le sixième et dernier article occupe une place un peu décalée relativement aux autres ;
on pourrait y voir une manière d’« heureuse transition » (ḥusn al-taḫalluṣ, comme
disent les rhétoriciens arabes) entre le dossier proprement dit et la section « Varia ».
Cela étant, la manière dont les grammaires arabisantes, d’Erpenius à nos jours, ont
compris et présenté la phrase nominale (jumla ismiyya) des grammairiens arabes n’est
pas sans rapport avec la problématique centrale de l’intertraductibilité – s’il est permis
d’employer ce néologisme un peu barbare – des catégories linguistiques d’une tradition
à l’autre.
14 Tel qu’il est, ce dossier n’a nullement la prétention d’épuiser une matière dont on a pu
mesurer la richesse : sans parler des langues qui n’ont pu être abordées ici (il existe
aussi, semble-t-il, des grammaires du berbère et du kurde sur le modèle arabe), il reste
bien des questions en suspens, et bien des textes à explorer. Souhaitons simplement
que cette première étape soit poursuivie par des travaux futurs, et que se prolongent
les échanges auxquelles ce projet a donné lieu.
BIBLIOGRAPHIE
Auroux, S., Koerner, E. F. K. et Niederehe, H.‑J., éd. 2000. History of the language sciences. An
international handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the present. Vol.
1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 18/1. Berlin : W. de Gruyter.
Aussant, É. 2017. La Grammaire sanskrite étendue – État des lieux. Histoire Épistémologie Langage,
no 39 : 7‑20.
Ermers, R. 1999. Arabic grammars of Turkic. The Arabic linguistic model applied to foreign languages &
translation of ʾAbū Ḥayyān al-ʾAndalusī’s Kitāb al-ʾIdrāk Li-Lisān al-ʾAtrāk. Studies in Semitic
languages and linguistics 28. Leyde/Boston/Cologne : Brill.
Guillaume, J.‑P. 2012. À propos d’un fragment du Marāḥ al-Arwāḥ d’Ibn Masʿūd. Dans En mémoire
de Sophie Kessler-Mesguich. Colloque international éponyme tenu et organisé à Paris par le Musée d’art et
d’histoire du judaïsme, 28‑29 novembre 2010, éd. par J. Baumgarten, J. Costa, J.‑P. Guillaume et J.
Kogel, 283‑292. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
12
Itzhaki, M. 2013. L’art poétique arabe en hébreu biblique : la poésie hébraïque en Espagne. Dans
Histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, éd. par B. Stora et A. Meddeb,
925-933. Paris : Albin Michel.
Jeremiás, É. M. 1993. Tradition and innovation in the native grammatical literature of Persian.
Histoire Épistémologie Langage, no 15 : 51‑68.
Jeremiás, É. M. 1997. Zā’id and Aṣl in early Persian prosody. Jerusalem studies in Arabic and Islam, n o
21 : 167‑186.
Jeremiás, É. M. 1999. Grammar and linguistic consciousness in Persian. Dans Proceedings of the
third European conference of Iranian studies, held in Cambridge, 11th to 15th September, 1995, Part 2:
Mediaeval and modern studies, éd. par Ch. Melville, 19‑31. Beiträge zur Iranistik 17. Wiesbaden : Dr.
Ludwig Reichert Verlag.
Jeremiás, É. M. 2000. Arabic influence on Persian linguistics. Dans Auroux et al. 2000 : 329‑333.
Jeremiás, É. M et MacKenzie, D. N. 2010. The grammatical tradition in Persian: Shams-i Fakhrī’s
rhyme science in the fourteenth century. Iran, no 48 : 153‑162.
Valle, C. del. 2000. Hebrew Linguistics in Arabic. Dans Auroux et al. 2000, 234‑240.
NOTES
1. Pour une présentation plus générale de cette problématique, qui ne concerne pas que la
grammaire arabe, voir Aussant (2017).
2. Sur la grammaire persane, qui n’est pas abordée ici, on pourra se reporter aux travaux d’Éva
M. Jeremiás, (notamment Jeremiás 1993, 1997, 1999 et 2000 ; Jeremiás et MacKenzie 2010), qui
abordent les principaux aspects de cette tradition.
3. Elle a été traduite et analysée dans Ermers (1999).
4. Sur cette « vulgate épistémologique » qui sous-tend globalement la tradition linguistique
arabe, voir Guillaume (2012).
5. Notons que cette notion existe en fait dans la tradition grecque, notamment chez Apollonius
Dyscole, sous le nom de diabasis (Lallot 1997, vol. 2, p. 418) ; toutefois, absente de la Tekhnè, elle
n’a pas été reprise par les premières grammaires syriaques (d’après une communication orale de
G. Bohas).
6. Ce qui n’est d’ailleurs pas sans poser des problèmes dans le cas des langues ayant adopté
l’écriture arabe, comme le souligne notamment Kees Versteegh à propos du malais, ainsi que
Jeremiás et MacKenzie (2010) à propos du persan.
AUTEUR
JEAN-PATRICK GUILLAUME
CNRS, Histoire des théories linguistiques (UMR 7597, HTL), Paris, France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
13
Extended grammar: Malay and the
Arabic tradition
Kees Versteegh
1 Learning a learned language
1 The reasons for choosing a learned language and the mechanisms by which this learned
language becomes entrenched in an educational system have been studied extensively,
for instance by Ostler (2005) and Hamel (2005).1 Learned languages may be useful for
any number of religious, political, or scholarly reasons, but are typically not used for
everyday communication. Historical examples include Sumerian in Akkad, Latin in
Medieval Europe, Greek in Classical Rome and in the Hellenistic world, Sanskrit in
Southeast Asia, Chinese in East Asia, Persian in the Mughal and Ottoman empires, and
Arabic in large parts of the Islamic world.
2 Those who know a learned language become members of an elite, who can afford to
send their children to the right schools where the learned language occupies a central
place. For practical reasons, a vernacular language often serves as the medium of
instruction. In the Arabic-speaking world, for instance, Berber was used in schools in
the Sous region as a language of instruction for beginning students. Referring to the
Qurʾānic verse (Q. 14/4) that God has sent messengers to each community in their own
language, the Berber poet Muḥammad Aẓnag (16th century CE) expresses this as
follows: “Arabic is the language of the Seal of the Prophets/A Berber will understand it
in Berber” (lʿarabi lluġa n ḫātimu lanbiyya/yan igan amaziġ ifhm t s lmazġiy-i) (van den
Boogert 1997: 49).
3 Teaching a learned language takes place largely on the basis of texts, which are
memorized together with their translation in the vernacular language. The translation
is often word-by-word, creating a linguistic variety that Riddell (2002) calls
“translationese”. Eickelman (1978) has analyzed how such a system of learning affects
the selection of texts and the establishment of a canon in all disciplines, including
grammar. For most students, linguistic knowledge was determined by a few
grammatical treatises learnt by heart together with their translation.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
14
4 The translating tradition created a stock of technical terms in the vernacular language.
The teaching of Latin in the abbey of Saint Gall, for instance, took place with Old High
German as an auxiliary language. As a result, a host of Old High German loan
translations of Latin terms entered the language (Grotans 2006). In other cases, the
Latin terminology was taken over wholesale in the form of loanwords. In the Irish
tradition, two sets of terminology were used, one with mostly Irish loan translations,
intended for an audience of students and learners, the other with mostly Latin
loanwords, used by scholars (Poppe 1999). In much of the Islamic world, the Arabic
tradition was followed faithfully and its technical lexicon predominated, so that Arabic
loanwords constituted the bulk of new technical terminology, with only a relatively
small number of loan translations, as in Persian and Turkic grammar. In this respect,
the Malay tradition was an exception, since, along with Arabic loanwords, it frequently
used loan translations.
5 The coexistence of two languages in education is likely to provoke a comparison of
their structure and qualities. The vernacular language is usually seen as a poorer
variety, more lively, perhaps, and better suited to the expression of feelings, but not as
rich or rational as the learned language, and certainly not deserving a grammatical
analysis of its own. Most people speak the vernacular language as their mother tongue
anyway and do not feel the need for a grammar. Yet, in some cases, scholars took the
initiative to write a grammar of their vernacular language, for which they depended on
the grammatical framework of the learned language. In Europe, Latin, the language in
which all religious and scientific literature was written (Waquet 1998), provided the
framework for all grammar study. The universality of its structure was taken for
granted, even when people were aware of the differences with their own vernacular.
6 The full emancipation of the vernacular language became possible only when the socio-
political context changed. In Europe, the triggering factor was the establishment of
political entities that focused on their identity as a nation with a language of its own.
After the Reconquista had been completed, the Spanish kings strove at founding an
empire with one ruler, one religion, and one language. The publication of Nebrija’s
grammar of Castilian in 1492, the first of its kind in Europe, showed that this new
imperial language was just as capable of expressing anything as the prestige language,
Latin. Nonetheless, the linguistic framework in which this newly emancipated language
was described remained the Latin one.
7 In the Arabic-speaking world, too, vernacular languages were generally seen as inferior
to Arabic and not deserving a grammar of their own. Exceptions to this view are few
and far between. In a discussion about the Syriac language that took place in 364/1026
between the Christian bishop Elias of Nisibis and the vizier ʾAbū l-Qāsim al-Ḥusayn
ibn ʿAlī, the Syrian bishop vigorously defended the superior quality of the Syriac
language (Bertaina 2011): Not only is it possible to say in Syriac whatever you can say in
Arabic, but it is even superior. When Elias is asked by the vizier whether Syriac
distinguishes between the agent and the object by means of case endings (ʾiʿrāb), he
explains that in Syriac a particle, l-, is used for the object, at least in those cases where
confusion is possible. This is much better than the Arabic system, he says, which breaks
down in words with virtual endings, like ḍaraba ʿīsā mūsā ‘ʿĪsā hit Mūsā’. Elias states
that the ʾiʿrāb fails in its main function, i.e. removing ambiguity (labs, iltibās), not only
between fāʿil (agent) and mafʿūl (object), but also between sentence types, such as
assertion and question (Majālis: 116-118). In spoken Arabic and Syriac, such distinctions
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
15
are expressed by intonation (naġamāt al-ṣawt; ibid.: 113.8), but while in written Arabic
there is no way to indicate them, Syriac scholars have devised a system of
interpunction (ʿalāmāt) for this purpose (ibid.: 122).
8 The pride Elias takes in the Syriac language may have had something to do with the fact
that before the emergence of the Arabic tradition Syriac possessed a grammatical
tradition of its own. In other cases, language communities developed their own
tradition in Islamic times. The revival of Coptic and the emergence of Coptic grammars
in the thirteenth century CE, for instance, came at a time of social and cultural
emancipation of the Copts, when Coptic scholars aimed to demonstrate the rich texture
of their language (Sidarus 2010). A similar apologetic aim is found in the dictionary of
the Turkic languages by al-Kāšġarī (11th century CE). In his Dīwān luġāt al-Turk, he
intended to show that the Turkic languages were just as capable as Arabic to express
complex thoughts, with an equally rich lexicon (Ermers 1999: 17).
9 While Syriac could not qualify for ʾiʿrābhood because it does not have endings, some
languages do have declensional endings. In Persian, the direct object suffix -rā was
interpreted by Persian grammarians as a ḥarf-i taḫṣīṣ ‘particle of specification’, until
later grammarians named it ʿalāmat-i mafʿūl ‘marker of the object’ (Jeremiás 1997: 174
& 180, n. 20). In Turkic, the ending -nī of the direct object was called by some
grammarians ʿalāmat al-naṣb ‘marker of the accusative’ (Ermers 1999: 163-284). The
Persian and Turkic endings received the Arabic name of the function they expressed
(naṣb, mafʿūl), but were not analyzed as instances of ʾiʿrāb: they expressed the same
syntactic categories as the ones marked by ʾiʿrāb in Arabic, but used different tools to
mark them. This approach parallels the description of European vernacular languages
within a Latin framework: their lack of declensional endings was compensated by
applying Latin case names to the syntactic functions of words.
10 Since the pioneers who started to focus on the vernacular language had been trained in
the powerful linguistic model of the learned grammatical tradition, which had the
status of a universal grammar, valid for all languages, they had to find a way to
accommodate the structure of their own language to this model. In the next section, we
shall see how this played out in the description of Malay in Southeast Asia.
2 Malay as an auxiliary language
11 Arabic was introduced in Southeast Asia in the wake of Islamization through the
thirteenth-fifteenth centuries CE as the written language of the Qurʾān and the Islamic
sciences. The language of instruction in the educational system was Malay, the lingua
franca of the Malaccan peninsula and the Indonesian islands, for which Arabic script
(Jawi) was introduced. Arabic texts were memorized, supported by Malay translations.
Grammar as a topic in the schools focused on Arabic, while there was no formal
teaching of Malay. During the colonial period from the seventeenth century CE onward,
Malay was the language of choice of the British and Dutch administrators, who used it
for communication with the indigenous population. They were the first to write
grammars of the language for the purpose of training colonial officers, within a
Western linguistic framework and terminology (Kaptein 2000).
12 When at the end of the nineteenth century a few Malay scholars started to describe
their own language, they did not employ the colonial model, but that of Arabic
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
16
grammar, which until then had been used in Southeast Asia exclusively for the study of
Arabic. Yet, since the teaching method in all Islamic disciplines, including grammar and
Qurʾānic exegesis, was based on Malay translations, an indigenous Malay terminology
had gradually been developed (Riddell 2017). Thus, when these pioneers started to
write a grammar of their own language, they did not need to develop all of its
terminology from scratch, but could draw on an existing stock of Malay terms
(Versteegh 2019).
13 The first and foremost Malay-written grammar of Malay was that of Raja Ali Haji
(probably d. 1873), a scholar from the Sultanate of Johor-Riau. At the sultan’s court, a
form of Classical Malay had become the cultural language shared by courtiers and
Dutch colonial administrators alike. In his Bustān al-kātibīn [Garden of writers] (1857),
Raja Ali Haji provides a grammatical analysis of this Malay, 2 while his incomplete
dictionary Kitab pengetahuan bahasa [Book of the knowledge of the language], written in
the 1850s, aims at exploring the lexicon of the language. It opens with a compendium of
Arabic grammar (Pengetahuan: 1-27) and features a large number of Arabic grammatical
terms (van der Putten 2002).
14 One of the factors motivating Raja Ali Haji to engage in this project was the deficient
performance of many speakers, for whom Malay was a second language, used for
interlanguage contact and for dealing with the colonial administration. He explains
that many people make mistakes while writing Malay:
I have met many people, either Malays from Johor, or other Malays, not to mention
people from other nations, who did not have Malay as their own language and
whose faulty practice even reached the point where they started to teach each
other, while believing themselves to be experts in this science (Telah banyaklah aku
dapat orang Melayu Johor atau Melayu yang lainnya, apalagi orang yang lain-lain bangsa
daripada bangsa yang bukan bahasa Melayu itu bahasa dirinya, hingga berpanjanganlah
amalnya yang palsu itu hingga mengajarlah setengahnya akan setengahnya padahal ia
menyangkakan akan dirinya ahli pada ilmu itu; Bustān: 6).
15 This is a recurrent theme in his treatise: as people make mistakes in writing or
speaking Malay, their work becomes worthless. What is worse, they are not even aware
of the fact that their Malay is faulty. Since a number of letters of the Arabic alphabet
are not used in spoken Malay, people err by adding or omitting letters (ibid.: 13), or by
writing the wrong ligatures (ibid.: 14). This shows that they possess only “stolen
knowledge” (ilmu yang dapat dicurinya; ibid.: 14.18f.). The concluding chapter of the
treatise (ibid.: 48-51) touches upon yet another aspect of the author’s didactic ambition
in writing his grammar. It is dedicated to the art of epistolography and includes precise
instructions on the proper way to address people of different rank, urging the reader to
use a polite style of Malay (ibid.: 49).
16 Like the Coptic, Turkic, and Syriac grammarians, Raja Ali Haji describes his own
language on the premiss that anything said in Arabic can also be said in Malay. Both
languages share an underlying structure that is identical with the model of the Arabic
grammarians. He does not aim at a full-scale grammatical description of the Malay
language, but only at a short instruction for those wishing to improve the quality of
their writing and speaking. Yet, some rules are necessary:
Nonetheless I have, where necessary, borrowed explanations, analogies, and
methods from the science of the Arabs, such as ṣarf ‘morphology’, naḥw ‘syntax’,
luġa ‘lexicography’ and others from the scientific literature, to compose this book...
(Syahadan sungguhpun yang demikian itu tempatnya aku mengambil petua dan kias dan
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
17
jalan memperbuat kitab ini, iaitu ilmu Arab juga seperti ṣarf dan naḥw dan luġa dan
lainnya daripada kitab ilmu...; Bustān: 24.33-25.1).
17 And, indeed, he freely uses Arabic grammatical terminology and, in some sections,
snippets of linguistic theory taken from the Arabic grammatical literature. The main
source for his description is the ʾĀjurrūmiyya and its commentaries, 3 as is clear from the
parallels in treatment. In addition, he must have been familiar with the ʾAlfiyya
tradition. Since the elementary grammatical treatises and commentaries are highly
interdependent, it is not always possible to pinpoint the exact source. Viain’s (2014)
detailed comparison of the structure of the ʾAlfiyya (2014: 228-253, 504-508) and the
ʾĀjurrūmiyya (2014: 254-259, 509-511) points out the following differences between
them:
i. Both texts have a rough division into nouns and verbs, but the ʾĀjurrūmiyya first treats
general rules of ʾiʿrāb, while the ʾAlfiyya first deals with a number of other constructions
(relatives, numerals, ḥikāya).
ii. The ʾĀjurrūmiyya starts with the verb, the ʾAlfiyya with the noun; for the noun, both
traditions follow a division into marfūʿāt, manṣūbāt, maḫfūḍāt.
iii. Within the nominative constructions, the ʾĀjurrūmiyya starts with the fāʿil, the ʾAlfiyya with
the mubtadaʾ.
iv. Within the accusative constructions, the ʾĀjurrūmiyya begins with the mafʿūl bihi, followed
by the mafʿūl muṭlaq, while the ʾAlfiyya has the reverse order.
v. Within the satellite constructions, the order in the ʾĀjurrūmiyya is naʿt − taʾkīd − ʿaṭf −
badal; in the ʾAlfiyya tradition taʾkīd and ʿaṭf switch places.
18 A look at the chapters of the Bustān (Table 1) shows that sometimes their order reflects
that of the ʾĀjurrūmiyya, for instance by treating first the mafʿūl bihi and then the mafʿūl
muṭlaq, but at other times it follows more closely that of the ʾAlfiyya tradition, for
instance in treating the noun before the verb, and the mubtadaʾ before the fāʿil. Within
the chapters, the relationship with the ʾĀjurrūmiyya commentaries is evident, yet it
appears that the author inserted remarks from an amalgam of different traditions.
Obviously, as a nineteenth-century Muslim intellectual he must have been familiar with
commentaries from both traditions.
Table 1. Chapters of the Bustān
introduction p. 3-11
§1 letters p. 12
§2 alphabet p. 12f.
§3 Jawi spelling p. 13
§§4-9 orthography p. 13-25
§10 parts of speech p. 25f.
§11 ism p. 26-29
§12 fiʿl p. 29-32
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
18
§13 ḥarf p. 32-38
§14 kalām/kalima p. 38f.
§15 mubtadaʾ/ḫabar p. 39-42
§16 types of sentence p. 42
§17 fiʿl/fāʿil p. 42f.
§18 mafʿūl bihi p. 43
§19 mafʿūl muṭlaq p. 43f.
§20 mafʿūl lahu p. 44
§21 mafʿūl fīhi p. 44
§22 mafʿūl maʿahu p. 44
§23 ḥāl p. 44f.
§24 tamyīz p. 45
§25 taʾkīd p. 45
§26 badal p. 45f.
§27 ṣifa p. 46
§28 ʾiḍāfa p. 47
§29-30 epistolography p. 47-51
epilogue p. 51-53
19 There is one aspect in which Raja Ali Haji’s work differs from the commentaries in the
Arabic tradition: his preoccupation with spelling and orthography. Spelling rules did
not form part of Arabic grammar, but were crucial in Southeast Asia because of the
idiosyncrasies of the Jawi script. Raja Ali Haji’s discussion of ʾiʿrāb (Bustān: 20f.) starts
with the observation that it consists of a stroke (baris) above or underneath the letter,
indicating a vowel, in combination with a letter wāw, yāʾ, or ʾalif. This clearly addresses
the representation of vowels in Jawi script, rather than declension, which is inexistent
in Malay. But then, confusingly, he continues by defining ʾiʿrāb as “changes in the
endings of speech due to the difference in governing words, overt or implicit” (mā
taġayyara ʾawāḫir al-kalām li-ḫtilāf al-ʿawāmil al-dāḫila ʿalayhā lafẓan ʾaw taqdīran; ibid.:
20.14f.).4 However, he says, the rules of ʾiʿrāb are very difficult and “it is not my purpose
to translate the ʿilm al-naḥw, but only to set up rules for writing and speaking Malay”
(bukan maksudku hendak menterjemahkan ilmu nahu, hanyalah maksudku hendak mengatur
peraturan tertib surat-suratan dan perkataan bahasa Melayu juga; ibid.: 24.29-31). Therefore,
he returns to the rules for correctly spelling the vowels in Malay, which are dealt with
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
19
in the first nine sections of his treatise after the introduction (ibid.: 12-25). The main
problem is that in Jawi script vowels are sometimes marked with and sometimes
without a glide consonant. A word like kepada ‘for’ is spelt correctly <kpd>, but di dalam
‘within’ is spelt <ddʾlam>. According to Raja Ali Haji, people without an education are
confused by this orthography and do not grasp the underlying rules (ibid.: 21). The
main rule, he says, is that in words that are free from ambiguity, there is no need for
any additional letters to indicate the pronunciation: <drpd> is immediately recognized
as daripada ‘from’, so there is no need for clarification. But in words like kota ‘city’, kata
‘word’, kita ‘we [incl.]’, writing the glide <kʾt>, <kwt>, and <kyt> is necessary in order to
distinguish them from each other (ibid.: 23).5
20 It is not clear whether Raja Ali Haji regards Arabic as a superior language. He seems to
believe firmly in the richness of his own language, at least for those who know how to
speak it well. Occasionally, however, he refers to a qualitative difference in the
linguistic inventory, for instance with respect to the negations. After explaining that
the Malay negation tiada is used for both generic and specific negations, he remarks:
Malay is extremely poor compared to Arabic. In Arabic there are two, three, four
different negative particles, each with its own rules (Sangatlah miskinnya bahasa
Melayu ini jika dibangsakan dengan bahasa ʿArab. Adapun pada bahasa ʿArab ḥarf tiada
itu ada dua, tiga, empat jenis, masing-masing dengan hukumnya; ibid.: 35.23-26).
21 Differences between the two languages are noted throughout the Bustān, for instance in
the verbal system. Raja Ali Haji explains that there are three classes of verbs, fiʿl māḍī
(perfect), fiʿl muḍāriʿ (imperfect), and fiʿl ʾamr (imperative). In Arabic, these three
classes have different forms, but in Malay, the same meanings can be expressed by
adding a particle (ibid.: 30.2f.): “As the sign of the fiʿl māḍī telah may be used, e.g. telah
memukul ‘he hit’” ( Adapun tanda fiʿl māḍī itu, boleh ditanggungkan telah seperti telah
memukul). The term tanda is used here as an equivalent of ʿalāma ‘sign, marker’, which
occurs elsewhere. Likewise, the fiʿl muḍāriʿ is expressed by adding lagi akan, e.g. lagi
akan memukul ‘he’ll hit’ (ibid.: 31.7).
22 Another example occurs in the discussion about those particles that govern the
genitive (jarr), where it is stated explicitly that the two languages express the same
meaning with different syntactic means:
When this particle occurs in Arabic, it needs its majrūr [i.e. genitive] which is
governed by it.6 In Malay there is no mention of its majrūr, only of its intention and
its meaning (Jika pada bahasa ʿArab datang ḥarf itu berkehendaklah majrūrnya yang
dikhabarkannya. Jika pada bahasa Melayu tiadalah dibicarakan majrūrnya itu melainkan
kehendaknya dan maknanya jua, adanya; ibid.: 32.12-15).7
23 In the next section, we shall follow the order of the chapters of the Bustān to see how
Raja Ali Haji extends the rules of Arabic grammar to Malay.
3 Arabic grammar extended to Malay
24 Raja Ali Haji’s indebtedness to the Arabic grammatical tradition is evident right away
from his classification of the parts of speech, in which he follows the Arabic
tripartition:
Speech that is produced has to be one of three things. The first is in Arabic ism,
which means ‘name’, the second is fiʿl, which means ‘action’, and the third ḥarf. By
this we mean here the ḥarf that has a meaning 8 (Bermula yang diperbuat perkataannya
itu tiadalah sunyi ia daripada tiga perkara. Pertama, pada bahasa ʿArab ism yakni nama,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
20
dan kedua, fiʿl yakni perbuatan, dan ketiga ḥarf. Maka dikehendak ḥarf di sini ḥarf yang
ada baginya makna; ibid.: 25f.).
25 After having introduced the three parts of speech with their Arabic names and the
Malay equivalent for the noun (nama) and the verb (perbuatan), Raja Ali Haji deals with
each part in a separate section under its Arabic name (ism, ibid.: 26-29; fiʿl, ibid.: 29-32;
ḥarf, ibid.: 32-38). The order of treatment, first the noun, then the verb, follows that of
the ʾAlfiyya, as the ʾĀjurrūmiyya begins with the verb.
26 Within the sections about the noun and the verb, the pattern of the ʾĀjurrūmiyya is
followed more or less closely. For the nouns, the division into indefinite (nakira) and
definite (maʿrifa) nouns9 follows right after the classification of the parts of speech
(ibid.: 26-29). The definite nouns are divided into five categories, ḍamīr (personal
pronoun), ʿalam (proper noun), ʾišāra (demonstrative), mawṣūl (relative), ʾiḍāfa
(annexion), omitting the noun with the definite article, but splitting the category of
mubham (a generic term for demonstrative and relative pronouns) of the ʾĀjurrūmiyya
into demonstratives and relatives.10
27 For the analysis of the verbal forms in Malay, we need to go to the Kitab pengetahuan
bahasa. According to van der Putten (2002: 426), two verbal forms are analyzed by Raja
Ali Haji as nominals: the meN- form, which focuses on the agent, is called ism fāʿil and
translated as orang yang... ‘someone who...’, whereas the di- form, which focuses on the
patient, is called ism mafʿūl and translated as orang yang kena... ‘someone who is affected
by...’. A typical example is found in the lemma ubat (obat) ‘medicine’ (Pengetahuan: 87f.),
with its derived forms (Table 2). The term ism fiʿl is used to indicate the root word ubat,
which can only be used nominally.11 While the explanation of the derived forms does
not impose a nominal interpretation per se, the terminology used in classifying them
does not seem to leave room for any alternative interpretation.
Table 2. The lemma ubat in the Pengetahuan: 87f.
ubat
[explanation of what a medicine is] ism fiʿl
‘medicine’
mengubat “i.e., someone who heals someone” (iaitu orang yang mengubatkan
ism fāʿil
‘to heal’ orang)
diubatkan “i.e. someone who has undergone treatment” (iaitu orang yang kena
ism mafʿūl
‘to be treated’ ubat)
berubat
“i.e., someone who has fallen ill takes a medicine” (iaitu orang yang
‘to take a ḥāl
kena penyakit berubat ia)
medicine’
ubatkanlah “i.e., someone orders someone to treat a patient” (iaitu seseorang
fiʿl ʾamr
‘heal!’ menyuruh kepada seseorang mengubatkan penyakit)
perubatan
“i.e., people are discussing the act of taking medicine” (iaitu orang yang taʾwīl
‘taking
berkhabar-khabar akan pekerjaan berubat-ubatan) maṣdar
medicine’
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
21
ubatan ism
“i.e., some components” (iaitu beberapa juzuk)
‘medicine’ maṣdar
28 Within the category of particles (ḥurūf), Raja Ali Haji distinguishes between the ḥurūf
jarr (prepositions) and those particles that serve to add a meaning to the sentence. The
criterion by which the two categories are distinguished is the category of the Arabic
equivalent of the Malay particle. To the former category belong those particles that
correspond to Arabic particles governing the genitive, such as dengan (Arabic bi- ‘with’,
‘by [in oaths]’, etc.), daripada (Arabic min ‘from’), kepada (Arabic li- ‘for’), seperti (Arabic
ka- ‘as’), etc. To the latter category belong particles used to address someone, like hai,
wai, weh, corresponding to the ḥurūf al-munādāt (vocative particles); melainkan,
introducing exceptions; and tetapi ‘but’, a ḥarf al-istidrāk (Bustān: 34). 12
29 There is yet a third category of particles, discussed by Raja Ali Haji under the label of
ḥarf Melayu ‘Malay particles’ (ibid.: 37.5), apparently because they have no direct Arabic
equivalent. He shows himself to be an acute observer of the fine pragmatic nuances
that some of these particles convey, for instance when he states that the particle amboi
‘gosh!’ may indicate both amazement and disappointment, depending on the intonation
(ibid.: 37.30-34).
30 The next chapter (ibid.: 38f.) introduces the distinction between perkataan ‘speech’ and
kata kata ‘words’, corresponding to that between kalām ‘speech’ and kalima ‘word’ in
Arabic linguistic theory. In the ʾĀjurrūmiyya tradition, the four distinctive features of
kalām are the following (Carter 1981: 8-10): it is a formal utterance (lafẓ), composite
(murakkab), informative (mufīd), and conventional (bi-l-waḍʿ). This excludes, among
other things, speech by someone sleeping, and self-evident statements of the type al-
samāʾu fawqanā ‘the sky is above us’ and al-ʾarḍu taḥtanā ‘the earth is beneath us’. Two
of these criteria are repeated almost verbatim by Raja Ali Haji, who defines perkataan as
“an utterance that conveys useful information” (lafaz yang memberi faedah; ibid.: 38.26f.).
He then gives the Malay translation of the two Arabic sentences quoted above, langit di
atas kita and bumi di bawah kita, and declares that these fall outside the definition of
speech (perkataan), because they do not convey new information. 13
31 In his discussion of syntax, Raja Ali Haji parses Malay sentences in the same way as in
Arabic grammar. A sentence may begin with a noun serving as mubtadaʾ (topic), on
which a ḫabar (predicate) is ‘made to lean’, in other words, ‘which supports a
ḫabar’ (ibid.: 39). The terms for the sentence constituents are introduced with their
Arabic form, but also with a Malay translation, permulaan (mubtadaʾ), berita (ḫabar); the
verb bersandar ‘to lean on’/ disandarkan ‘to be made to lean on’ apparently reflects
Arabic musnad/ʾisnād, which is not used in this text.14 As an example of a nominal
sentence he cites zaydun qāʾimun ‘Zayd is standing’, which is translated as si zaid yang
berdiri, where the relative sentence yang berdiri ‘who is standing’ translates Arabic
qāʾimun.15
32 The rules (hukuman) for the nominal sentence are taken directly from Arabic syntax,
for instance, the restriction that the mubtadaʾ cannot be an indefinite noun. Their
dependence on the rules of Arabic grammar makes some of these restrictions difficult
to understand when applied to Malay. One set of rules concerns the placement of the
predicate, which in principle follows its topic. In some cases, this position is
compulsory. Al-Širbīnī (Nūr: 202-204) mentions three of them: i) when there might be
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
22
confusion because both topic and predicate are definite, as in zaydun ʾaḫūka ‘Zayd is
your brother’, unless the context makes clear which is the predicate, as in ʾabū yūsufa
ʾabū ḥanīfata ‘ʾAbū Yūsuf is ʾAbū Ḥanīfa’; ii) when the topic might become confused with
the agent, so that the nominal sentence turns into a verbal sentence, as in qāma zaydun
‘Zayd stood up’; and iii) when the predicate is accompanied by ʾillā or ʾinnamā.
33 All three cases are mentioned by Raja Ali Haji, even though they are hardly valid for
Malay. For the first case, he mentions the sentence si zaid itu saudaramu ‘Zayd is your
friend’ as an example of a sentence in which the predicate needs to be placed last. This
restriction does not apply, he says, when the context indicates the predicate, as in ʾabū
yūsufa ʾabū ḥanīfata ‘ʾAbū Yūsuf is ʾAbū Ḥanīfa’ (Bustān: 41.8f.).
34 The second restriction deals with the relationship between nominal and verbal
sentences:
35 Don’t say telah berdiri si zaid ‘Zayd stood up’! If something like that is said, i.e. telah
berdiri si zaid, it does not fall under the heading of topic/predicate, but under the
heading of verb/agent (Maka jangan dikata telah berdiri si zaid, dan jika dikata juga seperti
itu yaʿni telah berdiri si zaid, maka bukanlah pada bab mubtadaʾ ḫabar ini, tetapi adalah ia
pada bab fiʿl dengan fāʿil; ibid.: 20-23).
36 As for the third restriction, he simply states that in a sentence with hanya sungguhnya
‘only’ or melainkan ‘except’ the predicate always follows ( ibid.: 41.31f.). The rather
unnatural sounding example he cites for this restriction, tiada ada si zaid itu melainkan
yang berdiri ia, probably means something like ‘It is not the case that Zayd is [anything
else] than that he is standing’.
37 The author also deals with the elision of the topic or the predicate (cf. Carter 1981: 204).
One of the cases he mentions is that of the predicate after the Malay equivalent of lawlā
‘if it weren’t for’. The example sentence in Malay, jikalau tiada si zaid binasalah si ʿumar
‘If it weren’t for Zayd, ʿUmar would be lost’ (Bustān: 42.7), looks constructed. This
particular case derives from the commentaries on the ʾAlfiyya (v. 138), for instance by
Ibn ʿAqīl (Šarḥ I: 248; see also Zamaḫšarī, Mufaṣṣal: 14.6f.; Ibn Hišām, Qaṭr: 121).
38 Some of the rules are incomprehensible outside the context of Arabic grammar, for
instance the rule that with a predicate consisting of a single word no pronoun is
expressed. This is explained in the following passage, one of the few instances of an
Arabic grammarian being mentioned by name:
39 In a ḫabar mufrad, such as si zaid saudaramu ‘Zayd is your friend’, the rule of the ḫabar is
not to receive a pronoun, i.e. ia ‘he’. But according to al-Kisāʾī [d. 189/805] and al-
Rummānī [d. 384/994], and a group of others, a pronoun must be understood here, as
when you say si zaid saudaramu yaʿni ia ‘Zayd is your friend’, i.e. ‘he’ (adapun misal ḫabar
yang mufrad itu ‘si zaid saudaramu’ adalah hukum ḫabar ini tiadalah diberi ḍamīr yakni ‘ia’;
akan tetapi pada Syeikh Kisaʾi dan Syeikh Rumani dan beberapa jamāʿah, harus ditanggungkan
ḍamīr, seperti katamu ‘si zaid saudaramu’ yaʿni ‘ia’; Bustān: 40).
40 The issue concerning the presence of a pronoun in a nominal sentence, which is
irrelevant for Malay, derives from a well-known controversy in Arabic grammar (see
Ibn al-ʾAnbārī, ʾInṣāf: 30f.) about the question of whether a single noun as ḫabar in a
sentence like ʿamr ġulāmuka ‘ʿAmr is your slave’ contains a pronoun referring to the
mubtadaʾ. According to the Kufans (i.e. al-Kisāʾī) and al-Rummānī, this predicate
contains a pronoun, since it is equivalent to a participle ḫādimuka ‘your servant [lit.
your serving one]’, which according to all grammarians contains a pronoun. This
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
23
particular statement probably derives from the commentaries on the ʾAlfiyya: Ibn ʿAqīl
(Šarḥ I: 205) mentions the opinion of al-Kisāʾī wa-l-Rummānī wa-jamāʿa, which is similar
to the passage in the Bustān.
41 After the topic/predicate, our text discusses the agent (fāʿil) and the verb (fiʿl), which is
the order of treatment in the ʾAlfiyya, though not in the ʾĀjurrūmiyya. 16 Nothing much is
said about this sentence type, but mention is made of the fact that the agent may be
overt (ẓāhir) or hidden (tersembunyi); the latter term translates Arabic muḍmar. This is
followed by brief sections on the different types of object (mafʿūl): mafʿūl bihi, mafʿūl
muṭlaq, mafʿūl lahu, mafʿūl fīhi, and mafʿūl maʿahu, followed by other accusative
constructions, ḥāl, tamyīz. In general, the order of treatment of these sections follows
that of the ʾĀjurrūmiyya in putting the direct object first, followed by the mafʿūl muṭlaq,
whereas the ʾAlfiyya tradition starts with the verbal noun. Note that our author uses
mafʿūl muṭlaq instead of maṣdar; the latter is the term used by Ibn ʾĀjurrūm, for which
he is criticized by al-Širbīnī (Carter 1981: 344; cf. Kasher 2019: 206). Raja Ali Haji also
uses mafʿūl fīhi where the ʾĀjurrūmiyya has ẓarf; this is mentioned as an alternative term
by the commentators (ʾAzharī, Šarḥ: 100.6; Kafrāwī, Šarḥ: 261.5; Širbīnī, Nūr: 352).
42 In the ʾĀjurrūmiyya tradition, the next sections deal with the tawābiʿ, satellite
constituents that derive their case ending from the word they follow, i.e. attribute
(naʿt), corroboration (taʾkīd), coordination (ʿaṭf), and apposition (badal). The author of
the Bustān leaves out coordination and deals with the adjective ( ṣifa) at the end.
Concerning taʾkīd, he repeats almost literally the explanation in Daḥlān’s commentary
(Šarḥ: 428-429; absent in al-Širbīnī): corroboration is needed to discard any ambiguity.
When you say ‘Zayd came’, someone might assume that a letter or a messenger from
him has arrived, but this possibility vanishes when you add nafsuhu/dirinya ‘himself’
(Bustān: 45).
43 The section on badal (ibid.: 45f.) follows the ʾĀjurrūmiyya and its commentaries (Širbīnī,
Nūr: 312ff., 318-320) closely. Four kinds of substitution are mentioned:
i. badal al-kull min al-kull: this is not the term used in the ʾĀjurrūmiyya, which has badal al-šayʾ
min al-šayʾ:17 lalu aku dengan saudara engkau si zaid ‘I passed your friend, Zayd’, Arabic jāʾa
zaydun ʾaḫūka ‘Zayd came, your brother’.
ii. badal al-baʿḍ min al-kull: makan aku roti sepertiganya ‘I ate the bread, one third of it’, Arabic
ʾakaltu l-raġīfa ṯulṯahu.
iii. badal al-ištimāl: telah mencengangkan daku si zaid ilmunya ‘I was amazed by Zayd, by his
knowledge’, Arabic ʾaʿjabanī zaydun ʿilmuhu.
iv. badal al-ġalaṭ: aku lihat akan laki akan ḥimār ‘I saw a man, a donkey’, Arabic raʾaytu zaydan al-
farasa ‘I saw Zayd, the horse’.
44 The section on ṣifa ( Bustān: 46) contains a succinct description of the adjective’s
function, not found in the commentaries on the ʾĀjurrūmiyya. According to Raja Ali
Haji, the adjective has five different roles: it serves to specify (taḫṣīṣ), to praise, to
blame, to express commiseration, and to confirm. This last role is illustrated with Q.
69/13 “and when the trump will be blown once” (fa-ʾiḏā nufiḫa fī l-ṣūri nafḫatun
wāḥidatun), translated into Malay as maka apabila ditiuplah pada sangkakala dengan tiup
yang satu.18 Presumably, Raja Ali Haji has taken over from an Arabic commentary a
remark about wāḥidatun emphasizing the singular of the masdar and applied it to the
Malay translation, where the numeral does not have this function.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
24
45 What follows in the ʾĀjurrūmiyya is the chapter about genitive constructions
(maḫfūḍāt), for which there is no direct parallel in Malay grammar. The point picked up
by Raja Ali Haji in the last of the grammatical sections of the Bustān is that of the ʾiḍāfa
(Bustān: 47). This part is similar to that in the ʾĀjurrūmiyya (Carter 1981: 456-458) and
has the same division of the genitive construction into two types, one with the meaning
of li- and one with the meaning of min, in Malay bagi and daripada, respectively. Even
the examples are partly the same, for the first type budak si zaid ‘Zayd’s servant’, as
equivalent of ġulāmu zaydin, and for the second type cincin perak ‘a silver ring’ and kain
sutera ‘a silk cloth’, as (partial) equivalents of ḫātamu ḥadīdin ‘an iron ring’ and ṯawbu
ḫazzin ‘a silk cloth’. Raja Ali Haji adds a third type, absent from the ʾĀjurrūmiyya,
namely the genitive with the meaning of fī ( pada), for which he gives the Malay
example pukul hari itu, translating the Arabic ḍarbu l-yawmi ‘today’s hitting’ that is
mentioned as an example for this type of genitive construction in Ibn al-Ḥājib’s Kāfiya
(p. 108).19
46 The author further remarks that there are two possible constructions of the ʾiḍāfa, one
with a definite noun and one with an indefinite noun as the second constituent. This
mirrors a remark in al-Širbīnī’s commentary (Nūr: 460), that the former is used for
purposes of taʿrīf, the latter for purposes of taḫṣīṣ. The two constructions are explained
in the Malay text as faedah kepada pengenalan ‘[conveying] the meaning of making
known’ for the former, and faedah kepada menentukan ‘[conveying] the meaning of
determining’ for the latter. These two phrases are offered as a translation of the Arabic
terms maʿrifa and nakira, but it is doubtful they could be understood by an average
Malay reader without knowledge of Arabic grammar.
4 Conclusion
47 In compiling his grammar of Malay, Raja Ali Haji followed the model of the grammatical
literature in which he was raised. It is hard to ascertain exactly which treatises were his
main authority, but it seems that he mostly followed the ʾĀjurrūmiyya tradition,
although he borrowed rules and remarks from other commentaries as well. In a fair
number of cases, the grammatical rules and examples cited in the Bustān are irrelevant
for the structure of Malay. His desire to find Malay analogues for Arabic constructions
is evident, even to the point where he constructs Malay sentences rather than deriving
them from living speech. The Malay practice of learning Arabic texts by heart together
with a Malay translation may have increased the acceptability of “translationese”, and
may even have led to the introduction of new constructions into the language in much
the same way as European languages introduced constructions taken over by Latin,
often on the basis of Bible translations from Latin or Hebrew.
48 With respect to lexicography, Raja Ali Haji himself noted the difference between his
own approach and that of the Western scholars with whom he was in contact, as van
der Putten (1995) reports. Presumably, he felt that his own discursive approach was
more in line with the Arabic dictionaries, which he believed to be better suited to the
Islamic language that was Malay.
49 Since Raja Ali Haji was a pioneer in writing about Malay grammar in Malay, the
creation of a technical lexicon must in large part be attributed to him, although some
Malay terminology in Qurʾānic exegesis and Arabic grammar was available. He provides
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
25
Malay equivalents for a considerable number of Arabic grammatical terms in the form
of loan translations, and in some cases even replaces an Arabic term with a Malay one,
for instance in the ʾisnād terminology. As the text is written in Jawi, it is not always
possible to see whether an Arabic term is used in the original form or as an integrated
loanword. The written word lafẓ, for instance, was probably pronounced lafaz, and fiʿl
was pronounced fiʾil. The integration of Arabic loanwords is evident in a number of
derivations, such as disifatkan ‘to be described’ (Bustān: 42.25) or dikhabarkan ‘to be
predicated’ (ibid.: 32.13).20
50 Raja Ali Haji’s work remained a relatively isolated attempt at describing Malay within
an Arabic framework. Even though he is still revered as a hero of the Malay language, 21
modern grammars follow a different framework, that of Western linguistics, as in
Moeliono and Dardjowidjojo’s (1988) standard grammar, which has traces of Arabic
grammatical terminology, but almost always opts for the Western terminology.
BIBLIOGRAPHY
Primary sources
ʾAzharī, Šarḥ = Zayn al-Dīn Ḫālid ibn ʿAbdallāh al-ʾAzharī. Šarḥ al-muqaddima al-ʾājurrūmiyya fī
ʾuṣūl ʿilm al-ʿarabiyya li-l-ṭullāb wa-l-mubtadiʾīna. Ed. by Maḥmūd Naṣṣār. Beirut: Dār al-Kutub al-
ʿIlmiyya. 2013.
Daḥlān, Šarḥ = ʾAḥmad ibn Zaynī Daḥlān. Šarḥ al-ʾĀjurrūmiyya. Ed. with marginal comm. Tašwīq al-
ḫillān by Muḥammad Maʿṣūm ibn Sālim al-Samarānī al-Safātūnī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
2013.
Elias, Majālis = Elias of Nisibis, Kitāb al-majālis. Ed. with Russian transl. by N.N. Seleznjov. Moscow:
Grifon. 2018.
Ibn al-ʾAnbārī, ʾInṣāf = ʾAbū l-Barakāt ʿAbd al-Raḥmān ibn Muḥammad Ibn al-ʾAnbārī. Kitāb al-
ʾinṣāf fī masāʾil al-ḫilāf bayna l-naḥwiyyīn al-Baṣriyyīn wa-l-Kūfiyyīn. Ed. by G. Weil. Leiden: E.J. Brill.
1913.
Ibn ʿAqīl, Šarḥ = Bahāʾ al-Dīn ʿAbdallāh Ibn ʿAqīl. Šarḥ al-ʾAlfiyya. Ed. by Muḥammad Muḥyī l-Dīn
ʿAbd al-Ḥamīd. 14th ed. 2 vols. Beirut: Dār al-Fikr. 1972.
Ibn al-Ḥājib, Kāfiya = Jamāl al-Dīn ʾAbū ʿAmr ʿUṯmān ibn ʿUmar Ibn al-Ḥājib. Al-Kāfiya fī l-naḥw
maʿ šarḥihi al-Nājiya. Karachi: Maktabat al-Madīna. 2012.
Ibn Hišām, Qaṭr = Jamāl al-Dīn ʾAbū Muḥammad ʿAbdallāh ibn Yūsuf Ibn Hišām al-ʾAnṣārī. Šarḥ
Qaṭr al-nadā wa-ball al-ṣadā. Ed. by ʾImīl Badīʿ Yaʿqūb. 8th ed. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya.
2018.
Kafrāwī, Šarḥ = Ḥasan ibn ʿAlī al-Kafrāwī. Šarḥ matn al-ʾĀjurrūmiyya. Ed. by Māzin bin Sālim Bā
Wazīr. Riyadh: Dār Ṭayya. 1418 AH.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
26
Raja Ali Haji, Bustān = Raja Ali Haji. Bustān al-kātibīn li-l-ṣibyān al-mutaʿallimīn, lithograph. Pulau
Penyengat (Riau). [1851] (repr. Singapore. 1310/1892; transl. into Dutch by Ph.S. van Ronkel
(1901); ed. (in transcription) by Hashim bin Musa. Kuala Lumpur. Yayasan Karyawan. 2005.
Raja Ali Haji, Pengetahuan = Raja Ali Haji. Kitab pengetahuan bahasa. Ed. (in transcription) by H. bin
Musa. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan. 2010.
Širbīnī, Nūr = Muḥammad ibn Muḥammad al-Širbīnī. Nūr al-sajiyya fī ḥall ʾalfāẓ al-ʾĀjurrūmiyya. Ed.
and transl. by M.G. Carter. 1981.
Zamaḫšarī, Mufaṣṣal = ʾAbū l-Qāsim Maḥmūd ibn ʿUmar al-Zamaḫšarī. Kitāb al-mufaṣṣal fī l-naḥw.
Ed. by J.P. Broch. Christiania: Libraria P.T. Mallingii. 1879.
Secondary sources
Bertaina, D. 2011. Science, syntax, and superiority in eleventh-century Christian-Muslim
discussion: Elias of Nisibis on the Arabic and Syriac languages. Islam and Christian-Muslim relations
22/2: 197-207.
Boogert, N. van den. 1997. The Berber literary tradition of the Sous. With an edition and translation of
“The Ocean of Tears” by Muḥammad Awzal (d.1749). Publication of the De Goeje Fund 27. Leiden:
Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.
Bruinessen, M. van. 1990. Kitab kuning: Books in Arabic script used in the Pesantren milieu.
Comments on a new collection in the KITLV library. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde
146: 226-269.
Carter, M.G., ed. 1981. Arab linguistics: An introductory classical text with translation and notes.
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history
of linguistics 24. Amsterdam: J. Benjamins.
Eickelman, D.F. 1978. The art of memory. Islamic education and its social reproduction.
Comparative studies in society and history 20: 485-516.
Ermers, R. 1999. Arabic grammars of Turkic. The Arabic linguistic model applied to foreign languages &
Translation of ʾAbū Ḥayyān al-ʾAndalusī’s Kitāb al-ʾidrāk li-lisān al-ʾatrāk. Studies in Semitic languages
and linguistics 28. Leiden/Boston/Cologne: Brill.
Grotans, A.A. 2006. Reading in Medieval St. Gall. Cambridge studies in palaeography and codicology
13. Cambridge: Cambridge University Press.
Hamel, R.E. 2005. Language empires, linguistic imperialism, and the future of global languages
[http://www.hamel.com.mx/Archivos-PDF/Work%20in%20Progress/
2005%20Language%20Empires.pdf].
Hidayatullah, M.S. 2012. Bustān al-kātibīn: Pengaruh tata bahasa Arab dalam tata bahasa Melayu
[Bustān al-kātibīn: The influence of Arabic grammar in Malay grammar]. Manuskripta 2/1: 53-77.
Jeremiás, É.M. 1997. Zāʿid and aṣl in early Persian prosody. Jerusalem studies in Arabic and Islam, no.
21: 167-186.
Kaptein, N. 2000. Arabic influence on Malay linguistics. In History of the language sciences: An
international handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the present, ed.
by S. Auroux, E.F.K. Koerner, H.-J. Niederehe, and K. Versteegh, vol. 1, 333-336. Handbücher zur
Sprach- und Kommunikationswissenschaft 18/1. Berlin/New York: W. de Gruyter.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
27
Kasher, A. 2019. How to parse effective objects according to Arab grammarians? A dissenting
opinion on al-mafʿūl al-muṭlaq. In The foundations of Arabic linguistics, IV, The evolution of theory, ed.
by M.E.B. Giolfo and K. Versteegh, 198-211. Studies in Semitic languages and linguistics 97.
Leiden: Brill.
Kridalaksana, H. 1991. Bustanulkatibin dan Kitab pengetahuan bahasa: Sumbangan Raja Ali Haji
dalam ilmu bahasa Melayu [The Bustanulkatibin and the Kitab pengetahuan bahasa: Raja Ali
Haji’s contribution to Malay linguistics]. In Masa lampau bahasa Indonesia: sebuah bunga rampai, ed.
by H. Kridalaksana, 349-361. Seri ILDEP 43. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
Moeliono, A.M. and Dardjowidjojo, S., eds. 1988. Tata bahasa baku bahasa Indonesia [A standard
grammar of Indonesian]. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
Mustari. 1998. Raja Ali Haji dan pemikiran kebahasaannya: Studi terhadap Kitāb bustān al-kātibīn
li as-subyān al-mutaʿallimīn [Raja Ali Haji and his linguistic thinking: a study of the Kitāb bustān
al-kātibīn li as-subyān al-mutaʿallimīn]. Al-Jāmiʿah 61: 181-198.
Ostler, N. 2005. Empires of the word. A language history of the world. New York: HarperCollins
Publishers.
Poppe, E. 1999. Latinate terminology in Auraicept na nÉces. In History of linguistics 1996. Selected
papers from the seventh international conference on the history of the languages sciences (ICHOLS VII),
Oxford, 12‑17 September 1996, I,Traditions in linguistics worldwide, ed. by D. Cram, A.R. Linn, and E.
Nowak, 191-201. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series III,
Studies in the history of the language sciences 94. Amsterdam/Philadelphia PA: J. Benjamins.
Putten, J. van der. 1995. Taalvorsers en hun informanten in Indië in de 19 e eeuw. Von de Wall als
politiek agent in Riau? [Language experts and their informants in the Indies in the 19th century:
Von de Wall as political agent in Riau?]. Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde 151: 44-75.
Putten, J. van der. 2002. On sex, drugs and good manners: Raja Ali Haji as lexicographer. Journal of
Southeast Asian studies 33: 415-430.
Riddell, P.G. 1990. Transferring a tradition: ʿAbd al-Raʾūf Al-Singkilī’s rendering into Malay of the
Jalālayn commentary. Monograph Series – Center for South and Southeast Asian Studies 31.
Berkeley CA: University of California.
Riddell, P.G. 2002. Literal translation, sacred scripture and Kitab Malay. Studia islamika: Indonesian
journal for Islamic studies 9: 1-26.
Riddell, P.G. 2017. Malay court religion, culture and language: Interpreting the Qurʾān in 17th century
Aceh. Texts and studies on the Qurʾān 12. Leiden: Brill.
Ronkel, P.S. van. 1901. De Maleische schriftleer en spraakkunst getiteld Boestānoe’l kātibīna [The
Malay primer of script and grammar, entitled Boestānoe’l kātibīna]. Tijdschrift voor Indische Taal-,
Land- en Volkenkunde 44: 512-581.
Sidarus, A. 2010. La Renaissance copte arabe au Moyen Âge. In The Syriac Renaissance, ed. by H.
Teule, C. Fotescu Tauwinkel, B. ter Haar Romeny, and J. van Ginkel, 311-340. Eastern Christian
Studies 9. Leuven/Paris/Walpole: Peeters.
Versteegh, K. 2019. Grammars of Malay between Arab and Western model. In The foundations of
Arabic linguistics, IV, The evolution of theory, ed. by M.E.B. Giolfo and K. Versteegh, 295-318. Studies
in Semitic languages and linguistics 97. Leiden: Brill.
Waquet, Fr. 1998. Le latin ou L’empire d’un signe, XVIe-XXe siècle. L’Évolution de l’humanité. Paris:
Albin Michel.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
28
NOTES
1. I wish to thank David Bertaina (University of Illinois Springfield) for kindly sending me a copy
of his article on Elias of Nisibis, and Jan van der Putten (Universität Hamburg) for his help in
obtaining some of the Indonesian material. Thanks are also due to an anonymous reviewer for
some corrections and a useful reference to the Kāfiya as a possible source.
2. See Kridalaksana (1991); Kaptein (2000); Hidayatullah (2012); Mustari (1998). In quotations
from the Bustān, I use, with slight changes in the transliteration of the Arabic words, the
transliterated edition by Hashim bin Musa (2005), which also contains a facsimile of the Leiden
ms. Kl 107. The manuscript used by van Ronkel (1901) for his Dutch translation of the text, Leiden
no. 218, is identical to the lithograph edition of Pulau Penyengat (Riau) [1851], but it has one
additional paragraph about separate writing of words and one about ʾiʿrāb; both are missing in
the other manuscripts (see van Ronkel (1901): 533 & 550).
3. In the East Indies, the most popular commentaries on the ʾĀjurrūmiyya were those by al-
ʾAzharī (d. 905/1499), al-Kafrāwī (d. 1207/1787), and ʾAḥmad ibn Zaynī Daḥlān (d. 1304/1886), a
contemporary Meccan scholar (van Bruinessen 1990). I do not know whether al-Širbīnī’s
(d. 977/1569) extensive commentary Nūr al-sajiyya was used in Southeast Asia. An important
commentary on the ʾAlfiyya is that by Ibn ʿAqīl (d. 769/1367). Another popular treatise was Qaṭr
al-nadā wa-ball al-ṣadā with autocommentary by Ibn Hišām (d. 761/1360).
4. This definition is almost identical with the one in the ʾĀjurrūmiyya (Carter 1981: 34), which has
taġyīr ʾaḥwāl ʾawāḫir al-kalām.
5. The discussion is complicated by Raja Ali Haji’s use of technical terms, for instance when he
states that it is sometimes obligatory “to use ʾiʿrāb with a letter” (wajib diiʾrabkan dengan huruf;
Bustān: 23.21) in cases like kumbang ‘bumblebee’ <kwmbŋ> and kambing ‘goat’ <kmbyŋ>. He seems
to suggest that there are two ways of indicating vowels (mengiʾrabkan), with baris and with huruf,
but the text is not very clear.
6. It is not clear to me why dikhabarkannya ‘to be predicated by it’ is used here; presumably, he
means that the particle is the operator of the majrūr.
7. As an example, the author refers to the famous issue of ʾakaltu l-samaka ḥattā raʾs-i/a/u-hu ‘I
ate the fish without/with/with its head’, but without quoting the Arabic sentence (Bustān: 33; van
Ronkel 1901: 551). Here, too, the problem of ambiguity exists in both languages, but they have
different tools to solve them: while Arabic has declensional endings, Malay uses particles
(Versteegh 2019).
8. This expression refers to the description right at the beginning of Sībawayhi’s Kitāb where the
term ḥarf is specified as ḥarf jāʾa li-maʿnā ‘particle that brings a meaning’, presumably in order to
distinguish it from ḥarf in the sense of ‘letter’.
9. In the ʾĀjurrūmiyya, this is dealt with in the chapter on the naʿt.
10. The later commentaries (Kafrāwī, Šarḥ: 209; Širbīnī, Nūr: 266) take Ibn ʾĀjurrūm to task for
having omitted the relatives.
11. Elsewhere Raja Ali Haji uses ism fiʿl in the sense of ‘interjection’ (Bustān: 28).
12. In the case of melainkan ‘except’, a distinction is made between the positive and the negative
exception. In Arabic, this distinction has a function since it determines the case ending in the
excepted noun after ʾillā, whereas in Malay it does not.
13. According to al-Kafrāwī (Šarḥ, p. 13) ‘conventional’ (bi-l-waḍʿ) excludes foreign languages
from the definition of “speech”, so this is not the most appropriate criterion to be used in a
grammar of Malay. The shorter form of the definition in the Bustān corresponds to the one in
Ibn Hišām (Qaṭr: 54) “speech is a meaningful utterance” (al-kalām lafẓ mufīd).
14. Note that bersandar and disandarkan are also used as translation for ʾiḍāfa (Bustān: 47.2).
15. For the interpretation of berdiri as a relative sentence, see above.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
29
16. In his commentary on the ʾĀjurrūmiyya, al-Širbīnī (Nūr: 150ff.) mentions the alternative
sequence of starting with the topic, which he attributes to Ibn Mālik and Ibn Hišām.
17. Al-Širbīnī mentions the former, but states that it is less appropriate; it is mentioned as an
alternative name by Daḥlān (Šarḥ: 437.1) and al-Kafrāwī (Šarḥ: 232.15). Ibn Hišām (Qaṭr: 288) has
badal kull min kull.
18. These categories of adjectives are mentioned by al-Zamaḫšarī (Mufaṣṣal: 46), who also quotes
the Qurʾānic verse as an example of an adjective used for the purpose of taʾkīd. The same
categories are distinguished by Ibn Hišām (Qaṭr: 267), who cites the same example for the
function of taʾkīd and adds a sixth function, that of clarification (tawḍīḥ). Ibn al-Ḥājib (Kāfiya:
115f.) leaves out commiseration, replacing it with tawḍīḥ.
19. The third type is mentioned also by some of the commentators on the ʾĀjurrūmiyya (ʾAzharī,
Šarḥ: 125; Širbīnī, Nūr: 458-460; Kafrāwī, Šarḥ: 313), who attribute it to Ibn Mālik, but without
quoting any example. It is mentioned indeed in the commentaries on Ibn Mālik’s ʾAlfiyya (v. 386),
for instance by Ibn ʿAqīl (Šarḥ II: 43), and by Ibn Hišām (Qaṭr: 237). The ʾAlfiyya tradition discusses
the ʾiḍāfa construction before the satellite constructions, rather than after them.
20. The number of derivates is relatively low compared to the general lexicon and the
specialized lexicon of Qurʾānic exegesis (Riddell 1990: 245-250), possibly because Raja Ali Haji
seems to prefer loan translations over loanwords.
21. A memorial sign in Tanjung Pinang on the island of Riau calls him “The father of Malay/
Indonesian, an intellectual of the beginning of the twentieth century” (Bapak bahasa Melayu-
Indonesia budayawan di gerbang abad XX); see e.g. http://liputankepri.com/catatan-sejarah-pulau-
penyengat-tanjungpinang (downloaded 30.07.2018).
ABSTRACTS
Throughout history, a number of languages have achieved the status of learned language, i.e., a
language included in the curriculum of an educational system without yielding any
communicational benefits. In large parts of the Islamic world, Arabic was (and still is) such a
learned language. Acquisition of the learned language took place through the memorization of
texts, with instruction and/or translation in vernacular languages. The vernacular languages
themselves were not deemed to be in need of grammatical description, which explains why
grammars for them were late to be developed. The present paper focuses on Malay, the lingua
franca of choice in Southeast Asia for both Muslim missionaries and British and Dutch colonial
administrators, while serving as the auxiliary language in the Islamic curriculum. The first
grammars of Malay were published by the British and Dutch. Malay grammars written by native
speakers did not make their appearance until the nineteenth century. Their main representative
is Raja Ali Haji (d. probably 1873). In his Bustān al-kātibīn, he used the grammatical framework of
Arabic grammar for a grammatical sketch of Malay, using in part the Malay terminology that had
been developed in traditional education for the study of Arabic grammar and Qurʾānic exegesis.
À travers les siècles certaines langues ont fonctionné comme des langues savantes, c’est-à-dire
des langues enseignées dans les écoles pour leur valeur culturelle intrinsèque, mais sans pour
autant constituer une langue de communication. Dans le monde islamique, l’arabe a longtemps
servi comme langue savante, dont l’acquisition se faisait sous la forme de mémorisation de textes
joints à leur traduction dans la langue vernaculaire, qui servait comme langue d’instruction dans
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
30
les écoles. Dans le présent article, nous prenons comme point de départ la position de l’arabe en
Asie du Sud-Est, où le malais, tout en fonctionnant comme langue d’instruction dans les écoles,
fut choisi par l’administration coloniale comme langue intermédiaire dans sa communication
avec la population indigène. Par conséquent, ce furent les Anglais et les Néerlandais qui
publièrent les premières grammaires de cette langue vernaculaire, composées dans le cadre de la
linguistique européenne. Les premières descriptions du malais fondées sur un modèle
linguistique arabe n’apparurent qu’à la fin du XIXe siècle. Le représentant principal de cette
tradition linguistique est Raja Ali Haji (m. probablement en 1873). Dans son traité Bustān al-
kātibīn, il emprunta le modèle de la tradition grammaticale arabe afin de composer une esquisse
de la structure du malais, dans laquelle il se servait en partie de la terminologie grammaticale
malaise qui avait été développée dans le système scolaire traditionnel pour l’étude de la
grammaire arabe et l’exégèse coranique.
INDEX
Keywords: ʾĀjurrūmiyya, Arabic grammatical tradition, extended grammar, grammar,
Indonesia, learned language, loan translation, loanwords, Malay, Malaysia, Raja Ali Haji,
terminology
Mots-clés: ʾĀjurrūmiyya, calque, emprunt lexical, grammaire, grammaire étendue, Indonésie,
langue savante, malais, Malaisie, Raja Ali Haji, terminologie, tradition grammaticale arabe
AUTHOR
KEES VERSTEEGH
Radboud Universiteit, Nijmegen, The Netherlands
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
31
Sur les traces de la racine trilitère
dans la grammaire hébraïque
Judith Kogel
Introduction
1 Au tournant du XIe siècle, l’on assiste à une véritable révolution de la grammaire
hébraïque. Abu Zakariyya Yaḥya ibn Dawud, connu sous le nom de Judah Ḥayyuj (Fez,
950 – Cordoue, ca 1000), emprunte à la tradition arabe la notion de trilitéralité des
racines. Pour la mettre en œuvre, il doit faire preuve d’une grande créativité, en raison
du comportement des consonnes faibles. Il est, en effet, le premier à noter qu’elles
peuvent ne pas être visibles dans certaines formes verbales, tout en restant présentes
dans la forme théorique de base. Il reste, cependant, une difficulté majeure pour les
apprenants : comment identifier la racine d’une forme nominale ou verbale complexe ?
Dans un chapitre original de sa grammaire, le Maʿaseh efod 1, Profiat Duran (Perpignan,
< 1360 – Catalogne, ca 1414) propose des techniques didactiques d’identification,
systématiquement reprises dès la Renaissance par les humanistes chrétiens et ce,
jusqu’au XIXe siècle.
1 Une révolution dans la grammaire hébraïque
2 Vers la fin du Xe siècle, Judah Ḥayyuj, qui vivait à Cordoue, rédige deux traités de
morphologie en arabe (caractères hébreux) dans lesquels il propose un modèle
théorique permettant de décrire et d’expliquer toutes les formes verbales irrégulières
de l’hébreu biblique : le Kitāb al-afʾal ḏawāt ḥurūf al-līn (traité des verbes contenant des
lettres faibles) et le Kitāb al-afʾal ḏawāt al-miṯlayn (traité des verbes contenant des lettres
doubles)2. L’auteur innove sur deux points : il postule l’existence d’une racine
consonantique servant de base dérivationnelle, qu’il est possible d’induire et de
reconstruire à partir des mots attestés dans la Bible et il affirme que toutes les racines
des verbes sont trilitères, « il n’y a pas de verbes contenant moins de 3 consonnes »
(Ḥayyuj 1870 : 12 ; 1844 : 27), même lorsqu’elles ne sont pas toutes apparentes 3. C’est là
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
32
que réside l’originalité de son analyse car si la trilitéralité de la racine est fortement
influencée par la tradition grammaticale arabe4, Ḥayyuj a dû faire preuve d’une grande
créativité pour l’adapter à la morphologie hébraïque. Rappelons qu’en arabe, les trois
radicales sont presque toujours apparentes et relativement aisées à retrouver quand
elles ne le sont pas, ce qui n’est pas le cas en hébreu.
3 Jusque-là, les écoles linguistiques partageaient une conception minimaliste de la racine.
C’était, pour elles, un lexème/sémantème composé des consonnes qui restaient visibles
dans les différentes formes verbales ; on avait ainsi des racines à 1, 2 ou 3 consonnes. Le
traité grammatical, Maḥberet, de Menaḥem ben Saruq (Tortose ca 910 – Cordoue ca 970)
reflète cette conception de la racine5 tout en l’organisant selon l’ordre alphabétique.
4 Avant que la trilitéralité des racines ne soit établie, les exégètes qui éprouvaient
quelques difficultés à identifier les racines de certains mots usaient de subterfuge pour
en indiquer le sens. C’est notamment le cas du célèbre Salomon ben Isaac, dit Rashi
(1040-1105), qui renvoyait fréquemment à la traduction araméenne accompagnant
traditionnellement le texte biblique dans les manuscrits ashkénazes, quand il ne
parvenait pas à discerner la racine d’une forme verbale et souhaitait néanmoins
l’expliciter. Rashi commente ainsi le mot wa-yyåronnū (Lv 9,24), également analysé par
Ḥayyuj, kə-targumo « comme le Targum d’Onqelos [l’a traduit] », qui renvoie à
l’araméen wə-šabbåḥū, « ils louèrent ». De fait, le Targum traduit toutes les occurrences
de la racine hébraïque RNN par des formes équivalentes de la racine ŠBḤ, une
indication qui a assurément échappé à Rashi. S’il avait pu parcourir l’ensemble de la
Bible, avec en vis-à-vis la version du Targum, il aurait été en mesure de rapprocher
cette forme verbale d’un autre mot de la même racine.
5 C’est en examinant les formes verbales irrégulières que Ḥayyuj a réussi à établir que la
forme phonologique (morpho-phonétique) de base peut être altérée lors de la
dérivation. Ce phénomène avait induit en erreur ses prédécesseurs qui avaient
considéré qu’il pouvait exister des racines biconsonantiques, voire même
monoconsonantiques. Dans un second temps, le grammairien a décrit le comportement
des consonnes faibles de l’hébreu et a noté que les lettres alef, he, waw et yod ont un
statut particulier : elles peuvent ne pas être prononcées, se substituer les unes aux
autres, être supprimées ou assimilées. La lettre devient ainsi « נעלםנחune [lettre]
quiescente cachée (sākin layyin) », qui peut disparaître graphiquement tout en faisant
partie de la racine. Il convient, dès lors, d’être attentif aux variations vocaliques,
notamment l’allongement de la voyelle précédente, qui peut constituer une trace de
leur existence et à la présence de dageš compensatoire. Ḥayyuj a ensuite exposé
quelques règles générales permettant l’identification des racines :
[…] et yissoḇ (Gn 42,24) yåḥom (Is 44,16) et autres formes semblables ressemblent à
yåšūḇ (Lv 13,16) et yåqūm (Ex 21,19) et autres formes sœurs, et on peut les confondre
[…] et en retrouvant pour chacun des deux types le sens primordial et la racine, on
comprend la différence. De plus, les unes sont marquées d’un dageš et la lettre
géminée est visible en ce qu’elle est absorbée par la seconde puisqu’on dit wa-
yyåsobbū (Jos 6,14), wa-yyåronnū (Lv 9,24). Les autres sont marquées d’un rafeh [trait
suscrit qui marque la prononciation fricative de certaines consonnes, en quelque
sorte le contraire du dageš] puisqu’aucune lettre n’a été absorbée et les waw que
[ces formes verbales] contiennent correspondent à la deuxième consonne de la
racine, comme wa-yyåqūmū (Gn 24,54), wa-yyåšuḇū (Jg 8,33). Ainsi, tu comprendras
que si ces formes sont marquées d’un dageš6 lorsqu’on ajoute d’autres lettres
(suffixes), il s’agit d’un verbe géminé comme wa-yyåsobbū, wa-yyåronnū (Lv 9,24) et
wə-hinneh təsubbēnåh (Gn 37,7). Et s’il y a un rafeh, il s’agit d’un verbe dont la
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
33
deuxième radicale est faible, comme wa-yyåqūmū (Gn 24,54), wa-yyåšūḇū (Jg 8,33) et
tåšoḇnåh (I S 7,14)7.
6 C’est à ces méthodes permettant d’identifier les racines comportant des consonnes
faibles que nous allons nous intéresser, et à leur devenir dans les ouvrages postérieurs.
Peu de grammaires hébraïques en contiennent alors qu’elles figurent dans un nombre
non négligeable de grammaires latines de l’hébreu.
2 Les grammaires hébraïques médiévales
7 Abraham ibn Ezra (ca 1089 – ca 1167), l’un des traducteurs des traités grammaticaux de
Ḥayyuj, a introduit quelques règles générales (kəlal) dans son premier ouvrage
linguistique, Sefer ṣaḥot8, dont voici une des entames : « Et je vais maintenant te donner
une règle qui te permettra d’analyser les formes verbales et d’en identifier la racine »
(Lippmann 1827 : f. 48r). Aussi étonnant que cela puisse paraître, on ne retrouve pas de
démarche de ce type dans les ouvrages linguistiques les plus célèbres, qu’il s’agisse de
ceux de Jonah ibn Janaḥ, qui a composé les premiers traités 9 comportant toutes les
bases théoriques de la grammaire hébraïque et qui est considéré comme le
continuateur de Ḥayyuj, ou de ceux de la famille Qimḥi, Joseph, Moïse ou David 10.
8 En revanche, Profiat Duran a consacré un chapitre entier du Maʿaseh efod aux
techniques à employer pour isoler ou retrouver les trois lettres radicales. Médecin,
astrologue, mathématicien et philosophe, Profiat Duran appartenait à l’élite socio-
culturelle de la communauté juive dont on a de nombreux exemples 11, et comme ses
pairs, il fut aussi un enseignant reconnu. Même après sa conversion forcée au
christianisme, en 1391, Profiat Duran, appelé dès lors Honoratus de Bonafide, continua
d’enseigner12 et de composer des ouvrages13. C’est avec le Maʿaseh efod, que l’on pourrait
peut-être traduire « [Grand-] œuvre du efod14 », composé en 1403, que la carrière
littéraire de Profiat Duran s’achève.
9 Ce passage, intitulé bi-netinat derakhim yudʿu mehem šoršei ha-peʿalim we-ha-šemot u-milot
ha-taʿam ha-nimṣaʾim ba-katuḇ, « À propos des moyens permettant d’identifier les
racines des verbes, des noms et des particules présents dans la Bible » (Friedländer
1865 : 141‑145), figure après la grammaire du nom et du verbe. Il s’ouvre sur
l’importance et la nécessité qu’il y a à identifier les racines des mots bibliques, et se
poursuit avec un véritable cours de méthodologie en huit points qui détaillent les
différentes techniques à mettre en œuvre :
1. […] Seules « les lettres qui sont toujours présentes dans le nom et les formes
dérivées, soit en acte comme c’est le cas pour les verbes réguliers, soit en puissance
comme c’est le cas pour tous les autres types de verbes, sont appelées « radicales »
de cette forme et de tout ce qui en dérive ». Il rappelle ensuite que la forme de
l’accompli masculin, troisième personne du singulier, au qal 15 et au piʿel ne contient
que les lettres de la racine, « et c’est une des manières qui permet d’identifier les
racines ».
2. Pour identifier les racines, il convient « d’examiner toutes les formes existantes
[dans le texte biblique] pour tenter de trouver une preuve de la racine ».
3. « Il faut être attentif à la présence ou l’absence de dageš, s’il ne s’agit pas d’un
verbe régulier qu’il est facile d’appréhender, comme nous le verrons. Si l’on repère
un dageš, même s’il n’est pas présent à toutes les formes, on doit en déduire que l’on
a affaire à une racine géminée ». Il signale ensuite que Ḥayyuj avait déjà indiqué ce
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
34
moyen d’identifier la racine dans le chapitre consacré aux géminés 16.
4. « Le quatrième moyen est de s’aider de la vocalisation pour une partie des cas,
puisqu’à l’accompli, seule la voyelle notée sous la lettre initiale de la racine permet,
au paʿal, de faire la différence entre les verbes ʿayin-waw [verbes dont la deuxième
radicale est un waw] et les géminés : un qameṣ pour compenser la lettre faible
disparue [verbes ʿayin waw] et un pataḥ pour les verbes géminés ».
5. « Et la cinquième façon d’identifier les racines, c’est de comprendre la structure
[du verbe] et c’est le principe essentiel pour en déduire les racines [...] Et c’est la
raison pour laquelle les opinions des premiers grammairiens ont divergé
concernant certaines racines et chacun a suivi son opinion concernant la structure
[du verbe] et certains n’ont peut-être pas accédé à la vérité parce que la structure
leur a échappé ».
6. « Et la sixième façon concerne les racines des noms dont on ne sait comment ils
fonctionnent et varient dans le texte biblique mais s’il se trouve un verbe
dénominatif et selon ce que l’on trouvera concernant le verbe, on en établira la
racine du nom […] De même pour dåg ‘poisson’, étant donné que l’on a wə-yidggū lå-
roḇ, ‘qu’ils foisonnent abondamment’ (Gn 48 : 16), nous comprenons qu’il a une
troisième consonne faible et non une deuxième comme l’ont cru certains […] Et
certains noms nous renseignent sur d’autres […] et nous avons statué, [concernant
la racine], pour ḥåron par analogie avec gåron17 ».
7. « Et la septième façon, [c’est d’] examiner les noms et les verbes avec [des formes]
bibliques semblables qui te semblent plus évidentes et cela te permettra d’identifier
la racine cachée mais il faut se garder de toute erreur : il peut souvent arriver que
tu voies deux mots dont le schème se ressemble et que tu veuilles substituer les
racines [de façon erronée] ».
8. « Et la huitième façon consiste à examiner le contexte où apparaissent les noms
et les verbes d’une même racine. Et avec discernement et entendement, tu
détermineras le sens de ce verset et selon ce qu’il t’apparaîtra de l’interprétation du
verset, tu statueras à propos de la racine mais c’est une méthode à posteriori car la
connaissance de la racine précède la compréhension du verset […] ».
10 Ce qui frappe dans ce texte, ce sont les éléments qui permettent une étude individuelle
autonome, en l’absence de maître. Il s’agit d’une démarche inhabituelle et novatrice qui
sera largement reprise par Sancte Pagnini dans son ouvrage Hebraicarum Institutionum
libri IIII18.
3 La grammaire de Sancte Pagnini
11 En 1526, paraît à Lyon, aux presses d’Antoine du Ry, la première grammaire hébraïque
en latin, d’importance, publiée en France19. L’auteur, Sancte Pagnini (Lucques, 1470 –
Lyon, 1541), a été l’élève, à Florence, d’un juif espagnol converti, Clément Abraham. Il
dédicace cette grammaire à Federigo Fregosio, archevêque de Salerne, « pour pallier le
fait que ce dernier n’avait pas de précepteur pour l’hébreu (quod idoneo carebas
praeceptore20) ». Bien que Robert Estienne, éditeur de la seconde édition de la grammaire
de Sancte Pagnini, présente cet ouvrage comme une traduction fidèle – fere transcripti –
du Mikhlol de David Qimḥi 21, certains passages ont été empruntés au Maʿaseh efod22 de
Profiat Duran. Sophie Kessler-Mesguich a été la première à le signaler et à noter que
Pagnini ne le nommait que rarement23 parmi ses sources, alors qu’il expliquait
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
35
fréquemment le vocabulaire technique de la grammaire hébraïque, en reprenant les
définitions24 du Maʿaseh efod. Dans les chapitres 4 et 5 du livre IV (Pagnini 1526) 25, De
modo inveniendi radices, hoc est themata, et primitiva omnium Hebraicarum dictionum et
particulatim nominum, « À propos des moyens permettant d’identifier les racines
complexes26 et primitives de tous les mots hébreux et en particulier des noms » (ibid. :
395‑398) et De modo inveniendi radices verborum, « À propos des moyens permettant
d’identifier les racines des verbes » (ibid. : 398‑400), Pagnini a perfectionné la méthode
du grammairien Profiat Duran en distinguant les noms des verbes et en réorganisant
les huit points énoncés par son prédécesseur.
12 De fait, Pagnini insiste, comme son modèle, sur l’importance qu’il faut attacher à
l’identification des racines : « La raison pour laquelle il faut trouver les racines des
noms […] parce que leur connaissance conduit dans une grande mesure à la
compréhension de l’écriture, j’estime très utile et déclare de quelle façon on peut
identifier les racines des noms et des verbes ». Il poursuit en rappelant « qu’il faut
garder en mémoire que les noms et les verbes peuvent être parfaits, quiescents,
défectifs ou géminés » et que « le šoreš, à savoir la racine des mots, sont les lettres qui
sont toujours présentes, en acte dans la prononciation comme [dans les mots] parfaits,
ou en puissance à l’aide de voyelles royales27 ou d’un dageš pour les [verbes] quiescents,
défectifs ou géminés28 ».
13 Il rappelle ensuite la trilitéralité des racines et la constitution des formes verbales et
des noms à l’aide des lettres serviles, avec de nombreux exemples :
Et nous avons souvent rappelé que presque tous les noms et les racines des verbes
contiennent trois lettres. Et dans les noms parfaits simples, il n’y a pas de doute ni
de difficulté, qu’ils contiennent seulement trois lettres radicales, comme ָד ּבָרdåḇår
‘parole’, כ ְ ּתָבkətåv ‘écriture’, אב ֵ ְ זzəʾeḇ ‘loup’, שכ ֶםְׁ šəḵεm ‘épaule’, ל ֵבָבleḇåḇ
‘cœur’, קם ָ ָ נnåqåm ‘vengeance’, etc. desquels on a traité dans le livre 2, chap. 16.
Dans les autres cas, en revanche, qui comportent des lettres accidentelles et
serviles, qui sont moše kataḇ ʿelenu [soit מmem ש, šin ה, he כ, kaf ת, taw ב, bet א,
alef ל, lamed י, yod נ, nun et וwaw]29, comme il a été dit au livre 1, chap. 15, ou
heʾemanti [soit הhe א,alef מ,mem נ,nun ת,taw et יyod] 30 pour les noms, une fois ces
lettres enlevées, les trois lettres qui restent dans les noms parfaits sont les radicales
ou bien ces lettres accidentelles se trouvent au début ou seulement à la fin ou au
début et à la fin, comme שכ ָ ּר ְׁ א
ֶ ʾɛškår ‘cadeau’, אצ ְבַ ּע
ֶ ʾɛṣbaʿ ‘doigt’ 31, une fois enlevé
le alefṢåḆaʾ. Et צ ָבַעŠåḴaR et שכ ַר ָׁ ,accidentel, restent trois lettres radicales []א
dans חה ָ ְ שִׁפšip̄ḥåh ‘servante’, מר ָה ְ א
ִ ʾimråh ‘discours’, si on enlève le he[]ה
accidentel qui est la désinence du féminin, il reste les lettres radicales שָׁפ ַחŠåP̄aḤ
et מרַ א
ָ ʾåMaR.
Et dans חהָ ָפ
ּ שְׁ מ
ִ mišpåḥåh ‘famille’, מה
ָ ח
ָ ְ מל
ִ milḥåmåh ‘guerre’, une fois enlevées la
lettre préformante mem et la lettre accidentelle [ ]מheשפ ַח ָׁ il reste les racines ,[]ה
ŠåP̄aḤ et חםַ ָ לLåḤaM. Et de même, dans les autres [noms] composés avec les lettres
accidentelles, il reste trois lettres radicales en acte.
Dans les noms [ayant une racine] quiescente, comme מקֹום ָ måqom ‘lieu’, מאוֹר
ָ måʾor
‘luminaire’, une fois enlevé le mem אוֹרaccidentel, il reste les lettres radicales []מ
שׁו ּבָהEt dans .קֹום,šūḇåh et צו ּר ָהṣūråh, une fois enlevé le signe hedu féminin, il []ה
reste les lettres radicales שׁו ּבŠWḆ, צו ּרṢWR. Et dans מרו ּצ ָה ְ mərūṣåh ‘course’,
משׁו ּבָה
ְ məšūḇåh ‘conversion’, une fois enlevés les mem et [ ]מheaccidentels, il []ה
reste les lettres radicales רו ּץRWṢ, שׁו ּבŠWḆ. Parfois en revanche, dans les mots
quiescents, les trois lettres radicales ne sont pas visibles en acte, comme dans
l’exemple précédent, mais en puissance des « voyelles royales », qui ont en
puissance les lettres quiescentes, comme sont les voyelles camés, séri, chiric, suivies
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
36
d’un yod, cholem. Comme ז ָדֹוןzådon ‘la superbe’, une fois enlevées les lettres
accidentelles vau et [ ]וnun ז ָדil reste ,[ ]נzåd et en puissance le camés est vauEt .[]ו
ainsi זו ּדZWD est la racine. Et dans ז ֵדוֹןzedon ‘superbe’, une fois enlevés
pareillement vau et [ ]וnun ז ֵדil reste ,[ ]נzed et le séri est vauen puissance et ainsi []ו
la racine est זו ּדZWD32 [...] 33 Et dans הנ ָפ ָה ֲ hănåp̄åh ‘tamisage’, une fois enlevés les
deux he נ ָףaccidentels, il reste [ ]הnåp̄. Et le camés est le vauen puissance et ainsi []ו
la racine est נו ּףNWP̄. Et dans או ָה ֲ ַת
ּ taʾăwåh ‘désir’ et תְעָל ָה
ּ təʿålåh ‘santé 34’, une
fois enlevé le tauʿåLåH. Et על ָה ָ ʾåWåH et או ָה ָ accidentel, il reste les radicaux []ת
dans תַבְניִ ת
ּ taḇnit ‘modèle’, תַכ ְל ִית ּ taḵlit ‘achèvement’, une fois enlevés les deux
lettres tau et [ ]תiod de la voyelle royale dans laquelle [ ]יheest en puissance, il []ה
reste les racines בָ ּנ ָהḆåNåH et כ ָ ּל ָהKåLåH.
Dans les noms [ayant une racine] défective où il manque généralement le nunou []נ
le iod que le [ ]יdaghés ou une voyelle royale supplée, comme dans שֹור ּ מ
ַ massor ‘scie’,
ַמב ּו ּע
ַ mabbūʿa ‘source’, une fois enlevé le mem accidentel et mis le [ ]מnunqui ,[]נ
est dans le dagés en puissance, les lettres radicales seront שר ַֹ ָ נNåSaR et נ ָבַעNåḆaʿ.
Et dans תָנ ָה ּ מ
ַ mattånåh ‘présent’, טר ָה ָּ מ
ַ mattåråh ‘garde’, une fois enlevées les
lettres mem et [ ]מhe accidentelles, et mis le [ ]הnun qui est dans le ,[ ]נdagés en
puissance, les lettres radicales seront נ ָתַןNåTaN et טר ַ ָ נNåTaR. Et dans מֹושָׁבmošåḇ
‘enceinte’, ׁ מוֹר ָשmoråš ‘possession’, une fois enlevées les lettres mem et [ ]מvau[]ו
[accidentelles], et mis le iod qui est en puissance dans le [ ]יcholemles lettres ,[ֹ]ו
radicales sont שב ַ ָ יYåŠaḆ et י ָר ַשYåRaŠ. Et dans חהָ ֵ תֹוכ
ּ toḵeḥåh ‘remontrance’, une
fois enlevées les lettres accidentelles tau et [ ]תhe et mis le ,[ ]הiodqui est dans le ,[]י
cholem שֵׁנ ָהYåḴaḤ. Et dans י ָכ ַחen puissance, les lettres radicales sont [ ]ֹוšenåh
‘sommeil’, ֵד ּעָהdeʿåh ‘science’, une fois mis le iod qui est en puissance dans le [ ]יséri
et enlevé le signe du féminin he YåDaʿ et י ַָדעles lettres radicales sont ,[שן ]ה ַ ָ יYåŠaN.
Dans les géminés parfaits, en revanche, c’est-à-dire dans ceux qui ont trois lettres
radicales, il n’y a pas de possibilité de se tromper. Dans les autres verbes, il faut
considérer que le daghés, qui supplée, fait fonction de vicaire des lettres défectives,
comme dans מג ִל ָ ּה
ְ məgillåh ‘rouleau’, חל ָ ּה
ִ ְת
ּ təḥillåh35 ‘commencement’ », une fois
enlevées les lettres mem ou [ ]מtau et [ ]תhequi sont des lettres accidentelles, et ,[]ה
mis le lamed qui est en puissance dans le [ ]לdaghés, il reste les radicales ג ָל ַלGåLaL
et חל ַל
ָ ḤåLaL. Et dans מה ָּ ִ זzimmåh ‘dessein’, תָהּ ח
ִ ḥittåh ‘peur’, une fois enlevé le
signe he du féminin et mis le [ ]הtau et le [ ]תmemqui sont en puissance dans le []מ
daghés, les lettres radicales sont חתַת ָ ḤåTaT et מם ַ ָ זZåMaM. Et dans עֹזʿoz ‘force’,
חםֹ ḥom ‘chaleur’, une fois mis le [deuxième] zain et le [deuxième] [ ]זmemqui []מ
sont en puissance dans le cholem, les radicales sont ַ עָזזʿåZaZ et מם ַ ח
ָ ḤåMaM.
14 Ce long développement très didactique, qui ne figurait pas dans la grammaire de
Profiat Duran, ne peut être dissocié des deux listes de noms qu’a insérées Pagnini en
prologue au Thesaurus36 qui est, on le sait, une adaptation du Sefer ha-shorashim ou
Dictionnaire des racines de David Qimḥi : une première (3r‑4v) où figurent les substantifs
ordonnés en fonction des préformantes – האמנתיhe, alef, mem, nun, taw, yod – et une
seconde (5r‑5v), rangée selon l’ordre alphabétique, faisant apparaître les racines des
substantifs « défectifs [noms auxquels manquent une consonne de la racine sans
compensation], quiescents [noms comportant une consonne quiescente cachée] et
géminés ». Seul, le dernier paragraphe de ce chapitre 4 reprend fidèlement le point 6
du Efod, que nous avons résumé plus haut37.
De plus, s’il y a [dans la Bible] un verbe dénominatif, tu pourras juger du nom à
partir de ce verbe. Nous disons que ׁ עָשʿåš ‘vers’ est géminé, car nous trouvons dans
le Psaume 31:2138, « Et mes osּ שו ׁ ש
ַׁ ע
ָ ʿåšašū disparaissent ». Quant à ָד ּגdåg ‘poisson’,
nous disons qu’il dérive de ָד ּג ָהDåGåH non seulement parce que dans le pluriel, il
n’y a pas de daghés [ce qui aurait été l’indice d’une racine géminée], mais aussi parce
que nous trouvons en Genèse 48:16, ּ ו ְיְִדג ּוwə-yidggū ‘qu’ils foisonnent
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
37
abondamment’. Et חרֹון ָ ḥåron ‘la colère’, nous disons que le mot dérive du verbe
ḤåRåH ; et חר ָה ָ teḇelBåLaL ; et בָ ּל ַלmonde’, nous disons qu’il vient de‘ תֵבֵל ּ
məgeråh פ ָה
ּ ח
ֻ GåRaR ; et ג ָ ּר ַרscie’ de‘ מג ֵר ָה
ְ ḥuppåh ‘dais nuptial’, non seulement en
raison du daghés mais aussi parce qu’on trouve [dans la Bible] חפ ַף ָ ḤåP̄aP̄, nous
considérons qu’il fait partie des géminés. Les dissyllabiques avec daghés prouvent
que les monosyllabiques dérivent des géminés, פ ַת ּ pat ‘morceau’ et קל ַ qal ‘léger’
dérivent de תִים
ּ ִפ
ּ pittīm39 ‘morceaux’ et קל ִ ּים ַ qallīm ‘légers’ (point 6)40.
15 Le chapitre 5 est entièrement consacré aux verbes. L’auteur commence par traiter des
verbes parfaits ou réguliers, verborum perfectorum, ceux qui gardent les trois consonnes
de la racine à toutes les formes :
Découvrir les racines de verbes parfaits, qui ont toujours trois lettres radicales ne
pose pas de difficulté quel que soit le binián. Une fois enlevées les lettres
accidentelles, comme celles qui constituent les personnes, par exemple, ou les
genres, ou les nombres, ou les modes, ou bien celles qui sont formatives des
conjugaisons, il reste les radicales, qu’il est facile de voir dans les cas singuliers des
binianím, c’est-à-dire les conjugaisons, mentionnés plus haut. Cependant, plus
précisément, dans les verbes parfaits de première et seconde conjugaison, dans la
troisième personne du masculin accompli, qui n’a aucune lettre accidentelle, se
trouve la racine de toutes les formes qui dérivent d’elle, dont les personnes, le
genre, le nombre et le mode. Et ainsi dans les verbes dont la première lettre est le
iod quiescent : ou la dernière qui est ,[ ]יalef ou [ ]אheune fois trouvé l’accompli ,[]ה
dont on a parlé, ou même l’impératif, outre le radical, ils n’ont pas de lettres
serviles : comme פ ָנ ָה ּ pånåh ‘il se tourna’, פ ְנ ֵה
ּ pəneh ‘tourne-toi’, une fois que l’on a
trouvé, on en juge que la racine de ו ַי ִ ּפ ֶןwa-yyip̄ɛn ‘il se tourna’ est פ ָנ ָה ּ PåNåH. Et de
même, ו ַי ֵ ּר ֶדwa-yyerɛd ‘il descendit’ de י ָר ַדYåRaD ; et ו ַי ִ ּצ ֶרwa-yyiṣɛr ‘ il forma’, de
YåṢaR ; י ָצ ַרet ו ַי ַ ּר ְאwa-yyarʾ ‘il vit’, de אה
ָ ָ רRåʾåH ; et ש ַ ּ ַ ו ַיwa-yyaʿas ‘il fit’, de שה
ֹ ע ָֹ ָע
ʿåSåH, et de même pour les autres (point 1).
Mais dans les verbes dont la deuxième [lettre] est un vauquiescent, nous en ,[]ו
jugerons à partir du maqor ou du futur : dans ceux qui ont un וquiescent, à
l’accompli ou au participe, dans ceux-là, le vauest seulement en puissance dans []ו
la voyelle royale camés. Comme ל ָקו ּםlå-qūm ‘se lever’, et ל ָשׁו ּבlå-šūḇ ‘revenir’. Ou
אקו ּם
ָ åqūm ‘je me lèverai’, שו ּב
ׁ א
ָ åšūḇ ‘je reviendrai’, nous déduisons que קם ָ qåm ‘il
se leva’, שָׁבšåḇ ‘il est retourné’, קם
ָ qåm ‘se levant’, מיםִ ק
ָ qåmīm ‘se levant (pl.)’, שָׁב
šåḇ ‘revenant’ et שָׁבִיםšåḇīm ‘revenant (pl.)’, viennent de קו ּםQWM et שו ּב ׁ ŠWḆ
(point 2).
Dans les géminés en revanche, si on trouve un [verbe] complet, c’est-à-dire ayant
trois lettres radicales, nous en déduisons les [racines des] imparfaits et défectifs.
Étant donné que nous trouvons les formes קל ַל ָ qålal מם ַ ָ ת, tåmam ז ָכַ ּך, zåkakhסבַב
ָ ,
såḇaḇ, nous déduisons que קל ַ qal ְ ז ַך, zakh סב ַ , saḇ et les autres [formes] défectives
des verbes dont nous avons parlé, viennent de géminés – et ainsi pour les autres
cas, dont nous avons parlé dans le livre 3, chap. 34 –bien que l’on puisse savoir qu’il
s’agit de géminés grâce à la voyelle pathach, qui est propre aux géminés – comme le
camés est propre aux verbes dont la seconde radicale vauest quiescente – et []ו
grâce au daghés qui est dans la seconde radicale, comme dans ּ ּקלו ַ qallū ‘ils sont
légers’,ּ מו ּ tammū ‘ils ont fini’,ּ ּ ז ַכוzakkū ‘ils sont purs’,ּ סב ּו
ּ ַת ַ sabbū ‘ils ont entouré’,
qui ont effectivement un daghés et sont des géminés. Même en ce qui concerne le
futur des géminés, au binián niphal défectif, on sait grâce au pathach qu’il s’agit de
futur des [verbes] défectifs quiescents, comme nous l’avons indiqué à sa place
(points 3 et 4).
Il y a une autre façon d’identifier les verbes et les noms communs, nous devons
faire l’effort de ne pas ignorer la signification des verbes et des noms. En effet (par
exemple), que נ ָז ַדnåzad est ‘il cuisinait’, nous pouvons immédiatement déduire que
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
38
ו ַיזָ ּ ֶדwa-yyåzɛd est ‘Jacob cuisina’ (Gn 25:29), à partir du verbe mentionné
précédemment. De même, si l’on sait que אֹז ֶןʾozɛn signifie ‘oreilles’ et le verbe
dénominatif, ‘percevoir avec les oreilles’, ou ‘incliner les oreilles’, nous comprenons
le verset Pv 17:4, « le menteur מז ִין ֵ mezīn (bien que le alef soit manquant) incline
l’oreille vers la langue pernicieuse (dangereuse) » : on le déduit de אֹז ֶןʾozɛn et la
forme régulière est אז ִין ֲ מ
ַ maʾazīn. Parce que nous savons que תוֹפ ֵפוֹת
ּ top̄ep̄ot signifie
‘jouant du tambourin’, nous comprenons que תֹוף ּ top̄, ‘tambourin’, vient de תָפ ַף ּ
tåp̄ap̄. Et nous pourrons de même discerner facilement les autres cas (point 5).
Il y a aussi une autre manière de reconnaître les [noms] communs, c’est-à-dire que
par analogie, nous pouvons déduire ce qui n’est pas connu à partir de ce qui lui
ressemble. Si l’on sait que la racine de י ָקו ּםyåqūm ‘il se lèvera’ est קו ּםQWM, j’en
déduirai que la racine de י ָשׁו ּבyåšūḇ ‘il reviendra’ est שו ּב ׁ ŠWḆ, parce qu’ils sont
semblables et l’on doit étendre cette déduction aux autres cas similaires. Et de
même pour les autres verbes et noms, comme אקו ּם ָ åqūm ‘je me lèverai’ et אשׁו ּב ָ
åšūḇ ‘je reviendrai’, et מה ּ ּ təqūmåh ‘édification’, et שו ּבָה
ָ תְקו ׁ ְת
ּ təšūḇåh ‘le retour’, et
ּ ּ ז ַכוzakkū ‘ils sont purs’, et ּ ּקלו
ַ qallū ‘ils sont légers’ […] qui appartiennent aux
géminés. Mais cette méthode peut induire en erreur les débutants/ignorants, parce
qu’il y a des formes semblables qui ont des racines différentes, comme חה ָ ֵ תוֹכ ּ
toḵeḥåh ‘remontrance’, et תֹועֵבָה ּ toʿeḇåh ‘abomination’ ; la racine du premier est en
effet י ָכ ַחYåḴaḤ et de l’autre עב ַ ָת
ּ TåʿaḆ […] בְ ּר ָכ ָהbəråkåh ‘bénédiction’ et מעָר ָה ְ
məʿåråh ‘grotte’ viennent [respectivement] de בָ ּר ַךBåReḴ et ער ָה ָ ʿåRåH, et non de
MåʿaR, comme certains le pensent (point 5). C’est pour cette raison que ce *ער ַ מ ָ
mode de déduction demande une attention non moindre, pour que nous ne nous
trompions pas dans les analogies. Mais nous venons de traiter quelques règles très
utiles pour la compréhension des écritures sacrées (point 7).
16 Au XVIIe siècle, un autre hébraïsant chrétien, Johannes Buxtorf, résume en cinq points
l’essentiel de cette démonstration dans l’introduction à son livre Epitome grammaticae
hebraeae41, sous le titre Regulae de themate facile investigando et cognoscendo « Règles pour
reconnaître et identifier facilement la racine » :
1. Si après avoir supprimé les lettres serviles, il reste trois lettres, celles-ci
constituent la racine : comme קד
ֹ ְ אפ
ֶ ɛp̄qod ‘je visiterai’, de PaQaD.
2. S’il n’en reste que deux, et que la première est marquée d’un dageš, alors ce dageš
correspond le plus souvent à la première lettre radicale נnun et plus rarement à י
yod, qui a été absorbée : comme ׁאג ָ ּש
ֶ ɛgåš ‘j’approcherai’ de נ ָג ַשNåGaŠ ; הציִ ּ ב
ִ hiṣīḇ
‘il installa’ de י ָצ ַבYåṢaḆ.
3. Si c’est la dernière des deux qui restent, qui est marquée d’un dageš, il s’agit d’une
racine géminée : comme ּ סב ּו ַ sabbū ‘ils ont entouré’ de סבַב ָ SåḆaḆ. Sauf
premièrement, si le dageš est un des traits de la conjugaison et que l’on peut
identifier par la forme, dans ce cas il faut placer à la fin un הhe : commeּ ג ִ ּלוgilū de
GåLåH ; deuxièmement, si les noms avec suffixes pronominaux sont marqués ג ָ ּל ָה
d’un dageš dans la seconde lettre, ils ont pour consonne intermédiaire [deuxième
radicale] nun : comme טה ָּ ח
ִ ḥittåh ‘blé’ de חנ ַט
ָ ḤåNaT, אף
ַ ʾap̄ ‘colère’ de אנ ַף
ָ ʾåNaP̄,
בַ ּתbat ‘fille’ de בָ ּנ ָהBåNåH.
4. Si la dernière des deux consonnes qui restent n’est pas marquée d’un dageš, soit la
première lettre est un יyod ou un נnun, plus rarement un אalef ; soit la lettre
intermédiaire est un וwaw, soit la dernière lettre est un הhe et plus rarement un א
alef.
5. Si après avoir supprimé les lettres serviles, il ne reste qu’une lettre radicale, dans
ce cas, il faut placer comme première lettre soit נnun, soit יyod et mettre à la fin un
הhe, excepté pour תֵת ּ tet ‘donner’, dont la racine est נ ָתַןNåTaN.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
39
17 Il termine par ces mots : Quiconque deviendra un très bon grammairien n’aura pas
besoin de ces règles ou d’autres semblables.
18 Ces règles sont versifiées dans l’édition Leusden42 (1691) et déplacées au chapitre 6.
1. Abjice Serviles, et tres si fortè supersunt,
Radicem thematis noveris esse tui.
2. Sin tantùm remanere duas conspexeris, adde
Nun vel Yod capiti, vel dato Wau medio,
Aut He postponas, aut conduplicato secundam
Vera statim Radix pullulat inde tibi.
3. Unica sed remanet mihi litera, quando removi
Serviles : Radix dic agè qualis erit?
Nun da principio, vel Yod superadde quiescens,
He fini : Radix inde petita venit.
4. Qui quid analogico normae dissentit ab usu;
Hoc exercitium, lector amice, dabit.
19 On les retrouve ensuite dans de nombreux ouvrages postérieurs. Adrianus Reeland
(1721, p. [2]) les reprend en les faisant précéder du titre Investigationi Radicum plurimum
inserviunt sequentes Versiculi. Dans une grammaire de l’hébreu, en anglais cette fois,
James Noble (1832, p. 122) signale qu’il est « habituel de donner dans les grammaires
hébraïques, ce que l’on qualifie de Règles pour identifier la racine ». Et, ajoute-t-il, « le
fait est que la grammaire [hébraïque] n’est rien d’autre qu’un système de règles
permettant d’identifier la racine. Ainsi, trouver la racine pour quelqu’un qui maîtrise la
grammaire n’est guère difficile ; quant à celui qui ne la maîtrise pas bien, aucune règle
sur le sujet ne sera d’une grande utilité ».
Conclusion
20 Ainsi, si les prémisses de ces passages didactiques permettant d’identifier les racines
faibles sont déjà présentes dans les traités de Judah Ḥayyuj et dans le Sefer ṣaḥot
d’Abraham ibn Ezra, elles ne sont devenues systématiques qu’au moment où
l’enseignement de la grammaire hébraïque a franchi les frontières des communautés
juives et ce, à mon sens, pour deux raisons : le processus d’apprentissage de l’hébreu
débutait dès l’enfance sous la direction d’un maître qui guidait ses élèves et pouvait, en
fonction de ses aptitudes pédagogiques, leur fournir les clés permettant d’identifier les
racines ; la connaissance intime des prières et des textes classiques facilitait le
rapprochement entre mots dérivés de la même racine, dont l’un pouvait avoir conservé
les trois radicales. Profiat Duran écrivit son ouvrage grammatical après avoir été
converti de force en 1391, peut-être à destination de ses frères d’infortune qui ne
pouvaient bénéficier d’un enseignement organisé, et il fut, semble-t-il, le premier à
consacrer un chapitre entier à ce point. Sa démarche novatrice fut reprise par Sancte
Pagnini dont les ouvrages ont influencé d’autres hébraïsants chrétiens, et ce jusqu’au
XIXe siècle43. Pour terminer, je souhaiterais mentionner un manuel français, celui de
l’abbé Ladvocat, dont le titre confirme mon sentiment, à savoir que les règles énoncées
par Profiat Duran avaient pour but d’aider un apprenant solitaire : Grammaire hébraïque
à l’usage des écoles de Sorbonne, avec laquelle on peut apprendre les principes de l’hébreu, sans
le secours d’aucun maitre44.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
40
BIBLIOGRAPHIE
Sources primaires
Benavente Robles, S. et Sáenz-Badillos, Á. Těšuḇot de los discípulos de Měnaḥem contra Dunaš ben
Labrat. Grenade : Universidad de Granada – Universidad pontificia de Salamanca. 1986.
Buxtorf, J. Epitome grammaticae Hebraeae. Bâle : Ludovic Regis. 1629.
Buxtorf, J. et Leusden, R. Epitome grammaticae Hebraeae. Brittenburg : Luchtmans. 1691.
Díaz Esteban, F. Sefer ʾoklah wě-ʾoklah. Colección de listas de palabras destinadas a conservar la
integridad del texto hebreo de la Biblia entre los judíos de la edad media. Madrid : Consejo superior de
investigaciones científicas. 1975.
Friedländer, J. et Kohn, J. Maase Efod. Einleitung in das Studium und Grammatik der Hebräischen
Sprache von Profiat Duran. Vienne : J. Holzwarth. 1865.
Ḥayyuj, J. ben David. Two treatises on verbs containing feeble and double letters. Trad. M. Gikatilla, éd.
J. W. Nutt. Londres/Berlin : Asher. 1870.
Ḥayyuj, J. ben David. Grammatische Werke des R. Jehuda Chajjug aus Fetz. Trad. A. ibn Ezra, éd. L.
Dukes. Stuttgart : A. Krabbe. 1844.
Ibn Janaḥ 1896 = Ibn Gānâḥ, A. M. Sepher Haschoraschim. Trad. J. ibn Tibbon, éd. W. Bacher. Berlin :
H. Itzkowski. 1896.
Ibn Janaḥ, J. Sefer ha-Riqmah (Kitāb al-Lumaʿ). Trad. J. ibn Tibbon, éd. M. Wilensky, D. Téné, Zeʾev
Ben-Hayyim. Jérusalem : Ha-Aqademyah la-lashon ha-ʿIvrit. 1964.
Ladvocat, J.‑B. Grammaire hébraïque à l’usage des écoles de Sorbonne ; avec laquelle on peut apprendre les
principes de l’hébreu, sans le secours d’aucun maître. Paris : Impr. de Vincent. 1755.
Lippmann, G. H. et Ibn Ezra, A. Sefer ṣaḥot. Fürth : Bi-defus D. Tsirndorfer. 1827.
Münster, S. Dictionarium Hebraicum. Bâle : Johann Froben, 1523.
Noble, J. Rudiments of the Hebrew language, with and without points. Glasgow : M. Lochhead. 1832.
Pagnini, Sancte. Habes hoc in libro… Hebraicas institutiones… quas nuper… Lyon : Antoine du Ry. 1526.
Pagnini, Sancte. Thesaurus linguae sanctae sive lexicon hebraicum. Lyon : Antoine du Ry. 1529.
Pagnini, Sancte. Hebraicarum institutionum Libri IIII. Paris : Robert Estienne. 1549.
Qimḥi, D. Sefer Mikhlol. Éd. I. Rittenberg. Lyck : Petzall. 622 [1862] (réimpr. Jérusalem 1966).
Qimḥi, J. Sepher Sikkaron : Grammatik der hebräischen Sprache. Éd. W. Bacher. Berlin : M’kize
Nirdamim. 1888.
Qimḥi, M. Rabi Mose Kimhi in introductorio grammaticae. Haguenau : Thomas Anshelme. 1519.
Qimḥi, M. Sefer darkhe leshon ha-qodesh… : Liber V[iarum Lingu]e Sancte Rabi Mosse Kimahi. Éd.
A.Giustiniani. Paris : Les Frères de Gourmont. [1520].
Reeland, A., Brevis introductio ad grammaticam hebraicam et chaldaicam. Éd. Charles Morthland.
Glasgow : J. Duncan. 1721.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
41
Tissard, Fr. [Grammatica hebraica]. Paris : Gilles de Gourmont. 1508 ou 1509.
Sáenz-Badillos, Á. éd. Mahberet – Menahem ben Saruq. Grenade : Universidad de Granada. 1986.
Zsigmondy, S. Grammatica Hebraea. Vienne : Antonius Nob. de Schmid. 1828.
Sources secondaires
Bacher, W. 1882. Die grammatische Terminologie des Jehûdâ b. Dâwîd (Abu Zakarjâ Jahja ibn Dâud)
Ḥajjûḡ. Nach dem Arabischen originale seiner Schriften und mit Berücksichtigung seiner Hebräischen
Übersetzer und seiner Vorgänger. Vienne : Gerold.
Emery, R. W. 1968. New light on Profayt Duran “The Efodi”. The Jewish quarterly review, n o 58 :
328‑337.
Iancu-Agou, D. 1976. Préoccupations intellectuelles des médecins juifs au Moyen Âge : inventaires
de bibliothèques. Provence historique t. 26, fasc. 103 : 21‑44.
Kessler-Mesguich, S. 2013. Les études hébraïques en France : de François Tissard à Richard Simon,
(1508‑1680). Travaux d’humanisme et Renaissance 517. Genève : Librairie Droz.
Kogel, J. 2018. Le Maʿaseh efod ou l’apprentissage de la langue hébraïque en solitaire. Iberia judaica,
no 10 : 21‑32.
Kozodoy, M. 2015. The secret faith of Maestre Honoratus. Profayt Duran and Jewish identity in Late
Medieval Iberia. The Middle Ages Series. Philadelphie PA : University of Pennsylvania Press.
Renan, E. 1893. Les écrivains juifs français du XIVe siècle. Paris : Imprimerie nationale.
Richler, B. et Beit-Arié, M., éd. 2001. Hebrew manuscripts in the Biblioteca Palatina in Parma :
Catalogue. Jérusalem : Hebrew University of Jerusalem, Jewish National and University Library.
Sáenz-Badillos. 2001. Hebrew philology in Sefarad : The state of the question. Dans Hebrew
scholarship and the medieval world, éd. par N. de Lange, 38‑59. Cambridge : Cambridge University
Press.
Schwarzfuchs, L. 2008. L’hébreu dans le livre lyonnais au XVIe siècle : inventaire chronologique.
Métamorphoses du livre. Lyon : ENS Éditions/Institut d’histoire du livre.
Sela, Sh. et Freudenthal, G. 2006. Abraham ibn Ezra’s scholarly writings : A chronological listing.
Aleph, no 6 : 13‑55.
NOTES
1. Friedländer (1865). Ce sujet a déjà été abordé dans une perspective différente, voir Kogel
(2018). Pour des raisons de lisibilité, nous avons adopté une translitération simplifiée pour les
noms propres, les titres d’œuvres, les noms de lettres, ainsi que les voyelles. En revanche, il nous
a semblé nécessaire de distinguer entre les lettres b, k et p et leur réalisation fricative ḇ, ḵ et p̄ (et
non v, kh et f) dans la traduction des différents extraits grammaticaux, pour permettre au lecteur
de suivre plus aisément les explications de Profiat Duran et de Sante Pagnini.
2. Ces deux traités ont été traduits une première fois, au XIe siècle, par Moïse Gikatilla, sous le
titre Sefer otyot ha-naḥ we-ha-meshekh et Sefer baʿaley ha-kefel (Ḥayyuj 1870) et une seconde fois, à
Rome vers 1140‑1142, par Abraham ibn Ezra, sous le titre Sefer otyot ha-naḥ et Sefer peʿaley ha-kefel
(Ḥayyuj 1844). En ce qui concerne la traduction d’Abraham ibn Ezra, voir l’article de Shlomo Sela
et Gad Freudenthal (2006).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
42
3. On peut citer, par exemple, l’adaptation à l’hébreu du paradigme faʿala. La première
occurrence apparait dans les Těšuḇot des disciples de Menaḥem ben Saruq à Dunaš ben Labraṭ
(Benavente Robles et Sáenz-Badillos 1986). L’utilisation des radicales fāʾ, ʿayn et lām pour
désigner les trois lettres radicales est explicite dans l’ouvrage de Ḥayyuj. Pour l’adaptation en
hébreu, c’est Ibn Gikatilla qui fait figure de pionnier (Ḥayyuj 1870 : 5).
4. Sáenz-Badillos (2001 : 47) ; la terminologie utilisée par Ḥayyuj est aussi largement empruntée à
celle de la grammaire arabe (Bacher 1882).
5. Sáenz-Badillos (1986). Cet ouvrage a été précédé par les listes massorétiques, comme Sefer
okhlah we-okhlah, qui regroupaient les mots selon des critères sémantiques ou morphologiques
(Díaz Esteban 1975).
6. Point diacritique placé dans la consonne, dont on distingue deux types : le dageš léger qui
marque la prononciation occlusive de certaines consonnes et le dageš fort qui note un
redoublement. C’est de ce dernier qu’il s’agit ici.
7. Ḥayyuj (1870 : 100). La traduction d’Abraham ibn Ezra est plus littérale et plus concise – il est
possible qu’il ait disposé d’une version arabe différente – et en voici la dernière phrase (Ḥayyuj
1844 : 146) : « si [la forme] est marquée d’un dageš, tu sauras avec certitude qu’il s’agit d’un verbe
géminé, et sinon qu’il s’agit d’un verbe à deuxième radicale faible. »
8. « Le livre de la langue élégante » a été composé en tishre 4906 [octobre 1145] à Rome (Sela et
Freudenthal 2006 : 19).
9. Le Kitāb al-Tanqīḥ, traduit par by Judah ibn Tibbon, comprenait deux parties : une grammaire
Kitāb al-Lumaʿ et un dictionnaire des racines Kitāb al-uṣul, qui avaient pour titre, en hébreu, Sefer
ha-Riqmah et Sefer ha-Shorashim (Ibn Janaḥ 1896 et 1964).
10. J. Qimḥi (1888), M. Qimḥi (1519) et D. Qimḥi (1966).
11. Iancu-Agou (1976).
12. C’est ce dont témoigne une des gloses relevées par Benjamin Richler dans le manuscrit
Parma, Biblioteca palatina 2290 : « c’est ce qu’il nous a transmis en secret et en se cachant
(fo 23vo) ». Voir Richler et Beit-Arié (2001 : notice 1310) et également le livre de Maud Kozodoy
(2015).
13. Une lettre adressée en 1393 à Joseph ben Abraham à la mort de son père, R. Abraham ben
Isaac ha-Levi de Gérone, un des guides spirituels les plus importants de la communauté juive
catalane, dans laquelle il décrit la situation désespérée du judaïsme contemporain ; deux textes
de polémique anti-chrétienne, une lettre satirique – ʾAl tehi ke-avotekha, « Ne sois pas comme tes
pères » – adressée en 1396 à son ami David Bonet Bonjorn, converti de force mais qui renia
ensuite la foi de ses pères, et Kelimat ha-goyim, « L’opprobre des nations », généralement daté de
1397, dans lequel Profiat Duran s’attaque aux fondements du christianisme (Renan 1893 :
395‑404). Selon Richard W. Emery (1968), ces ouvrages composés en hébreu étaient destinés à des
juifs ou à des conversos, dans le but de les soutenir et de les encourager à persévérer dans leur foi.
14. Comme souvent, les titres des ouvrages hébreux rappellent des expressions bibliques, tout en
fournissant des indications concernant l’auteur. Si dans la Bible, ep̄od (alef – pe – dalet) désigne un
vêtement du grand-prêtre (Ex 28,15 et 39,8), il faut le lire ici comme l’acronyme de Amar Profiat
Duran, « Profiat Duran a dit ».
15. Un des sept schèmes verbaux ou binyanim ‘constructions’, comme les ont nommés les
grammairiens médiévaux ; les noms des binyanim correspondent au croisement de la racine-type
PʿL avec le schème de l’accompli, troisième personne du masculin. On a ainsi le פעלpaʿal ou qal
‘le léger’, qui ne comprend ni redoublement, ni ajout de consonne, le nip̄ʿal, le piʿel, le puʿal, le
hip̄ʿil, le hop̄ʿal, le hitpaʿel.
16. Ḥayyuj (1870 : 100, l. 23 et suivantes), cité ici p. 4.
17. Voir plus loin l’explication plus complète de Pagnini.
18. Pagnini (1526, Libri IIII, chap. 4 et 5, p. 395‑400). Le titre de la première édition étant très long
parce qu’il détaillait ce que contenaient les quatre livres de ces Hebraicas institutiones, les éditions
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
43
ultérieures retiendront la mention figurant à la fin du livre, expliciunt Quatuor Libri Institutionum
Hebraicarum (1549).
19. Les deux grammaires de l’hébreu imprimées précédemment en France étaient assez
rudimentaires : Tissard (1508 ou 1509) ; Qimḥi ([1520]).
20. Schwarzfuchs (2008 : 16‑19).
21. Voir Kessler-Mesguich (2013 : 127 et n. 26).
22. La première édition du Mikhlol date de 1545 (Venise : Daniel Bomberg), tandis que le Maʾaseh
efod n’a pas été publié avant 1865.
23. Kessler-Mesguich (2013 : 145) : « Le Maʾaseh efod n’est explicitement cité que cinq fois, à
propos des différences de prononciation entre les différentes communautés juives, et à propos
des conjugaisons passives ».
24. Ibid. : 138.
25. Dans l’édition de 1549, les chapitres 4 et 5 sont réunis sous le titre Modus inveniendi radices, hoc
est themata, et primitiva omnium Hebraicarum dictionum avec comme sous-titre Ratio inveniendi
radices nominum, « méthode pour trouver les racines des noms » (p. 434‑437) pour le chapitre 4 et
Ratio inveniendi radices verborum, « méthode pour trouver les racines des verbes » (p. 437‑439)
pour le chapitre 5.
26. Thème latin = racine et le suffixe, sans les désinences personnelles. Pour un nom, on pourrait
parler en hébreu de schèmes nominaux. Dans la préface du Dictionarium hebraicum, Münster
désigne le « Livre des racines » dont il s’inspire, Sefer ha-shorashim de David Qimḥi, par
l’expression liber de Radicibus et il ajoute sic enim illa gens themata dictionum vocat « car c’est ainsi
que ces gens appellent les thèmes des mots » (1523, f. Aa2v).
27. Pagnini emploie plusieurs termes pour désigner les voyelles : nequdot, tenuʾot, rešamim et
melaḵim ( Hebraicarum institutionum : 6). Kessler-Mesguich (2013 : 132) fait remarquer que la
présentation de Pagnini rassemble des termes métalinguistiques provenant de plusieurs
grammairiens. Le terme melaḵim ‘rois’, bien qu’employé dans le Mikhlol de David Qimḥi, renvoie
au système le plus ancien, celui des sept rois, c’est à dire des sept timbres, auxquels s’oppose le
« serviteur », le šewa (ibid., n. 132).
28. C’est un passage du Efod (Friedländer 1865 : 141).
29. Ces lettres permettent de former la phrase mnémotechnique que David Qimḥi (1548, f. 38r)
cite au nom de son frère Moïse : moše kataḇ ʿelenu « Moïse nous a écrit » en revanche, ce dernier a
repris dans le Mahalakh celle qui figurait déjà dans le Maḥberet : etkenah mešali bo (Qimḥi, M. 1519
: 6).
30. Ces lettres forment le mot heʾemanti ‘j’ai eu confiance’.
31. L’édition 1529 a un shin et non un אשבעtsade, une erreur corrigée dans celle de 1549.
32..dans l’édition de 1529 צוד
33. L’édition de 1529 comporte une phrase qui a été supprimée de l’édition de 1549 : « Et dans עִיר
ʿīr ‘ville’, une fois enlevé le iod en puissance [et ]ערsigne de voyelle royale, il reste [ ]יchiric [est]
vau, et la racine est עו ּרʿWR. »
34. Jr 30 : 13. La traduction de ces deux termes ne figure pas dans l’édition de 1529.
35. L’édition de 1529 a « מחילהmeḥīllah ‘commencement’, une fois enlevées les lettres memet []מ
he.une erreur corrigée dans l’édition de 1549 ,« []ה
36. Pagnini (1529).
37. Friedländer (1865 : 144) : והדרך הששי.
38. Référence erronée dans Pagnini (1529).
39. Ibid. תִים
ּ ִפ
ּ : pattīm.
40. La formulation est laconique. Les monosyllabiques ne dérivent pas de la forme plurielle mais
bien de la racine géminée que l’on identifie grâce à la présence du dageš dans les dissyllabiques.
41. Buxtorf (1629 : f. 6r-v de l’introduction). Seuls quelques exemples supplémentaires des points
2 et 5 n’ont pas été reproduits ici.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
44
42. Buxtorf (1691 : 30‑31) : « 1. Enlève les serviles, et s’il reste trois lettres, tu peux considérer
qu’elles forment la racine du thème. 2. Si deux lettres seulement restent, tu peux ajouter soit nun,
soit yod au début, ou insérer un waw au milieu, ou encore mettre un he à la fin, ou doubler la
deuxième lettre, ce qui permettra de trouver la racine recherchée. 3. S’il reste une lettre
seulement, après avoir enlevé les serviles, tu dois mettre soit un nun soit un yod au début, et un he
à la fin ; la racine sera ainsi identifiée. 4. Tout ce qui s’écarte de ces règles, l’expérience, cher
lecteur, te le fournira. »
43. James Noble (1832 : 122‑124) cite le compendium de Adrianus Reeland (1721) et bien sûr
l’ouvrage de Johannes Buxtorf (1629 : f. 6r‑v de l’introduction), maintes fois édité. La filiation
entre ces ouvrages est indiquée par les auteurs. Voir également Sámuel Zsigmondy (1828 : 90) où
ne figurent que les trois premières règles précédées de la mention Antiquiores Grammatici
secundum hos versus verborum radicem investigabant.
44. Ladvocat (1755).
RÉSUMÉS
La notion de trilitéralité des racines, fortement inspirée par la tradition arabe, a demandé une
grande créativité pour être mise en œuvre dans la grammaire hébraïque. Judah Ḥayyuj (Fez,
950 – Cordoue, ca 1000) fit œuvre de pionnier en analysant le comportement des consonnes
faibles qui peuvent ne pas être visibles dans certaines formes verbales tout en restant présentes
dans la forme théorique de base. Ses travaux ont été poursuivis par Jonah ibn Janaḥ (Cordoue, ca
985/990 – ca 1050) dont les ouvrages, adaptés ou traduits en hébreu, ont permis la diffusion des
doctrines grammaticales de l’hébreu en Europe chrétienne et l’adoption définitive de la théorie
des racines trilitères. Les dictionnaires des racines sur le modèle du Kitāb al-uṣūl d’Ibn Janaḥ, outil
commode pour classer le lexique biblique, devinrent populaires en Provence médiévale. Il restait
cependant une difficulté majeure, à savoir les manières d’identifier la racine d’une forme
nominale ou verbale complexe. Profiat Duran (Perpignan, < 1360 – ca 1414) fut le premier auteur
à insérer dans sa grammaire, le Maʿaseh efod, un chapitre décrivant les différentes méthodes
permettant l’identification des racines. Ce passage, adapté ou résumé, fut fréquemment repris
par les humanistes chrétiens dans leurs ouvrages linguistiques, et ce jusqu’au XIXe siècle.
The notion of triconsonantal roots was borrowed from the Arabic tradition and a great deal of
creativity was required in order to apply it to Hebrew grammar. Judah Ḥayyuj (Fez, 950 –
Cordoba, ca 1000) was the first to note that weak consonants have a different comportment, that
they may not be visible in certain verbal forms, but remain present in the theoretical basic form.
His work was carried on by Jonah ibn Janaḥ (Cordoba, ca 985/990 – ca 1050), whose writings were
adapted or translated into Hebrew. This led to the diffusion of Hebrew grammatical knowledge in
Christian Europe and the adoption of the theory of triconsonantal roots. Dictionaries of roots
patterned on Ibn Janaḥ’s Kitāb al-uṣūl, which are a convenient tool for classifying the lexicon of
biblical words, became popular in medieval Provence. A major difficulty remained, namely how
to identify the root of a complex nominal or verbal form. Profiat Duran (Perpignan < 1360 – ca
1414) was the first author to include in his grammar, Maʿaseh efod, a chapter describing the
different methods for identifying the roots. This chapter, through adaptations or summaries, was
often used by the Christian humanists in their linguistic works down to the nineteenth century.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
45
INDEX
Mots-clés : Qimḥi (David), identification de la racine en hébreu, Duran (Profiat), racines
trilitères en hébreu, Pagnini (Sancte), tradition grammaticale hébraïque
Keywords : Qimḥi (David), Hebrew grammatical tradition, identifying roots in Hebrew, Duran
(Profiat), Pagnini (Sancte), triconsonantal roots in Hebrew
AUTEUR
JUDITH KOGEL
CNRS, Institut de recherche et d’histoire des textes (UPR 841 IRHT), Aubervilliers, France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
46
Le modèle arabe en grammaire
copte. Une approche des
muqaddimāt copto-arabes du Moyen
Âge
Adel Y. Sidarus
NOTE DE L’ÉDITEUR
La version originale de cet article a été publiée dans Dichy et Hamzé (2004 : 253‑267). Il
est republié ici avec l’aimable autorisation de l’Ifpo, sous une forme légèrement
retouchée et augmentée, revue par l’éditeur. Une version anglaise est également parue
en 2018 dans Coptica 17 : 11‑24.
1 Dans le courant du XIIIe siècle, les Coptes connurent une renaissance intellectuelle et
littéraire dans un contexte dominé par la langue et la culture arabes 2. À cette époque,
Le Caire était en voie de devenir la nouvelle capitale de l’islam arabe, par suite de la
destruction de Bagdad par les Mongols. Et dans ce cadre, l’étude intensive et
systématique de leur langue nationale et religieuse, qui cessait progressivement d’être
une langue vivante, mérita une attention particulière. D’autant plus que tout
renouveau intellectuel sérieux – nous le savons – touche, sous une forme ou une autre,
le champ linguistique.
2 Si la lexicographie pouvait se prévaloir d’une tradition nationale plusieurs fois
millénaire, égyptienne pharaonique et, plus tard, copte hellénique 3, la grammaire,
jusque-là inexistante (!), ne pouvait se développer que dans le giron de la tradition
linguistique arabe, dont les principaux mentors se trouvaient alors en Égypte (Makram
1980).
3 C’est ainsi que, parmi les grammaires nationales qui surgirent au Moyen Âge dans la
dépendance de cette vigoureuse tradition4, la grammaire copte – qui se prolonge
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
47
jusqu’à nos jours en milieu égyptien – mérite, à un triple titre, une attention
particulière : (a) elle est rédigée entièrement en langue arabe ; (b) elle n’a recours à
aucune autre tradition autochtone antérieure ; (c) elle décrit une langue non sémitique.
De plus, cette production linguistique copto-arabe a exercé, à son tour, un rôle
déterminant dans la naissance de la tradition nationale de philologie éthiopienne
(Moreno 1949 ; Cohen 1963).
4 La grammaire copte de langue arabe est appelée muqaddima (« préface, introduction,
prolégomènes »). Bien que cette appellation se trouve occasionnellement en arabe,
l’appellation semble s’être imposée historiquement à ce domaine de la philologie copte
à cause de la première de toutes les grammaires, celle de Yūḥannā al-Sammanūdī
(fl. 1230‑1260)5. Non seulement elle se présente, du point de vue de la forme et du
contenu, comme une véritable « introduction » grammaticale au vocabulaire copto-
arabe intitulé Sullam kanāʾisī (« Scala ecclesiastica »), objet premier de l’auteur, mais
c’est sous l’impulsion directe ou indirecte de cette première ébauche, communément
connue sous le nom d’al-Muqaddima al-samannūdiyya, qu’auront surgi les autres
grammaires.
5 Il n’y a pas lieu de nous attarder ici sur l’histoire littéraire de ce genre, que nous avons
exposé ailleurs6. Pour l’essentiel, on dira que nous avons un ensemble de sept ou huit
traités grammaticaux. Les six premiers ont vu le jour vers le milieu du XIIIe siècle, dans
un bref laps de temps d’une vingtaine ou trentaine d’années. Ils portaient sur le copte
bohaïrique, c’est-à-dire sur le dialecte, ou idiome, de la Basse-Égypte (al-Buḥayra). Les
septième et huitième traités ne sont apparus qu’un siècle plus tard dans la région de
Qous, en Haute-Égypte (al-Ṣaʿīd) ; ils traitent du sahidique 7. Le premier est une
reformulation de la grammaire de Sammanūdī adaptée au sahidique ; le second, dû au
futur évêque de Qous, Aṯanāsiyūs (fl. 1350‑1380), et titré pompeusement Qilādat al-
taḥrīr / fī ʿilm al-tafsīr (« Le collier tressé [égrenant les bases de] l’art de l’interprétation
[de la langue] »). L’auteur en a donné lui-même un long « Commentaire » (Šarḥ), à la
manière des grammairiens arabes de l’époque, lequel pourrait être considéré comme
une véritable neuvième grammaire, malgré l’état fragmentaire dans lequel il nous est
parvenu8. De toute manière, l’œuvre grammaticale d’Athanase de Qous, le dernier
grand écrivain arabo-copte du Moyen Âge9, constitue la description la plus complète, la
plus pertinente et la mieux structurée de la langue copte (voir tableau 1 ci-dessous).
6 Parmi les questions qui se posent à l’historien de la linguistique, surtout dans une
perspective comparatiste, la principale concerne les modalités de l’application des
catégories grammaticales arabes à la description de la langue copte : quels sont les
termes ou expressions techniques qui ont le plus ou le mieux servi à cet effet ? De
quelles écoles ou traités grammaticaux proviennent-ils ? Dans quelle mesure ces termes
arabes, forgés pour rendre compte d’une langue sémitique, ont-ils été appliqués au
copte d’une manière satisfaisante ?
7 Par ailleurs, quel a été le sens nouveau que certains termes ont dû prendre ? Quels
néologismes ont dû être forgés ? Existe-t-il des parallèles dans les autres traditions
grammaticales dépendantes de la linguistique arabe ? Dans quelle mesure, enfin, les
grammairiens coptes de cette basse-époque connaissaient-ils leur langue d’origine et
avaient l’appréhension correcte de ses règles et de sa structure elle-même ?
8 Évidemment, seule pourrait répondre à ces questions une étude systématique et
historique de la terminologie et des catégories grammaticales des muqaddimāt coptes.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
48
9 L’entreprise a été inaugurée par Bauer (1972 : 71‑150), qui a procédé à l’analyse critique
du vocabulaire technique d’Athanase de Qous, à partir de la Qilādat al-taḥrīr. Il faut
aujourd’hui étendre cette étude à son Šarḥ, dont l’existence était ignorée par Bauer.
D’autre part, on manifestera une certaine réserve à l’égard de plusieurs cas considérés,
trop facilement, comme néologismes : non seulement Bauer a consulté relativement
peu de sources originales, mais elle a négligé, ou n’a pas pu avoir accès à la masse des
traités grammaticaux arabes d’époque tardive, surtout de tradition égyptienne 10 –
ceux-là mêmes qui ont dû inspirer, en premier lieu, les grammairiens coptes.
10 Ceci dit, les résultats de l’étude circonscrite de Bauer sont largement corroborés par la
lecture des prédécesseurs d’Athanase, dont aucun des écrits, fort malheureusement, n’a
connu d’édition critique11.
11 Dans les limites du présent essai, il ne sera sans doute pas possible de remédier à tout
cela, ni de répondre intégralement à toutes les interrogations posées antérieurement.
Après avoir fourni des éléments complémentaires sur ce genre d’écrit philologique
bilingue, nous nous contenterons d’exposer quelques exemples de la stratégie adoptée
pour décrire convenablement en arabe la langue copte.
1 Structure et contenu des grammaires
12 Quelques observations, en tout premier lieu, à propos de la structure et du contenu des
grammaires coptes de langue arabe.
13 En observant le tableau 1, on pourra relever facilement la division tripartite selon les
parties du discours, devenue classique en arabe – à la suite, peut-être, du modèle gréco-
syriaque : nom / verbe / particule, ism / fiʿl / ḥarf.
Tableau 1. Structure de la Qilādat al-taḥrīr d’Athanase de Qous (milieu du 8 e/XIVe siècle ; double
version sahidique et bohaïrique)
Partie I : Le nom (ism)
1. Le masculin
2. Le féminin
3. Le pluriel
4. Différence du genre entre le copte et l’arabe
5. Construction du possessif (de la relation) (al-asmāʾ al-muʿtalla al-muḍāfa!)
6. Le nom indéfini
Le nom propre de personne (al-asmāʾ al-aʿlām ) et la relation/appartenance le concernant
7.
(nasab)
8. Le nom de lieu (asmāʾ al-mudun) et idem
9. Le vocatif
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
49
10. Flexion finale du vocatif grec (tarḫīm)
11. Le pronom personnel absolu (asmāʾ muḍmara)
12. Le démonstratif
13. L’annexion (asmāʾ muḍāfa)
14. Le pluriel avec formes particulières (taksīr)
15. Le nom composé
Partie II : Le verbe (fiʿl)
16. Le nom verbal (ism al-fiʿl)
17. Conjugaison du parfait [I]
18. Conjugaison du présent [II]
19. Le circonstanciel (fiʿl al-ḥāl )
20. Le futur I (fiʿl al-mahl)
21. Conjugaison de l’impératif
22. a. Le prohibitif (al-nahy bi-lā ; copte : mpe)
b. Négation I (al-nahy bi-lā = taḫṣīṣ ; copte : ‘nn-)
23. Négation II (al-nafy bi-lam ; copte : mpe)
24. Le complément absolu (maṣdar!)
25. Syntaxe des attributs du complément absolu (al-tawābiʿ)
26. Le complément prépositionnel (al-taʿaddī)
27. Mise en relief du sujet ou de l’objet (iẓhār…)
28. Inflexion et réduction finale de certains verbes (taṣġīr/tarḫīm)
29. Inflexion et réduction finale de l’impératif (taṣġīr/ğazm)
30. L’impératif renforcé (lawāḥiq al-amr)
31. Inflexion et réduction finale du prohibitif (taṣġīr/ğazm)
32. Modalités de la voix passive
33. Mise en relief de l’objet dans la voix passive (version bohaïrique solo)
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
50
Partie III : Les particules (ḥarf)
34. Particules inchoatives
35. Particules négatives et prohibitives (al-nafy wal-nahy)
36. Particules d’exception
37. Particules copulatives (al-ʿaṭf)
38. Particules interrogatives
39. Particules de comparaison
40. Particules diverses
41. Adverbes [et noms] de temps (incl. jours de la semaine et al.)
42. Adverbes [et noms] de lieu (incl. points cardinaux et al.)
43. Le nombre (avec les fractions)
Appendice (phonologie et alphabet)
44. La gémination (tašdīd ; sahidique solo)
45. Assimilation, dissimilation etc.
46. Altérations phonologiques de certaines lettres (version bohaïrique solo)
47. Pronoms divers et al. (asmāʾ išārāt)
48. Points d’articulation des sons (maḫāriğ al-ḥurūf ; sahidique solo)
49. Particularités de l’alphabet/lettres (asrār al-ḥurūf) (symbolique et classification phonologique)
14 On note aussi que, contrairement à la tradition arabe, la syntaxe n’est pas traitée
séparément. Elle est intégrée, en général, dans l’exposé morphologique, si bien qu’on
peut affirmer que les grammaires coptes médiévales nous offrent largement une
morphosyntaxe de la langue. En tous cas, il s’agit d’une syntaxe assez élémentaire, en
même temps que lacunaire et confuse. Sans doute, le modèle arabe, tout centré qu’il est
sur l’iʿrāb (flexion casuelle), ne pouvait guère servir pleinement.
15 D’autre part, suivant en cela les péripéties de l’histoire littéraire copto-arabe 12, le
processus d’élaboration de la grammaire copte a connu certaines ruptures, comme
nous l’avons dit. Cela aura entravé une évolution progressive dans le sens d’une analyse
syntaxique plus poussée et adéquate de l’idiome national d’origine.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
51
16 Dans la même ligne, on notera l’absence de toute sémantique des formes
grammaticales. Cette lacune se fait sentir, très particulièrement, lors du traitement des
formes verbales, dont le nombre oscille, selon les nomenclatures, entre quinze et vingt-
deux (!), temporelles ou modales13. Or rien n’est dit sur l’étiologie ou la fonction
sémantique de chacune de ces formes.
17 D’une manière générale, l’exposé linguistique recourt régulièrement à la méthode
contrastive par rapport à l’arabe. On assiste souvent à de simples procédés
d’équivalence ou de transposition des formes, des constructions, des fonctions
grammaticales de la langue arabe, que tout le monde est censé dominer, sinon avoir
étudié en tout premier lieu.
18 Toujours d’après notre tableau, le traitement des lettres et des sons se trouve rejeté à la
fin. On pourrait penser à une influence directe des traités arabes. Sauf que l’existence
de cette partie grammaticale dans la Qilāda se présente comme une exception par
rapport aux autres traités. De plus, elle semble constituer une addition inspirée, sinon
dépendante, d’un petit traité anonyme qui sert de prologue, dans un bon nombre de
manuscrits, au corpus des grammaires bohaïriques fixé un bon demi-siècle avant
(Sidarus 2016b).
2 Le traitement de la morphologie
19 Nous avons vu que la morphologie représente la partie principale des grammaires
coptes de tradition arabe. Sachant toutefois que le traitement de la morphologie dans
cette tradition linguistique, le taṣrīf, est vraiment sui generis, la question se pose
réellement de savoir en quoi consiste le taṣrīf copte : comment a fonctionné ici le
modèle arabe ? Quel changement de sens a pris ce terme et les mots de la même famille
(ṣarrafa, taṣarrafa, inṣarafa, mutaṣarrif, munṣarif...) qu’on trouve partout dans ces
grammaires (Bauer 1972 : 111‑114 et 316) ?
20 Rappelons d’abord que dans la grammaire arabe le taṣrīf (aujourd’hui ṣarf) s’applique
principalement à identifier les multiples schèmes morphématiques (ʾawzān, ʾabniya) du
mot et les règles de possibles variations phonologiques (ʾaḥwāl) 14. Ce procédé découle
directement du système morphologique arabe qui se présente très régulier : racine ou
base consonantique (ʾaṣl) combinée avec des « schèmes » vocaliques et un nombre
limité d’« augments » (ḥurūf zawāʾid). Dans une large mesure, c’est bien le cas des autres
langues sémitiques, comme l’hébreu ou le syriaque, pour la description desquelles cette
approche s’est avérée suffisamment adéquate15.
21 Mais le copte, on l’a dit, n’est pas une langue sémitique. Et tant les structures de base
que la construction des mots n’ont rien à voir avec ce type linguistique. En tant que
dernier avatar de l’égyptien ancien, il appartient certes à la grande famille chamito-
sémitique – ou « afro-asiatique », d’après une terminologie plus récente. Malgré cela,
quant à la structure des mots (noms et verbes), le copte se présente, dans ses différents
dialectes16, comme une langue éminemment agglutinante. Dans le tableau 2 ci-dessous,
nous en donnons un exemple extrême, tiré du bohaïrique et que Dulaurier (1849: 737)
avait jadis relevé.
22 Le grammairien al-Wağīh al-Qalyūbī (mort après 1271) avait bien vu cette particularité
du copte en opposition à l’arabe. Il écrit dans le prologue à sa grammaire intitulée al-
Kifāya17 :
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
52
Chaque langue recourt, pour son intelligence, à des marques (ʿalāmāt) distinguant le
singulier du pluriel, le masculin du féminin, le défini de l’indéfini […] 18.
Or il est des langues dont les marques [ distinctives sont exprimées] par des
voyelles19 ( fa-min al-luġāti mā ʿalāmātu-hu bi-l-ḥarakāt) – comme l’arabe. Dans
d’autres, ces marques [sont exprimées] par des segments [morphématiques] qui
s’ordonnent dans le mot lui-même (wa-min-hā mā ʿalāmātu-hu bi-ḥurūfin tantaẓimu fī
nafsi l-kalima) – et la langue copte appartient à ce type.
23 Ainsi donc, l’objet du taṣrīf copte sera très différent de l’arabe. Le terme et ses dérivés
s’appliqueront, en premier lieu, à l’analyse du phénomène omniprésent de l’affixation
du pronom personnel aux différentes catégories de mot, d’une part, et aux préfixes ou
« préformantes » définissant les temps et les modes du verbe, en second lieu (cf. Bauer
1972 : 111‑114). Dans le tableau 3 ci-dessous, nous donnons une idée de ce fait
linguistique.
24 On aura noté, dans le passage cité, l’emploi particulier du mot ʿalāma dans le sens de
« marque grammaticale, signe distinctif, morphème ». Nous avons affaire là à une
notion-clé de la grammaire copte, contrairement à l’arabe, où le terme, dans son sens
générique de « marque, signe », désigne parfois les segments morphématiques suffixés
tels que le tanwīn (marque d’indéfinitude), le suffixe -at du féminin (tāʾ marbūṭa ) ou le
suffixe -iyy servant à marquer l’adjectif de relation (nisba). En syntaxe, on a l’expression
technique ʿalāmāt al-iʿrāb pour exprimer les voyelles casuelles finales : /a, i, u, ø/. En
copte, par contre, le terme s’applique autant aux segments-lettres qu’aux mots-
particules dans leur fonction grammaticale propre ; d’où l’emploi constant du terme
(cf. Bauer 1972 : 137‑138).
25 Dans un sens plus technique, le terme désigne tantôt les suffixes pronominaux, dont
l’usage est très fréquent, tantôt les préfixes propres aux formes verbales (voir tableau
3).
Tableau 2. Exemple d’agglutination en copte (bohaïrique)
ϯⲙⲉⲧⲣⲉϥⲉⲣⲡⲉⲧϩⲱⲟⲩ = la méchanceté, malice, perversité, iniquité
ϯ–ⲙⲉⲧ–ⲣⲉϥ–ⲉⲣ–ⲡ–ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ
ϩⲱⲟⲩ = être mauvais/gâté, méchant/pervers
(verbe d’état)
ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ = qui est mauvais
(+ particule relative)
ⲡ–ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ = ce qui est mauvais → le mal
(+ article défini masc. sing.)
ⲉⲣ–ⲡ–ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ = faire le mal, être méchant/inique/pervers
(+ verbe auxiliaire factitif)
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
53
ⲣⲉϥ–ⲉⲣ–ⲡ–ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ = qui fait le mal, qui est méchant
(+ préfixe agentif < même verbe + pronom personnel)
ϯ–ⲙⲉⲧ–ⲣⲉϥ–ⲉⲣ–ⲡ–ⲉⲧ–ϩⲱⲟⲩ = l’état/qualité de faire le mal, d’être méchant
(+ préfixe d’abstraction avec article défini fém. sing.) → la méchanceté, malice, perversité, iniquité
Tableau 3. Domaines d’application du taṣrīf en copte (sahidique)
Pronoms personnels affixes Préfixes des formes verbales
1 –ⲓ/ⲁ/ⲧ ⲉ– Présent II
2m. –ⲕ ϣⲁ– Prés. consuetud.
singulier
2f. –ø/(ⲣ/ⲧ)ⲉ ⲙⲉ– – négatif
3m. –ϥ ⲁ– Parfait I
3f. –ⲥ ◌︥ⲙⲡ– – négatif
1 –ⲛ ◌︥ⲛⲧⲁ– Parfait II
pluriel
2 –(ⲧⲉ/ⲏⲩ)ⲧ︥ⲛ ⲛⲉ– Imparfait
3 –(ⲥ)ⲟⲩ/ⲥⲉ ◌︥ⲛⲧⲉⲣ– Temporel
ⲧⲁⲣ(ⲉ)– Finale
◌︥ⲛ(ⲧ)– Subjonctif
ⲧⲣ(ⲉ)– Causatif
etc.
Autres cas de suffixation du pronom personnel
• verbes-lexèmes (réflexif, complément d’objet
• prépositions
• article défini → article possessif
• certains substantifs (v. g. membres du corps)
3 Le traitement des lettres et des sons
26 La différence qui existe entre l’écriture essentiellement consonantique de l’arabe et
celle à la fois consonantique et vocalique du copte, a forcément amené à des
changements de sens dans la terminologie arabe propre à ce domaine de la description
linguistique.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
54
27 En graphémologie arabe, ḥarf (pl. ḥurūf) veut dire « lettre-consonne » et ḥaraka « signe-
voyelle ». En copte, le premier terme a pris le sens de « lettre » tout court, c’est-à-dire
« consonnes » et « voyelles » indifféremment − ḥarf signifie donc « lettre-son » ou
« graphème-phonème ». Quand il fallait parler univoquement de « voyelles », les
grammairiens coptes ont créé le néologisme ḥurūf ṣawtiyya ou nawāṭiq = « lettres
sonnantes/vocales ou articulantes » (sans doute sur le modèle du grec στoιχεῖα
φωνήεντα). Et pour indiquer les sept graphèmes d’origine égyptienne (démotique) qui
complètent l’alphabet grec adopté pour écrire le copte, ils ont emprunté au registre de
la terminologie morphologique arabe l’expression ḥurūf zawāʾid (« lettres
additionnelles/supplémentaires ») qui désigne les « augments » qui entrent en jeu dans
certains schèmes morphologiques, comme signalé plus haut.
28 Conformément au système d’écriture arabe, l’expression ḥarf muḥarrak veut dire
« consonne vocalisée/voyellée » (voir plus haut). En copte, l’expression a servi pour
exprimer l’anaptyxe : prothèse ou épenthèse (cf. Bauer 1972 : 118‑119). Dans la
prothèse, une consonne initiale reçoit une voyelle prothétique (« attaque vocalique »),
marquée par un signe supra-linéaire : un point, une barre ou une sorte d’accent grave,
selon les différentes traditions graphiques. C’est ou bien pour éviter la prononciation
d’un amas consonantique initial (peut-être par influence de l’arabe : alif al-waṣl), ou
bien pour prononcer séparément une consonne préfixée à fonction grammaticale. Dans
le cas de l’épenthèse, deux consonnes contiguës reçoivent une voyelle intermédiaire
« chuchée » (cf. le schwa), toujours signalée par le même type de « signe ».
29 Dans ce double phénomène, il est évident que le mot ḥaraka indique le signe
graphique20. Ce qui ne s’éloigne pas de l’un des sens primaires du mot arabe, puisque la
voyelle (ḥaraka) est nécessairement exprimée graphiquement par un signe supra- ou
infra-linéaire, dit ḥaraka de même, et que – sans doute par extension – un nombre de
ḥarakāt-signes indiquent graphiquement des faits phonologiques non vocaliques,
comme la gémination (šadd), la liaison (waṣl), etc. Dans la même ligne de restriction du
sens, du point de vue purement phonologique, et considérant le système alphabétique
du copte, le terme ḥaraka ne peut signifier qu’« anaptyxe » (prothétique ou
épenthétique), « voyelle prothétique », « voyelle intermédiaire chuchée ».
30 En alternative à ḥaraka/muḥarrak, on trouve aussi hamz/mahmūz (cf. Bauer 1972 :
119‑121). Si dans le cas de la prothèse, il y a identité entre l’attaque vocalique et
l’occlusive glottale (hamza) si caractéristique de l’arabe, dans le cas de l’épenthèse
copte, ce n’est plus le cas : on a affaire à un cas d’« extension du sens » (tableau 4).
Tableau 4. Un exemple supplémentaire de changement de sens par analogie
Arabe Copte
(alphabet consonantique) (alphabet consonantique et vocalique)
ḥarf (pl.
= lettre-consonne ḥarf = lettre-son/graphème-phonème
ḥurūf)
ḥurūf
= lettres sonantes/articulantes (gr.
ḥaraka = signe-voyelle ṣawtiyya/
στoιχεῖα φωνήεντα)
nawāṭiq
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
55
ḥarf = consonne voyellée = anaptyxe :
muḥarrak prothèse/épenthèse
= lettres additionnelles / = lettres additionnelles à l’alphabet
ḥurūf ḥurūf
supplément = augments (ordre grec = d’origine démotique (ordre
zawāʾid zawāʾid
morphématique) alphabétique)
4 Conclusion
31 Les limites de cette contribution ne nous permettent guère d’aller au-delà des quelques
exemples que nous venons de présenter, portant sur de grands chapitres de la
grammaire. Il s’agissait de donner une idée de la méthode suivie par les grammairiens
coptes de culture arabe pour décrire leur langue d’origine sous le signe de la
linguistique arabe. Historiens de cette tradition linguistique ou spécialistes de la
grammaire comparée pourront approfondir la question, en reprenant les données
recueillies par Bauer (1972) ou en analysant, après édition critique, certains des écrits
du genre, en vue d’assurer une perspective historique plus circonstanciée (cf. Sidarus
1977 : 27 et 33).
32 De toute façon, il nous semble pouvoir affirmer que les philologues coptes du Moyen
Âge ont, d’une manière générale, bien mené leur tâche. Grâce aux ajustements
nécessaires : extensions ou restrictions de sens, dérivations ou compositions, analogies
ou néologismes, les termes et les catégories grammaticaux arabes se sont révélés, sous
leur plume, assez aptes à décrire la langue des anciens Égyptiens dans sa dernière
phase. Les lacunes qu’on pourra relever dans leur labeur – telle l’absence du traitement
satisfaisant de la syntaxe ou de la sémantique des formes grammaticales – tiennent plus
des conditionnements externes de leur activité philologique et intellectuelle que
d’éventuelles limites de la tradition linguistique arabe comme telle 21.
BIBLIOGRAPHIE
Abd al-Masīḥ, Ğ. M. et Tābirī, H. Ğ. 1990. Al-Ḫalīl. Muʿğam musṭalaḥāt al-naḥw al-ʾarabī. Beyrouth :
Librairie du Liban.
Aṯanāsiyūs al-Maqārī. 2011. Fihrist kitābāt Ābāʾ Kanīsat al-Iskandariyya. Al-kitābāt [al-qibtiyya] al-
ʿarabiyya. 2 vol. Maṣādir Ṭuqūs Al-Kanīsa, 1.8-9. [Monastère Saint-Macaire]. [http://
www.athanase.net]22.
Auroux, S., Koerner, E. F. K., Niederehe, H.‑J. et Versteegh, K., éd. 2000. History of the language
sciences : an international handbook on the evolution of the study of language from the beginnings to the
present. vol. 1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, 18/1. Berlin : W. de
Gruyter.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
56
Bauer, G., éd. et trad. 1972. Athanasius von Qūs : Qilādat at-taḥrīr fī ʿilm at-tafsīr. Eine koptische
Grammatik in arabischer Sprache aus dem 13./14. Jahrhundert. Islamkundliche Untersuchungen, 17.
Fribourg-en-Brisgau : Klaus Schwarz Verlag.
Bohas, G. et Guillaume, J.‑P. 1984. Étude des théories des grammairiens arabes, 1, Morphologie et
phonologie. Publications de l’Ifead, 112. Damas : Institut français de Damas.
Cohen, M. 1963. Lexiques éthiopiens. Comptes-rendus du GLECS 9 (1960-1963) : 99-101.
CopEnc VIII : ʿAṭiyyaẗ, ʿA. S., éd. 1991. The Coptic Encyclopedia. vol. 8 : Linguistics. New York :
Macmillan.
Dichy, J. et Hamzé, H., éd. 2004. Le voyage et la langue. Mélanges en l’honneur d’Anouar Louca et
d’André Roman. Publications de l’Ifead, 211. Damas : Ifpo.
Dulaurier, É. 1849. Grammaire copto-arabe de Séménoudi. Catalogue général des manuscrits des
bibliothèques publiques des départements. vol. I : 718-739. Paris : Imprimerie nationale.
EI2 = Bearman, P. J. et al. éd. 1954-2007. Encyclopédie de l’Islam. 2 e éd. 13 vol. Paris : Maisonneuve et
Larose.
Fleisch, H. 1961. Traité de philologie arabe. vol. 1 : Préliminaires, phonétique, morphologie nominale.
Recherches publiées sous la direction de l’Institut de lettres orientales de Beyrouth, 16.
Beyrouth : Imprimerie catholique.
Graf, G. 1947. Geschichte der christlichen arabischen Literatur, 2, Die Schriftsteller bis zur Mitte des 15.
Jahrhunderts. Studi e testi, 133. Vatican : Biblioteca apostolica vaticana.
Kircher, A. 1643. Lingua aegyptiaca restituta. Rome : Ludovic Grignan.
Layton, B. 2000. A Coptic grammar, with chrestomathy and glossary. Sahidic dialect. Porta linguarum
orientalium, neue Serie, 20. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag.
Makram, ʿAbd al-ʿĀl Sālim. 1980. Al-Madrasa al-naḥwiyya fī Miṣr wal-Šām fī l-qarnyan al-sābiʿ wal-
ṯāmin min al-Hiğra [L’école grammaticale en Égypte et en Syrie aux VIIe et VIIIe siècles de l’Hégire].
Beyrouth/Le Caire : Dār al-Šurūq. 1400 H.
Mallon, A. 1906-1907. Une école de savants égyptiens au Moyen Âge. Mélanges de la Faculté orientale
1 : 109-131 et 2 : 213-264.
Mallon, A. 1956. Grammaire copte : bibliographie, chrestomathie et vocabulaire. 4 e éd. revue par M.
Malinine. Beyrouth : Imprimerie catholique23.
Moreno, M. M. 1949. Struttura e terminologia del Sawasew. Rassegna di studi etiopici 8 : 12-62.
Munier, H. éd. 1930. La scala copte 44 de la Bibliothèque nationale de Paris. Transcription et vocabulaire,
1, Transcription. Bibliothèque d’études coptes, 2. Le Caire : Imprimerie de l’Institut français
d’archéologie orientale.
Owens, J. 1988. The foundations of grammar : an introduction to Medieval Arabic grammatical theory.
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history
of the language sciences, 45. Amsterdam/Philadelphie PA : J. Benjamins.
Owens, J. 1990. Early Arabic grammatical theory : heterogeneity and standardization. Amsterdam
studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history of the
language sciences, 53. Amsterdam/Philadelphie PA : J. Benjamins.
Petersen, T. C. 1913. An unknown Copto-Arabic grammar by Athanasius bishop of Kûs or The source of
Tukhi’s Rudimenta linguae coptae sive aegyptiacae. Washington DC : The Catholic University of
America.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
57
Polotsky, H. J. 1949. Une question d’orthographe bohaïrique. Bulletin de la Société d’archéologie copte
12 : 25‑35.
Ryding, K. C. 2014. Arabic : a linguistic introduction. Cambridge/New York : Cambridge University
Press.
Sidarus, A. 1977. Athanasius von Qūs und die arabisch-koptische Sprachwissenschaft Des
Mittelalters. Bibliotheca Orientalis 34 : 22a‑35b.
Sidarus, A. 1978. La philologie copte arabe au Moyen Âge. Dans La signification du Bas Moyen Âge
dans l’histoire et la culture du monde musulman. Actes du 8e congrès de l’Union européenne d’arabisants et
islamisants, 267‑281. Aix-en-Provence : Edisud.
Sidarus, A. 1990a. Bibliographical introduction to Medieval Coptic linguistics. Bulletin de la Société
d’archéologie copte 29 : 83‑85.
Sidarus, A. 1990b. Les lexiques onomasiologiques gréco-copto-arabes du Moyen Âge et leurs
origines anciennes. Dans Lingua restituta orientalis. Festgabe für Julius Assfalg, éd. par R. Schulz et M.
Görg, 348‑359. Ägypten und Altes Testament, 20. Wiesbaden : O. Harrassowitz.
Sidarus, A. 1990c. Onomastica aegyptiaca. La tradition des lexiques thématiques en Égypte à
travers les âges et les langues. Histoire Épistémologie Langage 12 : 7‑19.
Sidarus, A. 1993. Essai sur l’âge d’or de la littérature copte arabe ( XIIIe-XIVe siècles) Dans Acts of the
fifth international congress of Coptic studies, Washington, 12‑15 August 1992. vol. 2, éd. par D. W.
Johnson. Rome : Centro internazionale di microfichas.
Sidarus, A. 2000. Dans History of the language sciences. An international handbook on the evolution of the
study of language from the beginnings to the present, éd. par S. Auroux, E. F. K. Koerner, H.‑J.
Niederehe et K. Versteegh. vol. 1. Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft,
18/1. Berlin : W. de Gruyter.
Sidarus, A. 2001. Medieval Coptic grammars in Arabic : The Coptic Muqaddimāt. Journal of Coptic
studies 3 : 63‑79.
Sidarus, A. 2007. Multilingualism and lexicography in Egyptian Late Antiquity. Dans Stabilisierung
und Profilierung der koptischen Kirche im 4. Jahrhundert. Beiträge zur X. internationalen halleschen
Koptologentagung 2006, éd. par J. Tubach et S. G. Vashalomidze, 173‑195. Hallesche Beiträge zur
Orientwissenschaft, 44. Halle : Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
Sidarus, A. 2010. La Renaissance copte arabe au Moyen Âge. Dans The Syriac Renaissance, éd. par H.
Teule, C. Fotescu Tauwinkel, B. ter Haar Romeny et J. van Ginkel, 311-340. Eastern Christian
Studies, 9. Louvain/Paris/Walpole : Peeters.
Sidarus, A. 2012. Bibliotheca Apostolica Vaticana, Borgia Copt. 133. Dans Coptic treasures from the
Vatican library. A selection of Coptic, Copto-Arabic and Ethiopic manuscripts. Papers collected on the
occasion of the tenth international congress of Coptic Studies, Rome, September 17th-22nd, 2012, éd. par P.
Buzi et D. V. Proverbio, 109‑116. Studi e testi, 472. Vatican : Biblioteca Apostolica Vaticana.
Sidarus, A. 2016a. Nouvelles données concernant la scala gréco-copto-arabe Liber graduum. Dans
Manuscripta graeca et orientalia. Mélanges monastiques et patristiques en l’honneur de Paul Géhin, éd.
par A. Binggeli, A. Boud’hors et M. Cassin, 563-581. Orientalia lovaniensia analecta, 243 ;
Bibliothèque de Byzantion, 12. Louvain : Peeters.
Sidarus, A. 2016b. Une introduction médiévale arabe à l’alphabet et la phonétique coptes. Dans
Coptic society, literature and religion from late Antiquity to modern times. Proceedings of the tenth
international congress of Coptic studies, Rome, September 17th-22th, 2012 and plenary reports of the ninth
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
58
international congress of Coptic studies, Cairo, September 15th-19th, 2008, éd. par P. Buzi, A. Camplani et
F. Contardi, 1361-1374. Orientalia lovaniensia analecta, 247. Louvain : Peeters.
Sidarus, A. 2017. Yūḥannā Al-Samannūdī, the founder of national Coptic philology in the Middle
Ages. Dans Christianity and monasticism in Northern Egypt, éd. par G. Gabra et H. N. Takla, 139‑159.
Le Caire/New York : The American University in Cairo Press.
Sidarus, A. 2018. Deux représentants tardifs de l’âge d’or de la littérature copto-arabe (al-Makīn
Ibn al-ʿAmīd, le Jeune et Athanase de Qous). Dans Between the cross and the crescent. Studies in honor
of Samir Khalil Samir, S.J. on the Occasion of his eightieth birthday, éd. par Ž. Paša, 299-315. Orientalia
christiana analecta, 304. Rome : Pontificio Istituto orientale.
Sidarus, A. 2020. Littérature copte et copto-arabe à la fin du Moyen Âge ( XIVe s.). Dans Études
coptes XVI. Dix-huitième journée d’études coptes, Bruxelles, 22‑24 Juin 2017, éd. par A. Boud’hors et C.
Louis, 281-307. Cahiers de la bibliothèque copte, 23. Paris : De Boccard.
Stern, L. 1880. Koptische Grammatik. Leipzig : T. O. Weigel 24.
Till, W. C. 1961. Koptische Grammatik (Saïdischer Dialekt). Mit Bibliographie, Lesestücken und
Wörterverzeichnissen. Lehrbücher für das Studium der orientalischen und afrikanischen Sprachen,
1. Leipzig : VEB Verlag Enzyklopädie.
Troupeau, G. 1976. Lexique-index du Kitāb de Sībawayhi. Études arabes et islamiques. Série 3, Études
et documents, 7. Paris : Klincksieck.
Van Lantschoot, A., éd. 1948. Un précurseur d’Athanase Kircher : Thomas Obicini et la “scala” Vat. copte
71. Bibliothèque du Muséon, 22. Louvain : Bureaux du Muséon.
Versteegh, K. 1977. Greek elements in Arabic linguistic thinking. Studies in Semitic languages and
linguistics, 7. Leyde : Brill.
Versteegh, K. 1997. The Arabic linguistic tradition. Routledge history of linguistic thought series ;
Landmarks in linguistic thought, 3. Londres/New York : Routledge.
Wadīʾ [al-Firansiskānī] ʿAwaḍ. 2005. Al-Asʿad Ibn al-ʿAssāl, Préface à la grammaire de la langue
copte. Bulletin de la Société d’archéologie copte 44 : 113‑132 25.
Wadīʾ [al-Firansiskānī] ʿAwaḍ. Préface à la grammaire de la langue copte dite « al-Kifāya » d’al-
Wajīh al-Qalyūbī. Bulletin de la Société d’archéologie copte 55 : 271‑301 26.
Wright, W., ed. 1896‑1898. A Grammar of the Arabic Language, translated from the German of Caspari.
Trad. par W. Wright. 3e éd. revue par W. Robertson Smith et M. J. de Goeje. 2 vol. Cambridge :
Cambridge University Press.
NOTES
2. Graf (1947 : 344‑444, § 112‑134) Aṯanāsiyūs al-Maqārī (2011 : I, 297‑655). Tentatives de
synthétisation et caractérisation dans Sidarus (1993) et (2010).
3. Sidarus (1990b), (1990c), (2007) et (2016a) ; EI2, s.v. « Sullam » [nouvelle version en préparation
pour l’édition en ligne EI3].
4. Pour une présentation d’ensemble de cette tradition, voir Sidarus (2000).
5. Pour une nouvelle mise au point sur l’homme, évêque de sa ville natale et traducteur du copte
à l’arabe, ainsi que sur l’ensemble de son œuvre, voir Sidarus (2017).
6. Sidarus (1978) et (2001), en plus de la bibliographie plus récente portant sur les auteurs clés
qui sont mentionnés dans ces pages.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
59
7. La tradition occidentale a fixé ainsi la même lettre h pour deux phonèmes arabes distincts : ḥ
(gutturale fricative sourde) et ʿayn (gutturale fricative sonore). En français, il aurait été meilleur
d’adopter un i tréma dans le second cas : saïdique.
8. MS Vatican, Borgia copte 139 (possible autographe) ; éd./trad. partielle par Petersen (1913),
dont le travail est resté ignoré jusqu’à très récemment : Sidarus (2000 : 280-281, M13) et (2001 :
74). Dernière mise au point dans Sidarus (2012b). Une première note sur l’existence même du
texte et sa nature, dans Sidarus (1977 : 28b).
9. Bauer (1972 : 10-14) Sidarus (1977). Nous avons établi définitivement, dans cette dernière
étude, de même que dans les nouvelles mises au point biobibliographiques (Sidarus 2018 et 2020),
que notre personnage appartient bien à la seconde moitié du 8 e/XIVe siècle. Dans cette dernière
publication de 2020, nous avons longuement évoqué le mouvement linguistique qui s’était
développé tardivement en Haute-Égypte.
10. Makram (1980). On notera, du reste, que certains termes ou expressions jugés nouveaux dans
l’analyse en question se trouvent être d’usage courant dans l’enseignement indigène de nos jours.
11. On se reportera sur ce point à nos exposés ci-dessus mentionnés, en plus de Sidarus (1990a).
Certains textes ou parties de texte ont été édités (parfois mal) à partir d’un seul manuscrit dans
les études ou ouvrages suivants : Kircher (1643) ; Dulaurier (1849) ; Mallon (1956) ; Munier (1930) ;
Van Lantschoot (1948) ; Wadīʾ (2005) et (2016). Il faut donc prendre les références à l’ouvrage de
Bauer (1972) comme purement indicatives.
12. En attendant la parution de notre Petite histoire de la littérature copto-arabe médiévale
(Beyrouth), on peut consulter Sidarus (2010), (2018) et (2020).
13. Voir plus bas le tableau 3. Pour tout ce qui est de la grammaire copte « réelle », on peut
consulter : Stern (1880) ; Mallon (1956) ; Till (1961) ; Layton (2000). Voir aussi les différentes
entrées de CopEnc VIII.
14. Pour tout ce qui concerne la terminologie linguistique arabe et les théories sous-jacentes, à
part les anciens ouvrages classiques de Wright (1896‑1898) et de Fleisch (1961), on peut se
reporter aux travaux plus récents de : Bohas et Guillaume (1984) ; Owens (1988) et (1990) ;
Versteegh (1977) et (1997) ; Ryding (2014). Voir aussi : Troupeau (1976) ; Abd al-Masīḥ et Tābirī
(1990).
15. On se rapportera aux chapitres respectifs du manuel d’Auroux et al. (2000). Voir de même
dans l’une ou l’autre des contributions du présent volume.
16. On peut en compter, selon les auteurs, jusqu’à une douzaine de dialectes ou sous-dialectes, le
bohaïrique et le sahidique étant les plus importants. Certains coptologues contemporains les
considèrent comme des langues à part entière (CopEnc VIII : 97-101 et 133-141).
17. Apud Wadīʾ (2016 : 3‑4). Voir aussi : Mallon (1906 : 127) Van Lantschoot (1948 : 76‑77). Dans la
traduction, nous soulignons les termes techniques jugés importants.
18. Suivent quelques autres catégories grammaticales.
19. Il faut entendre « accents/signes vocaliques ».
20. En arabe, le mot signifie originellement « mouvement, motion » (cf. le terme grammatical
grec kinèsis). De là le néologisme copte djinkim, plus ou moins « inventé » par les coptisants
modernes pour désigner le signe graphique que nous venons de décrire : Polotsky (1949) ; CopEnc,
s.v. Sur l’emploi du signe lui-même, voir aussi Stern (1880 : 9-11).
21. À propos de ces déboires, liés à la prise du pouvoir par la soldatesque mamelouke avec toutes
ses séquelles, voir maintenant l’annexe 7 de Sidarus (2020).
22. Il s’agit pratiquement de la version arabe de la partie sur les coptes de GCAL II‑IV, partant de
la traduction réalisée par Wilyam Kāmil (actuel Anbā Kīrillus, év. copte catholique. d’Assiout)
dans les années 1970 et restée inédite depuis. On y trouve une légère mise à jour, surtout pour ce
qui est des manuscrits des monastères d’Égypte, de Saint-Macaire au premier chef.
23. Cet ouvrage concerne le copte bohaïrique. Le sahidique est traité succinctement en
appendice.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
60
24. Cet ouvrage traite simultanément des deux principaux dialectes.
25. Cet article, rédigé en arabe, est en vérité une grammaire.
26. Idem.
RÉSUMÉS
Quand, vers le milieu du XIIIe siècle, les grammaires coptes apparurent pour la première fois, leurs
auteurs ne pouvaient recourir qu’au modèle linguistique arabe dominant : terminologie et
catégories grammaticales. La langue copte n’appartient pourtant pas à la même famille que
l’arabe ; elle était par ailleurs en voie de disparaître comme langue vivante. À partir de quelques
exemples typiques, ayant trait à l’écriture, à la phonologie et à la morphologie, nous essayons de
donner une idée de la méthode suivie pour appliquer ou adapter les outils conceptuels et
terminologiques arabes dans la description de l’ancienne langue égyptienne à sa dernière phase
et de démontrer que, d’une manière générale, les philologues coptes du Moyen Âge ont bien
mené leur tâche. Si l’on peut relever des lacunes, celles-ci ne sont pas nécessairement imputables
à la tradition linguistique qui a servi de modèle, mais plutôt aux conditionnements externes qui
ont présidé au labeur intellectuel des protagonistes.
When Coptic grammars appeared for the first time (middle of the thirteenth century), only the
dominant Arabic linguistic tradition could serve as a point of reference. However, Coptic, which
was losing its status of vernacular, does not belong to the same family as Arabic. Through some
typical samples related to script, phonology, and morphology, this paper tempts an insight into
the way the Arabic conceptual and terminological apparatus was applied and adapted to Ancient
Egyptian in its final stage. We show that in general medieval Coptic grammarians did in fact
succeed in their undertaking. Whatever deficiency one may find, this should not necessarily be
imputable to the linguistic tradition that acts as a model, but rather to the external conditions
affecting the very intellectual activity of the protagonists.
INDEX
Mots-clés : grammaire copte, langue arabe, linguistique comparée, terminologie grammaticale
arabe
Keywords : Arabic language, Arabic linguistic terminology, comparative linguistics, Coptic
grammar
AUTEUR
ADEL Y. SIDARUS
Université d’Evora (Portugal), City, Country
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
61
Transitivité et intransitivité dans la
grammaire de Bar Hebræus
Georges Bohas
Introduction
1 La propriété « transitif/intransitif » ne figurant pas dans la grammaire de Denys le
Thrace1, qui, ayant été traduite par Joseph d’Ahwaz (mort en 580), a été le berceau des
grammaires syriaques, la tradition syriaque l’a négligée, jusqu’à Bar Hebræus, qui,
selon Merx, l’a empruntée à Zamaḫšarī :
Etiam aliam rem ex grammatica arabica haustam Syriacae adhibuit, distinctionem verbi
transitivi, dupliciter transitivi et intransitivi, quam a Zamakhchario depromsit…
Il y a encore une autre chose puisée dans la grammaire arabe qu’il introduisit en
syriaque : la distinction verbe transitif, verbe doublement transitif et verbe
intransitif, qu’il emprunta à Zamaḫšarī (Merx 1889: 253).
2 L’objet de cette communication est de voir comment la notion a transité de l’arabe au
syriaque et comment Bar Hebræus (désormais BH) l’a « acclimatée » dans son modèle.
Quant à savoir comment le concept de transitivité s’est élaboré dans la tradition
grammaticale arabe jusqu’à Zamaḫšarī, cela n’entre évidemment pas dans le cadre de la
présente étude.
3 Il n’est pas inutile de mentionner que Zamaḫšarī est mort en 1144 et BH en 1286 : plus
d’un siècle les sépare donc, mais BH est presque contemporain d’Ibn Yaʿīš (1158-1245),
l’auteur du grand commentaire sur le Mufaṣṣal2, puisqu’il est né en 1226. Que BH ait
emprunté à Zamaḫšarī, illustre l’influence très importante qu’il a connue en Orient
arabe et dans le monde iranophone.
4 Rappelons d’abord que le texte de Zamaḫšarī sur la transitivité se trouve p. 257-58 celui
de BH se trouve dans le livre 2 consacré au verbe, p. 92-95. Dans la notation des
exemples syriaques nous négligerons la spirantisation des bgdkpt. Nous adopterons la
vocalisation occidentale (jacobite). Comme nous l’avons montré dans Bohas (2008), BH
traite des lettres et non pas des sons. Nous veillerons donc dans notre transcription à
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
62
garder les lettres, particulièrement le ʾōlaf que nous transcrirons par ʾ. De plus, nous ne
transcrirons pas ī, mais īy, nous ne transcrirons pas ē, mais ēy pour garder la voyelle et
la lettre et rester cohérent avec sa pensée. Le seul problème concerne le w que nous
gardons tel quel lui aussi.
1 Verbes transitifs et intransitifs
Chapitre I, à propos de l’intransitivité et de la transitivité des verbes : quatre
sections.
Première section : À propos d’exemples de verbes intransitifs et transitifs
Tout verbe, ou bien ne transite pas du sujet vers l’objet, mais se restreint au sujet 3
et est appelé intransitif comme ʾetōʾ feṭrōws [‘Pierre est venu’], ʾezal fōwlōws [‘Paul
est parti’], npal ywdōʾ [‘Judas est tombé’], qōm matīyaʾ [‘Mattiyas s’est levé’].
Ou bien il transite de l’un à l’autre et est appelé transitif, comme ʾaqīym [‘il a fait
lever’], ʾaḥet [‘il a fait descendre’], ʾapeq [‘il a fait sortir’], ʾaʿel [‘il a fait entrer’].
Certains4 appellent simple un intransitif comme bōt [‘il a passé la nuit’] et composé
un transitif comme ʾabīyt [‘il a fait passer la nuit’].
Élucidation
Tout verbe transitif passe à partir du sujet ou bien vers un objet comme mḥōʾ mōryōʾ
lmeṣrōye1 [‘Le Seigneur a frappé les Égyptiens 1’], ou bien vers deux objets comme :
qademtōyhy1 burqtōʾ tōbōʾ 2 [« Tu lui1 as offert une bonne bénédiction2 » : Ps 21,4], ou
bien vers trois comme : mkartkwn1 gēyr lgabrōʾ2 ḥad btwltōʾ dkīytōʾ 3 deʾqareb lamšīyḥōʾ
[« Je vous ai fiancés à un homme (comme) une vierge pure, lequel je présenterai au
Christ » : I Cor, 11, 2].
Dans le premier cas, il y a un complément : le nom « Égyptiens » ; dans le deuxième
cas, le premier complément est le pronom y et ses compagnons [i.e. la séquence
oyhy] et le second est : « une bonne bénédiction » ; dans le cas de trois
compléments, le premier est le pronom k et ses compagnons [i.e. la séquence kwn],
le deuxième est « un homme » et le troisième « une vierge pure ». « Que je
présenterai au Christ » n’est pas un quatrième complément mais une explication du
deuxième complément à savoir : « un homme ». Ainsi, dans la parole : sagīyʾeʾ
haymen beh1 [« Beaucoup crurent en lui » : Jean, 2, 23], il y a un complément et
dans : hw dēyn yešwʿ lōʾ mhaymen-hwa lhwn 1 nawšeh2 [« Jésus ne leur1 confiait pas son
âme2 » : Jean, 2, 24], il y a deux compléments [« leur » et « son âme », c’est-à-dire,
lui-même, donc pour rendre cela en français : « ne se fiait pas à eux »].
5 Une première différence avec les grammaires arabes est l’abondance des exemples,
particulièrement scripturaires, dont fourmille la grammaire de BH. Comme il n’y a pas
de cas apparents en syriaque, contrairement au texte de Zamaḫšarī où tous les
compléments sont à l’accusatif, et donc les verbes transitent directement, BH ne
distingue pas transitif direct vs indirect. Cela est d’autant plus motivé par le fait qu’en
syriaque, ce que nous appelons le complément direct est le plus souvent introduit par la
préposition l (parallèle au ʾet de l’hébreu biblique : bārāʾ ʾelohim ʾet haššamayim weʾet
haʾareṣ [Genèse I, 1]).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
63
2 Les causes de la transitivité
6 Chez les grammairiens arabes, et en particulier chez Zamaḫšarī, la notion de
transitivité permet de rendre compte de la relation entre la forme simple du verbe et
les formes dérivées ʾafʿala (la FIV des grammaires arabisantes) et faʿʿala (FII). Ces
formes ont (généralement pour la première, fréquemment pour la seconde) une valeur
causative ou factitive ; toutefois, celle-ci est exprimée en termes de transitivité : la
préfixation d’un ʾ dans le cas de ʾafʿala et le redoublement de la consonne médiane dans
celui de faʿʿala ont pour effet de rendre transitifs 5 les verbes intransitifs. Zamaḫšarī
parle à ce propos de « causes de la transitivité » (asbāb al-taʿdiya). BH applique la même
idée aux formes correspondantes du syriaque : la forme avec préfixe ʾ, m, n ou t,
équivalente de la forme IV de l’arabe6 et la forme avec première consonne mue par un
a, équivalente de la forme II de l’arabe. Pour la tradition syriaque, c’est en effet cette
vocalisation de la première consonne par un a qui distingue FI bṣar de FII baṣar. On a
donc les équivalences suivantes :
7 FI première consonne quiescente : bṣar.
8 FII première consonne mue par un a : baṣar = forme à redoublement de l’arabe.
9 FIV préfixation ʾ m n t : ʾaškeb = forme à préfixation de ʾa de l’arabe.
Deuxième section : des causes de la transitivité
Par deux causes un verbe intransitif devient transitif.
[1] La première est l’introduction des lettres ʾ m n t, comme
– de škeb [‘être étendu7’] à ʾaškeb [‘faire se coucher’] : ʾaškeb ʾenwn ʿal ʾarʿōʾ [‘Il les fit
se coucher à terre’ : II Sam, 8, 2] ;
– de sṭōʾ [‘se détourner’] à ʾasṭīy [‘détourner’] : waʾsṭīy nešawhy lebeh [« Ses
femmes détournèrent son cœur » : I Rois, 11, 3] ;
– de sged [‘se courber’] à ʾasged [‘adorer’] : wfwmeh ʾasgdeh galyōʾīyt [‘Sa bouche le
fit adorer distinctement’] ;
– de hmas [‘comprendre’] à ʾahmes [‘faire comprendre’] : waʾhmes beh kul
reʿyōnīyn [‘Il lui fit comprendre tous les sens’] ;
– de qʿōʾ [‘crier’] à ʾaqʿīy [‘faire crier’] : wkeʾbōʾ dḥašeh maqʿeʾ līy [‘Et la douleur
qu’il ressentit me fit crier’] ;
– de mak [‘être courbé’] à ʾamek [‘incliner’] : waʾmek rišōʾ lšalīyṭō [‘Il inclina la tête
vers le puissant’] ;
– de hgōʾ ‘réfléchir’ à ʾahgīy ‘enseigner’ : wmanw ktab lōk ʾōlaf bēyt dhōʾ ʾahgeʾ lōk
hafkoʾīyt [‘Qui t’a écrit l’alphabet ? Car regarde, il t’a enseigné de travers’].
Il en va de même pour dkar hw [‘il s’est souvenu’] et ʾadker laḥrōnōʾ [‘il a rappelé à un
autre’] : waʾnt dkart ʿlay ʿawlōʾ daʾnttōʾ [Mot à mot : ‘Tu te souviens contre moi de la
faute (ou d’une faute) d’une femme (ou de la femme, ou concernant la femme)’ : II
Sam, 3, 8]8 ; tehweʾ ʾarʿōʾ dīyhwd lmeṣrōyōʾ lswrōdōʾ wkul dnadkr īyh leh netrheb [‘La
terre de Juda deviendra la honte de l’Égypte, chaque fois qu’on la lui rappellera elle
sera terrorisée’ : Isaïe 19, 17].
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
64
[2] La deuxième consiste à assigner un a à la première lettre quiescente.
Ainsi, à partir de bṣar [‘être petit’], gmar [‘être complet’], twōʾ [‘s’irriter’], dwīy [‘être
faible’], ḥsar [‘manquer’] où la première est quiescente, on obtient baṣar
[‘diminuer’], gamar [‘achever’], tawīy [‘gourmander’], dawīy [‘affaiblir/frapper 9’],
ḥasar [‘manquer’] en vocalisant la première avec un a
– tawīy : wtawīy dawīyd lgabreʾ dʿameh [‘Et David gourmanda les hommes qui étaient
avec lui’ : I Sam 24, 8] ;
– dawī : dawīyt ʾenwn bḥemty [‘Je les ai frappés dans ma fureur’] [Isaïe 63, 6] ;
– ḥasar : mōryōʾ nerʿēyny wmedem lōʾ nḥasar līy [‘Le Seigneur me fait paître et il ne
me laisse manquer de rien’ : Psaume 23, 1].
10 Une remarque s’impose ici. Dans une forme comme baṣar, la consonne médiane est en
fait géminée, et elle est bien prononcée géminée de nos jours dans la version orientale
du syriaque, en revanche dans la version occidentale, il n’y a pas de gémination. BH,
comme nous l’avons rappelé ci-dessus, ne prend pas en compte les sons mais bien les
lettres, donc pour lui [baṣṣar], qui est écrit baṣar est bien un trilitère, avec vocalisation
de la première consonne par un a, ce qui l’oppose à la première forme bṣar où cette
consonne est quiescente. Nous le suivons en cela, pour la cohérence de
l’argumentation.
Élucidation
Parfois l’action transite par le biais d’un mot ou d’une lettre qui indique le
complément, comme dans :
– ʾetpanīy lwōty wašmaʿ bōʿwty [‘Il s’est tourné vers (lwōt) moi (y) et il a écouté ma
demande’] ;
– weʾnōʾ ldōdy wa ʿlay fnoyteh [‘Je suis à mon bien-aimé et sur (ʿal) (= vers) moi (y)
son retour (i.e. : il est revenu vers moi)]’ : Cantique, 7, 11] ;
– waṣbayt mōryōʾ baʾrʿōk [‘Tu t’es complu, Seigneur, dans (b) ta terre’ : Ps 85, 2].
Dans ces exemples en effet, c’est par vers lwōt, sur ʿal, et dans b qu’ont transité du
sujet vers l’objet le fait de se tourner, de revenir et de se complaire.
11 On retrouve ici la troisième « cause de transitivité » mentionnée par Zamaḫšarī
(Mufaṣṣal : 257) : la « transitivité par préposition » (al-taʿdiya bi-ḥarf ğarr), par laquelle
un verbe intransitif devient transitif. Ainsi ḫarağtu (‘je suis sorti’) devient transitif par
l’ajout de la proposition bi- (et acquiert par la même occasion une valeur causative)
dans ḫarağtu bi-hi (‘je l’ai fait sortir’), équivalant à ʾaḫrağtu-hu. Selon Zamaḫšarī, le
même procédé peut concerner les verbes transitifs, qui deviennent alors doublement
transitifs, ainsi ġaṣabta l-ḍayʿata (‘tu t’es emparé de force de la propriété’) et ġaṣabta
ʿalay-hi l-ḍayʿata (‘tu l’as spolié de la propriété’) :
Élucidation
Quand une cause de transitivité s’applique à un verbe qui transite [déjà] vers un
complément, elle le rend doublement transitif, comme de gbōʾ [‘choisir’] à ʾagbīy
[‘faire choisir’] : ʾagbyan yōrtwteh [‘Il nous1 a laissés choisir son héritage2’ : Psaume
47, 5]. De rḥem [‘aimer’] à ʾarḥem [‘faire aimer’] : yahb lhwn waʾrḥem ʾenwn lʿammeʾ
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
65
[‘Il leur a donné et les1 a fait aimer des peuples2’ : Deutéronome, 33, 3]. De šbōʾ
[‘emmener en captivité’] à ʾašbeʾ [‘faire conduire en captivité’, inaccompli] : waʾšbeʾ
šbīyteky baynōthēyn [‘Je ferai conduire en captivité tes prisonniers 1 au milieu
d’elles2’ : Ézéchiel 16, 53]. De sʾen [‘chausser’] à ʾasʾen [‘faire revêtir des
chaussures’] : waʾsʾenteky msōneʾ [‘Je te1 ferai revêtir des chaussures2’ : Ézéchiel 16,
10]. De baz [‘piller’] à ʾabez [‘donner à piller’, d’où ‘mépriser’] : weʾn ʾōmrīytwn
bmōnōʾ ʾabezn šmōk [‘Et si vous dites : en quoi1 avons-nous donné à piller ( i.e.
méprisé) ton nom2’ : Malachie 1, 6]. De ʾeḥad [‘prendre’] à ʾaḥed [‘louer, donner en
location’] : waʾwḥdeh lfalōḥeʾ [‘Et il la1 loua à des travailleurs2’ : Matth. 21, 33 et Luc,
20, 9]10.
3 L’échec des causes de la transitivité
12 BH aborde ensuite les cas où la préfixation de ʾmnt (correspondant à la FIV, ʾafʿala de
l’arabe) et la vocalisation de l’initiale par a (correspondant à la FII, faʿʿala) n’ont rien à
voir avec la transitivité, mais sont corrélées à un changement de sens, le second étant
tout à fait étranger au premier.
Troisième section : À propos de l’échec des causes de transitivité
L’adjonction des préfixes ʾmnt et la vocalisation par a de la première quiescente ne
provoquent pas toujours la transitivité. Ainsi les verbes ʾazhar [‘briller’], ʾaḥwar
[‘être blanc’], ʾagreb [‘être lépreux’] et ʾagah [‘briller’] ont bien un préfixe ʾ, m, n, t,
mais ne sont pas transitifs :
– ʾazhar [‘briller’] : wmazhar hwōʾ lbwšeh [‘Et ses vêtements brillaient’ : Marc, 9, 3] ;
– ʾaḥwar [‘être blanc’] : wmaḥwar ʾayk talgōʾ [‘et étaient blancs comme neige’ : Marc
9, 3] ;
– ʾagreb [‘être lépreux’] wʾīydeh magrbōʾ ʾayk talgōʾ [‘Sa main était lépreuse comme
neige’ : Exode 4, 6] ;
– ʾagah [‘briller’] : ʾōf tagahyʾ11 šalhebīytōʾ dnwreh [‘Aussi brillera la flamme de son
feu’ : Job 18, 5] ;
Les verbes galīy [‘se découvrir’], karīy [‘être court], gardīy [‘cesser’], maṭīy [‘arriver’],
faraḥ [‘voler’] et damīy [‘être semblable’] ont bien la première vocalisée d’un a, mais
ils ne sont pas transitifs :
– galīy [‘se découvrir’] : meṭul dmen lwōty galīyty wasleqty [‘Car d’auprès de moi tu t’es
découverte et tu es montée’ : Isaïe 57, 8] ;
– karīy [‘être court’] : wmeṭul dkarīy mōʾnōʾ wmeštīytōʾ qeṭnat [‘Car la couche est
courte et la couverture petite’ : Isaïe 28, 20] ;
– gardīy [‘être dépouillé, ôté’ 12] : wlōʾ temneʾ mōry bīyšōtan dlōʾ mgardeʾ ʿawlan menan
[‘Et ne tiens pas compte, Seigneur, de nos turpitudes, car notre iniquité ne peut
être ôtée de nous’] ;
– maṭīy [‘arriver’] : zabnōtō sagīyʾōtōʾ lmawtōʾ maṭīyt [‘Bien des fois je suis parvenu
jusqu’à la mort’ : Ecclésiastique 34, 13] ;
– faraḥ [‘voler’] : ʾayk ṣefrōʾ damfarḥōʾ ʿal ʾegōreʾ [‘Comme le passereau qui vole sur
les toits’ : Psaume 102, 8] ;
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
66
– damīy [‘imiter, être semblable’] : waʾykōʾ damīyw ʾarʿōnōyeʾ lašmayōneʾ [‘Comment
les êtres terrestres peuvent-ils être semblables aux célestes ?’].
Élucidation
Il y a des cas où l’introduction des préfixes ʾmnt et la vocalisation par a de la
première quiescente amènent le verbe à un sens complètement étranger, comme :
– fraʿ ḥawbtōʾ [‘il a rétribué un péché’] et ʾafraʿ, c’est-à-dire ‘il a fait germer’.
– qbal [‘accuser’], de qbwlyōʾ, c’est-à-dire ‘accusation’ et ʾaqbel, c’est-à-dire :
‘rencontrer’.
– ḥfar gwbōʾ [‘il a creusé une tombe’] et ʾaḥfar c’est-à-dire « avoir honte ».
13 Parmi les nombreux exemples donnés par BH, j’en conserverai deux qui portent sur la
vocalisation en a de la première consonne (équivalant à la FII faʿʿala de l’arabe) : šrōʾ
(‘délier’) et šarīy (‘commencer’) ; glōʾ (‘découvrir, manifester’) et galīy (‘exiler’).
14 On pourrait trouver un cas analogue en arabe moderne où ʾaḍraba (‘faire grève’) est
tout à fait étranger au sens de ḍaraba (‘frapper’), mais ici l’explication par le calque sur
l’anglais résout le problème. Toutefois, on en trouve bien d’autres du même genre,
qu’on ne saurait attribuer à un calque sur une langue étrangère, comme : ṣalā (‘toucher,
atteindre’) et ṣallā (‘prier, faire sa prière’) ; faraṭa (‘devancer’) et farraṭa (‘agir avec
négligence, éloigner, détourner’) ; qabila (‘accueillir, recevoir’) et qabbala (‘donner un
baiser’) ; kalama (‘blesser’) et kallama (‘adresser la parole à quelqu’un’).
4 Les verbes labiles
15 BH aborde enfin la question des verbes labiles, ceux qui peuvent être transitifs et
intransitifs, en gardant la même forme. Comme « ressuscite » : Jésus ressuscite/Jésus
ressuscite Lazare.
Quatrième section : À propos des verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs
Ces verbes sont comme gazīy laʾḥrīyn [‘il a privé d’enfants un autre’] et gazīy hw beh
[‘il s’est privé d’enfants lui-même’] ; ḥsan laʾḥrīyn [‘il l’a emporté sur un autre’] et
ḥsan hw beh [‘il été fort en lui-même’].
16 À nouveau, BH multiplie les exemples et consacre même une demi-page à des
attestations scripturaires dont nous allons rapporter quelques-unes particulièrement
significatives :
– Pour le verbe ḥsan : transitif ‘l’emporter sur’ – wtarʿeʾ dašywl lōʾ neḥsnwnōh [‘Les
portes de l’enfer ne l’emporteront pas sur elle’ : Matth. 16,18] ; intransitif « être
dur, pénible » : wyeldat rōḥēyl wḥesnat kad yōldōʾ [‘Rachel accoucha et elle fut à la
peine en accouchant’ : Genèse 35, 16].
– Pour le verbe nfaḥ : transitif ‘souffler sur’ – wkad nfaḥ bhwn ʾemar [‘Et après avoir
soufflé sur eux, il leur dit’ : Jean 20, 22] ; intransitif ‘gonfler, enfler’ : wnefḥat karsōh
weʾtmsīy ʿaṭmōtōh [‘Et son ventre enflera et ses os s’affaibliront’ : Nombres, 5, 27].
– Pour le verbe ʾamlek : transitif ‘établir comme roi’ – waʾmlek malkōʾ dBōbel
laMtanyōʾ [‘Et le roi de Babel établit comme roi Mattanya’ : 2 Rois 24,17] ; intransitif
‘régner’ : mōryō ʾamlek wgaʾywtōʾ lbeš [‘Le seigneur règne et il s’est vêtu de
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
67
splendeur’ : Psaume 93, 1]. Il s’agit bien du même ʾamlek qui dans un cas est
transitif, ‘nommer quelqu’un roi’, et dans l’autre intransitif, ‘régner’.
5 Conclusion
17 Si BH a emprunté le concept de transitivité à Zamaḫšarī, il en a donné un traitement
qui dépasse largement sa source. En effet, la seule préoccupation du grammairien arabe
est d’assurer que tous les compléments sont bien à l’accusatif et d’identifier les causes
de la transitivité. N’ayant pas ce problème d’assignement de l’accusatif, BH discute non
seulement de la transitivité (simple, double ou triple) et de ses causes (en arabe, FIV et
FII) comme le fait Zamaḫšarī, mais en outre, il envisage aussi l’échec de ces causes : les
cas où elles ne produisent pas la transitivité et les cas où elles produisent autre chose
que de la transitivité, à savoir un sens nouveau étranger. Les mêmes échecs se
produisent en arabe, mais Zamaḫšarī se garde bien d’en parler ici. Enfin, BH étudie en
détail les verbes labiles qui sont à la fois transitifs et intransitifs, sujet que Zamaḫšarī
n’aborde pas.
18 En fait, ces phénomènes d’échec des causes de transitivité et de labilité ont bien été
observés par les lexicographes arabes, entre autres par al-Sijistānī (255 H), al-Zajjāj (310
H) et al-Jawāliqī (540 H). Le titre de ce dernier est particulièrement explicite : Mā jāʾa
ʿalā faʿaltu wa-ʾafʿaltu bi-maʿnan wāḥid (‘Les cas où faʿaltu et ʾafʿaltu ont le même sens’). Il
s’agit donc de faire l’inventaire des cas ou faʿala (FI) et ʾafʿala (FIV) ont un sens
identique, comme : bašartu (FI) al-rajula, ʾabšartuhu (FIV) et baššartuhu (FII) qui veulent
tous dire : ‘j’ai annoncé une bonne nouvelle à quelqu’un’ (mot-à-mot ‘quelque chose de
réjouissant’). Dans sa préface, al-Zajjāj précise qu’il va parler :
• des verbes pour lesquels ʾafʿala et faʿala ont le même sens (voir l’exemple ci-dessus) ;
• des verbes où ils ont un sens totalement différent comme : ḏakartu (FI) al-šayʾa ‘j’ai
mentionné la chose’ et ʾaḏkara (FIV) al-rajulu, ‘l’homme a engendré un enfant mâle’ ; il s’agit
ici d’un cas analogue à fraʿ ḥawbtō ‘il a rétribué un péché’ et ʾafraʿ ‘il a fait germer’ de BH ;
• des cas où les deux formes étant attestées avec un sens identique, on préfère la forme IV
comme dans ʾabanna l-rajulu fī makān ‘l’homme a résidé dans un lieu’ ;
• des cas où l’on préfère la forme I, comme dans batartu al-šayʾa : j’ai coupé la chose à la racine.
19 Mais les grammairiens n’ont pas intégré ces données à leur traitement. Jusque dans l’un
des derniers avatars des théories des grammairiens arabes, le Ğāmiʿ al-durūs al-ʿarabiyya
d’al-Ġalāyīnī (1909), le traitement de la transitivité (I : 31-32) et celui de la forme IV 13
(II : 224) ne mentionnent aucunement les données rebelles recueillies par les
lexicographes. En revanche, BH propose un traitement qui intègre les règles et les
exceptions, la grammaire et le lexique. Cela est cohérent avec son orientation vers les
faits, qui se matérialise dans l’abondance des données, scripturaires ou non, citées par
lui.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
68
BIBLIOGRAPHIE
Sources primaires
al-Ġalāyīnī, Musṭafā. Ğāmiʿ al-durūs al-ʿarabiyya. Sidon : Al-Maṭbaʿa al-ʿaṣriyya lil-ṭibāʿa wal-našr.
13e éd. 1978/1398.
al-Jawāliqī, Abū Manṣūr. Mā jāʾa ʿalā faʿaltu wa-ʾafʿaltu bi-maʿnan wāḥid, muʾallaf ʿalā ḥurūf al-
muʿjam. Éd. M. Ḥ. al-Ḏahabī. Damas : Dār al-fikr. 1982/1402.
al-Sijistānī, Abū Ḥātim, Faʿaltu wa-ʾaf ʿaltu. Éd. Ḫ. I. al-ʿAṭiyya. Beyrouth : Dār Ṣādir. 1996/1416.
al-Zajjāj, Abū Isḥāq, Kitāb faʿaltu wa-ʾaf ʿaltu. Éd. M. Ḥ. al-Ḏahabī. Damas : al-Šarika al-muttaḥida
lil-tawzīʿ. 1984/1404.
al-Zamaḫšarī, Abū l-Qāsim. Al-Mufaṣṣal fī ʿilm al-ʿarabiyya. Beyrouth : Dār al-jīl. S.d.
Bar Hebræus, G. Ktōbō d-Ṣemḥē. Dans Le livre des splendeurs, la grande grammaire de Grégoire Bar
Hebræus. Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund, 4. Éd. par A.
Moberg. Lund/Paris. C. W. K. Gleerup/Édouard Champion. 1922.
Sources secondaires
Bohas, G. 2003. Radical ou racine/schème. L’organisation de la conjugaison syriaque avant
l’adoption de la racine. Le Muséon, no 116/3‑4 : 343-376.
Bohas, G. 2008. Bar Hebraeus et la tradition grammaticale syriaque. Parole de l’Orient/Melto d-
Madndho, no 33 : 145-158.
Lallot, J. 1989. La grammaire de Denys de Thrace. Sciences du langage. Paris: Éd. du CNRS.
Merx, A., éd. 1889. Historia artis grammaticae apud Syros. Abhandlungen für die Kunde des
Morgenlandes, 9/2. Leipzig : F. A. Brockhaus.
Moberg, A. 1907-1913, Buch der Strahlen: die grössere Grammatik des Barhebräus. Leipzig : O.
Harrassowitz.
Thesaurus = Payne Smith, R., éd. 1879. Thesaurus Syriacus. 2 vol. Oxford : Clarendon Press.
NOTES
1. Voir Lallot (1989).
2. Voir la notice sur le Mufaṣṣal dans le Corpus des textes linguistiques fondamentaux (http://
ctlf.ens-lyon.fr).
3. Chez Zamaḫšarī (Mufaṣṣal : 257), taḫaṣṣaṣa bi-l-fāʿil (‘concerne exclusivement le sujet’).
4. Comme Bar Zoʿbī, voir Bohas (2003).
5. On pourrait dire « transitiviser », si le mot existait en français.
6. Équivalence déjà relevée par tradition syriaque antérieure (voir Bohas 2003).
7. BH cite les verbes à la troisième personne du singulier du passé qui est, pour lui, la forme de
base du verbe. Je me conforme à l’usage occidental qui consiste à citer le verbe à l’infinitif.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
69
8. Le texte hébreu comporte le verbe tipqod. Dans ce contexte, il signifie ‘reprocher’.
Littéralement le sens du verset est donc en hébreu : « Et aujourd’hui tu me reproches une faute
de femme ». En syriaque, la préposition ʿal signifie ‘sur’ et aussi ‘contre’. L’expression syriaque
dkart ʿlay (‘tu te souviens contre moi’) rend le verbe « tu me reproches ». Je remercie David
Hamidovic qui m’a fourni les précisions sur l’hébreu.
9. D’après l’exemple cité, c’est ce sens qui est concerné ici.
10. Contextualisé dans l’évangile, il s’agit précisément de ‘vignerons’.
11. Il me semble qu’il y a ici un problème d’édition et que le verbe concerné est tgaheʾy (paʿʿel
avec la première vocalisée d’un a) ‘s’éteindra’ et que le sens est : « Aussi se calmera la flamme de
son feu ». Dans le Thesaurus, on trouve pour ce verset la traduction : sedabitur ardor ignis ejus. Mais
alors il y a un problème de logique : que fait-il avec les verbes commençant par ʾmnt ?
12. Selon Mgr Feghali, e-mail du 29/12/2017, le mot mgared vient de l’arabe ğarrada ‘enlever la
peau, l’écorce’.
13. « La forme ʾafʿala est le plus souvent pour la transitivité, c’est-à-dire pour transformer
l’intransitif en transitif, et si le verbe est déjà transitif il devient doublement transitif. »
RÉSUMÉS
Cette contribution aborde la façon dont Bar Hebræus a emprunté au grammairien arabe
Zamaḫšarī la notion de transitivité et comment il l’a reformulée dans le cadre de sa grammaire
du syriaque. Je procède en traduisant et commentant son texte et en comparant avec celui de
Zamaḫšarī. Son chapitre s’organise en quatre sections : 1. Première section : à propos d’exemples
de verbes intransitifs et transitifs ; 2. Deuxième section : des causes de la transitivité ;
3. Troisième section : à propos de l’échec des causes de la transitivité ; 4. Quatrième section : à
propos des verbes qui sont à la fois transitifs et intransitifs. C’est dans ces deux dernières
sections que se manifeste le mieux la différence entre les deux grammairiens ; et il apparaît que
si Bar Hebræus a emprunté le concept de transitivité à Zamaḫšarī, il en a donné un traitement
qui dépasse largement sa source. En effet, la seule préoccupation du grammairien arabe est
d’assurer que tous les compléments sont bien à l’accusatif et d’identifier les causes de la
transitivité. N’ayant pas ce problème d’assignement de l’accusatif, Bar Hebræus discute non
seulement de la transitivité (simple, double ou triple) et de ses causes (pour nous, FIV et FII)
comme le fait Zamaḫšarī, mais en outre, il envisage aussi l’échec de ces causes : les cas où elles ne
produisent pas la transitivité et les cas où elles produisent autre chose que de la transitivité, à
savoir un sens nouveau étranger. Les mêmes échecs se produisent en arabe. Enfin Bar Hebræus
étudie en détail les verbes labiles qui sont à la fois transitifs et intransitifs.
This contribution deals with how Bar Hebræus borrowed the notion of transitivity from the
grammarian of Arabic, Zamaḫšarī, and how he reformulated it within his grammar of Syriac. I
proceed by translating and commenting his text and comparing it with the text by Zamaḫšarī.
His chapter is organised into four sections: 1. First section: concerning examples of intransitive
and transitive verbs; 2. Second section: on the causes of transitivity; 3. Third section: concerning
the failure of the causes of transitivity; 4. Fourth section: concerning verbs which are both
transitive and intransitive. The difference between the two grammarians is manifest in the final
two sections in which it appears that although Bar Hebræus borrowed the concept of transitivity
from Zamaḫšarī, his treatment goes far beyond what is found in his source. Indeed, the only
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
70
concern of the grammarian of Arabic is to ensure that all the complements are in the accusative
and to identify the causes of transitivity. Without the problem of assigning the accusative, Bar
Hebræus not only discusses transitivity (single, double or triple) and its causes (for us, FIV and
FII) as Zamaḫšarī does, but he also envisages the failure of these causes: the cases in which they
do not produce transitivity and the cases in which they produce something different from
transitivity, namely, a new foreign sense. Finally, Bar Hebræus studies in depth the labile verbs
which are both transitive and intransitive.
INDEX
Mots-clés : Bar Hebræus, grammaire arabe, grammaire syriaque, transitivité, Zamaḫšarī
Keywords : Arabic grammar, Bar Hebræus, Syriac grammar, transitivity, Zamaḫšarī
AUTEUR
GEORGES BOHAS
ENS de Lyon, Interactions, corpus, apprentissage, représentations (UMR 5191 Icar), Lyon, France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
71
Turkic morphology seen by the
Arabic grammarians. The passive
Robert Ermers
1 Introduction: the sources
1 Arabic treatises of other languages present an intriguing type of source material for a
number of reasons. These treatises, written by specialists educated in the Arabic
grammatical tradition, deal with Turkic vocabulary, grammar, morphology and
phonology. In their concise descriptions and analyses, they apply extant concepts, yet
they occasionally find that they have to adapt them to this new language. In this
contribution, I intend to analyse what their authors write about the passive and about
passive constructions.1
2 The sources used for this paper are the following:
• Dīwān Luġāt at-Turk by Maḥmūd al-Kāšġarī (eleventh century; ed. Kültür Bakanlığı 1990);
• The Margin Grammar — a large compilation of sections on Turkic grammar (eleventh-
fourteenth century) in the margins of a copy of the Kitāb al-ʾIdrāk Veli ed-Din manuscript;
• Kitāb al-ʾIdrāk li-Lisān al-ʾAtrāk by ʾAbū Ḥayyān al-ʾAndalusī (fourteenth century; ed.
Caferoǧlu 1931);
• Al-Tuḥfa al-Zakiyya fī al-Luġa al-Turkiyya, anonymous (fourteenth century; ed. Halasi-Kun
1942);
• Kitāb al-Qawānīn al-Kulliyya li-Ḍabṭ al-Luġa al-Turkiyya, anonymous (fourteenth century; ed.
Kilisli 1928);
• Kitāb Ḥilyat al-Insān wa-Ḥalbat al-Lisān by Ǧamāl al-Dīn ibn al-Muhannā (fourteenth century;
ed. Kilisli 1921).
3 Most of them date from the fourteenth century, the one exception being Dīwān whose
original dates from the eleventh century (al-Kāšġarī, Dīwān; Auezova 2005; Dankoff and
Kelly 1982‑1985).2 All of these sources have been edited and published, except the one I
have called the Margin Grammar.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
72
4 The Margin Grammar is an as yet unpublished grammar of Turkic, scribbled in the
margins and between the lines of the Veli ed-Din ʾIdrāk MS. The author of the Margin
Grammar is unknown; in fact, it is probably not an entirely original work, considering
the fact that a considerable number of fragments are almost literal copies from other
known sources, mainly Qawānīn, ʾIdrāk and Dīwān, while the style and set-up of some
others shows strong resemblance to Tarǧumān (ed. Houtsma 1889) (Ermers 1999: 41f).
5 Of these sources, ʾAbū Ḥayyān’s work is of particular interest, because, in addition to
ʾIdrāk, other works of his on Arabic grammar have been preserved, such as
his Irtišāf (e.d al-Namās 1984, 1987, 1989) and his commentary on Ibn Mālik’s Alfiyya.
This makes it possible to compare his statements on grammar in ʾIdrāk with passages in
his other studies.
6 The sources describe different varieties of Turkic. Dīwān describes Ḫāqānī, a Turkic
language spoken in Central Asia at the time, whose modern descendant is Sariġ Yugur
or Yellow Uygur (Clauson 1965). The fourteenth-century sources describe the language
of Mamlūk military slaves in Egypt and Syria, who spoke a Kipchak language —probably
(Crimean) Tatar— with Oġuz (Turcoman) material (Berta 1998). A precise determination
of the Turkic language described in each work is complicated, one reason being that
there are large overlaps between languages and subgroups regarding morphology and
vocabulary, and another that the Arabic script as it is used in the sources does not
easily allow for the expression of nuances in vowels, such as the distinction between e/
a, o/u and ö/ü respectively (Ermers 1999).
7 From both morphological and syntactical perspectives, there are considerable
differences between Arabic and Turkic. Most Arabic nouns, verbs, and adjectives can be
derived from a root, whereas in Turkic word formation is based upon stems. Not
surprising, therefore, is the notion that in Arabic grammar a central concept of a verbal
root (rather than a stem) was developed, consisting of consonants to which other
consonants (ḥurūf, sg. ḥarf) are added as prefixes and infixes, thus adding derived
meanings (maʿnā, pl. maʿānī) and forming new patterns (wazn, pl. ʾawzān) that are more
or less predictable in form and function. Probably for this reason, the Arabic
grammatical tradition could develop into a functional grammar, in which given forms
(and positions) are correlated with certain meanings (see e.g. Bohas and Guillaume
1984; Owens 1988 & 1990; Versteegh 1995 & 1997; Sheyhatovitch 2018: 169ff; Ayoub and
Versteegh 2018). This perspective was enhanced by the divine status of Arabic as the
language of the Qurʾān, which, it was believed, thus could only have been chosen
because of its perfectness and logic in form and structure. As this perspective on
grammar was the only one available, all scholars were educated in this model
regardless of their origin.
2 Passive in Arabic and in Turkic
2.1 Arabic morphology: consonants of augmentation (ḥurūf al-
ziyāda)
8 Arabic uses morphological infixes, prefixes and suffixes which are placed onto a three-
consonantal root. In the Arabic grammatical tradition, the notion of prefixes and
infixes to this root is illustrated in an abstract way with the help of the paradigmatical
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
73
root f-ʿ-l, which in turn is derived from the verb faʿala ‘to do’. 3 When filled with the
appropriate vowels, the pattern faʿala signifies ‘he did’.
9 With the help of the appropriate paradigmatic form, the base consonants from any root
can easily be distinguished from any additions. In Arabic grammar, the augmented
meaningful elements are called ḥurūf al-ziyāda; all augments are consonants. For
example, the augmented consonant in the paradigmatical form ʾa-fʿala (paradigm IV in
Western studies of Arabic) is ʾa, and the same holds for the prefix in-, in-faʿala where
the augment is n only (paradigm VII). After the insertion of the pre- and infixes, often a
(secondary) shift of the vowels (naql al-ḥaraka) occurs, for example, often the first root
consonant, f-, loses its vowel.
10 In some paradigms, meanings are added by the simultaneous augmentation of two
consonants. For example, the paradigm (VI) ta-f-ā-ʿala signifies reciprocity, i.e. the
action of the verb is carried out together or reciprocally by several agents.
11 Note that in the Arabic morphological tradition the concept of long vowels as
morphemes did not exist. The so-called long vowels were understood as a sequence of a
consonant, a glide, preceded by a vowel sign: ā = /a”/, 4 ī = /iy/, ū = /uw/. In this way, for
example, the verbal pattern of the conative form, fāʿala, is understood as /fa”ʿala/, and
the additional meaning is attributed to ʾalif, represented as /”/.
12 Earlier (Ermers 1999: 270‑282) I analysed how Arab grammarians dealt with transitivity
and causativity in Turkic. My conclusions were that they tried to uphold their theories
regarding the correlations between form and function for Turkic as well (see also
Ermers 2007). Yet they had to recognize that in other languages functions could be
expressed by different syntactical and morphological elements that did not resemble
their Arabic counterparts.5 They were forced, to some extent, to engage in comparative
and universal linguistics. In this contribution, I intend to examine how they dealt with
the passive form.
2.2 Two types of passivity in Arabic
13 In Arabic grammar, there are two distinct notions of the passive. The first is the so-
called internal or apophonic passive of the verb, on the pattern fuʿila. This passive
stands out in Arabic grammar because it is not expressed by means of an infix or, in
Arabic terms, a meaningful particle, but by a vowel change: faʿala → fuʿila. The
imperfect tense is subjected to changes in the pattern too: yafʿilu → yufʿalu. The subject
of an internal passive verb is referred to in Arabic grammatical theory as an-nāʾib ʿan al-
fāʿil, which can be translated as “subject by proxy” or “substitute subject” (Soltan 2009:
535). The verb is “built for the patient” or “the logical object” (mabnī li-l-mafʿūl).
14 In the traditional Arabic grammatical theory, passivization is regarded as a process in
which the agent of a transitive verb (fiʿl mutaʿaddin) is deleted or kept hidden or
“unknown” (maǧhūl), although not absent, leaving the former object and the verb
(Bazzi-Hamzé 2007b: 94). “The subject of the apophonic passive in Arabic is obviously
not the agent of the process but rather one who is affected by the process” (Maalej
2008: 224).
15 This new situation is reflected in the verb, which assumes a new vowel pattern. Then
there occurs a (superficial) syntactical shift, in which the direct object of the original
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
74
verb assumes the subject position, i.e. the syntactic role of agent, and receives a
corresponding nominative case ending (Carter 1981: 168ff).
16 The second way for indicating a passive is the use of the pattern infiʿāl. This pattern
indicates an action without an evident cause:
17 The infiʿāl-pattern by itself expresses an action which the subject carries out by itself,
without an agent being implied. According to Abboud-Haggar (2006: 616), it “was used
as an alternative for the internal passive” in early texts, such as Qurʾanic Arabic.
18 However, the infiʿāl pattern is also used in relation to the semantical notion of muṭāwaʿa
‘compliance’, where there is a cause implied; hence Larcher’s (2003: 69) interpretation
as a ‘résultatif’. Versteegh (2014: 119) explains the morphological reasoning behind
compliance as follows:
Muṭāwaʿa was regarded as the opposite of taʿdiya, that is, decreasing the valency of
the verb with one, for example, kasara ‘to break [transitive]’ versus inkasara ‘to
break [intransitive]’; ʿallama ‘to instruct someone about something’ versus taʿallama
‘to be instructed, to become learned in something’ (Larcher 2012: 75‑77). What
mattered to the grammarians was the fact that the augment (ziyāda) correlated
with an additional meaning.
“[t]here is implicit causation underlying all forms of compliance” summarizes Maalej
(2008: 225), e.g. fataḥtu l-bāba fa-nfataḥa ‘I opened the door and it opened’ (An-Nādirī
1995: 353 apud Maalej 2008: 225). An-Nādirī, still according to Maalej (2008: 226), writes
that the complier is not necessarily intransitive (lāzim), it can also be transitive
(mutaʿaddī), which makes sense when the muṭāwaʿa is basically a resultative. The
muṭāwaʿa, from a morphological perspective, therefore does not depend on one single
verbal pattern, but can be expressed with several, intransitive and transitive, i.e., VII
infiʿāl, infaʿala; VIII iftiʿāl, iftaʿala ġamamtu-hu fa-ġtamma ‘I saddened him, so he was filled
with grief’; V tafaʿʿul, tafaʿʿala: kassartu l-ʾaqlāma fa-takassarat ‘I broke the pencils, so
they broke’ (Maalej 2008: 226), and others.6 Larcher (2009: 642) writes that Form VII
itself is already “the resultative of Form I”, although “in many dialects it is used as a
passive of the base form.” The internal passive has become rare in modern Arabic
dialects, and this process must have begun a long time ago (Carter 1981: 171). It subsists
in some modern dialects on the Arabian Peninsula, e.g. in Qatar it occurs with the u-i
form, e.g. ḥad qutil hina? ‘was somebody killed here?’ (Belova 2009: 306), while for Oman
the imperfect 3msg form prefix has been registered, e.g. yibā ʿ ‘it is sold’ (Al-Balushi
2016: 107; for Yemen see Simeone-Senelle 1997: 407). Instead of the internal passive,
therefore, in most variants of Arabic the passive is expressed by means of consonantal
prefixes and infixes to the verbal root. As a consequence, the distinctions between the
agent-less fuʿila passive on the one hand and patterns like infiʿāl on the other have
disappeared.
(1) ḍuriba zayd-un
hit.PASS.3sg.PAST Zayd-NOM
‘Zayd was hit [by someone]’
(2) in-kasara al-kaʾs-u
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
75
COMPL-break.3sg.PAST DEF-glass-NOM
‘the glass broke (by itself)’
2.3 Passive forms in Turkic languages
19 In all Turkic languages, semantic and voice changes to verbs are added to a stem. The
morphemes added can involve one or more consonants (and occasionally vowels). The
most common passive suffix is -(V)l-, ört- ‘cover’ → ört-ül- ‘be covered’, kör- ‘see’
→ kör-ül- ‘be seen’ (Róna-Tas 1998: 75; Johanson 1998: 42). In Kazakh (and Turkish),
the verbal form with ‑l‑ is bi-functional. It serves to form both “non-passives without
implied agents”, e.g. yesik aš-ıl-dı ‘the door opened’ (Kazakh), and “true passives with
implied agents” ‘the door was opened (by someone)’ or, in other words, “intransitivized
transitive verbs” (Şahan Güney 2006: 128).
20 When a verbal stem ends in a vowel or ‑l‑, ‑(V)n‑ is in Turkic used to indicate
passivization, e.g. sı:- ‘break (trans.)’ → sı-n- ‘break’ (Clauson 1972). 7 This then
coincides with the verbal suffix ‑(V)n‑ which indicates reflexivity, e.g. yu:- ‘wash
(trans.)’ → yu:-n- ‘wash oneself’ (ibid.: 870 & 942). Therefore, verbal forms in -n- under
some conditions can express either passivity or reflexivity, e.g. kör-ün- (< kör- ‘see’):
‘to be seen’ (passive), ‘become visible’ (reflexive). A third signification of ‑(V)n‑ is the
middle voice, e.g. Karakhanid al-ïn- ‘take for oneself’ (< al- ‘take’) (Johanson 1998: 42).
The form of the vowel V in the passive and reflexive suffixes is subjected to the
principles of fourfold vowel harmony in nearly all Turkic languages: u/ü (rounded:
back/front) and ı/i (unrounded: back/front). These cannot be rendered in Arabic script
(on Kipchak passive suffixes, see Berta 1998: 160).
3 Passive and compliance in the sources
21 The question is how the sources deal with passivization and compliance as semantic
concepts, how they link the voice to morphemes such as ‑(V)l‑ and ‑(V)n‑, the
distribution of these morphemes, and the concepts these morphemes are associated
with —i.e. the internal passive or a derived form— and which terminology is used for
the notion of stem for suffixes.8
22 The Turkic passive is dealt with in the sources in different contexts. Unlike Arabic, the
past tense verb is not close to the unmarked form, but expressed by an ending, -DI,
attached to the stem. The Turkic stem alone expresses the imperative. Some sources, as
we shall see, discuss the passive in the context of the passive participle, which in Turkic
merely requires the appropriate passive suffix to the stem, plus one other suffix which
expresses the participle. In Arabic, the passive participle is expressed by means of a
combination of a pre- and infix.
23 In ʾIdrāk, ʾAbū Ḥayyān uses three different expressions: the first is related to the voice
of the verb (mā lam yusamma fāʿiluhu ‘[the verb] whose agent is not expressed’), the
second to the consequences for the syntax (al-nāʾib ʿan al-fāʿil ‘substitute agent’), and
the third to the semantic notion of the resultative (muṭāwaʿa, lit. ‘compliance’).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
76
3.1 The distribution of l and n
24 In some sources, the logic behind the distribution of l and n is not explained at all. In
the Margin Grammar for example, the author writes quite vaguely that the rule
regarding the use of l and n is what one actually hears (al-samāʿ: MG 36a top). Kāšġarī
writes at the entry ʾaġirla-n- (< ʾaġirla- ‘praise’, ʾukrima ‘he was praised’) that n in this
verb can be replaced (mubdala) by l, yielding the alternative form ʾaġirla-l-, but he does
not explain why (Dīwān 148,6; Clauson 1972: 94).
25 The Margin Grammar writes that an unvocalized l is added before the marker of the
personal pronoun (muḍmar), i.e. probably in case of the past tense verb, or before the
marker of the future tense (istiqbāl) (MG, 37B right) —an important note, since in Arabic
the imperfect tense, used for the future tense, contains elements that express gender
and number.
26 Kāšġarī states:
For every biradical (ṯunāʾī) transitive (mutaʿaddī) verb, if you add an l to it, it
becomes an intransitive (lāziman) and passive verb (maǧhūlan) as explained before.
Wa-kull fiʿl ʾiḏā kāna ṯunāʾiyyan mutaʿaddiyan fa-ʾiḏā ʾadḫalta fīhi al-lāma yakūnu fiʿlan
lāziman wa-fiʿlan maǧhūlan kamā maḍā. (Dīwān 490)
27 The anonymous author of Qawānīn provides a short analysis:
The substitute agent (al-nāʾib ʿan al-fāʿil).9 The rule (qāʾida) in this is that you insert
(tuqḥim) an unvocalized l [or an unvocalized n] between the imperative form and
whatever marker follows.
Al-nāʾib ʿan al-fāʿil − al-qāʾida fīhi ʾan tuqḥim lāman sākina [ʾaw nūnan sākina] bayna fiʿl
al-ʾamr wa bayna mā yalī min ʿalāma. (Qawānīn 26)
28 The author does not elaborate further. Yet ʾAbū Ḥayyān in a very concise manner
provides more detailed rules regarding the distribution of -n-:
If [the verb] is uniradical or biradical, and its second consonant is either vocalised
or a silent l, or if [the verb ends in] lā, which serves the action (ʿamal), the addition
(mazīd) is an unvocalized n (ʾIdrāk 133).
29 ʾAbū Ḥayyān bases his distribution of -n-, on the following criteria:
1. the verb is uniradical, i.e. CV- or
2. the verb is biradical:
a. the final consonant of the [biradical] verb is vocalized (i.e. the stem ends in a vowel), i.e.
CVCV- or
b. it ends in an (unvocalized) l, i.e. CVl- or
3. the verb, of any length, ends in lā- (examples below).
30 Qawānīn describes four contexts which determine the form of the suffix, i.e. when an n
is used:
The rule (ḍābiṭ) regarding the position (mawḍiʿ) of the n is [1] that the verb 10
consists of one single consonant, like y [i.e. ya-] meaning ‘eat!’ (kul), [2] or of two
consonants, the second of which is vocalised (mutaḥarrik), like tuša, meaning
‘spread!’ (ufruš), [3] or it consists of two consonants the second of which is not
vocalised, but it is an l [that is used], e.g. ʾal meaning ‘take!’ (ḫuḏ), ṣal meaning
‘throw!’ (irmi), [4] or the verb has more consonants, the final one being lā which
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
77
serves the action (ʿamal) [i.e. used to construct denominal verbs], e.g. yumruq-lā
[< yumruq ‘fist’] ‘punch!’ (ulkum) ʾaylā! ‘work!’ [< ʾay ∼ e:ḏ ‘material’ 11] (iʿmal) and
sūy-lah! [< söz ‘word’] ‘talk!’ (taḥaddaṯ) and the like. These are the positions of the
n, and all the rest [is] the position of the l. [5] So you say in the constructions of
these examples according to their order: yi-n-il-dī [‘he was eaten’] and tuša-n-dī
[‘it was spread’], ʾal-in-ḍī [‘it was taken’], ṣal-in-ḍī [‘it was thrown’], yumruq-la-n-
dī [< yumruq ‘fist’ > yumruq-la- ‘to punch’] [‘he was punched’] and sū-la-n-dī [< sū
‘water’ > sū-la- ‘to water’] [‘it was watered’] and use this as a general rule (qis).
Wa-l-ḍābiṭ li-mawḍiʿ al-nūn ʾan yakuna al-ismu [ sic, al-fiʿl, R.E.] [1] ʿalā ḥarf [wāḥid]
naḥwa ya bi-maʿnā ‘kul’. [2] ʾaw ʿalā ḥarfayni wa-l-ṯānī minhumā mutaḥarrik naḥwa tuša
bi-maʿnā ufruš’. [3] wa-ʿala ḥarfayni wa-l-ṯānī minhumā sākin wa-lakinnahu lām, naḥwa
ʾal bi-maʿnā ‘ḫuḏ’, wa-ṣal bi-maʿnā ‘irmi’. [4] aw yakūna al-fiʿl ʿalā ʾakṯar min ḏālika wa-
ʾāḫiruhu lā, allati li-l-ʿamal naḥwa yumruq-lā12 bi-maʾna ‘ulkum’, ʾaylā bi-maʿnā ‘iʿmal’
wa-sūylah bi-maʿnā ‘taḥaddaṯ’ wa-naḥwa ḏalika. Fa-hāḏihi mawāḍiʿ al-nūn wa-mā ʿadāhā
mawḍiʿ al-lām. [5] Fa-taqūlu fī bināʾ hāḏihi l-ʾamṯila ʿalā t-tartīb yi-n-il-dī wa-tuša-n-dī,
ʾal-in-ḍī, ṣal-in-ḍī, yumruq-la-n-dī wa-sū-la-n-dī wa-qis ʿalā ḏālika. (Qawānīn 26)
31 If we rephrase Qawānīn’s statements in a more formal notation, the following picture of
the distribution of n emerges:
1. CV- —one consonant, e.g. ya-;
2. CVCV- —two consonants, a vowel follows the second consonant, e.g. tuša-;
3. CVl- —two consonants, the last one being an l, e.g. ṣal-;
4. -lā —verbal stem ends in -lā— this category includes denominal verbs —e.g. yumruq-lā-, a
denominal verb from yumruq ‘fist’.
32 Yet the examples Qawānīn gives still deviate from these rules. For example, instead of
yi-n-il-dī, [‘it was eaten’], which contains a combination of n and l, i.e. a two passive
suffixes on the stem yi- ‘to eat’, one would expect a form like yi-n-. 13 Another point is
that in his account the anonymous author does not account for the distribution of l.
33 If we combine this statement with ʾAbū Ḥayyān’s concise summary, it evolves that they
are essentially identical:
1. (CV)CV- —one or two consonants;
2. (CV)CVl- —two consonants, the final one being an l;
3. verbal stem ending in -lā.
34 The limitation in both sources on the number of consonants is difficult to understand
as there are many verbs consisting of more than two consonants, not ending in -lā to
which -n- can be added.
3.2 L and n as markers of the internal passive
35 All sources deal with the internal passive, yet not in the same way. Qawānīn, for
example, relates Turkic l and n to the Arabic u-i pattern in the unmarked verb: “The
rule (qāʿida) in this is that n is that you insert ( tuqḥim) an unvocalized l [or an
unvocalized n] between the imperative form and whatever marker follows” (cf. also
4.1). Examples (without Arabic equivalents) are ya-n-il-dī ‘it was eaten’ (which contains
a double passive, one -n, directly after the stem, ya- ‘eat’, and a second passive suffix in
-il-), tuša-n-dī ‘it was spread out’ [< tuša-], ʾal-in-ḍī ‘it was taken’ [< ʾal- ‘take’], ṣal-in-
ḍī ‘it was set free’ (< ṣal-), yumruq-la-n-ḍī ‘he was punched’ [< yumruq-la- ‘to punch’
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
78
[denominal v. < yumruq ‘fist’], sūla-n-dī ‘it was watered’ [< sū-la-, denominal v. < sū-
‘water’] (Qawānīn 26).14
36 ʾAbū Ḥayyān briefly discusses the passive form with -Vl- under the heading “Chapter
on the addition” (al-Qawl fī al-ziyāda) where a great number of nominal and verbal are
listed (ʾIdrāk 111‑116). He writes: “[the l] is added (tuzādu) as an indication (dalālatan)
that [the verb] is ‘formed for the passive form’” (bināʾ al-fiʿl li-l-mafʿūl ) (ʾIdrāk 115), i.e.
the internal passive:
37 Not only l, according to ʾAbū Ḥayyān, but also n serves the function of marker of the
internal passive as well. Elsewhere, in the “Chapter on the substitute of the agent”
(ʾIdrāk 133), ʾAbū Ḥayyān gives the following examples of n and the internal passive: ya-
dī − ʾakala, ya-n-dī − ʾukila; ṣi-dī − kasara, si-n-dī − kusira. Some of these examples
recur in a summary under the header “the logical object whose agent is not
mentioned” (al-mafʿūl mā lam yusamma al-fāʿilu-hu) (ʾIdrāk 112) albeit without
translations into Arabic.
(3) ʾur-il-dī
beat-PASS-3sg.PAST
‘he was beaten’
3.2.1 The passive participle
38 The author of the Margin Grammar chooses an approach based upon the passive
participle, which in Turkic is marked by a passive stem plus the ending -KAn:
[1] The “passive participle” in Arabic —as is well-known— can only be [derived]
from the transitive verb (al-fiʿl al-mutaʿaddī); the same is true in Turkic. [2] Its
marker (ʿalāma) [i.e. of the passive participle] is that you insert (tudḫil) an
unvocalized (sākin) l or an unvocalized (sākin) n between the basic imperative verb
(fiʿl al-ʾamr al-muǧarrad) and the marker of the connected agent (al-fāʿil al-mawṣūl).
[1] Ism al-mafʿūl − wa-qad ʿulima fī al-ʿarabiyya ʾannahu lā yakūnu ʾillā min al-fiʿl al-
mutaʿaddī fa-kaḏālika fī al-turkiyya. [2] Wa-ʿalāmatuhu ʾan tudḫila bayn fiʿl al-ʾamr al-
muǧarrad wa-ʿalāma al-fāʿil al-mawṣūl lāman sākinan (sic) ʾaw nūnan sākinan (sic). (MG
36a top)
39 The author here says, first, that a passive form can only be construed from a transitive
verb. This is not entirely true, because in Arabic grammar intransitive verbs, e.g.
ḏahaba ‘go’, the formation of impersonal passives is allowed (Girod 2007: 315): e.g.
ḏuhiba ʾilā al-qudsi, lit. ‘it was went to Jerusalem’ (Saad 2019 [1982]: 2).
40 He then explains that the marker l is put after the stem, but before -KAn. He
exemplifies this with wur-ġān (al-ḍārib) ‘the hitter’ and wur-ul-ġān (al-maḍrūb) ‘the
one that is hit’. He then analyses the participle ending -ġān as the marker of the
connected agent (al-fāʿil al-mawṣūl), and thus appears to assign other significations to it,
perhaps because this same ending is also used for the active participle. The Turkic
ending does not contain any information regarding gender, number or passivity:
41 A similar statement can be found in Tuḥfa. The passive participle (ism al-mafʿūl) and the
passive according to the pattern fuʿila (al-mabnī li-mā lam yusamma fāʿiluhu):
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
79
“Its marker [i.e. of the passive participle] is an unvocalized l which follows (talī) the
verb (fiʿl) [i.e. the verbal stem] in the three tenses (ḥālāt) for all pronouns”.
ʿAlāmatuhu lām sākina talī al- fiʿl ṯalāṯ ḥālāt fī jamīʿ aḍ-ḍamāʾir. (Tuḥfa 47v5)
42 The Arabic examples given here, surprisingly, contain conjugated verbs with the
internal passive rather than their passive participles, e.g. musiktu (‘I was taken’) and
their Turkic equivalents with ‑(V)l‑, e.g.:
(4) wur-ġān
hit-PART.PAST
‘the hitter’, ‘who was hit’
(5) wur-ul-ġān
hit-PASS-PART.PAST
‘the one that is hit’
(6) ṭūṭ-ūl-dū-m
take-PASS-PAST-1sg
‘I was taken’
3.3.2 K as a marker of passivity
43 In Turkic, there is a considerable number of deverbal adjectives ending in −(V)K 15 (i.e. -
ik, -uq, etc.).16 It makes sense to consider it a marker of passivity, albeit in a limited
context, e.g. ač-uk ‘open’ (< ač- ‘open’), yar-uq ‘split’ (< yar- ‘to cleave’), oy-uq ‘hole’
(< oy- ‘to hollow out’), and yül-ük ‘shaven’ (< yül- ‘to shave’). 17 The formation of these
adjectives is, as far as I know, not productive.
44 These adjectives in -(V)K can be translated with passive participles in Arabic. This is
the approach chosen in Tuḥfa. Tuḥfa (p. 48r) lists thirteen Arabic passive participles (of
the mafʿūl pattern) along with their Turkic equivalents, all of them ending in -Vq/-Vk,
e.g. maftūḥ − ʾaǧ-īq ‘open’, mašqūq − yār-īq ‘split’, maḥzūz − kārt-īk ‘notched’
[< kert- ‘to notch’],18 suggesting that -(V)K is a marker of passivity. As we shall see, Ibn
Muhannā too considers q to have this function (cf. 4.3.1), but he mistakes sin-uq- for a
verbal stem.
45 Kāšġarī takes this same reasoning regarding the use of the variants of -(V)K one step
further as he considers them verbal augments in relation to the passive voice of a verb
(p. 328). He gives two exemplifying phrases with a verb in -(V)K which he translates
with an Arabic internal passive. Note that in Turcological studies -(V)K is not
considered a productive suffix with verbal stems.19
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
80
46 The Turkic verb [bassiq-], Kāšġarī writes, derives from an original form (ʾaṣl) bas-dī
plus the ḥarf q. Bas- is, in fact, a common verb which is used in the sense of ‘to attack’.
47 In Kāšġarī’s view, the verb in 7b too consists of a stem (bal-) plus the suffix k/q. In
Turcology though, baliq is not derived from the stem bal-, but from an obsolete stem
ba:.20 Kāšġarī seems to acknowledge this, because he lists bāliġ as a noun elsewhere in
his work, with the meaning ‘the wounded one’ [al-ǧarīḥ, p. 205; also p. 107 & 131].
Perhaps a more accurate translation of 7b therefore may be ‘the man was a wounded
one’.
(7a) bass-iq-tī ʾar
buyyita al-raǧulu
‘the man was suddenly attacked’
(7b) ʾar baliq-ti
ǧuriḥa al-raǧul
‘the man was wounded’
3.3 Turkic l and n as markers of infiʿāl and muṭāwaʿa
48 The grammarians could not always decide whether the Turkic augments l/n stood for
the internal passive or for other forms. It appears that they prefer the infiʿāl rather
than the internal passive, possibly because this also involves the addition of a
consonant.
49 ʾAbū Ḥayyān in his ʾIdrāk deals with the l/n both in the context of the internal passive,
as I discussed above, but also in the compliance. He writes:
If the verb consists of one consonant (ʿalā ḥarf wāḥid), like their utterance ‘he broke
(tr.)’ (kasara) si-dī, in the compliance (muṭāwaʿa) a silent n is used instead of an l.
Thus for ‘he broke (intr.)’ (inkasara) you say si-n-dī.
Fa-in kāna al-fiʿl ʿalā ḥarf wāhid naḥwa qawlihim kasara si-dī fa-l-ḥarf allaḏī gīʾa bihi li-l-
muṭāwaʿa nūn sākina badala al-lām fa-taqūlu fi inkasara si-n-dī. (ʾIdrāk 110)
50 He does not give any other conditions for the change.
51 On the same page, ʾAbū Ḥayyān, again, discusses this l under the heading of “consonant
of the compliance” (ḥarf al-muṭāwaʿa). There he translates the Turkic passive verbal
form 3.sg kas-il-dī with Arabic in-qataʿa, which we can analyse as follows:
52 It is difficult to tell at this point whether ʾAbū Ḥayyān here refers to the muṭāwaʿa in
the semantical-interpretative sense, or whether he interprets all instances of infiʿāl as
muṭāwaʿa throughout. The lack of any context in this phrase suggests that the latter
may have been the case.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
81
53 The author of the Margin Grammar is more explicit. According to him [in Turkic], no
distinction is made between the “passive form” (mā lam yusamma fāʿiluhu) and the infiʿāl
form: they overlap. In Turkic, he writes:
[1] There is no difference between this form [i.e. the form in fuʿila] and the infiʿāl-
form; both are rendered by means of addition (ziyāda) of the l, regardless of
whether it is in the past tense (māḍī) or the future tense (mustaqbal).
[2] You say for example ʾur-ul-dī i.e. ‘he was beaten’ (ḍuriba) and likewise aṣ-il-dī
‘he was hung’ (ṣuliba), and ʾič-il-dī ‘it was drunk’ (šuriba) and the like.
[3] The difference between al-infiʿāl and [the form fuʿila] is that al-infiʿāl is
intransitive (lāzim) [while] this [the base form without ‑l‑] is transitive (mutaʿaddin).
[...]
[4] the infiʿāl occurs with an n, you say ʾari-n-dī [‘he is cleansed’] or the infiʿāl-form
of ‘the cleansing’ (al-naẓāfa), and likewise kur-u-n-dī [‘he is seen’] or the infiʿāl-
form of ‘the staring’ (al-ʾibṣār).
[1] Bāb mā lam yusamma fāʿilu-hu − lā farqa bayna-hu wa-bayn al-infiʿāl fī ziyāda al-lām
fī l-māḍī wa-l-mustaqbal; [2] taqūl min ḏālika ʾur-ul-dī ʾay ḍuriba wa-kaḏālika ʾaṣ-il-dī
ʾay ṣuliba wa-kaḏālika ʾič-il-dī ʾay šuriba wa-naḥwa-hunna. [3] Wa-l-farq bayna al-infiʿāl
wa-bayna-hā ʾanna al-infiʾāl lāzim wa-haḏā mutaʿaddin [...] [4] wa-qad yaʾtī al-infiʿāl bi-l-
nūn fa-taqūlu ʾār-in-dī ʾay infaʿala min al-naẓāfa w-kaḏālika kur-un-dī ʾay infiʿāl min al-
ʾibṣār. (MG 52A right)
54 The reference to the tenses is not without importance either. In Arabic, the past tense
verb of the 3.m.sg is the standard form without any additional consonants. The
present/future tense (muḍāriʿ or mustaqbal) is formed by means of an extra prefix and a
change in the pattern of the stem, e.g. in ḍaraba/yaḍribu (‘he hit’/‘he hits or will hit’). In
the Turkic verbal paradigm, these are only added to the verbal stem.
55 According to Kāšġarī, the effect of the insertion of n is that “the verb shifts from
transitivity to intransitivity” (fa-lamma ʾadḫalta al-nūna yuqlabu al-fiʿl min al-taʿdiya ʾilā l-
lāzim: (Dīwān 490).21 Kāšġarī suggests that both in Turkic and Arabic there is a similar
morphological process in which the n causes intransivity: 22
ʾar tukūn yaz-dī (ḥalla al-raǧul al-ʿuqda) ‘the man loosened the knot’ but then the n
is attached and they say tukūn yaz-in-dī23 i.e. ‘the knot is loosened’ (inḥallat al-
ʿuqda) and the verb has become intransitive because of the attachment of the n to it.
ʾAr tukūn yaz-dī ʾay ḥalla al-raǧulu al-ʿuqdata ṯumma yulḥaqu bi-hi al-nūn fa-yuqālu
tukūn yaz-in-dī ʾay inḥallat al-ʿuqdatu fa-ṣāra al-fiʿl lāziman bi-ʾilḥāq al-nūn bihi. (Dīwān
490‑491)
56 Perhaps they maintain that the functions of n in Turkic and Arabic here coincide, i.e. namely passivization of transitive verbs. 24
(8) in-qataʿa
PASS.RESULT-cut-3m.sg.PAST
‘it was cut’ (ʾIdrāk 110, 12‑15)
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
82
3.3.1 Ibn Muhannā on the internal passive and infiʿāl
57 In his work Ḥilyat al-Insān, Ibn Muhannā writes a brief yet elaborate explanation of the
passive forms. He announces a discussion of three items: “the fourth chapter on [1] the
verb whose agent is not mentioned (fiʿl mā lam yusamma fāʿiluhu), i.e. the fuʿila form [2]
the form infiʿāl and [3] the form tafaʿʿul”25 (Ḥilyat 129). The patterns infiʿāl and tafaʿʿul
are in Arab grammar often used in the context of compliance (muṭāwaʿa).
58 Then Ibn Muhannā proceeds with a description of four instances in which in Turkic an
unvocalized l is added. His point of departure is formed by the contexts in which one of
the passive forms is used in Arabic. The first of these is the internal passive (maǧhūl) in
which the l is, in Ibn Muhannā’s terms, inserted (ʾadḫalta) to the “roots” (ʾuṣūl) of the
verb, e.g.:
• ʾaḫaḏa — ʾal-dī, ʾuḫiḏa — ʾal-il-dī* ‘he took’, ‘he was taken’;
• ḍaraba — ʾur-dī, ḍuriba — ʾur-ul-dī, ‘he hit’, ‘he was hit’;
• kasara — sin-dur-dī, kusira — sin-dur-.l-dī, ‘he broke’, ‘he was broken’.
59 In all of these examples, the Arabic equivalents have the internal passive. The Turkic
forms differ from another. The choice for ʾal-il- is peculiar, for the regular passive
form of ʾal- is, according to the rules, ʾal-in-, ʾal-il- being quite rare (Clauson 1972:
145). Further, sin-dur- is surprising too, because it is a causative form (-dur-) and the
passivization process shown here (sin-dur-ul-) thus contains a cluster of one causative
and one passive suffixes.
60 Secondly, Ibn Muhannā explains, the unvocalized l in Turkic occurs as a marker where
in Arabic the verbal pattern infaʿala is used. He illustrates this with the following
examples:
• ṭahura ‘he was clean’ — ʾarī-dī, taṭahhara26 — ʾar-īl-dī ‘he was cleansed’;
• ʿallaqa ‘he hung’ — ʾas-dī, taʿallaqa — ʾas-īl-dī ‘he was hung’;
• farraqa ‘he separated’ — taġ-dī, tafarraqa — taġ-īl-dī ‘it was dispersed’.
61 Interestingly, while all Turkic forms indeed contain a passive in -Vl-, none of the Arabic
examples are an actual illustration of the VII pattern (infaʿala). Instead, they are all
V forms (tafaʿʿala). Perhaps Ibn Muhannā did not intend to refer literally to the VII
infaʿala form but rather the notion of muṭāwaʿa often associated with this pattern.
62 In the third place, according to Ibn Muhannā, a q is used as a marker of passivity, e.g.:
• kasara, s.n-dī ‘he broke’, takassara, s.n-uq-dī ‘it was broken’.
63 Yet a verbal stem s.n-uq-, as far as I know, does not exist; the form sın-uq is an
adjective to which, in a regular procedure, a past tense ending can be added (Clauson
1972: 837). Moreover, while no doubt derived from the verb sı- ‘break’, the adjective
already contains -n-, which denotes passivity. In proposing here q as a suffix, Ibn
Muhannā either follows Kāšġarī (cf. 3.2.2), who also proposes q as a marker of passivity,
albeit with a less adequately chosen example, or, alternatively, he has had access to
sources used by Kāšġarī.
64 In a fourth statement, Ibn Muhannā remarks that instead (ʿiwaḍ) of the l and the q an
unvocalized n can be used. The condition for using n is, he writes, that the preceding
consonant is vocalized with an a (maftūḥ) or a u (maḍmūm). This same n also serves as
the marker of the equivalent to the V tafaʿʿul pattern, the reflexive:
• ġasala — yū-dī ‘he washed’, taġassala — yū-n-dī ‘he washed himself’
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
83
• ḥarraka ‘he moved (tr.)’ — t.brā-dī ‘he moved (intr.)’, taḥarraka — t.brā-n-dī ‘he (was)
moved’.
65 Ibn Muhannā here appears to be saying that in regard to n, in Turkic no difference is
made between the internal passive and the other passive forms. However, again,
neither of the two examples he gives is an internal passive. In addition, his choice of
the second Turkic example, t.brā-dī is not very adequate, since it is intransitive and
clearly not the equivalent of the transitive verb ḥarraka.27
3.3.2 Kāšġarī on the combination of l and n
66 The suffixes l and n occasionally occur in combination with each other in Turkic verbs,
e.g. yaz-l-in- ‘become loose’ and yuv-lu-n-28 ‘roll’. In the reasoning of the Arab
grammatical tradition, doubling poses a problem, since these are both meaningful
suffixes which essentially serve the same function. Although Kāšġarī (490‑411) does not
mention this theoretical problem, he analyses the facts in some detail, in relation to the
passive-reflexive verbs yaz-li-n- ‘become loose’ and yuv-lu-n- ‘roll (pass.)’ [< yuv- ‘to
roll (trans.)’], which convey the same meaning as the simpler alternative passive forms
yaz-il- and yaz-in- and yuv-ul-, respectively. In Kāšġarī’s analysis, many of the issues
discussed above come together:
[1] Then the n is combined (turakkabu) with the l and they say yaz-li-n-dī, i.e. ‘the
knot loosens by itself’ (inḥallat al-ʿuqdatu bi-ṭabʿihi) (sic).
[2] They also say ʾar tubuq yuv-dī29 ‘the man rolled the ball’ (daḥraǧa al-raǧul al-
kurrata). Then they say tubuq yuv-ul-dī ‘the ball was rolled by the action of
something else’ (duḥriǧat al-kurra bi-fiʿili ġayrihi). The same applies in case of [the
Arabic verbal form] tadaḥraǧa ‘it rolled (intr.)’ [i.e. there is no implied agent]. Then
the n is attached to it (yulḥaqu), and they say yuv-lu-n-dī, i.e. ‘it rolled by itself’
(tadaḥraǧa bi-ṭabʿihi).
[3] Before the attachment of the n to the l [i.e. yaz-il-], the verb was transitive
(lāziman) in two aspects (waǧhayni). One of them30 was that the action affected it [i.e.
the semantic object] (wāqiʿan ʿalayhi) through an unknown agent (fāʿil maǧhūl) and
the verb follows the same course (maǧrā) as the l in it. 31
[1] ṯumma turakkabu al-nūn maʿa al-lām fa-yuqāl yaz-li-n-dī ʾay inḥallat al-ʿuqdatu bi-
ṭabʿihi [2] wa-kaḏālika yuqālu ʾar tubuq yuv-dī ʾay daḥraǧa al-raǧul al-kurrata. Ṯumma
yuqālu tubuq yuv-ul-dī ʾay duḥriǧat al-kurra bi-fiʿli ġayrihi wa-kaḏālika ʾiḏā tadaḥraǧa
ṯumma yulḥaqu bihi al-nūn fa-yuqālu [491] yuv-l-un-dī ʾay tadaḥraǧa bi-ṭabʿihi. [3] fa-
qabla ʾilḥāq al-nūn bi-l-lām kāna al-fiʿl lāziman ʿalā waǧhayni, ʾaḥaduhumā kāna yaǧūzu
ʾan yakūn al-fiʿlu wāqiʿan ʿalayhi min fāʿil maǧhūl fa-yaǧrī al-fiʿlu maǧrā al-lām fīhi.
67 What Kāšġarī appears to be saying in this section is that yuv-ul- is a passive form with
an implied, hidden (or unknown) agent. Yet after the addition of the n, resulting in
yuv-lu-n-, which contains a (vowel shift and a) combination of suffixes —impossible in
Arabic—, the verb looses the notion of implied or hidden agent and the action is carried
out by itself (bi-ṭabʿihi), expressed in Arabic by a passive-reflexive form such as
tadaḥraǧa.32 Thus he not only distinguishes semantically and functionally the Arabic
internal passive from the infiʿāl-form, he also assigns distinct functions to Turkic verbal
morphemes.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
84
3.4 The distinction between stem and root
68 While in Arabic the pre- and infixes are inserted before the verbal (or nominal) root
called ʾaṣl33 and between its consonantal elements, in Turkic all suffixes are attached to
an (almost) invariable stem and clustered to one another. Because of the distinct
qualities, the Turkic stem cannot be equivalent to the Arabic root
69 In the Margin Grammar and in Qawānīn, as we have seen above, therefore the terms fiʿl
al-ʾamr ‘imperative verb’ and fiʿl al-ʾamr al-muǧarrad ‘the bare imperative verb’ are used.
This makes sense, because the Turkic bare stem, devoid of any suffixes, conveys the
imperative. Other sources (Tuḥfa, Dīwān) use fiʿl for the verbal stem. Ibn Muhannā uses
once ‘roots’ in relation to verbs (ʾuṣūl, see 3.3.1). In yet another context, the Margin
Grammar uses al-ʾaṣl al-mufrad al-muǧarrad ‘the basic bare root’ (MG 36B top).
4 Conclusions
70 It is obvious that the Arab grammarians recognized the two Turkic suffixes, l and n,
that are attached to the verbal stem in order to indicate the passive form. Yet there are
different points of confusion as to the distribution of these suffixes. For example, for
some reason they link the distribution of the n to mono- or biradical verbs.
71 Another problem is the signification. In Arabic, the passive can be expressed by means
of an internal passive along the patterns /fuʿila/ —a change within the root (wazn)— or
/mafʿuwl/, or via changes to the root, VII infaʿala or V tafaʿʿala each signifying different
things. While the internal passive refers to an unknown, hidden agent, the VII and V
forms refer to an absent agent, the subject of the verb carries the action out by itself.
These forms are used in the concept of compliance, the resultative (muṭāwaʿa) in which
an agent carries out the action, while there is a causing element. In Turkic no such
differences exists and n can be assigned the same signification as the equivalent suffix
in Arabic: intransitivization. Most sources take the functional overlap of l and n, when
transferred to Arabic, for granted; only the Margin Grammar explicitly says that they
coincide. It seems the authors are confused by this overlap; they would have preferred
to assign the Turkic suffixes l/n distinct functions.
BIBLIOGRAPHY
Primary sources
Al-Andalusī, ʾAbū Ḥayyān. Kitāb al-ʾIdrāk fī lisān al-ʾAtrāk. Ed. by A. Caferoǧlu. Istanbul: Evkaf. 1931.
Al-Andalusī, ʾAbū Ḥayyān. Kitāb Manhaj al-sālik fī al-kalām ʾalā Alfīyyat Ibn Mālik. Ed. by S. Glazer.
New Haven CT: American Oriental Society. 1947.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
85
Al-Andalusī, ʾAbū Ḥayyān. Irtišāf al-Ḍarab fī Lisān al-ʿArab, vol. I, II, III. Ed. by. M.A. al-Namās.
Cairo: Al-Madanī. 1984, 1987, 1989.
Halasi-Kun, T. ed. Al-Tuḥfa al-Zakiyya fī al-Luġa al-Turkiyya / La langue des Kiptchaks d’après un
manuscrit arabe d’Istanbul, II, Édition phototypique. Budapest: Bibliotheca Orientalis hungarica. 1942.
Houtsma, M. Th. ed. Tarǧumān Turkī wa-Aǧami wa-Muġālī / Ein türkisch-arabisches Glossar nach der
Leidener Handschrift. Leiden: Brill. 1889.
Ibn Al-Muhannā, Ǧ.‑D. Kitāb Hilyat al-Insān wa-Halbat al-Lisān. Ed. by M.R. Kilisli. Istanbul: Matbaa-ı
Âmire. 1921.
Al-Kāšġarī, M. Dīwān Luġāt at-Turk. Facsimile edition of Ali Emiri 4189. Ankara: Kültür Bakanlıǧı
[Ministry of Culture]. 1990.
Kilisli, M.R. ed. Kitāb al-Qawānīn al-Kulliyya li-Ḍabt al-Luġa al-Turkiyya. Istanbul: Evkaf. 1928.
Secondary sources
Abboud-Haggar, S. 2006. Dialects: Genesis. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 1, 613-622.
Leiden: Brill.
Al-Balushi, R. 2016. Omani Arabic: More than a dialect. Macrolinguistics, n o 4/4: 80-125.
Auezova, Z.‑A. 2005. Mahmud Al-Kashgari: Diwan Lughat at Turk. Kazakhstanskie Vostokovednye
Issledovanii︠a︡. Almaty: Daik Press.
Ayoub, G. and Versteegh, K., eds. 2018. The foundations of Arabic linguistics, III, The development of a
tradition: Continuity and change. Studies in Semitic languages and linguistics 94. Leiden: Brill.
Baalbaki, R. 2009. Aṣl. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 4, 192-195. Leiden/Boston:
Brill.
Bazzi-Hamzé, S. 2007a. Fāʿil. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 2, 83-84. Leiden/Boston:
Brill.
Bazzi-Hamzé, S. 2007b. Fiʿl. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 2, 90-96. Leiden/Boston:
Brill.
Belova, A. Gr. 2009. South Semitic languages. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 4,
300-315. Leiden/Boston: Brill.
Berta, Á. 1998. Middle Kipchak. In The Turkic languages, ed. by L. Johanson and É.Á. Csató, 158-166.
London: Routledge.
Bohas, G. and Guillaume, J.‑P. 1984. Étude des théories des grammairiens arabes, 1, Morphologie et
phonologie. PIFD 112. Damascus: Institut français de Damas.
Carter, M.G., ed. 1981. Arab linguistics: An introductory classical text with translation and notes.
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history
of linguistics 24. Amsterdam: J. Benjamins.
Clauson, G. 1965. An Eastern Turki-English dictionary. By Gunnar Jarring. Lunds Universitets
Årsskrift, N. F. Avd. 1, Bd. 56, Nr. 4. Pp. 338. C. W. K. Gleerup, Lund. 1964. Kr. 50. Journal of the Royal
Asiatic Society of Great Britain and Ireland, no 97/1: 57.
Clauson, G. 1972. An etymological dictionary of pre-thirteenth-century Turkish. Oxford: Clarendon
Press.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
86
Dankoff, R. and Kelly, J., eds. 1982-1985. Maḥmūd al-Kāšγarī, Compendium of the Turkic dialects
(Diwān Luγāt at-Turk). 3 vols. Sources of Oriental languages and literatures; Turkish sources 7.
Cambridge MA: Harvard University.
Ermers, R. 1999. Arabic grammars of Turkic: The Arabic linguistic model applied to foreign languages &
translation of ʾAbū Ḥayyān al-ʾAndalusī’s Kitāb al-ʾIdrāk li-Lisān al-ʾAtrāk. Studies in Semitic languages
and Linguistics 28. Leiden/Boston/Cologne: Brill.
Ermers, R. 2007. The use of morphological patterns in Arabic grammars of Turkic. In Approaches to
Arabic linguistics presented to Kees Versteegh on the occasion of his sixtieth birthday, ed. by E. Ditters &
H. Motzki, 435-453. Studies in Semitic Languages and Linguistics 49. Leiden/Boston: Brill.
Girod, A. 2007. Impersonal Verb. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 2, 315-318. Leiden:
Brill.
Johanson, L. 1998. The structure of Turkic. In The Turkic languages, ed. by L. Johanson and É.Á.
Csató, 30-66. London: Routledge.
Khawla, M.F. 2012. Al-muṭāwaʿa wa-taʾṣīṣu-hā fī al-ʿArabiyya. Majallat Jāmiʿat Tikrīt Li-l-ʿUlūm al-
Insāniyya, no 19/10: 122-135.
Larcher, P. 2003. Le système verbal de l’arabe classique. 1st ed. Didactilangue. Aix-en-Provence:
Publications de l’université de Provence.
Larcher, P. 2009. Verbs. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 4, 638-645. Leiden/Boston:
Brill.
Larcher, P. 2012. Le système verbal de l’arabe classique. 2nd ed. Manuels. Aix-en-Provence: Presses
universitaires de Provence.
Maalej, Z. 2008. Middle verbs. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 3, 224-227. Leiden/
Boston: Brill.
Maróth, M. 2009. Qiyās. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 4, 11-14. Leiden/Boston: Brill.
An-Nādirī, M.A. 1995. Naḥw al-luġa al-ʿarabiyya: Kitāb fī qawāʿid an-naḥw wa-ṣ-ṣarf. Beirut: Al-
Maktaba al-ʿAṣriyya.
Owens, J. 1988. The foundations of grammar: An introduction to Medieval Arabic grammatical theory.
Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history
of the language sciences 45. Amsterdam/Philadelphia PA: J. Benjamins.
Owens, J. 1990. Early Arabic grammatical theory: Heterogeneity and standardization. Amsterdam
studies in the theory and history of linguistic science. Series 3, Studies in the history of the
language sciences 53. Amsterdam/Philadelphia PA: J. Benjamins.
Redhouse, J.W. 1890. A Turkish and English lexicon. Shewing in English the significations of the Turkish
terms (Re-pr. 1978). Istanbul: Çaǧrı Yayınları.
Róna-Tas, A. 1998. Proto-Turkic and the Genetic question. In The Turkic languages, ed. by L.
Johanson and É.Á. Csató, 67-80. London: Routledge.
Saad, G.N. 2019 [1982]. Transitivity, causation and passivization: A semantic-syntactic study of the verb
in Classical Arabic. Library of Arabic Linguistics 4. New York: Routledge.
Şahan Güney, F. 2006. Functions of the so-called passive morpheme −(I)l- in Kazakh. Bilig, n o 36:
125-137.
Sheyhatovitch, B. 2018. The distinctive terminology in Šarḥ al-Kāfiya by Raḍī l-Dīn al- ʾAstarābāḏī.
Studies in Semitic languages and linguistics 96. Leiden: Brill.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
87
Simeone-Senelle, M.‑Cl. 1997. The Modern South Arabian languages. In The Semitic languages, ed.
by R. Hetzron, 378-423. London: Routledge.
Soltan, U. 2009. Transitivity. Encyclopedia of Arabic language and linguistics 4, 535-542. Leiden/
Boston: Brill.
Versteegh, K. 1995. The explanation of linguistic causes: Al-Zaǧǧāǧī’s theory of grammar: introduction,
translation, commentary. Amsterdam studies in theory and history of linguistic science 75.
Amsterdam/Philadelphia PA: John Benjamins.
Versteegh, K. 1997. Landmarks in linguistic thought III: The Arabic linguistic tradition. Routledge
History of Linguistic Thought Series. London/New York: Routledge.
Versteegh, K. 2014. The Arabic Language. 2nd ed. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Yavrumyan, M. 2006. Das System der Verbalstämme in der Arabischen linguistischen Tradition.
Elemente der morphologischen und semantischen Analyse. Bayreuth: Universität Bayreuth.
NOTES
1. The author wishes to thank the anonymous reviewer for his critical remarks.
2. The importance of Dīwān is so great, that most Turkic peoples, from Turkey to Kazakhstan,
claim it as part of their cultural heritage. In addition, Dīwān formed the basis for Clauson’s
etymological dictionary of Turkic languages (Clauson 1972).
3. See, e.g. Yavrumyan (2006).
4. /”/ represents the ʾalif, which is preceded by /a/ (fatḥa), which then can only be realised as a
long vowel (see Bohas and Guillaume 1984: 256‑259).
5. It remains to be investigated whether they discerned new functions that were unknown to the
Arabic system.
6. Khawla (2012: 129‑130) lists eleven verbal patterns for the muṭāwiʿ, one of them, in fuʿila, as in
ǧadaʿahu fa-ǧudiʿa ‘he deceived him, so he was deceived’.
7. Clauson (1972) notes the rare form al-ıl- as a passive of al-; also bil-il- ‘be known’ (< bil-)
(Berta 1998: 160).
8. In the sources, the vowels in Turkic morphemes are occasionally not explicitly written; in
those cases, a period is used in the transcription, e.g. –.l- and –.n-.
9. On al-nāʾib ʿan al-fāʿil, cf. Bazzi-Hamzé (2007a: 82).
10. Correction for ‘noun’: R.E.
11. Clauson (1972: 57).
12. Em. by the editor.
13. The variant ye-n- does exist in the same meaning. The Turkic verb yaŋ- (pronounced with
front vowels as [yeŋ-] ‘to beat, conquer’, yeŋ- [Clauson 1972]) has a regular passive form, i.e. yaŋ-
il- ‘be conquered’. In Ottoman Turkish, the two verbs yen- and yeŋ- have merged into yenmek
‘to overcome’, ‘to be eaten’ (Redhouse 1978 [1890]).
14. Qawānīn repeats this same text almost literally when describing how the passive participle is
formed (p. 51; see discussion in 3.2.1).
15. K represents the morphemes k or q depending on whether the word is pronounced back or
front.
16. Note that in Clauson’s transcription of Turkic −q is not used. Whether a word is pronounced
back or front is to be inferred from the vowels.
17. Cf. Clauson (1972: 22, 962, 270 & 928).
18. Cf. Clauson (1972: 22, 962 & 738).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
88
19. According to Clauson (1972: 337), Kāšġarī here mistakes the -q for the suffix -siq.
20. Cf. ibid.
21. If we take this remark to also be valid for verbs with −il-, this is not entirely true, because
there are verbs without ‑l‑ that are transitive, e.g. igle-l-, (< igle: ‘be sick’); a disease igle-l-di
‘was suffered’ (Clauson 1972: 107).
22. Kāšġarī elsewhere remarks that the n in general causes intransitivity, e.g. for the medio-
passive or reflexive verbs (596‑597).
23. Correction for yaz-li-n-dī, which Kāšġarī mentions as an alternative later on in the text.
24. A step further would be the suggestion that Kāšġarī believed that -n has a cross-linguistic
signification and that it is the same morpheme in the two languages.
25. Numbers added: R.E.
26. Note that taṭahhara is the passive form to ṭahhara ‘cleanse’, not ṭahura, as Ibn Muhannā seems
to be asserting here.
27. Hence its causative form tepre-t-, cf. Clauson (1972).
28. Cf. ibid.: 987.
29. On yuv- cf. ibid.: 873.
30. Contrary to what one would expect here, a second aspect is not mentioned.
31. On maǧrā, see Maróth (2009: 13).
32. Kāšġarī adds in a subsequent passage on the same page that tetra-radical (rubāʾī) verbs that
are the result of a procedure of combining, such as yuv-lu-n-dī, are transferred (manqūla) from a
bi-radical (ṯunāʾī) verb (yuv-) to tri-radical (ṯulāṯī), and from tri-radical to tetra-radical.
33. On ʾaṣl, cf. Baalbaki (2009: 191); Bohas and Guillaume (1984).
ABSTRACTS
This paper deals with the analyses of medieval Arab grammarians of passive and resultative
verbs in Turkic. In Arabic grammatical theory, certain forms are correlated with unique
meanings. In Arabic there are basically two types of passives: first, an internal apophonic passive,
indicated by a vowel shift within the verbal root, e.g. /faʿila/ → /fuʿila/; secondly, a passive
indicated by the prefix in- attached to the root, i.e. Form VII, which results in the infinitive
pattern infiʿāl —yet verbal forms construed according to the VII paradigm are in addition often
interpreted as resultative verbs. In Turkic, verbs can be passivized by adding an -Vl- to the verbal
stem (under some criteria this is -Vn-), e.g. ʾur- ‘hit’ → ʾur-ul- ‘be hit’; the Turkish -Vn- form
also expresses the reflexive form, e.g. ʾur-un- ‘hit oneself’. In addition, other suffixes may
indicate passivization. This poses problems for the grammarians, which they tackle in similar but
also very distinct ways: the distinctions between the two passive forms in Arabic, the missing
resultative in Turkic, the passive in Turkic, the notion of stem in Turkic versus root in Arabic
theory, the position of the inserted element, the criteria according to which the Turkic passive
form is not -Vl- but instead -Vn-, to name but a few.
Cette contribution se penche sur les analyses des verbes passifs et résultatifs en turcique menées
par les grammairiens arabes. Dans la théorie grammaticale arabe, certaines formes sont corrélées
à une valeur unique. En arabe, il y a essentiellement deux types de passif : un passif apophonique
interne, indiqué par une variation des voyelles à l’intérieur de la racine verbale, e. g. /faʿila/ → /
fuʿila/, et un passif marqué par le préfixe in- attaché à la racine, autrement la forme VII, qui
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
89
donne l’infinitif infiʿāl ; toutefois les formes verbales de la forme VII sont en outre souvent
interprétées comme des verbes résultatifs. En turcique, les verbes peuvent être construits au
passif en ajoutant au radical un suffixe -Vl- (dans certains cas -Vn-), e. g. ʾur- ‘frapper’ → ʾur-ul-
‘être frappé’. La forme -Vn- en turc peut également exprimer la forme réfléchie, e. g. ʾur-un- ‘se
frapper soi-même’. Il existe en outre d’autres suffixes qui peuvent marquer le passif. Cela pose
des problèmes aux grammairiens, qui les traitent de manières diverses encore que voisines : la
distinction entre les deux passifs en arabe, l’absence de résultatif en turcique, le passif en
turcique, la notion de radical en turcique opposée à celle de racine en arabe, les critères qui
distinguent les passifs en -Vl- des passifs en -Vn-, pour n’en nommer que quelques-uns.
INDEX
Keywords: ʾAbū Ḥayyān al-Andalusī, Al-Tuḥfa al-Zakiyya fī l-Luġa al-Turkiyya, Arabic
grammatical theory, Ibn al-Muhannā, Kitāb al-Qawānīn li-Ḍabṭ al-Luġa al-Turkiyya, Maḥmūd al-
Kāšġarī, passive in Arabic, passive in Turkic, Turkic grammars in Arabic
Mots-clés: ʾAbū Ḥayyān al-Andalusī, Al-Tuḥfa al-Zakiyya fī l-Luġa al-Turkiyya, grammaires du
turcique en arabe, Ibn al-Muhannā, Kitāb al-Qawānīn li-Ḍabṭ al-Luġa al-Turkiyya, Maḥmūd al-
Kāšġarī, passif en arabe, passif en turcique, théorie grammaticale arabe
AUTHOR
ROBERT ERMERS
Radboud Universiteit, Nijmegen, The Netherlands
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
90
Entre grammaire arabe et
grammaires arabisantes. Heurs et
malheurs de la phrase nominale
Jean-Patrick Guillaume
1 Préliminaires
1 Bien qu’elle ne relève pas de la grammaire étendue au sens strict du terme, la
grammatisation en Occident d’une langue comme l’arabe, disposant déjà d’une longue
tradition linguistique, pose des problèmes qui ne sont pas substantiellement différents
de ceux qu’ont abordés les autres communications de ce dossier. Ici comme là, les
auteurs des grammaires arabisantes1 ont dû choisir, adapter ou réinterpréter les outils
fournis par la tradition arabe, dans un contexte différent et en réponse à des enjeux
nouveaux. À cet égard, la question de la phrase nominale et de ses avatars dans les
grammaires arabisantes du XVIe siècle à nos jours est particulièrement révélatrice de la
manière dont la tradition arabe a été reçue en Occident.
2 Il se trouve, en effet, que celle-ci a, depuis ses origines, identifié une « phrase
nominale » (jumla ismiyya), qui, en dépit d’une ressemblance partielle et superficielle,
n’a que peu à voir avec ce que l’on a l’habitude de nommer ainsi en linguistique
générale, au moins depuis Meillet (1906), à savoir une phrase « comportant un prédicat
nominal, sans verbe ni copule » (Benveniste 1950). De fait, la phrase nominale des
grammairiens arabes n’a cessé de poser des problèmes aux auteurs de grammaires
arabisantes, qui leur ont apporté des solutions diverses, sans qu’aucune, semble-t-il, se
soit imposée sur le long terme. Ce sont quelques-uns de ces problèmes et de ces
solutions que je voudrais aborder ici, en m’attachant avant tout aux grammaires qui, à
un titre ou à un autre, ont marqué l’histoire des études arabes.
3 Toutefois, avant d’entrer en matière, il est nécessaire de préciser ce que les
grammairiens arabes entendent par « phrase nominale », et comment ils l’ont
théorisée ; dans la mesure où les faits concernés sont assez complexes, cela prendra un
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
91
peu de temps. Les arabisants, pour qui ces choses n’ont pas de secret, pourront
avantageusement se dispenser de lire la section suivante.
2 La phrase nominale des grammairiens arabes
4 La tradition arabe a, dès l’origine, identifié deux types de phrases nettement distincts,
chacun étant soumis à des principes d’organisation spécifiques, la phrase verbale (jumla
fiʿliyya) et la phrase nominale (jumla ismiyya).
5 La phrase verbale se constitue, dans cet ordre, d’un verbe (fiʿl, litt. ‘action’) et d’un sujet
(fāʿil, litt. ‘agent’), éventuellement suivis d’un ou plusieurs compléments ; dans ce cas,
le verbe ne s’accorde pas en nombre avec le sujet :
1a qāma Zayd-un
s’est-levé Zayd NOM
« Zayd s’est levé »
1b qāma al-rijāl-u
s’est-levé les hommes NOM
« Les hommes se sont levés »
1c * qām-ū al-rijāl-u
s’est-levé PLUR les hommes NOM
6 La phrase nominale se constitue d’un thème (mubtadaʾ, litt. ‘commencement, point de
départ’) nominal et d’un « propos » (ḫabar)2 ; celui-ci peut être un nom ou un adjectif
(comme 2a ci-dessous), un groupe prépositionnel (comme 2b) ou une phrase (comme 2d
et 2e) ; dans ce cas, elle doit contenir un pronom renvoyant au thème :
2a Zaydun qāʾimun
Zayd NOM levé NOM
« Zayd est levé »
2b Zaydun fī al-dāri
Zayd NOM dans la-maison GEN
« Zayd est dans la maison »
2c Zaydun qāma ʾabū-hu
Zayd NOM s’est levé père NOM-lui
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
92
« Zayd, son père s’est levé »
2d al-rijāl-u qāmū
les hommes NOM se-sont-levés
« Les hommes, ils se sont levés » (cf. 1b)
2e Zayd-un qāma
Zayd-NOM s’est-levé
« Zayd, il s’est levé »
7 Comme on peut le constater, seul 2a correspond à la caractérisation de Meillet et
Benveniste (« un prédicat nominal, sans verbe ni copule ») ; c’est aussi, pour la quasi-
totalité des grammairiens arabes, le « prototype » (aṣl) de la phrase nominale, dont 2b-e
représentent des « cas dérivés » (furūʿ, sing. farʿ)3. Il n’en reste pas moins que, pour eux,
toutes ces données relèvent indiscutablement de la phrase nominale, ce qui, dans le cas
de 2c, 2d et 2e, apparaît à première vue déroutant, surtout en ce qui concerne 2e (cf. 1a
qāma Zaydun). Cette manière de classer les données n’en repose pas moins sur une
démarche tout à fait cohérente, pour peu qu’on en admette les présupposés. Reprenons,
en effet, l’exemple 2c : il se constitue d’un thème (Zayd) et d’un propos (qāma ʾabū-hu) ;
celui-ci, étant une phrase, se décompose à son tour en un verbe (qāma) et un sujet (ʾabū-
hu). Les choses sont encore plus claires si on les représente sous forme d’un arbre :
8 Cette analyse peut être étendue à 2d, pour peu que l’on admette, comme le font les
grammairiens arabes, que les marques de personne du verbe sont en fait des pronoms
sujets amalgamés à celui-ci :
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
93
9 Dans cette analyse donc, qāmū constitue à lui seul une phrase, qui contient bien un
pronom renvoyant au thème ; cela permet de rendre compte de l’opposition entre 1b
(qāma l-rijālu, avec le verbe au singulier) et 2d (al-rijālu qāmū, avec le verbe au pluriel 4).
Reste maintenant le cas de 2e, Zaydun qāma ; pour le résoudre, il faut franchir un pas de
plus dans l’abstraction et poser, comme le font les grammairiens arabes, que quand un
verbe à la 3e personne du singulier n’a pas de sujet exprimé, il comporte
nécessairement un « pronom caché » (ḍamīr mustatir) dépourvu de représentation
phonétique (donc représentable par un élément-zéro). Moyennant ce principe, il est
possible d’appliquer le même schéma à la phrase qui nous intéresse :
10 Comme on le voit, la phrase nominale des grammairiens arabes permet de regrouper
un ensemble assez consistant de données et à en rendre compte de façon parfaitement
cohérente ; cette cohérence n’apparaît toutefois qu’au prix d’un raisonnement
relativement complexe, nécessitant un certain effort d’abstraction. C’est là un point
qu’il ne faut pas oublier : les grammaires arabisantes auxquelles nous aurons désormais
affaire, étant destinées en principe à un public d’apprenants, sont nécessairement
conduites à maintenir un certain équilibre entre la cohérence de la description et
l’accessibilité pédagogique. Dans cette perspective, on peut facilement imaginer que les
données qui poseront problème seront 2c-e, et notamment le fait que 2e (Zaydun qāma)
nécessite une analyse différente de 1a (qāma Zaydun), ce qui, à première vue, ne va pas
de soi.
3 Deux grammaires du XVIIe siècle : Erpenius et
Martellotto
11 La Grammatica arabica d’Erpenius 5 (1584‑1624), dont la première édition date de 1613,
marque une étape décisive dans le développement des études arabes en Europe, en
proposant pour la première fois une grammaire pratique destinée à former des
arabisants à partir du niveau le plus élémentaire. De ce fait, elle a connu un succès
considérable, dont témoigne le nombre de ses rééditions et de ses traductions jusque
dans les premières décennies du XIXe siècle. Soucieux avant tout d’efficacité
pédagogique, l’ouvrage offre une présentation remarquablement précise et détaillée de
l’écriture et de la morphologie, c’est-à-dire des domaines qui sont le plus
immédiatement utiles aux débutants ; la syntaxe, en revanche, est traitée de façon
beaucoup plus sommaire, en une petite dizaine de pages. Elle ne comporte aucun
développement sur la phrase et fait par conséquent l’impasse sur la distinction entre
phrase verbale et phrase nominale ; de fait, la question qui nous intéresse ici n’est
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
94
abordée que sous le rapport de l’accord du verbe avec le sujet, c’est-à-dire l’opposition
1b vs 2d (qāma al-rijālu avec le verbe au singulier vs al-rijālu qāmū, avec le verbe au
pluriel) :
Concordia Substantivi cum Adjectivo, Relativi cum Antecedente ac Nominativi cum Verbo
eadem hic quae in aliis linguis. Solum observandum est :
[…]
2. Plurali humano eleganter quoque praeponi Verbum singulare, […] ut qāla al-nāsu 6
dixerunt homines, yaqūlu al-ḥukamāʾu […], dicunt sapientes, si verbum postponatur
omnia sunt regularia : ut al-nāsu qālū wa yaqūlūna, homines dixerunt et dicunt. (p. 196)
L’accord du substantif avec l’adjectif, du relatif avec son antécédent et du nominatif
[i.e. du sujet] avec le verbe est le même que dans les autres langues. Il faut
seulement observer :
[…]
2. qu’au pluriel humain, dans le bon usage, on antépose le verbe au singulier […],
comme qāla al-nāsu, « les hommes ont dit », yaqūlu l-ḥukamāʾu […], « les sages
disent » ; si le verbe est postposé, tout est régulier, comme al-nāsu qālū wa-yaqūlūna,
« les hommes ont dit et disent »
12 Ce passage est tout à fait représentatif de la méthode suivie par Erpenius : il ne s’agit
pas, à ce stade, de traiter exhaustivement et systématiquement de la syntaxe, mais de
signaler, à des débutants familiers de la grammaire latine, les points sur lesquels l’arabe
se comporte différemment des « autres langues ». Dans cette perspective, se livrer à des
considérations abstraites sur la différence entre 1a (qāma Zaydun) et 2e (Zaydun qāma)
ne serait guère efficace : il suffit de poser une règle d’accord ad hoc pour faire un sort à
l’opposition 1b vs. 2d, d’autant que les phénomènes d’accord en genre et nombre en
arabe présentent d’autres particularités au regard du latin et des langues européennes.
Cette démarche a évidemment un coût, puisque, posant que Zayd est sujet dans 2e
comme dans 1a, elle fait évidemment l’impasse sur 2c (Zaydun qāma ʾabū-hu) ; cela
étant, on peut considérer qu’à ce stade il est inutile d’en faire état, quitte à y revenir
lorsque les apprenants auront atteint un stade plus avancé. De fait, à l’intention de ce
public, Erpenius a donné en 1617 une édition accompagnée d’une traduction et d’un
commentaire de deux abrégés de syntaxe arabe la Muqaddima Ājurrūmiyya
d’Ibn Ājurrūm (mort en 1343) et les Miʾat al-ʿawāmil d’al-Jurjānī (mort en 1078), où la
doctrine traditionnelle est reprise et expliquée.
13 Les Institutiones linguae arabicae de Martellotto 7 (15??‑1617), parues à Rome en 1620,
suivent, quant à elles, une démarche nettement différente : il s’agit d’un ouvrage
beaucoup plus développé (quelque 500 pages in-quarto, à comparer aux 170 pages in-
octavo d’Erpenius). Le livre III notamment, consacré à la syntaxe (p. 352‑483), est un
exposé minutieux et précis de la doctrine des grammairiens arabes, dont s’inspirera
Silvestre de Sacy, comme nous le verrons sous peu. La question qui nous concerne ici
figure dans le deuxième chapitre de ce livre III, consacré aux différents types de
phrase ; elle est traitée dans trois passages, que je donne ici à la suite.
[Oratio] simplex duas obtinet species. Prima dicitur ismiyyatun nominalis, cum scilicet al-
musnad, siue enunciatum est nomen […] ut al-insān ḥayawān homo animal […]. Secunda
dicitur fiʿliyyatun verbalis, haec autem est illa, in qua al-musnad connexum est verbum
praecedens, veluti qāma Zaydun stetit Zaidus. Dicimus autem (quando connexum est
verbum praecedens;) nam si verbum subsequatur; tunc summa non est simplex, ut infra
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
95
patebit. (p. 355)
[La phrase] simple est de deux espèces. La première est dite ismiyya, « nominale », à
savoir lorsque al-musnad, c’est-à-dire l’énoncé [i.e. le prédicat] est un nom, comme
al-insān ḥayawān, « l’homme [est] un être vivant » […]. La seconde est dite fiʿliyya,
« verbale » ; c’est celle dans laquelle al-musnad, « le relié » [i.e. le prédicat], est un
verbe antéposé, comme qāma Zaydun « Zayd s’est levé ». Nous disons toutefois
« quand le relié est un verbe antéposé » ; en effet, si le verbe est postposé, alors il ne
s’agit pas d’une somme [i.e. d’une phrase, jumla] simple, comme il apparaîtra plus
loin.
Secundo autem modo accidit oratio composita, quando loco simplicis alicuius membri eius
collocatur, ac substituitur summa integra, veluti cum dicitur Zaydun māta abū-hu, Zaidus
mortuus est pater eius, vel Zaydun ibnu-hu ḥasanun, Zaidus filius eius pulcher. (p. 357)
Il y a un autre type de phrase complexe, lorsqu’à l’un de ses membres simples on
substitue une somme [i.e. une phrase, jumla] complète, par exemple quand on dit
Zaydun māta abū-hu, « Zayd son père est mort », ou Zaydun ibnu-hu ḥasanun « Zayd
son fils est beau ».
Si verbum non praecedat, sed subsequatur, dicetur potius Mobtadaum, unde cum dicitur
Zaydun ḍaraba Zaidus percussit, Zaidus non dicitur agens, sed Mobtadaum […] Quod si
Zaidus praeponatur atque dicatur Zaydun ḍaraba Zaidus percussit, tunc Zaidus erit
Mobtadaum, ut dictum est, agens vero erit pronomen eius, mustatir opertum, siue
occultum, nempe huwa ipse latens in eodem verbo ḍaraba. (p. 364 sq.)
Si le verbe ne précède pas [le sujet], mais le suit, on parle plutôt de Mobtada [i.e.
« thème », mubtadaʾ] ; par conséquent, lorsque l’on dit Zaydun ḍaraba, « Zayd a
frappé », alors Zayd n’est pas dit agent [i.e. sujet du verbe], mais Mobtada. […] Si
Zayd est antéposé et que l’on dit Zaydun ḍaraba, « Zayd a frappé », alors Zayd sera
Mobtada, comme on l’a dit, et l’agent sera son pronom mustatir « recouvert », c’est-
à-dire caché, à savoir huwa, c’est-à-dire « lui », latent dans ce même verbe ḍaraba.
14 Ce passage se passe presque de commentaires : on aura pu constater que Martellotto
reproduit fidèlement l’analyse et le raisonnement des grammairiens arabes, tels qu’ils
ont été exposés plus haut. On pourra simplement noter que la distinction entre phrase
simple et phrase complexe – également présente chez certains grammairiens arabes 8–
permet de séparer, dans l’exposé, le cas de la phrase nominale « simple » (celle qui a
seulement un prédicat nominal), en lui donnant de facto le statut de prototype.
15 On aura pu également remarquer le principal défaut de cette grammaire : une
terminologie technique à la fois pléthorique et redondante, où une notion peut être
désignée tantôt par le terme arabe, en graphie originale (e. g. al-musnad) ou sous une
forme latinisée (e. g. mobtadaum pour mubtadaʾ ‘thème’), tantôt par sa traduction
littérale dans son acception non technique (e. g. summa ‘somme’ pour jumla ‘phrase’),
tantôt par son équivalent latin (oratio pour le même jumla). Ce défaut, joint aux
dimensions considérables de l’ouvrage9, explique sans doute que celui-ci, malgré ses
qualités incontestables, n’a jamais connu le succès de celui d’Erpenius.
16 Cela étant, il faut insister sur le fait que la différence entre les deux grammairiens n’est
pas d’ordre théorique, mais pratique ou plus exactement stratégique : l’un et l’autre
admettent implicitement ou explicitement la théorie de la phrase des grammairiens
arabes et ne cherchent nullement à lui substituer une autre qui serait plus vraie ou plus
adéquate ; simplement, là où Martellotto s’applique d’emblée à l’exposer, Erpenius
préfère la passer provisoirement sous silence, quitte à y revenir dans des ouvrages
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
96
destinés à un public plus avancé, et se borne à fournir une règle ad hoc qui permet, à ce
stade, de parer au plus pressé.
4 Silvestre de Sacy
17 Avec la Grammaire arabe de Silvestre de Sacy (1758‑1838), nous abordons une nouvelle
étape dans l’histoire des théories linguistiques : ce savant, dont il est inutile de
souligner le rôle dans le développement des études orientales 10, est aussi l’un des
derniers représentants majeurs de la Grammaire générale. Celle-ci lui fournit d’emblée
un modèle théorique, censément universel, pour l’analyse de la phrase arabe, modèle
qu’il expose succinctement au début du livre III, consacré à la syntaxe :
3. […] toute proposition n’étant autre chose que l’énonciation d’un jugement de
notre esprit et devant être le tableau fidèle de notre jugement, il est nécessaire
qu’elle exprime un sujet, un attribut et l’existence intellectuelle de ce sujet avec
relation à cet attribut […].
4. De ces trois parties dont l’ensemble forme une proposition, le sujet, qui est la
première, est toujours un nom ou un pronom […]. La seconde des trois parties d’une
proposition, l’attribut, peut toujours être rendue par un nom, un pronom ou un
adjectif ; et la troisième, qui est l’expression de l’existence intellectuelle du sujet
avec relation à l’attribut, est exprimée par le verbe substantif, ou abstrait, le seul
qui ne contienne rien d’étranger à la nature du verbe proprement dit, c’est-à-dire
aucun attribut déterminé. (t. II, p. 3)
18 Silvestre de Sacy précise ensuite qu’il s’agit d’un modèle général et abstrait, qui peut se
réaliser de diverses manières selon les langues :
Tantôt le sujet et l’attribut seuls sont exprimés, et le verbe abstrait […] est supprimé
[…]. Tantôt un seul mot exprime l’attribut et l’existence intellectuelle du sujet avec
la relation à cet attribut ; et c’est là la fonction de tous les verbes autres que le verbe
abstrait […] ; aussi n’est-il aucun de ces verbes qui ne puisse être rendu par le verbe
abstrait et par un attribut : je mange, je vais, je lis équivalent à je suis mangeant, je suis
allant, je suis lisant. (ibid., p. 4)
19 Dans un tel cadre, il est bien évident que la distinction entre phrase nominale et phrase
verbale n’a plus de raison d’être : dans une phrase nominale « simple » comme 2a
(Zaydun qāʾimun, « Zayd [est] debout ») ou 2b (Zaydun fī al-dāri, « Zayd [est] dans la
maison »), on dira que le verbe abstrait est sous-entendu, et dans une phrase verbale
comme 1a (qāma Zaydun, « Zayd s’est levé », on posera que le verbe qāma est
décomposable en un verbe abstrait et un attribut, nom ou adjectif. Il est bien évident
aussi qu’il n’y a plus de sens à maintenir deux analyses distinctes pour 1a (qāma Zaydun)
et 2e (Zaydun qāma)11 :
89. Le sujet de tout verbe […] se met au nominatif, ce qui a également lieu soit que le
nom précède ou suive le verbe auquel il sert de sujet. Exemple ; Allāhu yaʿlamu mā
tafʿalūna12 ou bien yaʿlamu Allāh Dieu sait ce que vous faites. (t. II, p. 43)
20 Cette approche a une conséquence évidente : comme Erpenius, mais pour des raisons
entièrement différentes, Silvestre de Sacy a besoin d’une règle d’accord ad hoc pour
tenir compte de la différence entre 1b (qāma al-rijālu, avec le verbe au singulier) et 2d
(al-rijālu qāmū, avec le verbe au pluriel). Cette règle, comme je l’ai relevé plus haut, n’est
cependant pas exagérément coûteuse sur le plan pédagogique, même si elle peut laisser
sur sa faim un apprenant curieux de comprendre le pourquoi des choses.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
97
21 Il reste toutefois le cas de 2c (Zaydun qāma ʾabū-hu, « Zayd, son père s’est levé »), qui,
présente en apparence l’étrange particularité d’avoir deux « sujets », au sens où
l’entend Silvestre de Sacy. En apparence seulement, et il ne lui est pas exagérément
difficile de faire rentrer cette donnée récalcitrante sous le régime commun :
93. Il arrive très souvent que le complément objectif d’un verbe qui devrait être à
l’accusatif, celui d’une préposition qui devrait être au génitif, ou le complément
déterminatif d’un nom qui devrait aussi être au génitif […] sont déplacés du lieu qui
leur appartient dans la proposition et mis au commencement de la phrase : on les
met alors au nominatif et ils sont remplacés, dans le lieu qu’ils devraient occuper
naturellement, par un pronom personnel affixe. Ainsi l’on dit : […] Allāhu rasūlu-hu
ʿinda-kum Dieu, son apôtre est au milieu de vous. […]
94. Il résulte de là qu’une même proposition semble avoir deux sujets
grammaticaux, parce qu’il y a deux noms, indépendants l’un de l’autre, au
nominatif : Deus apostolus ejus inter vos. Mais il n’y a réellement qu’un sujet ; et le
mot mis au nominatif d’une manière absolue, qui semble ne pas appartenir à la
proposition, et être, si je puis m’exprimer ainsi, comme un hors-d’œuvre, et qui se
place toujours à la tête de la proposition, est le véritable complément, représenté
par le pronom personnel, qui fait la fonction de complément grammatical. Ainsi,
dans cette proposition Allāhu rasūlu-hu ʿinda-kum Dieu, son apôtre est au milieu de
vous (Deus, apostolus ejus inter vos), dont le sens est l’apôtre de Dieu est au milieu de
vous (apostolus Dei est inter vos), le vrai sujet grammatical est rasūlu l’apôtre ; le sujet
logique est rasūlu Allāhi l’apôtre de Dieu ; quant à Allāhu Dieu, mis au nominatif,
c’est le complément logique de rasūlu l’apôtre. (vol. II, p. 45‑47)
22 Le grammairien précise (p. 46) que « cette manière de s’exprimer ajoute de l’énergie au
discours et lui donne une sorte d’emphase qu’on pourrait faire sentir, en français, en
disant : […] C’est l’apôtre de Dieu même qui est au milieu de vous ». Preuve que Silvestre
de Sacy a perçu, au moins en partie, la fonction thématique de ce « nominatif absolu » ;
toutefois, il ne s’agit pas, pour lui, d’un type spécifique d’énoncé, mais d’une sorte de
figure, de procédé stylistique, qui ne change rien à la structure profonde de la phrase.
Cette analyse ne manque sans doute pas d’ingéniosité, mais elle passe sur le fait que,
dans une phrase de type 2e (Zaydun qāma, « Zayd, il s’est levé »), que Silvestre de Sacy,
nous l’avons vu, présente comme « normale », Zayd est tout aussi thématique que dans
2c. Autrement dit, la séparation qu’il introduit entre 2c et 2e apparaît, de ce point de
vue, largement artificielle.
5 Le tournant historico-comparatiste et ses limites
23 La même année que la seconde édition de la Grammaire arabe, en 1831, paraît à Leipzig le
premier volume de la Grammatica critica linguae arabicae d’Ewald (1803‑1875) 13, un
ouvrage dont l’importance tient notamment au fait qu’il est le premier à se réclamer
explicitement du nouveau paradigme historico-comparatiste qui se met en place dans
les premières décennies du XIXe siècle. Cette volonté de rupture, clairement affichée
dans le titre de l’ouvrage, est développée dans les « Prolégomènes » du premier volume
(p. 1‑19) : il s’agit de se démarquer clairement de ses prédécesseurs, et notamment de
Silvestre de Sacy14 mais aussi et surtout des grammairiens arabes, dont ceux-ci restent,
selon Ewald, trop étroitement tributaires. Si, en effet, poursuit-il, ces grammairiens
constituent une source indispensable pour connaître la langue arabe, il n’en est pas
moins nécessaire de les utiliser avec prudence, pour deux raisons. Tout d’abord, ils
ignorent – ou en tout cas ne tiennent pas compte – des autres langues sémitiques ; or
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
98
seule l’approche comparatiste permet « de comprendre et d’enseigner correctement les
lois et les causes d’une langue donnée » (quae sint singulae cujusdam [linguae] leges et
causas […] recte intelligi et docere : t. I, p. 18). En second lieu, leur souci de préserver la
langue du Coran dans sa pureté originelle les a conduits à négliger totalement
l’évolution historique de la langue (ibid., p. 19).
24 Apparaît ainsi, conséquence logique du nouveau paradigme, une attitude nouvelle
envers la tradition linguistique arabe, qui va dominer la plupart des travaux des
linguistes arabisants jusqu’à la seconde moitié du XXe siècle ; attitude dont l’expression
la plus radicale – la plus brutale, serais-je tenté de dire – se trouve chez Fleisch (1961),
et qui consiste à distinguer entre le corpus, qu’il faut traiter avec prudence, mais qui
conserve « une multitude de faits anciens […] pour le plus grand bien de la science
philologique moderne » (p. 47), et l’édifice théorique construit sur ce corpus, qui « n’est
pas fondé en réalité, est une violence faite à la langue, n’a pas de valeur scientifique, est
caduc et n’a plus qu’un intérêt historique » (p. 16). Toutefois, en ce qui concerne les
grammaires proprement dites, les choses sont loin d’apparaître aussi tranchées, du
moins sur le point qui nous concerne ici.
25 Celle d’Ewald, pour commencer, n’aborde pas directement la question ; les deux
sections du second volume, intitulées respectivement « Des constituants de l’énoncé, ou
du sujet et du prédicat et de leurs compléments » (De enunciationis partibus, sive de
subjecto et praedicato eorumque complementis, t. II, p. 145‑162) et « De l’ordre et de la force
[i.e. l’expressivité] des mots » ( De ordine et vi vocabulorum, p. 162‑185), ne font
aucunement état d’une distinction entre phrase nominale et phrase verbale, fût-ce
pour la réfuter comme le fait Silvestre de Sacy : à l’évidence, ce ne sont pas tant les
aspects formels de la syntaxe qui intéressent Ewald que les valeurs expressives liées à
l’ordre des mots, sur lesquelles il apporte des remarques qui ne manquent pas de
finesse. Ce choix, joint – il faut le dire – à un certain désordre dans la présentation, rend
cette grammaire difficilement utilisable comme grammaire de référence, malgré – ou
plutôt à cause de – son caractère novateur et original.
26 Tout en se réclamant à la fois de Silvestre de Sacy et d’Ewald, dont elle reprend
notamment toute l’organisation du livre III consacré à la syntaxe, la Grammatica arabica
in usum scholarum academicarum de Caspari (1814‑1892), parue en 1848, comme l’indique
son titre, se veut plus succincte et plus orientée vers la pratique. De fait, elle connut
une longue histoire éditoriale, faite de révisions et de traductions successives ; étudiée
en détail par Larcher (2014), elle a pour étape ultime la version anglaise de Wright, dont
la 3e édition revue et augmentée par W. Robertson Smith et M. J. de Goeje (Wright
1896‑1898) reste encore la principale grammaire de référence pour l’arabe classique.
Pour la question qui nous concerne, les seules éditions pertinentes sont la 1 re, en latin,
la 2e, révisée par l’auteur, en allemand (Caspari 1859), et la 5 e, revue par August Müller
(Caspari 1887)15 ; les éditions suivantes n’apportent pas d’éléments nouveaux.
27 Dans la 1re édition, Caspari, à la différence d’Ewald comme de Silvestre de Sacy, pose
d’emblée la distinction entre les deux types de phrases :
Enuntiatio, cujus subjectum et praedicatum nomina sunt, jumlatun ismiyyatun ,
enuntiatio nominalis, enuntiatio cujus vel praedicatum, vel praedicatum et subjectum verbo
exprimuntur, jumlatun fiʿliyyatun, enuntiatio verbalis, a grammaticis Arabicis vocantur.
(p. 245)
Une phrase dont le sujet et le prédicat sont des noms est appelée par les
grammairiens arabes jumla ismiyya, « phrase nominale », et celle dont soit le
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
99
prédicat, soit le prédicat et le sujet, sont exprimés par un verbe est appelée jumla
fiʿliyya, « phrase verbale ».
28 Cette formulation reprend en substance celle de Martellotto et se fonde sur l’idée,
partagée par la grande majorité des grammairiens arabes, que la phrase nominale
prototypique est celle qui est constituée de deux noms, comme on l’a signalé plus haut.
Elle n’en comporte pas moins une certaine ambiguïté, dans la mesure où elle semble
définir la phrase nominale par la nature du prédicat, ce qui est évidemment réducteur.
La suite du texte montre toutefois qu’il s’agit d’une formulation provisoire : Caspari
précise quelques lignes plus loin que « le prédicat peut aussi être une préposition avec
son régime » (praedicatum etiam praepositio esse potest cum genitivo suo, p. 246) et, à
propos des phrases du type 2c (Zaydun qāma ʾabū-hu) et 2e (Zaydun qāma), reprend
exactement l’analyse des grammairiens arabes :
Ubi nomen (nomen substantivum vel pronomen) primo, verbum secundo loco collocatum est,
illud non agens sed inchoativus, hoc non verbum, sed enuntiativus et enuntiatio non
verbalis, sed nominalis est; quae, ex inchoativo et integra enuntiatione, verbali, cujus agens
ipsa verbi forma continetur, enuntiatio composita dici potest, ut Zaydun māta Zeidus,
mortuus est, Zeid, er ist gestorben (māta = māta huwa), ʾanā qultu ego dixi, ich, ich
habe gesagt (agens est τὸ tu τoῦ qultu). (p. 247)
Lorsque le nom (substantif ou pronom) est situé en première position et le verbe en
seconde, celui-là n’est pas agent mais l’inchoatif [i.e. le thème] et celui-ci n’est pas le
verbe mais l’énonciatif [i.e. le propos], et la phrase n’est pas nominale mais verbale ;
celle-ci, constituée d’un inchoatif et d’une phrase complète dont l’agent est contenu
dans la forme verbale elle-même, peut être dite complexe, comme Zaydun māta,
« Zayd, [il] est mort, Zeid, er ist gestorben » (māta = māta huwa), ʾanā qultu, « Moi, j’ai
dit, ich, ich habe gesagt » (l’agent est [le morphème] -tu de qultu).
29 On peut observer ici que Caspari a parfaitement perçu le caractère thématique de ce
qu’il appelle, à la suite de Silvestre de Sacy l’« inchoatif » ; il prend même la peine de
rendre ses exemples en allemand, où cette valeur est apparemment plus facile à mettre
en évidence qu’en latin. Il n’en reste pas moins qu’il y a là une certaine ambiguïté, une
certaine tension, entre l’idée, suggérée par le début du texte, que la « vraie » phrase
nominale serait une phrase sans verbe et ce que je serais tenté de nommer le principe
de réalité, qui impose de prendre en compte les cas de type 2c-e en les intégrant à une
description cohérente.
30 Dans l’édition allemande, toutefois, le premier des deux fragments est entièrement
remanié, comme si Caspari se rendait compte du caractère insatisfaisant de la première
rédaction :
Ein jeder Satz, welcher mit dem Subject, sei dies nun ein Nomen oder ein Pronomen, beginnt,
wird von den arabischen Grammatikern jumlatun ismiyyatun, ein Nominalsatz genannt.
Ob das folgende Prädicat selbst wiederum ein Nomen oder eine Präposition mit dem von ihr
regierten Substantiv […], oder ob es ein Verbum (Verbalsatz) ist, das ist dabei gleichgiltig
(Zaydun māta gilt den arabischen Grammatikern ebensowohl für einen Nominalsatz als
Zaydun ʿālimun und Zaydun fīl-masjid, was den Nominalsatz, nach ihnen, charakterisirt,
ist immer die Abwesenheit einer durch ein Verbum finitum gegebenen oder in einem solchen
enthaltenen logischen Copula). (p. 322 sq.)
Toute phrase qui commence par le sujet, qu’il s’agisse d’un nom ou d’un pronom,
est pour les grammairiens arabes jumla ismiyya, « une phrase nominale ». Que le
prédicat qui le suit soit un nom, une préposition avec son régime ou un verbe (une
phrase verbale), cela n’entre pas en ligne de compte (Zaydun māta [« Zayd, il est
mort »] est pour eux tout autant une phrase nominale que Zaydun ʿālimun [« Zayd
est savant »] et Zaydun fī l-masjid [« Zayd est à la mosquée »] ; pour eux, la phrase
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
100
nominale est toujours caractérisée par l’absence d’une copule logique exprimée par
un verbe fini ou bien contenue dans celui-ci).
31 Le début du paragraphe rétablit la doctrine orthodoxe des grammairiens arabes : ce qui
caractérise la phrase nominale n’est pas la nature du prédicat, qui « n’entre pas en
ligne de compte » (das ist dabei gleichgiltig), mais l’antéposition du sujet. La dernière
phrase, en revanche, apparaît passablement obscure, pour ne pas dire confuse. D’une
part, elle prétend expliquer la position des grammairiens arabes en faisant appel à une
notion, celle de copule, qui leur est totalement étrangère : s’il n’existe pas, en arabe, de
verbe copule, ils pouvaient difficilement remarquer son absence, et encore moins
supposer qu’un verbe fini pût en contenir une. D’autre part, si l’on admet un tel
présupposé (qui semble repris à la Grammaire générale, autant que je puisse en juger),
on peut s’interroger sur sa pertinence pour qualifier un énoncé comme Zaydun māta,
qui contient bien un « verbe fini » et donc une copule ; la seule manière dont on puisse,
me semble-t-il, comprendre cette phrase serait de dire que la copule contenue dans le
verbe māta relie non pas celui-ci à Zayd, mais au « pronom masqué » qui lui sert de
sujet. Cela étant, l’impression demeure que la phrase nominale des grammairiens
arabes est désormais devenue un objet un peu encombrant, que l’on conserve faute de
mieux, dans la mesure où il permet de rendre compte des faits de manière cohérente,
mais que l’on a un peu de mal à valider. Symptomatique à cet égard est le régime
d’évidentialité des fragments cités plus haut : Caspari se borne à rapporter la position
des grammairiens arabes, sans la reprendre à son compte ni la rejeter explicitement, ce
qui est une façon de prendre ses distances avec elle, tout en conservant son potentiel
descriptif.
32 Cela étant, il faut insister sur le fait que Caspari – comme l’avait fait jusqu’à un certain
point Silvestre de Sacy – a clairement perçu certaines des particularités sémantico-
pragmatiques de la phrase nominale. Une « Remarque » insérée dans la 5 e édition de sa
grammaire (Caspari 1887), et due sans doute à son réviseur, August Müller, va
également dans ce sens :
Anmerk. Die Wichtigkeit, welche im Systeme der arabischen Grammatik dem Unterschiede
zwischen Nominalsatz und Verbalsatz beigemessen wird, ist keine künstliche, sondern
durchaus im Wesen der Sprache begründet. Der mit dem Ausdrucke für die Thätigkeit
beginnende Verbalsatz ist die gegebene Form für die Erzählung von Handlungen und
Ereignissen, der Nominalsatz, in welchem von dem voranstehenden Subject durch das
Prädikat etwas ausgesagt wird, dient ebenso natürlich der Beschreibung von Personen oder
Sachen […]. Dieser Unterschied wird, falls nicht der Wunsch nach Hervorhebung eines oder
des anderen Wortes eine Veränderung in der Wortstellung herbeiführt, im guten alten
Arabisch mit grosser Regelmässigkeit festgehalten. (p. 332)
Remarque. L’importance qui, dans le système des grammairiens arabes, est
attribuée à la différence entre phrase nominale et phrase verbale n’est nullement
artificielle, mais au contraire totalement fondée sur la nature de la langue. La
phrase verbale, qui commence par l’expression de l’activité est la forme appropriée
au récit des actions et des événements ; la phrase nominale, dans laquelle quelque
chose est dit, au moyen du prédicat, à propos du sujet antéposé sert naturellement
à décrire les personnes et les choses […]. Cette distinction est préservée avec la plus
grande régularité en vieil arabe de bonne qualité, sauf lorsque le désir de mettre
l’accent sur un mot ou un autre entraîne un changement dans l’ordre des mots.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
101
6 Phrase nominale et phrase sans verbe
33 Le traitement de la question par Caspari, ainsi que par ses réviseurs et continuateurs 16,
témoigne assez bien de la difficulté qu’éprouvent les grammairiens arabisants à se
passer des apports de la tradition arabe, lors même qu’ils entendent prendre leurs
distances vis-à-vis d’elle. Nous avons pu observer, dans les textes précédents, une
certaine hésitation entre la conception des grammairiens arabes et une autre, plus
simple et plus conforme à une sorte de « sens commun linguistique », pour laquelle la
distinction entre phrase nominale et phrase verbale dépend uniquement de la nature
du prédicat. C’est pour celle-ci qu’opte notamment Hermann Reckendorf (1863‑1924),
dans son ouvrage Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen (1895) :
Das Praed. ist entweder ein Nomen oder ein Verhältnissausdruck oder ein Verb. fin.; das
Karakteristische für die erste und zweite Art ist nicht das Fehlen einer Kopula, sondern das
Fehlen eines Verbum finitum. Sätze, deren Praed. ein Verb. fin. ist, werden als Verbalsätze
bezeichnet, alle andern als Nominalsätze. (p. 1)
Le prédicat est soit un nom, soit une expression relationnelle [i.e. un groupe
prépositionnel], soit un verbe fini : le trait caractéristique de la première et la
seconde catégorie n’est pas l’absence de copule, mais l’absence de verbe fini. Les
phrases dont le prédicat est un verbe fini sont qualifiées de phrases verbales, toutes
les autres de phrases nominales.
34 Comme on peut le constater, cette définition permet accessoirement d’évacuer la
question un peu encombrante de la copule, ou plus exactement de son absence (si tant
est que l’absence de quelque chose puisse être encombrante) ; il semble d’ailleurs qu’il y
a là une réponse implicite à la phrase de Caspari relevée plus haut. Dès lors, l’analyse
des grammairiens arabes n’est plus mentionnée que pour mémoire :
[…] die Grammatiker der Araber eben an dem Voranstehen des Subj. den Nominalsatz
erkennen und an dem Voranstehen des Praed. den Verbalsatz. Der Verbalsatz mit Inversion
(§ 22) ist für sie ein zusammengesetzter Nominalsatz, das praedizirende Verbum selbst ein
Satz, also Zaydun ḍaraba = „Zeid, er schlug“. (p. 2)
[…] les grammairiens arabes ont reconnu la phrase nominale à l’antéposition du
sujet, et la phrase verbale à celle du prédicat. La phrase verbale avec inversion est
selon eux une phrase nominale complexe et le verbe prédiqué à lui seul comme une
phrase, comme Zaydun ḍaraba = Zayd, il a frappé.
35 On remarquera que la traduction de l’exemple met bien en évidence le caractère
thématique de Zayd ; mais ici encore, comme chez Silvestre de Sacy, il est considéré
comme une simple variante stylistique, qui ne change rien à l’organisation syntaxique
de la phrase. Toutefois, la notion de « phrase verbale inversée » pose problème : s’il
s’agit d’une simple inversion dans l’ordre des mots, l’opposition entre le verbe au
singulier dans 1b (qāma al-rijālu) et le verbe au pluriel dans 2d (al-rijālu qāmū) reste
inexpliquée et on ne peut en rendre compte que par une règle d’accord ad hoc qui
apparaît totalement arbitraire.
36 La Grammaire de l’arabe classique de Régis Blachère (1900‑1973) et Maurice Gaudefroy-
Demombynes (1862‑1957), parue en 1937, se réclame explicitement de Reckendorf et
plus généralement de la tradition arabisante allemande (Fleischer, Nöldeke,
Brockelmann entre autres), ainsi que des indo-européanistes français (Burnouf,
Darmesteter, Bréal, Meillet), auxquels l’étude des langues doit « des progrès qui l’ont
entièrement renouvelée et des méthodes qui s’appliquent à la linguistique générale »
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
102
(Blachère et Gaudefroy-Demombynes 1937, « Avant-propos » : 4) ; ces progrès
permettent de rompre avec la vieille école représentée par Silvestre de Sacy et ses
continuateurs17 (ibid. : 3). De fait, la définition de la phrase nominale que donnent les
auteurs reprend celle de Reckendorf :
§ 350. – Définition. La phrase nominale simple est formée par le rapprochement de
deux éléments : le sujet (que les grammairiens arabes nomment mubtadaʾ
« inchoatif ») et l’attribut (que ces mêmes grammairiens appellent ḫabar
« énonciatif »), sans que ces deux éléments soient liés l’un à l’autre par un verbe.
(p. 387)
37 Les conséquences d’une telle définition sont celles que l’on peut prévoir : Blachère et
Gaudefroy-Demombynes, tout comme Reckendorf, sont conduits à postuler une règle
d’accord ad hoc pour rendre compte de l’opposition 1b vs 2d. Ce qui est plus gênant, ils
sont les uns et les autres amenés à occulter 2c (Zaydun qāma ʾabū-hu « Zayd, son père
s’est levé ») : cette donnée, pourtant nullement exceptionnelle, ne figure pas parmi les
différents types d’attributs possibles d’une phrase nominale énumérés p. 388.
38 Comme Reckendorf encore, les auteurs estiment nécessaire de faire un sort à la
définition des grammairiens arabes ; celle-ci fait l’objet d’une note de bas de page, qui
se rapporte au fragment que je viens de citer.
(1) […] on ne retiendra pas la définition de la phrase nominale donnée par les
grammairiens arabes qui considèrent comme nominale toute phrase ne commençant
pas par un verbe. Cette définition se fonde sur l’analyse suivante : Zaydun yamūtu
Zayd mourra = Zayd sera il meurt où il meurt est un attribut. Or cette décomposition
est inadmissible ; cf. Vendryès [1921], 144.
39 Cette « définition » a été vivement critiquée par Ayoub et Bohas (1981), qui en ont
souligné le caractère sommaire et confus ; je rappellerai ici leurs arguments principaux.
Tout d’abord, il est faux de dire (et a fortiori de l’écrire en italiques) que pour les
grammairiens arabes est nominale « toute phrase ne commençant pas par un verbe » :
une phrase nominale peut fort bien commencer par une particule, par exemple
interrogative (e. g. ʾa-Zaydun qāʾimun « Zayd est-il debout ? ») sans perdre à leurs yeux
cette qualité ; a contrario, une phrase verbale peut commencer par un nom lorsqu’il a
une valeur de focus (e. g. ʿAmran ḍaraba Zaydun, « [C’est] ʿAmr-ACC [que] Zayd-NOM a
frappé »). En second lieu, l’analyse proposée pour Zaydun yamūtu (« Zayd, il mourra »)
laisse perplexe, puisqu’elle ne saurait évidemment être le fait des grammairiens arabes,
à qui la notion de copule, on l’a dit, est étrangère. La référence à Vendryès ne fait
qu’aggraver cette perplexité, puisque, dans le passage concerné, il reproche aux
« logiciens disciples d’Aristote » (il s’agit semble-t-il, de la Grammaire de Port-Royal et
plus généralement de la Grammaire générale) de « décomposer la phrase verbale de
façon à y introduire le verbe substantif : le cheval court = le cheval est courant », chose
que les grammairiens arabes n’ont évidemment jamais songé à faire 18. Bref, il y a dans
tout cela une certaine légèreté, pour ne pas dire une certaine négligence, qui témoigne
du peu d’intérêt porté par les auteurs à la tradition grammaticale arabe, ou du moins à
ses aspects théoriques, désormais considérée comme une chose du passé. Il s’agit
d’ailleurs d’une attitude très répandue chez les arabisants dans la majeure partie du
XXe siècle, dont on a déjà vu l’expression dans le jugement de Fleisch cité plus haut 19. Ce
n’est que dans les années 1970‑1980 que paraissent plusieurs travaux innovants qui
donnent un nouvel essor à l’histoire de la tradition linguistique arabe.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
103
7 Une solution originale ?
40 Pour terminer ce passage en revue, je m’arrêterai sur une grammaire beaucoup plus
récente, celle de Badawi et al. (2004). À la différence des précédentes, il s’agit d’une
grammaire de la langue moderne, dont le corpus est pour l’essentiel tiré de l’usage de la
presse, et qui laisse de côté un certain nombre d’archaïsmes hérités de la tradition
médiévale. Cela étant, cela n’a guère d’impact sur la question qui nous intéresse, dans la
mesure où toutes les constructions mentionnées plus haut sont largement attestées
dans l’usage contemporain. Sur ce point, les auteurs proposent une solution ingénieuse,
marquée par un pragmatisme et un sens du compromis que, jusqu’à une période
récente, on aurait qualifiés de typiquement anglo-saxons :
The kernel or basic sentence in Arabic is either subj. + pred. or verb + agent. In the case of
subj. + pred. sentences a further subdivision can be made according to the structure of the
pred.
1. The equational sentence […]. This consists of subj. + pred. only and contains no verbal
copula or any other verbal element. It asserts that the subj. is identical with the pred. (which
cannot therefore be a verb) […]e.g. al-šamsu ḥāriqatun “the sun is burning” (i.e. in the
class of something which burns).
2. The topic + comment sentence […]. This also contains no verbal copula, but the comment
is an entire clause (either an equational or a verbal sentence). […] It thus differs
fundamentally from the single term predicate of the equational sentence in that the
comment is always compound […].
3. The verbal sentence. This consists of a verb, always in the first position […] accompanied
by its agent […]. (p. 306)
La phrase nucléaire ou basique en arabe est soit sujet + prédicat soit verbe + agent.
Dans le cas des phrases sujet + prédicat, une subdivision peut être faite selon la
structure du prédicat, ce qui donne trois types de phrases :
1. La phrase équationnelle […]. Elle consiste uniquement en sujet + prédicat et ne
contient ni copule verbale ni aucun autre élément verbal. Elle asserte que le sujet
est identique au prédicat (qui ne peut donc être un verbe) […] e. g. al-šamsu
ḥāriqatun « le soleil est brûlant » (i.e. il appartient à la classe de quelque chose qui
brûle).
2. La phrase topique + commentaire […]. Celle-ci ne contient pas non plus de copule
verbale, mais le commentaire est une phrase complète (équationnelle ou verbale).
Elle diffère donc fondamentalement du prédicat constitué d’un seul terme, en cela
que le commentaire est toujours composé. […]
3. La phrase verbale. Elle consiste en un verbe, toujours en position de tête […]
accompagné de son agent
41 Quelques pages plus loin, les auteurs reviennent sur les phrases de type 2e (Zaydun
qāma), en insistant sur le fait qu’il ne s’agit pas, en dépit des apparences, d’une phrase
verbale inversée, mais d’une phrase de type topique + commentaire dont l’agent est un
pronom incorporé au verbe (p. 329).
42 Cette solution ne manque certes pas d’ingéniosité, dans la mesure où elle permet de
préserver la conception courante de la phrase nominale comme phrase sans copule ni
verbe, tout en évitant de balayer sous le tapis les données les données de type 2c-e
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
104
(Zaydun qāma ʾabū-hu etc.). Cela étant, elle pèche quelque peu du côté de la cohérence.
Ce défaut apparaît d’emblée dans le disparate de la terminologie employée : « phrase
équationnelle » renvoie à la sémantique, « phrase topique + commentaire » à la
pragmatique et « phrase verbale » à la syntaxe. Au demeurant, la dénomination
« phrase équationnelle » n’apparaît pas très heureuse, même si elle semble assez
répandue comme synonyme de « phrase nominale » : définie comme assertant l’identité
du sujet avec le prédicat, elle ne vaut au sens strict que pour les définitions (e. g. « Un
célibataire est un homme non marié »)20 ou encore pour les phrases nominales dont le
propos est référentiel (e. g. « Walter Scott est l’auteur de Waverly ») ; en revanche, on ne
voit guère comment y faire entrer les autres, de loin les plus fréquentes. À cet égard, la
glose proposée pour al-šamsu ḥāriqatun illustre bien cette difficulté : on est passé
inopinément de l’assertion d’une identité à celle de l’appartenance à une catégorie, ce
qui n’est pas la même chose. L’incertitude s’accroît encore si l’on fait intervenir les
phrases nominales dont le propos est un groupe prépositionnel (e. g. Zaydun fī l-dār
« Zayd [est] dans la maison »), mentionnées quelques lignes plus loin : ici, il ne saurait
évidemment être question d’identité entre sujet et prédicat, et oserait-on gloser cette
phrase par « Zayd appartient à la classe de quelque chose qui est dans la maison » ?
43 D’un autre point de vue, on ne voit pas très bien pourquoi la dénomination « phrase
topique + commentaire » serait réservée au cas où ledit commentaire est une phrase :
rien, semble-t-il, n’empêche de l’appliquer aux constructions de type 2a (Zaydun
qāʾimun) et 2b (Zaydun fī al-dāri), comme l’indique notamment le fait que, dans les deux
cas, le « sujet » doit en principe être défini (on ne peut construire, par exemple,
*rajulun qāʾimun ‘un homme est debout’), ce qui correspond bien à ce que l’on attend
d’un thème. Autrement dit, la distinction entre phrase équationnelle et phrase
topique + commentaire apparaît en définitive largement artificielle.
44 On pourrait sans doute répondre à cela qu’elle a au moins le mérite de ne pas faire
l’impasse sur une partie des données – ce qui n’est pas le cas de tout le monde – tout en
préservant la conception communément admise de ce qu’est la phrase nominale, fût-ce
au prix d’un artifice de langage. On pourrait également répondre qu’une grammaire
n’est pas prioritairement destinée à des linguistes coupeurs de cheveux en quatre, mais
à des apprenants, et qu’elle reflète nécessairement un compromis entre efficacité
pédagogique et cohérence théorique. Comme on a pu le voir, il s’agit d’un débat qui ne
date pas d’hier et que je n’ai pas la prétention de trancher ici.
8 Conclusion
45 Que retenir de ce long périple à travers les grammaires arabisantes ? Le point principal
qui s’en dégage, me semble-t-il, est qu’il illustre parfaitement les pièges et les limites de
l’inter-traductibilité des catégories linguistiques. Il est inutile de s’appesantir
davantage sur le cas de la phrase nominale : on a suffisamment vu les malentendus et
les hésitations découlant du fait qu’une dénomination identique recouvre des objets
construits de manière fondamentalement différente. Toutefois, au-delà de cette
constatation quelque peu triviale, le nœud du problème – comme l’avaient déjà relevé
Ayoub et Bohas (1981) – réside dans la tendance constante dans les grammaires
arabisantes (sauf, dans une certaine mesure, la dernière citée) à classer indistinctement
sous la catégorie de sujet aussi bien le thème (mubtadaʾ) de la phrase nominale que
l’agent (fāʿil) de la phrase verbale et à penser l’un et l’autre sous l’opposition sujet/
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
105
prédicat : cet outillage ne leur permettait guère de donner une description réellement
précise et rigoureuse de la phrase nominale en arabe, lors même que certains d’entre
eux, tels Silvestre de Sacy ou Caspari en percevaient assez clairement certaines
particularités sémantico-pragmatiques. Ces outils existaient pourtant dès la seconde
moitié du XIXe siècle, avec la notion de « sujet psychologique » élaborée par Georg
von der Gabelentz, Hermann Paul et Phlipp Wegener (Nerlich et Clarke 1999), puis les
travaux de Charles Bally et du cercle de Prague. Cela conduit à s’interroger sur le
rythme et les réseaux par lesquels les innovations en linguistique se transmettent des
travaux théoriques aux grammaires d’apprentissage ; mais c’est là une question qui
dépasse autant les limites de cet exposé que les compétences de son auteur.
BIBLIOGRAPHIE
Sources primaires
Astārābāḏī (al-), Raḍī al-Dīn. Šarḥ al-Kāfiya. 2 vol. Istanbul. 1310 H [réimpr. Beyrouth : Dār al-
Kutub al-ʿIlmiyya. 1979].
Badawi, El-S., Carter, M. et Gully, A. 2004. Modern written Arabic. A comprehensive grammar.
Londres/New York : Routledge.
Blachère, R. et Gaudefroy-Demombynes, M. 1937. Grammaire de l’arabe classique. Paris, Librairie
orientale et américaine G. P. Maisonneuve.
Caspari, C. P. 1848. Grammatica arabica in usum scholarum academicarum. Leipzig : C. L. Fritzsche.
Caspari, C. P. 1859. Grammatik der arabischen Sprache für akademische Vorlesungen. Leipzig : C. L.
Fritzsche.
Caspari, C. P. 1887. Dr C. P. Caspari’s arabische Grammatik. Fünfte Auflage bearbeitet von August Müller.
Halle : Buchhandlung des Waisenhauses.
Erpenius, Th. Grammatica arabica dicta Gjarumia & Libellus centum regentium, cum versione Latina &
Commentarius. Leyde : Typographia erpeniana linguarum orientalium. 1617.
Erpenius, Th. Grammatica arabica in quinque libris explicata, 2 e éd. revue par l’auteur. Leyde : Jean
Maire. 1636 [1re éd. 1613. Leyde : Officina raphelengiana].
Ewald, G. H. Grammatica critica linguae arabicae. 2 vol. Leipzig : Libraria hahniana. 1831‑1833.
Fleisch, H. 1961. Traité de philologie arabe, I, Préliminaires, phonétique, morphologie nominale.
Beyrouth : Imprimerie catholique.
Ibn Hišām, Jamāl al-Dīn. Muġnī l-labīb. Éd. par M. Mubārak et M. ʿA. Ḥamdallāh. Beyrouth : Dār al-
Fikr. 1979 [1360/761H].
Martellotto, Fr. Institutiones linguae arabicae in tribus Libris divisae. Rome : Stefano Paolini. 1620.
Reckendorf, H. Die syntaktischen Verhältnisse des Arabischen. Leyde : Brill. 1895.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
106
Silvestre de Sacy, A.-I. Grammaire arabe à l’usage des élèves de l’École spéciale des langues orientales. 2 e
éd. revue et augmentée. 2 vol. Paris : Imprimerie royale. 1831 [1 re éd. 1810].
Socin, A. Arabische Grammatik, 6e éd. révisée par C. Brockelmann. Berlin : Reuther & Reichard.
1909.
Wright, W. A Grammar of the Arabic Language. 3e éd. révisée par W. Robertson Smith et M. J. de
Goeje. 2 vol. Cambridge : Cambridge University Press. 1896‑1898 [réimpr. Beyrouth : Librairie du
Liban. 1974].
Sources secondaires
Ayoub, G. et Bohas, G. 1981. Les grammairiens arabes, la phrase nominale et le bon sens.
Historiographia linguistica, no 8/2‑3 : 267‑284.
Benveniste, É. 1950. La phrase nominale. Bulletin de la Société de linguistique de Paris, n o 46/1 : 19‑36
[cité d’après Problèmes de linguistique générale 1, 151-167. Paris : Gallimard].
Espagne, M., Lafi, N. et Rabault-Feuerhahn, P., éd. 2014. Silvestre de Sacy : le projet européen d’une
science orientaliste. Cerf-α. Paris : Les Éditions du Cerf.
Fück, J. 1955. Die arabischen Studien in Europa: bis in den Anfang des 20. Jahrhunderts. Leipzig : O.
Harrassowitz.
Girard, A. 2010. Des manuels de langue entre mission et érudition orientaliste au XVIIe siècle : les
grammaires de l’arabe des caracciolini. Studi medievali e moderni, n o 14/1 : 279‑296.
Guillaume, J.‑P. 2018. Erpenius, Thomas. Grammatica arabica quinque libris methodicè explicata.
Corpus des textes linguistiques fondamentaux [http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?n=748].
Guillaume, J.‑P. 2019. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac. Grammaire arabe. Corpus des textes
linguistiques fondamentaux [http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?n=758].
Guillaume, J.‑P. 2020. Ewald, Georg Heinrich. Grammatica Critica Linguae Arabicae. Corpus des
textes linguistiques fondamentaux [http://ctlf.ens-lyon.fr/n_fiche.asp?n=762].
Jakobson, R. 1963. Essais de linguistique générale. Trad. par N. Ruwet. 2 vol. Arguments, 14 et 57.
Paris : Éd. de Minuit.
Jones, J. R. 1988. Learning Arabic in Renaissance Europe. Thèse de doctorat. Londres : SOAS.
Larcher, P. 2014. L’étrange destin d’un livre : la soi-disant Grammaire arabe de William Wright
(1830‑1889). Historiographia linguistica, no 41/1 : 109‑126.
Meillet, A. 1906. La phrase nominale en indo-européen. Mélanges de la Société linguistique, n o 14 :
1‑26.
Nerlich, Br. et Clarke, D. D. 1999. Champ, schéma, sujet : les contributions de Bühler, Bartlett et
Benveniste à une linguistique du texte. Langue française, no 121 : 36‑55.
Vrolijk, A. van et Leeuwen, R. van. 2014. Arabic Studies in the Netherlands. A Short History in Portraits,
1580‑1950. Trad. par A. Hamilton. Boston MA : Brill.
NOTES
1. Par convention, on désignera ainsi les grammaires produites en Occident à l’usage d’un public
occidental, et par « grammaire arabe » le système autochtone.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
107
2. Je ne tiens pas compte ici d’un certain nombre de constructions que la tradition a rattachées,
plus ou moins arbitrairement, à la phrase nominale, comme les constructions locatives du type fī
l-dāri Zaydun (« Dans la maison [il y a] Zayd »), que certains considèrent d’ailleurs comme un type
de phrase distinct, ou encore des données très marginales comme ʾa-qāʾimun al-Zaydān (« Est-ce
qu’il est [sic] debout, les deux Zayd ? »).
3. Le seul grammairien à rejeter explicitement cette affirmation, à ma connaissance, est al-
Astārābāḏī, qui la juge « dépourvue de fondement » (Šarḥ al-Kāfiya, I, 8).
4. Notons au passage que, dans l’optique des grammairiens arabes, ce n’est pas à proprement
parler le verbe qui est au singulier ou au pluriel, mais bien le pronom qui lui est amalgamé.
5. Sur cet ouvrage et son auteur, voir notamment Fück (1955 : 59‑72) ; Jones (1988 : 187‑212) ;
Vrolijk et van Leeuwen (2014 : 31‑40) ; Guillaume (2018).
6. Dans les citations, sont composés en romain les passages en graphie arabe dans l’original.
7. Sur cet ouvrage et son auteur, voir Girard (2010).
8. Par exemple Ibn Hišām, Muġnī l-Labīb, p. 490 sq.
9. À noter qu’une version abrégée de la grammaire de Martellotto a été donnée par son élève
Filippo Guadagnoli, sous le titre Breves Arabicae linguae institutiones (Rome, 1642). Celui-ci ramène
à de justes bornes la prolixité de son maître, sans pallier les incertitudes de sa terminologie.
10. Les différents aspects de la carrière et de l’œuvre de Silvestre de Sacy sont abordés, avec une
abondante bibliographie, dans Espagne et al. (2014). Sur sa Grammaire arabe, voir également
Guillaume (2019).
11. Le passage ci-dessous est assorti d’une longue note, où l’auteur déclare en substance qu’il
s’écarte sur ce point de la doctrine des grammairiens arabes ; celle-ci, dont la connaissance est
selon lui « indispensable à quiconque veut entendre les grammairiens, les lexicographes et les
scoliastes arabes » (t. I, p. ix) est en revanche exposée au livre IV de la Grammaire, pour lequel
Silvestre de Sacy déclare avoir « pris pour guide » le livre III de Martellotto (ibid., p. x).
12. Dans les citations en français, sont composées en italique les passages en graphie arabe dans
l’original.
13. Sur cet ouvrage et son auteur, voir Fück (1955 : 167) ; Guillaume (2020).
14. Auquel il rend toutefois un vif hommage « non seulement pour l’étendue de sa science, mais
encore pour la remarquable pureté de son âme » (non ob doctrinae solum copiam sed ob animi
candorem insignam, vol. I, p. v).
15. Je tiens à remercier Pascale Rabault-Feuerhahn, qui m’a aidé à comprendre et à traduire
plusieurs des textes en allemand cités ici.
16. C’est le cas, par exemple, de la grammaire de Socin (1 re éd. 1885), qui est pour l’essentiel un
abrégé de celle de Caspari ; maintes fois rééditée et traduite, elle donna lieu elle aussi à plusieurs
remaniements (voir Socin 1909 : 103‑107).
17. Parmi lesquels ils citent Caspari, ce qui est un peu réducteur et néglige notamment ce qu’il
doit à Ewald.
18. Il est bien évident que l’absence de copule dans une langue donnée – et partant, la tentation
de la « rétablir » là où l’on pense qu’elle devrait être – ne peut être ressentie que si l’on examine
les faits à partir d’une autre langue qui en est pourvue. Faute de prendre conscience de cette
vérité première, on ne peut que faire dire des sottises aux grammairiens arabes et s’enferrer soi-
même dans d’inextricables confusions.
19. Soulignons que ce grand arabisant – qualificatif que l’on ne saurait non plus refuser à
Blachère et à Gaudefroy-Demombynes – était aussi, en son temps, l’un des meilleurs connaisseurs
des textes grammaticaux arabes ; toutefois sa lecture restait surdéterminée par la vulgate
positiviste alors dominante, pour qui ils relevaient d’un « stade métaphysique » désormais
irrémédiablement dépassé.
20. C’est notamment en ce sens que l’emploie Jakobson (1963 : 52 et 218).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
108
RÉSUMÉS
En dépit de ressemblances superficielles, la phrase nominale (jumla ismiyya) de la tradition
grammaticale arabe n’a que peu à voir avec ce qu’il est convenu de nommer ainsi en linguistique
générale depuis au moins Meillet (1906). Elle ne se caractérise pas par l’absence de verbe ou de
copule, mais par une structure thème + propos (mubtadaʾ + ḫabar), et regroupe un ensemble assez
consistant de faits, tout en permettant d’en donner une explication cohérente. Cet article étudie
la manière dont ces faits sont présentés et analysés dans un ensemble de grammaires produites
en Europe depuis le XVIIe siècle jusqu’à nos jours, posant le problème de l’inter-traductibilité des
catégories linguistiques d’une tradition à l’autre.
In spite of superficial similarities, the nominal sentence (jumla ismiyya) according to the Arabic
grammatical tradition has little if anything to do with what is usually called by this name in
general linguistics since Meillet (1906). It is not characterized by the lack of any verb or copula,
but by a topic + predicate (mubtadaʾ + ḫabar) structure, and covers a substantial set of facts, while
explaining them in a self-consistent way. This paper discusses how these facts are presented and
analyzed in a set of Arabic grammars written in Europe from the 17th century to the present day,
raising the issue of the inter-translatability of linguistic categories from one tradition to another.
INDEX
Mots-clés : Badawi (Elsaid), Blachère (Régis), Carter (Michael), Caspari (Carl Paul), Erpenius
(Thomas), Ewald (Georg Heinrich), Gaudefroy-Demombynes (Maurice), grammaires européennes
de l’arabe, Gully (Adrian), jumla ismiyya, Martellotto (Francesco), phrase nominale, Reckendorf
(Hermann), Silvestre de Sacy (Antoine-Isaac), tradition grammaticale arabe, Wright (William)
Keywords : Arabic grammars in Europe, Arabic grammatical tradition, Badawi (Elsaid), Blachère
(Régis), Carter (Michael), Caspari (Carl Paul), Erpenius (Thomas), Ewald (Georg Heinrich),
Gaudefroy-Demombynes (Maurice), Gully (Adrian), jumla ismiyya, Martellotto (Francesco),
nominal sentence, Reckendorf (Hermann), Silvestre de Sacy (Antoine-Isaac), Wright (William)
AUTEUR
JEAN-PATRICK GUILLAUME
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, Histoire des théories linguistiques (UMR 7597 HTL), Paris,
France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
109
Varia
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
110
Le problème des mots simples issus
de composés privatifs.
Contribution à l’étude sur la formation des mots chez les grammairiens
anciens
Lionel Dumarty
1 Présentation : la théorie de la formation des mots
chez les anciens
1 Bien qu’elle n’ait jamais, dans l’Antiquité, fait l’objet d’une étude séparée, autonome et
systématique, la théorie de la formation des mots semble assez bien établie chez les
grammairiens anciens, d’après les témoignages dont nous disposons. Selon la Technè
grammatikè attribuée à Denys le Thrace, les grammairiens alexandrins distinguaient
deux modes de formation des mots, la dérivation et la composition, qu’ils
répertoriaient comme des « accidents » (παρεπóµενα) de la forme : 1) l’espèce (εἶδoς)
pour la dérivation ; 2) la figure (σχῆµα) pour la composition.
2 L’objet de cette contribution n’est pas de proposer une nouvelle analyse détaillée de
l’ensemble des théories de la formation1 ; il s’agit d’étudier un phénomène isolé, celui
des mots issus de composés privatifs, qui soulève un ensemble de problèmes touchant
la formation par composition. D’après un rapprochement étymologique établi par les
scholiastes, la figure désigne la forme du mot en tant qu’elle donne accès au sens, le
terme σχῆµα renvoyant à la relation (σχέσις) ad hoc entre une forme et sa signification 2.
Suivant une méthode héritée des premiers descripteurs de la langue, qui analysaient
déjà le mot comme une partie susceptible d’être divisée en unités de sens 3, les
grammairiens cherchent alors à déterminer combien d’unités lexicales signifiantes
(une, deux ou plusieurs) peut contenir un mot4. Ils distinguent ainsi trois sous-
catégories de la figure : le simple (ἁπλoῦν), le composé (σύνθετoν) et le dérivé de
composé (παρασύνθετoν). Le composé, la « figure par excellence 5 », est défini par les
commentateurs comme « un mot résultant de la réunion de deux ou plusieurs mots
concevables6 séparément, mais réunis sous un unique accent et s’appliquant à un
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
111
unique référent7 » (par ex., ϕίλoς ‘ami’ + σoϕóς ‘sage’ → ϕιλóσoϕoς ‘philosophe’). Le
simple n’a pas de définition propre, il n’est que le contraire du composé : un mot qu’on
ne peut subdiviser en unités lexicales concevables séparément 8. Quant au dérivé de
composé, il ne se définit pas autrement que comme un dérivé dont la base est un
composé9 (par ex., le comparatif ϕιλoσoϕώτερoς ‘plus philosophe’) et il s’analyse donc
formellement comme un composé10.
3 Comme on le voit, concernant la figure, l’approche des grammairiens est purement
analytique et synchronique : ils n’explorent pas la syntaxe interne des composés et se
contentent de descriptions en termes morphologiques11. En outre, ils ne disent rien des
procédés de formation. C’est sur ce dernier point que je voudrais porter mon attention.
En effet, d’après un double témoignage précis et longuement argumenté d’Apollonius
Dyscole, grammairien alexandrin du IIe siècle apr. J.-C., il existerait dans la langue
(grecque) de nombreux mots simples issus de mots composés, c’est-à-dire des mots
formés à partir d’un composé par suppression de l’une de ses parties. Ce témoignage
d’Apollonius, unique en son genre, intervient dans le cadre d’une controverse sur le
mérisme – i.e. la détermination du statut grammatical – de certaines formes,
« signalées » comme irrégulières, à cause de leur accentuation (motif fréquent
d’irrégularité). Le grammairien entend ramener ces formes à la régularité par une
hypothèse de formation surprenante : ce seraient des mots simples issus de mots
composés. La question se pose alors de savoir si cette hypothèse de formation, pour le
moins contre-intuitive, n’est qu’un artifice argumentatif parmi d’autres, visant à
justifier l’irrégularité pour sauver, par tous les moyens, la logique de la langue, ou si
elle s’inscrit dans le cadre d’une authentique théorie de la formation des mots – et s’il
faut alors tenir ce témoignage pour l’un des rares vestiges d’une réflexion plus
générale, aujourd’hui perdue, sur les procédés de formation.
2 Du composé au simple : état de la question
4 Les grammairiens anciens ne s’accordent pas sur le statut de la forme ἕκητι (‘à cause
de’) : certains y voient une conjonction causale12, d’autres un adverbe. Apollonius
arbitre le débat et tranche à deux reprises, dans le traité Des adverbes et dans le traité
Des conjonctions13, en faveur du statut adverbial. Selon lui, la réponse est sans appel, car
il existe un composé privatif ἀέκητι (‘en dépit de’). Or, s’il est possible de construire un
adverbe avec l’ἀ privatif, cela ne se produit jamais avec une conjonction 14. Il faut
préciser que, pour les anciens, le « (mot) privatif » ἀ (στερητικóν [µóριoν], στερητικὴ
ϕωνή, στέρησις15) est un adverbe de plein droit (cf. Chœroboscus, GG IV 1, 187, 33), au
même titre que la négation oὐ ‘non, ne… pas’, et qui a la particularité de se construire
uniquement en composition (cf. Adv. 134, 12). Or certains grammairiens 16 soutiennent
que les formes ἕκητι et ἀέκητι ont une accentuation fautive, puisque les adverbes en -τί
ou en -στί (comme ἀκoνιτί ‘sans combattre’, ἑλληνιστί ‘en grec’ etc.) sont oxytons17.
Apollonius rejette cet argument et consacre l’essentiel de son exposé à démontrer que
ces deux formes ont, au contraire, une accentuation parfaitement régulière. Voici, en
bref, sa démonstration :
5 1) Ἀέκητι ne peut pas être un composé privatif de ἕκητι, puisque tous les adverbes
formés d’un ἀ privatif sont des dérivés de composé (παρασύνθετα) 18 – par ex., ἀϕίλως
‘inamicalement’ n’est pas un composé de ἀ‑ ‘in-’ et de l’adverbe ϕίλως ‘amicalement’,
mais un dérivé de l’adjectif ἄϕιλoς ‘inamical’19. 2) De même qu’on a formé de nombreux
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
112
adverbes déverbatifs en -στί (par ex., ἑλληνίζω ‘je parle grec’ → ἑλληνιστί ‘en grec’,
ἰάζω ‘je parle ionien’ → ἰαστί ‘en ionien’ etc.), de même, c’est à partir du verbe composé
privatif ἀεκάζω ‘je ne consens pas (?)’20 qu’on a dérivé, par analogie, la forme
adverbiale ἀεκαστί, qui, après quelques transformations morphologiques dialectales
(changement ionien de l’α en η et chute du σ), a donné la forme ἀέκητι. Celle-ci n’a pas
conservé l’accent propre au type des adverbes en -στί, auquel elle n’est désormais plus
formellement identifiable21. 3) Pour prouver ensuite la régularité accentuelle de ἕκητι,
Apollonius pose qu’il est possible de tirer une forme simple d’un mot composé. Or, s’il
provient de ἀέκητι (par suppression de l’ἀ privatif) 22, il est tout à fait normal que ἕκητι
conserve l’accent de la forme dont il est issu23.
6 À partir de ce point, l’essentiel de la démonstration (Adv. 135, 21-137, 19 24) consiste à
montrer, à grands renforts d’exemples, qu’un tel procédé de formation, a priori contre-
intuitif, non seulement n’a rien d’extraordinaire, mais est au contraire d’un usage tout
à fait courant.
2.1 Le composé préexiste parfois au simple. Exemples
extralinguistiques
7 Dans un premier temps, Apollonius dénonce une δóκησις, une « idée répandue », selon
laquelle ce sont toujours les mots composés qui proviennent des mots simples, et
jamais l’inverse.
Δóκησιν µὲν ἔχει πρoϋπάρχoυσαν τoῦ ἀέκητι, καθὸ τὰ ἁπλᾶ πρoϋϕέστηκε τῶν
συνθέτων. Ἀλλ’ ἔστι γε ἀπoδεῖξαι πάµπoλλα ἁπλᾶ ἀπὸ συνθέτων γεγoνóτα ὡς ἔστι
γε ἐπινoῆσαι καὶ ἐπὶ τῶν κατὰ σύµπηξιν σωµάτων ἀπoβoλάς τινων µερῶν,
ἁπλóτητoς µὲν ἐχoµένας, δηλoύσας δὲ τήν πoτε γενoµένην αὐτoῖς σύµπηξιν, ὡς εἰ
κλινιδίoυ πoὺς ἤ τι τoιoῦτoν µερικóν. Τὸ ὑπóδειγµα ἐπὶ πoλλὰ συντείνει. Ἔστιν
oὖν τις τρóπoς καὶ τoιoῦτoς ἐν λέξεσιν, ὃς δoκεῖ µὲν ἁπλoῦς εἶναι, ὑπóµνησιν δὲ
ἔχει τoῦ ἐκπεπτωκέναι ἐκ συνθέτoυ λέξεως. (Adv. 135, 21-136, 4)
On pense couramment qu’il (sc. ἕκητι) est antérieur à ἀέκητι, puisque les mots
simples préexistent aux composés. En réalité, on peut tout à fait démontrer qu’un
très grand nombre de mots simples proviennent de composés, tout comme on peut
aussi, quand il s’agit des corps qui sont formés par assemblage, concevoir des
parties isolées qui, tout en étant simples, nous révèlent l’assemblage dont elles ont
été les éléments, comme un pied de lit ou quelque partie de ce genre. L’exemple
s’applique à de nombreux cas. Ce phénomène existe aussi dans le lexique, où [une
forme] est simple en apparence mais garde la mémoire du mot composé dont elle
s’est détachée.
8 Ce premier point est délicat et mérite qu’on s’y arrête. Apollonius réfute très
clairement l’idée reçue (δóκησις) selon laquelle un mot simple précède forcément le
mot composé dont il est lui-même, par ailleurs, un élément constitutif, et qui est
formulée incidemment dans une scholie à la Technè, dans des termes très proches de
ceux de notre passage : « Les simples précèdent (πρoτερεύoυσι) les composés ; de fait
l’existence du simple σoϕóς précède l’existence du composé ϕιλóσoϕoς25. » L’erreur
serait de croire qu’Apollonius cherche à remettre en cause ici un principe ontologique
élémentaire, qui veut que la partie préexiste au tout. Aussi, afin de dissoudre tout
malentendu, le grammairien fait-il, contre ses habitudes 26, un détour hors du champ de
la langue et recourt à une métaphore (le « pied de lit ») pour établir une analogie : on
peut concevoir l’existence de corps « formés par assemblage », dont les parties, si on les
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
113
isole, ne sauraient être perçues, dans leur simplicité, autrement que comme des
éléments relatifs au tout dont elles participent – et c’est à cette condition qu’on dit que
le tout leur préexiste. Autrement dit, Apollonius ne prétend pas que le lit précède
(ontologiquement) le pied dont il est constitué ; il veut dire que, isolément, le pied de lit
ne doit son identité propre que relativement au tout dont il a été abstrait – comme son
nom l’indique : κλινιδίoυ πoύς « pied de lit ». On retrouve, bien plus tard, exactement le
même raisonnement chez Chœroboscus, grand lecteur d’Apollonius, à propos de la
forme δέσπoτα (tirée, selon lui, du composé ἀδέσπoτα). Les métaphores produites par le
maître byzantin apportent, comme souvent, un éclairage supplémentaire :
Τὸ µέντoι ἀπὸ συνθέτoυ γίνεσθαι ἁπλoῦν oὐκ ἔστι ξένoν · ἔχoµεν γὰρ τoῦτo καὶ
ἐπὶ ϕυσικῶν πραγµάτων, ὥσπερ ἀπὸ δένδρoυ ἐάν τις ἀπoσπάσῃ κλάδoν, γίνεται
ἁπλoῦν ἀπὸ συνθέτoυ, καὶ ἐὰν ἀπὸ ζῴoυ ἀπoσπάσῃ τις χεῖρα ἢ πóδα, γίνεται
ὁµoίως ἀπὸ συνθέτoυ ἁπλoῦν. (GG IV 1, 392, 15-19)
Car, oui, qu’il (sc. δέσπoτα) provienne d’un composé n’a rien d’insolite. En effet, on a
cela également dans la nature, comme lorsqu’on retranche une branche à un arbre,
le simple vient du composé, et lorsqu’on retranche une main ou un pied à un vivant,
on a pareillement un simple tiré d’un composé.
9 Là encore, point de branche d’arbre sans un arbre, point de main, point de pied sans un
être vivant. Étendu au domaine linguistique, le raisonnement vise à montrer qu’il existe
des mots simples qui, de même que le pied de lit pour le lit ou la branche d’arbre pour
l’arbre, « gardent la mémoire (ὑπóµνησιν ἔχει) d’un composé dont ils se sont écartés »
(Adv. 136, 2).
2.2 Application au champ linguistique : ἠνoρέα
10 Apollonius commence par l’analyse d’un cas. Il n’est pas possible d’expliquer la
formation du nom ἠνoρέα ‘virilité’, si on part du principe qu’il est dérivé du nom
simple ἀνήρ ‘homme’, car celui-ci, d’après son type morphologique, ne pourrait
produire que la forme *ἀνερία – comme αἰθήρ produit αἰθερία etc. En revanche, comme
élément de composition, ἀνήρ subit une double altération : l’α initial se transforme en
η et l’η en ω : par exemple ἀντ-ήνωρ (ἀντί ‘à-la-place-de’ + ἀνήρ : ‘qui tient lieu
d’homme’), ἀγαπ-ήνωρ (ἀγαπάω ‘chérir’ + ἀνήρ : ‘qui chérit l’homme’) ou encore εὐ-
ήνωρ (εὐ ‘bien’ + ἀνήρ : ‘qui convient à l’homme’). Et c’est de cette dernière forme
qu’on a dérivé le nom εὐηνoρία ‘virilité’, altéré d’abord en εὐηνoρέα, puis en ἠνoρέα,
par ellipse (ἔλλειψις) du premier élément de composition 27.
2.3 Exemples homériques
11 Apollonius cite ensuite de nombreux exemples, tirés des textes d’Homère, afin de
montrer que, loin d’être un phénomène isolé, le procédé est tout à fait « courant 28 ». Il
commence par signaler d’autres mots simples, qui, comme ἠνoρέα, ont perdu l’adverbe
εὖ, premier élément de composition : dans κρητῆρα τετυγµένoν29 « un cratère
ouvragé », τετυγµένoν signifie εὖ τετυγµένoν ‘bien ouvragé’ ; de même, dans δóµoις ἔνι
πoιητoῖσι30 « dans les maisons construites », l’adjectif πoιητóς signifie εὖ πεπoιηµένoις
‘ayant été bien construites’. Il montre ensuite que la partie ellipsée peut appartenir à
une autre catégorie que l’adverbe et peut être, par ex., une préposition ou un nom. Une
préposition : ἔρχεσθε, dans ἀλλ’ ὑµεῖς ἔρχεσθε31, a le sens du composé ἀπέρχεσθε
(ἀπó + ἔρχεσθε), « mais vous, allez (= allez -vous-en) » ; ἔχoυσαι, dans πικρὰς ὠδῖνας
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
114
ἔχoυσαι32, signifie ἐπέχoυσαι (ἐπί + ἔχoυσαι), « qui ont (= soulagent) des douleurs
amères » ; ἐν πύλῳ, dans ἐν πύλῳ ἐν νεκύεσσι 33, signifie ἐν πρoπύλῳ, « à la porte
(= l’avant-porte), au milieu des morts ». Un nom : γείτoνες ‘voisins’, dans oἵ σϕιν
γείτoνες ἦσαν34, a le sens de ἀστυγείτoνες (ἄστυ ‘cité’ + γείτoνες), « ceux qui étaient
leurs voisins (= voisins -de-cité) ». Enfin, il arrive aussi que le composé produise un
simple par ellipse du second élément de composition. Dans πάρα δ’ ἀνήρ, ὃς
καταθήσει35, la forme πάρα vaut pour πάρεστι, « ici (= ici -est) un homme qui
l’installera » ; de même, ἄνα, dans ἀλλ’ ἄνα, εἰ µέµoνάς γε 36, est mis pour ἀνάστηθι,
« eh bien debout (= mets-toi-debout), si du moins tu le veux ».
3 Des mots simples « en apparence »
12 Comme l’annonçait Apollonius au début de son exposé (Adv. 136, 2‑4), toutes ces formes
sont « simples en apparence », car elles ont, comme ἠνoρέα, gardé la mémoire
(ὑπóµνησις) du composé dont elles proviennent. Mais que signifie « garder la mémoire
du composé » – et, surtout, qu’est-ce que cela implique ? Dans le traité Des adverbes, on
doit se contenter d’une longue liste d’exemples ; dans le traité Des conjonctions, en
revanche, le grammairien ajoute, avant l’exposé sur ἠνoρέα, un passage fameux, dans
lequel il explique très clairement la nature du phénomène auquel correspond cette
transformation des composés en simples :
[…] καὶ δῆλoν ὅτι τὸ πάθoς ὑπαντᾷ τῇ καλoυµένῃ ἀϕαιρέσει · ὃν γὰρ τρóπoν ἐπὶ
τῶν ἁπλῶν σχηµάτων37 τὸ λειπóµενoν πάντως τoῦ ὅλoυ δηλoυµένoυ ἐστὶ
παραστατικóν, τὸν αὐτὸν τρóπoν τὸ λειπóµενoν ἁπλoῦν δηλώσει τoῦ ὅλoυ τὴν
σύνθεσιν ἐκ τoῦ δηλoυµένoυ, ἐπεὶ τὸ ἀϕῃρηµένoν ἐν λεκτῷ καθίσταται. ( Conj. 232,
23-233, 2)38
Il est clair que cette modification (τὸ πάθoς) (i. e. la formation de simples à partir de
composés) fait écho au [phénomène] qu’on appelle « aphérèse ». En effet, de la même
manière que, dans le cas de formes simples, ce qui reste [après aphérèse] exprime
totalement le sens du mot complet, de même, le simple qui reste (après suppression
de l’autre élément de composition) indiquera la composition tout entière, par son sens,
puisque la partie supprimée se maintient dans le signifié (ἐν λεκτῷ).
13 D’un emploi bien réglé chez les grammairiens anciens, le terme ἀϕαίρεσις désigne, chez
Apollonius, une altération formelle du mot (πάθoς)39 par suppression d’un segment –
tendanciellement le début du mot, en particulier lorsqu’il s’oppose à l’apocope
(ἀπoκoπή), désignation spécifique de l’ellipse de la finale 40. Dans notre passage,
ἀϕαίρεσις s’entend au sens large, puisque l’on compte, parmi les exemples de mots
formés par aphérèse, des formes apocopées, telles que πάρα (pour πάρεστι) et ἄνα (pour
ἀνάστηθι).
14 Qu’est-ce qui distingue l’aphérèse affectant un mot simple de l’aphérèse affectant un
mot composé ? Si on s’en tient strictement à la structure du mot, l’aphérèse du mot
composé est différente, puisque c’est un mot entier (λέξις), i.e. l’une des deux parties
« concevables isolément » dans le composé41, qui est ellipsé, et non pas seulement,
comme pour un mot simple, une syllabe (συλλαβή)42. Sur le plan sémantique, en
revanche, ce passage dit clairement qu’il en va pour l’aphérèse dans les mots composés
comme dans les mots simples : dans les deux cas, la partie (τὸ λειπóµενoν « ce qui
reste », i. e. la forme altérée) garde le sens (δηλoύµενoν) du tout (τὸ ὅλoν, i.e. la forme
intègre)43. Les termes sont, on le voit, exactement les mêmes pour l’aphérèse du simple
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
115
comme pour celle du composé, à ceci près que, dans ce dernier cas, c’est la composition
(σύνθεσις) qui détermine le sens du tout – ce qui nous renvoie encore à la définition du
composé (καθ’ ἑνὸς ὑπoκειµένoυ « [appliqué] à un unique référent »). Enfin, la formule
conclusive, τὸ ἀϕῃρηµένoν ἐν λεκτῷ καθίσταται « la partie supprimée se maintient
dans le signifié44 », qui vise à justifier (ἐπεί…) ce trait morphosémantique, n’est autre
que l’énoncé d’une règle qui est au fondement de la pathologie grammaticale (théorie
des altérations45), règle maintes fois rappelée par Apollonius46, en vertu de laquelle une
altération affecte la forme d’un mot sans affecter son sens.
15 Le propre d’une forme altérée, c’est qu’elle n’est précisément qu’une variante
morphologique, puisqu’elle garde le sens qu’elle avait avant l’altération. C’est donc ainsi
qu’il faut comprendre que la forme simple « garde la mémoire du mot composé dont
elle s’est écartée » (cf. Adv. 136, 2, cité ci-avant) : la partie ôtée du composé est restée
dans le simple, pour le sens (ἐν λεκτῷ)47. Par conséquent, le reste de la formule, « [une
forme] est simple en apparence », se comprend bien : ces mots simples issus de
composés par aphérèse ne sont que des apparences de mots simples, puisque, pour le
sens, ce sont toujours des composés.
16 Ce passage nous invite à rappeler que, si la langue peut être appréhendée du point de
vue de la forme comme du point de vue du sens, chez Apollonius, c’est toujours le sens
qui constitue le critère normatif, au niveau du mot (λέξις) comme au niveau de l’énoncé
(λóγoς)48. Ainsi, c’est le sens et non la forme qui établit les rapports syntaxiques et
fonde les parties du discours49. On peut donc observer, à un autre niveau, des
irrégularités apparentes semblables à celle décrite dans ce passage. Par exemple, à
propos des adverbes qui ne se construisent pas avec un verbe (comme les interjections
ou certaines exclamations), Apollonius dit là aussi que ce n’est qu’en apparence que le
verbe est absent, car, au niveau du sens, il y a toujours un acte verbal (πρᾶγµα), auquel
se rapporte nécessairement l’adverbe, et sans lequel l’énoncé ne peut qu’être
incomplet50. Suivant la même logique, Apollonius affirme qu’un mot peut être « simple
en apparence » (ὃς δoκεῖ µὲν ἁπλoῦς εἶναι), tout en restant, dans sa structure
profonde (i.e. au niveau sémantique), un composé.
4 Ἕκητι : un mot formé « par figure » ?
17 Cela étant, lorsqu’on se demande s’il en va pour ἕκητι comme pour les autres simples
issus de composés par aphérèse, on se heurte à un obstacle, puisque, contrairement à
l’ensemble des formes citées en exemples précédemment, le simple ἕκητι (‘à cause de’)
n’a pas gardé le sens du composé ἀέκητι (‘en dépit de’). Il est donc impossible
d’affirmer, pour ἕκητι, ce qu’on affirmait plus haut pour ἠνoρέα, à savoir que la partie
supprimée reste au niveau du signifié, la suppression (ἀϕαίρεσις) du privatif ἀ ayant
entraîné un renversement du signifié du composé. La formation de ἕκητι s’apparente de
facto à ce qu’on peut imaginer que serait une authentique dé-composition 51 – c’est-à-dire
la formation d’un simple par dissolution du composé suivant le processus inverse de
celui qui est à l’œuvre dans la formation du composé (réunion de mots simples en un
tout). Car alors, comme le composé est porteur d’un signifié propre, il est normal que le
simple formé par « dé-composition » soit lui-même porteur d’un sens différent de celui
du composé dont il provient.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
116
18 Le seul témoignage qui, à ma connaissance, aille a priori dans le sens de cette hypothèse,
nous vient d’un fragment d’Hérodien (le fils d’Apollonius Dyscole). Voici ce qu’il affirme
à propos de la formation du nom δάκρυ ‘larme’ :
Δάκρυ oὐ γέγoνεν ἀπὸ τoῦ δάκρυoν κατ’ ἀπoκoπήν, ἀλλὰ κατὰ σχηµατισµóν.
Ἔστι γὰρ ἀπὸ συνθέτoυ λέξις ἁπλῆ. Ἔστι γὰρ ἀρίδακρυς πoλύδακρυς ἀρίδακρυ
πoλύδακρυ καὶ δάκρυ. Οὕτως Ἡρωδιανὸς Περὶ παθῶν. (GG III 2, 211, 3)
Δάκρυ n’est pas issu par apocope de δάκρυoν [larme] ; il est formé par figure (κατὰ
σχηµατισµóν). En effet, c’est un mot simple issu d’un composé : on a ἀρίδακρυς [aux
larmes-abondantes] ou πoλύδακρυς [même sens], [puis les neutres] ἀρίδακρυ ou
πoλύδακρυ, puis δάκρυ. Voilà ce que dit Hérodien dans son traité Des altérations.
19 Bien qu’il manque un contexte pour expliquer la position d’Hérodien soutenant cette
étymologie un peu surprenante, on peut tirer de ce fragment quelques observations : 1)
Hérodien décrit explicitement la formation d’un mot simple à partir d’un mot composé
(ἀπὸ συνθέτoυ λέξις ἁπλῆ) ; 2) cette modification du composé en simple appartient à
un certain type de formation, dit « κατὰ σχηµατισµóν », qui se distingue de la
formation κατ’ ἀπoκoπήν, i.e. par altération52 ; 3) s’agissant précisément de la
formation d’un simple à partir d’un composé, il semble que le terme σχηµατισµóς
renvoie ici spécifiquement à l’accident de la figure (σχῆµα) 53 – le mot δάκρυ est formé
« κατὰ σχηµατισµóν » parce qu’il change de figure, passant du composé (ἀρίδακρυ ou
πoλύδακρυ) au simple (δάκρυ) ; 4) on peut, enfin, opposer au κατὰ σχηµατισµóν
d’Hérodien, qui est un hapax, l’expression κατὰ πάθoς, très fréquemment employée
chez les grammairiens anciens, et en particulier chez le même Hérodien, pour qualifier
toute formation « par altération ». Ainsi, contrairement à la forme altérée qui n’a aucun
signifié propre, puisqu’elle renvoie à un autre signifiant (la forme intègre) 54, la figure
(σχῆµα) est porteuse d’un sens propre. Voilà en quoi l’on peut dire aussi, peut-être, que
la figure est une forme « qui donne accès au sens », pour reprendre la définition du
scholiaste (citée plus haut)55.
20 Il faudrait donc établir la même distinction entre le simple ἕκητι et toutes les formes
données en exemples par Apollonius : ἠνoρέα, γείτoνες, ἄνα et les autres formes
homériques renvoient forcément, en tant que formes altérées, au signifié d’une forme
intègre (εὐηνoρία, ἀστυγείτoνες, ἀνάστηθι). L’adverbe ἕκητι, qui, en revanche, n’est
pas une simple variante morphologique, a un sens propre, différent de celui de sa base.
5 Peut-on justifier la position d’Apollonius ?
21 Dans les deux passages de son corpus où il est question de la formation d’ἕκητι,
Apollonius ajoute une courte série d’exemples visant à illustrer la formation de mots
simples à partir de composés privatifs : ϕρoνεῖν, ψευδής et σαϕής sont alors, selon lui,
respectivement formés à partir des composés privatifs ἀϕρoνεῖν, ἀψευδής et ἀσαϕής.
Or, dans le traité Des conjonctions, ces exemples n’ont pas statut d’exceptions ; au
contraire, ils sont mêlés aux exemples homériques, censés illustrer l’ellipse dans un
composé quelconque :
Εἰς τὸν τoιoῦτoν λóγoν καὶ ἄλλα πλεῖστα ἔστι παραθέσθαι. Τὸ γὰρ ϕρoνεῖν ἢ
ψευδής ἢ σαϕής oὐκ ἄλλως ἂν κατασταίη, εἰ µὴ δoθείη ὅτι δεύτερα εἴη τῶν
καλoυµένων συνθέτων. Καὶ τὸ ‘ἀλλ’ ἄνα, µηκέτι κεῖσo’ (Σ 178) καὶ τὸ ‘πάρα δ’
ἀνήρ’ (π 45) εἰς τὸ αὐτὸ συναχθήσεται. (Conj. 233, 13 sq.)
Pour illustrer cette règle, on peut exhiber une foule d’autres exemples. Φρoνεῖν,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
117
ψευδής et σαϕής ne sauraient être formés d’une autre manière, si on ne concède pas
que ce sont des formes secondes issues d’ensembles dits composés. Il y a aussi [ἄνα,
dans] ἀλλ’ ἄνα, µηκέτι κεῖσo, et [πάρα, dans] πάρα δ’ ἀνήρ, qu’on rapportera au
même [procédé] [= ἀνάστηθι et πάρεστι].
22 Dans cet extrait, Apollonius semble confirmer ce qu’il disait plus haut (Conj. 232, 23 sq.),
à savoir que l’aphérèse qui affecte le composé privatif s’apparente à un πάθoς.
23 Dans le traité Des adverbes, en revanche, il en va autrement. Les trois formes, ϕρoνεῖν,
ψευδής et σαϕής, ne sont pas citées pêle-mêle avec d’autres exemples, mais sont
regroupées dans une liste à part et font l’objet d’une étude spécifique, dans une
deuxième partie de la démonstration.
24 Cette seconde partie fait pendant à la première, comme on le voit notamment dans la
formule d’introduction de l’analyse de ϕρoνεῖν ‘avoir sa raison’ (136, 28 « là encore, le
verbe ϕρoνῶ ne sera pas non plus bien formé (oὐδὲ… πάλιν… συστήσεται) »), qui
répond à la formule qui introduisait précédemment l’analyse de ἠνoρέα (136, 5
« ἠνoρέα, tant qu’il sera conçu comme mot simple, ne sera pas bien formé (oὐ
καταστήσεται) »). La démonstration, qui vise le même objectif – montrer qu’il s’agit d’un
mot simple issu d’un dérivé de composé –, reproduit scrupuleusement l’ordre
d’exposition de la première partie : 1) rejet de la formation communément admise :
certains ont cru à tort que ϕρoνῶ était dérivé du verbe ϕρενῶ ‘je ramène à la raison’,
par changement de l’ε en o – or ce phénomène ne se produit qu’à partir de verbes
barytons (i.e. non contractes), comme ϕέρω ‘je porte’, πέρθω ‘je détruis’, νέµω ‘je
partage’, qui ont donné respectivement les variantes ϕoρῶ, πoρθῶ, νoµῶ ; 2)
établissement de la forme correcte : en composition, ϕρήν ‘esprit’ change son η en ω,
donnant ainsi des mots comme ἄϕρων ‘déraisonnable’, dont on a dérivé le verbe
ἀϕρoνῶ ‘je suis déraisonnable’ 56. Et c’est de ce verbe qu’est issu, par suppression de l’ἀ
privatif, ϕρoνῶ. Pour clore sa démonstration, Apollonius suggère qu’on pourrait faire
le même « examen approfondi » pour les formes ψευδής ‘menteur’ et σαϕής ‘distinct’,
qui sont elles-mêmes issues des composés privatifs ἀψευδής ‘non-menteur’ et ἀσαϕής
‘indistinct’57.
25 Cette double structure argumentative et cette répartition raisonnée des exemples, si
elle met l’accent sur les similitudes structurelles, témoigne à coup sûr d’une volonté de
distinguer l’aphérèse dans les composés à premier élément privatif de celle qui affecte
les autres composés ou composés positifs.
6 Le statut marginal du privatif
26 À la fin de son exposé sur la formation de ϕρoνῶ, dans le traité Des adverbes, Apollonius
propose une définition du composé privatif, à laquelle il convient de prêter attention,
car elle fournit de précieux indices pour cerner la démarche du grammairien :
Ἐπεὶ δὲ τὰ ἐν στερήσει παραλαµβανóµενα καὶ ἐν καταϕάσει παραλαµβάνεται,
ἀϕαιρoυµένης τῆς στερήσεως, τὸ ϕρoνῶ ἐγίνετo εἰς κατάϕασιν τoῦ ἀντικειµένoυ
τoῦ ἀϕρoνεῖν. (Adv. 137, 5-7)
Puisque les composés privatifs sont également employés avec un sens affirmatif,
pour peu qu’on retranche le privatif [ἀ], on a fait ϕρoνῶ pour affirmer le contraire
de ἀϕρoνεῖν.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
118
27 Si la fin de cette citation correspond bien à ce qu’on attend d’une définition de la
privation – le simple positif affirme le contraire (τὸ ἀντικείµενoν) du composé
privatif – on est gêné, en revanche, par la première partie de la définition, qui, dans une
formulation un peu malaisée, se contente de réaffirmer que, contre l’opinion commune,
on forme aussi des simples positifs (ἐν καταϕάσει) à partir de composés privatifs (τὰ ἐν
στερήσει) par suppression de l’ἀ privatif (ἀϕαιρoυµένης τῆς στερήσεως).
28 Sur ce point, Apollonius ne veut probablement pas en dire davantage. Toutefois, cette
définition révèle quelque chose de la nature spécifique du composé privatif. En
affirmant que le signifié du composé est, à la privation près, celui du simple parce que la
privation est entièrement contenue dans le composant privatif ἀ, il dit aussi que
chacune des parties du composé privatif (le simple et le composant privatif) continue
de signifier par elle-même dans le composé – ce qui est contraire à la définition du
composé58. Cette idée est formulée plus explicitement encore dans le traité Des
conjonctions :
Ἀλλὰ πάλιν ἦν ἐκεῖνo ἀδύνατoν τὸ µὴ εἰς ταὐτὸν εἶδoς παραλαµβάνεσθαι τὸ ἐν
στερήσει παραλαµβανóµενoν µέρoς λóγoυ, ϕυλάττoν τὴν αὐτὴν κατάληξιν καὶ τὸ
αὐτὸ δηλoύµενoν, αὐτὸ µóνoν τῆς στερήσεως περιττευoύσης. (Conj. 231, 16-19)
Mais, au contraire, il n’est pas possible de ne pas accueillir dans la même espèce la
partie de phrase qui est employée (παραλαµβανóµενoν) « au privatif » 59, attendu
qu’elle conserve la même finale et le même signifié (τὸ αὐτὸ δηλoύµενoν), avec
seulement [l’indice de] la privation en plus.
29 Le composé privatif garde le signifié (δηλoύµενoν) du simple, auquel il « adjoint en
plus » (περιττευoύσης)60 la notion de privation. Dans cette définition, on note d’ailleurs
l’absence du terme « composé » (σύνθετoν) – il n’est plus question que d’un mot
(simple) « employé “au privatif” » ; et il en va de même en Adv. 137, 5, qui se laisse
traduire littéralement ainsi : « les mots employés “au privatif” (τὰ ἐν στερήσει
παραλαµβανóµενα) sont employés “au positif” (ἐν καταϕάσει παραλαµβάνεται) une fois
l’élément privatif supprimé ». Le composé privatif et son simple (positif) n’étant pas
tant conçus comme deux mots différents, appartenant à deux figures différentes, que
comme deux emplois d’un seul et même mot, la relation des éléments {privatif
ἀ + simple} s’apparente davantage à une structure juxtapositive du type {négation
oὐ + X}. De fait, pour Apollonius61, le privatif ἀ ‘in-’ et la négation oὐ ‘ne… pas’ ne
diffèrent l’un de l’autre que du point de vue du mode de construction : tandis que la
négation oὐ se construit avec un mot ou un groupe de mots par juxtaposition, le
privatif ἀ se construit toujours en composition avec un mot unique 62. En revanche, au
plan fonctionnel, les deux adverbes63 sont complètement assimilés l’un à l’autre :
Ἐπὶ καταϕάσει τινῶν τὰ τoιαῦτα µóρια παραλαµβάνεται εἰς ἀναίρεσιν τῆς
καταϕάσεως. (Adv. 133, 24-25)
Appliqués à une affirmation, ces mots (sc. les adverbes de privation et de négation)
sont employés pour abolir l’affirmation64.
30 Ils sont assimilés au point qu’on substitue volontiers le privatif à la négation, lorsque
celle-ci porte sur un mot unique :
Ἡ oὔ ἀπóϕασις, ἀναιρoῦσά τινα µέρη λóγoυ, καὶ εἰς τὴν α µεταλαµβάνεται
στέρησιν, oὐ ϕίλoς ἄϕιλoς, oὐ σέβω ἀσεβῶ. (Conj. 231, 26-27) 65
Lorsqu’elle annule une partie de phrase quelconque, la négation oὐ peut être
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
119
remplacée par le privatif ἀ : oὐ ϕίλoς / ἄϕιλoς [non amical / in-amical], oὐ σέβω /
ἀσεβῶ [je ne suis pas pieux / je suis im-pie].
31 Ce parallèle avec la négation permet de justifier la définition du composé privatif : de
même que la juxtaposition de la négation à un verbe ne constitue pas une entité
signifiante nouvelle et autonome mais exprime toujours le signifié du verbe avec, en
plus, l’annulation de l’affirmation que celui-ci contient 66, de même, le tout formé de la
réunion d’un simple et du privatif ne produit pas un signifié unique et nouveau, mais
continue d’exprimer le signifié du simple avec, en plus, l’indice de la privation.
32 Enfin, il est possible d’expliquer en partie la position d’Apollonius au sujet des simples
issus de composés privatifs : si c’est le même mot qui est employé tantôt au positif
tantôt au privatif, le rapprochement établi avec le πάθoς se justifie en un sens,
puisqu’une forme (intègre) et la forme altérée qui lui correspond ne sont, de la même
manière, qu’un seul et même mot (λέξις). À cet égard, il n’est pas surprenant
qu’Apollonius apparente la suppression de l’élément privatif à une aphérèse, c’est-à-
dire à une altération morphologique, dans la mesure où son δηλoύµενoν demeure après
cette suppression (Conj. 232, 23 sq., cité ci-avant : « Il est clair que cette modification fait
écho au [phénomène] qu’on appelle ‘aphérèse’… »), comme il dit, à l’inverse, que le
privatif est « ajouté en plus » (περιττευoύσα) au signifié du simple (Conj. 231, 19). D’un
emploi rare chez Apollonius, le verbe περιττεύω « adjoindre en plus, ajouter par
redondance » fait lui-même écho au phénomène qu’on appelle « pléonasme »
(πλεoνασµóς), ou altération par ajout d’un élément superflu67.
7 Conclusion : un fondement théorique ?
33 Au terme de cette enquête, il est donc possible de distinguer trois types de simples issus
de composés : 1) le simple « en apparence », formé par altération, qui conserve le signifié
du composé de base ; 2) le « dé-composé » (par figure), un simple formé par dissolution
des éléments d’un composé positif, et qui est porteur d’un signifié propre ; 3) le simple
issu de composé privatif, qui a le sens du composé privatif lui-même, dépourvu de la
privation.
34 Les distinctions d’ordre sémantique qui ressortent de ce classement n’ont pas retenu
l’attention d’Apollonius, qui n’a pas jugé utile de relever que, appliquée aux composés
privatifs, cette hypothèse de formation entrait en conflit, non seulement avec
l’altération, parce que le simple n’a pas gardé le sens du composé dont il est issu, mais
aussi avec la composition, parce que chaque partie du composé continue de signifier
par elle-même. Et pour cause, Apollonius ne cherche, dans ce chapitre, qu’à justifier
l’accentuation barytone de ἕκητι. Le reste en découle : 1) l’hypothèse de formation, qui
s’impose d’après la figure supposée du privatif ἀέκητι (dérivé de composé) : le composé
n’ayant pu être formé à partir du simple, c’est le simple qui doit être formé à partir du
composé ; 2) une analogie avec d’autres exemples apparentés – car, comme souvent,
chez Apollonius, le nombre d’exemples a force d’argument –, afin de montrer que, loin
d’être isolé, le procédé est d’un « usage courant » (chez les poètes). Or, sur le plan
strictement morphologique, l’analogie est irréfutable : ἕκητι, ἠνoρέα ou encore, si l’on
voulait, δάκρυ, sont tous des mots simples issus de mots composés par suppression de
l’un des éléments de composition68.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
120
35 Il est difficile de dire si les grammairiens anciens avaient, d’une manière ou d’une
autre, réfléchi à un tel classement. Contentons-nous de constater que, dans cet unique
témoignage, Apollonius ne s’appuie sur aucune théorie, n’invoque aucune autorité et
présente la formation des simples à partir de composés comme une hypothèse
théoriquement envisageable, afin de sauver la logique de la langue, quitte à établir, ce
faisant, des analogies dangereuses.
BIBLIOGRAPHIE
Références primaires
Les références aux textes des grammairiens et scholiastes grecs sont données dans l’édition des
Grammatici Graeci (Grammatici Graeci, recogniti et apparatu critico instructi, Leipzig, Teubner,
1878-1910), notée GG. Les traductions d’Apollonius Dyscole sont celles des éditions d’usage les
plus récentes (cf. références secondaires). Les autres traductions de grammairiens et de
scholiastes sont miennes.
Ap. Dysc. : GG II = 1. Apollonii Dyscoli scripta minora, éd. R. Schneider, 1878 ; 2. Apollonii Dyscoli de
constructione libri quattuor, éd. G. Uhlig, 1910. — Pron. : Du pronom = GG II 1, 1, p. 1-116. — Adv. : Des
adverbes = GG II 1, 1, p. 117-200. — *Adv. : Partie apocryphe du traité Des adverbes = GG II 1, 1,
p. 201-210. — Conj. : Des conjonctions = GG II 1, 1, p. 211-258. — Synt. : De la construction (Syntaxe)
= GG II 2.
Aristote, La Poétique, éd. R. Dupont-Roc et J. Lallot, Paris, Seuil, 1980 (réimpr. 2011).
Chœroboscus : GG IV 1 = Gregorii Chœrobosci prolegomena et scholia in Theodosii Alexandrini canones
isagogicos de flexione nominum, éd. A. Hilgard, 1894.
Hérodien : GG III = Herodiani Technici reliquae, éd. A. Lentz, 1867‑1870.
Sch. D. Thr. : GG I 3 = Scholia in Dionysii Thracis artem grammaticam, éd. A. Hilgard, 1901.
Technè : GG I 1 = Dionysii Thracis ars grammatica, éd. G. Uhlig, 1883.
Tryphon : Tryphonis grammatici Alexandrini fragmenta, éd. A. von Velsen, Berlin, F. Nicolai, 1853.
Références secondaires
Benveniste, É. 1974 [1966]. Formes nouvelles de la composition nominale. Dans Problèmes de
linguistique générale, vol. 2 : 161-176. Paris : Gallimard.
Blank, D. L. 1982. Ancient philosophy and grammar. The Syntax of Apollonius Dyscolus. American
Classical Studies 10. Chico (CA) : Scholars Press.
Blank, D. L. 1993. Apollonius Dyscolus. Dans Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt. Geschichte
und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung, 2, Principat, 34.1, Sprache und Literatur. Éd. W.
Haase et H. Temporini, 708-730. New York – Berlin : W. de Gruyter.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
121
Chantraine, P. 1999 [1968-1980]. Dictionnaire étymologique de la langue grecque : histoire des mots.
Avec un supplément sous la dir. de A. Blanc, Ch. de Lamberterie et J.‑L. Perpillou. Paris : Klincksieck.
Dalimier, C. 2001. Apollonius Dyscole, Traité des conjonctions. Introduction, texte, traduction et
commentaire. Paris : J. Vrin.
Desbordes, Fr. 1983. Le schéma « addition, soustraction, mutation, métathèse » dans les textes
anciens. Histoire Épistémologie Langage 5/I : 23-30.
Dumarty, L. à paraître. Apollonius Dyscole. Traité des adverbes. Introduction, texte, traduction et
commentaire. Paris : J. Vrin.
Erbse, H. 1980. Zur normativen Grammatik der Alexandriner. Glotta 58 : 236-258.
Ildefonse, Fr. 1997. La naissance de la grammaire dans l’Antiquité grecque. Histoire des doctrines de
l’Antiquité classique. Paris : J. Vrin.
Lallot, J. 1995. Analogie et pathologie dans la grammaire alexandrine. Lalies 15 : 109-123.
Lallot, J. 1997. Apollonius Dyscole, De la construction (Syntaxe). Introduction, texte, traduction, notes et
index. Paris : J. Vrin.
Lallot, J. 19982 [1989]. Denys de Thrace, La grammaire de Denys le Thrace, traduction annotée. Paris :
CNRS Éditions.
Lallot, J. 2004. Σχῆµα chez les grammairiens grecs. Dans Skhèma-Figura : formes et figures chez les
Anciens. Rhétorique, philosophie, littérature, Actes du colloque, Paris-Créteil, 27-29 mai 1999. Éd. par M. S.
Celentano, P. Chiron et M.‑P. Noël, 159-168. Paris : Éd. Rue d’Ulm.
Matthaios, S. 2008. Théories des grammairiens alexandrins sur la formation des mots. Dans
Regards croisés sur les mots non simples. Éd. par B. Kaltz, 35-49. Langages. Lyon : ENS Éditions.
Sluiter, I. 1990. Ancient Grammar in Context. Contributions to the Study of Ancient Linguistic Thought.
Amsterdam : VU University Press.
NOTES
1. Pour cela, voir Matthaios 2008.
2. Sch. D. Thr. (<Stephani>), GG I 3, 229, 9-10 : « Σχῆµα εἴρηται παρὰ τὴν σχέσιν τὴν πρὸς τὸ
σηµαινóµενoν ». À propos de cette définition, voir Lallot (2004 : 164, qui souligne le caractère
« artificiel » de l’interprétation suggérée par ce rapprochement, et Matthaios (2008 : 39-40). J’y
reviens plus loin.
3. Voir les étymologies du Cratyle, par exemple. Cf. Lallot (2004 : 162-163).
4. Cf. Sch. D. Thr. (<Heliodori>), GG I 3, 378, 3 sq.
5. Lallot (1998 : 137).
6. Mais non forcément « dicible », i.e. dont le signifié propre reste perceptible, car dans la forme
l’élément de composition peut être incomplet – cf. infra et Lallot (1998 : 138).
7. Sch. D. Thr. (<Heliodori>), GG I 3, 378, 7 : « Σύνθετα δὲ τὰ ἐκ δύo ἢ καὶ πλειóνων λέξεων ἰδίᾳ
νoητῶν συντεθειµένα, ἐν ἑνὶ τóνῳ καθ’ ἑνὸς ὑπoκειµένoυ λαµβανóµενα ». Définition encore
largement admise par les modernes. Comparer, par ex., avec Benveniste (1974 : 171) : « Il y a
composition quand deux termes identifiables pour le locuteur se conjoignent en une unité
nouvelle à signifié unique et constant ». L’idée que les parties du composé ne sont pas par elles-
mêmes signifiantes remonte à Aristote, Poétique 20, 1457a 12 ; 21, 1457a 32.
8. Sch. D. Thr. (<Heliodori>), GG I 3, 378, 6 : « ἁπλᾶ µέν ἐστιν ὅσα µὴ πέϕυκε διαιρεῖσθαι εἰς δύo ἢ
καὶ πλείoνας λέξεις ἰδίᾳ νoητάς. » À noter que le scholiaste ( GG I 3, 378, 5-6) parle tout d’abord,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
122
non du simple, mais du non composé : « [La figure est] la forme du mot sous un unique accent et un
unique esprit soit composé soit non composé (ἀσύνθετoς). »
9. Sch. D. Thr. (<Stephani>), GG I 3, 229, 12-14.
10. Voir les nombreuses fois où, chez Apollonius Dyscole, le terme σύνθετoν s’applique à un mot
défini par ailleurs comme « dérivé de composé » : Adv. 135, 23 ; 137, 5 etc. Le fait qu’il ne concerne
que peu de parties du discours – d’après Sch. D. Thr. (<Heliodori>), GG I 3, 379, 35-37, seul le nom
connaît des dérivés de composé ; il faudra ajouter l’adverbe, cf. infra – contribue sans doute à en
faire une figure à part : le scholiaste (GG I 3, 318, 3-9 ; 543, 19-21) formule deux définitions de la
figure sans même mentionner les παρασύνθετα.
11. Technè, GG I 1, 30, 1-4 : « Il y a quatre variétés de composés : les uns sont faits de deux (mots)
complets, comme Χειρίσoϕoς ; d’autres de deux (mots) incomplets, comme Σoϕoκλῆς ; d’autres
d’un (mot) incomplet et d’un complet, comme Φιλóδηµoς ; d’autres d’un (mot) complet et d’un
incomplet, comme Περικλῆς. » (trad. Lallot 1998 : 53).
12. Adv. 133, 15-18 : « il a la même valeur que ἕνεκα [à cause de] – en tout cas, on peut signaler
[cette forme], à cause de la construction qui s’y rapporte, ἕκητι σέθεν [par ta volonté] ; il en va
comme pour ἕνεκα σoῦ : la conjonction se porte sur un génitif et [la construction] signifie
quelque chose comme ἑκóντoς σoῦ [toi voulant] – comprenons : ἐθέλoντoς σoῦ [toi consentant]. »
13. Cf. Adv. 133, 13-137, 19 ; Conj. 231, 4-234, 12. La chronologie relative des œuvres d’Apollonius
reste aujourd’hui un sujet épineux, et sur ce chapitre en particulier, puisque chacun des deux
traités renvoie à l’autre : cf. Adv. 133, 13 : « il faut examiner ἕκητι, au sujet duquel nous nous
sommes déjà expliqué, dans le traité Des conjonctions, pour savoir s’il fallait le compter parmi les
conjonctions causales etc. » (et de même Adv. 133, 21) ; Conj. 232, 11 : « Voilà le raisonnement qui
est rapporté clairement dans le traité Sur les adverbes. »
14. Puisque celle-ci ne signifie rien par elle-même, ce n’est jamais sur elle seule que porte la
négation mais sur le tout qu’elle forme avec les mots qu’elle unit : elle peut donc recevoir la
négation oὐ, mais jamais le privatif ἀ. Cf. Adv. 133, 22-134, 11 ; Conj. 231, 8-232, 3.
15. Litt. ‘privation’, le terme στέρησις est souvent employé pour désigner, par extension, l’ἀ
privatif.
16. Le grammairien Tryphon d’Alexandrie ( Ier siècle av. J.-C.), d’après Apollonius. Cf. Tryphon, fr.
48 Velsen (Adv. 134, 19 sq. ; Conj. 231, 8 et 232, 4).
17. Cf. Adv. 134, 20 sq.
18. Au passage, Apollonius complète donc la liste de la Technè : les adverbes aussi connaissent la
figure du dérivé de composé – contre le scholiaste (Sch. D. Thr., GG I 3, 379, 35-37), qui affirme
qu’on ne trouve de παρασύνθετα que dans la catégorie du nom. Mais, p. 96, 18, il donne des
exemples d’adverbes dérivés de composés. Voir encore Sch. D. Thr., GG I 3, 273, 34 ; 428, 31.
19. Cf. Adv. 170, 22 sq.
20. Seule la forme de participe ἀεκαζoµένη est attestée (Il. VI, 458).
21. Ce principe est formulé plusieurs fois par Apollonius, cf. Adv. 135, 11 ; 138, 8 ; 166, 4.
22. Chantraine (1999, s.u. ἑκών) a retenu cette formation (« Sur ἀέκητι a été formé ἕκητι »).
23. On suppose qu’il devait y avoir une règle au nom de laquelle Apollonius s’autorise à affirmer
cela, mais les sources nous font défaut.
24. Voir aussi Conj. 232, 22-233, 23.
25. Sch. D. Thr., GG I 3, 114, 8 : « τὰ δὲ ἁπλᾶ πρoτερεύoυσι τῶν συνθέτων, καὶ γὰρ τὸ σoϕóς
ἁπλoῦν ὑπάρχoν πρoτερεύει τoῦ ϕιλóσoϕoς συνθέτoυ ὑπάρχoντoς. »
26. Ou seulement en de très rares occasions. Cf. Pron. 20, 17, où la masse des locuteurs est
comparée à un corps.
27. Adv. 136, 5-14 ; Conj. 233, 2-10.
28. Cf. Adv. 137, 16 : « des mots simples sont couramment (συνήθως) issus de composés ». Voir
aussi Conj. 233, 10 (oὐκ ἀσυνήθως).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
123
29. Il. XXIII, 741 ; Od. IV, 615 et XV, 115. Cf. Adv. 136, 17.
30. Od. XIII, 306 ; Il. V, 198. Cf. Adv. 136, 15 ; Conj. 233, 12.
31. Il. IX, 649. Cf. Adv. 136, 20.
32. Il. XI, 271. Cf. Adv. 136, 22. En Synt. 5, 13, où il cite le même passage, Apollonius interprète
ἔχoυσαι comme une forme ellipsée de παρέχoυσαι (prép. παρά).
33. Il. V, 397. Cf. Conj. 233, 23.
34. Od. IX, 48. Cf. Adv. 136, 24. En Conj. 233, 21, Apollonius cite Od. IV, 16 (γείτoνες ἠδὲ ἔται).
35. Od. XVI, 45. Cf. Adv. 136, 26 ; Conj. 233, 19.
36. Il. IX, 247. Cf. Adv. 136, 27. En Conj. 233, 17, Apollonius cite Il. XVIII, 178 (ἀλλ’ ἄνα, µηκέτι
κεῖσo).
37. Le mot σχῆµα n’a pas ici le sens technique de ‘figure’, mais désigne simplement, comme le
plus souvent chez Apollonius, la ‘forme’ d’un mot.
38. Je reproduis, ici et dans les autres citations du traité Des conjonctions, le texte établi par
Dalimier (2001).
39. Les anciens avaient classé les altérations de la forme en quatre types : addition, soustraction,
transformation, transposition. Sur ce sujet, on pourra se référer, par ex., à Desbordes (1983) et
Lallot (1995).
40. Cf. e. g. Adv. 158, 14.
41. Voir la définition du composé, supra.
42. Apollonius précise, dans le traité Des adverbes, que, dans certains mots simples, il peut se
produire des apocopes de deux syllabes (cf. Adv. 157, 17 ; 158, 6). À propos de la distinction entre
syllabe et mot, cf. Conj. 249, 12 : « là où on n’a pas de [simples] syllabes, on a des mots (λέξεις) ».
43. ‘Intègre’ (ὁλóκληρoς, ἐντελής), c’est-à-dire qui est antérieur à l’altération formelle (πάθoς).
Pour ne prendre qu’un exemple, cf. Adv. 158, 15-17 : « Après l’apocope (de ‑µα), δῶ signifie
(toujours) δῶµα [la maison] ; ἐθέλω [je veux] signifie la même chose (τὸ αὐτὸ σηµαίνει), après
aphérèse de l’ε – θέλω [je veux] –, et même après une nouvelle aphérèse dans la forme λῶ [je
veux]. » Ce type de formation par troncation est très vivant dans les langues modernes, qu’il
s’agisse de l’ellipse d’une syllabe ([mas]troquet, cinéma[tographe]…) ou d’un élément lexical dans
certains composés ([bateau à] vapeur…).
44. Le terme λεκτóν, emprunté au vocabulaire technique des Stoïciens, désigne toujours, chez
Apollonius, le contenu sémantique d’un mot, par opposition à la forme (ϕωνή).
45. Théorie qui vise à définir une norme des irrégularités phonétiques. Sur ce sujet, on pourra se
référer par exemple à Blank (1982 : 41 sq.) et Lallot (1995).
46. Cette règle, qu’on fait remonter à Aristarque (cf. Erbse 1980 : 238), est formulée à plusieurs
reprises par Apollonius. Cf. Adv. 136, 32 : « les altérations affectent, non pas les signifiés, mais les
formes (τὰ πάθη oὐ τῶν λεκτῶν, τῶν δὲ ϕωνῶν) ». Voir encore Adv. 158, 14 ; 164, 6 ; 184, 17 ;
Conj. 224, 14 ; 254, 6 ; *Adv. 209, 17.
47. Dans un autre passage, Apollonius utilise la même formule au sujet d’une forme simple
altérée par apocope (Adv. 157, 23) : « il existe aussi des formes altérées par apocope qui gardent la
mémoire (ὑπoµνήσεις ἔχoυσι) des syllabes coupées. »
48. Cf. Sluiter (1990 : 69) : « Semantics [ sic, comprendre things signified] are intrinsically more
important than ϕωναί. This is especially manifest from the fact that semantic considerations are of a
higher order than morphological ones and are decisive in matters of µερισµóς. » Voir aussi, par ex.,
Blank (1993 : 719) et Ildefonse (1997 : 263 sq.)
49. Pron. 67, 6 : « Οὐ γὰρ ϕωναῖς µεµέρισται τὰ τoῦ λóγoυ µέρη, σηµαινoµένoις δέ. »
50. Voir la définition de l’adverbe en Adv. 119, 5-6 « un mot non fléchi, qui prédique les verbes
(…) sans lesquels il ne saurait exprimer une pensée achevée ». Pour cet exposé sur les verbes
« passés sous silence », cf. Adv. 121, 14-26 et 122, 13-15.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
124
51. C’est avec une infinie précaution que je choisis d’employer ce néologisme, qui, dans ce
contexte, dit bien ce qu’il veut dire. En effet, il ne faudrait pas confondre le dé-composé (avec un
tiret), dont il est ici question, c’est-à-dire un mot simple issu d’un composé, avec le décomposé
(sans tiret) ou « dérivé de composé » (comme on appelle déverbatif un dérivé de verbe, etc.),
d’après le decompositum latin, calque de παρασύνθετoν.
52. GG III 1, 523, 14 : « [Κάρ] dans ‘ἐξ ὀρέων ἐπὶ κάρ’ ( Il. XVI, 392) [du haut des montagnes, sur la
tête…] est formé par altération (κατὰ πάθoς). En effet, il vient de κάρη [tête] par apocope (κατὰ
ἀπoκoπὴν) de l’η. »
53. Au sens lâche, le terme σχηµατισµóς désigne simplement la ‘configuration formelle’ d’un mot.
C’est le sens qu’on lui trouve le plus souvent chez Apollonius. Cf. Adv. 119, 7 ; 129, 26 ; 131, 8 ; etc.
54. Cf. e. g. Adv. 136, 31 : « On ne peut pas prétendre que c’est par altération (κατὰ πάθoς) que l’ε
[de ϕρενῶ] a été changé en o dans ϕρoνῶ, car le sens n’est pas le même – puisque les altérations
affectent, non pas les signifiés, mais les formes. »
55. D’après une scholie à la Technè (GG I 3, 229, 9-11), on appelle « σχῆµα » la figure « à cause de la
‘relation’ (σχέσις) au signifié, car c’est d’après la figure (σχῆµα) que nous comprenons ce que veut
signifier le mot ».
56. Comparer 136, 34 (« Τὸ ϕρήν πάλιν συντιθέµενoν τὸ η εἰς τὸ ω µεταβάλλει, ϕρήν ἄϕρων,
σώϕρων. » « À l’inverse, c’est en composition que ϕρήν change l’η en ω : ϕρήν → ἄϕρων,
σώϕρων. ») à 136, 8‑9 (« Τὸ ἀνήρ συντιθέµενoν τὸ α εἰς η µεταβάλλει, τὸ δὲ η εἰς ω. Ἀνήρ
ἀντήνωρ… » « en composition, ἀνήρ change l’α en η et l’η en ω : ἀνήρ → ἀντήνωρ etc. »).
57. Apollonius ne donne pas la raison d’une telle hypothèse de formation pour ces formes-là,
mais il est possible de la supposer, d’après un autre passage du traité Des adverbes (170, 22 sq.), où
il compare l’accentuation de plusieurs noms simples à celle de formes composées de ces noms :
καλóς est oxyton mais l’accent est remonté normalement dans πάγκαλoς ; en revanche, ψευδής et
σαϕής ont le même accent que les composés ἀψευδής et ἀσαϕής, ce que la formation par dé-
composition permet d’expliquer, comme on l’a vu pour ἀέκητι/ἕκητι.
58. Voir la définition du scholiaste (GG I 3, 378, 7), citée ci-avant.
59. Le simple et son composé privatif appartiennent à la même espèce (εἶδoς), autrement dit, l’un
n’est pas le dérivé de l’autre.
60. Sur le sens du verbe περιττεύω, voir ci-après.
61. Il est remarquable que, sur la question du rapport entre l’adverbe de privation ἀ et l’adverbe
de négation oὐ, les seuls témoignages que nous ait laissés la littérature grammaticale ancienne
sont, à ma connaissance, ceux d’Apollonius Dyscole et de Chœroboscus (GG IV 1, 334, 15 sq.).
62. Cf. Adv. 134, 4 sq. ; Conj. 231, 24 sq.
63. Sur le statut d’adverbe du privatif ἀ chez les Anciens, voir ci-avant.
64. Chœroboscus affirme, dans des termes proches de ceux d’Apollonius, que « la négation et le
privatif ne diffèrent pas l’un de l’autre (oὐδὲ γὰρ διαϕέρoυσιν ἀλλήλων), puisqu’ils ont tous
deux le pouvoir d’annuler (κατὰ τὸ εἶναι ἄµϕω ἀναιρετικά) » ( GG IV 1, 334, 19) – voir encore Ap.
Dysc., Synt. 164, 12 ; 348, 1 (pour la négation) ; Conj. 231, 13 (pour le privatif).
65. Voir aussi Adv. 134, 10-12.
66. Cf. Synt. 164, 12 ; 347, 12 sq. (III § 90-93).
67. Le verbe περιττεύω est formé sur l’adjectif περισσóς (att. περιττóς), litt. « superflu,
redondant », qui, dans un sens technique, qualifie toujours un élément ajouté par pléonasme. Cf.
e. g. Adv. 152, 2 et 8 ; 188, 24 ; 193, 17. De la même manière, on lit, plus haut dans le traité Des
conjonctions (218, 24-28) que « la négation est ajoutée par pléonasme » (τὸ πλεoνάζoν ἀπoϕάσει…
ἐπλεóνασε τῇ ἀπoϕάσει) à un énoncé pour former « l’énoncé opposé » (ἀντικείµενoν).
68. Et les contradictions apparentes, notamment en Conj. 232, 23 sq., ne sont qu’un effet de la
structure un peu lâche de l’argumentation : après avoir établi l’analogie avec la formation de
simples par altération, Apollonius entreprend, comme à son habitude, une digression sur
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
125
l’altération par aphérèse, cette fois-ci au sens large (de fait, il finit par mentionner des cas de
formation par apocope, sans le moindre rapport avec la formation du simple issu de composé
privatif), et il n’est déjà plus question de la forme ἕκητι, lorsqu’il formule la loi d’airain de la
pathologie en Conj. 233, 2.
RÉSUMÉS
Dans un témoignage unique, Apollonius Dyscole soutient que certains mots simples seraient
formés à partir de mots composés privatifs, par suppression de l’ἀ privatif (ἀέκητι → ἕκητι).
L’examen de ce procédé par Apollonius s’avère paradoxal. En effet, le grammairien assimile cette
formation à un pathos (une altération formelle) ; or une forme altérée, de l’aveu même
d’Apollonius, doit toujours garder le sens de la forme de base, tandis qu’un mot simple signifie
forcément le contraire de son composé privatif. Cet article vise à montrer ce que cette position
inattendue d’Apollonius, qui remet en cause le principe même de la pathologie, nous apprend du
statut particulier du composé privatif et de sa place dans la théorie grammaticale ancienne.
In an isolated testimony, Apollonius Dyscolus argues that some simple words are formed from
words compounded with alpha privative, by means of the deletion of the alpha (ἀέκητι → ἕκητι).
The way Apollonius discusses this formation is paradoxical. Indeed, the grammarian regards this
formation as a pathos (morphological change). However, a corrupted word-form, according to
Apollonius himself, should always retain the meaning of the original form, whereas a simple
word necessarily means the opposite of its privative compound. This article aims to show what
this conception of Apollonius, which challenges the very principle of pathology, teaches us about
the particular status of the privative compound and its place in ancient grammatical theory.
INDEX
Mots-clés : Apollonius Dyscole, altération (πάθoς), figure (σχῆµα), mot composé, mot composé
privatif, mot dérivé de composé, mot simple, tradition grammaticale grecque
Keywords : Apollonius Dyscolus, compound word, decompound word, figure (σχῆµα), Greek
grammatical tradition, morphological change (πάθoς), privative compound word, simple word
AUTEUR
LIONEL DUMARTY
Université Lyon 2 Lumière, Histoire et sources des mondes antiques (UMR 5189 HiSoMA), Lyon,
France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
126
Les options de catégorisation du
participe des temps composés dans
les grammaires des langues
romanes (XVe-XVIIIe siècles)
Alejandro Díaz Villalba
1 Préambule
1.1 Les temps composés : le modèle latin face aux données des
langues vernaculaires
1 La série des tiroirs verbaux appelés communément « temps composés » (désormais TC)
constitue un phénomène morphologique commun aux différentes langues romanes, du
moins pour le type avoir + participe (j’ai chanté), car le type être + participe (je suis arrivé)
ne subsiste aujourd’hui que dans une partie des langues, comme le français et l’italien.
La coalescence de avoir + participe, pour exprimer des contenus temporels et
aspectuels, fait figure d’innovation à l’égard du latin classique. Si une telle structure y
est attestée en tant que périphrase verbale résultative, l’association de avoir au
« participe des temps composés » (désormais PTC) a été vraiment exploitée dans les
langues modernes, qui ont restructuré de fond en comble le système verbal.
2 Lorsque la grammatisation des langues romanes, s’appuyant sur les grammaires latines,
émerge aux XVe et XVIe siècles, l’existence des formes verbales composées est une
donnée déjà bien en place dans ces langues. Ainsi, l’examen du traitement des TC
constitue un excellent terrain d’observation pour étudier les modalités du transfert du
cadre conceptuel et explicatif du latin vers le traitement des vernaculaires. En d’autres
termes, il s’agit d’observer la manière dont les grammairiens de la Renaissance
s’emparent du modèle disponible, élaboré pour le latin, et initialement pour le grec,
afin de traiter d’objets nouveaux.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
127
1.2 Une histoire sérielle et comparée
3 Le corpus est composé de 97 grammaires examinées dans le cadre d’une recherche
approfondie sur l’histoire du participe (Díaz Villalba 2017). Il réunit des œuvres parues
entre 1400 et 1800 qui décrivent l’espagnol, le français, l’italien et le portugais, ainsi
que des grammaires générales rédigées dans ces langues. Cet ensemble de textes invite
à la comparaison, dans la mesure où les langues entretiennent un double lien de
parenté : un lien interne ou linguistique, puisque toutes dérivent du latin et partagent
bon nombre de faits de langue ; un lien externe ou épistémologique, parce que leur
codification se réalise dans le même moule théorique et descriptif, la grammaire latine.
4 L’histoire comparée se fonde, dans cette étude, sur le croisement des traditions. C’est
précisément le socle grammatical partagé par les traditions qui assure la possibilité de
mettre les textes en parallèle.
5 Nous faisons le choix d’une histoire sérielle. Le concept de série textuelle recouvre
souvent un regroupement cohérent : « un ensemble de textes imprimés ou manuscrits
qui traitent le même sujet dans le même cadre épistémologique ou bien sans méthode
déclarée, mais avec le même but et dans des conditions comparables. » (Haßler 2000,
p. 97). Or, la mise en série est conçue, dans notre étude, de manière plus restreinte : elle
concerne la réunion de textes qui abordent le même problème en proposant des
solutions théoriques et des innovations terminologiques comparables, en dépit de leur
appartenance à des traditions linguistiques et des projets scientifiques hétérogènes.
Dans les deux démarches, il existe une construction historienne, la seconde impliquant
un changement d’échelle historiographique et posant foncièrement le problème de la
commensurabilité.
2 La délimitation des problèmes et leur traitement
dans les grammaires
6 Il convient de délimiter les objets linguistiques que les grammairiens se proposent de
réduire à un cadre intelligible ; il importe également de présenter les procédés
théoriques et explicatifs qu’ils mobilisent. Les phénomènes qui mettent à l’épreuve les
ressources descriptives des premiers grammairiens (XVe-XVIIe siècles) peuvent être
résumés en trois questions :
2.1 Le caractère analytique des formes verbales
7 Un des aspects abordés par les premiers grammairiens est le caractère analytique d’une
partie de la conjugaison verbale, plus particulièrement l’expression de la diathèse
passive (je suis aimé) et celle de la diathèse active (j’ai aimé, je suis venu). Il importe de
souligner deux faits remarquables dans ce que l’on pourrait appeler une approche
périphrastique du verbe : d’une part, la prégnance de l’organisation binaire (temps
simple vs temps double) de la morphologie vernaculaire, dont la manifestation la plus
aboutie apparaît dans les chapitres consacrés aux formes périphrastiques chez Nebrija
(1981 [1492] : 187-188), Barros (1540, f. 25r-26r), l’Anonyme de Louvain (1966 [1559] : 55)
et chez Ramus (1562 : 100-107) ; d’autre part, la variation terminologique pour
exprimer le caractère composé. Les désignations les plus fréquentes sont en latin
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
128
circumlocutio, circumloquor, en français circonlocution, périphrase (Fournier & Raby 2014),
en espagnol et en portugais circunloquio, rodeo (Gómez Asencio 2015), mais des verbes
comme suppléer et ses cognats romans sont également courants. L’extension des objets
désignés par ces termes n’est pas toujours homogène, bien que l’on trouve des
récurrences (outre les formes verbales analytiques, on y place souvent les degrés de
l’adjectif et le verbe impersonnel, entre autres). Le phénomène de la circonlocution
dépasse ainsi les seuls TC, qui s’insèrent alors dans un cadre plus général de rapport au
latin : l’expression pluriverbale d’un seul contenu fonctionnel ou catégoriel.
2.2 L’auxiliarité
8 Le rôle des verbes être et avoir dans la conjugaison des langues vulgaires fait, très tôt,
l’objet d’une innovation terminologique dans les grammaires du français ou rédigées
dans cette langue. À partir de l’idée d’aide que ces verbes prêtent à la formation des
temps, on forge le terme latin auxiliarium – la première attestation se trouve chez Pillot
(1561 [1550] : 73) – ainsi que le français auxiliaire dans la décennie suivante. Le mot
désigne une classe fonctionnelle ad hoc, le nouveau type venant s’ajouter aux types des
verbes envisagées par la grammaire latine, en même temps qu’il sert à les distinguer :
déjà, chez Pillot avoir était l’auxiliaire des actifs, comme être était celui des passifs
(Colombat 2003 : 103). Dans les autres langues romanes, il faudra attendre le siècle
suivant pour observer des attestations de termes équivalents. Toutefois, des remarques
sur l’importance, pour le paradigme verbal, de ces verbes est attestée de façon générale
dans toutes les traditions. Cependant, on ne saurait réduire le traitement de
l’auxiliarité verbale à la seule notion d’aide (Chevalier 1999, Díaz Villalba 2017).
2.3 La forme du verbe conjugué
9 La question de la nature et des propriétés de la forme du verbe auxilié, id est le PTC,
notamment en coalescence avec avoir, où cette dernière est presque toujours
invariable, est un problème linguistique dont témoignent les premières descriptions.
Les solutions à ce problème prennent des formes diverses : par exemple, le constat du
caractère invariable de ces participes en espagnol (Miranda 1566 : 214, Alessandri 1560,
f. 125v), les propositions qui mettent l’accent sur une propriété (ainsi le PTC, avec avere
comme avec essere, a le trait sémantique « passé » chez Castelvetro (2004 [1563] : 297),
alors que le même trait est absent dans le participe passif), ou encore les créations
terminologiques (participe auxiliaire chez Dangeau 1927 [1694-1722] : 105), qui
introduisent des subdivisions dans la classe du participe. L’exemple le plus poussé
d’adaptation aux faits du vernaculaire apparaît chez Nebrija (1981 [1492] : 193), qui crée
une nouvelle partie du discours, le nombre participial infinito (nom participial infini), se
démarquant ainsi par son originalité de la tradition latine dont il hérite.
10 On peut remarquer que les réponses aux questions suscitées par les TC représentent
des modes très différents d’appréhender les données : innovations terminologiques et
traductions de termes latins (auxiliaire, rodeo), mobilisation de concepts empruntés aux
figures de construction (périphrase), création de classes ad hoc (nombre participial infinito,
verbe auxiliaire), ou encore ré-examen des propriétés d’une classe (le « participe passé »
de Castelvetro). Parfois, une grammaire peut convoquer divers dispositifs. Ainsi, dans la
méthode d’espagnol de Lancelot (1660a), on observe les trois solutions, ce qui tend à
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
129
montrer qu’il s’agit de moyens de conceptualisation n’opérant pas sur le même plan.
Dans certains textes, ils peuvent être opposés : Dumarsais (1751), qui soutient que les
TC du français sont des périphrases, catégorise les PTC en tant que noms abstraits et
métaphysiques1, en même temps qu’il critique le concept d’auxiliaire.
11 On met ici l’accent sur le fait que les deux dernières questions (c’est-à-dire le statut de
l’auxiliaire, et celui de l’auxilié) sont à même de modifier le système de classification
des mots de la grammaire latine, soit parce qu’elles introduisent des nouvelles sous-
classes, soit parce qu’elles interrogent les propriétés des classes héritées. Certes, le
concept de verbe auxiliaire connaîtra un grand succès dans la tradition occidentale, ce
qui pourrait nous faire oublier qu’une réflexion sur la nature et les propriétés de la
forme de l’auxilié est présente dans la même tradition. Aussi proposerons-nous un
panorama historique de la catégorisation de la forme du verbe principal, appelé
communément participe, dans les TC de la voix active.
3 Le participe, de la grammaire latine aux langues
romanes
12 Élaborée dans les grammaires grecques et latines antiques, la classe du participe dont
hérite la tradition médiévale et moderne se présente comme une partie du discours,
c’est-à-dire une classe au même titre que le pronom ou la préposition, par exemple. En
effet, depuis la grammaire de Denys de Thrace (Tékhnē, chap. 15), le participe se
caractérise par une nature hybride, associant des propriétés grammaticales du nom
(l’adjectif est également compris dans cette classe) et du verbe. Ainsi, chez le latin
Donat (IVe s.), le participe est défini en ces termes :
Participium est pars orationis, dicta quod partem capiat nominis partemque uerbi. Recipit
enim a nomine genera et casus, a uerbo tempora et significationes, ab utroque numerum et
figuram. Participiis accidunt sex, genus, casus, tempus, significatio, numerus, figura.
(Donat, Ars maior, Holtz 1981 : 644)2
13 Parmi les propriétés ou « accidents » attribués au participe, l’expression des valeurs
temporelles (tempora) et des valeurs diathétiques (significationes), partagées avec le
verbe, jouent un rôle important dans la classification des formes. Ainsi les formes en
−tus du latin sont, chez Donat (Holtz 1981 : 644-645), identifiées comme des participes
passifs (par exemple, amatus), des participes déponents (luctatus), ou des participes
communs (criminatus)3. Quant au temps, ces formes sont des participes de præteritum
(passé) chez Donat (ibid.), ainsi que chez Priscien (GL 2,557) 4.
14 Les grammairiens latins observent différentes caractéristiques syntaxiques du
participe, dont le régime, catégorie grammaticale consistant en un rapport de
dépendance établi par le mot régissant sur le mot régi, qui adopte une forme casuelle
spécifique. Si le régime ne fait pas partie des définitions antiques du participe, Priscien
(GL 3.160) s’appuie, pour distinguer les participes des noms, sur l’idée que les mots qui
suivent un participe se mettent au même cas que lorsqu’ils suivent un verbe. La
construction du complément du participe à la manière d’un verbe appartient, tout
comme les critères du temps et de la diathèse, à la boîte à outils dont disposent les
grammairiens face aux problèmes de classification posés par certaines formes latines,
même s’il ne s’agit pas des seuls critères employés (Visser 2010, Colombat 2019).
15 Dans les premières grammaires des vernaculaires, l’identification du participe de type
aimé, équivalent du latin amatus se fait aisément. De même, les accidents sont hérités
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
130
par les grammaires dans l’ensemble de la Romania (Díaz Villalba 2017). Parmi ceux
empruntés au nom, le genre et le nombre permettent de traiter convenablement la
morphologie, alors que le cas est écarté assez tôt. Toutefois, ce sont les accidents
verbaux, la signification et le temps, qui servent à désigner les sous-classes du participe.
Ainsi, dans les grammaires françaises des XVIe et XVIIe siècles, aimé est un participe
« passif » et « passé » ou « prétérit »5, aimant est un participe « actif » et « présent »6.
16 Du point de vue de son fonctionnement, le participe en latin peut être défini, dans une
terminologie moderne, comme un mot flexionnel verbo-adjectif (parfois substantivé) :
il remplit des rôles prototypiques d’adjectif (attribut ou modificateur adnominal,
principalement), mais il peut aussi admettre des compléments propres au verbe. En
revanche, le PTC associé à avoir, dans les langues romanes, est d’une autre nature. En
effet, les TC sont le résultat d’un processus de grammaticalisation avancée, si bien que
l’on ne peut plus parler d’adjectif pour la forme participiale. En revanche, cette
dernière montre une forte coalescence avec le verbe auxiliaire (ordre fixe de deux
constituants). De même, le rapport que le participe établissait, dans les langues
médiévales, avec l’accusatif du verbe, manifesté par l’accord en genre et en nombre (du
type les lettres que j’ai écrites), a disparu (espagnol, portugais) ou est resté cantonné à
certaines configurations syntaxiques (français, italien), ce qui représente l’abandon
d’une morphosyntaxe adjective du participe. Du point de vue sémantique, la perte de ce
lien implique également l’absence de signification passive.
17 Bien évidemment, d’autres questions connexes doivent compléter la problématique
(notamment la concurrence de l’auxiliaire être et la manifestation de l’accord du
participe) ; cependant, nous nous occuperons uniquement de la catégorisation du PTC
en coalescence avec avoir.
4 Propositions de (re)catégorisation dans les
grammaires
18 La grammaire castillane de Nebrija élargit, nous l’avons souligné plus haut, la liste des
parties du discours connues :
Una otra parte de la oración tiene nuestra lengua, la cual no se puede reduzir a ninguna de
las otras nueve, τ menos la tiene el griego, el latín, ebraico τ arávigo. [...] E por que aún entre
nos otros no tiene nombre, osemos la llamar nombre participial infinito : nombre, por que
significa substancia τ no tiene tiempos ; participial, por que es semejante al participio del
tiempo passado ; infinito, por que no tiene géneros, ni números, ni casos, ni personas
determinadas. (Nebrija 1981 : 193)7
19 Le grammairien fait ainsi preuve d’originalité, car il modifie la structure même du socle
commun de la tradition occidentale. Cependant, il ne sera pas suivi. Les grammairiens
de la série se contentent souvent d’introduire des sous-classes du participe ad hoc,
comme Irson (1656 : 19-20) qui forge le participe commun actif : commun parce que la
même forme présente des valeurs différentes, en l’occurrence, le même participe
exprime la passivité dans d’autres constructions. Outre ces innovations, les textes
attestent également la recatégorisation dans d’autres sous-classes du verbe. C’est ainsi
que Figueiredo conçoit le PTC comme un supin :
O Supino, que he a voz do Infinito Activa, que se ajunta em todos os Verbos aos dous
Auxiliares Ter, e Haver para formar com elles os Tempos compostos, ou de circumloquio,
nem tẽ plural, nem terminação feminina, e nisto se distingue dos Participios do Preterito
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
131
Passivos, os quaes, aindaque por elle se formem, tem todos ambos os generos, e terminações,
por ser isto da natureza do Participio. (Figueiredo 1811 [1799] : 84-85) 8
20 L’extrait affiche nettement la polycatégorisation des formes participiales : on y
appréhende comme « supin » le type invariable en compagnie de ter ou haver, et comme
« participe de passé passif » le type variable.
4.1 La série des catégorisations : étiquettes et enjeux
21 L’examen des propositions terminologiques et des vues originales 9 sur la catégorisation
du PTC dans l’ensemble des grammaires des langues romanes fait émerger la
récurrence significative des options envisagées. Le tableau 1 réunit 42 ouvrages, rangés
par ordre de leur première édition. La limite chronologique de 1799 est arbitraire, la
série pouvant s’étendre au XIXe siècle, notamment chez les auteurs des grammaires
générales. Néanmoins, nous analysons les trois premiers siècles de grammatisation, qui
correspondent à l’élaboration de la problématique.
22 Afin de saisir les contours précis de la construction historiographique que dessine le
tableau, deux remarques s’imposent. D’une part, nous ne saurions trop insister sur le
fait que les désignations ne laissent pas toujours deviner le choix de la catégorisation. À
titre d’exemple, Castelvetro (1563) emploie partefice passato (participe passé),
appellation traditionnelle, pour parler des seuls PTC, porteurs de l’expression du
temps, contrairement aux autres participes, dépourvus, aux yeux de l’auteur, d’une
telle propriété. D’autre part, il n’y a pas homogénéité, à l’intérieur de la série, dans la
façon de catégoriser, ni par la portée théorique, ni par le dispositif descriptif, ni non
plus par l’organisation des classes de mots. En effet, le traitement reste parfois peu
approfondi : chez Mambelli (1685 : 547), par exemple, on constate simplement l’idée
que le participe prétérit possède un sens actif lorsqu’il est régi par le verbe avere
(avoir), alors que sa sémantique est passive en coalescence avec le verbe essere (être).
En revanche, nombreux sont les grammairiens (Nebrija 1492, Meigret 1550, Ramus
1562, Arnauld et Lancelot 1660, Lancelot 1660, pour ne nommer qu’eux) qui accordent
une place prépondérante à la théorisation sur ce type de mots. Néanmoins, les enjeux
sont sans commune mesure. Ainsi, Nebrija tente de se démarquer par son originalité de
la tradition latine dont il hérite (Tollis 1998). Dans le même sens, Meigret, veut poser
des bases rationnelles pour une description du français reposant sur les données
propres à cette langue. Ramus, quant à lui, refonde le système des parties du discours
selon un principe binaire, s’écartant ainsi des classifications traditionnelles. C’est ainsi
que le grammairien oppose les mots exprimant le nombre (le nom et le verbe) et les
autres mots, les mots « avec nombre » pouvant être à leur tour divisés en mots de
nombre fini, tels que les formes conjuguées du verbe, ou en mots de nombre infini,
comme le gérondif ou l’infinitif, dont le PTC est une sous-classe. La démarche de Port-
Royal, quant à elle, explore la possibilité d’une catégorisation générale des participes
des langues modernes, dont les faits du français, de l’espagnol et de l’italien sont, aux
yeux de ces grammairiens, des manifestations concrètes des mêmes principes. En
somme, les modalités des traitements, les arguments et les enjeux épistémologiques
sont particuliers (Fournier 2011, Díaz Villalba 2012). Toutefois, c’est la mise en série
d’un grand nombre de textes qui nous permet d’observer la cristallisation d’une
problématique générale stable dans la durée.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
132
Tableau 1. Catégorisation du participe des temps composés (1492-1799).
désignation pour le
métalangue/langue- choix de
date auteur participe des temps
objet (si différente) l’étiquette
composés
1492 ES Nebrija nombre participial infinito nom + participe
1530 AN/FR Palsgrave participle preterit participe
infinitif passé et actif,
1550 FR Meigret infinitif
infinitif prétérit
1563 IT Castelvetro partefice passato participe
1562 FR Ramus infiny (ou perpetuel) preterit infinitif
1570 LA/FR Cauchie vox præteriti forme verbale
1607 FR Maupas participe commun participe
1619 PT Roboredo gerundio de preterito gérondif
1627 ES Correas partizipio ministro participe
1651 ES Villar supino supin
1656 FR Irson participe commun actif participe
Arnauld et
1660 FR gérondif gérondif
Lancelot
1660 FR/IT Lancelot gérondif gérondif
1660 FR/ES Lancelot gérondif gérondif
1675 FR Bouhours supin supin
participe (de signification
1681 FR Vairasse d’Allais participe
active)
participio preterito de
1685 IT Mambelli participe
significazione attiva
1694 FR Dangeau participe auxiliaire participe
Régnier- participe absolu, participe
1705 FR participe
Desmarais passé adjectif & actif
1708 FR/ES Vayrac participe actif participe
1719 FR Vallange supin supin
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
133
1728 FR/ES Torre y Ocón participe prétérit actif participe
1730 supin, nom substantif
FR Dumarsais supin, nom
1751 abstrait & méthaphysique
participe passif (de
1730 FR Restaut participe
signification active)
1744 FR Vallart participe auxiliaire participe
1754 FR Duclos supin supin
1760 FR D’Açarq supin supin
1765a,b
FR Beauzée supin supin
1767
participio de preterito
1769 ES San Pedro participe
(activo)
participio de preterito
1770 PT Lobato participe
indeclinavel
participio de preterito
1770 ES Puig (significacion activa, voz participe
neutra)
participio passato + nome participe + nom
1771 IT Soave
universale oggetto sous-entendu
Real Academia
1771 ES participio auxîliar participe
Española (RAE)
1775 FR Condillac participe substantif participe
1783 PT Bacelar nominativo indeclinavel nom
terminacion neutra del
1793 ES Muñoz participio de pretérito participe
perfecto
participio de pretérito (de
1796 ES Ballot participe
significacion activa)
1798 FR Sicard supin supin
1799 FR Serreau participe absolu participe
1799 PT Figueiredo supino supin
AN : anglais, ES : espagnol, FR : français, IT : italien, LA : latin, PT : portugais
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
134
4.2 Les axes du traitement
23 Lorsqu’on approche l’ensemble des catégorisations sous un angle général, on observe
des options théoriques majeures. Ainsi, la colonne de droite du tableau 1 inventorie les
désignations qui permettent de catégoriser les formes en question : le nom, le participe,
l’infinitif, le gérondif et le supin. Il s’agit, peut-on constater, de parties du discours ou
de sous-classes héritées de la grammaire latine. On peut ranger les choix de la
catégorisation selon deux procédés fondamentaux : a) création d’une (sous-)classe
nouvelle ; b) utilisation d’étiquettes catégorielles disponibles dans le modèle latin.
24 Le premier procédé, c’est-à-dire l’invention d’une classe, regroupe un éventail de choix.
Nebrija (1492), nous l’avons signalé, propose l’instauration d’une nouvelle partie du
discours. Néanmoins, la solution adoptée par la suite est la création d’une sous-classe
ad hoc, option fortement représentée dans le corpus. La démarche la plus féconde
consiste à conserver, par principe d’économie terminologique, le terme de participe
suivi d’un qualificatif (actif, passé, indéclinable ou infini), renvoyant à une propriété
saillante de la classe. Dans la formation des dénominations, les grammairiens
manifestent une certaine liberté en puisant dans le vocabulaire technique de la
grammaire latine. On découvre également des créations originales, telles la
catégorisation en partizipio ministro (participe assistant) de Correas (1984 [1627] : 158),
ainsi que des expressions plus ou moins générales et vagues, comme vox præteriti (forme
du prétérit) chez Cauchie (1586 [1570], f. 68v). On observe en outre l’expression voz
neutra (voix neutre) chez Puig (1770 : 133) et terminación neutra (terminaison neutre)
chez Muñoz (1799 [1793] : 47) ; autrement dit, ces auteurs invoquent une catégorie
grammaticale (le genre) afin d’expliquer l’invariabilité. L’idée d’une forme neutre est
aussi proposée par Correas (1984 [1627] : 158) ; elle est présente dans la catégorisation
en tant que supin (cf. infra).
25 L’une des caractéristiques notoires du PTC est d’ordre fonctionnel, c’est-à-dire qu’il
forme des tiroirs verbaux, ce qui écarte incontestablement ces formes du
comportement des autres participes. Six auteurs mettent en avant cette propriété en
inscrivant l’auxiliarité dans les désignations10. Maupas (1618, f. 97r) affirme que le
participe est commun parce qu’il sert à former les temps actifs comme les passifs, se
joignant aux deux auxiliaires être et avoir. D’autres auteurs vont plus loin : le choix de
participe auxiliaire (Dangeau, op. cit.) ou de participio auxîliar (RAE 1771 : 182), ainsi que de
partizipio ministro (corrélat de verbos ministrales, i.e. verbes auxiliaires, chez Correas
(1984 [1627], 157 sq), représente un transfert d’une innovation terminologique (verbes
auxiliaires) de la classe du verbe vers la classe du participe. L’approche adoptée par ces
grammairiens met l’accent sur le caractère complémentaire de la relation auxiliaire-
participe. En effet, Correas justifie la désignation par le fait que le participe en question
n’apparaît jamais seul, mais « en compañia de los tienpos que aiuda á formar i suplir »
(op. cit., p. 165) (en compagnie des temps qu’il aide à former et auxquels il supplée),
dans une formulation assez proche de la définition d’un verbe auxiliaire. Dangeau (1927
[1694-1722] : 100-105) et Vallart (1744 : 234), de leur côté, préfèrent le terme d’usage
pour parler de l’essence fonctionnelle du participe auxiliaire, là où RAE (1771 : 182)
qualifie d’oficio (office) le rôle de la classe.
26 Le deuxième procédé consiste à trouver, pour ces formes, une classe de la grammaire
latine permettant d’expliquer leurs caractéristiques linguistiques. Les options
privilégiées correspondent aux formes non finies du verbe : le gérondif, l’infinitif et le
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
135
supin. Ce phénomène illustre une conséquence de la latinisation de la grammaire des
vernaculaires. On peut être sensible au fait que les trois possibilités catégorielles
offertes par le schéma théorique et descriptif (les classes verbales que connaît la
grammaire latine sont précisément, en dehors des formes personnelles, au nombre de
trois) sont envisagées dans les grammaires de différentes traditions, comme si le
modèle tendait à produire, de manière prévisible, des réflexions de même nature pour
traiter certaines données.
27 Or, chacune des options représente des enjeux différents et pose des problèmes
spécifiques. L’infinitif constitue, dans la tradition occidentale, un mode fonctionnant,
en réalité, comme un chapeau pour l’ensemble des formes verbo-nominales. Cette
essence générale a dû conduire Meigret au choix terminologique d’infinitif prétérit pour
le PTC, mais il n’y a pas de coïncidence entre les propriétés de cette sous-classe et celles
de l’autre infinitif (aimer), qui ne saurait, par exemple, exprimer une quelconque valeur
temporelle. L’infinitif de Ramus, sous le terme de perpétuel ou d’infini (1562 : 52), est,
quant à lui, une subdivision primaire des verbes (opposable à l’ensemble des formes
finies), dont les espèces sont l’infinitif présent, le gérondif et l’infini prétérit (le PTC),
toutes étant dépourvues de l’expression formelle du nombre. Les approches théoriques
de Meigret et de Ramus n’ont pas eu de successeurs directs. Si Cauchie (1586, f. 38r) se
fait l’écho des débats sur la catégorisation du PTC en tant qu’infinitif, il n’adhère pas à
ce choix. Toutefois, la possibilité théorique restant disponible, des textes bien plus
récents (Noboa 1839, Jullien 1849) optent pour la catégorisation du PTC en infinitif.
28 Le choix du gérondif est également circonscrit dans le temps (Roboredo 1619 : 18, 33,
Arnauld et Lancelot 1660 : 133 sv, Lancelot 1660a : 74, 1660b : 87 sv). Il convient de
rappeler que, dans la tradition française au XVIe siècle, le terme de gérondif s’identifie
exclusivement à des formes latines et à leurs traductions en langue vernaculaire, et pas
encore à des formes françaises en −ant. En effet, la catégorisation du gérondif repose
sur la classe du gerundium latin (type amandum, −i, −o), c’est-à-dire, une forme
nominale du verbe sans variation de genre et de nombre ; il s’agit, en quelque sorte,
d’une déclinaison de l’infinitif. Cette conception se retrouve encore, en grande partie,
au siècle suivant. Néanmoins, les auteurs de Port-Royal élèvent le gérondif au rang de
catégorie générale et abstraite dont ils ne retiennent que les éléments définitoires (cf.
infra), ce qui leur permet de percevoir des « gérondifs » dans les PTC des langues
modernes (le français dans la Grammaire générale et raisonnée (GGR), mais aussi l’italien
et l’espagnol dans les méthodes d’apprentissage de Lancelot). Ainsi, le participe
invariable est un gérondif qui régit l’accusatif dans « io ho riceuuto la vostra lettera, j’ay
receu vostre lettre » (Lancelot 1660b : 90), alors que le participe qui montre l’accord
n’est pas un mot régissant, par exemple « la lettera che voi mi hauete mandata, la lettre
que vous m’auez enuoyée » (ibid.).
29 Cependant, la théorie d’une classe appelée gérondif pour les TC n’a pas eu la chance
d’être entérinée, malgré le rôle historique de la GGR dans la tradition grammaticale.
Régnier-Desmarais (1706 : 486 sq.) fait une critique de la catégorisation de Port-Royal,
en établissant une distinction nette entre les participes et les vrais gérondifs. En outre,
le terme s’étant spécialisé dans les grammaires du XVIIe siècle pour nommer les formes
françaises du type (en) aimant, une éventuelle reprise de cette étiquette pour les PTC
aurait sans doute brouillé les distinctions des classes grammaticales.
30 Il en va autrement pour le choix de l’étiquette terminologique supin, qui figure dans un
groupe de textes bien plus étoffé. Le rapprochement du participe passif et du supin
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
136
s’explique aisément en raison du morphème homonyme de ces classes en latin, le
participe passif au neutre ayant une forme identique neutre au nominatif/accusatif
(v.gr. amatum). La ressemblance se prête à des métaphrases des exemples vernaculaires
à l’aide du latin. Par exemple, Bouhours exploite une telle possibilité dans l’extrait
suivant :
Avec le verbe avoir il [le participe] est naturellement indéclinable, n’ayant ni genre,
ni nombre. J’ay receû vos Lettres ; j’ay reçeû vos Livres, parce que c’est plûtost le supin
des Latins, que le participe ; & que c’est comme si on disoit, habeo acceptum Litteras,
habeo acceptum libros. (Bouhours 1675 : 360)
31 L’avantage de la similitude formelle est décisive : l’existence de cette homonymie
morphématique en latin, modèle de toute description grammaticale, est une raison
solide pour postuler l’existence de deux mots aimé, l’un variable, l’autre invariable.
32 Beauzée approfondit cette idée en l’étendant, car l’auteur développe dans deux articles
de l’Encyclopédie (Beauzée 1765a, 1765b) avec force arguments, la thèse selon laquelle le
PTC doit être considéré comme un supin (Díaz Villalba 2015a), dans plusieurs langues
modernes (allemand, espagnol, français et italien), lorsqu’il est invariable, tandis que
les formes participales qui manifestent l’accord dans les lettres que mon père a reçues
(1765a : 96) sont catégorisées comme des participes. Il est question, dans ces textes,
d’une catégorisation plus abstraite et générale sur la base d’une poignée de propriétés
grammaticales comparables. Mais ce type d’approche n’est pas l’apanage des auteurs
des grammaires générales, il est représenté depuis la Renaissance. Ainsi, le traitement
du PTC à l’aide d’une des trois classes verbo-nominales réside dans une série de
caractéristiques :
33 a) sous l’angle de la morphologie, les classes précitées (infinitif, gérondif, supin)
partagent l’absence d’une variation formelle en genre et en nombre, contrairement aux
participes passés, qui, eux, sont variables (cf. supra Bouhours) ;
34 b) sous l’angle de la sémantique, on attribue à ces formes verbales la diathèse active,
tandis que les participes passés sont passifs.
[...] el participio simple, que algunas vezes llamamos supino [...] en los circunloquios de la
voz activa significa accion, y assi dezir yo e amado, es dezir, yo e sido de quien procedio la
accion de amar. (Villar 1651, p. 79)11
35 c) sous l’angle de la construction, la nature active présente un corrélat syntaxique, le
régime, dans la mesure où ces formes manifestent la capacité de régir le même cas que
les formes personnelles ou conjuguées du verbe à la voix active (cela est aussi vrai pour
les participes actifs). Les grammairiens de Port-Royal s’appuient notamment sur ce
critère dans le traitement de la classe :
Ainsi pour resoudre la difficulté proposée, je dis que dans ces façons de parler, j’ay
aimé la chasse, j’ay aimé les livres, j’ay aimé les sciences, la raison pourquoy on ne dit
point ; j’ay aimée la chasse, j’ay aimez les livres ; c’est qu’alors le mot aimé ayant le
regime du verbe, est gerondif, et n’a point de genre ny de nombre. (Arnauld et
Lancelot 1660 : 133)
36 Les qualités grammaticales évoquées ci-dessus sont, par ailleurs, présentes chez
d’autres grammairiens du corpus, dans des désignations du type « participe actif » ou
« participe indéclinable » en tant que spécifications supplémentaires, alors que ces
traits grammaticaux sont intrinsèques aux classes de l’infinitif, du gérondif et du supin,
ce qui constitue un argument de poids pour les grammairiens de la période. On peut
comprendre que les trois étiquettes de la grammaire latine représentent de « bonnes
candidates » pour la recatégorisation des formes qui nous intéressent.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
137
37 Il existe encore une caractéristique commune ayant trait à la nature même de ces
classes en tant qu’elles sont conceptualisées comme classes proches du substantif. En
effet, les grammairiens assimilent ces classes verbales à des noms. Ainsi, Lancelot
affirme à propos de l’infinitif : « L’Infinitif venant à perdre l’affirmation qui est propre
au verbe, doit estre consideré comme un nom substantif dans toutes les langues. »
(Lancelot 1660b : 82).
38 C’est pourquoi la prise en compte des seules désignations peut s’avérer insuffisante
pour saisir tous les enjeux de la catégorisation. Ce phénomène est patent dans le
caractère nominal indissociable des formes non personnelles du verbe. Par ailleurs, la
dimension de parenté avec le nom entre en résonance avec d’autres options théoriques,
telles que nombre participial infinito (Nebrija 1492), nom substantif abstrait et métaphysique
(Dumarsais 1730) participe substantif (Condillac 1775), ou encore nominativo 12 indeclinavel
(Bacelar 1783). La mise en réseau des textes fait ressortir le fait que les connexions
possibles entre les propositions théoriques sont multiples et complexes.
4.3 La polycatégorisation dans le traitement des questions
particulières
39 Un panorama très général encourt le risque de réduire, en quelque sorte, l’épaisseur
historique de l’objet. Il en va ainsi de la manière dont la problématique s’inscrit dans
l’histoire de la description de faits de langues particuliers.
40 S’agissant de la tradition française, la polycatégorisation s’insère dans l’histoire de la
règle de l’accord du participe passé, en cours d’élaboration en français classique (N.
Fournier 1998 : 315-329). Dans cette tradition, les choix théoriques présentés dans notre
étude concernent quasi exclusivement le type avoir + participe invariable (par exemple
dans la citation de Lancelot reproduite plus haut), au détriment des autres
configurations, qui comportent, aux yeux de certains grammairiens, le véritable
participe. En ce sens, la problématique de l’accord est investie d’une réflexion
approfondie sur la nature des mots et leurs rapports sémantiques et syntaxiques. Cela
explique certainement la forte présence d’auteurs français dans notre série de
recatégorisations : les débats sur la règle de l’accord ont fourni, dans l’histoire de la
grammaire française, un terrain favorable à la réflexion syntaxique (Fournier 2011).
41 Le problème de la nature du participe est également remarquable dans les grammaires
de l’espagnol et du portugais. L’accord du participe dans la périphrase avec tener a
conduit, d’abord dans les grammaires espagnoles parues en France, ensuite en Espagne,
à établir des divisions parmi les verbes auxiliaires de l’espagnol (tener et haber pour
l’actif, ser et estar pour le passif), en corrélation avec une polycatégorisation des
participes selon qu’ils s’accordent ou non (Díaz Villalba 2015b). On peut ajouter que,
dans la problématique des doubles participes (réguliers et irréguliers) de l’espagnol et
du portugais, la règle de distribution qui commence à être élaborée dans le dernier
tiers du XVIIIe siècle, n’est pas étrangère aux distinctions catégorielles : l’existence de
deux formes tend à confirmer que ces participes sont de natures différentes. Ainsi,
Figueiredo (1811 [1799] : 91-92) établit deux classes distinctes pour les participes
doubles portugais : le supin se joint aux auxiliaires ter et haver, le participe se joint à
l’auxiliaire ser.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
138
5 Conclusion
42 La catégorisation des mots, dont la macrostructure visible est le système des parties du
discours, constitue un dispositif essentiel de la grammatisation des vernaculaires
romans. Notre étude s’attache à examiner la façon dont les grammairiens adoptent ce
cadre théorique et explicatif pour traiter de nouveaux sujets.
43 La mise en série d’une quarantaine de grammaires, rarement réunies dans l’analyse, est
guidée par la présence d’un même objet : tous les textes proposent un terme
catégorisant, souvent soutenu par une armature théorique, pour conceptualiser la
nature ou les propriétés du participe des TC. Il nous est apparu, dans les textes
sélectionnés, deux grands choix dans la façon de s’approprier les outils de la
catégorisation. Le premier consiste à modifier le système de classification, soit par
l’invention d’une partie du discours (l’option de Nebrija : le nombre participial infinito),
soit par l’introduction de nouvelles subdivisions au sein d’une classe, telles le partizipio
ministro (Correas). Généralement, le traitement de la sous-classe représente la mise en
avant d’une propriété remarquable : partefice passato (Castelvetro) ou terminacion neutra
(Muñoz). Le deuxième choix met à contribution des classes grammaticales (nom,
gérondif, infinitif, supin) qui présentent des caractéristiques aptes à expliquer le
comportement du participe. La recatégorisation du PTC à l’aide de ces étiquettes n’est
d’ailleurs pas incompatible avec le premier choix. Ainsi, l’infinitif passé actif (Meigret)
n’est pas une simple transposition de l’infinitif latin, mais le texte du grammairien
implique une ré-élaboration argumentée de la classe pour expliquer les faits
linguistiques du français. C’est pourquoi, les deux options constituent des possibilités
complémentaires des ressources disponibles dans la boîte à outils qu’est le modèle
fondé en classes et en accidents (propriétés ou catégories grammaticales).
44 Optant pour une approche d’ensemble ou extensive, l’investigation doit être complétée
par des analyses particulières du traitement dans des parcelles de la série. Choisir le
long terme en histoire, c’est aussi se donner les moyens de mieux comprendre la
transmission des choix explicatifs, ainsi que le rythme du changement théorique. Sans
doute l’existence d’une communauté du savoir métalinguistique, issue du transfert du
cadre latin, a-t-elle favorisé la circulation des idées dont témoigne la diffusion de
certaines propositions théoriques.
45 Néanmoins, l’objectif de la présente étude se veut plus général : il s’agit d’une
illustration de l’intérêt de l’histoire comparée des grammaires. Ainsi, l’alignement d’un
ensemble de textes permet de délimiter un objet historiographique dans la
grammatisation des langues romanes, dont on peut affirmer la longévité et la
récurrence.
BIBLIOGRAPHIE
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
139
Sources primaires
Alessandri, Giovanni M. 1560. Il Paragone della lingua toscana et castigliana. Naples : Cancer.
Anonyme. 1966 [1559]. Gramática de la lengua vulgar de España, édition établie par R. de Balbín et A.
Roldán. Madrid : CSIC.
Arnauld, Antoine & Claude Lancelot. 1660. Grammaire générale et raisonnée. Paris : Le Petit.
Bacelar, Bernardo de Lima e Melo. 1996 [ 1783]. Gramática Filosófica da Língua Portuguesa, fac-
similé, éd. établie par Amadeu Torres. Lisbonne : Academia Portuguesa da História.
Ballot, Joseph P. 1796. Gramática de la lengua castellana. Barcelone : Piferrer.
Barros, João. 1540. Grammatica da lingua portuguesa. Lisbonne : Rodrigues.
Beauzée Nicolas. 1765a. Participe. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers dir. par Denis Diderot & Jean Le Rond d’Alembert, vol. 12, 90-99. Paris : Briasson, David, Le
Breton et Durand.
Beauzée Nicolas. 1765b. Supin. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des
métiers dir. par Denis Diderot & Jean Le Rond d’Alembert, vol. 15, 670-671. Paris : Briasson, David,
Le Breton et Durand.
Beauzée Nicolas. 1767. Grammaire Générale, 2 vol. Paris : Barbou.
Bouhours, Dominique. 1675. Remarques nouvelles sur la langue françoise. Paris : Mabre-Cramoisy.
Castelvetro, Lodovico. 2004 [1563]. Giunta fatta al ragionamento degli articoli et de’ verbi di Messer
Pietro Bembo, éd. établie par Matteo Motolese. Roma/Padova : Antenore.
Cauchie, Antoine. 1586 [1570]. Grammaticae gallicae libri tres. Strasbourg : Jobin.
Condillac, Étienne Bonnot de. 1775. Grammaire (Cours d’étude pour l’instruction du Prince de Parme,
vol. I). Parme : Imprimerie Royale.
Correas, Gonzalo. 1984 [1627]. Arte Kastellana, éd. établie par Manuel Taboada Cid. Universidad de
Santiago de Compostela.
D’Açarq, Jean-Pierre. 1760. Grammaire française philosophique, 2 vol. Genève : Moreau & Lambert.
Dangeau, Abbé Louis de Courcillon de. 1927 [1694-1722]. Opuscules sur la grammaire, éd. établie par
Manne Ekman. Uppsala : Almquist & Wiksells.
Denys, le Thrace. 1998. La grammaire de Denys le Thrace, 2 e éd., texte établi et traduit par Jean
Lallot. Paris : CNRS Editions.
Duclos, Charles. 1754. Remarques. Grammaire générale et raisonnée par Antoine Arnauld & Claude
Lancelot. Paris : Prault.
Dumarsais, César Chesneau. 1987 [1729-1756]. Les véritables principes de la grammaire et autres
textes, éd. établie par Françoise Douay-Soublin. Paris : Fayard.
Dumarsais, César Chesneau. 1751. Auxiliaires. Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des
arts et des métiers dir. par Denis Diderot & Jean Le Rond d’Alembert, vol. 1, 903-904. Paris :
Briasson, David, Le Breton et Durand.
Estienne, Robert. 1557. Traicté de la grammaire Francoise. Genève : Estienne.
Figueiredo, Pedro José de. 1811 [1799]. Arte da grammatica portugueza, 3 e éd. Lisbonne : Impressão
Régia.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
140
Irson, Claude. 1656. Nouvelle methode pour apprendre facilement les principes et la pureté de la langue
françoise contenant plusieurs traitez. Paris : Meturas.
Jullien, Bernard. 1849. Cours supérieur de grammaire. Paris : Hachette et Cie.
Lancelot, Claude. 1660a. Nouvelle Methode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue
espagnole. Paris : Le Petit.
Lancelot, Claude. 1660b. Nouvelle Methode pour apprendre facilement et en peu de temps la langue
italienne. Paris : Le Petit.
Lobato, António J. dos Reis. 1770. Arte da grammatica da lingua portuguesa. Lisboa : Regia Officina
Typographica.
Mambelli, Marcantonio. 1685. Osservazioni della lingua italiana. Forlì : Selva.
Maupas, Charles. 1618 [1607]. Grammaire et syntaxe françoise, 3 e éd. Orléans : Boynard et Nyon.
Meigret, Louis. 1980 [1550]. Le traité de la grammaire française, éd. établie par Franz-Josef
Hausmann. Tübingen, Gunter Narr.
Miranda, Giovanni. 1566. Osservationi della lingua castigliana. Venise : de’ Ferrari.
Muñoz Álvarez, Agustín. 1799 [1793]. Gramática de la lengua castellana. Séville : de la Puerta.
Nebrija, Elio Antonio de. 1981 [1492]. Gramática de la lengua castellana, éd. établie par Antonio
Quilis. Madrid : Editora Nacional.
Noboa, Andrés M. de. 1839. Nueva gramática de la lengua castellana segun los principios de la filosofía
gramatical. Madrid : Aguado.
Palsgrave, John. 1852 [1530]. L’éclaircissement de la langue française. Paris : Imprimerie Nationale.
Pillot, Jean. 1561 [1550]. Gallicæ linguæ institutio, latino sermone conscripta. Paris : Etienne Grouleau.
Priscien. 1855-1859. Institutionum grammaticorum libri XVII, vol. 2-3, éd. établie par Heinrich Keil.
Leipzig : Teubner.
Puig, Salvador. 1770. Rudimentos de la Gramatica Castellana. Barcelone : Piferrer.
Ramus, Petrus. 1562. Gramerę. Paris : Wechel.
Real Academia Española. 1984 [1771]. Gramática de la lengua castellana. Madrid : Editora Nacional.
Fac-similé, étude de Ramón Sarmiento.
Régnier-Desmarais, François Séraphin. 1706 [1705]. Traité de la grammaire françoise. Paris :
Coignard.
Restaut Pierre. 1758 [1730]. Principes généraux et raisonnés de la Grammaire françoise. Paris : Vve
Lottin, Desaint et Saillant.
Roboredo, Amaro de. 2002 [1619]. Methodo Grammatical para todas as Linguas, éd. établie par Marina
A. Kossarik. Lisbonne : Imprensa Nacional-Casa da Moeda.
San Pedro, Benito de. 1769. Arte del romance castellano. Valence : Monfort.
Serreau, Jean-Edme. 1799 (floréal an VII). Grammaire raisonnée, ou principes de la langue française,
appropriés au génie de la Langue. Paris : Richard, Caille et Ravier.
Sicard, Roch-Ambroise-Cucurron Abbé. 1808 [1798]. Elémens de grammaire générale, appliqués à la
langue française, 3e éd. Paris : Deterville.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
141
Soave, Francesco. 2001 [1771]. Gramatica ragionata della lingua toscana, éd. établie par S. Fornara.
Pescara : Università Editrice.
Torre y Ocón, Francisco de la. 1728. Nuevo methodo breve, util y necessario para aprender a escribir
entender y pronunciar las dos principales lenguas española y francesa. Madrid : Aritzia.
Vairasse d’Allais, Denis. 1681. Grammaire méthodique. Paris : chez l’auteur.
Vallange, de. 1721 [1719]. Grammaire françoise raisonée. Paris : Jombert, et al.
Vallart, Abbé Joseph. 1744. Grammaire Françoise. Paris : Desaint et Saillant.
Vayrac, abbé de. 1708. Nouvelle grammaire espagnole. Paris : s. n.
Villar, Juan de. 1651. Arte de la lengua española. Valence : Verengel.
Sources secondaires
Chevalier, Jean-Claude. 1999. La notion d’auxiliaire verbal. Origine et développement. Langages
135 : 22-32.
Colombat, Bernard. 2003. Institution de la langue française, Jean Pillot, Gallicae linguae institutio,
1561. Paris : Honoré Champion.
Colombat, Bernard. 2019. Participium. Histoire des parties du discours. Dir. par Bernard Colombat &
Aimée Lahaussois (Orbis Supplementa, 46.), 319-326. Louvain : Peters.
Díaz Villalba, Alejandro. 2012. Le participe dans les grammaires des langues romanes, de la
Renaissance à la grammaire générale (1492-1660). Dans Vers une histoire générale de la grammaire
française. Dir. par Bernard Colombat, et al., 653-670. Paris : Honoré Champion.
Díaz Villalba, Alejandro. 2015a. La catégorie « supin » dans l’Encyclopédie de Diderot et
D’Alembert. Dans Les classifications en linguistique : problèmes, méthodologie, enjeux. Dir. par Angelina
Aleksandrova, et al., 125-143. Bochum : Westdeutscher Universitätsverlag.
Díaz Villalba, Alejandro. 2015b. La classe des verbes auxiliaires dans les grammaires de l’espagnol
en France au XVIIe siècle. Dans La terminología gramatical del español y del francés : emergencias y
transposiciones, traducciones y contextualizaciones. Dir. par Cécile Bruley & Javier Suso López, 97-119.
Franfurt am Main : Peter Lang.
Díaz Villalba, Alejandro. 2017. Le participe dans les grammaires des langues romanes ( XVe-XVIIIe siècles).
Histoire comparée d’une classe grammaticale. Thèse de doctorat. Université Sorbonne Nouvelle et
Universidad de Salamanca.
Fournier, Jean-Marie. 2011. À propos des règles dans les grammaires françaises de l’âge
classique : forme, fonction, statut (le cas de l’accord du participe passé). Dans History of Linguistics
2008, Selected Papers from the Eleventh International Conference on the History of the Language Sciences.
Dir. par Gerda Hassler, 265-276. Amsterdam/Philadelphia : Benjamins.
Fournier, Jean-Marie & Raby, Valérie. 2014. Retour sur la grammatisation : l’extension de la
grammaire latine et la description des langues vulgaires. Dans Penser l’histoire des savoirs
linguistiques. Hommage à Sylvain Auroux. Dir. par Sylvie Archaimbault, et al. 337-350. Lyon : ENS
Éditions.
Fournier, Nathalie. 1998. Grammaire du français classique. Paris : Belin.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
142
Fournier, Nathalie, Samain, Didier & Lahaussois, Aimée. 2019. Article. Dans Histoire des parties du
discours. Dir. par Bernard Colombat & Aimée Lahaussois (Orbis Supplementa, 46.), 165-201.
Louvain : Peters.
Gómez Asencio, José. 2015. Terminología gramatical española de los principios/Principios de la
terminología gramatical española. Dans La terminología gramatical del español y del francés.
Emergencias y transposiciones, traducciones y contextualizaciones. Dir. par Cécile Bruley & Javier Suso
López, 25-74. Franfurt am Main : Peter Lang.
Haßler, Gerda. 2000. Les séries de textes dans l’histoire de la linguistique. Dans Actes du XII e
Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Dir. par Annick Anglebert, et al., vol. 1,
97-102. Tübingen : Niemeyer.
Holtz, Louis. 1981. Donat et la tradition de l’enseignement grammatical. Étude sur l’Ars Donati et sa
diffusion (IVe-IXe siècle) et édition critique. Paris : CNRS.
Tollis, Francis. 1998. À propos des circunloquios du verbe castillan chez Nebrija. Le nombre
participial infinito. La description du castillan au XVe siècle. Villena et Nebrija par Francis Tollis, 91-121.
Paris : L’Harmattan.
Visser, Louise. 2010. The Participle in Latin Grammars in the Early Middle Ages (400-900 AD). A
Linguistic, Philological, and Cultural-historic Study. Thèse de doctorat. Katholike Universiteit Leuven,
Louvain.
NOTES
1. Le terme métaphysique joue un rôle important dans le métalangage grammatical de Dumarsais
(Seguin 1980), dont l’emploi le plus connu se trouve dans adjectif métaphysique, catégorisation
qu’approfondira Beauzée (Fournier et al., 2019 : 177-178) pour traiter ce qu’on appelle aujourd’hui
les déterminants. La désignation noms abstraits et métaphysiques renvoie à une conceptualisation
propre au langage de l’ordre du contenu grammatical ; ces « noms » se distinguent, en vertu de
leur signification méta-abstraite, par exemple dans avoir aimé, des autres noms abstraits (honte,
froid, soif), qui ont une signification lexicale, par exemple, dans avoir honte (Díaz Villalba 2015a).
2. « Le participe est une partie du discours ainsi appelée du fait qu’elle prend une part du nom et
une part du verbe. En effet, il prend du nom les genres et les cas, du verbe les temps et les
significations ; il prend de l’un et de l’autre le nombre et la figure. Six accidents échoient au
participe : le genre, le cas, le temps, la signification, le nombre et la figure. » (Nous traduisons)
3. On rappellera que les verbes communs sont, chez Donat (Holtz 1981 : 635-636), ceux terminés
en −r à la première personne qui peuvent se construire à l’actif ou au passif : criminor te « je
t’accuse », face à criminor a te « je suis accusé par toi ». Les classifications des verbes selon la
diathèse articulent, dans les grammaires latines, des critères formels et sémantiques, pour
arriver à différentes divisions du verbe : actif, passif, neutre, déponent et commun.
4. Chez Priscien, le participe en −tus exprime sous une seule forme les valeurs de prétérit parfait
et de plus-que-parfait.
5. On mentionnera ici le participe « passif » chez Meigret (1980 [1550] : 98) et le « Participe
preterit » chez Estienne (1557 : 72), pour ne citer qu’eux.
6. Par exemple, « actif » chez Meigret (1980 [1550] : 98), « Participe de temps pres[ent] terminé en
ant » chez Maupas (1618, f. 155v). On trouvera un inventaire complet chez Díaz Villalba (2017 :
273-277, 686-687).
7. « Notre langue possède une partie du discours qui ne peut être réduite à aucune des neuf
autres. Elle n’existe pas en grec, ni en latin, ni en hébreu, ni non plus en arabe. Comme elle n’a
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
143
pas encore de nom chez nous, nous osons l’appeler nom participial infini : nom, parce qu’elle
signifie la substance et elle n’a pas de temps ; participial, parce qu’elle est similaire au participe du
temps passé ; infini, parce qu’elle n’a ni genre, ni nombre, ni cas, ni personne déterminés. » (Nous
traduisons)
8. « Le supin, étant la forme active de l’infinitif qui se joint, dans tous les verbes, aux auxiliaires
ter (avoir) et haver (avoir) pour former les temps composés ou temps par circonlocution, n’a pas
de pluriel, ni de terminaison féminine, ce qui le différencie des participes passifs du prétérit :
bien que ces derniers soient formés sur lui, ils comportent les deux genres et des terminaisons,
car la nature du participe consiste en cela. » (Nous traduisons)
9. Sont exclus les auteurs qui catégorisent le PTC comme un simple participe. Nous avons relevé
les étiquettes terminologiques pour les PTC et les sous-classes du participe dans 97 grammaires
(Díaz Villalba 2017 : 680-691).
10. Cette sous-série est composée d’influences : Irson s’inspire de Maupas, Vallart (1744 : 234)
reconnaît l’influence de Dangeau, notamment par l’emprunt terminologique de participe
auxiliaire, et la RAE se fait l’écho de la proposition de Correas, un auteur que l’institution place
dans son horizon de rétrospection (cf. RAE 1771/Sarmiento 1984).
11. « Le participe simple, que nous appelons parfois supin [...] dans les périphrases de la voix
active, signifie l’action, si bien que dire yo e amado (j’ai aimé), c’est comme dire « c’est de moi que
l’action d’aimer est provenue ». (Nous traduisons)
12. Dans ce cas, le terme nominativo n’a pas le sens traditionnel de nominatif, il désigne le nom.
RÉSUMÉS
Les formes participiales des temps composés font l’objet d’un traitement particulier chez les
grammairiens des différentes langues romanes depuis la Renaissance. Les formes participiales
posent en effet un problème assez spécifique, dès lors que dans ces vernaculaires elles présentent
des propriétés incompatibles avec la classe du participe telle que la définit la tradition latine.
Certains proposent de recatégoriser ces formes en leur affectant une désignation ou une nouvelle
classe avec des propriétés plus adaptées. La mise en série des options théoriques relevées dans un
corpus étendu (XVe-XVIIIe s.) tend à souligner l’importance de cette manière d’appréhender les
données qui mettent à l’épreuve le modèle descriptif latin. Par ailleurs, la récurrence et la
commensurabilité des solutions théoriques dans diverses traditions montrent l’intérêt de sortir
du cadre des histoires nationales.
The participles of compound tenses have been the subject of special treatment among
grammarians of Romance languages since the Renaissance. Such forms raise a fairly specific issue
since their properties do not appear to be compatible with the class of participles as the Latin
tradition defines it. Some suggest recategorizing these words by giving them a new designation
or assigning them to a new class with more suitable properties. This study brings together a
series of texts (15th-18th centuries) in which theoretical options are proposed, and it highlights
the importance of recategorization for dealing with data that challenge the Latin descriptive
model. Furthermore, the recurrence and commensurability of theoretical solutions in various
traditions show the interest of going beyond the framework of national histories.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
144
INDEX
Keywords : categorization, Romances languages, grammar, participle, series of texts, compound
tense, grammatical tradition, word class, auxiliary verb
Mots-clés : catégorisation, langues romanes, grammaire, participe, série textuelle, temps
composé, tradition grammaticale, classe de mot, verbe auxiliaire
AUTEUR
ALEJANDRO DÍAZ VILLALBA
Histoire des théories linguistiques (UMR 7597)
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
145
Lettres d’Émile Benveniste à Claude
Lévi-Strauss (1948-1967)
John E. Joseph, Chloé Laplantine, Georges-Jean Pinault, Emile Benveniste
et Claude Lévi-Strauss
1 Nous publions ici les lettres d’Émile Benveniste à Claude Lévi-Strauss 1, conservées par
ce dernier et qui sont consultables (sous réserve d’autorisation) à la Bibliothèque
nationale de France dans le Fonds Claude Lévi-Strauss sous la cote NAF 28150 (183) 2.
Malheureusement il n’a pas été possible de publier les lettres de Lévi-Strauss à
Benveniste, toute la correspondance reçue par Benveniste ayant disparu 3. La
correspondance publiée ici (et qui est possiblement incomplète) débute en 1948, aux
lendemains de la soutenance de la thèse de doctorat d’état de Lévi-Strauss 4, par une
discussion concernant l’organisation de la parenté indo-européenne, et se poursuit
jusqu’en 1967. D’après la correspondance Jakobson / Lévi-Strauss publiée par
Emmanuelle Loyer et Patrice Maniglier et complétée par Pierre-Yves Testenoire 5, où il
est souvent question de Benveniste, les deux hommes se rencontrent en 1946, et
commencent à échanger en 19476 dans le contexte de l’écriture de la thèse sur la
parenté, Benveniste apportant à Lévi-Strauss sa connaissance du domaine indo-
européen7. En effet, de 1945 à 1952 Benveniste poursuit au Collège de France 8 un
enseignement sur le « vocabulaire des institutions indo-européennes », développant
chaque année une étude particulière de tel ou tel domaine institutionnel. Ces études
seront publiées en 1969 dans l’ouvrage du même nom9 et la question de la parenté indo-
européenne y occupe un long chapitre10 ; elle fait également l’objet d’un article
spécifique publié en 1965 dans L’Homme11.
2 Au dire de Lévi-Strauss (se confiant à Jakobson), Benveniste était le seul membre de son
jury de thèse à même de suivre la démarche d’analyse développée dans les Structures
élémentaires : « Je ne vous parle pas de la soutenance : ce fut une longue corvée, et
Benveniste a été le seul membre du jury à comprendre ce que j’ai voulu faire 12 ». Cette
compréhension mutuelle ne se limite pas à la thématique de la parenté qu’ils abordent
tous les deux, mais elle tient à leur manière de l’aborder. En effet, à plusieurs reprises
Benveniste confie à Lévi-Strauss qu’il entrevoit dans l’approche structurale qui guide
ses recherches un avenir ouvert pour les sciences humaines : « Je ne sais quel accueil y
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
146
feront les ethnologues qualifiés, mais je crois que tôt ou tard la méthode d’analyse
structurale s’imposera ici comme ailleurs et que vous aurez le mérite d’avoir ouvert
une voie neuve. Votre ouvrage alimentera les discussions les plus fécondes, d’où non
seulement ce problème, mais quantité d’autres sortiront transformés ». Ailleurs,
Benveniste conçoit la « structuralisation » comme une « des qualités que l’ethnologie
est en train d’acquérir13 ».
3 Le structuralisme n’a jamais eu une définition unanimement acceptée. Celui de Lévi-
Strauss, relativement constant, ne coïncide pas avec celui de Benveniste, toujours en
évolution depuis les années 1930 jusqu’à la fin des années 1960, quand il n’est plus
évident qu’il reste structuraliste du tout14. Son enthousiasme pour la démarche de Lévi-
Strauss est donc assez surprenant, mais témoigne de sa capacité à apprécier un type
d’analyse qui n’est pas le sien mais qui rend possible une percée scientifique dans un
champ où il a un vif intérêt – l’analyse culturelle – et ne réclame pas une unique
autorité. Comme Benveniste, Lévi-Strauss rapprochait ethnologie et linguistique,
contre la pratique traditionnelle qui reléguait la linguistique aux marges. Dans le cas de
Benveniste, on doit identifier sa fidélité à un héritage intellectuel au moins double,
d’une part l’enseignement de Meillet, relatif à la dimension sociologique de la
linguistique, et d’autre part la lecture de Marcel Mauss, qui orientait davantage vers
l’anthropologie.
4 Un mois après sa soutenance de thèse, Lévi-Strauss rapporte à Jakobson une discussion
à propos de la comparaison des structures linguistiques (sud-asiatiques, indo-
européennes, américaines) et des structures de la parenté : Benveniste « considère le
parallélisme sans signification parce que, dit-il, la structuration n’existe dans la langue
qu’au niveau des éléments différentiels et qu’on ne peut la retrouver au niveau de la
grammaire ou du vocabulaire. Il ne pense donc pas qu’il y ait des structures formelles
coextensives au champ entier de la pensée inconsciente15 ». Dans son texte « L’analyse
structurale en linguistique et en anthropologie16 » publié en 1945 dans le premier
numéro de la revue Word et qui fonde l’approche structurale en ethnologie, ou dans
« Histoire et ethnologie17 », Lévi-Strauss fait de la reconnaissance du caractère
inconscient des faits linguistiques et sociaux une base essentielle de l’analyse
structurale18, et c’est dans la phonologie de Troubetzkoy et surtout dans les propos sur
l’inconscient linguistique formulés par Boas dans l’Introduction au Handbook of
American Indian Languages19 qu’il voit l’émergence de ce principe d’analyse. Benveniste
se montre enthousiaste concernant les réflexions de Lévi-Strauss – « Est-il besoin de
vous dire que j’adhère à ce que vous dîtes du caractère inconscient des faits
linguistiques et sociaux. Vous devriez une fois traiter en détail le problème du
symbolisme dans les faits sociaux20 » –, mais lorsqu’il parle de l’inconscient dans un
article qu’il a écrit pour une nouvelle revue lancée par Jacques Lacan (La Psychanalyse),
ce sera dans un cadre freudien ; et quant au social, Benveniste insistera dans ses
derniers écrits et ses dernières conférences sur le fait que « la langue contient la
société », comme il le démontre à chaque page du Vocabulaire des institutions indo-
européennes, et sur le fait que les autres systèmes sémiologiques ont besoin de la langue
comme interprétant. Ce ne sont pas les préoccupations de Lévi-Strauss ; on ne peut
parler ni d’une dispute, ni même d’un dialogue. L’analogie la plus apte est peut-être
avec les « monologues collectifs » de Piaget.
5 Lévi-Strauss joue un rôle dans la mise en œuvre de certains projets de Benveniste en
Amérique du Nord : il le met en relation en février 1950 avec Edward D’Arms de la
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
147
Fondation Rockefeller21 ; cette institution soutiendra son invitation à enseigner au
Summer Institute de la Linguistic Society of America à Ann Arbor de juin à août 1950,
un projet de conférence américano-européenne sur la sémantique (1950-1951), et deux
séjours de plusieurs mois sur la côte Nord-Ouest où Benveniste enquêtera sur
différentes langues : Haida, Tlingit, Gwich’in, Inupiaq (1952 et 1953) 22.
6 Les lettres publiées ici font aussi référence à la collaboration des deux hommes autour
de la revue L’Homme. Revue française d’anthropologie (fondée par Benveniste, Pierre
Gourou23 et Lévi-Strauss) et du long processus de sa mise en route. Il en est question dès
194924 ; le premier numéro de la revue paraîtra en 1961. C’est une revue
d’anthropologie originale en ce qu’elle donne une place importante aux approches
linguistiques de la culture. C’est dans cette revue que paraîtra en 1962 l’article de
Jakobson et Lévi-Strauss sur Les Chats de Baudelaire, que Benveniste a relu en donnant à
Lévi-Strauss une liste de commentaires qui seront publiés partiellement en note de
l’article, et qu’on reproduit ici intégralement (21). Quelques années plus tard, en 1967,
Benveniste entreprendra sa recherche sur « la langue de Baudelaire » en distinguant sa
démarche, la recherche d’une structure profonde, de celle de Lévi-Strauss et Jakobson 25
qui abordent le poème comme un objet et le démontent en révélant ses structures
formelles. Benveniste s’intéresse à la manière dont est fait le poème, mais en même
temps cette recherche n’est pas dissociée de la question de ce que fait le poème, mettant
le sujet au cœur de l’analyse26.
7 Dans l’hommage qu’il rend à Benveniste en 1976 dans L’Homme – et cet hommage prend
tout son sens en ce qu’il est publié dans ce journal et en rappelle le projet initial –, Lévi-
Strauss n’est pas loin de dire que le Vocabulaire des institutions indo-européennes est un
livre d’ethnologie et que Benveniste est un ethnologue des langues et du langage : « Cet
illustre spécialiste des langues indo-européennes portait un vif intérêt à l’ethnologie,
comme en témoignent la place non négligeable qu’occupent dans ses travaux des
langues africaines et amérindiennes – ces dernières, étudiées par lui sur le terrain en
Colombie britannique et en Alaska – et les enseignements ethnologiques que, tout au
long de sa vie, il ne cessa de demander à la philologie comparée. A cet égard, il n’est pas
excessif de dire que son ouvrage en deux volumes sur le Vocabulaire des institutions indo-
européennes apporte à l’anthropologie sociale une contribution d’importance majeure.
Cette orientation constante explique qu’en 1948, il ait bien voulu accepter de siéger au
jury de soutenance de ma thèse sur les structures élémentaires de la parenté 27 ».
(1)
1 rue Monticelli (14e) Paris le 5 Juin 48
Cher Monsieur,
Que de ma courte et bien inutile intervention à votre soutenance il reste au moins
deux ou trois remarques sur des points de détail. Vous trouverez sur la feuille
jointe28 le texte dont je me suis servi et l’indication de la source. En outre, il y aurait
lieu de rectifier en partie ce que vous dites des sapiṇḍa (p. 684 sq.). Le mot piṇḍa ne
signifie pas “corps” ou il n’a cette acception que tardivement et par transposition
métaphorique du seul et vrai sens qui est “boulette d’offrande 29”. Les sapiṇḍa sont
ceux qui sont unis par l’obligation de l’offrande cultuelle du piṇḍa. Vous pourriez
donc, si vous êtes encore maître de votre manuscrit, faire l’économie <au bénéfice
de votre démonstration> de toute la page où vous essayez d’interpréter sapiṇḍa en
fonction du sens fictif de “corps”.
J’aurais aussi quelques réserves à faire sur l’assimilation <(p.675 sq)> des “couleurs”
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
148
des castes ou classes aryennes avec les (Os) blancs et noirs 30. J’ai l’impression qu’il
s’agit de choses différentes. Les “couleurs” aryennes sont emblématiques de classes
ou d’états, non de fractions tribales ou de “moitiés”. Il ne faudrait pas non plus tirer
du texte indien que vous citez (je n’ai malheureusement plus votre ms.) une
équivalence trop précise entre l’opposition ārya / dāsa et celle blanc / noir. La
couleur qui est ici celle du visage n’est qu’indirectement impliquée dans une
opposition qui n’est, littéralement prise, qu’ethnique.
Enfin sur les transcriptions de mots sanskrits : écrire gotra (sans signe de longue)
et svayaṃvara (sans signe de longue non plus).
Un mot encore. La position que vous prenez vous donne incontestablement le
droit de juger vos devanciers. La justice coïncide-t-elle avec le jugement qui énonce
« Malinowski, avec la légèreté qui le caractérise … » ? L’œuvre de Malinowski n’est-
elle vraiment <">caractérisée<”> que par la légèreté ?
Mes félicitations encore pour votre brillante soutenance et mes remercie-/ments
pour les indications relatives au Handbook de Boas.31
Croyez-moi, je vous prie, votre cordialement dévoué,
EBenveniste
(2)
1 rue Monticelli (14e) Paris le 16 juin 1948
Cher Monsieur,
Pour répondre à votre question, il m’a fallu me reporter à Herzfeld 32 et à divers
ouvrages que je n’avais pas sous la main. La liste de Videvdad (ou Vendidad) XII
pose au moins en effet une question qui demandait examen et quand je vous ai
donné la traduction généralement admise des termes de parenté (d’après
Bartholomae33), je n’ai pas tenu compte d’une discordance qui se manifeste entre le
sanskrit et l’avestique dans l’acception d’un terme.
Voici donc les termes dans leur séquence exacte et dans leur forme :
Vd. XII, I pitō … māta « père ; mère »
3-4 puθrō … duγδa « fils ; fille »
5-6 brāta … xvaŋha « frère ; sœur »
7-8 nmānō.paitiš … nmānō.paθnī « maître de maison ; maîtresse de maison »
9-10 nyāka … nyāke « grand-père ; grand-mère »
11-12 napō … naptī « petit-fils ; petite-fille »
13-14 brātruyō … brātruye « fils du frère ; fille du frère »
15-16 tūiryō … tūirya « frère du père ; sœur du père »
17-18 tuiryō.puθrō … tūirya.duγδa « fils du frère du père ; fille du frère du père »
19-20 tūirya puθrō vā puθrō … tūirya.duγδairi « fils du fils du frère du père ; fille du
fils du frère du père »
Voilà la liste des nabānazdišta (les plus proches du nombril ou par le n. 34)
1) Il faut observer que en skr. bhrātṛvya signifie certainement « fils du frère du
père » (cousin parallèle), mais ce sens ne peut être admis en iranien bien que la
forme soit identique35. Vous observerez que s’il fallait calquer le sens de av. brātruya
sur skr. bhrātṛvya, on ne distinguerait plus brātruyō du terme tūirya puθra qui
désigne sûrement le « fils du frère du père ». Il faut donc admettre que brātuirya a
été ramené à « fils du frère » et c’est ce que confirment les formes / modernes
comme pašto wrōrә « fils du frère36 ». Herzfeld a donc raison de rendre brātuirya par
« brother’s son ». Mais attention : il cite (p. 112 en haut) comme preuves skr.
bhrātṛvya et lat. fratruus. Or skr. bhrātṛvya a un tout autre sens et lat. « fratruus »
n’existe pas. C’est malheureusement souvent ainsi chez Herzfeld.
2) L’expression complexe de 19-20 doit avoir très vraisemblablement le sens que je
lui donne pour le premier terme (masculin) tūirya puθrō vā puθrō bien que la langue
soit bizarre ; mais l’équivalence féminine tūirya.duγδairi est traduite au jugé par
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
149
simple féminisation du terme précédent. Il n’y a pas d’autre exemple du mot
duγδairi37. Il faut donc décider entre « fille du fils du frère du père » et « fille de la
fille du frère du père », ce qui est différent. Votre expérience de ces problèmes vous
inspirera sans doute un avis.
Vous avez sans doute raison pour le texte de la Mimāṃsa [sic 38]. Il m’est soudain
revenu en mémoire la veille de votre soutenance. Je l’ai copié hâtivement et sans
reproduire les signes de longues qui distinguent deux noms propres et le relisant le
matin, il m’a semblé poser une question dont je vous ai fait part 39. Mais Vāsudeva est
certainement fils de Vasudeva et le problème est tout autre comme vous le dites.
Il faut donc se résigner, comme je le vois, à ne retenir de Malinowski, que les
données d’observation. C’est signe, après tout, que l’ethnologie se rigorise. Votre
beau travail en est la preuve.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien dévoué,
EBenveniste
(3)
1 rue Monticelli (14e) Paris le 24 juin 1948 40
Cher Monsieur,
Il me semble que la manière dont vous appréciez les relations des nabānazdišta
rend bien compte, à l’intérieur de la structure iranienne, de cette exogamie
régulièrement contaminée d’endogamie qui caractérise la société avestique, au
moins dans ses représentants nobles41. La filiation patrilinéaire est certaine. Le
point intéressant est de pouvoir faire ressortir, par l’analyse des relations de
parenté, la fréquence des mariages consanguins.
J’ai cherché à préciser le problème des nabānazdišta, mais n’ai pu découvrir malgré
mes recherches de texte plus explicite que celui qui vous occupe. Il reste un
problème, mais qui ne comporte pas en ce moment, pour la même raison, de
solution : celui de la dénomination de nabānazdišta. Celle-ci est purement
iranienne : la forme correspondante du skr. n’est attestée que dans un nom propre
Nabhānediṣṭhaḥ et n’enseigne rien42. On est conduit à se demander si ce n’est pas là
la désignation spécifique de la parenté telle qu’elle résultait de ce type de mariage.
On ne peut que poser la question.
Un autre point mérite l’attention, surtout à cause de faits connexes qu’il évoque.
Nous avons affaire à une parenté qui se manifeste à l’occasion du deuil. Or je suis
intrigué depuis un certain temps par un fait singulier de la terminologie grecque,
qui est sans parallèle à ma connaissance. En grec, un même terme 43 désigne la
parenté par alliance et le deuil. La notion de rendre les derniers devoirs et celle de
s’allier par un mariage ont la même expression. Est-ce le reflet d’une exogamie
stricte, selon laquelle le clan où je prends femme assume l’obligation d’ensevelir
mes morts à charge de réciprocité ? Connaît-on d’autres exemples de prestations
funéraires aussi rigoureusement liées à l’échange de femmes ?
Il y a quelques jours, avant d’avoir reçu votre lettre, j’ai eu l’occasion de voir M.
Dumézil44 et d’évoquer avec lui les noms de ceux qui pourraient assumer les
enseignements vacants à la Ve section. Le vôtre a naturellement été prononcé, / et
j’ai dit ce que je pensais d’une œuvre que M. Dumézil n’était pas encore à même de
connaître, mais sur laquelle son sentiment sera, on peut le présumer, favorable.
Veuillez me croire, cher Monsieur, votre bien dévoué,
EBenveniste
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
150
(4)
Collège de France Paris, le 21 avril 49
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli (14 e)
Cher Monsieur,
La question que vous voulez bien me poser, et qui a de suggestifs prolongements,
ne laisse pas de m’embarrasser. Vous savez qu’on a beaucoup discuté sur la forme
du δέπας ἀµϕικύπελλoν, et que les <commentateurs> anciens, non plus que les
modernes, n’en avaient probablement jamais vu45. Je ne puis que vous indiquer
deux précisions de fait.
1) L’expression se retrouve chez Homère en bien d’autres endroits que les quatre
que vous mentionnez. Voici la liste complète : Iliade A 584 Z 220 I 656 Ψ 219, 656,
663, 667, 699 – Odyssée γ 63 o 102, 120 ν 57 cf. θ 89 χ 86 υ 183. Il faudrait en outre
tenir compte de l’expression, qui a été considérée comme synonyme, ϕιάλη
ἀµϕίθετoς Ψ 270, 616.
2) ἀµϕικύπελλoς signifie littéralement « qui est pourvu, de part et d’autre (ἀµϕι),
d’une coupe (κύπελλoν) », donc, « vase à double coupe46 ». Est-ce, comme vous le
suggérez, « une coupe faite de deux récipients accolés » ? Mettons, si vous voulez,
un récipient <à boire> formé de deux coupes accolées 47. Voilà à peu près ce que le sens
littéral permet d’imaginer. Mais comment se représenter matériellement l’objet ?
L’avis d’un helléniste archéologue (M. Chapouthier par exemple) 48 serait précieux. Il
faudrait connaître l’état actuel d’un débat qui n’a pas dû cesser chez les
archéologues et sur lequel je n’ai pas d’information.
Voilà le peu que je me hasarde à vous dire, regrettant de ne pouvoir être plus
affirmatif. Mais l’idée d’une relation avec des cultes est ingénieuse et mériterait
d’être poursuivie si les données matérielles autorisent une représentation précise.
Je dois me rendre en Angleterre la première semaine de Mai, mais pour un court
séjour49. A mon retour, vers le milieu du mois, nous pourrons nous entretenir de
l’état de la revue.
Croyez, cher Monsieur, à mes cordiaux sentiments,
EBenveniste
(5)
Collège de France Paris, le 6 Août 49
Chaire de grammaire comparée 1 rue Monticelli (14 e)
Cher Monsieur,
Je veux, d’un mot au moins, vous dire combien j’ai trouvé d’intérêt à relire, cette
fois « objectivés » par la forme imprimée, vos deux travaux, la description si
suggestive des Nambikwara où une analyse très stricte ne fait pas tort à la
sympathie humaine, et surtout le beau livre sur la parenté. Je ne sais quel accueil y
feront les ethnologues qualifiés, mais je crois que tôt ou tard la méthode d’analyse
structurale s’imposera ici comme ailleurs et que vous aurez le mérite d’avoir ouvert
une voie neuve. Votre ouvrage alimentera les discussions les plus fécondes, d’où
non seulement ce problème, mais quantité d’autres / sortiront transformés.
Avec tous mes souhaits pour le développement de vos recherches et mes
sentiments cordiaux,
EBenveniste
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
151
(6)
Collège de France Paris, le 22 Janvier 50
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher Monsieur,
J’ai lu avec grand intérêt les deux travaux que vous m’avez aimablement
communiqués. Dans le Southwestern J. of Soc. l’article de Capell est riche de faits
instructifs que j’aimerais discuter par écrit et en tout cas utiliser 50. Mais pour
l’instant je n’en ai pas le loisir.
Le travail de Garvin sur le Ponape est un bon exemple de monographie strictement
descriptive et conduite selon la méthode bloomfieldienne orthodoxe 51. C’est une
étude de bonne qualité, encore qu’elle ne soit pas complète, surtout dans la partie
syntaxique. Le problème me paraît surtout pratique et d’ordre financier : une étude
longue et d’impression coûteuse ne risque-t-elle pas / d’obérer dangereusement les
ressources de L’Homme dès le début ? Et si on la mettait en réserve pour un des
exercices à venir, l’auteur accepterait-il de se voir renvoyé à une date imprévisible ?
Je me suis demandé si on ne pourrait pas se borner à une partie seulement, en
retranchant p. ex. les conversations-phonogrammes, utiles mais vraiment longues
et les portions trop techniques. Mais ce serait peu seyant et l’auteur n’accepterait
probablement pas.
Vous avez mon avis – ou plutôt mes inquiétudes. J’ai peur que cette dépense, si on
l’entreprend, ne paralyse pour longtemps l’effort de l’« Homme ».
Je vous dépose les deux travaux à l’Ecole.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien cordialement dévoué,
EBenveniste
Lundi soir. J’ai trouvé au Collège votre article de la Rev. de Métaph. 52, dont je vous
remercie. Vous posez avec / lucidité un problème de grande portée. La critique de
Malinowski est pertinente. Mais je ne suis pas certain que vous ne fassiez pas
l’histoire plus belle qu’elle n’est, en lui prêtant implicitement quelques unes des
qualités que l’ethnologie est en train d’acquérir – la structuralisation et tout ce qui
en découle53 –, de quoi les historiens actuels me paraissent loin d’avoir pris
conscience. – Est-il besoin de vous dire que j’adhère à ce que vous dîtes du caractère
inconscient des faits linguistiques et sociaux 54. Vous devriez une fois traiter en
détail le problème du symbolisme dans les faits sociaux.
(7)
Le 3/4/50
Cher Monsieur,
La fin des cours me permet enfin de souffler. J’ai à vous remercier de votre
instructive observation sur mon article de la RHR55. Sans doute aurais-je dû
dissocier explicitement la légende rapportée par Eschyle, Pindare etc. de l’épisode
mythologique, qui me paraît tout différent. Je ne saurais dire comment ni pourquoi
les deux se sont associés, mais je doute qu’on puisse donner de l’ensemble
une explication unique et cohérente.
J’aurais également dû insister sur l’optique différente sous laquelle nous
envisagerons les Suppliantes, selon que nous nous interrogeons sur les intentions
d’Eschyle ou sur la motivation réelle de la légende. Il est bien certain que le poète
n’a / pas songé à émouvoir les Athéniens avec un drame du cousinage croisé. C’était
des « suppliantes » qu’il s’agissait pour lui, du drame des fugitives et de la
protection à leur accorder, même au risque d’une guerre, et cela faisait revivre une
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
152
légende royale que beaucoup devaient connaître. En développant ce thème tout
humain, et pour animer son action, Eschyle instaure un débat où, tout
naturellement en Attique, le problème est posé tel qu’il devait se poser, quand une
fille se trouvait héritière. Là est l’adaptation de la légende au droit du temps. Cela
est instructif pour les rapports d’Eschyle avec son temps et son public, mais non
pour l’interprétation du drame réel, tel que je le comprends. On ne peut donc voir
ici « double jeu » de la part des Danaïdes : elles jouent consciemment l’épiclérat,
elles jouent l’endogamie sans le savoir. Toutes / les références que j’ai réunies à
l’appui de l’interprétation proposée nous sont données par Eschyle malgré lui. Il n’a
certainement pas posé le débat entre l’endogamie et l’exogamie. Mais les traits qu’il
rapporte soulignent que tel est bien le fond du problème.
Quand bien même – pour revenir aux termes de parenté – mon étude n’aurait que
la valeur d’une position linguistique du problème, je ne croirais pas devoir m’en
dispenser. Il s’agit essentiellement de montrer qu’il y a parenté classificatoire
jusque peu avant les systèmes historiques. Le reste vous appartient.
Croyez, cher Monsieur, à mes sentiments cordiaux,
EBenveniste
(8)
1 rue Monticelli 14e Le 7/2/52
Cher Monsieur,
J’ai lu avec un vif intérêt vos ingénieuses considérations sur l’agencement des
éléments dans le vocabulaire des parties du corps en kepkiriwat. 56 Mais je me sens
très embarrassé pour formuler un avis. Non seulement je ne connais de cette langue
que ce que vous en citez, mais dans ma lecture je me suis heurté à des difficultés de
principe auxquelles je ne sais si une réponse est possible. Je me borne à les énoncer.
La principale est celle-ci : comment analyser les mots ? C’est-à-dire comment
analyser les morphèmes ? Il faudrait procéder à une comparaison systématique de
ces termes corporels avec le reste du vocabulaire, sans notion préconçue, et voir en
particulier selon quels principes s’agencent les éléments identifiables. Il se peut par
exemple que des morphèmes qui ont l’air identiques ne puissent l’être en toute
position et remplissent selon leur répartition des fonctions distinctes : je pense p.
ex. à kap qui apparaît <entre> uzabilisep « cils » et uzabilikapsep « sourcil » et qui ici
ne se ramène pas facilement à la définition générale indiquée p. 13.
Une autre difficulté, connexe d’ailleurs à la précédente, résulte de l’incertitude où
l’on est quant à la structure générale de la langue. Y a-t-il des préfixes, des
suffixes ? Voici un fait précis. Vous notez une différence singulière entre un groupe
de termes, obtenus en indiquant les parties du corps de l’informateur, et un autre
groupe qui se rapporte au corps d’animaux dépecés. Ceci me suggère
immédiatement une conjecture, que vous avez peut-être envisagée. Cette différence
est une différence entre deux préfixes possessifs. Les mots de la première série,
commençant tous par u-, se réfèrent au corps de l’informateur ; ici « bras » doit
signifier « mon bras ». Ceux de la deuxième série, appliqués à un animal, auraient un
s- qui serait le possessif de 3 e sg. Et ici le mot traduit « estomac » serait « son
estomac ». Ce n’est qu’une hypothèse, mais a priori les noms de parties du corps,
obtenus de cette manière, doivent être munis d’indices de possession. Ceci
modifierait passablement l’interprétation des termes.
Il y a aussi dans ce vocabulaire des discordances : pour « cils » on trouve à la fois
unzapisep (p. 11, 12) et undjakapsep (p.13), sans différence ? – Dans les formes
énumérées p. 7, je soupçonne que les traductions doivent être rectifiées : sur quoi
repose l’interprétation d’une série de formes par des infinitifs, d’une autre par un
impératif (tisser / pose-le …), quand la finale est identique ? A-t-on des raisons
d’écrire en un mot umambikutangen et en deux unanbu kutanga ? Et d’une manière
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
153
générale ces formes ont-elles été obtenues dans des conditions qui permettent
d’exclure des expressions complexes quand on attendait des termes simples ? par
exemple, l’informateur a-t-il donné « poing » simplement ou « je ferme le poing » ?
Il est fort possible qu’il y ait à la base d’un grand nombre de ces termes, comme
vous le supposez, certains procédés de composition analogues à ceux du guato. C’est
à des problèmes préliminaires que je m’arrête, car toute l’analyse en dépend, et je
ne le fais que pour assurer les bases d’une interprétation. Il faudrait en tout cas un
examen de tous les faits recueillis pour déterminer les classes de formes
(nominales, verbales, simples, composées, suffixées, etc.) et procéder plus sûrement
à l’analyse de ces termes.
Croyez toujours, cher Monsieur, à mes sentiments cordialement dévoués,
EBenveniste
(9)
Le 11 Février 1952
Cher Monsieur,
Surtout ne croyez pas que mes observations impliquent une critique du procédé de
représentation que vous proposiez57. Simplement une réserve sur la possibilité de
justifier une analyse morphologique rigoureuse. Je me suis donc tenu très en deçà
du plan où vous portiez la discussion, en me bornant à voir si le matériel lexical
(dont je sais dans quelles conditions difficiles il a été recueilli) permettait
d’identifier à coup sûr les éléments en combinaison. Il serait néanmoins intéressant
de vérifier votre interprétation dans une langue beaucoup mieux connue, comme
l’algonkin, où l’analyse est assurée pour l’essentiel. Vous en auriez l’occasion en
travaillant cette année auprès de Voegelin58.
J’ai décliné une proposition américaine pour l’été prochain. Si j’y allais, je voudrais
pouvoir enquêter chez les Indiens, mais c’est inconciliable avec une période
d’enseignement, et j’ai beaucoup à faire ici.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre cordialement dévoué,
EBenveniste
(10)
14/11/53
Au cours de mon enquête59, qui a été longue et dure et assez fructueuse, je n’ai pas
perdu de vue la question qui vous intéressait. Chez les Tlingit, pas de réaction
caractérisée au corbeau zoologique. Mais en athapaske du nord, chez les
« Loucheux » du Haut Yukon, un indice curieux : le corbeau est nommé
descriptivement « excréments autour de la bouche60 », car, disent ces chasseurs-
trappeurs, le corbeau ne vit que de charogne, il est incapable de tuer quelque être
que ce soit. Cela n’empêche pas le corbeau mythologique d’avoir l’importance que
vous savez.
Croyez, cher Monsieur, à mes sentiments cordiaux,
EBenveniste
(11)
1 rue Monticelli 14e Le 20 Déc. 55
Cher Monsieur,
J’ai commencé votre livre61 pendant les heures lucides que me laissait une récente
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
154
convalescence, et d’une page à l’autre, d’un chapitre au suivant, j’ai retenu
longtemps, pour arriver au bout d’une lecture captivante, le remerciement que je
vous devais. Et maintenant je ne saurais plus louer comme il faudrait ce livre si
riche, où tous les genres se mêlent, où les pages les plus désintéressées vibrent d’un
accent personnel. On voudrait commenter à chaque page tout ce que vous offrez à
foison, les descriptions ou les méditations. Mais on se sent entraîné à imaginer, au
delà de ce qu’on lit, le destin possible d’un ouvrage qui ouvre tant de problèmes. La
belle et haute méditation où il s’achève éclaire un aspect de notre civilisation qui
n’apparaît si lucidement que parce qu’il en présage la fin probable, et peut-être
votre livre hâtera-t-il une prise de conscience qui précipitera cette fin. Vous avez
enrichi la littérature ethnographique d’un témoignage qui retentira dans la
conscience des ethnographes et sans doute la transformera. On regrette seulement
qu’un livre pareil risque d’être confondu – en partie à cause d’un titre qui ne me
semble pas des plus heureux – avec tant de relations qu’il dépasse de si loin. Mais
j’ai confiance que ceux qui sont aptes à le lire sauront le découvrir, et non pas
seulement en France.
– J’ai bien reçu votre lettre au sujet de l’Homme. L’arrangement que vous envisagez
avec Plon me paraît heureux, puisqu’il sauvegarde la nature scientifique de la
collection, tout en lui assurant une diffusion meilleure, et je suis heureux que vous
ayez obtenu un crédit appréciable pour faire repartir la Collection. Je souhaite que
les manuscrits retenus soient de qualité – mais votre choix en est garant. Je vous
donne donc mon accord pour que l’Homme passe chez Plon aux conditions que vous
mentionnez.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre amicalement dévoué,
EBenveniste
PS. Je suis affligé d’un œil qui ne peut rien sauter dans une lecture. J’espère que,
pour une nouvelle édition de votre livre, une gracieuse Nambikwara consentira à
dévorer la dernière lettre du « poux » (p. 298 fin), et que vous transfériez à « sans
que je m’aperçus » (p. 315) l’appendice gênant de « se départissait » (p. 284). Est-ce
pour préparer la tâche d’un futur traducteur qu’il y a un anglicisme p. 357 « il
s’exprime par et trouve … dans un jeu … » ? Excusez ces vétilles.
(12)
1 rue Monticelli 14e Le 10/10/56
Cher Monsieur,
J’ai à vous remercier de l’envoi de votre remarquable étude sur les organisations
dualistes62, qui pose un important problème en termes qui le rendent non
seulement accessible, mais instant pour d’autres que les sociologues aussi. J’espère
que cette vigoureuse démonstration suscitera en anthropologie un débat – où je me
garderai bien d’entrer. Mais depuis que je vous ai lu, je suis en proie à des
perplexités que, faute de connaître d’assez près les faits que vous articulez, je ne
saurais même formuler exactement. Voici le type de questions que je me pose : 1°)
est-il vraiment possible de réduire l’un à l’autre les systèmes qui commandent les
organisations diamétrales et concentriques respectivement ? La notion de centre, et
de cercle autour d’un centre, me semble quelque chose d’hétérogène et
d’irréductible ; il détermine un autre type de structure logique, qui ne répond pas et
ne se ramène pas à la structure bipartie des organisations dualistes – ni
inversement. – 2°) La division établie sur l’opposition : proximité / éloignement du
centre ne paraît pas avoir le même sens que la division : possibilité / impossibilité
du mariage ; 3°) Les organisations triadiques, d’après vos exemples, peuvent fort
bien coexister dans une société avec une structure dualiste ; elles n’ont pas le même
objet ; est-il donc nécessaire d’imaginer que ce dualisme est toujours un triadisme
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
155
dégénéré ou simplifié ? 4°) Pourquoi (p. 119-120) les oppositions du type
« logiquement hétérogènes » (« stabilité / changement », etc.) seraient-elles moins
recevables dans la symbolique sociale que celles de gauche / droite, été / hiver –. Au
fond, guerre et paix ; création et conservation du monde ; cru et cuit sont <termes>
aussi complémentaires que haut et bas, aîné et cadet. 5) Ceci en marge de votre
argumentation et sans rapport précis avec votre raisonnement : je me demande s’il
ne serait pas possible de découvrir dans une relation triadique concrète,
identifiable sur un point quelconque du monde, / entre deux termes opposés et
complémentaires, un troisième qui serait la « neutralisation » de l’opposition. Si
c’est concevable et démontrable, ce que je ne sais, ce serait une trouvaille de grande
portée théorique, et qui en outre, concilierait d’un coup dualisme et triadisme.
Peut-être n’ai-je pas su voir que toutes ces questions avaient déjà leur réponse dans
vos pages ? Ne doutez pas en tout cas de l’intérêt que j’ai pris à vous lire.
– J’en viens maintenant à votre note au sujet de L’Homme. Mon accord vous est
acquis, puisque vous avez retenu ces mss. Une seule observation : est-il prudent de
publier des plaquettes dans cette série ? Car plaquettes deviendront des mss. de
30 p. dactyl., donc à peine 18-20 pages d’impression large, comme les 3 derniers
mentionnés. Ce serait admissible pour des écrits doctrinaux (j’aurais très bien vu
votre article publié ou republié* <[en marge] *oui, pourquoi pas ?> sous cette
forme), moins pour des contributions spécialisées. Ne vaudrait-il pas mieux en
grouper deux ou trois – qui auraient quelque affinité – sous une même couverture ?
Je pose simplement la question, qui est d’ordre pratique.
Croyez-moi, cher Monsieur, votre bien cordialement dévoué,
EBenveniste
(13)
Collège de France Paris, le 3/2/59
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher Monsieur,
J’apprends avec satisfaction que la chaire est créée63 ; cette fois la création s’est
faite, me semble-t-il, dans des délais assez courts, mais naturellement il ne sera pas
question d’une nouvelle visite64. Aucun problème ne devrait surgir maintenant, et la
seconde étape vous acheminera au but.
– Il serait dommage de renoncer à éditer l’Homme en France ; je ne sais rien de
l’aspect commercial du problème, mais il faudrait essayer de tenir, au moins jusqu’à
ce que / le CNRS, qui répugne, on le sait, à s’engager pour longtemps, vous ait fait
connaître sa décision.
Vous n’avez plus besoin de souhaits. Je vous dis seulement mes sentiments bien
cordiaux,
EBenveniste
PS. Je reçois à l’instant les papiers de Sol Tax au sujet de Current Anthrop. 65 J’hésite
un peu à m’engager dans cette nouvelle entreprise qui semble conçue pour devenir
accaparante.
(14)
Collège de France Paris, le 26 Avril 59
Chaire de Grammaire comparée
Cher Monsieur,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
156
C’est avec retard que je vous réponds. J’ai passé trois semaines à l’hôpital à me
délivrer d’une sorte de grippe infectieuse, et quelques jours de convalescence dans
le Midi. Veuillez m’excuser de me borner aujourd’hui à la question la plus urgente :
celle de l’Homme. (Votre communication antérieure était restée en souffrance ici).
Je déplore le tour qu’a pris la correspondance entre Plon et le CNRS, et j’approuve
tout à fait la ligne de conduite / que vous avez adoptée. Il faut que nous restions
maîtres de publier ce que nous jugeons notable, et donc que le soutien accordé à la
collection reste global. Je souhaite que vous puissiez aboutir dans ces nouvelles
démarches ; il nous faudrait un éditeur un peu hardi, mais pas tellement, car
finalement cela paraît se vendre.
Je veux vous remercier de vos observations sur mes articles, mais y mieux réfléchir
avant de vous répondre. Vos remarques sont de grande importance. Croyez-moi
votre bien cordialement dévoué,
EBenveniste
(15)
Collège de France Paris, le 16 Février 62
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher ami,
Merci pour votre message. Chez moi il n’y a que des dégâts matériels, portes
arrachées, entrée ravagée. A un mètre près, j’ai échappé dans mon bureau, à la
projection des portes. Mais je n’ai pas éprouvé de commotion sérieuse 66.
Tout cela sera, je pense, bientôt réparé. Votre sympathie m’est précieuse.
Votre aimablement dévoué,
EBenveniste
(16)
Collège de France Paris, le 18 juin 62
1 rue Monticelli 14e
Cher ami,
Permettez-moi, ayant lu vos deux livres à la suite67, de les englober dans un même
remerciement. J’ai suivi avec admiration ces deux exposés complémentaires, le
premier critique et réfutant le totémisme par ses contradictions, le second
synthétique et intégrant le totémisme dans une vaste classification. Cette analyse
des classifications ou de la pensée classificatoire en ses multiples aspects abonde en
observations importantes et alimentera certainement des recherches nouvelles. J’ai
été personnellement très séduit par vos observations / sur la nature classificatoire
des noms propres68, comme à un autre point de vue, j’ai trouvé une vive saveur à
vos remarques sur la pensée de Bergson69.
Je vous félicite de fournir ainsi de belles réinterprétations des problèmes
classiques de l’anthropologie et une contribution de valeur à l’analyse de la culture.
Croyez-moi bien votre amicalement dévoué,
EBenveniste
(17)
Collège de France Paris, le 21 Nov. 62
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
157
Cher ami,
Je suis content que mon livre ne vous ait pas semblé trop rebutant 70. Il est si
difficile en ce domaine de dépasser le niveau de la pure technique où l’on se
confinait, et d’atteindre celui des vrais problèmes.
Vous en avez discerné un, et fort justement : en effet antiyant- « gendre » témoigne
pour la matrilocation. Mais dans la complexité de la culture hittite où des
influences divines se croisent, l’absence de la formule « conduire (la femme 71) »
pourrait n’être pas / encore à expliquer par là. Cela semble néanmoins fort
probable, et un hittitologue m’a confirmé, depuis, que la seule expression usitée est
« prendre en mariage ».
Merci, et croyez à mes sentiments amicaux,
EBenveniste
(18)
Collège de France Paris, le 9 février 64
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher ami,
Tous mes remerciements pour le précieux dépouillement ethnologique que vous
avez si aimablement fait faire à mon intention. Les résultats, en effet, ne sont pas
absolument concordants ; néanmoins la proportion des coïncidences entre
matrilocation et teknonymie est plus élevée que je ne l’aurais cru, et pourrait
suggérer une relation entre les deux phénomènes. Mais je me garderais de rien
affirmer.
J’ai eu une conversation avec Cuisenier72, et il m’a fait part des améliorations qu’il
avait apportées à son article73 après l’avoir fait relire par des turcologues. Si vous
jugez satisfaisante cette nouvelle rédaction – que je n’ai pas vue –, on pourrait la
prendre pour l’Homme.
Laissez-moi vous féliciter pour votre récente promotion74, que je viens
d’apprendre, et y joindre tous les bons vœux de
Votre amicalement dévoué,
EBenveniste
(19)
Collège de France Paris, le 26 Nov. 64
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher ami,
J’ai un peu tardé à vous remercier de votre envoi. C’est que j’ai mis du temps à lire
Le Cru et le Cuit.75 Il faut lire ce livre ou très vite et d’un trait, ce que je ne pouvais
faire, ou à petites étapes et en rêvant un peu, ce que j’ai fait, et sans me flatter
d’avoir pu suivre de tout point vos exégèses, je suis émerveillé de l’ingéniosité et de
la rigueur que vous apportez à découvrir – puis à interpréter dans des connexions
systématiques, les éléments signifiants des mythes. Je pense en particulier à tout le
développement sur cuisine et bruit, mais il faudrait s’arrêter à maint autre endroit.
C’est un ouvrage d’une richesse très singulière, où s’entrelacent tant d’appels et
d’échos que, indépendamment des références musicales qui l’encadrent, je pensais
sans cesse à une composition de Messiaen, à tort ou à raison, je ne sais.
En tout cas vous avez promu l’étude du mythe à un plan tout nouveau et qui
annonce une transformation de votre méthode d’analyse.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
158
Tous mes remerciements pour ce beau livre et croyez à mes sentiments amicaux,
EBenveniste
(20)
Collège de France Paris, le 14 Février 1967
Chaire de Grammaire comparée 1 rue Monticelli 14 e
Cher ami,
Je termine la lecture captivante de votre livre76 où, à l’ombre de Virgile et de
Rousseau, les fumées de tabac et les rayons de miel engendrent une étonnante
richesse de mythes. Plus captivante encore est votre analyse des structures
apparentes ou implicites où cette richesse s’organise et devient signifiante. Vous
avez accompli une nouvelle étape sur la voie que vous vous êtes assignée. Le
linguiste vous suit dans vos démarches, voit les analogies et les différences avec sa
propre pratique, et les perspectives, diverses aussi, qui s’ouvrent. Dans certains de
vos développements la langue intervient directement que ce soit dans la forme du
discours ou dans les termes du vocabulaire, et la réflexion en est vivement stimulée.
J’aurais souhaité, mais peut-être n’était-ce pas possible, que le domaine de
l’enquête fût circonscrit par des critères extérieurs à la matière de l’enquête, par
exemple par la relation des langues entre elles, ou une certaine symbiose culturelle,
etc., et qu’on pût ainsi distinguer entre identités ou affinités d’une
part, / homologies de l’autre. Cela aurait été de grande portée méthodologique.
Vous avez indiqué çà et là des analogies avec des domaines non contigus au vôtre :
Pacifique N.O. ou Chine. Des distinctions pourraient-elles être tracées à l’intérieur
du monde indien tropical ? Il s’agirait de mieux voir s’il y a des enchaînements
nécessaires et à quelles conditions.
Je souhaite qu’un jour vous puissiez étudier parallèlement tout ce grand complexe
mythique du miel et de l’ours dans les traditions nordiques et sibériennes – ou
encore les relations structurales de la boiterie dans d’autres mythologies
(Hephaistos !). Mais on n’en finirait pas, tant cette lecture suscite de questions et
éclaire d’analogies. C’est à tous égards un livre important.
– Beaucoup moins l’est probablement celui77 que je vous envoie, en souvenir de
cette si agréable soirée où, entre autres, j’ai appris que les proverbes éveillaient la
curiosité de votre jeune fils78.
Merci pour ce nouvel enrichissement et croyez à mes amitiés,
EBenveniste
(21) [Remarques adressées par Benveniste à Lévi-Strauss en octobre 196179 concernant l’article
sur « Les Chats » de Baudelaire80].
QUELQUES REMARQUES
1) D’après l’éd. de Sacy, il y a une variante. Aux vv. 7-8, le texte du Corsaire porte :
l’Erèbe les eût pris … s’il pouvait … Cela mériterait mention, par ex. p. 23.
2) Dans l’analyse des rimes, il faudrait considérer aussi ce « système interne » des
demi-vers :
1 ã – ɛr
2ã–õ
3u–õ
4 ø – ɛr
3) p. 19 le dernier alinéa n’est pas clair. Est-ce intentionnellement qu’on parle ici (et
ici seulement) de « lignes » au lieu de « vers » ?
4) Il y a quelques flottements dans ces pages, me semble-t-il, sur le statut de
l’« Erèbe ». Il est partout pris comme inanimé (cf. p. 20, 23), mais aussi parfois
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
159
comme un être (p.25, 32). Une personnification ne peut être réduite à l’inanimé :
d’ailleurs l’Erèbe est frère de la Nuit. Ou alors il faudrait instituer un « genre »
spécial pour les êtres mythiques, ce qui serait admissible ici.
5) Un motif n’est pas relevé dans cette analyse, c’est celui de la « mûre saison ». Il
m’a toujours paru significatif : de Baudelaire dans sa notion de la beauté, et de ce
sonnet. La « mûre saison » est médiatrice entre « amoureux fervents » et « savants
austères » : c’est dans leur mûre saison qu’ils se rejoignent, pour s’identifier
« également » aux chats. Car rester « amoureux fervents » jusque dans la « mûre
saison » signifie déjà qu’on est hors de la vie commune, tout comme sont les
« savants austères » par vocation. La situation initiale du sonnet est celle de la vie
hors du monde (néanmoins la vie souterraine est refusée) et elle se développe,
transférée aux chats, de la réclusion frileuse vers les grandes solitudes étoilées où
science et volupté sont rêve sans fin.
Baudelaire, Œuvres complètes, éd. S. de Sacy, Paris, Club du Meilleur Livre, 1955,
tome I, p. 1227 [notes sur Les Chats] :
14 novembre 1847, Le Corsaire (dans le feuilleton de Champfleury : « Le Chat Trott »).
1848, Revue de Belgique (p.280-281, dans un article de Retchezken 81).
–––––––
Str. II, v.3-4. Ils présentent un sens différent selon que l’on donne au verbe prendre
son sens propre ou le sens figuré de considérer, regarder comme, ce dernier sens
s’accordant mieux avec la syntaxe de cette phrase. Remarquons d’ailleurs que Le
Corsaire et la Revue de Belgique font écrire à Baudelaire :
S’il pouvait au servage incliner leur fierté.
désignant ainsi l’Erèbe.
Voilà la source de mon observation, d’après une édition que vous pouviez ne pas
avoir sous la main. La variante aurait donc été donnée deux fois.
Veuillez croire à mes sentiments amicaux.
E. Benveniste
BIBLIOGRAPHIE
Archives de la Rockefeller Foundation. RF, RG 1.2. Series 500R. Box 12. f. 112.
Fonds Claude Lévi-Strauss. Départements des Manuscrits. Bibliothèque nationale de France. NAF
28150.
Bader, Françoise. 2012. « Lettres d’Émile Benveniste à Claude Lévi-Strauss. Contribution à la
biographie d’Émile Benveniste ». In : Giampaolo Borghello e Vincenzo Orioles (a cura di), Per
Roberto Gusmani 1. Linguaggi, culture, letterature 2. Linguistica storica e teorica. Studi in ricordo. Udine :
Forum. 227-249. Disponible en ligne. URL : http://forumeditrice.it/percorsi/lingua-e-letteratura/
studi-in-onore/per-roberto-gusmani/lettres-d2019emile-benveniste-a-claude-levi consulté le
18/04/2020.
Bartholomae, Christian. 1904. Altiranisches Wörterbuch. Strassburg : Karl J. Trübner.
Beekes, S.P. Beekes. 2010. Etymological dictionary of Greek. With the assistance of Lucien van Beek.
Leiden-Boston : Brill.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
160
Benveniste, Émile. [1932] 2015. « Les classes sociales dans la tradition avestique ». Langues,
Cultures, Religions. 47-59.
Benveniste, Émile. [1938] 2015. « Traditions indo-iraniennes sur les classes sociales ». Langue,
cultures, religions. 105-118.
Benveniste, Émile. [1949] 2015. « La légende des Danaïdes ». Langues, Cultures, Religions, Limoges :
Lambert-Lucas. 209-216.
Benveniste, Émile. [1953] 2015. « Le vocabulaire de la vie animale chez les Indiens du Haut Yukon
(Alaska) ». Langues, cultures, religions. Limoges : Lambert-Lucas. 225-250.
Benveniste, Émile. 1962. Hittite et indo-européen : Études comparatives. Paris : Adrien-Maisonneuve.
Benveniste, Émile. 1965. « Termes de parenté dans les langues indo-européennes ». L’Homme
5(3-4) : 5-16. Juillet-décembre 1965. Études sur la parenté. https://journals.openedition.org/
lhomme/persee-123934 consulté le 18/04/2020.
Benveniste, Émile. 1966. Problèmes de linguistique générale. Paris : Gallimard.
Benveniste, Émile. 1974. Problèmes de linguistique générale 2. Paris : Gallimard.
Benveniste, Émile. 1969a. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. Économie, parenté, société.
Paris : Minuit.
Benveniste, Émile. 1969b. Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 2. Pouvoir, droit, religion.
Paris : Minuit.
Benveniste, Émile. 2011. Baudelaire. Edition, introduction et notes par Chloé Laplantine. Limoges :
Lambert-Lucas.
Benveniste, Émile. 2015. Langues, cultures, religions. Choix d’articles réunis par Chloé Laplantine et
Georges-Jean Pinault. Limoges : Lambert-Lucas.
Boas, Franz. 2018. Introduction du Handbook of American Indian languages (1911). Traduction d’
Andrew Eastman et Chloé Laplantine. Préface de Chloé Laplantine. Limoges : Lambert-Lucas.
Bruneau, Michel. 2000. « Pierre Gourou (1900-1999) ». L’Homme [En ligne] 153 | janvier-mars 2000,
URL : http://journals.openedition.org/lhomme/1 consulté le 18/04/2020.
Capell, Arthur. 1949. « The Concept of Ownership in the Languages of Australia and the Pacific »,
Southwestern Journal of Anthropology, 5(3) : 169-189.
Chantraine, Pierre. 1968-1980. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris :
Klincksieck.
Cuisenier, Jean. 1962. « Endogamie et exogamie dans le mariage arabe ». L’Homme 2(2) : 80-105.
Garvin, Paul A. Ponapean, a Micronesian Language. [texte dactylographié]
Hauser, Stefan R. 2003 (updated March 2012). « Ernst Herzfeld. i. Life and work ». In : Ehsan
Yarshater (ed.), Encyclopædia Iranica. XII/3, New York, Bibliotheca Persica Press, 2003. Disponible
en ligne, URL : http://www.iranicaonline.org/articles/herzfeld-ernst-i-1 consulté le 18/04/2020.
Herzfeld, Ernst. 1947. Zoroaster and His World, t. 1. Princeton : Princeton University Press.
Jakobson, Roman et Lévi-Strauss, Claude. 1962. « ‟Les Chats” de Charles Baudelaire ». L’Homme
2(1) : 5-21.
Jakobson, Roman et Lévi-Strauss, Claude. 2018. Correspondance 1942-1982. Préfacé, édité et annoté
par Emmanuelle Loyer et Patrice Maniglier. Paris : Seuil. Librairie du XXIe siècle.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
161
Laplantine, Chloé. 2011. Emile Benveniste, l’inconscient et le poème. Limoges : Lambert-Lucas.
Laplantine, Chloé. 2018. « Préface ». In : Franz Boas. Introduction du Handbook of American Indian
languages (1911). Limoges : Lambert-Lucas.
Lévi-Strauss, Claude. [1945] 1958 et 1974. « L’analyse structurale en en linguistique et en
Anthropologie ». Anthropologie structurale. Paris : Plon : 43-69.
Lévi-Strauss, Claude. 1948. « Tribes of the Right Bank of the Guaporé River ». In : Julian H.
Steward (ed.). Handbook of South American Indians, vol. 3 : The tropical forest tribes. Bureau of
American Ethnology. Bulletin 143. Washington, D. C. : Smithsonian Institution. 371-379.
Lévi-Strauss, Claude. [1949a] 1967. Les structures élémentaires de la parenté. Berlin-New York,
Mouton de Gruyer.
Lévi-Strauss, Claude. [1949b] 1958 et 1974. « Histoire et ethnologie ». Anthropologie structurale.
Paris : Plon.
Lévi-Strauss, Claude. 1950a. « Documents Rama-rama ». Journal de la Société des Américanistes 39 :
73-84.
Lévi-Strauss, Claude. 1950b. « Introduction à l’œuvre de Marcel Mauss ». In : Marcel Mauss.
Sociologie et anthropologie. Paris : PUF. IX-LII.
Lévi-Strauss, Claude. 1951. « Language and the Analysis of Social Laws ». American Anthropologist
53(2). 155-163. (Adaptation française : « Langage et société ». Anthropologie structurale).
Lévi-Strauss, Claude. 1955. Tristes tropiques. Paris : Plon. Mythes et religions.
Lévi-Strauss, Claude. [1956] 1958. « Les organisations dualistes existent-elles ? ». Anthropologie
structurale. Paris : Plon. 147-182.
Lévi-Strauss, Claude. [1962a] 2002. Le totémisme aujourd’hui. Paris : Presses Universitaires de
France. [Disponible en ligne. URL : https://www.cairn.info/le-totemisme-aujourd-
hui-9782130528784.htm ?contenu =presentation consulté le 18/04/2020).
Lévi-Strauss, Claude. 1962b. La pensée sauvage. Paris : Plon.
Lévi-Strauss, Claude. 1964. Le cru et le cuit (Mythologiques, 1). Paris : Plon.
Lévi-Strauss, Claude. 1967. Du miel aux cendres (Mythologiques, 2). Paris : Plon.
Lévi-Strauss, Claude. 1976. « Hommage à Émile Benveniste ». L’Homme 16(4) : 5.
Lévi-Strauss, Claude. 1991. Histoire de Lynx. Paris : Plon.
Lévi-Strauss, Dina. 1938. « Mission Lévi-Strauss-Vellard (1938-1939) ». Journal de la Société des
Américanistes 30(2) : 384-386.
Loyer, Emmanuelle. 2015. Claude Lévi-Strauss. Paris : Flammarion.
Mayrhofer, Manfred. 1956-1976. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. 3 tomes.
Heidelberg : Carl Winter.
Mayrhofer, Manfred. 1986-1996. Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. 1. Teil : Ältere
Sprache. 2 tomes. Heidelberg : Carl Winter.
Meillet, Antoine. [1906] 1921. « L’état actuel des étudies de linguistique générale ». Linguistique
historique et linguistique générale [I]. Paris : Champion. 1-18. Réimprimé 1982. Genève : Slatkine.
Nouvelle édition préparée par Pierre Ragot : 2015. Linguistique historique et linguistique générale.
Limoges : Lambert-Lucas. 79-96.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
162
Morgenstierne, Georg. 1927. An etymological vocabulary of Pashto. Oslo : Jacob Dybwad.
Morgenstierne, Georg. 2003. A new etymological vocabulary of Pashto. Compiled and edited by J.
Elfenbein, D.N. MacKenzie and Nicholas Sims-Williams. Wiesbaden : Reichert.
Renou, Louis. 1961. Anthologie sanskrite. Textes de l’Inde ancienne traduits du sanskrit. Paris : Payot.
Sauvageot, Antoine. 1951. Compte rendu de : Garvin Paul L. Ponapean, a Micronesian Language.
Journal de la Société des Océanistes 7 : 315-317.
Skjaervø, Oktor Skjaervø. 2013. « Marriage ii. Next-of-kin marriage in Zoroastrianism ».
Encyclopædia Iranica, online edition, 2013, URL : http://www.iranicaonline.org/articles/marriage-
next-of-kin consulté le 18/04/2020).
Szemerényi, Oswald. 1977. Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages. = Acta
Iranica 16. Textes et mémoires. vol. VII : Varia 1977. Téhéran-Liège : Bibliothèque Pahlavi & Leiden :
Brill.
Testenoire, Pierre-Yves. 2019. « Compléments à la correspondance Jakobson – Lévi-Strauss ». Acta
structuralica 4. URL : https://doi.org/10.19079/actas.2019.4.2 consulté le 18/04/2020.
NOTES
1. Françoise Bader (2012) dans un article portant également sur cette archive, publiait quatre des
vingt lettres de Benveniste et en débutait l’analyse du point de vue de l’histoire
intellectuelle. Le présent travail édite l’intégralité des lettres et apporte un appareil de
références plus complet.
2. Nous remercions ici Monique Lévi-Strauss de nous avoir autorisés à consulter et à publier cette
archive, ainsi que Michel Zink, Secrétaire perpétuel de l’AIBL, de nous avoir autorisé à publier les
lettres d’Émile Benveniste.
3. Pour être précis, il n’est pas exclu qu’une partie de cette correspondance soit actuellement
entre des mains privées, mais nous n’avons pas identifié les détenteurs de ces précieux
documents.
4. Lévi-Strauss soutient son doctorat d’État le 5 juin 1948 (thèse principale : Les Structures
élémentaires de la parenté ; thèse complémentaire : « La vie familiale et sociale des Nambikwara ». Le
directeur de thèse est un sociologue durkheimien, Georges Davy, et le jury est composé d’Albert
Bayet (sociologue), Émile Benveniste, Jean Escarra (juriste sinologue), et Marcel Griaule
(ethnologue africaniste).
5. Jakobson et Lévi-Strauss (2018), et Testenoire (2019).
6. Lettre du 29 décembre 1947 de Lévi-Strauss à Jakobson : « nous avons passé deux heures à une
discussion si animée du système de parenté indo-européen que ni [Benveniste] ni moi n’avons
plus pensé à la question [de la participation du Cercle linguistique de New York à un Congrès de
linguistique] ». Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 75).
7. Lévi-Strauss à Jakobson le 4 juillet 1948 : « Benveniste et moi échangeons une longue
correspondance sur des problèmes de parenté hindous, iraniens et grecs ; nous nous entendrions
très bien s’il n’était si défiant et cérémonieux. C’est au compte-gouttes, et avec mille précautions,
qu’il se décide, peu à peu, à me communiquer un renseignement ou à me consulter sur un
problème. Enfin, ces relations épistolaires contribuent à la préparation de la suite de mon
travail ». Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 93). Dans la section des Structures élémentaires (Lévi-
Strauss [1949a] 1967 [2e édition] : 454-547) consacrée au système de la parenté en Inde et dans le
monde indo-européen, Lévi-Strauss fait référence (459 n. 17, 545 n. 33) à deux articles de
Benveniste (Benveniste 1932 et 1938).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
163
8. Benveniste occupe la chaire de « Grammaire comparée » depuis 1937.
9. Ce qui aboutira aux deux volumes publiés en 1969 : Benveniste (1969a) et (1969b).
10. Benveniste (1969a : 203-276).
11. Benveniste ([1965] 2015 : [5-16] 291-303).
12. Lettre du 4 juillet 1948 : Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 93). Même propos avant même la
soutenance dans sa lettre du 6 mars 1948 : « j’ai intrigué pour que Benveniste fasse partie du jury,
et j’attache du prix à sa présence, car il sera sans doute le seul à comprendre ce que j’ai voulu
faire ». Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 86).
13. Lettre 6, du 22 Janvier 50.
14. La question du « structuralisme » dans les sciences humaines dépasse le cadre du présent
article, et n’est donc pas traitée ici de manière détaillée.
15. Lettre du 4 juillet 1948. Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 97). Voir Lévi-Strauss (1951) pour la
publication de cette hypothèse de comparaison entre structures de parenté et structures
linguistiques, et ici la lettre 9, et la note 57.
16. Lévi-Strauss ([1945] 1958 et 1974 : 43-69).
17. Qui devient plus tard le chapitre d’introduction d’ Anthropologie structurale. Lévi-Strauss
([1945] 1958 et 1974 : 9-39).
18. Voir aussi l’introduction au livre de Mauss Sociologie et anthropologie, Lévi-Strauss 1950b : IX-
LII. Voir aussi Laplantine (2018 : 25-26, et 2011 : 93-97).
19. Boas (1911 : 67-73). Lévi-Strauss attribue à Boas « le mérite d’avoir, avec une admirable
lucidité, défini la nature inconsciente des phénomènes culturels, dans des pages où, les
assimilant de ce point de vue au langage, il anticipait sur le développement ultérieur de la pensée
linguistique, et sur un avenir ethnologique dont nous commençons à peine à entrevoir les
promesses » Lévi-Strauss ([1945] 1958 et 1974 : 32). Notons que Lévi-Strauss participe grandement
à faire connaître Boas en France, en traduisant notamment de longs passages de cette
« Introduction ».
20. Lettre 6, du 22 Janvier 50.
21. Archives de la Rockefeller Foundation : RF, RG 1.2, Series 500R, Box 12, f. 112.
22. Voir la lettre 10, du 14 novembre 1953.
23. Pierre Gourou (1900-1999) est un géographe spécialiste de l’Indochine et de la géographie
tropicale. Sur Pierre Gourou, on peut se référer à l’article de Michel Bruneau (2000).
24. Lettre 4, du Paris, le 21 avril 49.
25. « Différences d’approche / Une approche consiste à partir <de la pièce de> vers comme d’une
donnée, de la décrire, de la démonter comme un objet. C’est l’analyse telle qu’on la trouve
appliquée aux Chats dans le bel article de Lévi-Strauss et Jakobson. / Une autre approche sera
d’un type tout autre. On s’efforcera d’atteindre la structure profonde de son univers poétique
dans le choix révélateur des images et dans leur articulation ». Benveniste (2011 : 186).
26. En effet, Benveniste insiste sur les « émotions », comme base des images poétiques,
autrement dit sur le corps du poète, voir Benveniste (2011 : 26, 28, 192), et en particulier : « Le
discours poétique est un discours d’émotion » (Benveniste 2011 : 246).
27. Lévi-Strauss (1976 : 5).
28. Cette feuille n’a pas été retrouvée dans le fonds de la BnF.
29. Comparer désormais Lévi-Strauss (1967 : 462-464 et 481-482, spécialement 463).
30. Voir désormais Lévi-Strauss (1967 : 458).
31. Boas (1911).
32. Herzfeld 1947. Ernst Herzfeld (1879-1948), archéologue, philologue et historien, fut une figure
importante des études du Proche-Orient et de l’Iran ancien ; professeur à Berlin à partir de 1920,
contraint de s’exiler en 1933 du fait de son ascendance juive, puis professeur à Princeton
(Institute for Advanced Studies) à partir de 1936. Voir Hauser (2003 [2012]).
33. Bartholomae (1904).
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
164
34. Littéralement, “les plus proches par la parenté” (Bartholomae 1904 : 1040) ; le premier terme
nabā° est apparenté à av. nāfa-, nāfah- « parenté, famille », originellement « nombril », cf. véd.
nābhi- « nombril, moyeu, centre, origine, parenté » ; voir Mayrhofer 1956-1976, II : 135, 153 et
Mayrhofer 1986-1996, II : 13-14, avec références.
35. Discussion reprise dans Benveniste (1969a : 259-261 et 264-265), dans le chapitre « Formation
et suffixation des termes de parenté ». Scénario de Benveniste contesté par Szemerényi (1977 :
62-63) ; discussion et autres références dans Mayrhofer (1986-1996, II : 281).
36. La dactylographie est sûre pour wrōrǝ. Il faut cependant lire wrārǝ, cf. Morgenstierne (1927 :
89, n° 277) (wrārǝ ‘nephew’) et Morgenstierne (2003 : 91) (idem, ‘nephew, brother’s son’. Le nom
pašto pour « frère » est wror, hérité de l’étymon iranien, et le terme wrārǝ est rapproché d’av.
brātruya-, comme le reprend Benveniste.
37. Sur ce terme, qui est dérivé du nom avestique de la fille (duγdar-), voir Szemerényi (1977 : 58
n. 222).
38. Il faut évidemment lire Mīmāṃsā.
39. Texte du Tantravārttika sur le mariage d’Arjuna et Vāsudeva, traduit par Renou (1961 :
213-214). Voir Lévi-Strauss (1949a [1967] : 466, n. 54).
40. Cette lettre comporte des mots grecs écrits en marge au crayon, sans accent ni esprit
(« εδνoν / γαµειν / ηγεισθαι / εγγυησις », « εδνoν »), mais ils ne sont pas de l’écriture de
Benveniste. Ils sont probablement dus à la personne qui a eu les papiers en main et qui les a triés
à un certain moment.
41. Allusion à cette pratique dans Lévi-Strauss (1967 : 545). Voir désormais Skjaervø (2013).
42. En fait, forme de ce nom propre en védique est Nā́bhānédistha- (nom d’un poète), dérivé
patronymique, qui signifie donc « descendant d’un proche parent », *nabhā-nediṣṭha- = avestique
nabā-nazdista-. Voir Mayrhofer (2003 : 50, 2.1.272).
43. Il s’agit de κῆδoς (depuis Homère) “soin, souci”, qui s’est spécialisé dans les deux emplois
mentionnés par Benveniste : « deuil, honneurs rendus à un mort » (Hom., ion. −att.) et « union,
parenté par mariage, par alliance » (Eschyle, Hérodote), sens qui se retrouve dans plusieurs
dérivés, voir Chantraine (1968-1980 : 523) ; Beekes (2010 : 684).
44. Georges Dumézil (1898-1986) était directeur d’études à la V e section (Sciences religieuses) de
l’École Pratique des Hautes Études. Il occupera la chaire des civilisations indo-européennes au
Collège de France de 1949 à 1968, puis, soutenu par Lévi-Strauss, sera élu à l’Académie française
en 1978.
45. On pourrait être tenté de mettre en relation la curiosité de Lévi-Strauss pour ce « vase à
double coupe » avec sa fascination répétée pour les choses doubles, jumelles, scindées. Cf. par
exemple Lévi-Strauss (1991).
46. Interprétation littérale, cf. Chantraine (1968-1980 : 600) et (Beekes 2010 : 804), avec
références.
47. Cette interprétation était celle d’Aristote (Histoire des Animaux, 624a), qui considérait le vase
en question comme une coupe dont le pied creux forme lui-même une coupe. Il y comparait les
cellules des ruches d’abeilles.
48. Fernand Chapouthier (1899-1953), professeur de langue et littérature grecques en Sorbonne,
et directeur adjoint de l’École normale supérieure.
49. Allusion à la mission de Benveniste en mai 1949, pour donner des conférences à l’université
de Londres, cf. Annuaire du Collège de France, année 1948-1949, p. 159.
50. Capell (1949 : 169-189).
51. Paul L. Garvin a fait circuler ses diverses études sur la langue ponapéenne sous forme de
miméographe (par ex. « A Linguistic Study of Ponapean » et « A Definitional Grammar of
Ponapean », que Kenneth L. Rehg et Damian G. Sohl déclarent « invaluable » dans la préparation
de leur propre Ponapean Reference Grammar, Honolulu : University of Hawaii Press, 1981), mais
elles sont restées inédites. Celle à laquelle Benveniste réagit est sans doute « Ponapean, a
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
165
Micronesian Language », dont un compte rendu cinglant par Aurélien Sauvageot est paru dans le
Journal de la Société des Océanistes. Voir Sauvageot (1951 : 315-317).
52. Lévi-Strauss 1949b (« Histoire et ethnologie »).
53. Voir par exemple dans cet article : « On dira peut-être que ces malencontreuses incursions
dans le domaine de la sociologie comparée sont, après tout, des exceptions dans l’œuvre de
Malinowski. Mais l’idée que l’observation empirique d’une société quelconque permet d’atteindre
des motivations universelles y apparaît constamment, comme un élément de corruption qui
ronge et amenuise la portée de notations dont on connaît, par ailleurs, la vivacité et la richesse ».
Lévi-Strauss ([1949b] 1958 et 1974 : 26).
54. Voir Lévi-Strauss ([1949b] 1958 et 1974 : 32-39) concernant ses idées sur l’inconscient
ethnologique et linguistique.
55. Benveniste ([1949] 2015 : 209-216), « La Légende des Danaïdes ». L’article contient ([p. 137n.]
p. 215 n.]) une référence aux Structures élémentaires de la parenté.
56. Les investigations de Lévi-Strauss sur la population kepkiriwát (or kep-kiri-uat, kepikiriwat,
Kepi-keri-uate, Quepiquiriuate etc.) de la région rondônienne (du nom du général Rondon) de
l’Amazonie brésilienne datent de 1938-1939. Leur langue tupienne occidentale est aujourd’hui
éteinte, selon www.ethnologue.com. Lévi-Strauss fait référence à cette population dans plusieurs
textes ; voir Lévi-Strauss (1948 et 1950a). Pour le détail de la mission Lévi-Strauss-Vellard voir
Loyer (2015 : 199) sv., et Lévi-Strauss (1938 : 384-386).
57. Lévi-Strauss semble ne pas avoir apprécié les critiques de Benveniste énoncées dans la lettre
précédente, à tel point qu’il suspend la publication d’un article. Il confie à Roman Jakobson dans
une lettre du 13 mars 1952 : « Je suis d’autant plus agacé par cette polémique [polémique de
chercheurs concernant son article « Language and the Analysis of Social Laws » (1951)] qu’ayant
récemment terminé mon étude sur les noms des parties du corps dans les langues sud-
américaines dont vous aviez aussi approuvé l’esquisse je l’ai montrée à Benveniste, qui l’a
complétement condamnée. Or, aussi défectueux que soient le matériel et naïve ma méthode, il y
avait tout de même dedans quelque chose de curieux : c’est que, dans les langues considérées, les
termes paraissent formés par une combinaison de morphèmes, laquelle paraît interprétable en
chaînes de Markov. Même si ce n’est pas vrai, il me semble que l’hypothèse méritait d’être
vérifiée ; et j’avais signalé à Benveniste qu’une personne compétente pouvait le faire sur
l’algonkin, où les mots sont manifestement construits par le même procédé. Devant l’attitude
critique de Benveniste, j’ai renoncé à envoyer le manuscrit à l’impression ». Voir. Roman
Jakobson et Claude Lévi-Strauss (2018 : 149-150).
58. Charles Voegelin (1906-1986), linguiste et anthropologue américain, professeur à l’université
d’Indiana à partir de 1947, éditeur de l’International Journal of American Linguistics à partir de 1944,
après la mort de F. Boas. Auteur de nombreux articles et monographies sur les langues
amérindiennes de l’Amérique du Nord.
59. Il s’agit du second séjour d’enquête d’Émile Benveniste sur la côte Nord-Ouest américaine,
durant lequel il travaille principalement sur let Tlingit, mais aussi le Gwich’in (Loucheux) et
l’Inupiak.
60. Voir Benveniste ([1953] 2015). Pour l’analyse du nom du corbeau, voir p. 237.
61. Lévi-Strauss (1955), Tristes tropiques.
62. Lévi-Strauss ([1956] 1958), « Les organisations dualistes existent-elles ? ».
63. Chaire d’Anthropologie sociale, créée par l’assemblée générale des professeurs au Collège de
France le 30 novembre 1958. Lévi-Strauss sera élu lors de l’assemblée du 15 mars 1959 (voir Loyer
2015 : 447-448).
64. Selon la tradition, les candidats à une chaire au Collège de France doivent effectuer des visites
auprès de chaque professeur.
65. L’anthropologue américain Sol Tax (1907-1995) a fondé la revue Current Anthropology
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
166
66. Cette lettre fait référence aux attentats de l’OAS à Paris et dans la région parisienne du
mercredi 7 février 1962 : dix plasticages à la porte du domicile parisien d’hommes politiques,
d’intellectuels, de professeurs, de journalistes, voir entre autres Le Monde, daté 9 février 1962. Il
n’est pas certain que Benveniste ait été personnellement visé. Il se peut que son appartement ait
été endommagé par un plasticage qui eut lieu sur le même palier. L’immeuble du 1, rue Monticelli
était (et est encore) la résidence de nombreux universitaires.
67. Claude Lévi-Strauss ([1962a] 2002), Le totémisme aujourd’hui et (1962b), La pensée sauvage.
68. Cf. Lévi-Strauss (1962b : 202-259).
69. Voir Lévi-Strauss [1962a] 2002 : 136 sv., concernant la discussion des thèses d’Henri Bergson
sur le totémisme telles qu’énoncées dans Les Deux Sources de la morale et de la religion (1932) et son
rapprochement avec les conceptions de Radcliffe-Brown.
70. Benveniste (1962), Hittite et indo-européen : Études comparatives. Sur hitt. antiyant-, voir
spécialement p. 12, glosé par Benveniste comme ‘qui entre dans la famille du beau-père’.
71. Allusion à la formule indo-européenne reflété par lat. uxorem ducere, cf. Benveniste (1969a :
240-241), dans le chapitre « L’expression indo-européenne du mariage ».
72. Jean Cuisenier (1927-2017) est un ethnologue français, spécialiste des traditions populaires,
en particulier de l’architecture rurale. En 1971, il soutient une thèse, Économie et parenté, leurs
affinités de structure dans le domaine turc et dans le domaine arabe sous la direction de Raymond
Aron.
73. Cuisenier (1962).
74. Il pourrait s’agir de la Légion d’honneur, au grade d’officier. Claude Lévi-Strauss est fait
Grand Officier de la Légion d’honneur en 1985, et Grand Croix en 1991.
75. Lévi-Strauss (1964), Le cru et le cuit.
76. Lévi-Strauss (1967), Du miel aux cendres.
77. Benveniste a publié deux livres en 1966 : Problèmes de linguistique générale et Titres et noms
propres en iranien ancien. Il semblerait assez prévisible qu’il ait considéré le premier comme
spécialement destiné à Lévi-Strauss, dans le contexte du « structuralisme » parisien de l’année
1966.
78. Matthieu, né en 1957 de l’union de Claude Lévi-Strauss avec Monique Roman.
79. Manuscrits conservés dans le fonds Lévi-Strauss, dans le dossier NAF 28150 (67). Voir
Jakobson et Lévi-Strauss (2018 : 243-245) et Testenoire 2019, lettre 12.
80. Jakobson et Lévi-Strauss (1962 : 5-21).
81. « Retchezken est un pseudonyme utilisé par trois auteurs belges lorsqu’ils écrivent
conjointement : Léon Jouret (1828-1905), musicologue et compositeur, Léon Gauchez (1825-1907),
critique et marchand d’art, et Edouard Wacken (1819-1861), dramaturge, poète et critique, et
directeur de la Revue de Belgique, dans laquelle ces textes paraissent ». (Jakobson et Lévi-Strauss
2018 : 244 n.2)
RÉSUMÉS
Ce travail présente et édite 20 lettres d’Émile Benveniste adressées à Claude Lévi-Strauss entre
1948 et 1967. Il permet de documenter l’histoire du structuralisme, du dialogue et du
rapprochement de la linguistique et de l’ethnologie, par exemple dans les discussions concernant
la parenté ou l’organisation sociale, ou celles accompagnant la création de la revue L’Homme.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
167
We here provide a presentation and edition of 20 letters sent by Émile Benveniste to Claude Lévi-
Strauss between 1948 and 1967. They shed new light on the history of structuralism, the dialogue
between linguistics and ethnology, for example in the discussions concerning kinship or social
organization, or surrounding the creation of the journal L’Homme.
INDEX
Keywords : Benveniste (Emile), Lévi-Strauss (Claude), ethnology, history of the structuralism
Mots-clés : Benveniste (Emile), Lévi-Strauss (Claude), ethnologie, histoire du structuralisme
AUTEURS
JOHN E. JOSEPH
The University of Edinburgh, School of Philosophy, Psychology & Language Sciences, Edinburgh,
UK
CHLOÉ LAPLANTINE
CNRS, Histoire des théories linguistiques, Paris, France
GEORGES-JEAN PINAULT
École Pratique des Hautes Études, Paris, France
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
168
Lectures et critiques
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
169
Sériot, Patrick, dir. 2019. Le nom des
langues en Europe centrale, orientale et
balkanique
Limoges : Lambert-Lucas. 304 p.
Émilie Aussant
RÉFÉRENCE
Sériot, Patrick, dir. 2019. Le nom des langues en Europe centrale, orientale et balkanique.
Limoges : Lambert-Lucas. 304 p. ISBN 978-2-35935-251-1.
1 Ce recueil fait suite à une série d’ouvrages inaugurée en 1997 par Andrée Tabouret-
Keller aux éditions Peeters, intitulée Le nom des langues (je renvoie le lecteur aux trois
comptes rendus que j’ai rédigés dans les numéros 31.2 et 32.2 d’HEL). On peut
également signaler les volumes dirigés par Akin (1999), Aussant (2009) et Koren (2016),
qui abordent la question de la nomination des langues selon d’autres perspectives. Les
études que le présent recueil réunit, sous la direction de Patrick Sériot, couvrent la
partie orientale de l’Europe, cette « autre Europe », « au-delà du Danube ». Outre une
préface rédigée par Andrée Tabouret-Keller (p. 7-12), qui rappelle l’esprit du projet
initié il y a plus de 20 ans, et la présentation du recueil (Sériot, p. 13-16), ce volume se
compose de quatre parties : 1) « Deux modèles » (p. 19-36, une contribution),
2) « Europe centrale » (p. 39-77, deux contributions), 3) « Europe orientale » (p. 81-200,
cinq contributions), 4) « Europe balkanique » (p. 203-302, quatre contributions).
2 C’est l’article de Lia Formigari, « Langue, nation, nationalité. Du jacobinisme à
l’Internationale », qui ouvre le recueil. L’auteure retrace, de la Révolution à la
Deuxième Internationale, en passant par la Völkerpsychologie, l’évolution des notions de
« langue », « nation », « nationalité » ainsi que celle de leurs rapports. Cet article dense
– on y croise Bernhardi, Fichte, Hamann, Herder, F. Schlegel, Schelling, Humboldt,
Steinthal, Lazarus, Engels, Renan, Bauer et Kautsky – nous invite à revenir sur
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
170
quelques-unes des étapes-clés de l’histoire du conflit qui oppose deux conceptions du
nom des langues (le modèle jacobin et le modèle romantique).
3 Ondřej Bláha, dans son article « Moravian Czech », vise avant tout à présenter les traits
caractéristiques (principalement morphologiques et phonologiques) de la variété
linguistique désignée sous le nom de « (tchèque) morave ». La question du nom est
brièvement évoquée dans l’introduction ; l’étude proprement dite se concentre
davantage sur ce qu’est le tchèque morave. On retiendra que, comme dans de nombreux
autres cas, c’est essentiellement lorsqu’il s’agit de faire exister l’« ethnie morave » –
notamment face aux Allemands (protestants) au XVIIIe siècle ou, plus tard, aux
Tchèques de Prague – que la question de la langue (morave) surgit.
4 Dans son étude intitulée « La langue tchécoslovaque », L΄jubomir Ďurovič se livre à une
analyse fouillée du contenu juridique et politique du nom de langue tchécoslovaque, qui
connut une existence particulièrement brève (1920-1938). L’auteur retrace d’abord son
histoire, du IXe siècle à 1918-1920, puis se concentre sur son adoption, en 1920, par
l’Assemblée nationale, pour désigner, sous un terme commun, les deux expressions
(slovaque et tchèque) d’une seule et même langue. Ce nom de langue tchécoslovaque, au
contenu purement juridique, permet, d’une part, d’instituer la nation tchécoslovaque
et, d’autre part, de distinguer ladite nation des minorités nationales et linguistiques
(allemande, hongroise, polonaise). Mais, pour diverses raisons, essentiellement liées
aux organisations gouvernementales, aux questions d’identité nationale ou ethnique,
ainsi qu’aux obédiences religieuses, Slovaques et (surtout) Tchèques ne se
l’approprieront finalement pas.
5 Natalia Bichurina, dans son article « Noms d’ailleurs : l’“albanais” et le “gréco-tatar”
d’Ukraine », revient sur les enjeux de la nomination de deux idiomes parlés en Ukraine
orientale, l’albanais (qui mêle des traits albanais archaïques à des interférences slaves
et turques) et le gréco-tatar (idiome turc avec des traits oghouzes et kiptchaks). Si
l’URSS s’intéresse tant à la nomination (donc à l’identification) des langues parlées sur
son territoire, c’est avant tout pour renforcer l’ancrage du pouvoir soviétique dans les
zones « marginales » où vivent les peuples non russophones. Institutionnaliser les
langues, c’est aussi institutionnaliser les nations soviétiques « titulaires » qui leur
correspondent. Lorsque la langue russe, langue de la révolution, s’impose comme
langue d’État par-delà les nations, les langues nationales deviennent de véritables outils
identitaires. Ces outils survivront à la dissolution de l’URSS, événement qui rend
possibles les contacts avec les « compatriotes d’ailleurs » (Albanais d’Albanie, Bulgares,
Grecs…). Mais ces contacts mènent aussi, inexorablement, à la comparaison entre les
langues (albanais d’Ukraine vs albanais d’Albanie, grec d’Ukraine vs grec de Grèce…) et
donc à des hiérarchies.
6 Pietro U. Dini et Giedrus Subačius présentent et discutent, dans leur article « Lituanie et
Samogitie : sources, onomastique, étymologie », les différentes hypothèses avancées au
sujet du nom de la Lituanie et de la Samogitie. Concernant le nom Lituanie, ils
retiennent les « principaux paradigmes modernes d’interprétation qui caractérisent le
panorama des études depuis leur début », à savoir : 1) le « paradigme classique » (la
dérivation du nom Lituanie à partir de la racine *lei(t)), 2) le paradigme hydronymique
(Lietáuka nom d’un torrent → Lietuva ‘Lituanie’ → Lietuvai ‘Lituaniens’), 3) le paradigme
« innovateur » (Litva comme nom de groupe). Concernant le nom Samogitie, ils
mentionnent : 1) l’étymon traditionnel (Samogitie serait dérivé de l’adjectif žemas
ʻbasʼ »), 2) les étymologies « populaires » (Massagète, Samaritain), 3) l’hypothèse
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
171
contemporaine (dérivation de žẽmė ʻterreʼ). Ils terminent leur étude sur un aperçu de
l’histoire – complexe – des trois glottonymes žemaičiai, lituanien et aukštaičiai.
7 Dans son article « La langue universelle slave de Juraj Križanić. Le cas de la
terminologie militaire dans les Discours sur le gouvernement », Valérie Geronimi revient
sur l’entreprise du penseur croate Juraj Križanić (1618-1683), théoricien et praticien
d’une langue slave écrite qu’il désignait sous le nom de russe. L’auteure, qui cherche à
mettre au jour les raisons de l’insuccès de Križanić, montre que celui-ci est davantage
lié au caractère xénophobe du projet linguistique du croate qu’à l’artificialité de la
langue qu’il crée.
8 L’étude menée par Michael Moser et Serhij Wakoulenko, intitulée « Un dédale
glottonymique : quelques noms de la langue ukrainienne », raconte de façon détaillée
les aléas de l’histoire – longue et complexe – de la nomination et du statut de la langue
que l’on connaît aujourd’hui sous le nom d’« ukrainien » et qui désigne l’unique langue
d’État en Ukraine. Celle-ci s’est vu imposer toute une série de glottonymes artificiels
(ruthène, cosaque, ukrainien, petit-russe/petit-russien, r(o)u(s)sn(i)aque), dont aucun
n’embrassait la totalité de l’aire où cette langue était parlée. Sans surprise, le nom
ukrainien – qui finit par s’imposer – fut choisi par la communauté linguistique elle-
même.
9 Dans son article « De quoi la langue moldave est-elle le nom ? », Patrick Sériot étudie la
façon dont les linguistes ont pris part à la querelle de la nomination de la langue
moldave, dont l’enjeu est bien plus complexe qu’il n’y paraît. Quel(s) discours ces
professionnels ont-ils tenu(s) ? Dans quelle mesure s’articulent-ils aux
« représentations sur la langue » et, finalement, que nous disent-ils de l’objet
<langue> ? L’auteur rappelle à quel point toute réflexion sur la question de la langue
impose une délimitation nette de ce que le terme même de « langue » recouvre (langue
maternelle ? langue ethnique ? langue officielle ? langue littéraire ? langue d’État ?
langue parlée ?...). La langue moldave constitue un cas exemplaire d’« entité à
géométrie variable », ouvrant la voie à des argumentations variées et contradictoires,
et qui pose de façon aiguë la question de la frontière entre les langues.
10 Paul Garde consacre son étude intitulée « Serbo-croate, serbe et/ou croate : petite histoire
de cinquante-neuf noms de langue(s) » aux noms attribués aux langues slaves, des
origines à nos jours, de quatre États qui furent tous, entre 1945 et 1991 des républiques
yougoslaves : Bosnie-Herzégovine, Croatie, Monténégro, Serbie. Cet ensemble
linguistique, à la fois un et multiple, aura connu pas moins de 59 noms. Se fondant sur
de nombreuses sources, l’auteur revient sur la vie et la mort de ces appellations variées
(slavon, serbe, slavo-serbe, serboulien [srbuljski], langue croate [hrvatski], slovine
[slovenski], stribiligo illyrica, scythica lingua, dalmate, dubrovački, slovino-bosnien
[slovinsko-bosanski], serviana, ilirski/ilirički, bosniaque (bošnjački), langue yougoslave
(jugoslavenski), serbo-croate (srpskohrvatski), croato-serbe, bosnien-croate-monténégrin-
serbe… pour n’en citer que quelques-uns). Mais cette profusion de noms ne saurait
masquer l’omniprésence, tout au long de l’histoire, de serbe et croate – termes
autochtones et ethnonymes.
11 Dans leur article « Les noms du grec moderne », Irini Tsamadou-Jacoberger et Maria
Zerva reviennent sur la nomination du grec moderne entre le XVIII e et la première
moitié du XXe siècles, ainsi que sur les problématiques qui y affèrent : la question de la
langue de l’État à créer (seconde moitié du XVIIIe siècle) et, de fait, celle de l’identité
grecque à construire et à légitimer, la relation du grec moderne au grec ancien,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
172
notamment. Les auteures passent également en revue les différents noms du grec
moderne (katharévoussa, démotique, graikiki, roméique, hellénique, néohellénique…),
ainsi que l’évolution de leurs référents, en faisant la part belle aux « donneurs de
noms », i. e. aux acteurs impliqués dans le processus de dénomination (le philosophe
Damodos, les écrivains Rhoïdis et Psichari, les linguistes Triandafyllidis et Kriaras,
entre autres).
12 Patrick Sériot, dans son étude intitulée « Faut-il que les langues aient un nom ? Le cas
du macédonien », montre à quel point la nomination d’une langue – le macédonien en
l’occurrence – cristallise des enjeux qui dépassent de (très) loin les problématiques de
la linguistique. Occupée par les Turcs ottomans de 1318 à 1912, la Macédoine devient, à
partir de la 1re guerre balkanique, l’objet de tensions sans fin entre la Serbie, la Grèce et
la Bulgarie. D’un point de vue strictement linguistique, on n’est ni plus ni moins en
présence d’un continuum. Mais pour les Bulgares, les Macédoniens parlent bulgare ;
pour les Serbes, ils parlent le serbe ou un dialecte indifférencié ; pour les Grecs, le
macédonien n’est rien d’autre que du grec. De 1912 à 1918, la langue officielle de la
Macédoine fut le bulgare, puis le serbo-croate de 1918 à 1941, et à nouveau le bulgare,
de 1941 à 1944. Or les dialectes locaux n’étaient ni l’un ni l’autre. L’existence officielle
de la nation macédonienne est proclamée en août 1944 et le macédonien, langue
normée de Macédoine, dérivé d’un dialecte slave parlé dans la région de Skopje, devient
finalement la langue de cette nouvelle république. Ce qui ne signifie pas que tous les
problèmes soient résolus... tout au moins pas sur tous les fronts.
13 Dans son article « Arvanitika, Vlachika and Slavika: Languages of Greece? », Peter
Trudgill aborde la situation linguistique de la Grèce au travers des concepts de Ausbau
(« langue par élaboration ») et d’Abstand (« langue par distance »), qui permettent de
distinguer les langues sur la base de critères linguistiques et socio-culturels. Le grec
moderne a le statut de langue Abstand : il n’est pas typologiquement proche d’autres
langues d’Europe et il ne fait pas partie d’un continuum dialectal comme l’allemand et
le néerlandais. Cette « distance linguistique » suffit à en faire une langue « à part
entière ». Ce statut n’est pas sans conséquence sur le plan identitaire : les Grecs
seraient, in fine, ceux qui parlent grec. Or tout le monde ne parle pas (que) grec en
Grèce. C’est notamment le cas des communautés albanaise, valaque et slave. L’auteur
nous montre comment ces minorités composent avec l’idéologie monolingue de la
Grèce.
14 Dans la lignée des volumes précédents, l’ouvrage dirigé par Sériot montre que la
querelle des noms de langue dans cette « autre Europe » est avant tout liée à des débats
de nature religieuse, culturelle et politique, non linguistique (ou alors de manière –
très – marginale). Si l’enjeu était seulement linguistique, il n’y aurait pas querelle, a
priori. Le nom d’une langue appelle celui d’un territoire et celui d’un peuple. Les enjeux de
la nomination des langues vont donc bien au-delà des questions qui intéressent les
linguistes. Il n’y a là rien de surprenant. Mais si « le nom des langues n’est pas un
problème de linguistes », comme l’affirme Sériot (p. 285), il reste un des domaines où
l’imaginaire épilinguistique se cristallise avec une acuité toute singulière. Ne sommes-
nous pas là, aussi, au cœur de la langue ?
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
173
BIBLIOGRAPHIE
Akin, S., dir. 1999. Noms et re-noms : la dénomination des personnes, des populations, des langues et des
territoires. Rouen : Presses de l’université de Rouen.
Aussant, É., dir. 2009. La nomination des langues dans l’histoire (numéro thématique). Histoire
Épistémologie Langage 31/2.
Koren, R., dir. 2016. La nomination et ses enjeux socio-politiques (numéro thématique).
Argumentation et analyse du discours 17.
AUTEURS
ÉMILIE AUSSANT
CNRS, HTL
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
174
Hirschkop, Ken. 2019. Linguistic
turns. 1890-1950
Oxford : Oxford University Press. xiv-323 p.
Nick Riemer
RÉFÉRENCE
Hirschkop, Ken. 2019. Linguistic turns. 1890-1950. Oxford : Oxford University Press.
xiv-323 p. ISBN 978-0-19-874577-8.
1 Ken Hirschkop (H.) propose dans Linguistic turns (LT) une analyse riche, stimulante et
novatrice de travaux théoriques de penseurs importants, surtout anglais, allemands,
français et russes, issus de champs disciplinaires différents et portant sur des questions
de langue et de langage entre la dernière décennie du XIXe siècle et le milieu du siècle
suivant.
2 Dans une période caractérisée par les débuts d’une réflexion explicite sur les rapports
entre le langage et la société, H. fait une lecture socio-politique très subtile et
révélatrice de textes pour la plupart classiques en philosophie, études littéraires et
linguistique, entre le Saussure des années 1890 et les travaux d’Orwell, Austin et
Wittgenstein dans les années 1940-1950. Ces textes n’abordent pas toujours les
questions politiques de manière avouée. Mais, au-delà des grandes différences de cadre
intellectuel entre, par exemple, Bakhtine, Benjamin, ou Ogden, H. décèle néanmoins la
présence d’enjeux sociétaux déterminants pour les propos théoriques que tiennent les
auteurs sur les structures et les pratiques langagières. Rejetant l’idée d’un seul
« tournant linguistique » – terme rendu courant en philosophie par l’anthologie de
Richard Rorty (1967) –, H. suit avec une grande érudition les évolutions de divers
savants vers une conception qu’il dénomme « langage en tant que tel » (language as
such), conception qui permet d’aborder, souvent sous forme tacite (on hésite à la
qualifier d’ « allégorique », mais le terme paraît parfois juste), les problèmes d’un ordre
social en pleine transformation, ou crise, démocratique.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
175
3 C’est chez Bakhtine, sujet d’un ouvrage précédent (Hirschkop 1999), que H. a fait pour
la première fois l’hypothèse d’un « lien métonymique étroit entre le bon langage et la
bonne politique » (p. 185), constatant le passage effectué par le savant russe d’une
philosophie éthique systématique dans les années 1920, conçue comme essentielle au
« sauvetage » de l’Europe, vers une « identification du langage avec une conception de
la vie sociale » (p. 138) dans les recherches sur Dostoïevski à la fin de la même décennie.
Celui de Bakhtine n’était qu’un seul parmi toute une « constellation » de tournants
linguistiques, aucunement limités à un seul champ disciplinaire et reflétant de manière
très diverse les évolutions des sociétés modernes. Comme l’explique l’auteur (je
traduis) :
le XIXe siècle avait effectué une identification entre les langues et les « peuples ». En
même temps que ces « peuples » devenaient la substance des sociétés politiques et
que la politique même devenait responsable de l’instauration et du maintien de
l’ordre dans ces sociétés, les discussions sur la nature de l’ordre et du consentement
linguistiques ont été investies d’une urgence toute particulière. (p. 153)
4 Ainsi, explique H. de façon convaincante, au fil des décennies qu’il a étudiées, le
langage servait dans la production théorique de métonymie pour des ensembles
politiques et sociaux plus importants : à travers leurs propos sur le langage, les
chercheurs traitaient en filigrane de la politique. Cette métonymie était à l’origine de
divers surinvestissements théoriques. Certains, comme Benjamin, Bakhtine, Cassirer ou
Šklovskij, ont trop misé sur le « langage en tant que tel », surestimant ainsi les
possibilités politiques qu’il offrait, alors que d’autres, à l’instar de Saussure ou Ogden,
se livraient à une vision plus pessimiste, exagérant combien les langues réelles sont
défectueuses ou décevantes, trop rétives au changement. La lecture de Saussure et de
Wittgenstein qu’avance H. est particulièrement éclairante :
5 Ces versions du « langage en tant que tel » n’étaient-elles pas un modèle, ou peut-être
plus précisément, une vision de communauté et d’ordre social à un moment où l’ordre
social semblait dépourvu de toute logique et de tout fondement ? Ne fournissaient-elles
pas un modèle qui acceptait l’individualisme atomistique de la société européenne, tout
en démontrant comment celle-ci pourrait néanmoins être liée ensemble par un
système ? Ce système, n’était-il pas une synthèse merveilleuse de la démocratie et de la
quiétude politique ? Car « le langage » chez Saussure et Wittgenstein était, d’un côté,
démocratique et auto-inventé – tout le monde participait à sa construction, et rien au-
delà ne le fondait – et, de l’autre côté, immunisé contre le débat public, dans la mesure
où on ne pouvait pas proposer de raisons pour le changer. Dans une époque de crise,
c’était une image d’équilibre social. (p. 103)
6 Au détour des huit chapitres, H. retrace la façon dont le langage permettait aux
penseurs de la première moitié du siècle dernier de penser la politique, la nation, le
consentement démocratique ou les fondements d’un ordre social, et d’analyser la
bonne manière de prendre des décisions collectives. Pour certains d’entre eux, comme
Saussure ou Wittgenstein, le langage fournissait un modèle de consensus et d’ordre.
Pour d’autres – Ogden, Orwell, Bakhtine, Frege – et, parfois, pour Saussure aussi, il
détenait une force motrice passionnelle, envisagée soit comme une menace à la
démocratie, soit comme sa composante nécessaire.
7 Chez des penseurs célèbres dans les sciences humaines, tels Jean-François Lyotard,
Ernesto Laclau et Chantal Mouffe ou Judith Butler, comme l’affirme H. dans sa préface,
les déferlantes structuralistes et post-structuralistes ont transformé le langage en
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
176
véhicule de propositions historiques ou politiques substantives, « comme si les théories
du langage (Saussure, Wittgenstein, théorie des actes de parole, Foucault) avaient des
affiliations politiques ou sociales » (p. viii). La prise de conscience à l’origine de LT,
selon l’auteur, était l’idée selon laquelle « on a pu tirer des tendances et des conclusions
politiques des textes théoriques sur le langage parce que des idées politiques et sociales
étaient déjà implantées dans ceux-ci » (ibid.).
8 C’est donc à la recherche de ce contenu politique souvent implicite que H. propose les
analyses de LT. Il le fait à travers des lectures croisées d’une grande lucidité, détaillées
et documentées, toujours alimentées par une connaissance profonde de la littérature
scientifique concernant les penseurs qu’il aborde. H. évoque souvent les travaux
précédents avec beaucoup de générosité : le lecteur a l’impression qu’il n’a ignoré
aucune piste soulevée dans le cours de ses recherches : chaque personnage, chaque
thème a été étudié à fond (il faut signaler à ce propos que l’ouvrage est assorti d’un
excursus intéressant – mais trop court – sur Sorel et Gramsci, dont les idées
linguistiques, au lieu de découler de leurs positions politiques, influaient sur celles-ci).
Une séquence particulièrement frappante (p. 65-80) mène de Wittgenstein à Lukács (les
objets, d’ailleurs, d’une comparaison inattendue et pertinente), en passant, entre
autres, par Benveniste, Habermas, Pearson, Rorty, Leavis et Williams. Effectivement,
peu nombreux seront les lecteurs à même d’évaluer la justesse des propos de H. dans
leur totalité, vu l’érudition, l’originalité et la profondeur de ses analyses. L’auteur de ce
compte rendu ne déroge aucunement à ce constat : j’ai appris beaucoup en lisant LT et
compte y revenir souvent.
9 H. explique que l’interprétation des tournants linguistiques qu’il défend ne peut
trouver sa cohésion dans un seul récit continu : il raconte une « constellation » d’idées
politiques sous la forme de théories linguistiques, et non une transmission historique ;
de ce fait, LT est organisé de manière thématique et « épisodique ». Les choix de
l’auteur, parfaitement compréhensibles et pour la grande majorité pleinement justifiés,
reflètent forcément une certaine conception de l’histoire intellectuelle quant aux
questions de langue. Cette conception intègre Benjamin, Jakubinskij, Vinokur et
Cassirer (ce dernier fait l’objet d’une discussion éclairante), tout en passant à côté de
Merleau-Ponty, de Boas (exclu, sans doute, en raison de son immigration aux États-
Unis ; les articles recueillis dans Race and Democratic Society [Boas 1945] auraient
pourtant fourni un point de départ pour des comparaisons intéressantes), ainsi que des
théoriciens de deuxième plan, comme Damourette et Pichon, ou Polivanov – le vice-
commissaire pour les affaires étrangères en 1917-1918 –, comme de la plupart des
linguistes examinés dans les travaux de Christopher Hutton (1999) sur la linguistique et
le Troisième Reich. C’est donc une interprétation particulière que propose H. de
l’histoire des réflexions sur le langage : si quelque chose frappe dans LT, c’est la
préférence qu’affiche l’auteur pour la politique comme thème souvent larvé des travaux
sur le langage. Ainsi, certains penseurs qui abordent de front l’efficacité politique de la
langue ne sont que rapidement discutés (c’est le cas de Vološinov) et certains thèmes
sont même absents, comme les thèses de Polivanov (2014 [1931]) sur la linguistique
« marxiste », qui ne fait l’objet que d’une brève référence (p. 214). De manière
cohérente avec ce choix, mais au demeurant moins justifiée, la conception et les détails
de la politique sont peu définis : l’histoire politique n’est guère brossée, même à gros
traits, et le lecteur trouvera très peu de références à des événements historiques ou
politiques précis, choix dont découle une certaine abstraction dans les analyses. H.
évite soigneusement aussi toute thématisation idéologique. Sa sympathie pour une
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
177
certaine critique idéologique paraît néanmoins claire et certaines de ses lectures
peuvent être lues comme un prolongement des positions de Richard Bauman et Charles
L. Briggs (2003) dans leur étude essentielle Voices of Modernity. Language Ideologies and the
Politics of Inequality. C’est le cas quand, par exemple, H. présente les projets de réforme
linguistique dans la philosophie analytique comme des tentatives d’accaparement du
débat politique par des clercs, ou voit dans l’objectivité scientifique un substitut
aristocratique d’une sphère publique démocratique. LT propose surtout une histoire
intellectuelle du rôle des enjeux politiques à l’intérieur des idées sur le langage, pas du
tout une lecture « externe », historique ou sociologique, de celles-ci. Il faut constater
aussi que le détail et la rigueur bibliographique qui marquent l’investigation des idées
linguistiques caractérisent moins la manière assez générale dont H. aborde les
questions politiques. Dans un travail qui propose d’étudier les rapports entre les idées
sur la langue et les enjeux socio-politiques, cette frilosité est à regretter et laisse parfois
le lecteur sur sa faim.
10 Ces réserves, secondaires, ne devraient surtout pas minorer l’accomplissement
impressionnant que représente LT. L’ouvrage de H., passionnant, de grande envergure
et très original, est le produit d’une érudition plurilingue mise au service d’un
acharnement savant peu habituel et exprimée avec une élégance et une clarté de style
admirables, étant donné surtout la densité des analyses. Chose rare, les thèmes
dégagés, qui vont bien au-delà de ceux que j’ai pu relever ici, permettent d’aborder sous
un jour tout à fait nouveau le récit de la pensée moderne sur le langage. L’histoire de la
linguistique telle qu’on la pratique actuellement n’est sans doute ni suffisamment
politique, ni suffisamment ouverte aux enjeux idéologiques. Si le livre de H. ne propose
de suivre ni l’une ni l’autre de ces pistes en détail, il fournit néanmoins des analyses
intellectuelles précieuses, et une cartographie du territoire très éclairante, à ceux qui
voudraient prendre la relève. On peut donc espérer que LT donnera lieu à des travaux
d’approfondissement – de la part tant de H. lui-même, que d’autres chercheurs, que l’on
souhaite nombreux – que l’ouvrage sera susceptible d’inspirer.
BIBLIOGRAPHIE
Bauman, R. et Briggs, Ch. L. 2003. Voices of modernity. Language ideologies and the politics of
inequality. Cambridge : Cambridge University Press.
Boas, Fr. 1945. Race and democratic society. New York : J.J. Augustin.
Hirschkop, K. 1999. Mikhail Bakhtin: An aesthetic for democracy. Oxford : Oxford University Press.
Hutton, Chr. M. 1999. Linguistics and the Third Reich. Mother-tongue fascism, race and the science of
language. Londres : Routledge.
Polivanov, E. D. 2014. Pour une linguistique marxiste. Éd. par Elena Simonato. Trad. par Elena
Simonato et Patrick Sériot. Limoges : Lambert-Lucas.
Rorty, R., dir. 1967. The linguistic turn. Recent essays in philosophical method. Chicago : University of
Chicago Press.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
178
AUTEURS
NICK RIEMER
The University of Sydney, HTL
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
179
Gambier, Yves et Stecconi, Ubaldo,
dir. 2019. A world atlas of translation
Amsterdam/Philadelphie : Benjamins. vii-493 p.
Jacqueline Léon
RÉFÉRENCE
Gambier, Yves et Stecconi, Ubaldo, dir. 2019. A world atlas of translation. Amsterdam/
Philadelphie : Benjamins. vii-493 p. ISBN 9789027202154.
1 Cet ouvrage propose une vaste étude de l’histoire des conceptions et de
l’institutionnalisation de la traduction au niveau mondial. Il comporte 21 chapitres
rédigés par 29 contributeurs – en plus des deux directeurs de l’ouvrage –, pour la
plupart universitaires spécialistes d’études littéraires et de traduction – on compte
aussi deux traducteurs de la Bible –, chacun représentant une tradition de traduction
différente. Les chapitres portent, dans l’ordre d’apparition dans l’ouvrage, sur l’Océanie
(deux chapitres : les îles du Pacifique et l’Australie), l’Asie dont le Moyen-Orient (huit
chapitres : le Japon, la Chine, la Thaïlande, l’Inde, la Perse, le monde arabe, la culture
hébraïque, la tradition altaïque), l’Afrique (deux chapitres : l’Afrique du Sud et
l’Angola), l’Europe (cinq chapitres : la Russie, les cultures slaves, la tradition
hellénophone, la tradition latino-romane, la tradition germanique), enfin l’Amérique
(quatre chapitres : l’Amérique latine hispanophone, le Brésil, l’Amérique centrale et le
Mexique, l’Amérique du Nord). Chaque chapitre est précédé par un résumé et
comprend sa propre bibliographie
2 L’ouvrage comporte une préface explicitant les hypothèses et les objectifs de l’atlas et
une postface principalement consacrée à l’évaluation du travail accompli. Des notes
biographiques des auteurs, un index des langues, populations et toponymes, un index
des noms et un index des sujets figurent à la fin de l’ouvrage.
3 L’originalité et l’intérêt de l’ouvrage tient à sa démarche résolument empirique, limitée
par un encadrement assez strict des différentes contributions, ainsi qu’à son statut de
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
180
chantier en cours visant à terme l’exhaustivité. À partir du constat qu’il n’existe pas, à
l’heure actuelle, de définition opérationnelle et transculturelle de la traduction, les
directeurs de l’ouvrage critiquent la position européocentriste, adoptée par nombre de
théoriciens de la traduction, selon laquelle on ne peut aborder la traduction qu’à partir
des théories et des catégories construites au fil des siècles en Occident et fondées sur
l’hypothèse d’universaux. Ils revendiquent une démarche empirique et inductive
(bottom-up) afin de déterminer s’il est possible de définir a posteriori une notion de
traduction à partir des données.
4 Chaque chapitre se présente ainsi comme un « rapport » (report) sur une tradition
donnée. Les généralisations sont effectuées à partir de données comparables et
collectées « sur le terrain », rassemblant toutes formes et modes de communication
rencontrés dans les communautés examinées (textes écrits et oraux, audio et vidéo,
enregistrements, textes numérisés, etc.). Ces rapports ont pour tâche de rendre compte
de la perception de la traduction qu’ont les locuteurs et les traducteurs d’une tradition
donnée, ainsi que de la place et la fonction de la traduction dans ces traditions.
5 L’Atlas revendique de viser une certaine exhaustivité, obtenue au terme de
développements et remaniements futurs. Il se définit comme un chantier en cours
devant être augmenté par l’ajout de traditions non encore explorées, et susceptible
d’être modifié par la réinterprétation des résultats déjà obtenus. La postface se
présente ainsi comme une sorte d’évaluation, voire une autocritique du travail
accompli.
6 La préface fait état des instructions fournies aux contributeurs des rapports. Elles ont
été définies par six universitaires consultants, spécialistes des grandes régions du
monde traitées dans l’ouvrage. Ceux-ci ont eu pour tâche d’identifier les traditions à
partir d’aires géographiques et linguistiques, et de déterminer les critères de définition
de ce qu’est une traduction. Sont distingués les concepts de traduction, à savoir les
idées sur la traduction, déterminées historiquement et culturellement selon les
traditions (input de la recherche), et la notion de traduction, à savoir une description
interculturelle constituant l’objectif de la recherche (output de la recherche).
7 Dans leurs instructions aux auteurs, figurent les questions auxquelles ceux-ci devront
s’attacher à répondre : déterminer les termes utilisés pour dénoter la traduction dans
une tradition donnée, situés dans leur évolution historique ; s’interroger sur la
traduction comme pratique autonome et entité culturelle, sur les relations entre
traduction et autres formes de communication ; examiner en quoi la traduction est une
pratique culturelle qui reflète et formate les idées venant de l’étranger, autrement dit
en quoi elle constitue un transfert d’idées d’une tradition à une autre. Il s’agit aussi
d’examiner les relations de pouvoir dans lesquelles peut être impliquée la traduction,
comment elle intervient dans les échanges et stratégies de domination et de résistance.
Seront aussi étudiées les relations entre politiques linguistiques et traduction, ainsi que
l’impact des nouvelles technologies de communication et des nouveaux modèles de
gestion (business models) sur le concept de traduction.
8 Dans leur postface auto-évaluative, les directeurs de l’ouvrage admettent qu’une
définition claire de la notion de traduction n’émerge pas de l’étude. Ils invoquent
l’hétérogénéité des données, notamment l’absence de traces non écrites avant
l’apparition des moyens d’enregistrement, de même que l’archivage imparfait des
documents écrits. Cette disparité tient aussi à la diversité des traditions et à l’approche
inductive où chacun rend compte de sa tradition dans ses propres termes. Ils déplorent
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
181
cette diversité des approches et des méthodologies adoptées par les contributeurs,
qu’elles soient économique, sociologique, historique, ou linguistique, tout en
reconnaissant qu’ils ne voulaient en aucun cas interférer sur le mode d’approche
adopté. Ils observent toutefois que certains traits sont communs à des traditions
différentes, comme par exemple la traduction comme véhicule de la modernisation
dans les traditions thaï, altaïque et russe ; le rôle joué par la traduction dans la
colonisation et par les missionnaires dans le Pacifique, l’Australie, l’Angola et le Brésil.
Au contraire, la traduction a pu jouer un rôle dans l’autodétermination et la résistance
à la colonisation dans les traditions slave, nord-américaine, hispano-américaine, arabe
et hébraïque. Certains traits n’apparaissent que dans certaines traditions, comme l’idée
selon laquelle la traduction n’est pas un mouvement qui éloigne du texte mais un
changement à l’intérieur du texte, que l’on retrouve dans la plupart des traditions
européennes.
9 Ainsi émerge une conception de la traduction comme frontière. D’une part, comme lieu
où des approches conflictuelles, des intérêts et des relations de pouvoir s’affrontent et
s’installent. La traduction est une région frontière, un territoire qui ne peut être occupé
de façon permanente et qu’on négocie (notion de negotiating border). Elle réfère soit à
une frontière géographique – il s’agit d’un atlas –, soit à des frontières temporelles
comme les phases de transition historiques ou culturelles, ou bien encore à une
circulation des informations et des savoirs accessibles d’un côté d’une frontière et non
de l’autre. Il y a traduction quand un ensemble de signes, pratiques et habitudes sont
tirées à l’intérieur d’une frontière par les membres d’une communauté linguistique et
culturelle (par exemple la volonté de modernisation d’un gouvernant comme dans la
tradition thaï), ou quand elles sont poussées de l’autre côté de la frontière (comme la
diffusion de textes sacrés dans la tradition angolaise).
10 Pour conclure, on constate que, malgré l’hétérogénéité des méthodes et des approches,
inhérente à la démarche inductive et empirique, et que n’a pas toujours réussi à réduire
le cadre fourni aux auteurs, l’ouvrage reste tout à fait cohérent. Même si les approches
linguistiques restent très succinctes – seul le chapitre sur les cultures slaves présente
une analyse morphologique des termes nommant la « traduction » – et que ce sont les
aspects sociolinguistiques, notamment de politique linguistique, qui dominent les
analyses, l’ouvrage s’avère, par son ampleur, tout à fait intéressant. On regrettera un
peu que, bien qu’elles figurent dans les indications données aux auteurs, ne soient pas
du tout abordées les questions d’aide informatisée à la traduction (dictionnaires
informatisés, bases de données terminologiques, corpus numérisés, corpus alignés,
etc.), dont l’impact sur l’activité de traduction a pourtant été très important ces
dernières décennies.
11 Enfin, bien que, contrairement à l’ouvrage dirigé par Émilie Aussant (2015), concentré
sur les théoriciens du langage d’un nombre plus restreint de traditions et sur la façon
dont leur posture théorique a orienté l’activité de traduction, l’Atlas ait des visées
moins historiques et épistémologiques, en particulier si l’on se réfère à son objectif de
découverte inductive d’une définition de la traduction, cet ouvrage présente un intérêt
certain pour les historiens de la linguistique par la qualité de la réflexion sur la
traduction et par la richesse des données et des références que comportent chacun des
rapports.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
182
BIBLIOGRAPHIE
Aussant, É., dir. 2015. La traduction dans l’histoire des idées linguistiques. Représentations et pratiques.
Paris : Geuthner
AUTEURS
JACQUELINE LÉON
CNRS, HTL
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
183
Ouvrages de collaborateurs d’HEL
Publications by associates of HEL
NOTE DE L’ÉDITEUR
Les « collaborateurs d’HEL » sont les membres du laboratoire HTL ainsi que les
membres du bureau de la SHESL. Leurs ouvrages ne peuvent donner lieu à compte
rendu dans HEL. / “Associates of HEL” refers to members of HTL research unit and to
members of the SHESL board. Their publications shall not be reviewed in HEL.
1 Sablayrolles, Jean-François. 2020. Comprendre la néologie : conceptions, analyses, emplois.
Limoges : Lambert-Lucas. La Lexicothèque. 312 p. ISBN 978-2-35935-286-3.
La néologie, phénomène universel des langues vivantes, touche pratiquement tous les
domaines des sciences du langage et son traitement varie selon les modèles
linguistiques empruntés (saussurien, martinetien, chomskyen…). Ce livre a pour
objectif de proposer un tour d’horizon aussi complet que possible de ces questions et
des réponses qui y sont apportées. Trois grandes parties exposent successivement :
(1°) les concepts-clefs des créations lexicales avec leurs évolutions, leurs définitions et
leurs rapports avec les dictionnaires ; (2°) les différentes typologies qui en ont été
proposées et, après distinction entre configuration et matrice, un tableau raisonné des
matrices suivi de l’examen de cas délicats ; (3°) les utilisations et les utilisateurs de la
néologie considérés dans ses aspects énonciatifs, de politique linguistique et de
relations sociales.
2 Bisconti, Valentina, De Angelis, Rossana et Curea, Anamaria, dir. 2020. Héritages,
réceptions, écoles en sciences du langage : avant et après Saussure. Paris : Presses de la
Sorbonne Nouvelle. 366 p. ISBN 978-2-37906-030-4.
L’ouvrage offre un panorama des études actuelles dans le domaine de l’histoire et de
l’épistémologie des sciences du langage. Conçu en hommage à Christian Puech, qui n’a
cessé de faire dialoguer la linguistique et d’autres sciences humaines, il propose un état
des lieux de la linguistique, de ses rapports avec des disciplines telles que la grammaire,
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
184
la sémiologie et la philosophie, et identifie la place qu’elle occupe actuellement dans les
sciences humaines.
Épistémologie et historiographie de la grammaire et de la linguistique, impact de
l’œuvre de Saussure, courants structuralistes : trente-et-un articles, rédigés par des
spécialistes internationaux de l’histoire et de l’épistémologie des sciences du langage,
portent sur les traditions linguistiques européennes et extra-européennes, couvrant
une période qui va de l’Antiquité à nos jours.
3 Léonard, Jean Léo et Avilés González, Karla Janiré, dir. 2019. Didactique des « langues
en danger » : recherche-action en dialectologie sociale = Pedagogía co-participativa y “lenguas
en peligro” : propuestas de dialectología social en acción. Paris : Michel Houdiard Éditeur.
242 p. ISBN 978-2-35692-177-2.
Ce livre est un recueil de propositions pour une didactique des langues vulnérables ou
en danger. Il apporte une pierre de touche aux méthodes et théories de la
« revitalisation » de ces langues. Il se présente comme un kaléidoscope de méthodes et
d’idées pour développer des ateliers de développement de ressources pédagogiques en
langues autochtones (TERPLO), à partir de multiples ateliers d’écriture réalisés
principalement par et avec des locuteurs d’une trentaine de langues mésoaméricaines,
mais également sous d’autres latitudes, comme l’Estonie. Des langues (nahuatl,
mazatec, zapotec, etc.), ou des variétés dialectales d’un domaine linguistique (võro,
mulgi et une variété orientale d’estonien, de Kodavere) qui, malgré la distance
géographique et typologique, partagent les processus de résistance et de résilience
sociolinguistique investis par leurs locuteurs. Cette dynamique de résistance, mais aussi
de création et d’invention, d’élaboration et d’affinement de leur lexique et de leurs
grammaires à travers la pratique pédagogiquement orientée de l’écriture, se reflète
dans chacun des ateliers analysés ici. Ces travaux co-participatifs, menés aux côtés de
linguistes et d’anthropologues qui partagent leurs connaissances techniques et
méthodologiques avec les instituteurs, les élèves des écoles et les étudiants des
universités interculturelles, démontrent que l’écriture n’est pas un instrument
appartenant exclusivement aux langues « dominantes », mais plutôt un outil de
communication, un processus par lequel l’oralité reste certes un élément inhérent à la
vitalité linguistique et donc de la pérennité de ces langues. L’écrit agit plutôt comme
une ressource que comme une barrière. L’oralité et l’écriture, le transfert des
connaissances, l’autonomisation, la dialectologie sociale et perceptuelle, la
confrontation des points de vue (de l’expert et de l’usager), l’optimisme et le
pessimisme constituent quelques-uns des axes qui soutiennent ces TERPLO, ou ateliers
d’écriture didactique des « langues de tradition orale » ou de toute langue menacée,
contribuant à la construction épistémologique, méthodologique et écologique de cette
praxis éducative et sociolinguistique qu’est la revitalisation des langues « en danger ».
4 Colombat, Bernard et Lahaussois, Aimée, dir. 2019. Histoire des parties du discours.
Louvain : Peeters. Orbis/Supplementa 46. xxii + 563 p. ISBN 978-90-429-3952-3.
Comment définir le nom ? Qu’est-ce qu’un verbe ? Faut-il faire du pronom une
catégorie distincte du nom ? Pourquoi l’article est-il une catégorie reconnue seulement
dans certaines langues ? À partir de quel moment a-t-on fait de l’adjectif une classe de
mots à part ? Peut-on trouver des interjections dans toutes les langues ? Y a-t-il des
classes de mots universelles ? Pourquoi le nombre de parties du discours varie-t-il
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
185
d’une langue à l’autre ? C’est à ces questions et à quelques autres que cet ouvrage veut
répondre, en présentant une histoire des classes de mots (les « parties du discours »)
dans la tradition occidentale et dans deux traditions « orientales » : arabe et sanskrite.
Son originalité est d’inscrire cette histoire dans le long terme, en partant des classes
identifiées dans la tradition grammaticale gréco-latine et en examinant ensuite le
devenir de ces classes dans la grammaire française et d’autres traditions européennes.
Le volume comporte quatorze chapitres : le premier est consacré à une étude des
parties du discours dans leur ensemble, avec leurs « accidents », c’est-à-dire les
catégories linguistiques qui les affectent, le deuxième au mot et les dix suivants à
chacune des classes de mots (nom, article, adjectif, pronom, verbe, participe, adverbe,
préposition, conjonction, interjection). Les deux derniers chapitres traitent des
traditions grammaticales arabe et sanskrite. L’ouvrage se termine par une copieuse
bibliographie et par trois index (auteurs, langues, concepts).
5 Tran Duc Thao. La dialettica materialista della coscienza. Éd. par Jacopo D’Alonzo. Rome :
Castelvecchi. Le Navi. 2019. 96 p. ISBN 9788832828047
Cos’è la coscienza? E qual è il metodo per studiarla? Con questo saggio, pubblicato tra il
1974 e il 1975 e qui compendiato da note critiche e una ricca bibliografia, Tran Duc
Thao, filosofo vicino a Sartre e a Merleau-Ponty e figura chiave della fenomenologia
francese del secondo dopoguerra, propone un’inedita metodologia per lo studio della
coscienza. Questa passa per un progetto semiologico, fortemente debitore della
tradizione marxista, il quale non manca di alcuni elementi di grande originalità, come
la nozione di “linguaggio della vita reale”. Sullo sfondo di un bilancio biografico e
teorico del suo percorso intellettuale, che non risparmia critiche all’individualismo e
all’idealismo, Thao accoglie le sfide provenienti dalle scienze (linguistica, psicologia,
biologia, paleoantropologia, genetica) e rivendica il ruolo svolto dal corpo,
dall’interazione pratica con il mondo reale, dal linguaggio e dalle relazioni sociali nella
formazione della coscienza.
6 Binaghi, Francesco et Sartori, Manuel, dir. 2019. Fuṣḥā écrit contemporain : usages et
nouveaux développements. Marseille : Diacritiques Éditions. 271 p. ISBN
979-10-97093-04-4.
Suite au colloque qui s’est tenu à Aix-en-Provence en juin 2015, intitulé « Matériaux
pour l’établissement de grammaires descriptives du fuṣḥā écrit contemporain. Entre
norme(s) et pratiques au cours des 50 dernières années », ce recueil propose d’ouvrir la
réflexion sur la langue arabe écrite contemporaine et, plus particulièrement, sur ce qui
est réputé dans le monde arabe comme étant du fuṣḥā écrit contemporain
(Contemporary Written Fuṣḥā – CWF).
À partir de données nouvelles, en termes de faits de langue, provenant d’un travail sur
corpus écrits (littérature, presse, blogs, etc.) issus de divers supports (papier ou
internet), ce recueil propose l’analyse de quelques aspects de cet arabe écrit
contemporain. L’objectif est de rendre compte des évolutions notables de cette variété
de langue, qui intéressent au premier chef la syntaxe, mais qui relèvent tout aussi
d’évolutions sémantiques et d’usages sociolinguistiques.
7 Aussant, Émilie et Lahaussois, Aimée, dir. 2019. « Grammaires étendues » et
descriptions de morphologie verbale (numéro thématique). Faits de langues 50/2.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
186
Leiden : Brill. 166 p. ISSN 1244-5460.
Cette livraison de Faits de langues rassemble quelques-uns des travaux présentés lors
d’une journée d’étude consacrée aux « retombées » du phénomène des « Grammaires
étendues » en linguistique descriptive, organisée en novembre 2016 avec le soutien du
Labex EFL. Cet ensemble d’articles, rédigés par des linguistes descriptivistes qui
s’interrogent sur les modèles grammaticaux utilisés, au cours de l’histoire, pour la
description des langues ou des aires sur lesquelles ils travaillent, est éclairant à – au
moins – deux titres : il connecte les pratiques actuelles avec l’histoire des descriptions,
faisant émerger, pour une langue ou un sous-groupe de langues, l’évolution des termes
et représentations utilisés ; il montre, à ceux qui travaillent « au présent », toute
l’utilité des descriptions des langues réalisées par le passé. Outre les données que ces
descriptions rassemblent, qui intéressent les descripteurs pour la dimension
diachronique qu’elles donnent à voir, elles prouvent à quel point le « bricolage » des
prédécesseurs est riche d’enseignements, à bien des égards.
Histoire Épistémologie Langage, 42-1 | 2020
Vous aimerez peut-être aussi
- Le prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesD'EverandLe prisme des langues: Essai sur la diversité linguistique et les difficultés des languesPas encore d'évaluation
- Ddoc T 2015 0324 NaouiDocument444 pagesDdoc T 2015 0324 NaouiSerigne Modou NDIAYEPas encore d'évaluation
- DICTION Weber 16maiDocument14 pagesDICTION Weber 16maifredlouissPas encore d'évaluation
- Document de Synthese - HDRDocument82 pagesDocument de Synthese - HDRnewman jerseyPas encore d'évaluation
- Fagard EUE 2010Document444 pagesFagard EUE 2010ulisePas encore d'évaluation
- Linguist I QueDocument3 pagesLinguist I QueMeriem FellahPas encore d'évaluation
- 2005 Ferrando RousseletDocument402 pages2005 Ferrando RousseletAlina Partenie100% (1)
- Du Structuralisme À La Linguistique de L'énonciation - Les Courants Linguistiques en MouvementDocument15 pagesDu Structuralisme À La Linguistique de L'énonciation - Les Courants Linguistiques en MouvementTar OuadPas encore d'évaluation
- BenvenisteDocument14 pagesBenvenisteEsengül Yazıcı KayaPas encore d'évaluation
- Problemes de Linguistique Generale BenveDocument22 pagesProblemes de Linguistique Generale BenveFloydPas encore d'évaluation
- 1ère Partie Cours Initiation À La Linguistique S4 G4 Pr. Ali OuassouDocument6 pages1ère Partie Cours Initiation À La Linguistique S4 G4 Pr. Ali OuassouLoubna100% (1)
- Syllabus Cours Theories Linguistiques s1 Option L A I 2022 2023Document32 pagesSyllabus Cours Theories Linguistiques s1 Option L A I 2022 2023Dounia zed SouyiehPas encore d'évaluation
- Textes Littéraires Et Enseignement Du Français - 1Document55 pagesTextes Littéraires Et Enseignement Du Français - 1gabvrielaPas encore d'évaluation
- Apophonie Et Categories Grammaticales Dans Baltique - PetitDocument220 pagesApophonie Et Categories Grammaticales Dans Baltique - PetitAdam PaulukaitisPas encore d'évaluation
- 04 ValenceDocument4 pages04 ValenceBethlPas encore d'évaluation
- These Paris 4 2005Document403 pagesThese Paris 4 2005Sebastian Natera SilvaPas encore d'évaluation
- Lexicologie S Approches Crois 233 Es en S 233 Mantique Lexicale - Facebook Com LinguaLIB PDFDocument462 pagesLexicologie S Approches Crois 233 Es en S 233 Mantique Lexicale - Facebook Com LinguaLIB PDFenri50% (2)
- JJJJJJJJJDocument42 pagesJJJJJJJJJSelma Elim ElimPas encore d'évaluation
- TheseDocument446 pagesThesedoğa çardakPas encore d'évaluation
- Benveniste Emile - Problèmes de Linguistique Générale Tome 2Document289 pagesBenveniste Emile - Problèmes de Linguistique Générale Tome 2Laurence Driouch100% (8)
- ENS LETRAN UE 421 Courants Actuels de La Théorie Linguistique-1Document8 pagesENS LETRAN UE 421 Courants Actuels de La Théorie Linguistique-1ITEBE DIEUDONNEPas encore d'évaluation
- 1 Cours Initiation À La Linguistique Introduction Et Histoire LAHLOUDocument6 pages1 Cours Initiation À La Linguistique Introduction Et Histoire LAHLOUTABETPas encore d'évaluation
- Claude Lefébure (1945-2020)Document9 pagesClaude Lefébure (1945-2020)DuveyrierPas encore d'évaluation
- ArbachDocument24 pagesArbachhafidPas encore d'évaluation
- Le BanquetDocument7 pagesLe BanquetdragPas encore d'évaluation
- Initiation À La Linguistique (S4) - Chalfi - Séance 3 - FPEDocument3 pagesInitiation À La Linguistique (S4) - Chalfi - Séance 3 - FPEDELTANETO SLIMANE100% (1)
- Grammaire Fond Amen Tale Du HongroisDocument286 pagesGrammaire Fond Amen Tale Du HongroisKevin EpsiPas encore d'évaluation
- Plaquette VEPDocument37 pagesPlaquette VEPscaricascarica100% (2)
- 2010pa030061 1Document229 pages2010pa030061 1Alim Saphir YayaPas encore d'évaluation
- Brochure Ed 268 2016 2017Document36 pagesBrochure Ed 268 2016 2017Alexander León PuelloPas encore d'évaluation
- Cours Théories LinguistiquesDocument17 pagesCours Théories LinguistiquesKhalil RebbaliPas encore d'évaluation
- These LoussakoumounouDocument529 pagesThese LoussakoumounouYannick Demeo Goli100% (1)
- Init Ling 2020Document178 pagesInit Ling 2020OUSSAMA OUBELLAPas encore d'évaluation
- Histoire de La Linguistique - Tarrier PDFDocument68 pagesHistoire de La Linguistique - Tarrier PDFkrenari68100% (1)
- 1ere Partie Naissance de La SociolinguistiqueDocument10 pages1ere Partie Naissance de La SociolinguistiqueLou-salomé Ferret Renevier100% (1)
- Cours Sur Les Français RegionauxDocument18 pagesCours Sur Les Français RegionauxSocratePas encore d'évaluation
- Claude Rilly - La Langue Du Royaume de Méroé, Un Panorama de La Plus Ancienne Culture Écrite D'afrique Subsaharienne. - Champion (2007)Document633 pagesClaude Rilly - La Langue Du Royaume de Méroé, Un Panorama de La Plus Ancienne Culture Écrite D'afrique Subsaharienne. - Champion (2007)GaneshGPas encore d'évaluation
- Thèse Didactique de Textes LittérairesDocument330 pagesThèse Didactique de Textes LittérairesSemiotista0118100% (2)
- Relire Georges Mounin Aujourd'huiDocument17 pagesRelire Georges Mounin Aujourd'huiVasile SambritchiPas encore d'évaluation
- Expression Et ExpressivitéDocument380 pagesExpression Et ExpressivitéITEBE DIEUDONNE100% (1)
- Gammaire Et LinguistiqueDocument3 pagesGammaire Et LinguistiqueMorsli MahieddinePas encore d'évaluation
- PDF Thierry BulotDocument29 pagesPDF Thierry BulotHo Ten100% (1)
- Problèmes de Linguistíque GénéraleDocument372 pagesProblèmes de Linguistíque GénéraleBreno Gomes100% (2)
- Verdelhan 2020Document15 pagesVerdelhan 2020kpelegbeu bleuPas encore d'évaluation
- Herslund-Le Francais Comme Langue Exotique 2008Document27 pagesHerslund-Le Francais Comme Langue Exotique 2008Tabitha SandersPas encore d'évaluation
- можеDocument412 pagesможеKsushaKorolkovaPas encore d'évaluation
- Verbe - Didactique D'enseignementDocument31 pagesVerbe - Didactique D'enseignementRania BouazizPas encore d'évaluation
- Propositions Pour Une Typologie Des Méthodes de LanguesDocument36 pagesPropositions Pour Une Typologie Des Méthodes de LanguesNguyen-Thuc Thanh-TinPas encore d'évaluation
- Histoire de L'enseignement Du Français - A ChervelDocument8 pagesHistoire de L'enseignement Du Français - A ChervelNanditaWaglePas encore d'évaluation
- Universidad GranadaDocument17 pagesUniversidad GranadaAlexandra GherghelPas encore d'évaluation
- Raconte-Moi Tes Langues ... Les Biographies Langagières en Tant Qu'outils D'enseignement Et de RechercheDocument11 pagesRaconte-Moi Tes Langues ... Les Biographies Langagières en Tant Qu'outils D'enseignement Et de RechercheJaime Abad MontesinosPas encore d'évaluation
- TD 1Document2 pagesTD 1jismail100% (1)
- Quelques Réflexions Sur La Traduction Littéraire Du Chinois Vers Les Langues EuropéennesDocument17 pagesQuelques Réflexions Sur La Traduction Littéraire Du Chinois Vers Les Langues EuropéennesStown TVPas encore d'évaluation
- Breve Histoire de Linguistique RobinsDocument241 pagesBreve Histoire de Linguistique Robinshmayda riad100% (2)
- Enonciation Et Analyse Du Discours PDFDocument12 pagesEnonciation Et Analyse Du Discours PDFmassado foueka linda jolivettePas encore d'évaluation
- VLemoine-bresson Entretienf - CartonDocument17 pagesVLemoine-bresson Entretienf - CartonHamid BraikPas encore d'évaluation
- SociolinguistiqueDocument8 pagesSociolinguistiqueElennaSpeianuPas encore d'évaluation
- De La Linguistique A La SociolinguistiqueDocument20 pagesDe La Linguistique A La SociolinguistiqueDiana TreastinPas encore d'évaluation
- Biblio PhillipeLaneDocument2 pagesBiblio PhillipeLanerooxy_gyrlPas encore d'évaluation
- Fiches Pédagogiques Des Cours de M2 Du Master de FLEDocument11 pagesFiches Pédagogiques Des Cours de M2 Du Master de FLETewodrosPas encore d'évaluation
- Introduction A Larchitecture ARMDocument16 pagesIntroduction A Larchitecture ARMbelabbas houasPas encore d'évaluation
- TP 20 - Modélisation Et Étude Cinématique (OUVRE PORTAIL AVIDSEN) REDIER CyrilDocument12 pagesTP 20 - Modélisation Et Étude Cinématique (OUVRE PORTAIL AVIDSEN) REDIER CyrilCyril REDIERPas encore d'évaluation
- Tassement Du Sol Et Formules de Boussinesq PDFDocument5 pagesTassement Du Sol Et Formules de Boussinesq PDFSam Adele50% (2)
- Concombre Et CornichonDocument2 pagesConcombre Et Cornichonjohn johnPas encore d'évaluation
- IFU Thermoval BabyDocument98 pagesIFU Thermoval Babytiffanis.72Pas encore d'évaluation
- GENIE CIVIL SerieExercice1 PDFDocument5 pagesGENIE CIVIL SerieExercice1 PDFFao DPas encore d'évaluation
- Contrôle SEDocument2 pagesContrôle SEYahya KylaPas encore d'évaluation
- La Vierge Marie Sa Sublime Histoire Et Ses ApparitionsDocument12 pagesLa Vierge Marie Sa Sublime Histoire Et Ses ApparitionsirinamonteiroteixeiraPas encore d'évaluation
- J. Farges - Lebenswelt - Husserl-Dilthey-EuckenDocument29 pagesJ. Farges - Lebenswelt - Husserl-Dilthey-EuckenFabio Prado de FreitasPas encore d'évaluation
- ATYS CONCEPT - MIV EFC Doc HDDocument2 pagesATYS CONCEPT - MIV EFC Doc HDlee marvin BilongPas encore d'évaluation
- Les Styles D'apprentissageDocument5 pagesLes Styles D'apprentissageMohamed ElkaPas encore d'évaluation
- Prés - 1Document26 pagesPrés - 1AlbertoPas encore d'évaluation
- Tradition Orale & Developpement (G. Singo, DeA)Document33 pagesTradition Orale & Developpement (G. Singo, DeA)mouhabaldePas encore d'évaluation
- TP2 SB Solutions v3Document11 pagesTP2 SB Solutions v3m.aziz.belhajPas encore d'évaluation
- PDF NGKDocument262 pagesPDF NGKbouani yosriPas encore d'évaluation
- Cours-Les Réactions chimiques-FR PDFDocument6 pagesCours-Les Réactions chimiques-FR PDFhakima032100% (1)
- Calcul DifferentielDocument72 pagesCalcul DifferentielRachid KdidarPas encore d'évaluation
- SepaDocument1 pageSepaPEROTIN100% (1)
- Ed 6129Document32 pagesEd 6129abdelbarrPas encore d'évaluation
- Protocole de Qualification Des Machines À TablettesDocument23 pagesProtocole de Qualification Des Machines À TablettesScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- WallisDocument4 pagesWallisyouness hidaPas encore d'évaluation
- Patho Spéciale M KEMTI-1Document72 pagesPatho Spéciale M KEMTI-1DahirouPas encore d'évaluation
- Cours OnduleurDocument7 pagesCours Onduleurmasmoudimohamed50% (2)
- Davis Mike - Ville en CartonsDocument3 pagesDavis Mike - Ville en CartonskaeyuserPas encore d'évaluation
- TEST LOG CorrigéDocument6 pagesTEST LOG CorrigéJonas Makambo0% (1)
- 03extrait ConductionDocument13 pages03extrait Conductionالغزيزال الحسن EL GHZIZAL HassanePas encore d'évaluation
- Rigidité Diélectrique Et Mécanismes de ClaquageDocument7 pagesRigidité Diélectrique Et Mécanismes de Claquagenarimen lamis rezkiPas encore d'évaluation
- Examen Comptabilité Enoncé T.G.CDocument9 pagesExamen Comptabilité Enoncé T.G.CWalid BarchoumPas encore d'évaluation
- Modele Contrat Bible LitteraireDocument41 pagesModele Contrat Bible Litteraire4ykbjfyfhxPas encore d'évaluation
- Ranger 305D Part List PDFDocument34 pagesRanger 305D Part List PDFamekhzoumiPas encore d'évaluation
- Vocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirD'EverandVocabulaire DELF B2 - 3000 mots pour réussirÉvaluation : 4.5 sur 5 étoiles4.5/5 (34)
- Trésor des Proverbes Latino-Américains avec leurs équivalents espagnols, français, québécois et anglaisD'EverandTrésor des Proverbes Latino-Américains avec leurs équivalents espagnols, français, québécois et anglaisPas encore d'évaluation
- Psaumes Tehilim - Hebreu-Phonetique-FrancaisD'EverandPsaumes Tehilim - Hebreu-Phonetique-FrancaisÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (4)
- Apprendre l'Anglais : Expressions idiomatiques ‒ Proverbes et DictonsD'EverandApprendre l'Anglais : Expressions idiomatiques ‒ Proverbes et DictonsPas encore d'évaluation
- Anglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueD'EverandAnglais ( L’Anglais Facile a Lire ) 400 Mots Fréquents (4 Livres en 1 Super Pack): 400 mots fréquents en anglais expliqués en français avec texte bilingueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Tests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesD'EverandTests de grammaire française: 400 questions pour évaluer vos connaissancesÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (3)
- Anglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireD'EverandAnglais Pour Les Nulles - Livre Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos de los Koalas pour apprendre anglais vocabulaireÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Le Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirD'EverandLe Participe passé dans tous ses états: Petit traité de l'Accord du Participe passé avec être et avoirPas encore d'évaluation
- Apprendre l’allemand - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Allemand)D'EverandApprendre l’allemand - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Allemand)Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)
- Anglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre Anglais Utile en Voyage: Un livre anglais debutant avec 400 phrases pour apprendre anglais vocabulaire pour voyageursD'EverandAnglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre Anglais Utile en Voyage: Un livre anglais debutant avec 400 phrases pour apprendre anglais vocabulaire pour voyageursÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- le vocabulaire anglais pour comprendre 80% des conversations: parlez et comprendre l'anglaisD'Everandle vocabulaire anglais pour comprendre 80% des conversations: parlez et comprendre l'anglaisÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Le langage corporel : interpréter les signes non verbauxD'EverandLe langage corporel : interpréter les signes non verbauxÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (3)
- L’Anglais facile a lire - Apprendre l’anglais (Vol 1): 12 histoires en anglais et en français pour apprendre l’anglais rapidementD'EverandL’Anglais facile a lire - Apprendre l’anglais (Vol 1): 12 histoires en anglais et en français pour apprendre l’anglais rapidementÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (72)
- Enseigner les Traits pertinents temporels: avec la participation active des apprenantsD'EverandEnseigner les Traits pertinents temporels: avec la participation active des apprenantsPas encore d'évaluation
- L’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 1): 12 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisD'EverandL’Espagnol Pour Tous - apprendre l’espagnol pour débutant (Vol 1): 12 nouvelles en espagnol facile, un livre bilingue espagnol francaisPas encore d'évaluation
- Anglais (L’Anglais Facile a Lire) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Vol 11): 400 images et mots essentiels, en texte bilingue, sur la quarantaine, le coronavirus, la transmission de virus, pandémie et termes médicauxD'EverandAnglais (L’Anglais Facile a Lire) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Vol 11): 400 images et mots essentiels, en texte bilingue, sur la quarantaine, le coronavirus, la transmission de virus, pandémie et termes médicauxPas encore d'évaluation
- Anglais - Livre Bilingue Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos pour apprendre anglais vocabulaireD'EverandAnglais - Livre Bilingue Anglais Français Facile A Lire: 50 dialogues facile a lire et photos pour apprendre anglais vocabulaireÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (1)
- Apprendre l'Italien : Proverbes et ExpressionsD'EverandApprendre l'Italien : Proverbes et ExpressionsÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (4)
- Petit guide pratique de la phonétique corrective du fleD'EverandPetit guide pratique de la phonétique corrective du fleÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Apprendre l'anglais - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Anglais)D'EverandApprendre l'anglais - Texte parallèle - Collection drôle histoire (Français - Anglais)Évaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (16)
- Anglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Super Pack 10 livres en 1): 1.000 mots, 1.000 images, 1.000 textes bilingues (10 livres en 1 pour économiser et apprendre l'anglais plus rapidement)D'EverandAnglais ( L’Anglais facile a lire ) - Apprendre L’Anglais Avec Des Images (Super Pack 10 livres en 1): 1.000 mots, 1.000 images, 1.000 textes bilingues (10 livres en 1 pour économiser et apprendre l'anglais plus rapidement)Évaluation : 2.5 sur 5 étoiles2.5/5 (2)
- Apprendre le portugais - Texte parallèle (Français - Portugais) Collection drôle histoireD'EverandApprendre le portugais - Texte parallèle (Français - Portugais) Collection drôle histoireÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Anglais ( L’Anglais Facile a Lire ) Dictionnaire des mots de base: Dictionnaire anglais francais des 850 mots anglais essentiels, avec traduction et exemples de phrasesD'EverandAnglais ( L’Anglais Facile a Lire ) Dictionnaire des mots de base: Dictionnaire anglais francais des 850 mots anglais essentiels, avec traduction et exemples de phrasesÉvaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (3)