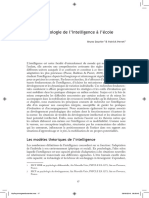Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours - Approches Historiques Et Contemporaines de La Résolution de Problème
Cours - Approches Historiques Et Contemporaines de La Résolution de Problème
Transféré par
willy vleiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours - Approches Historiques Et Contemporaines de La Résolution de Problème
Cours - Approches Historiques Et Contemporaines de La Résolution de Problème
Transféré par
willy vleiDroits d'auteur :
Formats disponibles
APPROCHES HISTORIQUES ET CONTEMPORAINES DE LA REwSOLUTION DE
PROBLEMES
La résolution de problèmes a une longue histoire : elle a revêtu différentes formes
depuis le début de la psychologie, elle a été l’objet de grandes controverses théoriques, son
étude recèle beaucoup de difficultés et elle requiert une méthodologie spécifique. Cela tient au
fait que c’est une activité complexe qui est au carrefour des différentes activités
psychologiques : la mémoire, car elle fait appel aux connaissances et à l’expérience passée, la
perception, car la prise d’information sur la situation joue un rôle majeur, le raisonnement
prospectif pour planifier et anticiper les conséquences d’une action, le raisonnement
rétrospectif pour comprendre les raisons d’un échec (par exemple), la compréhension, car la
difficulté d’un problème tient bien souvent à une mauvaise appréhension de la situation de
sorte que le problème requiert une réinterprétation, l’attention, car les opérateurs humains
sont en interaction permanente avec des dispositifs qui assurent des tâches de contrôle et de
surveillance impliquant souvent des décisions efficaces.
La psychologie de la résolution de problèmes a été traversée par une vive controverse
sur la nature de cette activité. Essentiellement étudiée chez l’animal, elle a été envisagée et
décrite par les théoriciens du mouvement behavioriste comme le résultat d’un apprentissage
par renforcement et l’établissement de familles de réponses adaptées à la situation. À
l’opposé, en critiquant vivement le point de vue réductionniste des behavioristes, les
théoriciens du mouvement de la Gestalt Psychology ont insisté sur le caractère négatif que
peuvent avoir les apprentissages antérieurs et les habitudes dans la découverte de solution.
Aujourd’hui, la résolution de problème est envisagée comme une activité complexe finalisée
et un rôle central est accordé à la représentation mentale construite en situation dans la
découverte de solution.
Professeur N’DOUBA B. François
1
Chapitre 1 - La controverse historique sur la nature de la résolution de problèmes
Bien qu’il y ait eu un consensus dans les premières approches de la résolution de
problèmes sur la définition d’un problème comme une situation pour laquelle l’organisme a
un but mais ne dispose pas d’un moyen connu pour y parvenir, les points de vue se sont
opposés sur le rôle de l’apprentissage et de l’expérience passé dans la découverte de solution.
D’un point de vue purement descriptif, le découverte de solution semble bien procéder de
différentes tentatives et d’erreurs jusqu’à l’atteinte du but. Mais ce comportement de
découverte par tâtonnement signifie-t-il que l’on découvre la solution sans représentation de
la situation ?
I - L’approche behavioriste : découverte par essais erreur et par expérience
Les premiers travaux sur la résolution de problèmes ont été menés chez l’animal, et la
conception dominante était que la découverte de la réponse résultait d’un apprentissage
progressif et non intentionnel par essais et erreurs, ne faisant intervenir ni la perception, ni la
compréhension des contraintes du problème ou de la situation. Les études de THORNDIKE
sur l’apprentissage associatif chez l’animal illustrent cette conception. THORNDIKE étudia le
comportement de résolution d’animaux placés dans des puzzle-boxes dans lesquelles la
découverte de solution consiste à utiliser un dispositif (par exemple appuyer sur un bouton ou
tirer sur une ficelle, pour s’échapper de la cage ou obtenir de la nourriture).
Les résultats de ces observations ont été interprétés par l’auteur comme la manifestation
d’un apprentissage par essais et erreurs, et par réussite accidentelle. La résolution de
problèmes est envisagée comme un processus dans lequel les réponses inadaptées sont
éliminées (stamped out) laissant place aux réponses adaptées (stamped in).
Cette interprétation sera reprise par l’approche behavioriste et associationniste selon
laquelle le raisonnement peut être décrit comme l’application par essais et erreurs de réponses
préexistantes désignées par le terme “ habitus ”. WATSON, le fondateur du mouvement
behavioriste, les définira comme un ensemble appris de réponses motrices. Plus tard, HULL
formalisera cette conception en introduisant la notion de famille hiérarchique d’habitudes.
Pour toute situation problème donnée, S, il existe des associations avec plusieurs réponses
possibles, R1, R2,…Rn. Ces liens, formant des familles de réponses associées à chaque
situation problème, peuvent être plus ou moins forts. Ces forces d’association entre stimulus
et réponses définissent une hiérarchie des réponses : les réponses dont les associations sont
Professeur N’DOUBA B. François
2
plus fortes se trouvent au sommet de la hiérarchie, celles dont les associations sont plus
faibles en bas. Le comportement de résolution est défini par un changement de la force des
associations entre stimulus et réponses sous l’effet de l’apprentissage. En fin d’apprentissage,
les réponses les moins adaptées se trouvent en bas de la hiérarchie, les plus adaptées en haut
de la hiérarchie.
On a envisagé que les mêmes principes étaient à l’œuvre dans la résolution de
problèmes chez l’humain. Pour l’étayer, ils font appel à la résolution de problèmes
d’anagrammes qui a donc été une situation privilégiée pour mettre à l’épreuve la conception
behavioriste sur le rôle accordé à l’expérience passée dans la découverte de la solution. Dans
ces situations très simples, il est possible de calculer le nombre de combinaisons possibles à
partir du nombre de lettres qui composent le mot. Par exemple, avec un mot constitué de cinq
lettres comme “ amour ”, on peut calculer 120 arrangements (5 ! = 5x4x3x2x1=120) qui
constitueront les anagrammes. La découverte de solution dans ces problèmes est interprétée
comme l’application par essais et erreurs des différentes réponses associées (120 au total),
certaines étant plus hautes dans la hiérarchie que d’autres. Ainsi, en faisant varier la
familiarité des mots à découvrir, c’est-à-dire leur fréquence d’usage dans le langage, on peut
prédire le degré de difficulté des anagrammes. La solution de l’anagramme doit être plus
rapide si le mot à découvrir est un mot familier qu’un mot non familier, car, dans le premier
cas, la réponse est supposée être en haut de la hiérarchie des réponses associées et donc plus
rapidement évoquée par l’anagramme. Autrement dit, la résolution procède de l’application
par tâtonnement des différentes combinaisons de lettres, la réponse dominante en premier. La
découverte de solution est donc conditionnée par l’expérience générale de l’individu mais
peut l’être aussi par l’expérience immédiate vécue avant ou pendant la résolution du
problème.
L’intelligence pratique et les conduites de détours
La caractéristique des puzzle-boxes étudiés par THORDIKE est que le dispositif qui
permet d’atteindre le but est caché et que l’animal ne peut envisager la découverte de solution
autrement que par tâtonnement et tentatives apparemment désordonnées. Dans ces dispositifs,
la découverte de solution se fait par approximations successives et est guidée par le
renforcement sélectif des tentatives qui sont les plus proches du but. La résolution de ces
problèmes n’apparaît donc pas très intelligente.
Professeur N’DOUBA B. François
3
Dans les problèmes dits “ d’intelligence pratique ”, tous les éléments de la solution sont
visibles et on a ainsi pu mettre en évidence l’expression des comportements de solution
intelligents chez les jeunes enfants mais aussi chez l’animal. Les deux caractéristiques des
solutions intelligentes sont l’utilisation d’outils ou d’instruments et le comportement de
détour pour atteindre un but. Ce dernier fait référence au fait qu’il faut apparemment
s’éloigner du but pour pouvoir s’en rapprocher.
Ces situations indiquent clairement les limites de l’interprétation proposée par
THORDIKE et le courant behavioriste. Ainsi, la chance ou la découverte par essais erreurs
jouent un rôle mineur dans la résolution de problème. En effet, dans les problèmes,
l’utilisation d’un instrument suppose selon KÖHLER que l’on ait construit une représentation
du but, de son mode de réalisation et d’une certaine compréhension de la situation. Au fond,
les conduites de détour ne consistent pas à s’éloigner du but, mais à changer de but en
construisant un nouveau but qui est un pré requis, c’est-à-dire une condition à satisfaire, pour
pouvoir réaliser le but premier.
II- L’approche de la théorie de la forme : découverte par restructuration et insight
Ce qui distingue l’approche des gestaltistes de l’approche behavioriste, c’est le rôle
accordé à l’apprentissage et à l’expérience passée dans la découverte de solutions créatives.
Les comportements intelligents exprimés par les singes de KÖHLER ou par l’humain ne se
réduisent pas à la réorganisation des habitudes et au changement de la hiérarchie des réponses.
KÖHLER introduit trois notions importantes : (1) la solution est souvent atteinte par insight,
c’est-à-dire par découverte soudaine, quand les éléments ou les objets de la situation sont
perçus et utilisés d’une nouvelle façon ; (2) l’atteinte de la solution est rendue difficile par la
persistance d’habitudes anciennes et de façon de percevoir la situation ; (3) il y a de bonnes et
de mauvaises erreurs, les bonnes erreurs sont celles qui constituent des étapes vers la solution,
les mauvaises celles qui relèvent d’habitudes et d’une certaine rigidité mentale.
Les gestaltistes ont ainsi mis l’accent sur l’influence de la représentation interne du
problème sur le processus de découverte de solution. Selon cette approche, découvrir la
solution consiste à envisager le problème sous un nouvel éclairage et à passer d’une structure
(le problème) à une autre (la solution) par une réorganisation qui concerne essentiellement le
champ perceptif. Cette réorganisation au caractère brusque, dénommée “ insight ” est la
preuve selon les gestaltistes, que la découverte procède bien d’une restructuration et non une
élimination progressive des erreurs comme le prétendent les behavioristes.
Professeur N’DOUBA B. François
4
Pour les théoriciens de la forme, la découverte de solution procède donc d’une nouvelle
façon de percevoir les éléments de la situation qui ne doit rien à l’apprentissage. Cette
restructuration permet de découvrir les propriétés pertinentes des objets pour la solution.
En clair, sans nier le rôle de l’expérience passée dans la découverte de solution, les
gestaltistes ont insisté sur l’effet négatif des apprentissages antérieurs et des habitudes établies
par l’expérience. Ils ont ainsi distingué les apprentissages par mémorisation qui contribuent à
l’expression de la pensée reproductrice, des apprentissages par compréhension qui favorisent
le développement de la pensée productive. L’apprentissage par compréhension a un effet sur
le transfert à long terme. Ce qui caractérise la pensée reproductrice c’est qu’elle consiste à
appliquer des solutions connues et le transfert d’apprentissage se fait essentiellement par
mémorisation, alors que la pensée productive se manifeste par des solutions créatives dans des
situations jamais rencontrées auparavant et procède par compréhension et restructuration du
problème.
Les effets des apprentissages antérieurs et des habitudes ont été interprétés comme un
frein à la découverte de solutions créatives et responsable des phénomènes de fixation. Une
première source de fixation est liée à la fixité fonctionnelle des objets. La fixité fonctionnelle
désigne le fait qu’un objet utilisé dans un contexte donné est attaché à cette fonction et peut
difficilement être utilisé dans une autre fonction requise pour la solution du problème.
Autrement dit, l’utilisation préalable d’un objet dans une fonction habituelle empêche de
découvrir une nouvelle façon de s’en servir. Une autre source de fixation est liée aux effets
d’attitude ou rigidité du comportement défini comme la conséquence des effets de
“ l’Einstellung ” qui désigne une certaine attitude prédisposant immédiatement l’individu à un
type d’acte conscient ou moteur. Ainsi pour LUCHINS, les conséquences de l’habitude et des
apprentissages antérieurs font partie des déterminants des comportements rigides et sont un
frein à la pensée créative.
En somme, la controverse qui a opposée behavioristes et gestaltistes a portée sur le
statut accordé à l’apprentissage et à la représentation interne de la situation dans les conduites
intelligentes de la solution de problèmes. Pour les premiers, il n’est pas besoin de faire appel à
la notion de représentation qui relève d’une conception “ mentaliste ”. Les découvertes de
solution sont le résultat d’un apprentissage par renforcement de la réponse adaptée à la
situation et du changement de hiérarchie dans la famille des habitudes. Pour les seconds, la
solution de problèmes est caractérisée par la réorganisation du champ de la situation et de
Professeur N’DOUBA B. François
5
l’action et les apprentissages antérieurs peuvent être la source des phénomènes de fixation qui
empêchent la découverte de la solution.
Bien que l’on ait reconnu l’enrichissement apportée par la théorie de la forme dans la
description de la résolution de problèmes, ce courant a fait l’objet de nombreuses critiques. La
principale critique repose sur la nature “ vague ” et non formalisée de la théorie qui la rend
difficile à tester expérimentalement. Une autre critique est que cette approche ne propose pas
une théorie des processus qui explique comment la restructuration de la situation, c’est-à-dire
le changement de représentation, s’opère.
Professeur N’DOUBA B. François
6
Chapitre II - Les approches contemporaines de la résolution de problèmes
Ce n’est qu’à la fin des années soixante que l’étude de la résolution de problèmes est à
nouveau investie en psychologie. Ce regain d’intérêt a été suscité par la conception nouvelle
de la résolution de problèmes proposée par NEWELL et SIMON (1972). Contrairement à
l’approche gestaltiste, les auteurs se sont centrés sur le processus de recherche de solution,
l’objectif principal étant d’identifier, de décrire et de modéliser par programme informatique,
les heuristiques générales de résolution de problèmes chez l’humain.
I - L’approche du traitement de l’information : découverte par exploration à
l’intérieur d’un espace de recherche
Très influencés par la révolution cybernétique et les travaux développés en intelligence
artificielle, les auteurs ont contribués dans le domaine de la résolution de problèmes au
développement de l’approche du traitement de l’information. Cette approche repose sur deux
métaphores computationnelles. La première est l’analogie entre l’être humain et la machine :
l’être humain peut être conçu comme un calculateur complexe, un système de traitement de
l’information. La deuxième est l’analogie entre la pensée et le programme informatique : les
processus de pensée de l’être humain peuvent être formalisés par un programme informatique.
Deux principes fondamentaux de la cybernétique ont été repris dans ce paradigme : (1) les
boucles et le principe d’homéostasie et (2) la structure hiérarchique des processus.
Le premier principe stipule que tout système adaptatif régule constamment les
différences entre l’état dans lequel il se trouve et l’état qu’il veut atteindre en réalisant des
actions qui réduisent toute différence détectée. Le second principe affirme que tout processus
ou comportement complexe peut être représenté comme une structure hiérarchique de
processus élémentaires simples entremêlés.
Dans cette perspective, NEWELL et SIMON ont conceptualisé la résolution de
problèmes comme un processus d’exploration à l’intérieur d’un espace de recherche. Trois
composantes sont distinguées : le système de traitement de l’information, l’espace de
recherche et l’espace problème. Le système de traitement de l’information peut être envisagé
comme un modèle cognitif du sujet qui résout le problème. L’espace de recherche correspond
à la description des entités physiques pertinentes pour la solution et aux conditions de leur
transformation. Cet espace est symbolisé par un graphe dans lequel les nœuds correspondent
aux états successifs engendrés par l’application des actions (les opérations) qui permettent de
Professeur N’DOUBA B. François
7
transformer un état en un autre. Les liens entre les états représentent ces actions. Ainsi, l’état
initial est figuré par un nœud, l’état but par un autre. Il n’y a pas de lien qui relie directement
l’état initial à l’état but : résoudre un problème revient à trouver un chemin qui relie l’état
initial (les données de la situation) à l’état but (la solution). On peut ainsi formaliser l’espace
des états possibles de toute une série de problèmes à transformation d’états. Cette catégorie de
problèmes se définit par une situation initiale, une situation but et un ensemble de règles (les
conditions d’application des opérations) qui contraint les transformations d’un état en un autre
(exemple du problème de la Tour de Hanoï).
Dans l’approche du traitement de l’information, la résolution de problèmes consiste
donc à construire un espace problème et à l’explorer à l’aide d’heuristiques de recherche qui
déterminent la sélection des opérateurs. Cette approche a permis deux avancées importantes
dans l’étude de la résolution de problèmes. La première est le développement de modèles de
simulation par programme informatique des comportements de résolution. Les simulations
sont un moyen de tester les théories sur les processus en jeu dans l’activité. La seconde est
l’introduction des notions d’espace de recherche et d’espace problème. En ce sens, le mérite
de ce modèle est d’avoir été l’un des premiers modèles à formaliser et stimuler les processus
de la compréhension et de construction de l’espace problème. Toutefois, ce modèle présente
certaines limites et paraît aujourd’hui un peu simpliste. D’une part, l’élaboration de la
représentation et la recherche de solution sont formalisées comme deux états successifs de
traitements distincts, la seconde n’intervenant pas au moment de la construction de l’espace
problème. Ce n’est qu’une fois qu’un espace problème est construit que la recherche de
solution s’effectue dans cet état par l’application d’heuristiques de recherche. Si la recherche
est infructueuse dans l’espace primitif alors un nouvel espace est susceptible d’être construit.
D’autre part, l’espace problème est défini par rapport à l’espace de recherche qui représente
uniquement les états accessibles par l’application des opérateurs légaux. Cet espace est donc
entièrement défini par les contraintes objectives de la tâche. Ceci suppose que l’on ait
identifié les contraintes de la solution et compris les conditions d’application des opérateurs.
Cette conception de l’espace de recherche semble incomplète car elle ne prend pas en compte
la façon dont l’individu interprète les conditions d’application des opérateurs, identifie les
contraintes objectives, se représente le but ; elle ignore par ailleurs les contraintes subjectives
qu’il se donne et qui réduisent les possibilités d’action dans l’espace de recherche. La notion
d’espace sémantique introduite par RICHARD (2004) élargit la notion d’espace de recherche
Professeur N’DOUBA B. François
8
et permet d’intégrer dans la description de la représentation les interprétations de la consigne,
les heuristiques et les buts.
II - L’approche fonctionnelle genevoise
Le courant de la psychologie génétique s’est intéressé aux processus en jeu dans la
résolution de problèmes. Tout en s’inscrivant dans la perspective du constructivisme
épistémologique de PIAGET, INHELDER et le groupe de Genève donnent une nouvelle
orientation à l’approche génétique en conceptualisant les relations entre structure de
connaissance et processus par l’étude des micro-genèses des découvertes de l’enfant dans la
résolution de problèmes.
Dans la nouvelle perspective proposée par les auteurs, il s’agit de décrire comment le
sujet psychologique individuel “ l’homo quotidianus ” et non plus le sujet épistémique de la
connaissance rationnelle, utilise ces connaissances dans l’élaboration de procédures, de
savoir-faire, quand il est confronté à des situations problèmes. Dans ce contexte théorique, la
résolution de problèmes est envisagée comme l’application de structures à l’assimilation
d’ “ univers de problème ” et comme « l’occasion d’éviter les processus fonctionnels quand le
sujet applique ses connaissances à des contextes particuliers ».
III - L’approche de RICHARD : découverte par compromis dans un ensemble de
contraintes
Dans la lignée du travail de formalisation initié par NEWELL et SIMON, RICHARD
souligne la nécessité de développer des modèles de simulation par programmes informatiques.
Les connaissances générales qui participent à la construction de la représentation du
problème, ainsi que les interprétations sur la situation et les buts, occupent une place centrale
dans ces modèles. L’un de ces modèles est une formalisation de la représentation qui est
définie par trois types d’éléments : les interprétations de la consigne et de la situation, les
heuristiques générales de résolution, et les buts du sujet. Ces trois types d’éléments sont
décrits sous un même format qui est celui des contraintes. Une contrainte est formellement
définie comme une restriction a priori sur l’ensemble des actions possibles dans chacun des
états du problème.
Ainsi, pour chaque état du problème, une contrainte détermine un sous-ensemble
d’actions interdites. Une contrainte est décrite par un vecteur à deux valeurs possibles : 0 si
l’action est autorisée par la contrainte, et 1 si elle ne l’est pas. Les contraintes objectives qui
Professeur N’DOUBA B. François
9
sont données dans la consigne comme les contraintes subjectives qui sont liées à la
représentation que l’on peut avoir à un moment donné de la résolution, déterminent ainsi pour
chaque état les actions autorisées et interdites.
Ce modèle permet de simuler, par programme informatique, les comportements de
résolution dans une grande variété de problèmes comme les problèmes des missionnaires et
des cannibales, les problèmes de Tour de Hanoï et aussi des items des tests d’intelligence. Ce
modèle permet d’interpréter les performances en termes de processus de résolution dans les
différents items d’un test d’intelligence. La formalisation de ces processus par des listes de
contraintes permet de simuler et d’expliquer les réussites dans la réalisation de la tâche mais
aussi les difficultés et les échecs. Cette méthodologie de l’analyse des protocoles individuels
permet ainsi de rendre manifeste les différents processus qui sont supposés expliquer les
différences de performance.
Ainsi, dans ce formalisme, la résolution de problèmes est décrite comme la recherche
d’un compromis entre un ensemble de contraintes issues des interprétations, elles-mêmes
influencées par les connaissances activées et mobilisées en mémoire et celles issues des
apprentissages sur la tâche. Résoudre un problème consiste à éliminer les contraintes
subjectives qui empêchent d’avancer vers la solution, à intégrer les contraintes objectives de
la tâche et à structurer les buts en ordonnant temporellement leur réalisation et en satisfaisant
les conditions de cette réalisation, c’est-à-dire les prérequis.
Pour résumer, la résolution de problèmes initialement conçue dans le cadre des théories
behavioristes comme une activité relevant de l’apprentissage par renforcement des liens entre
stimulation et réponse adaptée, a peu à peu été envisagée comme une activité finalisée
complexe dans laquelle la représentation mentale de la situation occupe une place
prédominante. Les premiers travaux menés par le courant gestaltiste ont eu une grande
influence sur ce nouveau point de vue en insistant sur le rôle négatif des habitudes et des
apprentissages antérieurs dans la découverte de solution par créativité. Mais c’est sans doute
l’approche du traitement de l’information initiée par NEWELL et SIMON qui a marqué un
tournant décisif dans la conception de la résolution de problèmes. En développant des
modèles computationnels capables de formaliser la représentation mentale et de simuler les
comportements de sujets humains, les auteurs ont ouvert une nouvelle voie dans l’étude de
cette activité. Dans une autre perspective, les travaux d’INHELDER et de l’école de Genève
ont apporté un nouvel éclairage en se centrant sur le rôle des connaissances, des schèmes
Professeur N’DOUBA B. François
10
familiers dans les cheminements de découverte de la solution. Enfin, l’approche proposée par
RICHARD offre une conception théorique et méthodologique qui prend en compte les
exigences de formalisation de la représentation mentale et intègre les connaissances que le
sujet importe dans la construction de cette représentation. En développant un modèle de
simulation qui intègre les connaissances familières dans l’élaboration de la représentation
mentale, l’auteur propose un cadre théorique qui permet l’analyse du cas individuel et
l’identification des processus qui sous-tendent les comportements de résolution. Par ailleurs,
la formalisation de l’analyse des protocoles individuels proposée revêt un caractère
d’objectivité et de reproductibilité par la simulation informatique des protocoles observés.
Professeur N’DOUBA B. François
11
Vous aimerez peut-être aussi
- Fiche Finances PubliquesDocument18 pagesFiche Finances Publiquesshunukiya100% (2)
- QuestionsDocument6 pagesQuestionsSaid Ahmed ZoulatiPas encore d'évaluation
- Questions Réponses Docfinal 1Document10 pagesQuestions Réponses Docfinal 1Barthélemy HoubenPas encore d'évaluation
- La Pédagogie de La Situation ProblèmeDocument5 pagesLa Pédagogie de La Situation ProblèmeHassan ElhassanPas encore d'évaluation
- Resume Du Support de CoursDocument5 pagesResume Du Support de CoursAfroKing Official- InstrumentalPas encore d'évaluation
- Théories de L'apprentissageDocument24 pagesThéories de L'apprentissageAurora MartínezPas encore d'évaluation
- Définition de La DidactiqueDocument18 pagesDéfinition de La DidactiqueOMAR IKEN100% (1)
- Constructivisme CoursDocument3 pagesConstructivisme CoursroroririazPas encore d'évaluation
- Les Théories Et Troubles D'apprentissageDocument19 pagesLes Théories Et Troubles D'apprentissagelaarbimeryemPas encore d'évaluation
- Le RaisonnementDocument22 pagesLe RaisonnementMassePas encore d'évaluation
- Présentation 20Document16 pagesPrésentation 20Sàfwéň ĞarfàPas encore d'évaluation
- Psychosociologie Du TravailDocument23 pagesPsychosociologie Du TravailJofrane SompaPas encore d'évaluation
- C1 Théories D'apprentissageDocument10 pagesC1 Théories D'apprentissagerachidzte1Pas encore d'évaluation
- Le Modãle BehavioristeDocument15 pagesLe Modãle BehavioristeRima HafPas encore d'évaluation
- Lexique PedagogiqueDocument3 pagesLexique PedagogiqueMeriemAissaniPas encore d'évaluation
- Théories D'apprentissages Et Modèles D'enseignementDocument10 pagesThéories D'apprentissages Et Modèles D'enseignementNaima BlhPas encore d'évaluation
- Conceptions Jalal KhounaDocument28 pagesConceptions Jalal KhounaMohamed AIT KASSIPas encore d'évaluation
- 2019 Chapitre Pratiques de Remédiation CognitiveDocument20 pages2019 Chapitre Pratiques de Remédiation CognitiveMerya DefanaPas encore d'évaluation
- Les StratégiesDocument15 pagesLes Stratégiessecoucamara261092100% (1)
- I. Le Constructivisme: Jean Piaget L'intelligenceDocument4 pagesI. Le Constructivisme: Jean Piaget L'intelligenceagathe.2201Pas encore d'évaluation
- AAP72002Document30 pagesAAP72002maria.namsiiiiPas encore d'évaluation
- Principaux Concepts Des Didactiques Des DisciplinesDocument5 pagesPrincipaux Concepts Des Didactiques Des DisciplinesMouayed Mhamdi100% (3)
- Situation ProblèmeDocument26 pagesSituation Problèmebouchta100% (2)
- 04 Documents PDFDocument127 pages04 Documents PDFAllogogermainPas encore d'évaluation
- Conference Motivation EcoleDocument3 pagesConference Motivation Ecolehoussem rebouhPas encore d'évaluation
- Apprentissage Par Problème++Document16 pagesApprentissage Par Problème++Sahbi DkhiliPas encore d'évaluation
- Britt Mary BarthDocument15 pagesBritt Mary BarthYann_Pellissie_5296Pas encore d'évaluation
- Les Théories D'apprentissagesDocument11 pagesLes Théories D'apprentissagesGuedi AboubakerPas encore d'évaluation
- La Théorie de La GestaltDocument5 pagesLa Théorie de La GestaltsoumPas encore d'évaluation
- 3 Inteligence DauvierDocument19 pages3 Inteligence DauvierAnastasia DoyenPas encore d'évaluation
- Theories Et Modeles Dapprentissage PDFDocument9 pagesTheories Et Modeles Dapprentissage PDFFaten ben yahiaPas encore d'évaluation
- Semaine 3 - Oct 2021 - Problématique, Cadre Conceptuel Et Théorique, Revue de LittératureDocument26 pagesSemaine 3 - Oct 2021 - Problématique, Cadre Conceptuel Et Théorique, Revue de LittératureMariam MansourPas encore d'évaluation
- ProblematiqueDocument14 pagesProblematiquemafefil18Pas encore d'évaluation
- Semaine 3 - Oct 2021 - Problématique, Cadre Conceptuel Et Théorique, Revue de LittératureDocument26 pagesSemaine 3 - Oct 2021 - Problématique, Cadre Conceptuel Et Théorique, Revue de LittératureMariam MansourPas encore d'évaluation
- Psychologie Générale Notes de Cours Date Inconnue Inconnue 1Document32 pagesPsychologie Générale Notes de Cours Date Inconnue Inconnue 1haitnPas encore d'évaluation
- GestaltDocument5 pagesGestaltpeace and lovePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 RésuméDocument2 pagesChapitre 2 RésuméYasmineNciriPas encore d'évaluation
- Résumé+duDocument4 pagesRésumé+duOUSSAMA OUBELLAPas encore d'évaluation
- Comparaison Béhaviorisme Et Cognitivisme (F FDocument41 pagesComparaison Béhaviorisme Et Cognitivisme (F FKawtar AchmaniPas encore d'évaluation
- DEVALAY - Metodo Experimental PDFDocument14 pagesDEVALAY - Metodo Experimental PDFdidi santosPas encore d'évaluation
- Synthèse Didactique G6Document5 pagesSynthèse Didactique G6zouhirdaoudi1090Pas encore d'évaluation
- CognitivismeDocument2 pagesCognitivismealiali047742Pas encore d'évaluation
- Piaget MirieuDocument10 pagesPiaget MirieuTika BerPas encore d'évaluation
- GM Audelacaricatures 27 03 20Document5 pagesGM Audelacaricatures 27 03 20Obi-Wan GrégoriPas encore d'évaluation
- ConstructivismeDocument2 pagesConstructivismeAllioui WalidPas encore d'évaluation
- IntroductionDocument3 pagesIntroductionmariem ben salemPas encore d'évaluation
- Luis Amigó, El Apóstol de Los Extraviados EN FRANCESDocument13 pagesLuis Amigó, El Apóstol de Los Extraviados EN FRANCESnicolasatiye12Pas encore d'évaluation
- Act Petit RésuméDocument20 pagesAct Petit Résuméarchange gabPas encore d'évaluation
- Obstacle Situation Problème Conflit CognitifDocument35 pagesObstacle Situation Problème Conflit CognitifSiham El ouazizi100% (1)
- 2015-Les Émotions Au Sce de L'apprentissage-Appraisal, Pertinence Et Attention Émotionnelle PDFDocument9 pages2015-Les Émotions Au Sce de L'apprentissage-Appraisal, Pertinence Et Attention Émotionnelle PDFLakhdar HadjarabPas encore d'évaluation
- BEHAVIORISMEDocument4 pagesBEHAVIORISMEabdeljebbarmPas encore d'évaluation
- Bien Étudier - Le Behaviorisme - Définition, Avantages Et PrincipesDocument11 pagesBien Étudier - Le Behaviorisme - Définition, Avantages Et PrincipesRamón CastillaPas encore d'évaluation
- 50 Les Theories de L ApprentissageDocument4 pages50 Les Theories de L ApprentissageJosephine JaskoPas encore d'évaluation
- Liaison Cm2 6eme Situation Probleme ST AndiolDocument19 pagesLiaison Cm2 6eme Situation Probleme ST Andiolaneffeg zakariaPas encore d'évaluation
- Psychopeda - Ens L1Document15 pagesPsychopeda - Ens L1jerminominoPas encore d'évaluation
- Theories de L ApprentissageDocument6 pagesTheories de L ApprentissageMireille Contrio100% (1)
- Psychologie Du Sport: CM - Professeurs ExpertsDocument4 pagesPsychologie Du Sport: CM - Professeurs ExpertscolombierPas encore d'évaluation
- Les Théories de L'apprentissage3Document3 pagesLes Théories de L'apprentissage3Hamza Azzouz100% (1)
- La Perspective Pragmatique Dans L'étude Du Raisonnement Et de La RationalitéDocument43 pagesLa Perspective Pragmatique Dans L'étude Du Raisonnement Et de La RationalitéikoukPas encore d'évaluation
- Weil Barais-Approche Cognitive EtDocument16 pagesWeil Barais-Approche Cognitive EtyogoamorPas encore d'évaluation
- Humanité - Nature, humain & environnement : défi ultime ou chaos assuré ? - Tome 2: La réponse à la problématiqueD'EverandHumanité - Nature, humain & environnement : défi ultime ou chaos assuré ? - Tome 2: La réponse à la problématiquePas encore d'évaluation
- Évaluer Les Psychothérapies - Méthodes Et Pratiques (PDFDrive)Document312 pagesÉvaluer Les Psychothérapies - Méthodes Et Pratiques (PDFDrive)willy vleiPas encore d'évaluation
- Burn-Out Des Troupes Sénégalaises Engagées Dans Les Opérations Extérieures: Cas de La Mission de Maintien de La Paix Au DarfourDocument7 pagesBurn-Out Des Troupes Sénégalaises Engagées Dans Les Opérations Extérieures: Cas de La Mission de Maintien de La Paix Au Darfourwilly vleiPas encore d'évaluation
- La Parentalité À L'Épreuve de La Maladie Grave de L'EnfantDocument13 pagesLa Parentalité À L'Épreuve de La Maladie Grave de L'Enfantwilly vleiPas encore d'évaluation
- (Des Mots Pour Comprendre) La DÉNÉGATION Ou Le Refus de L'inconscient - Barthélémy (2012) (Défense)Document1 page(Des Mots Pour Comprendre) La DÉNÉGATION Ou Le Refus de L'inconscient - Barthélémy (2012) (Défense)willy vleiPas encore d'évaluation
- Dialogue de GestionDocument172 pagesDialogue de GestionabdelmarethPas encore d'évaluation
- MémoireDocument54 pagesMémoireRaouan El0% (1)
- Dépliant FUPDocument2 pagesDépliant FUProdolfoenjaPas encore d'évaluation
- AQ Dans l'ES (Session 3 Setif Octobre 2012)Document82 pagesAQ Dans l'ES (Session 3 Setif Octobre 2012)sakerfahemPas encore d'évaluation
- Ali 2012Document218 pagesAli 2012Abderraouf MEDJDOUBPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage Licence CCA - AKOUNGDocument37 pagesRapport de Stage Licence CCA - AKOUNGDany ArthurPas encore d'évaluation
- Catalogue Des Masteres ISGT 2021Document33 pagesCatalogue Des Masteres ISGT 2021Amin SaihiPas encore d'évaluation
- Evaluation SommativeDocument2 pagesEvaluation SommativeAbderrahmane ouaakiPas encore d'évaluation
- SciencesPoParisGrand Syllabus 2015 2016 PDFDocument2 423 pagesSciencesPoParisGrand Syllabus 2015 2016 PDFjosephchainesPas encore d'évaluation
- Organisation Du Travail, Prise de Note, Fiche de Lecture, Recherches PersonnellesDocument10 pagesOrganisation Du Travail, Prise de Note, Fiche de Lecture, Recherches PersonnellesMélissa RoxanePas encore d'évaluation
- Mwamini Louise CorrigéDocument68 pagesMwamini Louise CorrigéWenceslas lukeka kaseshiPas encore d'évaluation
- Révision Des Classifications Des Secteurs Et Des Produits de Haute TechnologieDocument26 pagesRévision Des Classifications Des Secteurs Et Des Produits de Haute TechnologieOumar sanohPas encore d'évaluation
- Guide Stage PerfectionnementDocument9 pagesGuide Stage PerfectionnementYassine HabibiPas encore d'évaluation
- Presses de L'université de Montréal: Chapitre 1. La GéographieDocument81 pagesPresses de L'université de Montréal: Chapitre 1. La GéographieKomla Xana SADJO-HETSUPas encore d'évaluation
- CAS 01 CorrigéDocument3 pagesCAS 01 CorrigéHas NaPas encore d'évaluation
- Savoirs Communs N°5 - Appui Aux Systèmes Productifs Locaux Ou Clusters (AFD - 2009)Document104 pagesSavoirs Communs N°5 - Appui Aux Systèmes Productifs Locaux Ou Clusters (AFD - 2009)HayZara MadagascarPas encore d'évaluation
- Master Professionnel en Ingénierie FinancièreDocument4 pagesMaster Professionnel en Ingénierie Financièrehammouda25Pas encore d'évaluation
- Le Chemin DavenirDocument37 pagesLe Chemin DavenirAugues NZOULOU MABIALAPas encore d'évaluation
- Audit of The University of HelsinkiDocument90 pagesAudit of The University of Helsinkimohamed__salahPas encore d'évaluation
- 1071 Em16072013Document20 pages1071 Em16072013elmoudjahid_dzPas encore d'évaluation
- Amawal TjerrumtDocument164 pagesAmawal TjerrumtAbdlemjid MoutalibPas encore d'évaluation
- 12 Ans DOlympiades Académiques de Mathématiques À Lusage Des Lycéens de Premières - Une Préparation en 9 Thèmes Détude Et... (Nicolas Fardin)Document332 pages12 Ans DOlympiades Académiques de Mathématiques À Lusage Des Lycéens de Premières - Une Préparation en 9 Thèmes Détude Et... (Nicolas Fardin)Ourirem MohamedPas encore d'évaluation
- Controle de Méthodologie de Recherche en Didactique Des MathématiqueDocument2 pagesControle de Méthodologie de Recherche en Didactique Des MathématiqueYouness Ouhallab100% (1)
- Les Documents Fondateurs Du Système Éducatif MarocainDocument57 pagesLes Documents Fondateurs Du Système Éducatif MarocainMUHAMED AKHRIFPas encore d'évaluation
- La SatisfactionDocument79 pagesLa SatisfactionLaila HJPas encore d'évaluation
- Bourgeoisie Noblesse Et Leurs Reseaux Au 15eme SiècleDocument71 pagesBourgeoisie Noblesse Et Leurs Reseaux Au 15eme SiècleCHUMBPas encore d'évaluation
- 1 PBDocument17 pages1 PBtahaPas encore d'évaluation
- Méthodologie de Diagnostic Pour Le Projet de Territoire Une Approche Par Les Modèles SpatiauxDocument23 pagesMéthodologie de Diagnostic Pour Le Projet de Territoire Une Approche Par Les Modèles SpatiauxMohamed BoutoumiPas encore d'évaluation