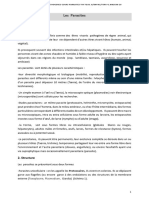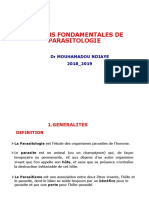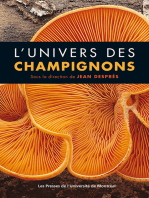Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Transféré par
cheikh Tidiane NiassDroits d'auteur :
Formats disponibles
Vous aimerez peut-être aussi
- Transmath 6e LDP CompletDocument213 pagesTransmath 6e LDP Completbactac100% (3)
- Cours Parasitologie 2021Document80 pagesCours Parasitologie 2021Issam mairfat100% (1)
- Cours Parasitologie MédicaleDocument23 pagesCours Parasitologie MédicaleNada Tahiri67% (3)
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- QCM en Biochimie Clinique (Epruves de Résidanat)Document34 pagesQCM en Biochimie Clinique (Epruves de Résidanat)Laouami Fatima94% (18)
- Compréhension Du Fonctionnement de La Station de Récupération de Fluide Frigorigène Et ProcédureDocument28 pagesCompréhension Du Fonctionnement de La Station de Récupération de Fluide Frigorigène Et ProcédureMARDOUMA0% (1)
- Introduction À La Parasito PrésentationDocument28 pagesIntroduction À La Parasito Présentationcheikh Tidiane NiassPas encore d'évaluation
- Cours 1Document3 pagesCours 1Archippe Abia Tchangpina100% (1)
- 01.introduction Parasitologie PDFDocument16 pages01.introduction Parasitologie PDFEltsine FredPas encore d'évaluation
- Parasitologie HumaineDocument12 pagesParasitologie Humainealiouahmed2024Pas encore d'évaluation
- L3 Biochimie Cours Parasitologie Mouhoub Sayah C.Document25 pagesL3 Biochimie Cours Parasitologie Mouhoub Sayah C.Med AichaPas encore d'évaluation
- Cours de ParasitologieDocument24 pagesCours de Parasitologiegjob100% (1)
- Introduction Générale À La ParasitologieDocument5 pagesIntroduction Générale À La Parasitologiesaid mos100% (1)
- Parasitologie AM 1Document147 pagesParasitologie AM 1Franky StonePas encore d'évaluation
- TexteDocument4 pagesTextedht2ts9zw9Pas encore d'évaluation
- Generalites Sur Les ParasitesDocument4 pagesGeneralites Sur Les ParasitesBalayira BakaryPas encore d'évaluation
- 1 - IntroductionDocument6 pages1 - Introductionoustiz134Pas encore d'évaluation
- Généralités Sur Le Parasitisme 2021Document64 pagesGénéralités Sur Le Parasitisme 2021Fatima Dh100% (1)
- Cours de Parasitologie-1Document77 pagesCours de Parasitologie-1mudiboelikya26Pas encore d'évaluation
- 1-Introduction À La ParasitologieDocument9 pages1-Introduction À La Parasitologiesylvie jacklinePas encore d'évaluation
- Polycopie Parasito-Myco 2006-2007Document93 pagesPolycopie Parasito-Myco 2006-2007zlimitounePas encore d'évaluation
- Parasitologie Médicale S1Document8 pagesParasitologie Médicale S1Ciza kassim muyingaPas encore d'évaluation
- Les ParasitesDocument10 pagesLes ParasitesHayat IssaouiPas encore d'évaluation
- CoursDocument16 pagesCoursSalam AbdulPas encore d'évaluation
- Introduction À La Parasitologie - Mycologie 2024Document36 pagesIntroduction À La Parasitologie - Mycologie 2024drsoniaoualiPas encore d'évaluation
- Generalités Dentaire en ParasitologieDocument23 pagesGeneralités Dentaire en ParasitologieLina Ray BenPas encore d'évaluation
- Notion Fondamentale en ParasitologieDocument43 pagesNotion Fondamentale en ParasitologieMELISSA TIGORIPas encore d'évaluation
- Résumé ParasitologieDocument5 pagesRésumé ParasitologieDahou AliPas encore d'évaluation
- Partie1: Généralités Sur La Parasitologie 1-DéfinitionsDocument11 pagesPartie1: Généralités Sur La Parasitologie 1-Définitionsnrnsouma27100% (1)
- PARASITOLOGIEDocument3 pagesPARASITOLOGIERazPas encore d'évaluation
- Généralité Sur Le ParasitismeDocument4 pagesGénéralité Sur Le ParasitismeChristophe VitofodjiPas encore d'évaluation
- 1 Generalites Sur Le ParasitismeDocument15 pages1 Generalites Sur Le ParasitismeVictor MusengePas encore d'évaluation
- Cours Diversité Parasitaire 2012Document86 pagesCours Diversité Parasitaire 2012wallace88leoPas encore d'évaluation
- Cours Parasitologie Et Epidemiologie ÉvolutiveDocument30 pagesCours Parasitologie Et Epidemiologie ÉvolutiveAbdo OuhamoPas encore d'évaluation
- Correction de TD PDFDocument9 pagesCorrection de TD PDFnoureddie100% (3)
- ParasitologieDocument38 pagesParasitologieTom BianchiPas encore d'évaluation
- Geneparasito Semestre 4 2019-20Document39 pagesGeneparasito Semestre 4 2019-20Balla Moussa DiédhiouPas encore d'évaluation
- Parasitologie Generale FGTRDDocument24 pagesParasitologie Generale FGTRDTala ToroPas encore d'évaluation
- 9 Parasitologie MycologieDocument49 pages9 Parasitologie Mycologiemaramzakhama100% (1)
- Diapo 1 - Notions GénéralesDocument24 pagesDiapo 1 - Notions GénéralesAdila DjelailiaPas encore d'évaluation
- Parasitologie Générale 2023Document18 pagesParasitologie Générale 2023Flora NdouyangPas encore d'évaluation
- 4a d1 Ue9 Cours 3 Le Monde Des Parasites RoneoDocument10 pages4a d1 Ue9 Cours 3 Le Monde Des Parasites RoneoJJPas encore d'évaluation
- 10 Généralité PARASITOLOGIEDocument6 pages10 Généralité PARASITOLOGIENouhoum DembéléPas encore d'évaluation
- 2019 Cours ParasitoDocument42 pages2019 Cours ParasitoIlias ElasriPas encore d'évaluation
- Parasito1 2023 PDFDocument49 pagesParasito1 2023 PDFLE BRISHOUALPas encore d'évaluation
- Cours Parasitologie 1Document33 pagesCours Parasitologie 1bonneaug8100% (5)
- Travail Pratique Groupe 1Document5 pagesTravail Pratique Groupe 1jure pudongoPas encore d'évaluation
- Généralités PrasitoDocument2 pagesGénéralités Prasitoferielbrs3Pas encore d'évaluation
- ParasitesDocument16 pagesParasitesMativet 59Pas encore d'évaluation
- 0 - Introduction Mycologie MedicaleDocument2 pages0 - Introduction Mycologie Medicalet.dounia2000Pas encore d'évaluation
- 1 - Introduction À La Bactériologie MédicaleDocument7 pages1 - Introduction À La Bactériologie MédicalenessaibatalebPas encore d'évaluation
- Protozoaires Et Protozooses AnimalesDocument5 pagesProtozoaires Et Protozooses AnimalesHoucïne KerkoubPas encore d'évaluation
- Chapitre VI - HématologieDocument21 pagesChapitre VI - Hématologie페 리알Pas encore d'évaluation
- ParazitoDocument168 pagesParazitoevrard.kinnenonPas encore d'évaluation
- Resource 1Document12 pagesResource 1mintchimechak2Pas encore d'évaluation
- Cours PARASITOLOGIE S6 DéfDocument119 pagesCours PARASITOLOGIE S6 DéfSalma EzzliguiPas encore d'évaluation
- 1er Cours de Physiologie Et Biochimie Des MicroorganismesDocument56 pages1er Cours de Physiologie Et Biochimie Des MicroorganismesbenchihebPas encore d'évaluation
- Microbiologie Et ImmunologieDocument51 pagesMicrobiologie Et ImmunologiehananPas encore d'évaluation
- Zoologie - Chap II ProtozoairesDocument13 pagesZoologie - Chap II Protozoaireslouai beznisPas encore d'évaluation
- Bacterio ParasitoDocument10 pagesBacterio ParasitoOumar TraoréPas encore d'évaluation
- td1 MétazoairesDocument17 pagestd1 Métazoairesfouad abdelhamidPas encore d'évaluation
- Système immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandSystème immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Rapport D'intervention Raoul Faulreaut MTNDocument5 pagesRapport D'intervention Raoul Faulreaut MTNNasredine AlainPas encore d'évaluation
- Calcul de Charge Pour CombinaisonDocument1 pageCalcul de Charge Pour CombinaisonHamed100% (1)
- Station de Pompage TARGUISTEDocument11 pagesStation de Pompage TARGUISTEkhadija eddahbyPas encore d'évaluation
- 20201003-Mémoires de Guerre-De GaulleDocument5 pages20201003-Mémoires de Guerre-De GaulleFrance CulturePas encore d'évaluation
- Polymerisation RadicalaireDocument36 pagesPolymerisation RadicalairesamirPas encore d'évaluation
- Simplexe Post OptimaleDocument23 pagesSimplexe Post OptimaleYahya AbidaPas encore d'évaluation
- Reviser Son Bac Avec Le Monde MATHeMATIQUESDocument98 pagesReviser Son Bac Avec Le Monde MATHeMATIQUESje100% (1)
- Exercices ForcesDocument2 pagesExercices ForcesFlorian AmelinckPas encore d'évaluation
- Capacité Calorifique Des GazDocument4 pagesCapacité Calorifique Des Gazleilalargate_3780929Pas encore d'évaluation
- Td1: Exercices de Statistiques Descriptives: DD DD D D Nna DDDocument4 pagesTd1: Exercices de Statistiques Descriptives: DD DD D D Nna DDMalincov MandatPas encore d'évaluation
- HeseDocument5 pagesHesenadinembalteanuPas encore d'évaluation
- Al-Mahdi - BostaniDocument68 pagesAl-Mahdi - BostaniMourtaza RadjahoussenPas encore d'évaluation
- Catalogue Ethnos Stat'ManiaDocument12 pagesCatalogue Ethnos Stat'ManiaLoTfi GarZounPas encore d'évaluation
- Manual Cucta TefalDocument292 pagesManual Cucta TefalDya DanaPas encore d'évaluation
- Dess IcationDocument6 pagesDess IcationYas MiinePas encore d'évaluation
- Triangles Egaux Triangles SemblablesDocument3 pagesTriangles Egaux Triangles Semblableselias aouichatPas encore d'évaluation
- Mesures Électriques - 23-3-2022Document31 pagesMesures Électriques - 23-3-2022Adil BELMOUMENPas encore d'évaluation
- CHIMIE - 1re CD - LES ETAPES DE LANALYSE ELEMENTAIREDocument2 pagesCHIMIE - 1re CD - LES ETAPES DE LANALYSE ELEMENTAIREPatrick NgondamaPas encore d'évaluation
- Exploitation de La Chanson Meunier Tu DorsDocument8 pagesExploitation de La Chanson Meunier Tu DorsClaudinejeannePas encore d'évaluation
- Cours ESC - C.Cazet Pédefer - CG Et Stratégie 2022Document43 pagesCours ESC - C.Cazet Pédefer - CG Et Stratégie 2022rabiPas encore d'évaluation
- MVNO Starter Pack Vdef - FR 2Document14 pagesMVNO Starter Pack Vdef - FR 2Mamadou Oulaye KeitaPas encore d'évaluation
- CV Eddahbi SihamDocument1 pageCV Eddahbi SihamSiham EddahbiPas encore d'évaluation
- TD Fiscalité - TVADocument6 pagesTD Fiscalité - TVAX Æ A-12Pas encore d'évaluation
- Asset Brochure Produit Zehnder ZFPDocument52 pagesAsset Brochure Produit Zehnder ZFPquan.betemPas encore d'évaluation
- Electroerosion Et Usinage Electrochimique ProfDocument3 pagesElectroerosion Et Usinage Electrochimique ProfHem ZaPas encore d'évaluation
- COURSDocument19 pagesCOURStouzajohanPas encore d'évaluation
- Composant ExtracteurDocument9 pagesComposant ExtracteurThierry Epiphane KaborePas encore d'évaluation
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Transféré par
cheikh Tidiane NiassTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Généralités Sur La Parasitologie Mycologie
Transféré par
cheikh Tidiane NiassDroits d'auteur :
Formats disponibles
Introduction à la parasitologie médicale
I. Définitions
La parasitologie : est l’étude des parasites
(animaux, fongiques), de leurs hôtes et
leurs interactions.
La parasitologie en médecine humaine :
étudie les maladies (parasitoses) de
l’homme, qui représente 6 à 8/10 des
maladies.
Dr Mallé GUEYE Page 1
I. Définitions
Parasite : un animal ou un champignon
qui, de façon permanente ou temporaire,
doit obligatoirement se nourrir aux dépend
d’un autre organisme vivant.
Champignon : parasite végétal :
mycose.
L’étude des champignons est la mycologie.
Ex : les dermatophytes : champignons
microscopiques filamenteux.
Parasite : Animal.
L’étude des parasites est la parasitologie.
Ex : puce, sarcoptes, pou, ténia,
Trichomonas vaginalis …
Hôte: c’est l’organisme vivant qui héberge
le parasite. Ex : Homme, animal,
moustique, mollusque …
Dr Mallé GUEYE Page 2
II. Classification
1. Selon le cycle biologique du parasite
Les parasites permanents, obligatoires
ou parasites vrais.
Les parasites temporaires
Les parasites facultatifs, saprophytes : le
parasitisme n’est qu’une option possible
nécessitant certaines conditions
Dr Mallé GUEYE Page 3
II. Classification
2. Selon la localisation du parasite chez
l’hôte
Ectoparasites : à la surface, dans
l’épiderme.
Mésoparasites : dans une cavité de l’hôte
communiquant avec l’extérieur.
Ex : intestin
Endoparasites : dans le milieu intérieur de
l’hôte.
Ex : vaisseaux, tissus, cellules.
Dr Mallé GUEYE Page 4
II. Classification
3. Selon la spécificité parasitaire
Parasites sténoxènes : adapté, inféodé à
un seul hôte.
Parasites euryxènes : spécificité lâche,
c’est le cas des agents des parasitoses
communes à l’homme et aux animaux.
Dr Mallé GUEYE Page 5
III. Taxonomie
Espèce : c’est un ensemble d’individus
ayant les mêmes caractères et qui se
reproduisent entre eux pour transmettre ces
mêmes caractères à leurs descendances.
Genre : c’est un ensemble d’espèces
affines ou voisines.
Désignation : Genre espèce :
Ex : Tænia saginata.
Dr Mallé GUEYE Page 6
III. Taxonomie
Ils existent 4 règnes :
1. Protozoaires (êtres unicellulaires
doués de mouvement)
Selon les cas ils se déplacent grâce à:
des plasmopodes (rhizopodes),
des flagelles,
une membrane ondulante
ou des cils.
Ils se présentent :
sous forme asexuée
ou à potentiel sexué,
mobile ou enkysté,
intra ou extracellulaire.
Dr Mallé GUEYE Page 7
III. Taxonomie
Ils existent 4 règnes :
2. Helminthes ou vers
Une part des métazoaires : être pluricellulaire
possédant des tissus différenciés.
Ils sont reconnus :
sous formes adultes des deux sexes
sous forme larvaire,
embryonnaire ou ovulaire.
Dr Mallé GUEYE Page 8
III. Taxonomie
Ils existent 4 règnes :
3. Fungi ou micromycètes
Ces derniers constituent un règne à part
entière
Ce sont des champignons microscopiques
identifiés :
sous forme de spores isolées ou
regroupées
ou de filaments libres ou tissulaires.
Dr Mallé GUEYE Page 9
III. Taxonomie
Ils existent 4 règnes :
4. Arthropodes
Ce sont des métazoaires, pluricellulaires et
possédant des tissus différenciés.
Insectes, arachnides mollusques et crustacés,
pouvant se présenter :
sous formes adultes (imago) mâles et
femelles,
œufs
et larves (nymphes).
Dr Mallé GUEYE Page 10
IV. Modalité d’interaction (relation hôte-
parasite)
Dr Mallé GUEYE Page 11
IV. Modalité d’interaction
Le parasitisme : association ente deux
êtres vivantes, obligatoire pour le parasite,
qui seul en tire bénéfice.
La vie libre : l’organisme peut subvenir
par lui-même à ses besoins métaboliques.
Le saprophytisme : l’organisme se nourrit
de matières organiques ou végétales en
décomposition dans le milieu extérieur :
Vie saine puis à une certaine condition
devient parasite.
Dr Mallé GUEYE Page 12
IV. Modalité d’interaction
Le commensalisme : l’organisme se
nourrit de matières organiques sur un être
vivant (milieu buccal, intestin) sans
entraîner de troubles ou de spoliations chez
son hôte.
La symbiose : les êtres vivent en étroite
collaboration dans une association
bénéfique aux deux parties (équilibres des
flores intestinales ou vaginales).
La relation hôte/parasite n’est pas forcément
destructive pour l’hôte, il fournit un biotope
et/ou des éléments nutritifs nécessaires à la
survie du parasite.
Remarque : Il faut que le parasite s’adapte
à l’organisme de l’hôte.
Dr Mallé GUEYE Page 13
V. Résultat de l’interaction
1. Action du parasite sur l’hôte
Le parasitisme ne veut pas forcément dire
« effet pathogène » : variations entre le porteur
sain de parasites et le malade.
L’action spoliatrice: le parasite vivant
aux dépend de son hôte est spoliateur par
définition (prend quelque chose de
l’organisme de l’hôte). Ex : Spoliation
sanguine.
L’action traumatique bactérifère :
tout parasite perforant une muqueuse ou le
revêtement cutané peut constituer une
porte d’entrée microbienne (détruire
certaine structure).
Dr Mallé GUEYE Page 14
1. Action du parasite sur l’hôte
L’action mécanique-traumatique :
fréquente est fonction de la taille des
parasites, de leurs localisations, et leurs
éventuelles migrations ectopiques.
Ex : compression de certains organes
(l’occlusion lymphatique …)
L’action toxique : due à l’émission
d’excrétion/sécrétion toxiques.
L’action immunodépressive,
allergique voir anaphylactique : est celle
de tout corps étranger pénétrant un
organisme qui se défend.
Dr Mallé GUEYE Page 15
2. Action de l’hôte sur le parasite
Processus cellulaires : ils mobilisent,
macrophages, éosinophiles, histiocytes.
Processus tissulaires : ils s’expriment
par les granulomes inflammatoires.
Processus plus directement immuno-
pathologiques : ils impliquent antigènes,
anticorps et complexes immuns circulants
participant à la formation de métaplasies
réactionnelles (paragonimose), de
granulomes, de phénomènes allergiques et
anaphylactiques.
Dr Mallé GUEYE Page 16
V. Epidémiologie – Cycle biologique
Vecteur
Hôte Réservoir
Vecteur
Dr Mallé GUEYE Page 17
1. Cycle : succession d’état
Transformation d’une génération à une
génération et infection d’un nouvel hôte.
C’est une chaîne à plusieurs maillons dont
la connaissance peut orienter soit vers une
action thérapeutique ou une action
prophylactique.
La place de l’homme dans le cycle peut
être : normale, annexe ou une impasse
parasitaire.
Dr Mallé GUEYE Page 18
2. Eléments d’un cycle parasitaire
Le parasite ou l’agent pathogène
L’hôte définitif (HD) :
Qui héberge les formes adultes propres à la
reproduction. Ex : forme adulte pour les
Helminthes ou la forme sexuée
protozoaire.
L’hôte intermédiaire (HI) :
C’est l’être vivant chez lequel le parasite
doit obligatoirement séjourner pour se
transformer en une forme (le plus souvent
larvaire) infestante pour l’hôte définitif.
Ex : forme larvaire pour les Helminthes
ou la forme asexuée des protozoaires.
Dr Mallé GUEYE Page 19
3. Eléments d’un cycle parasitaire
L’hôte accidentel
Le vecteur
Agent transmetteur du parasite
Le réservoir
Ensemble des structures biotique et
abiotique qui assurent la survivance d’un
parasite (milieu extérieur, humain, animal)
Dr Mallé GUEYE Page 20
4. Types de cycle parasitaire
Cycles directs
cycles courts :
Ou le parasite est immédiatement infestant
(amibes) ou auto-infestant (la forme
parasitaire émise, larves ou œufs
embryonnés, est immédiatement infestante :
c’est le cas des anguillules et oxyures),
cycles directs longs :
Une maturation (éclosions des œufs
embryonnés, mues des larves) du parasite
doit s’accomplir pendant un court séjour
dans le milieu extérieur sous certaines
conditions d’humidité et de chaleur et de
composition des sols (ascaris, anguillules,
ankylostomes).
Dr Mallé GUEYE Page 21
4. Types de cycle parasitaire
Cycles indirects:
Le parasite passe par un ou plusieurs hôtes
intermédiaires (ou vecteur transformateur
obligatoire de l’agent pathogène en une forme
infestante) :
Poissons (bothriocéphale, Opistorchis)
crustacés (douve de Chine),
mollusques (douves et schistosomes),
mammifères (tænias),
fourmi (petite douve).
Dr Mallé GUEYE Page 22
VI. Mode de contamination
Voie digestive : ingestion de kyste, œuf,
larve
Voie cutanée ou muqueuse passive
Voie transcutanée active : traverse la
peau pour atteindre la circulation générale
Voie aérienne par inhalation
Voie Trans-placentaire : ex : toxoplasmose
Transfusion sanguine
Greffe d’organes
Dr Mallé GUEYE Page 23
VII. Prophylaxie
1. Prophylaxie individuelle
Éviter l’infestation du sujet sain en
s’attaquant au cycle à un seul niveau :
Empêcher la pénétration du parasite.
Détruire le parasite dès sa pénétration.
Bloquer son développement.
Hygiène alimentaire, moustiquaires,
chimio-prophylaxie, vaccination,
répulsifs…
Dr Mallé GUEYE Page 24
2. Prophylaxie collective
S’attaque à tous les maillons vulnérables
de la chaîne épidémiologique.
Education sanitaire,
contrôle des HI,
destruction des vecteurs, dépistage
et traitement de masse.
Dr Mallé GUEYE Page 25
La mycologie
I. Définitions
Champignon : eucaryote hétérotrophe
(ont besoin d’hôte).
Mycologie médicale : étude des
champignons qui provoquent un état
pathologique.
Champignon microscopique ou mycète :
organisme pluri ou unicellulaire
dépourvu de chlorophylle. La plupart ne
vivent pas en parasites. On les retrouve
dans l’environnement ou chez les animaux
(source d’infections diverses).
Dr Mallé GUEYE Page 26
II. Caractère généraux
Ni tige, ni feuilles, ni racine
Sans chlorophylle
Saprophyte ou parasite
Saprophyte puis parasite : champignon
opportuniste
Constitué de thalle ou mycélium :
ensemble de filaments qui assure la
nutrition par absorption directe (glucide,
composé organique).
Aérobies : présence d’oxygène
Se développent entre 20 et 37°C et à
l’humidité
Dr Mallé GUEYE Page 27
II. Caractère généraux
Les champignons ont besoin d’avoir :
Une forme de résistance :
champignon filamenteux et levuriforme
champignon placé dans des conditions
difficiles (ex : pour éviter les phagocytes)
épaississement de la paroi : survie du
champignon
Dr Mallé GUEYE Page 28
III. Classification
Règne : Champignon (fungi)
Division ou phylum : …mycotina
Classe : …mycète
Ordre : …ales
Famille : …aceae
Dr Mallé GUEYE Page 29
III. Classification
1. Champignon filamenteux
Pluricellulaire
Sous forme de filaments mycéliens
cloisonnés ou non-septés.
Mode de reproduction asexué (simples
mitoses) ou sexué (processus de fusion de
caryogamie+ méiose)
Dr Mallé GUEYE Page 30
III. Classification
2. Champignon levuriforme : levures
Sous forme de bourgeon
Reproduction asexuée
Par bourgeonnement
Dr Mallé GUEYE Page 31
IV. Relation hôte-champignon
1. Contamination
A partie de l’environnement
Sol ou objets inertes : atteinte des
téguments
Inoculation avec les végétaux : mycose
sous cutanée
Inhalation dans la poussière : mycose
pulmonaire et disséminée (absence de
contagiosité)
A partie de l’homme ou l’animal
Champignon anthropophile : contagion
interhumaine
Champignon zoophile
Dr Mallé GUEYE Page 32
2. Voie de pénétration dans l’organisme
Voie transcutanée
Voie transmuqueuse : buccale ou nasale
Voie digestive
Voie sanguine par erreur d’asepsie
Dr Mallé GUEYE Page 33
Vous aimerez peut-être aussi
- Transmath 6e LDP CompletDocument213 pagesTransmath 6e LDP Completbactac100% (3)
- Cours Parasitologie 2021Document80 pagesCours Parasitologie 2021Issam mairfat100% (1)
- Cours Parasitologie MédicaleDocument23 pagesCours Parasitologie MédicaleNada Tahiri67% (3)
- Microbiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainD'EverandMicrobiologie médicale I: agents pathogènes et microbiome humainÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- QCM en Biochimie Clinique (Epruves de Résidanat)Document34 pagesQCM en Biochimie Clinique (Epruves de Résidanat)Laouami Fatima94% (18)
- Compréhension Du Fonctionnement de La Station de Récupération de Fluide Frigorigène Et ProcédureDocument28 pagesCompréhension Du Fonctionnement de La Station de Récupération de Fluide Frigorigène Et ProcédureMARDOUMA0% (1)
- Introduction À La Parasito PrésentationDocument28 pagesIntroduction À La Parasito Présentationcheikh Tidiane NiassPas encore d'évaluation
- Cours 1Document3 pagesCours 1Archippe Abia Tchangpina100% (1)
- 01.introduction Parasitologie PDFDocument16 pages01.introduction Parasitologie PDFEltsine FredPas encore d'évaluation
- Parasitologie HumaineDocument12 pagesParasitologie Humainealiouahmed2024Pas encore d'évaluation
- L3 Biochimie Cours Parasitologie Mouhoub Sayah C.Document25 pagesL3 Biochimie Cours Parasitologie Mouhoub Sayah C.Med AichaPas encore d'évaluation
- Cours de ParasitologieDocument24 pagesCours de Parasitologiegjob100% (1)
- Introduction Générale À La ParasitologieDocument5 pagesIntroduction Générale À La Parasitologiesaid mos100% (1)
- Parasitologie AM 1Document147 pagesParasitologie AM 1Franky StonePas encore d'évaluation
- TexteDocument4 pagesTextedht2ts9zw9Pas encore d'évaluation
- Generalites Sur Les ParasitesDocument4 pagesGeneralites Sur Les ParasitesBalayira BakaryPas encore d'évaluation
- 1 - IntroductionDocument6 pages1 - Introductionoustiz134Pas encore d'évaluation
- Généralités Sur Le Parasitisme 2021Document64 pagesGénéralités Sur Le Parasitisme 2021Fatima Dh100% (1)
- Cours de Parasitologie-1Document77 pagesCours de Parasitologie-1mudiboelikya26Pas encore d'évaluation
- 1-Introduction À La ParasitologieDocument9 pages1-Introduction À La Parasitologiesylvie jacklinePas encore d'évaluation
- Polycopie Parasito-Myco 2006-2007Document93 pagesPolycopie Parasito-Myco 2006-2007zlimitounePas encore d'évaluation
- Parasitologie Médicale S1Document8 pagesParasitologie Médicale S1Ciza kassim muyingaPas encore d'évaluation
- Les ParasitesDocument10 pagesLes ParasitesHayat IssaouiPas encore d'évaluation
- CoursDocument16 pagesCoursSalam AbdulPas encore d'évaluation
- Introduction À La Parasitologie - Mycologie 2024Document36 pagesIntroduction À La Parasitologie - Mycologie 2024drsoniaoualiPas encore d'évaluation
- Generalités Dentaire en ParasitologieDocument23 pagesGeneralités Dentaire en ParasitologieLina Ray BenPas encore d'évaluation
- Notion Fondamentale en ParasitologieDocument43 pagesNotion Fondamentale en ParasitologieMELISSA TIGORIPas encore d'évaluation
- Résumé ParasitologieDocument5 pagesRésumé ParasitologieDahou AliPas encore d'évaluation
- Partie1: Généralités Sur La Parasitologie 1-DéfinitionsDocument11 pagesPartie1: Généralités Sur La Parasitologie 1-Définitionsnrnsouma27100% (1)
- PARASITOLOGIEDocument3 pagesPARASITOLOGIERazPas encore d'évaluation
- Généralité Sur Le ParasitismeDocument4 pagesGénéralité Sur Le ParasitismeChristophe VitofodjiPas encore d'évaluation
- 1 Generalites Sur Le ParasitismeDocument15 pages1 Generalites Sur Le ParasitismeVictor MusengePas encore d'évaluation
- Cours Diversité Parasitaire 2012Document86 pagesCours Diversité Parasitaire 2012wallace88leoPas encore d'évaluation
- Cours Parasitologie Et Epidemiologie ÉvolutiveDocument30 pagesCours Parasitologie Et Epidemiologie ÉvolutiveAbdo OuhamoPas encore d'évaluation
- Correction de TD PDFDocument9 pagesCorrection de TD PDFnoureddie100% (3)
- ParasitologieDocument38 pagesParasitologieTom BianchiPas encore d'évaluation
- Geneparasito Semestre 4 2019-20Document39 pagesGeneparasito Semestre 4 2019-20Balla Moussa DiédhiouPas encore d'évaluation
- Parasitologie Generale FGTRDDocument24 pagesParasitologie Generale FGTRDTala ToroPas encore d'évaluation
- 9 Parasitologie MycologieDocument49 pages9 Parasitologie Mycologiemaramzakhama100% (1)
- Diapo 1 - Notions GénéralesDocument24 pagesDiapo 1 - Notions GénéralesAdila DjelailiaPas encore d'évaluation
- Parasitologie Générale 2023Document18 pagesParasitologie Générale 2023Flora NdouyangPas encore d'évaluation
- 4a d1 Ue9 Cours 3 Le Monde Des Parasites RoneoDocument10 pages4a d1 Ue9 Cours 3 Le Monde Des Parasites RoneoJJPas encore d'évaluation
- 10 Généralité PARASITOLOGIEDocument6 pages10 Généralité PARASITOLOGIENouhoum DembéléPas encore d'évaluation
- 2019 Cours ParasitoDocument42 pages2019 Cours ParasitoIlias ElasriPas encore d'évaluation
- Parasito1 2023 PDFDocument49 pagesParasito1 2023 PDFLE BRISHOUALPas encore d'évaluation
- Cours Parasitologie 1Document33 pagesCours Parasitologie 1bonneaug8100% (5)
- Travail Pratique Groupe 1Document5 pagesTravail Pratique Groupe 1jure pudongoPas encore d'évaluation
- Généralités PrasitoDocument2 pagesGénéralités Prasitoferielbrs3Pas encore d'évaluation
- ParasitesDocument16 pagesParasitesMativet 59Pas encore d'évaluation
- 0 - Introduction Mycologie MedicaleDocument2 pages0 - Introduction Mycologie Medicalet.dounia2000Pas encore d'évaluation
- 1 - Introduction À La Bactériologie MédicaleDocument7 pages1 - Introduction À La Bactériologie MédicalenessaibatalebPas encore d'évaluation
- Protozoaires Et Protozooses AnimalesDocument5 pagesProtozoaires Et Protozooses AnimalesHoucïne KerkoubPas encore d'évaluation
- Chapitre VI - HématologieDocument21 pagesChapitre VI - Hématologie페 리알Pas encore d'évaluation
- ParazitoDocument168 pagesParazitoevrard.kinnenonPas encore d'évaluation
- Resource 1Document12 pagesResource 1mintchimechak2Pas encore d'évaluation
- Cours PARASITOLOGIE S6 DéfDocument119 pagesCours PARASITOLOGIE S6 DéfSalma EzzliguiPas encore d'évaluation
- 1er Cours de Physiologie Et Biochimie Des MicroorganismesDocument56 pages1er Cours de Physiologie Et Biochimie Des MicroorganismesbenchihebPas encore d'évaluation
- Microbiologie Et ImmunologieDocument51 pagesMicrobiologie Et ImmunologiehananPas encore d'évaluation
- Zoologie - Chap II ProtozoairesDocument13 pagesZoologie - Chap II Protozoaireslouai beznisPas encore d'évaluation
- Bacterio ParasitoDocument10 pagesBacterio ParasitoOumar TraoréPas encore d'évaluation
- td1 MétazoairesDocument17 pagestd1 Métazoairesfouad abdelhamidPas encore d'évaluation
- Système immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandSystème immunitaire: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Rapport D'intervention Raoul Faulreaut MTNDocument5 pagesRapport D'intervention Raoul Faulreaut MTNNasredine AlainPas encore d'évaluation
- Calcul de Charge Pour CombinaisonDocument1 pageCalcul de Charge Pour CombinaisonHamed100% (1)
- Station de Pompage TARGUISTEDocument11 pagesStation de Pompage TARGUISTEkhadija eddahbyPas encore d'évaluation
- 20201003-Mémoires de Guerre-De GaulleDocument5 pages20201003-Mémoires de Guerre-De GaulleFrance CulturePas encore d'évaluation
- Polymerisation RadicalaireDocument36 pagesPolymerisation RadicalairesamirPas encore d'évaluation
- Simplexe Post OptimaleDocument23 pagesSimplexe Post OptimaleYahya AbidaPas encore d'évaluation
- Reviser Son Bac Avec Le Monde MATHeMATIQUESDocument98 pagesReviser Son Bac Avec Le Monde MATHeMATIQUESje100% (1)
- Exercices ForcesDocument2 pagesExercices ForcesFlorian AmelinckPas encore d'évaluation
- Capacité Calorifique Des GazDocument4 pagesCapacité Calorifique Des Gazleilalargate_3780929Pas encore d'évaluation
- Td1: Exercices de Statistiques Descriptives: DD DD D D Nna DDDocument4 pagesTd1: Exercices de Statistiques Descriptives: DD DD D D Nna DDMalincov MandatPas encore d'évaluation
- HeseDocument5 pagesHesenadinembalteanuPas encore d'évaluation
- Al-Mahdi - BostaniDocument68 pagesAl-Mahdi - BostaniMourtaza RadjahoussenPas encore d'évaluation
- Catalogue Ethnos Stat'ManiaDocument12 pagesCatalogue Ethnos Stat'ManiaLoTfi GarZounPas encore d'évaluation
- Manual Cucta TefalDocument292 pagesManual Cucta TefalDya DanaPas encore d'évaluation
- Dess IcationDocument6 pagesDess IcationYas MiinePas encore d'évaluation
- Triangles Egaux Triangles SemblablesDocument3 pagesTriangles Egaux Triangles Semblableselias aouichatPas encore d'évaluation
- Mesures Électriques - 23-3-2022Document31 pagesMesures Électriques - 23-3-2022Adil BELMOUMENPas encore d'évaluation
- CHIMIE - 1re CD - LES ETAPES DE LANALYSE ELEMENTAIREDocument2 pagesCHIMIE - 1re CD - LES ETAPES DE LANALYSE ELEMENTAIREPatrick NgondamaPas encore d'évaluation
- Exploitation de La Chanson Meunier Tu DorsDocument8 pagesExploitation de La Chanson Meunier Tu DorsClaudinejeannePas encore d'évaluation
- Cours ESC - C.Cazet Pédefer - CG Et Stratégie 2022Document43 pagesCours ESC - C.Cazet Pédefer - CG Et Stratégie 2022rabiPas encore d'évaluation
- MVNO Starter Pack Vdef - FR 2Document14 pagesMVNO Starter Pack Vdef - FR 2Mamadou Oulaye KeitaPas encore d'évaluation
- CV Eddahbi SihamDocument1 pageCV Eddahbi SihamSiham EddahbiPas encore d'évaluation
- TD Fiscalité - TVADocument6 pagesTD Fiscalité - TVAX Æ A-12Pas encore d'évaluation
- Asset Brochure Produit Zehnder ZFPDocument52 pagesAsset Brochure Produit Zehnder ZFPquan.betemPas encore d'évaluation
- Electroerosion Et Usinage Electrochimique ProfDocument3 pagesElectroerosion Et Usinage Electrochimique ProfHem ZaPas encore d'évaluation
- COURSDocument19 pagesCOURStouzajohanPas encore d'évaluation
- Composant ExtracteurDocument9 pagesComposant ExtracteurThierry Epiphane KaborePas encore d'évaluation