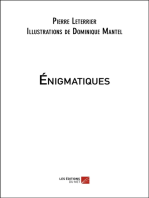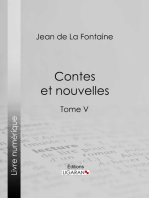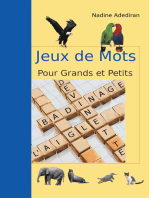Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Résumé Séance 3
Résumé Séance 3
Transféré par
Hồng Anh LêTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Résumé Séance 3
Résumé Séance 3
Transféré par
Hồng Anh LêDroits d'auteur :
Formats disponibles
Influence de la littérature dans la langue
Séance 3 : L’héritage du XVIIe siècle (1)
des conseils multiples
Objectifs de la séance :
- Le XVIIe siècle est LE siècle du théâtre ;
- Pourquoi retenir des citations du théâtre ? Parce que la tragédie sert d’exemple, par le
courage des personnages et la musicalité du vers employé (l’alexandrin).
- Des moralistes réfléchissent aussi sur l’homme et transmettent des conseils.
- Les auteurs présentés : Corneille, Racine (dramaturges) ; Descartes, Pascal
(penseurs) ; La Fontaine (fabuliste = auteur de fables).
1. L’héritage du théâtre
1.1. L’héroïsme des personnages
Exemple : le courage
« La valeur n’attend pas le nombre des Contexte de la pièce : Le Cid, une tragi-
années », Corneille, Le Cid, Acte II, scène 2 comédie (= tragédie avec une fin
(1637) heureuse) : Deux pères veulent marier leurs
Sens : la réussite est indépendante de l’âge enfants, amoureux, mais l’un des pères,
insulté par l’autre, demande à son fils (le
jeune Rodrigue) de le venger. Même s’il
manque d’expérience, Rodrigue s’exécute et
tue l’offenseur de son père.
Pierre Corneille (1606-1684)
1.2. La musicalité de la tragédie
Exemple 1 : par la répétition de mots
« Et le combat cessa faute de combattants » Corneille, Le Contexte de la pièce :
Cid, IV, 3 Rodrigue, parti combattre les
Sens : un combat est arrêté par abandon de l’adversaire. Le Maures (les musulmans
rythme du vers et la répétition combat/combattant permettent d’Afrique du nord), raconte
une mémorisation facile. Ce vers est parfois repris pour parler sa victoire au roi.
d’arrêts (de matchs sportifs, de réunions…)
Exemple 2 : Sonorité et menace
« Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos Histoire de la pièce : c’est une chaîne
têtes ? » Racine, Andromaque, V, 5 (1667) amoureuse qui conduit à la mort.
Intérêt moderne : l’allitération (= répétition du son Chez Racine, la passion détruit tout ; les
« s ») rappelle le sifflement du serpent et crée l’idée personnages perdent leur liberté.
de menace ; une reprise moderne en chanson (Vous
La douleur
êtes lents d’Alain Souchon).
d’Andromaque de
Pour écouter la chanson de Souchon :
https://www.youtube.com/watch?v=tRzC0VVcBTY J.L. David (1783),
musée du Louvre.
Alain Souchon
© Cours de Civilisation Française de la Sorbonne / Marie-Pierre Sales / printemps 2024
1
1.3. Donner des conseils de vie
Exemple 1 : équilibrer des forces
« A vaincre sans péril, on triomphe sans Contexte de la pièce : Don Gomès, le père
gloire » Corneille, Le Cid, II, 2 offenseur, refuse d’abord le combat contre
Le sens : il faut mériter une victoire par des Rodrigue car, étant plus expérimenté, il ne
forces équilibrées. Le sens moderne est retirerait aucun mérite de sa victoire.
affaibli : il va de l’emploi guerrier à l’emploi
sportif ou politique.
Exemple 2 : se ménager
« Qui veut voyager loin ménage sa monture », Racine, Les Plaideurs, I, 1 (1668)
Emploi moderne : il faut savoir économiser ses forces, ne pas se fatiguer trop vite. Les
Plaideurs est la seule comédie de Racine.
2. L’influence des moralistes
Exemple 1 : l’homme, un être de raison
« Je pense donc je suis », Descartes, Discours de la méthode, (1637)
Descartes, un mathématicien, était proche des moralistes. Son influence est restée dans
l’adjectif cartésien (= rigoureux) et par des reprises modernes de sa citation, comme dans une
chanson de Goldman (les Choses, 2001 : C'est plus 'je pense' mais 'j'ai' donc je suis)
qui critique la surconsommation.
Pour revoir la chanson en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=7oNV2KIhYko
Exemple 2 : faire confiance à son intuition
« Le cœur a ses raisons que la raison ignore », Pascal, Pensées (1669, posthume)
Une citation aujourd’hui mal comprise, qui justifie des décisions irrationnelles ; Pascal voulait
montrer comment accéder aux idées religieuses (car croire en Dieu passe par le cœur et non par
la raison). Le vrai sens de l’expression serait donc : il faut suivre son intuition.
3. La renommée d’un fabuliste
L’art de la fable :
Les Fables de La Fontaine, écrites entre 1668-1694 sont des textes en vers, contenant des
animaux, qui ont l’apparence d’hommes, et une morale, au début ou à la fin. L’intérêt de la
fable est d’instruire, par l’utilisation de la poésie (pour plaire) et d’animaux (représentant les
défauts humains), pour éviter la censure. Une fable présente une critique de l’époque et montre
l’intérêt de l’auteur pour les problèmes de son temps.
De nombreuses morales, qu’il développe, sont devenues des
proverbes actuellement, des conseils de vie : « Rien ne sert de
courir il faut partir à point » (= la patience) dans Le Lièvre et la
Tortue ; « On a souvent besoin d’un plus petit que soi » (=
l’entraide) dans Le lion et le Rat ; « Tel est pris qui croyait
prendre » (= être victime de son propre piège) dans Le Rat et
l’Huître.
© Cours de Civilisation Française de la Sorbonne / Marie-Pierre Sales / printemps 2024
2
Exemple 1 : le constat de l’injustice « La raison du plus fort est toujours la meilleure »
LE LOUP ET L'AGNEAU A retenir :
La raison du plus fort est toujours la meilleure :
Nous l'allons montrer tout à l'heure. La morale initiale constate l’injustice, compréhensible
Un Agneau se désaltérait dans le contexte de l’époque (une monarchie absolue : le
Dans le courant d'une onde pure. roi a tous les pouvoirs)
Un Loup survient à jeun, qui cherchait aventure, L’argumentation est fondée sur une inégalité : la mauvaise
Et que la faim en ces lieux attirait.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?
foi du loup contre la raison de l’agneau.
Dit cet animal plein de rage : Le dialogue est important, pour rendre le récit vivant.
Tu seras châtié de ta témérité. C’est une parodie de justice : l’agneau était condamné
Sire, répond l'Agneau, que Votre Majesté avant même de parler.
Ne se mette pas en colère ;
Mais plutôt qu'elle considère Vocabulaire : se désaltérer = boire pour ne plus avoir soif ;
Que je me vas désaltérant une onde = l’eau ; à jeun = qui n’a pas mangé ; hardi =
Dans le courant, courageux ; un breuvage = une boisson ; la rage = la colère ;
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle ; châtié = puni ; la témérité = courage aveugle ; médire =
Et que par conséquent, en aucune façon,
dire du mal ; téter = aspirer le lait.
Je ne puis troubler sa boisson.
Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,
Et je sais que de moi tu médis l'an passé.
Comment l'aurais-je fait si je n'étais pas né ?
Reprit l'Agneau ; je tette encor ma mère
Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.
Je n'en ai point. C'est donc quelqu'un des tiens :
Car vous ne m'épargnez guère,
Vous, vos Bergers et vos Chiens.
On me l'a dit : il faut que je me venge."
Là-dessus, au fond des forêts
Le loup l'emporte et puis le mange,
Sans autre forme de procès. Le Loup et l’Agneau, livre 1, fable 4 (1668)
Exemple 2 : l’honnêteté « Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute »
A retenir Le Corbeau et le Renard
La morale finale : ne pas céder à la flatterie. Maître Corbeau, sur un arbre perché,
Les animaux sont personnifiés : ils ont des comportements Tenait en son bec un fromage.
humains, des défauts (corbeau/vaniteux et renard/flatteur) mais Maître Renard, par l'odeur alléché,
ils gardent des attributs d’animaux (ramage, plumage) Lui tint à peu près ce langage :
La position initiale se renverse : le corbeau, en hauteur, perd son "Hé ! bonjour, Monsieur du Corbeau.
Que vous êtes joli ! que vous me semblez beau !
bien et se retrouve en état d’infériorité. Sans mentir, si votre ramage
Le ton : humour et ironie. Se rapporte à votre plumage,
Vocabulaire : Vous êtes le Phénix des hôtes de ces bois. "
Alléché par l’odeur = attiré A ces mots le Corbeau ne se sent pas de joie ;
Le ramage : le chant de l’oiseau Et pour montrer sa belle voix,
Le plumage = les plumes de l’oiseau Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le phénix = oiseau légendaire qui renaît de ses cendres Le Renard s'en saisit, et dit : "Mon bon Monsieur,
Une proie : objet (personne) capturé lors d’une la chasse Apprenez que tout flatteur
Se saisir = attraper Vit aux dépens de celui qui l'écoute :
Aux dépens de = au détriment, aux frais de quelqu’un Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. "
Le Corbeau, honteux et confus,
Le Corbeau et le Renard, livre 1, fable 2 (1668) Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus.
Conclusion : Ces références illustrent différents aspects du siècle (le théâtre ; les penseurs ; la
fable) reprises sous diverses formes (titres, refrain) car elles sont un héritage d’auteurs majeurs.
© Cours de Civilisation Française de la Sorbonne / Marie-Pierre Sales / printemps 2024
3
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Livre Du Serpent NoirDocument6 pagesLe Livre Du Serpent Noiredmonddantes02-1Pas encore d'évaluation
- Les Registres LittérairesDocument10 pagesLes Registres Littérairesmanal kirechPas encore d'évaluation
- En NF 14411Document24 pagesEn NF 14411Mustapha HadounePas encore d'évaluation
- CV LAZRAK Meryem PDFDocument1 pageCV LAZRAK Meryem PDFMohamed HAMMAR100% (1)
- Cours LaFontaineDocument7 pagesCours LaFontaineAnne-catherine TopouchianPas encore d'évaluation
- AYEL Jean - Lubrifiants Pour Moteurs Thermiques - Normes GeneralesDocument16 pagesAYEL Jean - Lubrifiants Pour Moteurs Thermiques - Normes GeneralesYodaScribdPas encore d'évaluation
- Serie Tableau AvancementDocument5 pagesSerie Tableau AvancementkkkkPas encore d'évaluation
- De La Couleur Des Choses Lucrece de RerDocument29 pagesDe La Couleur Des Choses Lucrece de RerJean-Loup M. H. DabePas encore d'évaluation
- Le Corbeau Et Le RenardDocument4 pagesLe Corbeau Et Le Renardgeupier100% (1)
- Dissertation Fables de La FontaineDocument4 pagesDissertation Fables de La Fontaineelava33% (3)
- 2014 12 30 Chapitre3 FMDocument36 pages2014 12 30 Chapitre3 FMBUKURU Cossam100% (1)
- Swiffer SweepVac ManualDocument2 pagesSwiffer SweepVac ManualKevin Severud67% (3)
- Les Animaux Malades de La PesteDocument15 pagesLes Animaux Malades de La Pestecamille bongardPas encore d'évaluation
- Ironie Fiche Synthe Se PDFDocument2 pagesIronie Fiche Synthe Se PDFMostafa AmriPas encore d'évaluation
- BAC Les Animaux Malades de La PesteDocument3 pagesBAC Les Animaux Malades de La PesteMya MilhommePas encore d'évaluation
- 31 01 10les Figures de Styles Eleves 1 2Document14 pages31 01 10les Figures de Styles Eleves 1 2ouefilsdePas encore d'évaluation
- Corbul Si VulpeaDocument5 pagesCorbul Si VulpeaMihaela GabrielaPas encore d'évaluation
- Projet 2 Séquence3 de 2èmeDocument13 pagesProjet 2 Séquence3 de 2èmeDjamel SebaPas encore d'évaluation
- Séance 2 Versification RévisionDocument4 pagesSéance 2 Versification Révisionlouis bivortPas encore d'évaluation
- L'art Du Récit 2Document3 pagesL'art Du Récit 2yoan tancelinPas encore d'évaluation
- Projet 2 Séquence3 de 2èmeDocument12 pagesProjet 2 Séquence3 de 2èmeDjamel SebaPas encore d'évaluation
- Séance 3 - Jean de La Fontaine Les Animaux Malades de La Peste Fables 1678Document4 pagesSéance 3 - Jean de La Fontaine Les Animaux Malades de La Peste Fables 1678Maxim BrickPas encore d'évaluation
- Un Mal Qui Répand La TerreurDocument3 pagesUn Mal Qui Répand La TerreurHanae LaroussiPas encore d'évaluation
- Fables, Livres VII À XI, Jean de La Fontaine, 1678-1679: Présentation GénéraleDocument9 pagesFables, Livres VII À XI, Jean de La Fontaine, 1678-1679: Présentation Généralenaboussy inassPas encore d'évaluation
- LETTRE VOYANT RIMBAUdDocument2 pagesLETTRE VOYANT RIMBAUdceliagirodmoinePas encore d'évaluation
- S3 Fiches Élèves. Rusé Comme Un Renard !Document7 pagesS3 Fiches Élèves. Rusé Comme Un Renard !2012berivanPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture FablesDocument8 pagesFiche de Lecture FablessouihinicolasPas encore d'évaluation
- Groupement Textes Theatre 2 1Document23 pagesGroupement Textes Theatre 2 1hajar hajarPas encore d'évaluation
- 6 Etude de La Fable Mise en Scène WilsonDocument6 pages6 Etude de La Fable Mise en Scène WilsonSacha DivoPas encore d'évaluation
- Fiche BacDocument6 pagesFiche BacMhamad990Pas encore d'évaluation
- Analyse La FontaineDocument14 pagesAnalyse La FontaineMeriem BRIKIPas encore d'évaluation
- La Comedie Et La TragedieDocument7 pagesLa Comedie Et La Tragedieastaifi saidPas encore d'évaluation
- Saint-Gilles DialogueDocument9 pagesSaint-Gilles DialoguelohohammouPas encore d'évaluation
- Tragédie (Séance À Vidéoprojeter)Document30 pagesTragédie (Séance À Vidéoprojeter)abramannabellePas encore d'évaluation
- Séance 1Document2 pagesSéance 1BugesPas encore d'évaluation
- 6 Tâche Sur LafontaineDocument4 pages6 Tâche Sur LafontaineNicole GarcíaPas encore d'évaluation
- SteveDocument10 pagesSteve8rgxxbvf9sPas encore d'évaluation
- Thème 2 FrançaisDocument16 pagesThème 2 FrançaisMaëlyssPas encore d'évaluation
- Support Les Registres LittérairesDocument3 pagesSupport Les Registres Littérairesbassrimustapha18Pas encore d'évaluation
- Fables 2020 1323998 PDF 1230 PDFDocument43 pagesFables 2020 1323998 PDF 1230 PDFHuPas encore d'évaluation
- LDP CompletDocument438 pagesLDP CompletDiego Matos GondimPas encore d'évaluation
- Mariage de FigaroDocument164 pagesMariage de FigarojamalotPas encore d'évaluation
- Books Library - Online 09121013Ls0C6Document7 pagesBooks Library - Online 09121013Ls0C6Othmane El BazPas encore d'évaluation
- HTTPSWWW - Editions Ellipses - frpdF9782729888855 Extrait PDFDocument8 pagesHTTPSWWW - Editions Ellipses - frpdF9782729888855 Extrait PDFlulu.genotparisPas encore d'évaluation
- Les Figures de StyleDocument5 pagesLes Figures de StyleChimène SmithPas encore d'évaluation
- Explication Le Lion, Le Loup Et Le RenardDocument2 pagesExplication Le Lion, Le Loup Et Le RenardGabriel AndrieuPas encore d'évaluation
- Cours 1Document6 pagesCours 1gaspardchirolPas encore d'évaluation
- Overflow of Rhymes and Leonine Verses inDocument10 pagesOverflow of Rhymes and Leonine Verses inaaaaaaPas encore d'évaluation
- L'Illusion ComiqueDocument6 pagesL'Illusion ComiqueDan MoldovanPas encore d'évaluation
- Descriptif BB Février 2024Document12 pagesDescriptif BB Février 20247k9dwqf2hsPas encore d'évaluation
- Malade LPDocument19 pagesMalade LPFbyes SPas encore d'évaluation
- Les Genres ThéâtrauxDocument5 pagesLes Genres ThéâtrauxAmal FadelPas encore d'évaluation
- DNB La FontaineDocument7 pagesDNB La FontaineFleur FlurPas encore d'évaluation
- PoésieDocument8 pagesPoésieMohammed ChoujaaPas encore d'évaluation
- Candide Seq 3Document8 pagesCandide Seq 3Marwa NaciriPas encore d'évaluation
- Séquence 2 Chapitre 4Document25 pagesSéquence 2 Chapitre 4Erza ScarlettPas encore d'évaluation
- Texte 4 La Cour Du Lion FablesDocument2 pagesTexte 4 La Cour Du Lion Fablessheckyna86Pas encore d'évaluation
- Capture D'écran . 2023-01-01 À 12.10.08Document1 pageCapture D'écran . 2023-01-01 À 12.10.08Nicole MartinPas encore d'évaluation
- Le Discours DirectDocument13 pagesLe Discours Directsqcq cqqPas encore d'évaluation
- Le Loup Et L'agneauDocument14 pagesLe Loup Et L'agneauaalaska4Pas encore d'évaluation
- Les Registres Littéraire ExercicesDocument3 pagesLes Registres Littéraire Exerciceslouise.monyletPas encore d'évaluation
- FrancaitDocument13 pagesFrancaityevernPas encore d'évaluation
- Substituts Exercices 2Document11 pagesSubstituts Exercices 2hend boussaadaPas encore d'évaluation
- Suite 3Document3 pagesSuite 3Hồng Anh LêPas encore d'évaluation
- Homework 16.10Document1 pageHomework 16.10Hồng Anh LêPas encore d'évaluation
- SL Descriptif Des Cours 1Document1 pageSL Descriptif Des Cours 1Hồng Anh LêPas encore d'évaluation
- Licence 1 Administration Economique EtDocument4 pagesLicence 1 Administration Economique EtHồng Anh LêPas encore d'évaluation
- Le Support Du Cours - Urgences NéphrologiquesDocument110 pagesLe Support Du Cours - Urgences NéphrologiquesMarouan DhnPas encore d'évaluation
- TP Zoologie La ParamecieDocument7 pagesTP Zoologie La ParamecieIkram GouasmiPas encore d'évaluation
- Comprendre Les Cycles Hydrologiques Et Cultiver L Eau v1 WEBDocument124 pagesComprendre Les Cycles Hydrologiques Et Cultiver L Eau v1 WEBbeaubyPas encore d'évaluation
- Poly2M271 2015Document74 pagesPoly2M271 2015Kurros LANPas encore d'évaluation
- Lelievre 2011ecap0031 ArchDocument199 pagesLelievre 2011ecap0031 ArchAbdoul Maguidou KaboréPas encore d'évaluation
- Exam 07 TIAC Nain CorriGDocument2 pagesExam 07 TIAC Nain CorriGLili AlexPas encore d'évaluation
- PDF 24Document24 pagesPDF 24ZA ERPas encore d'évaluation
- Seconde Equations Droites ExDocument7 pagesSeconde Equations Droites ExDIOUFPas encore d'évaluation
- DroPix V2Document33 pagesDroPix V2Charly de TaïPas encore d'évaluation
- Toolkit EditionDocument164 pagesToolkit EditionFeth-allah SebbaghPas encore d'évaluation
- 1 - Présentation Générale, Objectifs: Mini Projet de Programmation en Langage CDocument5 pages1 - Présentation Générale, Objectifs: Mini Projet de Programmation en Langage CRegueragui EssabbarPas encore d'évaluation
- Portrait Pierrette GengouxDocument10 pagesPortrait Pierrette GengouxphilodeschampsPas encore d'évaluation
- Cours 5 ProthèseDocument4 pagesCours 5 ProthèseDDan2005Pas encore d'évaluation
- Cours Math - Chapitre 12 Généralités Sur Les Fonctions - 2ème Sciences MR HamadaDocument4 pagesCours Math - Chapitre 12 Généralités Sur Les Fonctions - 2ème Sciences MR Hamadajihed25100% (2)
- 6-Outillage ManuelDocument16 pages6-Outillage ManuelYannick NDO'O NDOUMOUPas encore d'évaluation
- Fra 11074Document586 pagesFra 11074Karolliny FrotaPas encore d'évaluation
- Fiche Soutien Sanitaire Sdis 78Document6 pagesFiche Soutien Sanitaire Sdis 78Sébastien LachaumePas encore d'évaluation
- IS0102A01MMDocument2 pagesIS0102A01MMdadaPas encore d'évaluation
- CV MwabanwaDocument1 pageCV Mwabanwanaasson kapelPas encore d'évaluation
- Cer, - Ger, - GuerDocument5 pagesCer, - Ger, - Guerleila BKPas encore d'évaluation
- CD PDF L3 18Document34 pagesCD PDF L3 18pfePas encore d'évaluation
- Emploi Du Temps SVI S1 S3 S5 - 17 18Document3 pagesEmploi Du Temps SVI S1 S3 S5 - 17 18Sebbar ImadPas encore d'évaluation