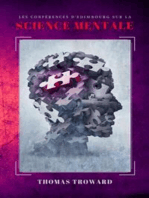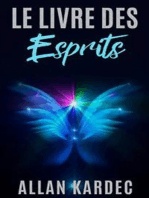Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Oeuvre Suivie
Oeuvre Suivie
Transféré par
evaTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Oeuvre Suivie
Oeuvre Suivie
Transféré par
evaDroits d'auteur :
Formats disponibles
Commentaire d'une œuvre suivie
LECTURE SUIVIE
Essai sur les données immédiates de la
conscience, Henri Bergson, 1889 (chapitre 2)
Dans cet ouvrage, Bergson s’interroge sur ce qui constitue la nature du temps.
Thèse et hypothèse
Pour Bergson, le temps n’est pas physique, mais spirituel. Selon lui, il convient d’op-
poser à une lecture physico-mathématique du temps une conception spiritualiste
qui restitue la réalité du temps comme « vécu » de la conscience.
Présentation
Cette œuvre est l’une des deux thèses de docto-
rat de Bergson, l’auteur y soutient la nature psy-
chologique du temps. L’ouvrage prend place dans
l’histoire de la philosophie comme une critique
du positivisme, il est composé trois chapitres.
Dans le premier chapitre intitulé « De l’intensité
des États psychologiques », Bergson fait essen-
tiellement une distinction entre l’intensité quan-
titative et l’intensité qualitative. Ainsi lorsqu’une
sensation de froid progresse en nous elle ne le
fait pas par degrés cumulables. Certes, le thermo-
mètre mesure par degré la cause de la sensation
de froid, mais au sein de la conscience l’impres-
sion ressentie est un effet bien différent : il s’agit
d’une sensation qui enveloppe toutes nos repré-
sentations et dont l’intensité est qualitative et
prend la forme d’un progrès continu.
Bergson procède ensuite à une définition négative de l’idée de durée, la notion de durée étant
mieux saisie par une approche de ce qu’elle n’est pas. Selon lui, la durée n’est pas le nombre, ni
l’espace, ni le mouvement. Ces notions sont souvent définies ou utilisées par la science, ce qui
amène à considérer le temps à travers une approche fonctionnelle qui produit une abondance
de représentations inadéquates.
Bergson interroge enfin la possibilité de comprendre l’homme à partir de ses déterminismes
corporels. Selon lui, un état psychologique ne peut pas être expliqué par une disposition
corporelle, serait-elle celle du cerveau. L’analyse de la durée a permis de comprendre que
l’homme est d’abord un « Moi profond » qui ne se laisse pas réduire à un assemblage, de
moments, ou de neurones. Cette personnalité spirituelle profonde s’exprime dans la liberté
de créer. La liberté est donc un jaillissement du Moi profond qu’aucune définition ne peut
cerner sans le trahir.
BERGSON XXe siècle
LLS.fr/PHTBergson
Analyse de l’œuvre
A. Que nous apprend la théorie du nombre sur le temps ?
Lorsque nous comptons, nous ne le faisons pas dans la durée, mais dans l’espace. Chaque unité
comptée (un, deux, trois) appartient à un espace et nous passons de nombre en nombre en nous
figurant un « saut brusque » et non une continuité. Si nous faisons souvent l’erreur de considérer
que nous comptons dans la durée, c’est que nous ne percevons pas que l’idée de nombre contient
le présupposé de l’espace.
Pourquoi tout nombre contient-il le présupposé de l’espace ? L’un des arguments de Bergson est que
la conscience vit des simultanéités, alors que le nombre suppose la succession d’unités distinctes.
Ainsi quand nous comptons jusqu’à dix, nous nous figurons la succession de chacune des unités et
nous gardons en mémoire chacune des unités dénombrées lorsque l’on arrive à dix.
Ainsi, nous nous figurons les unités additionnées comme des points juxtaposés dans l’espace et
nous conservons en mémoire toutes les positions des unités.
Les deux multiplicités sont les suivantes :
Quand nous comptons des objets du monde, suivant la multiplicité arithmétique, nous les
figurons comme indépendants les uns des autres dans l’espace. Nous ne pouvons pas conce-
voir en effet que deux corps occupent absolument le même espace. Mais ce qui peut passer
pour une propriété de la matière est en fait une propriété du nombre, avant d’être des objets,
ils sont deux, trois, etc. Or Bergson vient d’établir que nous concevons une unité et la suivante
dans l’espace. Donc l’espace et le nombre sont solidaires.
La conscience connaît également la multiplicité d’états spirituels, comme les idées ou les
sentiments. Cependant, lorsque nous comptons nos états de conscience, nous sommes placés
devant une multiplicité différente. Les états psychiques s’interpénètrent, il faut donc, pour
les compter, les séparer et les spatialiser avant de les dénombrer. Nous les comptons donc en
leur substituant un symbole. Ces symboles sont ensuite organisés comme des nombres, c’est-
à-dire sous une forme spatiale, mais ces symboles ne sont pas nos états de conscience. Ainsi
nous commettons l’erreur de penser nos états de conscience suivant la logique du nombre.
B. À quoi correspondent les idées d’espace et de temps ?
Bergson indique qu’il faut distinguer la perception de l’étendue et la conception de l’espace.
Ces deux approches s’impliquent mutuellement, mais plus nous nous élevons vers les espèces intel-
ligentes et plus ces notions se distinguent. Pour l’homme et pour l’animal, l’espace ne désigne donc
pas la même chose. L’animal vit l’espace sans sentiment d’extériorité prononcé, alors que l’homme
conçoit l’espace comme « un milieu vide homogène ». Kant propose, par sa définition des formes
a priori de l’intuition sensible, un espace ainsi conçu qui ne repose pas sur une différenciation
qualitative, propre à l’animalité. Ainsi l’animal ne perçoit pas l’espace géométrique, mais un espace
qualitativement différent, par exemple en fonction du magnétisme de telle ou telle zone : « On a
essayé d’expliquer ce sentiment de la direction par la vue ou l’odorat, et plus récemment par une
perception des courants magnétiques, qui permettrait à l’animal de s’orienter comme une boussole.
Cela revient à dire que l’espace n’est pas aussi homogène pour l’animal que pour nous ».
Bergson s’inscrit en faux contre l’école anglaise qui fait dériver la notion d’espace de la notion de
durée. Selon Bergson, c’est l’espace qui est premier. Il prend l’exemple d’une succession de sensa-
tions lorsque l’on promène nos doigts sur une surface. On ne peut pas distinguer chaque moment
sensible sans les situer dans l’espace, l’idée d’espace est donc première.
Cette réfutation suppose que nous distinguions la durée mêlée à l’idée d’espace, et la durée pure
qui correspond à un esprit qui s’abstient de distinguer l’avant et l’après de ses états de conscience,
et qui pour ainsi dire « se laisse vivre ».
Ainsi, lorsque nous percevons une mélodie nous pouvons avoir deux attitudes. D’abord nous pou-
vons tenter de distinguer chaque note, les replacer dans la succession, donc les spatialiser par un
effort d’abstraction de la pensée. Mais la vraie durée de la mélodie est alors perdue.
Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson, 1889
Commentaire d'une œuvre suivie
Ensuite, pour percevoir véritablement la durée, il faut que la succession des notes se produise sans
distinction de chaque élément, ne voyons-nous pas que « nous les apercevons néanmoins les unes
dans les autres, et que leur ensemble est comparable à un être vivant, dont les parties, quoique
distinctes, se pénètrent par l’effet même de leur solidarité ? ». Cette durée prend la forme d’un
mouvement continu, et l’intuition seule est capable de la saisir.
La vraie durée est dans l’interpénétration de changements qualitatifs au sein de la conscience, et ils
ne doivent rien à la conception du nombre. C’est ce que Bergson nomme « l’hétérogénéité pure ».
La multiplicité des états de conscience est alors qualitative et prend la forme d’un progrès continu.
Bergson prend l’exemple de l’endormissement. Si nous nous endormons au bruit d’un balancier
régulier qui oscille, ce n’est pas le dernier bruit perçu qui provoque l’endormissement, ce n’est pas
plus la somme arithmétique de tous ces bruits séparés et additionnés. C’est l’ensemble des bruits,
qui forme un rythme, un organisme, et c’est précisément leur qualité organique qui provoque l’en-
dormissement, c’est-à-dire que le tout – le rythme – n’est pas réductible à la somme des parties et
donc à l’addition des bruits.
Nos sens perçoivent des mouvements comme « le signe en quelque sorte palpable d’une durée
homogène et mesurable » et les sciences – la physique par exemple – conçoivent le temps comme
une quantité chiffrable. Il est donc peu étonnant que nous éprouvions « une incroyable difficulté à
nous représenter la durée dans sa pureté originelle ».
Pour y parvenir il faut comprendre une confusion fréquente entre l’espace le temps. Ainsi lorsque
nous observons une horloge et le déplacement des aiguilles, nous pensons percevoir une durée.
Or la position de l’aiguille est toujours un « ici et maintenant ». Les positions passées de l’aiguille
n’existent plus dans le monde extérieur, ce n’est que pour une conscience capable de se remémorer
les positions passées que la succession existe.
Si nous supprimons l’horloge, il reste la durée interne de la conscience, mais si nous supprimons
la conscience, la position des aiguilles est toujours une, sans succession. L’extériorité – le monde
physique – est sans succession, et la durée de la conscience est sans extériorité.
En revanche, si nous rapprochons l’espace réel sans durée et la durée réelle qui n’est pas une addi-
tion d’instants, nous faisons naître « une représentation symbolique » : « La durée prend ainsi la
forme illusoire d’un milieu homogène, et le trait d’union entre ces deux termes, espace et durée, est
la simultanéité, qu’on pourrait définir l’intersection du temps avec l’espace. »
C. Que produit la distinction entre le temps et la durée ?
Le mouvement est défini, lui aussi, par la relation de superposition de la durée de la conscience
avec un réel sans durée. Plus clairement, Bergson prend l’exemple d’un mobile qui se déplace. Le
mobile occupe bien une position dans l’espace, mais une seule. Pour qu’il occupe plusieurs positions
pendant une durée, il faut un spectateur conscient qui se remémore chacune des positions passées.
Le mouvement ne relève donc plus de l’espace, mais du psychisme.
Dans l’étude du mouvement, nous confondons régulièrement l’espace parcouru – une quantité d’es-
pace homogène – et l’acte qui consiste à le parcourir et qui n’est durable que pour une conscience.
Il faut une conscience pour que les mouvements passés et présents soient reliés.
Ainsi, Bergson montre l’erreur au sein du paradoxe de Zénon d’Élée : si Achille ne peut pas rattra-
per la tortue dans la formulation de Zénon c’est que l’intervalle entre eux est toujours divisible,
comme l’espace homogène l’est. Mais le mouvement relève de la durée et non de l’espace : « si le
mouvement était composé de parties comme celles de l’intervalle lui-même, jamais l’intervalle ne
serait franchi ».
La science ne parvient pas à saisir le temps et le mouvement, sinon en supprimant ce qui fait leur
nature. Elle conçoit le temps, mais sans la durée, elle conçoit aussi le mouvement, mais sans la
mobilité. Ainsi, en mécanique, la durée est définie comme un intervalle entre un instant initial et un
instant final. Pour définir ces deux instants, nous observons la simultanéité d’un état de conscience
avec un changement extérieur. Mais la durée entre ces deux instants ne peut être comprise que par
une conscience, car la durée est toujours en train de s’accomplir. Or, nos états de conscience sont des
multiplicités qui diffèrent de la multiplicité des nombres, car ils sont qualitatifs et non seulement
arithmétiques : « Il devient dès lors évident qu’en dehors de toute représentation symbolique le
temps ne prendra jamais pour notre conscience l’aspect d’un milieu homogène, où les termes d’une
succession s’extériorisent les uns par rapport aux autres. »
Nous vivons au contact d’objets extérieurs et notre conscience a pris l’habitude de les considérer
comme des objets dénombrables et dans l’espace. Nous avons donc un « moi de surface » qui est
composé de la suite des sensations relatives aux objets extérieurs. Inversement, dans le « moi inté-
rieur », les moments sensibles sont interpénétrés les uns avec les autres, ils ne se distinguent pas.
Mais nous ne saisissons pas cette différence, car « comme ce moi plus profond ne fait qu’une seule et
même personne avec le moi superficiel, ils paraissent nécessairement durer de la même manière ».
Ainsi la majorité de la vie psychique voit « l’invasion graduelle de l’espace dans le domaine de la
conscience pure. » Autrement dit, nous avons pris l’habitude de penser la durée sous la forme de
l’espace et du nombre. Cependant, nous pouvons faire l’expérience de la durée vraie ; elle est res-
sentie dans le rêve. Dans le cadre du rêve, la communication avec le monde extérieur est restreinte
et modifiée, nous ne sommes plus alors dans une durée spatialisée, nombrée, et quantitative ; nous
ressentons la durée, sous une forme instinctuelle, et parfois confuse. Il existe donc deux formes
de la durée : « la durée homogène » et la « durée hétérogène » et deux strates du moi qui leur
correspondent.
D. Comment retrouver le moi fondamental ?
Notre esprit est chargé de représentations spatiales de la durée qu’il faut supprimer pour retrouver
le moi fondamental. Sur plan du moi intérieur, nous vivons des états de conscience : confus, indivi-
duels, et indicibles. Sur le plan du moi superficiel, nous vivons des états de conscience impersonnels,
mais clairs et communicables. Le langage, en verbalisant un état de conscience profond, le rend
superficiel. Bergson propose plusieurs analyses pour appuyer sa thèse. Ainsi, lorsque nous sommes
encore des enfants, nous verbalisons des sensations, puis à l’âge adulte nous utilisons les mêmes
verbalisations pour des sensations qui sont pourtant différentes. Les mots décolorent la sensation
précise. Tout l’art du romancier est de restituer la confusion émotionnelle que le langage ordinaire
masque sous une dénomination qui fait écran au moi intérieur.
Conclusion Importance de cette œuvre
« La vie consciente se présente sous un double aspect, Bergson porte son attention sur la vie intérieure : la
selon qu’on l’aperçoit directement ou par réfraction à mémoire, la liberté, la durée, ou encore l’intuition. Son
travers l’espace. » Notre moi intérieur est l’intuition de la approche est spiritualiste, teintée de métaphysique, ce qui
durée qualitative ; nos états de conscience y sont person- la rend moins audible aujourd’hui. Sa philosophie a été un
nels, mais confus et incommunicables par le langage. Dans sujet d’étude pour Deleuze et Merleau-Ponty, mais surtout
le temps réfracté, nos états de conscience sont clairs et une influence majeure pour Lévinas qui considère que l’Es-
transmissibles par le langage, mais ils sont modifiés et tra- sai sur les données immédiates de la conscience est l’un des
his pour se conformer à la vie sociale. Progressivement, les cinq livres majeurs de la philosophie.
nécessités de la vie sociale et le langage supposent que le
moi superficiel recouvre le moi intérieur. La durée n’est plus
alors appréciée qualitativement, mais seulement quantita-
tivement et notre moi intérieur est comme réfracté au-de-
hors. Au cours du passage de « nos états de conscience du
dedans au-dehors : petit à petit ces états se transforment
en objets ou en choses ; ils ne se détachent pas seulement
les uns des autres, mais encore de nous. »
Essai sur les données immédiates de la conscience, Henri Bergson, 1889
Vous aimerez peut-être aussi
- Mémoire Bergson Technique Et Thérapeutique 3Document6 pagesMémoire Bergson Technique Et Thérapeutique 3Guillian ValléPas encore d'évaluation
- L'existence et le temps (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandL'existence et le temps (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Bergson Et La Question Du TempsDocument12 pagesBergson Et La Question Du Tempsjeanmaxbea509Pas encore d'évaluation
- TextesDocument3 pagesTextesevaPas encore d'évaluation
- La perception (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa perception (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophiePas encore d'évaluation
- Cours Le TempsDocument1 pageCours Le TempsMario Vander LindenPas encore d'évaluation
- Bergson Les Deux MoisDocument3 pagesBergson Les Deux Moisعدي أوبيهيPas encore d'évaluation
- Bergson Qu'Arrive T Il...Document6 pagesBergson Qu'Arrive T Il...Galoot38Pas encore d'évaluation
- Aspects Divers de La Mémoire Chez BergsonDocument4 pagesAspects Divers de La Mémoire Chez BergsonTomás PadillaPas encore d'évaluation
- Le Temps - Fiche de RevisionDocument3 pagesLe Temps - Fiche de Revisionebenammar53Pas encore d'évaluation
- Base de Astro CronobiologieDocument9 pagesBase de Astro CronobiologieElvira DuboisPas encore d'évaluation
- Bergson - L'âme Et Le Corps (L'energie Spirituelle, 1919)Document16 pagesBergson - L'âme Et Le Corps (L'energie Spirituelle, 1919)kairoticPas encore d'évaluation
- L'inconscient (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandL'inconscient (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Philo Bergson Mémoire Habitude Mémoire Pure - OdtDocument2 pagesPhilo Bergson Mémoire Habitude Mémoire Pure - OdtLolpierrePas encore d'évaluation
- Memoire Et DureeDocument12 pagesMemoire Et DureeTiresia GiunoPas encore d'évaluation
- La pensée et le mouvant: Essais et Conférences (1903-1923)D'EverandLa pensée et le mouvant: Essais et Conférences (1903-1923)Pas encore d'évaluation
- La Matière Et L'esprit PDFDocument88 pagesLa Matière Et L'esprit PDFFady ABDELNOURPas encore d'évaluation
- Sensation DroitDocument10 pagesSensation DroitNaydi jublince CebePas encore d'évaluation
- Cours Philo Le TempsDocument11 pagesCours Philo Le TempsMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Phie FrançaiseDocument6 pagesPhie FrançaiseRichard DANIELPas encore d'évaluation
- Le Seuil du Monde Spirituel: Aphorismes et pensées de Rudolf Steiner sur l'expérience de l'au-delàD'EverandLe Seuil du Monde Spirituel: Aphorismes et pensées de Rudolf Steiner sur l'expérience de l'au-delàPas encore d'évaluation
- Bergson - Introduction À La MétaphysiqueDocument27 pagesBergson - Introduction À La MétaphysiquekairoticPas encore d'évaluation
- Corps Et Esprit, BarbarasDocument80 pagesCorps Et Esprit, BarbarasGros Caca Liquide100% (1)
- Matière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l'espritD'EverandMatière et mémoire: Essai sur la relation du corps à l'espritPas encore d'évaluation
- Analyse Du TexteDocument4 pagesAnalyse Du Texteadam es-sakhiPas encore d'évaluation
- La Matiere Et L'espritDocument7 pagesLa Matiere Et L'espritMbenidPas encore d'évaluation
- Matiere Esprit JPDocument20 pagesMatiere Esprit JPMaxime CasinoPas encore d'évaluation
- La ConscienceDocument4 pagesLa Consciencebeebac2009100% (1)
- Fondement de La Distinction Des Sens Chez AristoteDocument6 pagesFondement de La Distinction Des Sens Chez AristotePLÉPas encore d'évaluation
- Méthode Intuitive Chez BergsonDocument24 pagesMéthode Intuitive Chez BergsonGKF1789Pas encore d'évaluation
- Chap 3 RésuméDocument9 pagesChap 3 RésuméEucharistie AbiPas encore d'évaluation
- Merleau Ponty AutruiDocument13 pagesMerleau Ponty AutruiJulien BeigbederPas encore d'évaluation
- ExtraitDocument8 pagesExtraitRudina PrevalPas encore d'évaluation
- La matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieD'EverandLa matière et l'esprit (Fiche notion): LePetitPhilosophe.fr - Comprendre la philosophieÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- Joie Et Liberté Chez Bergson Et Spinoza - Présentation de L'ouvrageDocument4 pagesJoie Et Liberté Chez Bergson Et Spinoza - Présentation de L'ouvrageMamadou Moustapha SarrPas encore d'évaluation
- Corps, Espace Vécu Et Thérapeutique Chez Ludwig Binswanger: DaseinanalyseDocument4 pagesCorps, Espace Vécu Et Thérapeutique Chez Ludwig Binswanger: DaseinanalyseSchwindenhammerPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 La Conscience Et L& #039 InconscientDocument12 pagesChapitre 1 La Conscience Et L& #039 Inconscientorianedatte28Pas encore d'évaluation
- Yram - de La Sphère de L'égo À La Super Sphère de L'etreDocument6 pagesYram - de La Sphère de L'égo À La Super Sphère de L'etreplolpPas encore d'évaluation
- 3 Philo Nasra 2020 2021 Theme n1 Le Sujet Chapitre n3 1 Linconscient Partie1 2Document6 pages3 Philo Nasra 2020 2021 Theme n1 Le Sujet Chapitre n3 1 Linconscient Partie1 2younesrahma03Pas encore d'évaluation
- Commentaire D'un Texte de BergsonDocument7 pagesCommentaire D'un Texte de BergsonNIBEDOU NZOUE MARTINPas encore d'évaluation
- Courssynthese Le TempsDocument5 pagesCourssynthese Le Tempsmavrinissue4Pas encore d'évaluation
- Dossier Sur La ConscienceDocument9 pagesDossier Sur La ConscienceShakespeare Wiliams Emile VictorPas encore d'évaluation
- Merleau-Ponty - Veronique Le Ru 2015Document16 pagesMerleau-Ponty - Veronique Le Ru 2015Désirée DompsinPas encore d'évaluation
- Les PersonnesDocument6 pagesLes PersonnesMouctar GUINDOPas encore d'évaluation
- Evideon 1 - Corrado Malanga FrançaisDocument44 pagesEvideon 1 - Corrado Malanga FrançaisC.O.M.A research -stopalienabduction-100% (1)
- Parler le langage de l'univers: Développement personnelD'EverandParler le langage de l'univers: Développement personnelPas encore d'évaluation
- Lewis Robinson L'IMMORTALITÉ SPINOZISTE 40897074Document26 pagesLewis Robinson L'IMMORTALITÉ SPINOZISTE 40897074Carlos PachecoPas encore d'évaluation
- Conscience Et IncoscienceDocument12 pagesConscience Et IncoscienceSarah LeyesPas encore d'évaluation
- Bergson - Essai Sur Les Données Immédiates de La ConscienceDocument105 pagesBergson - Essai Sur Les Données Immédiates de La ConscienceDante SimerPas encore d'évaluation
- Le Sens Du Temps Chez Saint AugustinDocument6 pagesLe Sens Du Temps Chez Saint AugustinaminickPas encore d'évaluation
- La ConscienceDocument6 pagesLa Consciencemzt5z6mpdcPas encore d'évaluation
- BRAGAGNOLO FLORINE La Liberté Radicale Chez Sartre, Une Lecture de La Transcendance de L'egoDocument43 pagesBRAGAGNOLO FLORINE La Liberté Radicale Chez Sartre, Une Lecture de La Transcendance de L'egoFlorine BragagnoloPas encore d'évaluation
- La Conscience - FicheDocument4 pagesLa Conscience - Fichebabette.rubbenPas encore d'évaluation
- Enchevêtrement quantique et inconscient collectif. Physique et métaphysique de l'univers. Nouvelles interprétations.D'EverandEnchevêtrement quantique et inconscient collectif. Physique et métaphysique de l'univers. Nouvelles interprétations.Pas encore d'évaluation
- Devoir 2BDocument5 pagesDevoir 2Bcharlottejerome85Pas encore d'évaluation
- Les Esprits de La Nature - 1Document12 pagesLes Esprits de La Nature - 1José Oscar BingoniPas encore d'évaluation
- Exercice 01Document2 pagesExercice 01sin paiiiPas encore d'évaluation
- Du Togo: Annales HydrologiquesDocument195 pagesDu Togo: Annales HydrologiquesOusman TouréPas encore d'évaluation
- Mémoire de Fin D'étude - Dimitri KABORE - Version Final CorrigéDocument76 pagesMémoire de Fin D'étude - Dimitri KABORE - Version Final CorrigéDimitri Kabore80% (5)
- Fonction Logarithme: Jean Neper (1550-1617)Document8 pagesFonction Logarithme: Jean Neper (1550-1617)ShawtyyPas encore d'évaluation
- Serie 2Document2 pagesSerie 2Aya MaallemPas encore d'évaluation
- Serie DynamiqueDocument2 pagesSerie DynamiqueNouradine BasbasPas encore d'évaluation
- C'Est Leur Domaine-PPBDocument114 pagesC'Est Leur Domaine-PPBbaumetPas encore d'évaluation
- Lerch 2022 EquimeetingDocument5 pagesLerch 2022 EquimeetingWafaa ZagharyPas encore d'évaluation
- Activite Chimie DI Dosage de La Vitamine CDocument15 pagesActivite Chimie DI Dosage de La Vitamine CTahraoui HafsaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Evaluation Des Besoins en Eau AEPDocument9 pagesChapitre 1 Evaluation Des Besoins en Eau AEPYassine GCPas encore d'évaluation
- Progression Maths 6èmeDocument2 pagesProgression Maths 6èmeClotilde CrosPas encore d'évaluation
- Lessentiel de La Photo Un Guide Pour Comprendre Le Triangle de Lexposition Et Les Modes de Votre Appareil Photo by Nicolas CroceDocument111 pagesLessentiel de La Photo Un Guide Pour Comprendre Le Triangle de Lexposition Et Les Modes de Votre Appareil Photo by Nicolas Crocejose100% (1)
- These: République Algérienne Démocratique Et PopulaireDocument109 pagesThese: République Algérienne Démocratique Et PopulaireLÿ DîePas encore d'évaluation
- Exposé Global WarmingDocument31 pagesExposé Global Warmingaman.niamkey19Pas encore d'évaluation
- Saison 2021-2022Document6 pagesSaison 2021-2022ElzaSokoPas encore d'évaluation
- Exo-Energie EolienneDocument2 pagesExo-Energie EolienneOmar MenichiPas encore d'évaluation
- Barrier Philippe, Le Corps Malade, Le Corps TémoinDocument23 pagesBarrier Philippe, Le Corps Malade, Le Corps TémoinRadu TomaPas encore d'évaluation
- PARCW FinalDocument22 pagesPARCW FinalcocoPas encore d'évaluation
- Projet À Microcontrôleur PIC 16F876ADocument12 pagesProjet À Microcontrôleur PIC 16F876Aهشام هشام المسيلة0% (1)
- Raport de Stage CirmaDocument88 pagesRaport de Stage CirmaELSAPas encore d'évaluation
- Descriptifs Maquette L3 2017-2018Document33 pagesDescriptifs Maquette L3 2017-2018robert kamba mukediPas encore d'évaluation
- 1ère C Maths CC N°1 Sept 2023 PDFDocument2 pages1ère C Maths CC N°1 Sept 2023 PDFEyid'a Ngangue IsaccPas encore d'évaluation
- Cours RheologieDocument18 pagesCours RheologieAbdelkrim KhlPas encore d'évaluation
- BTS M S P NouveauDocument99 pagesBTS M S P NouveauAbi ClémentPas encore d'évaluation
- Cours 2 Biologie VégétaleDocument58 pagesCours 2 Biologie VégétaleIliass NaouadirPas encore d'évaluation
- Cordee TP Info 1 3Document5 pagesCordee TP Info 1 3Kenzy SadaouiPas encore d'évaluation
- Atomistique Ex CorDocument2 pagesAtomistique Ex Coramirtrk80100% (1)
- Sans Nom 1Document3 pagesSans Nom 1api-646094222Pas encore d'évaluation