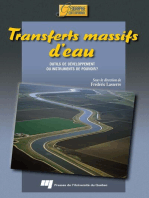Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Pont Initial, Ouvrages D'art
Pont Initial, Ouvrages D'art
Transféré par
maxime CLOTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Pont Initial, Ouvrages D'art
Pont Initial, Ouvrages D'art
Transféré par
maxime CLODroits d'auteur :
Formats disponibles
REPUBLIQUE DU BENIN
*********
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE (MESRS)
*********
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (UAC)
*********
ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI (EPAC)
*********
DEPARTEMENT DE GENIE CIVIL (D/GC)
*********
ANNEE D’ETUDE : 4ième année d’Ingénierie Civile
THEME : GENERALITES SUR LES OUVRAGES D’ART
Matière : PONT INITIAL
Réalisé et soutenu par : Enseignant
AÏDEKON Ernest Dr. DOKO Valéry
ARIORI Julienne
CLO Maxime
DOVONOU Merveille
DEGNON Aristide
ERIOLA Mendel
MAMADOU Halissou
TOSSA Eliab
YADODE Petrick
Année académique 2023-2024
Généralités sur les ouvrages d’art 1
SOMMAIRE
SOMMAIRE ................................................................................................ 2
Table des illustrations................................................................................... 3
INTRODUCTION ........................................................................................ 4
I. Définition et Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art .................... 5
A. Définition des Ouvrages d’Art ............................................................. 5
B. Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art ...................................... 6
II. Fonctions et Familles des Ouvrages d’Art ..........................................11
A. Fonctions des Ouvrages d’Art ............................................................11
B. Famille des Ouvrages d’Art ................................................................11
III. Ouvrages d’art de franchissement......................................................13
A. Pont.....................................................................................................13
B. Tunnel.................................................................................................17
C. Ecran acoustique ................................................................................22
IV. Ouvrages d’art de protection et de soutènement ................................24
A. Murs de soutènement..........................................................................24
V. Ouvrages d’art de retenues d’eau..........................................................32
A. Barrages .............................................................................................32
B. Digues .................................................................................................37
VI. Autres ouvrages d’art .........................................................................40
A. Quais...................................................................................................40
B. Réservoir ............................................................................................42
VII. Contraintes et Enjeux dans la construction des Ouvrages d’Art........44
VIII. Maintenance des Ouvrages d’Art ....................................................46
IX. Technologie Innovante dans la réalisation des Ouvrages d’Art :
Impression 3D .............................................................................................47
CONCLUSION ...........................................................................................50
Table des matières .......................................................................................51
Généralités sur les ouvrages d’art 2
Table des illustrations
Image 1 Les cinq familles de ponts ................................................................15
Image 2 Différentes parties d’un pont ............................................................16
Image 3 Ecoduc ............................................................................................18
Image 4 Tunnel hélicoîdal .............................................................................19
Image 5 Tunnel de base du Saint-Gothard ......................................................20
Image 6 Quelques exemples d’écrans acoustiques ..........................................24
Image 7 Mur-Poids .......................................................................................27
Image 8 Mur en béton armé sur semelle ........................................................28
Image 9 Rideau de palplanches métalliques ...................................................28
Image 10 Paroi moulée .................................................................................29
Image 11 Paroi berlinoise..............................................................................29
Image 12 Paroi ancrée...................................................................................30
Image 13 Paroi clouée...................................................................................30
Figure 14 Paroi en remblai renforcé avec des gabions ....................................31
Image 15 Quelques images de barrages..........................................................33
Image 16 Quelques image de digues ..............................................................38
Figure 17 Quelques images de quais ..............................................................41
Image 18 Quelques images de chateaux d’eau ................................................43
Figure 19 Exemple d’un passage piéton réalisé avec l’imprimante 3D ............49
Généralités sur les ouvrages d’art 3
INTRODUCTION
Au cœur de nos paysages urbains et naturels, les ouvrages d'art se
dressent comme des symboles de progrès et d'ingéniosité. Leur
présence discrète ou imposante témoigne de la capacité de l'homme à
défier les contraintes de la nature et à créer des liaisons vitales pour le
développement des sociétés. Dans cet exposé, nous plongerons dans
l'univers captivant des ouvrages d'art, explorant leur diversité et leur
fonctionnement. Nous aborderons également les contraintes et enjeux à
prendre en compte dans la réalisation des ouvrages d’art.
Généralités sur les ouvrages d’art 4
I. Définition et Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art
A. Définition des Ouvrages d’Art
Pour élaborer des routes, on rencontre différents obstacles tels que les oueds ou
rivières, les montagnes, les chemins de fer et les autres routes. Pour les franchir,
on construit les ouvrages artificiels qui portent le nom : Ouvrages d’Art. Ce terme
est composé de deux mots:
« Ouvrages » indiquant les constructions
« Art » indiquant l’importance de l’aspect esthétique et architectural dans
ces constructions.
Un ouvrage d’art peut être qualifié selon le milieu dans lequel il est construit de :
ouvrage d’art terrestre
ouvrage maritime
ouvrage d’art de montagne
ouvrage d’art fluvial.
Le rôle des ouvrages d'art dans l'ingénierie civile est multiple :
Franchissement d'obstacles
Les ouvrages d'art permettent de franchir des obstacles naturels ou artificiels qui
pourraient autrement bloquer ou perturber les voies de circulation. Par exemple,
un pont permet de traverser une rivière ou une vallée, tandis qu'un tunnel permet
de passer à travers une montagne.
Généralités sur les ouvrages d’art 5
Connectivité du réseau routier et ferroviaire
Les ouvrages d'art sont des éléments clés du réseau routier et ferroviaire, en
assurant la continuité des routes, autoroutes, voies ferrées, etc. Ils facilitent la
circulation des véhicules et des trains sur de longues distances.
Amélioration de la sécurité
Les ouvrages d'art contribuent à rendre les déplacements plus sûrs en offrant des
solutions d'infrastructure sécurisées et efficaces. Par exemple, des ponts bien
conçus assurent la stabilité des routes et des chemins de fer, réduisant ainsi les
risques pour les usagers.
Développement économique
Les ouvrages d'art favorisent le développement économique en facilitant le
transport des biens et des services. Ils ouvrent des régions éloignées au commerce
et aux échanges, ce qui stimule l'activité économique et favorise la croissance
régionale.
Impact environnemental
Les ouvrages d'art peuvent également avoir un impact sur l'environnement en
modifiant les écosystèmes naturels. Il est important de prendre en compte les
considérations environnementales lors de la conception et de la construction de
ces structures pour minimiser leur impact sur la nature.
B. Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art
L'histoire des ouvrages d'art est un récit fascinant qui retrace l'évolution des
prouesses techniques et de la créativité humaine face aux défis de franchir des
obstacles naturels et d'aménager le territoire. La chronologie ci-dessous met en
lumière l'évolution des ouvrages d'art en génie civil à travers les âges, depuis les
Généralités sur les ouvrages d’art 6
premières réalisations de l'Antiquité jusqu'aux projets ambitieux et
technologiquement avancés d'aujourd'hui.
Les premiers ouvrages d'art connus remontent à la Préhistoire, où des
constructions rudimentaires en bois et en pierre servaient à franchir des cours
d'eau ou des dénivelés de terrain.
A l’Antiquité, l’on a assisté à l’essor architectural et technique avec les premiers
exemples d'ouvrages. En effet, les civilisations anciennes comme les Égyptiens,
les Grecs et les Romains ont construit des ponts, des aqueducs, des tunnels et des
routes pavées pour faciliter le commerce, le transport et l'approvisionnement en
eau. Ainsi :
De 2600 av. J.-C. à 2500 av. J.-C. : Les Égyptiens ont construit le premier
barrage connu, le barrage de Sadd-el-Kafara, pour retenir l'eau du Nil
pendant la saison sèche.
De 753 av. J.-C. à 476 ap. J.-C. : Les Romains ont construit un vaste réseau
d'aqueducs pour transporter l'eau vers les villes, dont l'aqueduc du Pont du
Gard, achevé vers 50 après J.-C.
De 312 av. J.-C. à 63 av. J.-C. : Les Romains ont développé des techniques
avancées de construction de routes pavées, connues sous le nom de
"chaussées romaines", pour faciliter le commerce et le mouvement des
troupes.
De 100 av. J.-C. à 44 av. J.-C. : La construction du pont de César à Rome,
en 54 av. J.-C., a marqué l'utilisation généralisée de l'arc en plein cintre
dans la construction de ponts.
De 112 à 113 : Les Romains ont construit le pont de Trajan à Alcantara, en
Espagne, l'un des plus anciens ponts romains encore en service aujourd'hui.
Généralités sur les ouvrages d’art 7
Pendant le Moyen Âge, les techniques de construction ont été influencées par les
avancées techniques et les besoins des sociétés médiévales. Le Moyen Âge a
connu une période de ralentissement dans la construction d'ouvrages d'art, mais a
également vu l'émergence de nouvelles techniques et d'adaptations aux
contraintes du terrain. Des châteaux forts, par exemple, étaient souvent dotés de
ponts-levis et de fortifications complexes. Des ponts en arc et des murailles de
protection ont également été construits pour des raisons militaires et défensives.
Ainsi :
De 1000 à 1500 : De nombreux châteaux forts et les fortifications urbaines
ont érigé à travers toute l'Europe en raison des nombreuses guerres qui se
déroulaient au cours de cette période.
De 1410 à 1439 : Filippo Brunelleschi a construit le dôme de la cathédrale
Santa Maria del Fiore à Florence, en Italie, utilisant des techniques de
construction révolutionnaires qui influenceront le génie civil pendant des
siècles.
La Renaissance a vu un renouveau dans les arts et les sciences, ce qui a conduit
à des avancées significatives dans le domaine du Génie Civil. Des architectes et
des ingénieurs comme Leonardo da Vinci ont conçu des structures innovantes, et
les ponts en arc ont été perfectionnés. L'utilisation de nouveaux matériaux comme
la brique et la pierre taillée, ainsi que l'adoption de techniques innovantes comme
la voûte en berceau et l'arc-boutant, ont permis de réaliser des structures plus
hautes, plus élégantes et plus résistantes. C’est ainsi que de 1761 à 1772, l’on
assiste à la construction du pont de Menai au Pays de Galles. Ce pont a été conçu
par Thomas Telford, faisant de ce pont le premier pont en fer suspendu majeur au
monde.
Généralités sur les ouvrages d’art 8
La Révolution Industrielle a révolutionné le domaine du Génie Civil. L'ère
industrielle a marqué un tournant décisif dans l'histoire des ouvrages d'art.
L'invention de la machine à vapeur et l'utilisation croissante du fer et de l'acier ont
ouvert la voie à des constructions d'une ampleur et d'une complexité sans
équivalent auparavant. Les ponts suspendus, les viaducs ferroviaires et les tunnels
ont transformé les réseaux de transport et permis de relier des régions auparavant
inaccessibles.
De 1800 à 1850 : La Révolution industrielle entraîne l'utilisation
généralisée du fer et de l'acier dans la construction de ponts et de bâtiments.
En 1883 : Le pont de Brooklyn à New York, conçu par John Augustus
Roebling, est achevé. Il s'agit du premier pont suspendu en acier au monde.
En 1937 : Le pont du Golden Gate à San Francisco est achevé. Avec sa
longueur de 2,7 kilomètres, il devient l'un des ponts les plus emblématiques
au monde.
En 1959 : La construction du pont sur le détroit de Messine, en Italie, est
proposée pour la première fois. Bien que le projet ne soit pas encore réalisé,
il reste l'un des projets d'ingénierie les plus ambitieux au monde.
Aux XXe et le XXIe siècles, les avancées technologiques telles que le béton armé
et l'acier précontraint ont permis la construction de structures encore plus
audacieuses avec l’émergence d'ouvrages d'art toujours plus vertigineux et
durables. Les gratte-ciel, les ponts à haubans et les tunnels sous-marins sont des
exemples qui ont fait repousser les limites de l'ingénierie et de l'architecture. La
préoccupation croissante pour le développement durable a également conduit à la
conception d'ouvrages d'art plus respectueux de l'environnement et intégrant des
technologies innovantes pour réduire leur impact sur l'environnement.
Généralités sur les ouvrages d’art 9
En 2009, l'inauguration du pont de la baie de Hangzhou en Chine marque
l'achèvement du pont à haubans le plus long du monde, avec une portée principale
de 1 088 mètres.
Généralités sur les ouvrages d’art 10
II. Fonctions et Familles des Ouvrages d’Art
A. Fonctions des Ouvrages d’Art
Les ouvrages d'art sont des structures de Génie Civil conçues pour permettre le
franchissement d'obstacles naturels ou artificiels tels que des cours d'eau, des
vallées, des routes, des chemins de fer, ou d'autres infrastructures. Ces structures
sont essentielles pour assurer la continuité des voies de communication et faciliter
les déplacements des personnes et des biens. La fonction d'un ouvrage d'art est
liée à la fonction de la voie de communication à laquelle il est lié :
un ouvrage d'art routier supporte une route,
un ouvrage d'art autoroutier supporte une autoroute, qu'il s'agisse de la voie
principale ou d'une bretelle de raccordement à l'autoroute,
un ouvrage d'art ferroviaire supporte une voie ferrée.
NB : Les voies navigables, canalisations d'eau (aqueducs) ou d'autres fluides ne
donnent pas lieu à la définition d'une typologie spécifique à ces voies.
B. Famille des Ouvrages d’Art
Selon leur fonctionnalité et l’objectif symbolique ou esthétique on distingue :
Les ouvrages d’art fonctionnels, tels que les ponts, les tunnels et les
barrages qui ont pour but de franchir des obstacles physiques et de faciliter
la circulation ou la gestion de ressources.
Les ouvrages d’art non fonctionnels ou décoratifs comme les statues, les
monuments commémoratifs et les sculptures décoratives qui sont
principalement érigés à des fins esthétiques, symboliques ou
commémoratifs, enrichissant ainsi le paysage urbain et reflétant l’histoire
et la culture d’une société.
Généralités sur les ouvrages d’art 11
Dans la catégorie des ouvrages d’art fonctionnels, on distingue selon leur nature
et leur rôle :
Les ouvrages de franchissement ou lié à des voies de communications :
pont, tunnel, écran acoustique.
Les ouvrages de protection ou de soutènement : destiné à la stabilisation
des pentes ou des soutènements des terres afin de se prémunir des effets des
mouvements des terres (écroulements, glissements, coulées des boues):
mur de soutènement, rideaux de palplanche, parois moulé, clouage de
massif.
Les ouvrages de retenues d’eau : barrage (en béton ou en terre et
enrochements), digues (remblais longitudinaux naturels ou artificiels).
Les autres ouvrages d’arts : tranchée ouverte ou couverte, quais,
réservoir, structure paré-pierre ou paré-bloc.
Généralités sur les ouvrages d’art 12
III. Ouvrages d’art de franchissement
A. Pont
Un pont est un ouvrage d'art qui permet de franchir un obstacle naturel ou artificiel
(dépression, cours d'eau, voie de communication, vallée, ravin, canyon) en
passant par-dessus. Le franchissement supporte le passage d'humains et de
véhicules dans le cas d'un pont routier, ou d'eau dans le cas d'un aqueduc.
1. Classes de ponts
Des critères spécifiques conduisent à définir un type de pont. Le matériau utilisé
est un des critères de différenciation commun à l’ensemble des ponts. La
conception, la construction, la surveillance et l'entretien diffèrent selon le
matériau. Chaque type de pont est adapté à une plage de portée, les ponts
suspendus permettant les plus grandes portées.
On distingue 05 classes de ponts sont définies selon leur structure:
les ponts voûtés
les ponts à poutres
les ponts en arc
les ponts suspendus
les ponts haubanés.
Généralités sur les ouvrages d’art 13
Généralités sur les ouvrages d’art 14
Image 1 Les cinq familles de ponts
2. Différentes parties d’un pont
Un pont comprend trois parties distinctes:
le tablier, structure sur laquelle se fait le déplacement à niveau ou avec une
pente suffisamment faible pour être admissible par des piétons, des
animaux ou des véhicules (automobiles, trains, avions, etc.) entre ses deux
extrémités. Le tablier comprend une ou des travées qui sont des parties du
pont comprises entre les piles ou entre une pile et une culée. Dans le cas
Généralités sur les ouvrages d’art 15
des ponts suspendus et des ponts à haubans, le tablier est soutenu par des
suspentes ou des haubans accrochés à des pylônes ;
les appuis qui supportent le tablier : culées aux deux extrémités et piles
intermédiaires ou piles-culées si le tablier n'est pas continu ;
les fondations qui permettent la transmission des efforts de l'ouvrage au
terrain.
Image 2 Différentes parties d’un pont
Généralités sur les ouvrages d’art 16
B. Tunnel
Un tunnel est un ouvrage d’art linéaire souterrain ouvert à la circulation routière
ou ferroviaire. Pour les ouvrages hydrauliques (adduction d’eau, égouts), les
ouvrages de petite section (galeries de reconnaissance, passages de câbles), le
terme galerie est le plus souvent employé. Ceci dit un ouvrage souterrain utilisé
par les piétons est un passage souterrain.On considère souvent qu’un tunnel doit
être plus long qu’il n’est large, doit être fermé de tous les côtés excepté à chacune
de ses extrémités.
1. Possibles fonctions des tunnels
Un tunnel peut être utilisé pour permettre le passage de personnes : piétons,
cyclistes, trafic routier, trafic ferroviaire, péniches (canal en tunnel) ou
navires de plaisance et de trafic maritime.
D'autres tunnels avaient fonction d'aqueduc, construits uniquement pour
transporter de l'eau — destinée à la consommation, à l'acheminement des
eaux usées ou à l'alimentation de barrages hydroélectriques — alors que
d'autres encore sont creusés pour acheminer des câbles de
télécommunication, de l'électricité, des hydrocarbures.
Quelques tunnels secrets ou stratégiques ont été également construits à des
fins militaires pour pénétrer des secteurs interdits, comme les tunnels de Củ
Chi au Viêt Nam, les tunnels reliant la bande de Gaza en Israël, ou les tunnels
de sape destinés à affaiblir des fortifications ou les murailles de châteaux.
2. Cas particuliers de types de tunnels
Il existe aujourd'hui des écoducs, tunnels spécifiquement destinés à
permettre à des espèces menacées de traverser des routes sans danger. On
désigne également comme écoduc ou écopont (par exemple : les
écuroducs), des passages construits ou « réservés » dans un milieu
aménagé, pour permettre aux espèces animales, végétales, fongiques, etc.
Généralités sur les ouvrages d’art 17
de traverser des obstacles construits par l'être humain ou résultant de ses
activités.
Image 3 Ecoduc
Un tunnel hélicoïdal est construit en spirale à l'intérieur de la montagne, il
permet un dénivelé important sur une très courte distance apparente (la sortie
se fait souvent à l'aplomb de l'entrée).
Généralités sur les ouvrages d’art 18
Image 4 Tunnel hélicoîdal
Les tunnels à grande profondeur sont des tunnels franchissant des massifs
montagneux à une altitude peu élevée (d'où le qualificatif de tunnel de base).
Ce sont des tunnels ferroviaires qui présentent l'avantage de supprimer les
rampes d'accès aux tunnels traditionnels qui franchissaient les massifs
montagneux à haute altitude, de simplifier le tracé en permettant des vitesses
beaucoup plus élevées.
Le plus long tunnel du monde, le tunnel de base du Saint-Gothard a été percé sous
le massif du Saint-Gothard en Suisse entre Erstfeld et Bodio: long de 57 km, il
comporte deux tubes parallèles. Le percement du premier tube a été achevé le 15
octobre 2010, et le second au printemps 2011. Ce tunnel mis en service en juin
2016 relie Zurich à Milan en 2h40 pour les trains de passagers qui peuvent y
circuler à 250 km/h; les trains de marchandises roulent à 160 km/h.
Généralités sur les ouvrages d’art 19
Image 5 Tunnel de base du Saint-Gothard
3. Méthodes de construction
Il existe plusieurs méthodes de construction d'un tunnel. La méthode est choisie
en prenant en compte les caractéristiques du terrain à creuser (notamment roches
tendres/dures), de la géométrie de l'ouvrage (longueur, profondeur, tunnel sous -
marin), le contexte (tunnel sous des constructions) ainsi que des contraintes
géologiques (failles…) et hydrogéologiques (nappes phréatiques). Les quatre
principales méthodes sont:
Creusement à l'explosif (dans un terrain rocheux)
Creusement par attaque ponctuelle (dans un terrain rocheux)
Creusement par prédécoupage mécanique (dans un terrain difficile)
Creusement à l'aide d'un tunnelier (dans un terrain difficile)
Généralités sur les ouvrages d’art 20
4. Autres modes de construction
Tunnels réalisés par emboitement à poussée hydraulique
Ce mode de construction consiste à insérer dans le terrain des sections de tunnels
en béton préfabriqués qui sont poussés à l'aide d'un système hydraulique. Cette
méthode est utilisée lorsque le tunnel est court (quelques centaines de mètres au
maximum) et peu profond et que la surface au-dessus du tunnel est occupée par
des routes, des voies ferrées ou des pistes d'aéroport dont le trafic ne peut être
interrompu.
Tunnel sous-marin
Il existe plusieurs méthodes permettant de construire un tunnel sous-marin.
Lorsque la solution d'un pont n'a pu être retenue, on utilise souvent la technique
des tunnels préfabriqués au sec et immergés. Cette méthode consiste à pré-
fabriquer le tunnel en plusieurs tronçons plus ou moins longs à l'air libre et au sec
dans une forme de radoub improvisée pour le chantier. Ces sections de tunnels
sont réalisées en béton armé, en béton précontraint ou en acier rempli de béton.
Leurs extrémités sont rendues étanches puis ils sont déplacés par flottaison jusqu'à
l'endroit où ils doivent être placés. Ils sont alors immergés et jointoyés avec
l'élément déjà en place.
Le tunnel du Seikan, tunnel sous-marin de 53,850 km qui relie les îles de Honshū
et de Hokkaidō au Japon, a été le plus long tunnel ferroviaire du monde jusqu'à la
mise en service du tunnel de base du Saint-Gothard en juin 2016.
Le tunnel sous la Manche entre la France et le Royaume-Uni fait 50,450 km.
À titre de curiosités, on peut citer les tunnels du CERN (Centre européen de
recherche nucléaire), accueillant les accélérateurs de particules Super Proton
Synchrotron (SPS) et Large Hadron Collider (LHC), tous deux situés au niveau
de la frontière franco-suisse, à proximité de Genève. Ils présentent la particularité
Généralités sur les ouvrages d’art 21
de former chacun un anneau (d’une circonférence de sept kilomètres pour le SPS
et de 26,66 kilomètres pour le LHC), et de fait ils ne possèdent aucune extrémité
et ne débouchent jamais à la surface. On y accède via des puits verticaux ou des
galeries de service.
C. Ecran acoustique
Un mur anti-bruit, appelé aussi écran anti-bruit ou écran acoustique, est une
structure extérieure, solide, destinée à développer un effet d'isolation phonique. Il
est habituellement construit le long d'infrastructures proches d'habitations et
sources de nuisances sonores telles que:
les grandes routes, voies périphériques ;
les voies ferrées (TGV notamment) ;
les voies autoroutières ;
les infrastructures portuaires ou aéroportuaires et les sites industriels
bruyants.
Ils ont pour rôle de diminuer la pollution sonore causée par ces sources de
nuisances sonores. Le bruit est considéré comme une source importante de stress,
voire de troubles graves du sommeil et de la santé.
Ces murs (ou talus de terre végétalisée) font généralement une dizaine de mètres
de haut. Quand il s'agit de murs, ils sont souvent parsemés de portes de
maintenance. Dans le meilleur des cas, la voie « bruyante » est entièrement
recouverte (tranchée couverte, tunnel), mais cette situation est plus coûteuse. Elle
permet aussi parfois de supprimer un effet de fragmentation écologique (au droit
d'un écoduc par exemple). Certains de ces ouvrages peuvent être provisoires (le
temps d'un chantier urbain de longue durée par exemple).
Généralités sur les ouvrages d’art 22
Généralités sur les ouvrages d’art 23
.
Image 6 Quelques exemples d’écrans acoustiques
IV. Ouvrages d’art de protection et de soutènement
A. Murs de soutènement
Le mur de soutènement ou ouvrage de soutènement est un mur vertical ou sub-
vertical qui permet de créer un dénivelé entre des terres. La retenue des terres par
un mur de soutènement répond à des besoins multiples : aménagement des terrains
en pente pour des cultures en terrasses, préservation des routes et bâtiments en
contrebas des terres, maintien des terres dans le cas de digues ou quais ou soutien
provisoire ou permanent des fouilles et tranchées de chantier.
Depuis quelques décennies, les parois préfabriquées se sont largement substituées
aux murs en béton coulé sur place et aux murs en maçonnerie appareillée, parce
Généralités sur les ouvrages d’art 24
qu'elles sont meilleur marché, plus rapides et plus faciles à mettre en œuvre, et
plus favorables à l'environnement.
1. Principe de dimensionnement
La principale considération dans le dimensionnement des soutènements, quel que
soit leur type, est la correcte estimation des efforts exercés sur le mur couramment
appelée poussée des terres. Des charges d'exploitations, comme la présence de
véhicules, peuvent également s'exercer en amont du mur. Pour combattre cette
poussée des terres, le mur peut être constitué de différentes façons:
Opposer un poids supérieur à la partie remplacée en contre-balancement de
la poussée : tels sont les murs poids ;
Être ancré dans un corps mort fournissant une inertie ou ancré plus loin
dans le sol à proximité qui ne fait pas partie de l'ensemble susceptible de
glissement ou a une meilleure composition afin que la poussée soit
contenue, éviter le glissement et annuler le moment de basculement: ce sont
les parois ancrées ;
Résister au basculement par une semelle insérée sous les terres, semelle de
surface de base en rapport avec la hauteur fournissant le moment de
renversement : murs Cantilever (en L) ;
Réduire la poussée par un épaulement des terres retenues entre deux
contreforts: murs à redans.
2. Différents types de murs de soutènement
Les ouvrages de soutènement sont classés en huit grandes familles, qui ont des
morphologies, matériaux, dimensionnement, modes d'exécution et domaines
d'application différents:
Généralités sur les ouvrages d’art 25
Le mur-poids, qui peut-être en pierres sèches, pierres jointoyées, en béton,
en gabion ou en éléments empilés de béton préfabriqué
Le principe du mur-poids, aussi appelé mur gravitaire, est d'opposer le poids de
la maçonnerie du soutènement à la poussée des terres. Celle-ci étant minimale au
sommet du mur et croissante avec la profondeur, le mur-poids s'épaissit vers la
base, en présentant un fruit (la partie inclinée est à l'extérieur du mur) ou un
contre-fruit (la partie inclinée est côté terre).
Généralités sur les ouvrages d’art 26
Image 7 Mur-Poids
Le mur en béton armé sur semelle
Le mur de soutènement en béton armé, également appelé mur cantilever, est
constitué d'un voile de béton armé encastré dans une semelle également en béton
armé, formant généralement une structure en forme de T renversé ou de L. L'avant
de la semelle, côté aval, est appelé patin et l'arrière, côté terre, est appelé talon. Le
talon peut être pourvu d'une bêche pour éviter le glissement. Des variantes
peuvent inclure des contreforts côté aval ou amont, l'usage de pieux ou des tirants
d'ancrage. La structure peut soit être coulée en place, soit être préfabriquée, soit
comprendre des éléments préfabriqués et coulés en place.
Généralités sur les ouvrages d’art 27
Image 8 Mur en béton armé sur semelle
Rideau de palplanches métalliques
Image 9 Rideau de palplanches métalliques
Généralités sur les ouvrages d’art 28
La paroi moulée
Image 10 Paroi moulée
La paroi composite, dont les parois parisiennes ou berlinoises
Image 11 Paroi berlinoise
Généralités sur les ouvrages d’art 29
Les voiles et poutres ancrés
Image 12 Paroi ancrée
La paroi clouée
Image 13 Paroi clouée
Généralités sur les ouvrages d’art 30
Les ouvrages en remblai renforcés par des éléments métalliques ou
géosynthétiques.
Figure 14 Paroi en remblai renforcé avec des gabions
Généralités sur les ouvrages d’art 31
V. Ouvrages d’art de retenues d’eau
A. Barrages
Un barrage est un ouvrage d'art hydraulique construit en travers d'un cours d'eau
et destiné à en réguler le débit et/ou à stocker de l'eau, notamment pour le contrôle
des crues, l'irrigation, l'industrie, l'hydroélectricité, la pisciculture et la retenue
d'eau potable.
Généralités sur les ouvrages d’art 32
Image 15 Quelques images de barrages
Généralités sur les ouvrages d’art 33
1. Types de barrages
Barrage poids
Un barrage poids est un barrage dont la propre masse suffit à s'opposer à la
pression exercée par l'eau. Ce sont des barrages souvent relativement épais, dont
la forme est généralement simple (leur section s'apparente dans la plupart des cas
à un triangle rectangle). On compte deux grandes familles de barrages-poids, les
barrages poids-béton, et les barrages en remblai (ces derniers n'étant d'ailleurs
généralement pas qualifiés de barrage-poids, mais de barrage en remblai).
Barrage en remblai
On appelle barrages en remblai tous les barrages constitués d'un matériau meuble,
qu'il soit fin ou grossier (enrochements). Le barrage homogène est un barrage en
remblai construit avec un matériau suffisamment étanche (argile, limon). C'est la
technique la plus ancienne pour les barrages en remblai.
Barrage voûte
La technique de barrage-voûte nécessite une vallée plutôt étroite (même si des
barrages-voûtes ont été parfois construits dans des vallées assez larges, poussant
cette technologie à ses limites) et un bon rocher de fondation.
Barrage à contreforts
Lorsque les appuis sont trop distants, ou lorsque le matériau local est tellement
compact qu'une extraction s'avère presque impossible, la technique du barrage à
contreforts permet de réaliser un barrage à grande économie de matériaux.
Barrage multivoûtes
Le mur plat ou multivoûtes (Vezins, Migoëlou ou Bissorte) en béton s’appuie sur
des contreforts en béton armé encastrés dans la fondation, qui reportent la poussée
de l’eau sur les fondations inférieures et sur les rives.
Généralités sur les ouvrages d’art 34
Barrages mobiles à aiguilles
Le barrage mobile ou à niveau constant, a une hauteur limitée ; il est généralement
édifié en aval du cours des rivières, de préférence à l’endroit où la pente est la
plus faible. On utilise généralement ce type de barrage dans l’aménagement des
estuaires et des deltas.
Barrages à vannes mobiles
Barrage mobile à vanne-toit : la vanne-toit est formée d'un caisson ballastable,
articulé autour d’une charnière fixée sur un radier creux en béton armé.
2. Catégories de barrages
Barrages écrêteurs de crues
Certains barrages sont construits dans le but exclusif de stocker une partie du
volume des crues, pour limiter le risque d'inondation.
Barrage simple
Le barrage simple, peu élevé, est construit sur une rivière ou à l'entrée/la sortie
d'un lac pour réguler le niveau de l'eau en amont.
Barrage alluvial
Le barrage alluvial est une retenue créée par l'accumulation de sédiments et
d'alluvions, qui bloquent le canal d'un ruisseau.
Barrage filtrant
Structure construite sur un canal d'alimentation, généralement à son extrémité en
amont. Le matériau de filtration est composé de pierres et de graviers.
Généralités sur les ouvrages d’art 35
Barrage souterrain
Le barrage souterrain est une barrière verticale et imperméable visant à collecter
l'eau souterraine d'un cours d'eau éphémère en l'interceptant. Il est construit en
travers du lit d'une rivière à sec et comblée de sable, sur une digue rocheuse en
saillie.
Barrage régulateur
Le barrage régulateur est un petit ouvrage construit en travers d'une ravine ou d'un
petit cours d'eau à des endroits permettant de contrôler le niveau de l'eau en amont
et de régulariser l'écoulement vers l'aval.
Barrage perméable
Le barrage perméable est construit en travers du fond d'une vallée, pour réduire
les débits de crue en étalant l'eau sur une plus grande superficie. C'est un long
ouvrage fait d'accumulation de pierres.
3. Techniques de construction
Un barrage est soumis à plusieurs forces. Les plus significatives sont :
la pression hydrostatique exercée par l'eau sur son parement exposé à la
retenue d'eau
les sous-pressions (poussée d'Archimède), exercées par l'eau percolant dans
le corps du barrage ou la fondation
les éventuelles forces causées par l'accélération sismique.
Pour résister à ces forces, deux stratégies sont utilisées :
construire un ouvrage suffisamment massif pour résister par son simple
poids, qu'il soit rigide (barrage-poids en béton) ou souple (barrage en
remblai)
Généralités sur les ouvrages d’art 36
construire un barrage capable de reporter ces efforts vers des rives ou une
fondation rocheuse résistantes (barrage voûte, barrage à voûtes multiple)
B. Digues
Une digue est un ouvrage d'ingénierie hydraulique destiné à faire obstacle aux
eaux. Constituée d'un remblai longitudinal (le plus souvent composé de terre), de
nature artificielle ou d'une accumulation de sédiments (digue naturelle), elle
forme un « ouvrage continu sur une certaine longueur » qui empêche la
submersion des basses-terres par les eaux d'un lac, d'une rivière ou de la mer,
protège les côtes de l'érosion marine ou régularise un cours d'eau et protège ses
rives. L'influence des digues sur les systèmes fluviaux est similaire à celle des
levées.
Généralités sur les ouvrages d’art 37
Image 16 Quelques image de digues
1. Les grands types de digues
On peut distinguer:
Les digues de protection contre les crues et intrusions marines. Parfois aussi
nommées levées, elles sont situées dans le lit majeur de certains cours d'eau,
parallèles aux berges, pour contenir les eaux à l'extérieur des digues. En
France, les digues situées sur les cours d'eau dits domaniaux sont dites
digues domaniales. Les remblais composant des barrages sont parfois
appelés digues (exemple: digue d'étang), mais pour éviter toute confusion,
il n'est pas recommandé d'employer le mot digue pour désigner un ouvrage
transversal qui barre un cours d'eau.
Généralités sur les ouvrages d’art 38
Les digues portuaires, plus ou moins longues faisant office d'écran aux
vagues, sont appelés brise-lames. N'ayant qu'une fonction de protection
contre les vagues et courants de marée, elles n'ont pas vocation à être
étanches. Certaines digues sont basses et constituées de blocs de pierre ou
de béton qui atténuent les vagues sans empêcher l'eau d'y circuler, les
digues minières de résidus ou sont stockées des quantités énormes de
déchets sous forme de boues (sulfuré…) provenant de l'extraction de
différents métaux (or, aluminium, fer, argent, plomb, zinc).
Les digues dites « à bermes reprofilables »; ce sont des digues marines
conçues pour que la houle puisse les remodeler, de manière à atteindre un
profil en S plus stable.
Les digues dites « écologiques »; conçues pour limiter ou en partie
compenser leur impact écologique. Ce sont par exemple des lignes de
défenses (côtières ou fluviales) auxquelles on a intégré une vocation de
récif artificiel, de support de faune et algues marines ou de filtration ou
amélioration de la qualité de l'eau, et/ou un intérêt éco-touristique. Elles
peuvent faire partie d'un dispositif compensateur de perte ou fragmentation
d'habitats littoraux ou sédimentaires. Elles peuvent s'intégrer dans une
trame verte et bleue ou une trame bleu marine. Des études visent à mieux
comprendre comment elles peuvent contribuer à réduire ou compenser des
impacts d'endiguements.
Généralités sur les ouvrages d’art 39
VI. Autres ouvrages d’art
A. Quais
Le quai est une structure sur le rivage d'une mer, sur la berge d'une rivière ou sur
un canal, où les navires accostent. C’est un dispositif permettant le chargement et
le déchargement de passagers et de biens au bord d'une étendue d'eau.
Il s'agit d'une levée ordinairement revêtue de pierres, au bord du bassins d'un port
ou sur les rives d'une rivière, d'un canal, d'un lac, et destinée à retenir les berges
ou à faciliter l'accostage des navires pour leur déchargement.
Dans les ports maritimes, les levées de pierres sont remplacées par des ouvrages
de maçonnerie constitués d'un mur de soutènement perpendiculaire au niveau de
l'eau et longé d'une chaussée ou d'une plate-forme permettant l'accostage et les
opérations de débarquement et d'embarquement.
Sur un quai, on peut trouver des engins de levage, comme des grues ou des
portiques de manutention, ainsi que des constructions telles que les hangars
servant à l'entreposage des marchandises débarquées de navires.
Les voies de circulation qui longent les voies d'eau, particulièrement en zone
urbaine, prennent fréquemment le nom de « quai » même en l'absence d'accostage.
Le terme de quai est également utilisé dans les chemins de fer; il provient du
monde de la marine. Il permet d'embarquer ou de débarquer les voyageurs et les
marchandises dans les trains.
Généralités sur les ouvrages d’art 40
Figure 17 Quelques images de quais
Généralités sur les ouvrages d’art 41
B. Réservoir
On peut qualifier de réservoir les ouvrages suivants :
Réservoir d'eau ou Réservoir hydrique
Retenue d'eau
Lac de barrage
Château d'eau au niveau du sol ou une citerne
Réservoir d'eau de pluie;
Généralités sur les ouvrages d’art 42
Image 18 Quelques images de chateaux d’eau
Généralités sur les ouvrages d’art 43
VII. Contraintes et Enjeux dans la construction des Ouvrages
d’Art
A. Contraintes dans la construction des Ouvrages d’Art
La réalisation des ouvrages d'art implique plusieurs contraintes :
Contraintes Techniques
Les contraintes techniques de la réalisation des ouvrages d'art sont nombreuses et
dépendent du type d'ouvrage en question. Elles peuvent inclure:
Résistance structurelle : Les ouvrages doivent être conçus pour supporter les
charges prévues, telles que le trafic routier, ferroviaire, piétonnier, ou les forces
naturelles comme le vent, la neige, ou les séismes.
Stabilité géotechnique: La stabilité des fondations et des sols environnants
doit être évaluée et prise en compte pour assurer la solidité de la structure.
Durabilité: Les matériaux utilisés doivent être durables et résistants à la
corrosion, à l'usure et aux conditions environnementales, afin de garantir une
longue durée de vie de l'ouvrage.
Conception hydraulique: Pour les ouvrages traversant des cours d'eau, des
lacs ou des zones inondables, il est nécessaire de concevoir des systèmes de
drainage appropriés pour gérer les eaux de surface et les crues.
Normes et réglementations: Les ouvrages doivent être conformes aux normes
techniques et réglementations en vigueur, en matière de construction, de
sécurité et d'accessibilité.
Contraintes Financières
Les contraintes financières liées à la réalisation des ouvrages d'art sont
significatives et peuvent inclure:
Coûts de construction: Ils englobent les dépenses liées à l'achat des
matériaux, à la main-d'œuvre, à la machinerie, aux équipements et aux frais
généraux associés à la construction de l'ouvrage.
Généralités sur les ouvrages d’art 44
Coûts d'ingénierie et de conception: Ils comprennent les honoraires des
ingénieurs, architectes, géotechniciens et autres professionnels impliqués
dans la conception technique et architecturale de l'ouvrage.
Acquisition de terrains: Si des terrains doivent être achetés pour la
construction de l'ouvrage, cela peut représenter une part importante des
coûts, surtout dans les zones urbaines denses.
Études environnementales: Des études environnementales doivent
parfois être réalisées pour évaluer l'impact de l'ouvrage sur
l'environnement, ce qui entraîne des coûts supplémentaires.
Frais réglementaires: Des frais de permis, de conformité aux normes et
de respect des réglementations locales peuvent être nécessaires pour obtenir
les autorisations de construction.
Frais d'entretien et de maintenance: Ils sont souvent sous-estimés mais
représentent une dépense continue tout au long de la durée de vie de
l'ouvrage pour garantir sa sécurité et sa durabilité.
Financement et gestion des risques: La gestion des risques liés aux
retards, aux changements de conception et aux imprévus peut nécessiter des
provisions financières supplémentaires.
Contraintes Environnementales
La construction d'ouvrages d'art peut avoir un impact sur l'environnement,
notamment en termes d'habitat naturel, de qualité de l'eau et d'émissions de gaz à
effet de serre.
Impact sur les écosystèmes: La construction d'ouvrages d'art peut
perturber les écosystèmes naturels, notamment en modifiant les habitats
aquatiques, en détruisant des zones humides ou en fragmentant les habitats
terrestres.
Qualité de l'air et des eaux: Les activités de construction peuvent
entraîner des émissions de poussières, de polluants atmosphériques et de
déchets qui peuvent affecter la qualité de l'air et des eaux environnantes.
Généralités sur les ouvrages d’art 45
Gestion des déchets: La construction génère souvent des déchets solides,
liquides et dangereux qui doivent être gérés de manière responsable pour
éviter la pollution de l'environnement.
Consommation de ressources naturelles: La construction nécessite
souvent l'utilisation de matériaux comme le béton, l'acier et le bois, ce qui
peut entraîner une exploitation excessive des ressources naturelles et des
émissions de gaz à effet de serre associées à leur production.
Protection des sites sensibles: Certains sites naturels ou culturels peuvent
être protégés par la loi en raison de leur importance écologique, historique
ou culturelle, ce qui impose des restrictions supplémentaires à la
construction.
Gestion des habitats fauniques: Les ouvrages d'art peuvent interférer avec
les migrations d'animaux, les corridors biologiques et les zones de
reproduction, ce qui nécessite des mesures de protection et d'atténuation
pour minimiser les impacts sur la faune locale.
Adaptation aux changements climatiques: Les ouvrages d'art doivent
être conçus pour résister aux effets des changements climatiques, tels que
l'élévation du niveau de la mer, les tempêtes plus fréquentes et les
précipitations intenses.
VIII. Maintenance des Ouvrages d’Art
La maintenance des ouvrages d'art après leur réalisation est essentielle pour
assurer leur sécurité, leur durabilité et leur bon fonctionnement tout au long de
leur cycle de vie. Pour cela on peut procéder à :
Inspections régulières
Des inspections régulières sont nécessaires pour évaluer l'état des ouvrages d'art,
détecter tout signe de dommage, de détérioration ou de dysfonctionnement, et
planifier les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires.
Entretien préventif
Des travaux d'entretien préventif tels que le nettoyage, la lubrification, le
remplacement des joints d'expansion, et la réparation des revêtements de
Généralités sur les ouvrages d’art 46
protection peuvent aider à prévenir les problèmes futurs et à prolonger la durée de
vie des ouvrages.
Réparations et réhabilitations
Lorsque des dommages ou des défauts sont détectés lors des inspections, des
travaux de réparation ou de réhabilitation doivent être entrepris pour corriger les
problèmes et restaurer l'intégrité structurelle des ouvrages.
Renforcements et améliorations
Parfois, des renforcements ou des améliorations sont nécessaires pour adapter les
ouvrages d'art aux évolutions des normes de sécurité, des charges de trafic, ou des
conditions environnementales.
Gestion des risques naturels
Les ouvrages d'art peuvent être exposés à des risques naturels tels que les
inondations, les séismes, ou l'érosion. Des mesures de protection et de prévention
doivent être mises en place pour réduire ces risques et minimiser les dommages
potentiels.
Surveillance continue
La surveillance continue des ouvrages d'art à l'aide de capteurs et de systèmes de
surveillance peut permettre de détecter les signes de détérioration ou de
mouvement anormal et d'intervenir rapidement en cas de problème.
Gestion des données
La collecte et l'analyse des données sur la performance des ouvrages d'art, les
interventions de maintenance réalisées et les coûts associés sont importantes pour
une gestion efficace des actifs et la prise de décision éclairée en matière de
planification de la maintenance.
IX. Technologie Innovante dans la réalisation des Ouvrages
d’Art : Impression 3D
L'impression 3D, également appelée fabrication additive, est une technologie qui
permet de créer des objets tridimensionnels en ajoutant des couches successives
de matériau, généralement du plastique, du métal ou du béton, à partir de données
numériques.
Principe et fonctionnement: Le processus d'impression 3D débute par la création
d'un modèle numérique 3D de l'objet à imprimer à l'aide de logiciels de conception
Généralités sur les ouvrages d’art 47
assistée par ordinateur (CAO) ou de modélisation 3D. Ce modèle est ensuite
découpé en tranches horizontales, et chaque tranche est envoyée à l'imprimante
3D. L'imprimante dépose alors des couches successives de matériau, une par une,
en suivant les contours de chaque tranche, jusqu'à ce que l'objet complet soit
formé.
La prouesse technique vient de la méthode de fabrication. L’imprimante spéciale,
D-shape, est constituée d’un cadre de 4 mètres sur 4 qui permet de réaliser les
différents éléments. Huit morceaux ont été nécessaires pour ce pont. Une sorte de
grosse tête d’impression dépose la poudre de béton, couche par couche. Sont
incorporées dans le béton, des fibres de polypropylène (sorte de plastique) qui
rigidifient l’ensemble et donnent à l’ouvrage un aspect lisse. Cette technique
d’avant-garde permet d’éviter la construction fastidieuse de moules et de
structures aux formes inhabituelles.
Quelques exemples concrets d'ouvrages d'art réalisés avec l'impression 3D:
Pont de Gemerská Poloma, Slovaquie
En 2017, le premier pont imprimé en 3D au monde a été construit à Gemerská
Poloma, en Slovaquie. Il mesure environ 12 mètres de long et a été conçu pour
supporter le passage de piétons et de cyclistes. Cette prouesse technologique a
démontré la faisabilité de l'utilisation de l'impression 3D dans la construction de
ponts.
Le pont de la Gandeyrade, France
En 2018, le pont de la Gandeyrade, situé à Castelnaud-la-Chapelle en France, a
été rénové avec l'aide de l'impression 3D. Des éléments décoratifs en béton
imprimés en 3D ont été ajoutés au pont, apportant une touche artistique
contemporaine à cette structure historique.
Le pont de la Banane, Amsterdam, Pays-Bas
En 2019, la ville d'Amsterdam aux Pays-Bas a inauguré le "Pont de la Banane"
(Banana Bridge), un petit pont piétonnier en béton imprimé en 3D. Situé dans le
quartier Westerdok, ce pont unique en son genre a été conçu pour être à la fois
fonctionnel et artistique.
Le pont médiéval de Bobila, Espagne
En 2021, des archéologues espagnols ont restauré une partie du pont médiéval de
Bobila, situé à Gavà en Espagne, en utilisant la technologie de l'impression 3D
pour reproduire des éléments manquants de la structure d'origine. Cette approche
Généralités sur les ouvrages d’art 48
novatrice a permis de préserver et de restaurer ce pont historique tout en respectant
son authenticité.
Figure 19 Exemple d’un passage piéton réalisé avec l’imprimante 3D
Une autre réalisation à Amsterdam avec cette fois, un pont fait de métal
réalisé par la société MX3D. L’imprimante met en action un bras robot
articulé et un imposant fer à souder : les tubulures de métal s’entrecroisent
et reçoivent le métal liquide qui jaillit du bras robot.
Ces exemples illustrent comment l'impression 3D est utilisée dans la construction
et la rénovation d'ouvrages d'art à travers le monde, offrant des solutions
innovantes et créatives pour répondre aux défis de conception et de construction.
Généralités sur les ouvrages d’art 49
CONCLUSION
En conclusion, les ouvrages d'art sont bien plus que de simples structures
physiques; ce sont des témoins de notre histoire, des symboles de notre progrès et
des facilitateurs essentiels de notre vie quotidienne. Leur conception, leur
construction et leur entretien exigent un savoir-faire technique et une créativité
remarquables, tout en intégrant les besoins fonctionnels, esthétiques et
environnementaux. En explorant les généralités sur les ouvrages d'art, nous avons
pris conscience de leur importance incontestable dans notre monde moderne. Au-
delà de leur utilité pratique, ils incarnent l'ingéniosité humaine et constituent des
repères visuels qui structurent nos paysages et enrichissent notre patrimoine
collectif. Ainsi, en appréciant et en préservant ces merveilles d'ingénierie, nous
perpétuons leur héritage et assurons leur contribution continue à la connectivité,
à la mobilité et à la beauté de notre société.
Généralités sur les ouvrages d’art 50
Table des matières
SOMMAIRE ................................................................................................ 2
Table des illustrations................................................................................... 3
INTRODUCTION ........................................................................................ 4
I. Définition et Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art .................... 5
A. Définition des Ouvrages d’Art ............................................................. 5
B. Chronologie d’évolution des Ouvrages d’Art ...................................... 6
II. Fonctions et Familles des Ouvrages d’Art ......................................... 11
A. Fonctions des Ouvrages d’Art ........................................................... 11
B. Famille des Ouvrages d’Art ............................................................... 11
III. Ouvrages d’art de franchissement..................................................... 13
A. Pont.................................................................................................... 13
1. Classes de ponts .............................................................................. 13
2. Différentes parties d’un pont .......................................................... 15
B. Tunnel................................................................................................ 17
1. Possibles fonctions des tunnels........................................................ 17
2. Cas particuliers de types de tunnels ............................................... 17
3. Méthodes de construction ............................................................... 20
C. Ecran acoustique ............................................................................... 22
IV. Ouvrages d’art de protection et de soutènement ............................... 24
A. Murs de soutènement......................................................................... 24
1. Principe de dimensionnement......................................................... 25
2. Différents types de murs de soutènement ....................................... 25
V. Ouvrages d’art de retenues d’eau......................................................... 32
A. Barrages ............................................................................................ 32
1. Types de barrages ........................................................................... 34
2. Catégories de barrages ................................................................... 35
3. Techniques de construction ............................................................ 36
B. Digues ................................................................................................ 37
1. Les grands types de digues ............................................................. 38
Généralités sur les ouvrages d’art 51
VI. Autres ouvrages d’art ........................................................................ 40
A. Quais.................................................................................................. 40
B. Réservoir ........................................................................................... 42
VII. Contraintes et Enjeux dans la construction des Ouvrages d’Art....... 44
VIII. Maintenance des Ouvrages d’Art ................................................... 46
IX. Technologie Innovante dans la réalisation des Ouvrages d’Art :
Impression 3D ............................................................................................ 47
CONCLUSION .......................................................................................... 50
Table des matières ...................................................................................... 51
Généralités sur les ouvrages d’art 52
Vous aimerez peut-être aussi
- RDM PortiqueDocument12 pagesRDM Portiquemaxime CLO100% (1)
- Projet de Recherche M2GC - OUMAR - SULAIMAN - MAYADocument34 pagesProjet de Recherche M2GC - OUMAR - SULAIMAN - MAYAOUMAR SOULOUMPas encore d'évaluation
- Cuivre For Web PDFDocument42 pagesCuivre For Web PDFTEIUSANU100% (1)
- Les Tuyaux en Plomb - FVB-FFC ConstructivDocument22 pagesLes Tuyaux en Plomb - FVB-FFC ConstructivCamelia SmahanPas encore d'évaluation
- CETMEF Guide D'enrochement Dans Les Ouvrages Hydrauliques 2009Document38 pagesCETMEF Guide D'enrochement Dans Les Ouvrages Hydrauliques 2009MansourLassouedPas encore d'évaluation
- Rapport Projet AssainissementDocument37 pagesRapport Projet AssainissementMohamed MehdiPas encore d'évaluation
- Pylones PDFDocument32 pagesPylones PDFImen dhibi67% (6)
- Histoire Et Architecture de La CMDocument122 pagesHistoire Et Architecture de La CMguessousPas encore d'évaluation
- 09 Chapitre 1Document0 page09 Chapitre 1Oussama SapherPas encore d'évaluation
- Edifice ArtificelightDocument27 pagesEdifice ArtificelightAndreia NicolauPas encore d'évaluation
- Château D'eauDocument39 pagesChâteau D'eaugodwin dk100% (2)
- DDOC T 2014 0342 SCHLICKLIN Vol1Document438 pagesDDOC T 2014 0342 SCHLICKLIN Vol1Aida NayerPas encore d'évaluation
- PROJET TUTORE DE FIN DE CYCLE DimensionnDocument22 pagesPROJET TUTORE DE FIN DE CYCLE DimensionnSeverin OvonoPas encore d'évaluation
- Projet QualitéDocument19 pagesProjet Qualitémamoudou dioubatePas encore d'évaluation
- Ormos 2021 Cairo in ChicagoDocument467 pagesOrmos 2021 Cairo in ChicagoJohn SmithPas encore d'évaluation
- 2016 MemoireDocument219 pages2016 MemoireMANEL PaynePas encore d'évaluation
- Pathologie Et Réabilitation Des Ponts M2 GC Bouteraa ZohraDocument117 pagesPathologie Et Réabilitation Des Ponts M2 GC Bouteraa ZohraBreathe 4 footballPas encore d'évaluation
- 1.la Terre Comme Matériau de ConstructionDocument19 pages1.la Terre Comme Matériau de ConstructionLEIS DJIFACKPas encore d'évaluation
- F077IS - Les Tuyaux en Plomb - For - WebDocument24 pagesF077IS - Les Tuyaux en Plomb - For - Webjawad chraibiPas encore d'évaluation
- Alger (La Grande Poste)Document67 pagesAlger (La Grande Poste)Ami RaPas encore d'évaluation
- Le BatimentDocument12 pagesLe BatimentHurlin BrayanePas encore d'évaluation
- 4 720 1070Document41 pages4 720 1070BassetPas encore d'évaluation
- Cours Et TD-CM-3eme GC Et TP - S1Document75 pagesCours Et TD-CM-3eme GC Et TP - S1bilal bedrouniPas encore d'évaluation
- Barrages Voutes 1Document35 pagesBarrages Voutes 1GoOD GirLPas encore d'évaluation
- Ilot Ouvert de Portzamparc Rapport GE12 Bellego Cazin FournierDocument38 pagesIlot Ouvert de Portzamparc Rapport GE12 Bellego Cazin FournierDaniela VelozoPas encore d'évaluation
- Memoire DamienEMOND s161223Document133 pagesMemoire DamienEMOND s161223banzacelestin933Pas encore d'évaluation
- Revue de Littérature DavidDocument36 pagesRevue de Littérature DavidJohnson noutche100% (1)
- DELIGNE - Bruxelles Et Sa Rivière - Genèse D'un Territoire Urbain (12e-18e Siècle) - 2003Document276 pagesDELIGNE - Bruxelles Et Sa Rivière - Genèse D'un Territoire Urbain (12e-18e Siècle) - 2003Igor AntonissenPas encore d'évaluation
- Pont Final BonDocument117 pagesPont Final BonRees HowellsPas encore d'évaluation
- MEMOIREDocument140 pagesMEMOIREKARIM GARAHPas encore d'évaluation
- Beton FinalDocument53 pagesBeton Finaljordan ekohPas encore d'évaluation
- Setra - Guide - Ponts - MixtesDocument229 pagesSetra - Guide - Ponts - MixtesBENMESSAOUD SaidPas encore d'évaluation
- Les Lignes Et Les Surfaces Courbes en Architecture: Patrick Meyer - Jan RESZKADocument59 pagesLes Lignes Et Les Surfaces Courbes en Architecture: Patrick Meyer - Jan RESZKAJudithPas encore d'évaluation
- THÈME: Conception Et Étude Comparative Sous Robot, Du Dimensionnement D'un Bâtiment de Type R+3Document73 pagesTHÈME: Conception Et Étude Comparative Sous Robot, Du Dimensionnement D'un Bâtiment de Type R+3Desormēt LeDøcteurPas encore d'évaluation
- 09 Chapitre 1 PDFDocument34 pages09 Chapitre 1 PDFabdallahPas encore d'évaluation
- Pont DefinitifDocument39 pagesPont Definitifbadaromuald6Pas encore d'évaluation
- Conception Et Calcul Des Murs de Soutenement en Terre ArmeeDocument51 pagesConception Et Calcul Des Murs de Soutenement en Terre Armeeboumehdikhaled100% (8)
- Rapport Pfe AymenDocument184 pagesRapport Pfe Aymenfatma100% (1)
- Cour Performance BatnaDocument156 pagesCour Performance Batnatouaf zinebPas encore d'évaluation
- 8 PiséDocument46 pages8 PiséLEIS DJIFACKPas encore d'évaluation
- Module 12 Connaissance Différ Ouvra en Travaux-BTP-TCCTPDocument93 pagesModule 12 Connaissance Différ Ouvra en Travaux-BTP-TCCTPMed Ramzi Roubache100% (1)
- Emergence de L'architecture Container - Etude de La Vision Des Habitations Containers - Benjamin MarlotDocument134 pagesEmergence de L'architecture Container - Etude de La Vision Des Habitations Containers - Benjamin MarlotNoel saa molio MillimounoPas encore d'évaluation
- Les Ponts: Rapport Du Projet de Fin D'annéeDocument35 pagesLes Ponts: Rapport Du Projet de Fin D'annéeIhssane HsainiPas encore d'évaluation
- Résurgences de La Tradition Des Icônes Orthodoxes RussesDocument117 pagesRésurgences de La Tradition Des Icônes Orthodoxes Russessaintclairchris4Pas encore d'évaluation
- Gha Noui AbdelkaderDocument146 pagesGha Noui AbdelkaderSidali RafaPas encore d'évaluation
- Isabelle Duval EstienneDocument282 pagesIsabelle Duval EstienneClaudia FernandezPas encore d'évaluation
- Vers Une Meilleure Stratégie de Résilience Des Villes Littorales Façe Aux Changements ClimatiquesDocument71 pagesVers Une Meilleure Stratégie de Résilience Des Villes Littorales Façe Aux Changements Climatiquesyosrbelhedi.ybhPas encore d'évaluation
- Hearsttowernyc StructureetarchitectureDocument32 pagesHearsttowernyc StructureetarchitectureEliézerd UpenjmunguPas encore d'évaluation
- GP Presentation IntroDocument24 pagesGP Presentation IntrochristophesandPas encore d'évaluation
- Syllabus OA PDFDocument60 pagesSyllabus OA PDFHidlerPas encore d'évaluation
- Architecture Ville Et PatrimoineDocument138 pagesArchitecture Ville Et PatrimoineAkbabai nesrinePas encore d'évaluation
- Rapport de Thèse - Amal BECHIKHDocument127 pagesRapport de Thèse - Amal BECHIKHmouradPas encore d'évaluation
- Rapport VisiteDocument20 pagesRapport VisiteMay Boudhraa100% (1)
- Réfection de Dalot Sous-TerrainDocument47 pagesRéfection de Dalot Sous-TerrainMustapha BeramiPas encore d'évaluation
- Master 138Document119 pagesMaster 138Hocine HohoPas encore d'évaluation
- 2017 TH Azirian JulienDocument101 pages2017 TH Azirian Julieneric de l'orPas encore d'évaluation
- Introduction À L'urbanismeDocument69 pagesIntroduction À L'urbanismeWalid BibimounePas encore d'évaluation
- Cours de Route 2Document61 pagesCours de Route 2LordPas encore d'évaluation
- L' Ingénieur et le développement durableD'EverandL' Ingénieur et le développement durableÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Les Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?D'EverandLes Transferts massifs d'eau: Outils de développement ou instruments de pouvoir ?Pas encore d'évaluation
- Les Autoroutes de l'information: Un produit de la convergenceD'EverandLes Autoroutes de l'information: Un produit de la convergencePas encore d'évaluation
- Théories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardeD'EverandThéories des organisations: approches classiques, contemporaines et de l'avant-gardePas encore d'évaluation
- Matériaux Innovants Et Géotechnique Routière 2022-2023 - VFDocument168 pagesMatériaux Innovants Et Géotechnique Routière 2022-2023 - VFmaxime CLOPas encore d'évaluation
- Devoir 3 Clorivière 1ere CDocument5 pagesDevoir 3 Clorivière 1ere Cmaxime CLOPas encore d'évaluation
- Expposé PBDocument25 pagesExpposé PBmaxime CLOPas encore d'évaluation
- Épreuves Économie Générale GC3Document4 pagesÉpreuves Économie Générale GC3maxime CLOPas encore d'évaluation
- Chapitre 4Document29 pagesChapitre 4Mohand BADJOUPas encore d'évaluation
- Ouvrage en Site Aquatique - Talus Et PentesDocument35 pagesOuvrage en Site Aquatique - Talus Et PentesYouyou YanisPas encore d'évaluation
- Ces DRS 2010Document30 pagesCes DRS 2010qkdnczzsdgPas encore d'évaluation
- Chapitre 6 PART 2 - Dimensionnement Des Ouvrages Portuaires (27!05!2021)Document95 pagesChapitre 6 PART 2 - Dimensionnement Des Ouvrages Portuaires (27!05!2021)medreda.taziPas encore d'évaluation
- Les Murs de CouronnementDocument138 pagesLes Murs de CouronnementAdam El'merzoukiPas encore d'évaluation
- P6 - OURAGAN KATRINA v0Document11 pagesP6 - OURAGAN KATRINA v0Thierry IRIEPas encore d'évaluation
- Cours D'ouvrages 2ème PartieDocument158 pagesCours D'ouvrages 2ème PartieLanciné Djene KouroumaPas encore d'évaluation
- MODULE 11 Partie 2Document39 pagesMODULE 11 Partie 2Ange Basile Diawara TshivumdaPas encore d'évaluation
- H - Annexe3 - GUIDE BLEU-Edition 2012Document36 pagesH - Annexe3 - GUIDE BLEU-Edition 2012Brahima DiarrassoubaPas encore d'évaluation
- Ref-Etude de VulnérabilitéDocument91 pagesRef-Etude de Vulnérabilitéboughrara amiraPas encore d'évaluation
- Questionnaire D'enquêteDocument16 pagesQuestionnaire D'enquêtebakhawdiene92Pas encore d'évaluation
- Étude Des MilieuxDocument9 pagesÉtude Des MilieuxBobPas encore d'évaluation
- Mémoire BourezgDocument71 pagesMémoire BourezgWalidBenHamidouche100% (1)
- Correction TD #3-1Document3 pagesCorrection TD #3-1salwawak14100% (1)
- Techologie Des Ouvrages - OdtDocument9 pagesTechologie Des Ouvrages - OdtSylvano ArisePas encore d'évaluation
- Rapport MellegueDocument25 pagesRapport MellegueAhmed BahaeddinePas encore d'évaluation
- Mémoire Modelisation Numerique de L'effet Des Infiltrations Sur La Stabilite D'un Barrage en TerrDocument90 pagesMémoire Modelisation Numerique de L'effet Des Infiltrations Sur La Stabilite D'un Barrage en TerrImene Senadi100% (1)
- Rapport - Modèle - Physique - (3D)Document92 pagesRapport - Modèle - Physique - (3D)kadaPas encore d'évaluation
- Les Infrastructures Hydrauliques de Phnom Penh (Cambodge) Face Au Risque D'inondation Depuis 1979Document18 pagesLes Infrastructures Hydrauliques de Phnom Penh (Cambodge) Face Au Risque D'inondation Depuis 1979TomatoPas encore d'évaluation
- Cours Barrages - 1a-Master-Voa 2018-2019Document306 pagesCours Barrages - 1a-Master-Voa 2018-2019Chaker Mohamed Ramzi100% (2)
- Le Phicometre, Outil de Mesure de La Resistance Au Cisaillement in SituDocument10 pagesLe Phicometre, Outil de Mesure de La Resistance Au Cisaillement in Situishaq AllalPas encore d'évaluation
- Copie de PROJET ETUDE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONSDocument13 pagesCopie de PROJET ETUDE DE PROTECTION CONTRE LES INONDATIONSCelia CiciPas encore d'évaluation
- Utilisation Des Enrochements Dans Les Ouvrages HydDocument11 pagesUtilisation Des Enrochements Dans Les Ouvrages HydAbderrahman SrailPas encore d'évaluation
- 2757-RUGC René Houpert-10893-2-10-20210528Document8 pages2757-RUGC René Houpert-10893-2-10-20210528Ahmed NoePas encore d'évaluation
- TDR Tchad-Section 7Document16 pagesTDR Tchad-Section 7Rami OUERGHI100% (1)
- Referentiel Technique Digues Maritimes Et Fluviales PDFDocument191 pagesReferentiel Technique Digues Maritimes Et Fluviales PDFsaamehbenhelelPas encore d'évaluation
- Surveillance, Entretien Et Diagnostic Des Digues de Protection Contre Les Inondations (P. Mériaux, P. Royet, C. Folton) - 2004Document181 pagesSurveillance, Entretien Et Diagnostic Des Digues de Protection Contre Les Inondations (P. Mériaux, P. Royet, C. Folton) - 2004rabahPas encore d'évaluation
- 9-Etude Géologique Et Géotechnique Pour La Construction Du Barrage TlitaDocument154 pages9-Etude Géologique Et Géotechnique Pour La Construction Du Barrage TlitaAsmaa KasmiPas encore d'évaluation