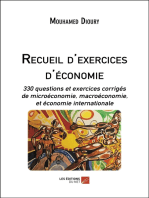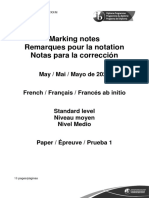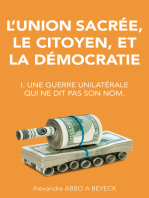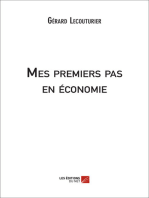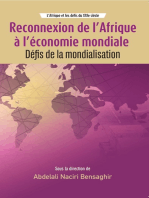Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Cours Economie Internationale Licence 3 AES
Cours Economie Internationale Licence 3 AES
Transféré par
Ju Drtz DlbTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Cours Economie Internationale Licence 3 AES
Cours Economie Internationale Licence 3 AES
Transféré par
Ju Drtz DlbDroits d'auteur :
Formats disponibles
Economie Internationale
L3 AES
conomie Internationale
Examen : dissertation avec deux sujets au choix en deux heures. Prsentation : 15 points Introduction : 20 points, mise en contexte du sujet, noncer le sujet lui-mme, dgager une problmatique (une question ou un ensemble de question distinct du sujet), dgager un plan (le plan dcoule logiquement de la problmatique) Dveloppement : 45 points, chaque paragraphe doit dvelopper un argument avec des exemples Conclusion : 20 points, on peut terminer par une ouverture Plan du cours : Introduction Gnrale : Au tournant du sicle quelques faits marquants Chapitre 1 : Dune brve histoire des changes internationaux aux caractristiques de la mondialisation actuelle Chapitre 2 : Les thories traditionnelles du commerce international Chapitre 3 : Quelques lments dEconomie Politique Internationale Chapitre 4 : La place des pays en dveloppement dans le monde contemporain
Introduction gnrale : Au tournant du sicle quelques faits marquants
La fin du 20e sicle a t marqu par un certains nombre de phnomnes, de circonstances qui ont eu un impact l'chelon international et si le tournant des annes 1980 aux annes 1990 a t marqu par la chute du mur de Berlin et par la dcomposition du bloc sovitique en rpublique aux aspirations dmocratiques, on peut dire que la transition entre le 20e et le 21e sicle aura t encore plus brutal et les attentats du 11 septembre 2001 sont venus conforter la thse d'un choc des civilisations. Quelques rappels sur les faits officiels : le 11 septembre 2001 quelques minutes d'intervalles 4 avions se seraient crass sur la ct Est des Etats-Unis. Les deux premiers sur les tours jumelles du World Trade Center New York, le troisime se serait cras sur le pentagone Washington et le dernier se serait cras en rase campagne quelque part en Pennsylvanie. Le bilan de ces attentats a t trs lourd puisqu'on a dnombr plus de 3 000 morts qui sont presque tous des civiles. Suite ces attentas la raction de l'tat amricain qui a subit le choc a t trs rapide et un certains nombre de liens ont t vite tablit entre ces attentats et le mouvement terroriste Al Qaida et leur chef Houssama Ben Laden. Ces attentats ont sem le trouble bien des niveaux. En effet, comment un tat scuritaire comme les Etats-Unis d'Amrique avaient-ils pu laisser oprer des terroristes sans que les services secrets amricains soient avertis ? Quelles taient les motivations profondes de ces Page | 1
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
attentats ? Et pourquoi s'attaquer des civiles en mme temps qu'au symbole du libralisme et de la mondialisation qui tait situ en plein milieu du quartier des affaires et deux pas de Wall Street ? Il semblerait que les rvlations des semaines suivantes ont dmontrs que ces attentats n'avaient pu tre organiss que de longue date c'est--dire bien avant l'arrive au pouvoir de George W Bush en janvier 2001 et mme bien avant la reprise de la 2e Intifada (rvolte des pierres) en septembre 2000. Par ailleurs, les auteurs de ces attentats et leur cerveau prsum Mohamed Atta n'taient absolument pas des palestiniens de la bande de Gaza ni mme des Irakiens opprim par une dizaine d'annes d'embargo par les nations unies. Mais sur les 19 terroristes, 15 d'entre eux taient originaire d'Arabie Saoudite et les 4 autres taient originaires de riches familles d'Egypte, du Liban ou encore des Emirats arabes Unis. De plus, les 19 terroristes kamikazes n'taient de jeunes dsuvrs l'avenir incertain mais l a plupart taient diplm de grandes universits et donc vou un avenir prometteur. Les causes de ces attentats sont sans doutes rechercher ailleurs et donc plutt dans la pratique d'un islamisme radicale et belliqueux o les impies de confession chrtienne et l'idologie librale taient viss. Le traumatisme caus par le 11 septembre a t mondial et pour la premire fois depuis leur constitution au 18e sicle les USA taient touchs sur leur sol en plein cur des centres de dcision politique, militaire et conomique. On peut souligner que bien peu d'experts en gostratgie ou en gopolitique avaient mis l'hypothse de tels attentats. Par exemple, un ouvrage a t publi par Pascal Boniface intitul Les guerres qui menacent le monde mais il n'a pas t assez lucide pour prvoir un tel phnomne. On peut tenter de mettre en vidence les liens qui peuvent exister entre cet vnement et le phnomne de mondialisation. Le sociologue Zaki Laidi avait en 2001, quelques semaines aprs ces attentats, mis en vidence trois lments qui mettent en rapport le 11 septembre 2001 et le phnomne de mondialisation. Tout d'abord le fait que la mondialisation est aussi porteuse d'une violence collective l'abri de laquelle aucune socit ne peut se placer , ensuite le fait que sans rgulation politique la mondialisation dmultiplie les maux publics mondiaux (drogue, terrorisme, ingalit sociale) ainsi que les risques d'une double violence : la violence diffrencialiste qui s'exprime dans l'intention de casser ce qui apparat comme un processus d'uniformisation culturelle du monde et la violence mimtique qui s'exprime parce que l'on ne possde pas ce que le puissant ou le riche possde , enfin la rvlation du profond dficit de sens dont souffre la mondialisation, dficit qui s'exprime de deux faons, d'une part la difficult croissante de faire de la libralisation des changes une finalit de l'ordre social mondial et d'autre part l'impossibilit de doter la communaut internationale d'un principe d'ordre . Au del des enseignements de ces attentats et de la chute du mur de Berlin, on peut identifier un ensemble de phnomnes qui permettent de caractriser la transition qui s'opre ou qui s'est opr entre le 20e et le 21e sicle.
I-
La fin d'un monde polaris
On est pass d'un monde compos au plan diplomatique par deux blocs Est et Ouest une recomposition des relations internationales, recomposition qui s'avre chaotique et peut-tre d'avantage marque par des disparits culturelles ou religieuses mme si la composante idologique demeure importante. Dans ce contexte l, on a assist une multiplication de conflits d'origine ethnique et religieuse entre les composantes d'un mme tat. Parmi ces conflits, on retrouve du terrorisme en Tchtchnie, en Afghanistan, au Mexique... Comme le note Ignacio Ramonet, Geopolitique du chaos, la plupart des conflits
en cette fin de sicle sont des conflits internes,
Page | 2
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
intra-tatique qui opposent souvent un pouvoir central une fraction de sa propre population . A
ces conflits vient s'ajouter une accentuation des disparits conomiques et sociales au sein des pays mais aussi entre les pays. A la polarisation Est-Ouest fait place une mosaque de conflits localis et en mme temps une polarisation Nord -Sud qui s'accentue notamment au plan conomique.
II-
L'mergence de nouveaux acteurs et une nouvelle rpartition des rles
La transition entre le 20e et le 21e sicle a aussi t marqu par l'mergence des ONG uvrant au plan mondial comme le WWF, Amnesty International ou encore Attac. Cette modification des rgles du jeu diplomatique s'est surtout rvle en 1999 lors de la premire runion interministrielle de l'organisation mondiale du commerce qui avait t organise Seattle et c'est lors de cette runion que des manifestants anti-mondialisation ont rclam de prendre part aux discussions sur les enjeux mondiaux. Ces nouveaux acteurs internationaux viennent s'ajouter aux acteurs traditionnels que sont les tats et les organisations internationales (ONU, Unisef, FMI, la banque mondiale...). Dans ce contexte on peut s'interroger sur le poids de l'tat nation ? Et on peut notamment se demander si l'chelle nationale encore une signification ? On peut rappeler aussi que la fin du 20e sicle a galement marqu une transition dans la place accorde aux institutions internationales. En effet, depuis 1945 (accords de Bretton Woods) les institutions cres par ces accords fonctionnaient sur une rgulation reposant sur une concertation entre les tats. Or, les annes 1980 vont marquer un coup d'arrt aux politiques nationales d'tat providence pour laisser place une doctrine librale dont les plus fervent dfenseurs ont taient Margaret Tatcher ou encore Ronald Reagan. D'une certaine manire le centre du pouvoir politique l'chelle internationale a progressivement bascul de New-York (sige des nations unies) Washington (siges de la banque mondiale et du FMI). Certains l'ont qualifi de consensus de Washington qui marque le nouveau paradigme (ide dominante) des relations internationales fond sur la domination de l'conomique sur la politique. Les runions annuelles qui se droulent Damos en Suisse ou encore les runions du G8 illustrent bien ce nouveau paradigme.
III-
La monte des proccupations environnementales et l'mergence du dveloppement durable
On est toujours dans la fin du 20e et dbut du 21e sicle. Les dcennies 1980 et 1990 ont galement mis sur le devant de la scne les problmatiques environnementales avec un certains nombres d'vnements importants comme la catastrophe de Bhopal en 1984, la catastrophe de Tchernobyl en 1986, un certains nombres de mares noires, la rarfaction de l'eau douce, le trou dans la couche d'ozone, le phnomne des pluies acides ou encore le changement climatique avec l'accroissement de l'effet de serre. Les enjeux environnementaux apparaissent dsormais manifestement lis aux enjeux conomiques, sociaux, culturels et gopolitiques. De ce point de vue, la diffusion du concept de dveloppement durable permet l'annonce d'un changement dans la faon d'apprhender la relation entre l'homme et la nature. Dfinition du dveloppement durable : dfini en 1987 dans le rapport Brundtland, dveloppement qui rpond au besoin du prsent sans compromettre la capacit des gnrations futures de rpondre leurs propres besoins. Page | 3
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
IV-
Les rapports entre la technique et l'thique
Les relations entre l'homme et la technique ont toujours t sulfureuse (mythe de Promthe). Le gnie gntique couplet au progrs de l'informatique permet d'esprer des progrs de la mdecine fondamentaux mais ils ravivent aussi les craintes des plus sceptiques. D'une certaine manire les rapports entre science et thique sont au cur des proccupations contemporaines. Par exemple comment s'assurer que l'usage d'internet puisse se faire sans violation de la vie prive ? Les manipulations gntiques ne vont-elles pas conduire certaines personnes tenter le clonage humain ? Au cours du 20e sicle bien des techniques se sont dveloppes mais se sont sans doute les biotechnologies et les nouvelles techniques de l'information et de la communication qui avivent le plus d'espoir mais aussi le plus de crainte. En effet depuis une trentaine d'annes, l'essor de moyens de tlcommunication et des moyens de transports rendu les vnements de ce monde plus instantans et la diffusion de l'outil internet et de l'ensemble des nouvelles technologies de l'information et de la communication conduit une recomposition des relations aussi bien au sein de l'entreprise qu'entre les citoyens du monde. Cependant il faut rappeler que si le dveloppement l'accs internet t rapide il demeure largement ingalitaire. Paralllement, on assiste depuis une trentaine d'anne un dveloppement sans prcdant des biotechnologies et du gnie gntique tel point que tous les grand pays se sont lanc dans une course au dcodage du gnome humain. Si les enjeux alimentaires et mdicaux de ces techniques sont importants (les OGM permettraient de cultiver diverses plantes dans des milieux hostiles ou le gnie gntique offrirait la possibilit de soigner des maladies gntiques), les enjeux conomiques sont tout aussi important. On assiste une course au brevetage du vivant qui a t lanc ds les annes 1990 par les grandes firmes pharmaceutiques mondiales. L encore il est permis de percevoir un processus qui est fondamentalement ingalitaire travers les changes dette-nature. Les pays pauvres du Sud qui sont richement dot en biodiversit vont changer leurs ressources naturelles contre une annulation de leur dette. En contre partie les pays du Nord qui sont faiblement dot en ressources gntiques investissent dans la recherche et achtent massivement des brevets ou en dposent dans l'espoir que l'une des plantes qu'ils auront brevet devienne un vaccin efficace. Dans ces conditions mme si les firmes pharmaceutiques affirment que leur dcouvertes pourraient profiter tous, y compris aux habitants des pays en dveloppement, il est permis d'en douter.
V-
L'explosion dmographique
En l'an 2000, on a atteint le chiffre symbolique de 6 milliards d'tres humains sur terre. Cette question de l'accroissement dmographique l'chelle globale avait t souligne dans les annes 1960. Au niveau de la prospective, les tudes estiment environ 9 milliards le nombre d'tre humain qui devraient peupler la terre en 2050 et partir de l ce chiffre devrait se stabiliser pour ne plus croitre que faiblement. La question de la dmographie est lie de manire troite celle de la culture et du niveau de dveloppement. Par exemple dans les socits occidentales on a assist une baisse du taux de fcondit et en mme temps un vieillissement de la population qui est vraisemblablement li au dveloppement du planning familial mais aussi l'accroissement du niveau de l'ducation. Ce processus conduit des situations contrastes entre les pays du nord et les pays du sud. On assisterait une mondialisation deux vitesses o les pays riches du nord dtiennent la plus grande part du PIB mondial (20 % de la population mondiale dtiendrai 80 % du PIB mondial) tandis que les Page | 4
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
pays pauvres se partagerai la plus petite part c'est--dire 20 % du PIB mondial pour 80 % de la population mondiale. A cela s'ajoute des processus migratoire et notamment un exode rural trs important dans les pays en dveloppement qui conduit des phnomnes de mtropolisation. La plante regroupait environ 50 % d'urbains en 2002 et selon les tudes prospectives, elle devrait en compter environ 60 % en 2025. Ce processus croissant d'urbanisation va s'accompagner d'une concentration de la population dans les trs grandes agglomrations. En 1900 Pkin comptait 1 million d'habitants, aujourd'hui il y a une multiplication x 10. Face la pousse dmographique, on se rend compte que c'est dans les pays en dveloppement que le nombre de mgapole de plus d'1 million d'habitant est le plus lev.
Page | 5
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
Chapitre 1 : Dune brve histoire des changes internationaux aux caractristiques de la mondialisation actuelle
IUne brve histoire des changes commerciaux
1- LAntiquit : la domination de lespace mditerranen Contrairement une ide reue, les conomies qui se sont dveloppes depuis lAntiquit ntaient pas toutes fondamentalement tourne vers lchange marchand. Comme le remarque Jacques Adda dans son ouvrage La mondialisation de lconomie : sils nignoraient pas le march les
premiers empires de lAntiquit et les socits primitives qui les ont prcdes taient gnralement organises selon des principes diffrents fonds sur la rciprocit, sur la redistribution et sur lautarcie. La rciprocit qui est caractristique de nombreuses socits primitives signifie que les actes conomiques sinscrivent dans une chaine de don et de contre don rciproque qui long terme squilibre avantageant de la mme faon chacune des parties concernes.
Effectivement, si on regarde dun point de vue historique lAntiquit nous a lgu des constructions monumentales dont on peut encore admirer les vestiges telles que les pyramides dEgypte, aux temples Grecs, Romains ou Maya dont le but initial ntait absol ument pas tourne vers lchange marchand. Au-del de ces caractristiques, on peut rappeler que lAntiquit est aussi la priode o se sont dvelopps les premiers changes marchand entre les civilisations et entre continents. Par exemples cest lge dor du commerce chez les grecques, la route de la soie qui partait de la Chine jusquen Turquie ou jusquau Liban et ce voyage durait de 5 7 ans, chaque tape tait un lieu dchange dpices de th et de soie. 2- Le Moyen Age : le temps des marchands, des foires et du dveloppement de la monnaie Au Moyen Age les foires et les marchs vont stendre et se spcialiser et les caravanes de marchands sillonnent les routes et donc avec larrive de nouvelles activits se crent de nouveaux besoins. Il nest pas tonnant que ce dveloppement de la sphre marchande se soit accompagn dun dveloppement de la monnaie, de sa forme fiduciaire jusqu sa forme moderne qui est la forme scripturale. Dans ce contexte, les banques se dveloppent et bientt les banquiers italiens vont ouvrir des succursales dans toutes les grandes villes dEurope. Prcisment, cette poque va voir lessor et lautonomie des villes et en particulier des ports Page | 6
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
de commerces notamment de Venise, Gnes ou Pise ou encore de Bisance. Mais cest aussi le temps des foires rgionales qui vont permettre certaines villes de se dvelopper de faon importantes (exemple : Arras). Cette premire pousse du capitalisme marchand va sinterrompre brutalement partir du milieu du 14e sicle parce quon assiste une srie de crises et de dpressions avec notamment des grandes famines et des guerres et des pidmies de peste, de colra. On peut retenir lexemple de lpidmie de peste noire de 1348 puisquelle a t favorise par le dveloppement des voies de communication entre les villes. Cette pidmie a t particulirement meurtrire puisquelle va tuer un europen sur trois. Cela va faire passer la population totale en Europe en dessous des 50 millions. 3- La Renaissance et le grand dsenclavement de lEurope En lespace dun peu plus dun sicle, entre 1430 et 1540, cest--dire en pleine Renaissance, les navigateurs conqurants vont dcouvrir ou dfricher de nombreuses terres jusqualors inconnues des europens. Cest lge dor des navigateurs italiens mais aussi espagnols et portugais. Par exemple les voyages de Vasco de Gama en 1490 et en 1492 Christophe Colomb part la conqute de lInde mais dcouvrira lAmrique. A partir de ce moment l, les espagnols essentiellement vont investir les territoires dAmrique du sud et dAmrique centrale en ramenant des gigantesques quantits dor et de mtaux prcieux en mme temps quils vont perptuer le plus grand gnocide de lhumanit. A partir de l les espagnols et les portugais vont dtrner les italiens et cest Lisbonne qui va devenir la capitale du commerce des pices. Pendant ce temps, le port dAnvers va se dvelopper et va bientt simposer comme le port de commerce le plus important dEurope dans la premire moiti du 16 e sicle. Lnorme empire de Charles Quint va se constituer et va stendre du Sud au Nord de lEurope et cela va conduire consacrer les Pays-Bas et en particulier Amsterdam comme centre principal de dcision et de commerce. La Renaissance est aussi marque par la consolidation des tats nations comme la France et lAngleterre, par exemples, et par la prdominance dune doctrine le mercantilisme qui fait des marchands les conseillers du prince. La doctrine mercantilisme a t forte au cours du 17e sicle et elle conduit notamment au protectionnisme et au dveloppement de lauto suffisance alimentaire. 4- De lpoque classique aux prmisses de la rvolution industrielle Le 18e sicle, appel sicle des Lumires, voit le dveloppement de la science (thorie de la gravitation) mais aussi une ouverture et un cosmopolitisme croissant. Par exemple dans ses cahiers Montesquieu saffirme comme citoyen du monde. Et cest le dveloppement aussi de lencyclopdie de Diderot et dAlembert avec pour projet de rendre accessible les connaissances au plus grand nombre. Sur les travaux conomiques se sont le dbut de lconomie politique (Adam Smith). Sur le plan de lactivit conomique, on observe une prdominance du secteur agricole qui reprsente entre la moiti et les trois quarts du revenu national en Angleterre et en France. Il y a la disparition du servage et la constitution dune socit rurale o les ouvriers agricoles peuvent louer ou acheter leurs terres et o ils vivent en autarcie complte. A cette poque, les techniques ont peu progresses et les productivits restent faibles et llevage reste extensif. Dans ce contexte on assiste des famines et des disettes plus ou moins importantes. Au niveau de lindustrie, la production reste trs lie lactivit agricole. Les paysans ou les agriculteurs fabriquent eux-mmes les objets de et sajoute cela une industrie rurale trs disperse dans les rgions et en mme temps trs spcialiss.
Page | 7
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
Au cours du 18e sicle, les activits vont se diversifier et la manufacture qui au dpart tait la simple runion commerciale ou dateliers familiaux indpendants va devenir un btiment part entire situ prs du lieu dexploitation de la matire premire ou prs de l eau et du bois qui sont les deux principales sources dnergie. On passe des systmes de fabrique do vont naitre les industries nouvelles, lessentiel des produits de lindustrie est destin la consommation et la production de biens dquipement reste relativement marginale. La seule industrie massive qui se dveloppe cette poque cest lindustrie textile et malgr tout, on est encore dans des conomies qui restent relativement fige, sans relle croissance et labsence de croissance est lie essentiellement la faiblesse de la circulation. Le transport le plus sr est par voie deau. Un seul secteur volue vritablement est le secteur du commerce maritime, transocanique et colonial. 5- De la rvolution industrielle la Premire Guerre Mondiale Les historiens ont pour habitude de dsigner sous lexpression de rvolution industrielle une priode qui a compltement bouleverse lhistoire du travail et des travailleurs. Cette rvolution industrielle dbute dans la seconde moiti du 18e sicle et va donner naissance la machine qui va progressivement se substituer au travail manuel et qui ncessitera dautres sources dnergies que celles qui taient jusque l utilises (animale, musculaires, olienne, hydraulique) comme la vapeur. Le terme de rvolution ne doit cependant pas faire illusion puisque en effet les nouveaux modes de travail mcanique ont eu du mal simplanter dans la mesure o il menaait les situations acquises et les attitudes hrditaires. Lapparition des machines na pas t vue par un trs bon il car les ouvriers craignaient de se voir priv de travail, cest--dire tre rduit au chmage et leurs chefs se sentaient menac dans leurs positions sociales et dans leurs privilges. On peut citer Claude Fohlen, 1971, Quest-ce que la rvolution industrielle ? : les transformations ne furent pas
seulement industrielles mais sociales et intellectuelles. Dautre part, le terme de rvolution implique une soudainet dans le changement qui peut difficilement affecter une rvolution conomique. . De nombreux secteurs avaient acquis ds le 17e
ou le 18e sicle les caractres reconnus une industrie moderne c'est--dire la concentration de la main duvre, le recours des investissements importants ou encore lemploi des machines sans que cela ait modifi en quoi que se soit lconomie du pays. Si la transformation dun ou de plusieurs secteurs ne suffit pas crer une rvolution celle-ci ne suppose pas que tous les secteurs ne soient touchs. Pour Karl Marx, la rvolution industrielle se manifeste avec lapparition de la machine vapeur, la transformation des rapports de production et lapparition du proltariat. Pour Karl Polanyi (1944, La grande transformation ) la rvolution industrielle est une des manifestations dune transformation structurelle dans lhistoire de lhumanit qui va tre caractris dun point de vue conomique par le passage une conomie de march. La rvolution industrielle sest manifeste : par une rvolution dans les transports avec le dveloppement du chemin de fer et des voies navigables, des routes ; par une accumulation du capital et dveloppement des investissements ; par ltablissement de la constitution dun systme bancaire moderne ; par des transformations sociales avec la naissance de la classe ouvrire et laffirmation de la bourgeoisie industrielle. Page | 8
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
A partir de 1850, on assiste aux premires crises de surproduction qui sont lies la saturation du march international. La solution trouve ces crises est laugmentation des salaires qui va permettre de maintenir la production et les profits. Le mouvement de colonisation du 19e sicle et du dbut du 20e sicle aura aussi contribu au dveloppement du commerce mondial tel point que certains analystes caractrisent la priode qui stend entre 1880 et 1914 comme une premire vague de mondialisation.
6- De la Premire la Seconde Guerre Mondiale Le processus de mondialisation qui stait dvelopp dans la priode antrieure va tre compltement remis en cause entre les deux guerres mondiales. Le premier choc va dcouler directement des consquences de cette guerre puisque les grandes puissances europennes vont sortir de la guerre trs affaiblies et en particulier elles sont trs endettes et elles sont devenues incapables de poursuivre leur stratgie de dveloppement de leurs investissements directs ltranger (IDE). La nouvelle conomie dominante sest les Etats-Unis qui sont sortis renforcs de leur intervention en Europe partir de 1917. Cette poque marque la fin de lre des Tsars, suite la rvolution russe de 1917. Les annes 1920 vont confirmer lampleur des changements qui sont issus de la guerre avec la fin du systme de ltalon or et laffaiblissement des monnaies europennes. Par ailleurs, il y a un ralentissement des changes commerciaux. Dans ce contexte la crise qui va stendre de 1929 1932 va exprimer lampleur des dsquilibres qui se sont accumuls depuis 1914. Dans le mme temps, la monte des dictatures agressives au Japon, en Allemagne et en Italie va conduire progressivement le monde vers la Seconde Guerre Mondiale. 7- Les Trente Glorieuses et les prmisses de la mondialisation actuelle Les Trente Glorieuses est une priode qui stend de la fin de la Seconde Guerre Mondiale et qui sachve au moment du premier choc ptrolier (1973). Durant cette priode, le monde et en particulier les pays industrialiss vont connaitre une croissance conomique soutenue, rgulire et dune ampleur ingale sur une priode aussi longue. Jean Fourasti a utilis pour la premire fois cette priode de Trente Glorieuses et il crivait : ne doit-on pas dire glorieuses les trente annes qui ont fait pass la France de la vie vgtative traditionnelle au niveau de vie et au genre de vie contemporain. Les transformations conomiques au cours de cette priode sont tout fait spectaculaires puisque le produit national brut mondial est pass de lindice 100 en 1950 lindice 170 en 1960 et lindice 270 en 1970. Cette croissance sest effectue sans recul dune anne sur lautre. Mais ceci dit, cette croissance a surtout bnfici quelques pays dvelopps puisque 6 dentre eux (Etats-Unis, URSS, Japon, Rpublique Fdrale dAllemagne, France et Royaume-Uni) assuraient les deux tiers du PNB mondial en 1970. Cette priode a t marque sur le plan politique par le processus de dcolonisation dans les annes 1960 et par des tensions diplomatiques importantes entre les deux blocs Est et Ouest (Guerre Froide). Dans ce contexte les changes internationaux vont sorganiser autour de ce clivage politique fort.
Page | 9
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
II-
Les caractristiques de la mondialisation
Si on a vu que le dveloppement des changes internationaux est un phnomne ancien, on assiste depuis une trentaine dannes un dveloppement sans prcdant de ces changes. Depuis les annes 1970, linternationalisation des conomies samplifie. Cette internationalisation participe au processus de mondialisation conomique c'est--dire lmergence dun vaste march des biens, des services, des capitaux et de la force de travail saffranchissant de plus en plus des frontires politiques entre les tats et accentuant les interdpendances entre les pays. Le terme de mondialisation ou encore globalisation est apparu dans les annes 1960 mais son usage sest surtout rpandu partir des annes 1980. Jacques Adda affirme que la mondialisation est un processus distinct du processus dinternationalisation. Il dit la mondialisation c'est--dire lintgration croissante des parties constituant le tout de lconomie mondiale donne celle-ci une dynamique propre chappant de plus en plus au contrle des tats et portant atteinte aux attributs essentiels de leur souverainet tels que le contrle montaire et la gestion des finances publiques . Dans ce sens, la mondialisation constituerait donc une rupture qui contribuerait instituer un nouvel ordre plantaire. Pour dautres auteurs, la mondialisation ne doit pas tre dissocie de linternationalisation, elle constituerait donc un approfondissement de linternationalisation des changes. 1- Une intgration commerciale croissante Le commerce mondial sest trs nettement dvelopp au cours des 25 dernires annes. Dailleurs, le rapport entre les changes et le PIB mondial a plus que doubl entre 1980 et 2005. Cette hausse a t en grande partie gnre par lvolution des conomies mergentes dont la part dans les changes mondiaux a significativement progresse puisquelle est passe denviron un quart au dbut des annes 1980 environ un tiers en 2005. Sur cette priode, lexpansion des flux commerciaux internationaux a t particulirement forte partir de 1995. Depuis 1999, les conomies mergentes reprsentent plus de 40 % de la croissance des importations mondiales et plus de 50 % de la croissance des exportations mondiales. Dans ce contexte, il est intressant de noter que depuis 1990 plus des trois quarts de laugmentation de louverture commerciale des Etats-Unis et de lUnion Europenne rsultent des changes internationaux avec des pays qui nappartiennent pas lOCDE. Linsertion de ces nouveaux acteurs ne se limite pas lextension du commerce mondial car elle en transforme aussi la nature. Les changes commerciaux entre deux pays peuvent tre de deux natures diffrentes, cest ce quon appelle le commerce intra branche et le commerce inter branche. Le commerce intra branche est celui qui recouvre les changes de biens similaires (exemple : automobiles de qualits diffrentes ou identiques). Le commerce inter branche reprsente des changes de biens diffrents (exemple : change de textile contre des avions entre la Chine et la France). Suivant ces distinctions, on peut noter que les changes au sein de lUnion Europenne sont trs marqus par des changes intra branche dont la part continue daugmenter significativement sur la priode rcente avec 58 % en 1993, 64 % en 2002. A linverse, le commerce inter branche est plus important dans nos changes avec les pays tires et notamment avec les pays en dveloppement. Jusqu la fin des annes 1990 lapprofondissement des changes avec les pays dvelopps qui dominaient la structure du commerce de lUE et des Etats-Unis a contribu la rduction de la part du commerce inter branche au profit du commerce intra branche. En ce sens, les gains de la mondialisation proviennent alors principalement de laccroissement de la varit Page | 10
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
des biens qui sont consomms. Cependant, depuis quelques annes et contrairement ce quon peut observer dans les changes intra europens, la part du commerce inter branche remonte aussi bien dans les changes des Etats-Unis que dans ceux de lUnion Europenne. 2- La transformation de la place des Etats et lmergence des firmes multinationales Avec le processus de mondialisation, on assisterait laffaiblissement voire la disparition des Etats non en tant quinstance de rgulation politique mais en tant quespace conomique. Si on met de ct certains Etats forts comme la Chine, par exemple, on peut admettre que le pouvoir politique cde progressivement la place au pouvoir conomique. Les limites de lintervention de lEtat qui sont calques sur les limites de son territoire vont exclure la plus grande part du domaine conomique puisque celui-ci est devenu international. Cela signifie que linterventionnisme conomique des Etats a trouv ses limites. Le concept de patriotisme conomique qui a pu tre voqu sous diffrentes formes par des pays comme la France, lItalie ou encore les Etats-Unis a finalement peu doutils sa disposition dans le cadre du libralisme qui rgne lchelle internationale. De la mme manire la nationalit des firmes na plus tellement de signification comme le cas franais puisquentre 1917 et 2005 la part du capital tranger dorigine trangre dans les entreprises du CAC 40 est passe de 33 47 %. Daprs les estimations de la CNUCED (confrence des nations unies sur le commerce et le dveloppement) il existe aujourdhui dans le monde environ 65 000 entreprises multinationales qui comptent environ 850 000 filiales trangres tablies dans diffrents pays. Une firme est qualifie de firme multinationale lorsquelle ralise des investissements directs ltranger (IDE) c'est--dire une prise de participation assez significative dans le capital dune entreprise trangre qui lui donne en mme temps un certain contrle sur l es dcisions de cette firme. Les conventions internationales retiennent le seuil de 10 % du capital pour avoir un certain contrle. On peut rappeler que lIDE peut se faire selon deux modalits principales. Tout dabord la construction dun site de production ex nihilo ( partir de rien), on parle dinvestissements greenfield. Par le rachat dun site de production existant, on parle de fusion et acquisition internationale Lvolution des flux dIDE permet de traduire lextension du poids des firmes multinationales. Sur la priode rcente, on remarque que ces investissements ont augments rapidement sur une trentaine dannes, en particulier depuis les annes 1980. Si bien que selon certains analystes la mondialisation serait davantage porte par laccroissement des flux dIDE que par louverture commerciale des pays. Lessor ou le dveloppement de la place des firmes multinationales dans lconomie mondiale a deux consquences principales : Limpact de la multinationalisation des firmes est une source de pr occupation croissante pour les responsables politiques du monde entier mais aussi pour les travailleurs des pays dvelopps Cette activit importante des firmes multinationales amne revisiter les analyses de la mondialisation. En effet, comme ces entreprises sont naturellement trs actives sur les marchs mondiaux (daprs les estimations de la CNUCED, elles sont appliques dans prs des deux tiers des relations commerciales internationales), les rflexions sur le dveloppement du commerce international ne peuvent plus ngliger linfluence de ces acteurs aujourdhui. Les FMI sont devenus des acteurs incontournables de la mondialisation conomique.
Page | 11
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
3- Mondialisation conomique mais intgrations conomiques rgionales Les deux mouvements de mondialisation dune part et dintgration rgionale dautre part sont souvent perus comme contradictoire car la mondialisation est sens reflter la disparition des frontires alors que lintgration rgionale va traduire au contraire la volont dimposer des nouvelles frontires. La coexistence de ces deux mouvements constitue une sorte de paradoxe. Tout dabord, dun point de vue dynamique (dans le temps), la squence entre mondialisation et intgration rgionale nest pas la mme pour toutes les conomies. En effet, dans un certain nombre de pays lintgration dans le processus de mondialisation semble avoir prcd la constitution de groupements rgionaux institutionnaliss comme cest le cas par exemple du regroupement en Asie de lEst : lASEAN. Pour dautres pays et notamment les pays dAmrique latine membre du MERCOSUR, linverse est vrai. Cette constatation suggre finalement que les liens entre les dynamiques dintgration rgionale et de mondialisation sont complexes. Finalement, la coexistence de ces deux mouvements voire mme leur essor parallle pourrait suggrer que ces deux mouvements se renforcent mutuellement. Dans le cadre dune conception conomique librale, lintgration rgionale peut tre envisage comme une tape vers la mondialisation. Dans ces conditions, le rgionalisme ne serait rien dautre une forme de mso mondialisation (tape intermdiaire entre lintgration rgionale et la mondialisation conomique). Le cas du rgionalisme ouvert illustre ce cas de figure puisque le principal dterminant de cette forme dintgration est la recherche de lefficacit conomique ou de la croissance conomique travers la participation des activits qui cre de la richesse au niveau global. LUE constitue une de ces formes dintgration rgionale travers le trait de Lisbonne. Lun des principaux bnfices de la mondialisation conomique est douvrir de nouveaux marchs et de favoriser la spcialisation. Toutefois, le revers de la mdaille est quon assiste souvent un accroissement de la concurrence et en intensifiant la concurrence au niveau mondial (on parle dune concurrence sur les IDE ou sur les marchs exportations) et en exacerbant les exigences de comptitivit, la mondialisation pourrait inciter aux regroupements rgionaux. En effet, dans un environnement fortement concurrentiel il est important datteindre la taille critique ce que prcisment lintgration rgionale ne peut que favoriser. En dautres termes, lintgration rgionale peut constituer un moyen de catalyser les effets bnfiques de la mondialisation. L encore, on peut prendre lexemple de lUE, le mouvement dintgration europenne constitue une bonne illustration puisque le projet du march unique puis ltablissement dune monnaie unique taient un moyen de rpondre la concurrence qui provenait essentiellement du Japon et des Etats-Unis. 4- La globalisation financire La mondialisation conomique et la globalisation financire ont fortement impuls la croissance conomique mondiale depuis une quinzaine dannes. Dune certaine manire, cest le capitalisme international productif et financier qui a assit sa domination sur lconomie mondiale contribuant en cela une forte croissance. En moyenne la croissance conomique de 1990 2007 a t de 3,8 % par an. Ceci a essentiellement bnfici aux pays en dveloppement. Mais cette croissance a t instable. Cela est une diffrence majeure par rapport aux Trente Glorieuses. Lconomie mondiale a t secoue par une srie de crise financire dune frquence ingale dans lhistoire conomique contemporaine. Lintensit de ces crises est devenue importante. Aprs la crise de la dette des pays en dveloppement au dbut des annes 1980, la crise du systme montaire europen en 1992-1993, la crise mexicaine en 1994-1995, la crise asiatique en 1997-1998 et la mme anne la crise russe, Page | 12
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
1999 et 2002 pour le Brsil, en 2000 la crash des valeurs de la nouvelle conomie, la crise Argentine entre 2001 et 2003, 2007 la crise actuelle. Toutes ces crises montrent les risques en termes de stabilit et de soutenabilit dun mode de croissance qui est impuls par les firmes multinationales et par les marchs financiers mais aussi des risques qui sont lis des stratgies nationales non coordonnes et sans institution de gouvernance mondiale. La globalisation financire repose sur trois processus cest la rgle des 3 D : Drglementation : conduite essentiellement par les tats et qui amne abolir les entraves aux flux de capitaux et qui favorise les innovations financires (possibilit de crer de nouveaux placements) et qui permet de libraliser les transactions sur le march des changes ; Dsintermdiation financire : processus qui permet des agents besoin de financement de recourir directement au march financier plutt que de faire appel un tablissement bancaire ; Dcloisonnement des marchs : se traduit par la suppression des barrires entre les diffrents marchs montaires et financiers au sein de chaque pays et en mme temps par louverture vers lextrieur des marchs nationaux de capitaux. Depuis le dbut des annes 1980, lconomie mondiale a connu un prodigieux dveloppement des institutions et des marchs financiers qui gre des masses normes de capitaux et qui sont en qute dune rentabilit forte qui est dcouple des performances relles. Tous ces marchs financiers, de capitaux contribuent la dtermination des taux de change mais aussi des taux dintrts et par consquent, dterminent les conditions de financement des entreprises et des mnages. La globalisation financire avec ces alternances de boom et de crash rvlent que les marchs sont myopes et en plus ils sont instables mais aussi moutonniers et cyclotynique (lunatique). La globalisation financire va conduire au gonflement de dsquilibres qui finissent un jour par clater. 5- Un monde sans cesse plus urbanis Aujourdhui, une personne sur deux dans le monde est un urbain. Environ 3 milliards dautres personnes devraient rejoindre les villes dici 2050. Tout ceci accentuant un mouvement qui sacclre depuis la fin des annes 1980. Pour lessentiel, cet accroissement de la population urbaine se produit dans les villes dAfrique, dAsie et dAmrique Latine. Ces villes qui accueillent chaque mois 5 millions de nouveaux habitants contre 500 000 dans les villes dEurope et dAmrique du Nord. Finalement si on peut dire que ce processus durbanisation est un processus commun aux cinq continents, les trajectoires diffrentes restent marques par les cultures et les conditions sociales, conomiques et techniques locales. De cette manire, ce sont essentiellement des grandes villes qui vont attirer la nouvelle population urbaine en Amrique Latine, en Amrique du Nord et en Asie alors quen Europe et en Afrique la croissance urbaine se fait majoritairement dans les villes moyennes qui sont nes de lurbanisation des zones rurales. En mme temps, on observe que dans dautres villes, notamment en Europe de lEst, la population diminue ceci tant la consquence de la crise conomique que ces pays traversent. Le facteur conomique est dterminant pour comprendre cette dynamique durbanisation. En effet, le premier ressort de lurbanisation est conomique. Certaines villes vont devenir des moteurs incontournables de la mondialisation, cest ce quon appelle la ville globale. Quand on analyse les changes mondiaux concernant les biens, les services ou les capitaux se font surtout entre des villes qui sont relies les unes aux autres par de multiples rseaux matriels (voie de communication) mais aussi immatriels (rseaux politiques, culturels ou scientifiques). Ce sont ces opportunits denrichissement, conomiques qui attirent toujours plus de personnes vers les centres urbains. Limpact environnemental de ces migrations va Page | 13
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
tre proportionnel lampleur du phnomne durbanisation. En effet, on estime que les villes seraient responsables denviron 75 % des missions de gaz effet de serre en mme temps quelles consommeraient environ 75 % de lnergie lchelle globale. Cela sexplique par le fait que les villes accueillent la moiti de la population mondiale mais surtout parce quelles concentrent lessentiel de lactivit conomique. Ces proportions importantes sexpliquent aussi parce que lurbanisation a, jusqu aujourdhui, reproduit le modle dexpansion des villes des pays industrialiss comme les villes tales des Etats-Unis avides de ressources et qui ont t faonnes par le dveloppement du transport automobile et par un prix de lnergie relativement faible depuis environ un demi sicle. Or, on sait que les ressources naturelles mais galement les ressources financires nexistent plus en quantit suffisante pour continuer sur ce type de trajectoire. Tout ceci appelle une rupture profonde en termes de transport mais aussi industriel et tertiaire et enfin en termes dhabitats. Toute transition urbaine est marque par une sgrgation sociale et spatiale grandissante. La plupart des nouveaux citadins sinstallent dans des quartiers irrguliers mal desservis, mal quips et qui concentrent souvent une trs forte pauvret. Selon quelques chiffres, la part de la population urbaine prcaire ou pauvre slve 43 % en Asie du Sud et 62 % en Afrique Subsaharienne et ceci sans que les politiques daccompagnement dans ces quartiers soit la hauteur des besoins. Pourtant, parmi les objectifs du millnaire on retrouve la rduction de moiti de la population pauvre et avoir accs des rseaux deaux et dassainissements pour cette population. Finalement, les villes sont aujourdhui prises dans les flux de lconomie mondialise et les plus grands centres urbains qui sont directement connects aux rseaux commerciaux, financiers, scientifiques, culturels et politiques en sont les principaux acteurs et parfois mme ces acteurs ont plus dimportance que les tats. Exemple : le produit national brut de Tokyo est le double de celui du Brsil et la capitale japonaise concentre une population plus importante que la Sude, la Finlande, le Danemark et la Norvge runie. Cette puissance conomique nest pas le simple rsultat de lurbanisation mais plutt le rsultat dune stratgie conomique qui est fonde sur des investissements cibls comme les infrastructures notamment, secteur conomique porteur, mais aussi le capital humain : ducation, culture tout ceci permettant de rendre les villes attractives, innovantes et dynamiques.
Page | 14
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
Chapitre 2 : Les thories traditionnelles du commerce international
ILanalyse traditionnelle du commerce international
Ce chapitre expose la dmarche et les principaux rsultats de ce que lon peut considrer comme lexpression traditionnelle de la thorie du commerce international. Ce qui est au centre de lanalyse va tre la question du libre change. Dans cette perspective, linspiration des premiers auteurs relevait pour une bonne part dune dmarche normative (analyse de ce qui doit tre). Lanalyse va tenter de favoriser le libre change. Lobjectif de ces auteurs tait de montrer lavantage que les pays pouvaient retirer dune libralisation du commerce. Finalement, la dimension normative dans lanalyse du commerce international va demeurer dans une trs large mesure dans les travaux ultrieurs. Dans cette perspective le libre change va tre dcrit comme une situation optimale de rfrence. Ceci dit, comme dans toute approche conomique, il existe toujours une dimension positive de la thorie qui cherche comprendre le fonctionnement effectif de lchange international va tre galement prsente dans ces approches. Le fait que les modles thoriques multiplient les hypothses restrictives ne signifie pas quil se dsintresse de la ralit. Mais en ralit, ils vont sefforcer de la simplifier, de nen retenir que les aspects les plus fondamentaux et ceci pour mieux lexpliquer. Afin de prciser le cadre de lanalyse du commerce international, on commence par en exposer les caractristiques et les hypothses essentielles. Tout dabord, lanalyse est a-montaire, a-temporelle et a-spatiale. Cette analyse ignore la monnaie en supposant sa parfaite neutralit et elle va raisonner en termes rels plutt quen termes nominaux. Par ailleurs, elle ne fait pas intervenir le temps ce qui signifie quelle va ignorer tous les problmes de dynamique, de lajustement lquilibre. Elle ne prend pas en compte lespace et lorsquil est question de localisation des activits, cela va se faire en rfrence aux caractristiques propres au pays indpendamment de leur loignement gographique. Par ailleurs le cadre thorique reprend les hypothses qui fondent lanalyse microconomique dans un monde de concurrence pure et parfaite et de parfaite certitude. Enfin, la dimension internationale de lchange va tre caractrise en faisant rfrence une diffrence de mobilit des biens et des facteurs de production. Les biens sont supposs parfaitement mobiles au sein de chaque pays et entre les pays alors que les facteurs de production vont tre supposs parfaitement mobiles lintrieur dun mme pays mais totalement immobiles entre les pays. 1- Les fondements classiques La thorie du commerce international est ne de lanalyse qui a t dvelopp essentiellement par les auteurs classiques anglais. Les thses de ses auteurs ont t labores au moment de la rvolution industrielle en Grande Bretagne. Ces thses sopposaient aux arguments des mercantilistes qui taient favorables au protectionnisme et elles dfendaient largument oppos c'est--dire celui du libre change. En ce la, elles rpondaient aux attentes de lindustrie anglaise qui tait naissante. Les deux arguments principaux pour soutenir cette ide des vertus du libre change taient dune part la libralisation du commerce qui permettait une baisse du cot de la main duvre en rendant possible une diminution des cots de Page | 15
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
subsistance grce limportation de produits agricoles trangers moins onreux. Dun autre ct, le libre change offrait des dbouchs la production industrielle britannique. Cette adquation entre la thorie traditionnelle du commerce international et les attentes de cette poque expliquent sans doute, au mois partiellement, le succs de cette analyse. Mais si lanalyse nous intresse aujourdhui encore, cest parce que le schma gnral quelle a trac reste toujours au cur de la thorie contemporaine de la thorie internationale. Finalement, toute lanalyse du commerce international va sarticuler autour de trois questions essentielles : Pourquoi les pays changent-ils ? Question du fondement de lchange ; Quel pays change quel produit ? Question du sens de lchange ; Comment se fait lchange ? Question des termes de lchange avec son corolaire qui est la question de la rpartition de ses gains. Il est possible dtablir une correspondance entre les trois grands auteurs classiques et les trois questions fondamentales. Lapport essentiel de Smith (1776) rsiderait dans sa rponse la premire question. Pour lui, lchange est le corolaire de la spcialisation, de la division du travail qui est source de richesse. David Ricardo (1817) a marqu lanalyse du commerce international par sa rponse la deuxime question. La rponse la plus complte la question des termes de lchange va tre fournie par John Stuart Mill en 1948 avec sa loi des valeurs internationales qui nest autre quune reformulation de la loi de loffre et de la demande. Les rponses apportaient par les auteurs classiques sont encore dactualit. Certes, elles ont pu tre reformules, compltes mais elles nont jamais t compltement rejetes. a- Le fondement de lchange : la spcialisation des tches Adam Smith1 est connu pour avoir clbr les avantages de la division du travail ou de la spcialisation des tches. Cette division du travail est pour lui un moyen de produire davantage ou de produire un moindre cot. Mais cette question de la division du travail va en ralit de paire avec lchange. En effet, se spcialiser implique de renoncer soi mme certains biens qui sont obtenus en change du surplus de production que permet cette spcialisation. Cette ide va fonder toute la doctrine librale dAdam Smith et plus largement de lensemble des conomistes classiques. Ce principe va fonctionner aussi bien lchelle individuelle qu lchelle internationale. Selon cette doctrine, louverture au libre change doit tre la plus large possible puisque cest lextension du march qui va accroitre la facult dchanger et cela va donner lieu la division du travail considr comme une source de richesse. Par ailleurs lchange va permettre chacun de concentrer ses activits dans le domaine o il est le plus performant voire de renforcer ses comptences si la spcialisation accroit la productivit. Lchange va permettre une affectation plus efficace des ressources productives. En se spcialisant chaque pays va abandonner une part de la production dans laquelle il est le moins performant pour se concentrer sur la production o il est performant. Cette ide gnrale, se retrouve dans toutes les analyses du commerce international mais elle va apparaitre de manire diffrente dans les analyses qui la suite des travaux de David Ricardeau vont constituer les bases de lanalyse traditionnelle du commerce internationale depuis cette poque (dbut 19me sicle) jusqu la priode contemporaine. Dans ces formulations laccent va tre mis sur la capacit dexploiter par la spcialisation des tches, des carts de comptences qui sont pr dtermines. Pour Adam Smith, il ne sagit pas l du seul avantage de la spcialisation. Pour lui la spcialisation permet aussi daccroitre la productivit. Le renforcement de la production va pouvoir saccompagner dune baisse du cot unitaire.
1
Ouvrage de 1876
Page | 16
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
b- Le sens de lchange : de lavantage absolu lavantage relatif Deux pays : lAngleterre et le Portugal qui produisent chacun deux biens : des draps et du vin. Les cots unitaires en travail Production Pays Angleterre Portugal Drap 3 6 Vin 4 2
Chaque pays est capable de produire un bien un cot unitaire qui est dans labsolu plus faible que celui de son partenaire. Suivant lanalyse de Smith, lAngleterre possde un avantage absolu dans la production de drap tandis que le Portugal possde un avantage absolu dans la production de vin. A partir de l on comprend que la production totale des deux pays peut tre accrue si chaque pays se spcialise conformment son avantage. Mais compte tenu de la varit des besoins dans chaque pays, une telle spcialisation nest acceptable que sil existe une possibilit dchange avec le pays partenaire qui sest spcialis dans la production qui a t abandonne. La rponse la question pourquoi les pays changent-ils est assez claire : ils changent pour bnficier des avantages de la spcialisation c'est--dire de la division internationale du travail. Cette thorie va aussi apporter un dbut de rponse la question du sens des changes puisquelle enseigne que chaque pays doit se spcialiser dans la production pour laquelle il a lavantage. Ceci signifie quil va produire dans ce secteur au-del de ses besoins et quil pourra exporter le surplus de production. Cest grce ces exportations que lon pourra acqurir par le biais des importations les biens que le pays a renonc produire. Chaque pays va exporter le bien pour lequel il a un avantage absolu c'est--dire le bien quil produit un cot plus faible que son pays partenaire. Cependant on peut souligner des limites cette thorie de lavantage absolu. Ces limites apparaissent notamment quand on tente de rpondre la question qui change quoi ? En effet, lexemple mentionn ci-dessus donne une rponse assez claire, mais on ne peut pas traiter un cas o lun des deux pays serait capable de produire un cot unitaire plus faible que son partenaire. Pour tenter de rsoudre ce problme, Ricardo va proposer sa thorie ou son principe gnral de lavantage relatif (ou avantage comparatif). Les cots unitaires en travail Production Pays Angleterre Portugal Drap 3 6 Vin 4 5
Plutt que de retenir les cots absolus tels quils apparaissent dans le tableau, Ricardo va raisonner sur le rapport de ces cots. Cest ce quon appelle les cots relatifs. Lide est que pour bnficier des avantages de la spcialisation et de lchange, chaque pays doit dvelopper la production dans laquelle il a le cot relatif le plus faible. Dans lexemple, lAngleterre va possder un avantage relatif dans la production de drap et le Portugal va avoir un avantage relatif dans la production du vin. Dans un cadre avec deux pays et deux biens, on Page | 17
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
voit quon a une distribution des avantages relatifs o les positions des deux pays sont symtriques. Selon la division du travail la spcialisation et lchange international conformment au principe de lavantage relatif doit permettre une plus grande efficacit productive. En effet pour dvelopper se production de drap de une unit, lAngleterre va avoir besoin de dplacer trois units de travail de sa production de vin vers la production de drap. Cela signifie quil suffit de renoncer produire trois quart dunit de vin qui signifie que le cot relatif du drap est de trois quart en Angleterre et symtriquement, en renonant produire une unit de drap, le Portugal va pouvoir accroitre sa production de vin de 1,2 unit. Le cot relatif du drap au Portugal est de 6/5me. Ces cots relatifs mettent en vidence un avantage rciproque. La spcialisation des pays conformment leurs avantages relatifs a permis une cration nette de richesse puisquon se rend compte quon a une augmentation de la production mondiale de vin sans diminution de la production de drap. Si on suppose que les cots unitaires de production restent constants, le gain que lon a fait apparaitre peut tre obtenu de nouveau par labandon dune unit supplmentaire de la production dans laquelle le pays na pas lavantage. La recherche dun gain maximal va pousser chaque pays renoncer totalement la production pour laquelle il nest pas comptitif. On est face une logique de spcialisation intgrale sous rserve que les capacits de production soient suffisantes pour satisfaire les besoins totaux des deux pays. Un lment supplmentaire est quon na pas raisonn sur la taille des pays. Si les deux pays sont de taille ingale, on peut supposer que le grand pays peut tre conduis rduire sa production dans le secteur o il na pas lavantage relatif mais sans lannuler ceci si le petit pays ne peut rpondre la demande totale mondiale. c- Les termes de lchange : la loi de loffre et de la demande La thorie de lavantage relatif va aussi permettre de donner un dbut de rponse la question des termes de lchange. En effet, en situation dautarcie les rapports dchanges des biens dans chaque pays sont dtermins par les rapports de cot de ces biens. Pour souvrir linternational, pour tre accept par les deux partenaires, le rapport dchange international doit avoir une valeur comprise entre les rapports dchanges dautarcie. John Stuart Mill a permis da poser les mcanismes qui sont sous-jacent la dtermination de lquilibre international. Selon ses propres termes, il ne sagit que dune extension de la loi gnrale de loffre et de la demande. Les cots unitaires en travail Production Pays Angleterre Portugal Drap 3 6 Vin 4 5
En situation dautarcie il faut lquivalent en travail de trois quart dunit de vin pour produire une unit de drap en Angleterre. Alors que cette mme unit de drap peut tre obtenue avec lquivalent en travail de 6/5me dunit de vin au Portugal. Si on suppose quon ouvre les possibilits dchanges entre les pays, et donc possibilit darbitrage entre les deux pays. Il est plus avantageux dacqurir le drap en Angleterre en y vendant du vin et symtriquement il est plus avantageux dacqurir du vin au Portugal en y vendant du drap. On fait face un double dsquilibre dans cette situation. On se retrouve face une demande excdentaire de drap en Angleterre et une demande excdentaire de vin Page | 18
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
au Portugal. Tout ceci va conduire une hausse de la valeur dchange du drap en termes de vin en Angleterre et une baisse de ce mme rapport au Portugal. Ce double mouvement va se poursuivre jusqu llimination de lcart justifiant lchange entre les deux marchs nationaux. Si on fait lhypothse dune nullit des cots de transaction2 cet quilibre international va tre atteint lorsquun mme rapport dchange va prvaloir dans les deux pays. Cest la loi du prix unique qui caractrise la loi dintgration des marchs. Ce r apport dchange international dquilibre qui est compris entre les rapports dchanges dautarcie correspond une spcialisation et des flux de commerce qui sont conformes la distribution des avantages relatifs. Le rapport dchange du drap en termes de vin va tre plus lev sur le march international quen Angleterre lorsque celle-ci vivait en autarcie. Tout ceci constitue bien une incitation pour les producteurs anglais rorienter leur activit vers la fabrication du drap ce qui implique une rduction de la production de vin. Evidemment linverse vaut pour le Portugal. Le mcanisme marchand qui conduit lquilibre des changes saccompagne dune spcialisation des pays qui est celle dont lanalyse de Ricardo a pu montrer quelle tait source de gain. 2- Linterprtation factorielle du commerce international Ce sont deux conomistes Sudois Heckscher (1919) et Ohlin (1933) qui ont dvelopp une analyse des dterminants de lavantage relatif. La dmarche de ces auteurs est lie au cadre gnral dhypothse dans lequel sinscrit le modle noclassique. Dans ce cadre danalyse, ce qui va caractriser lchelle internationale et ce qui va la diffrencier de lchelle nationale cest la question de la mobilit des facteurs de production. Cette mobilit est nulle entre les pays et parfaite lintrieur de chacun des pays. Dans cette perspective ce qui va caractriser un pays cest sa dotation factorielle. On chercher identifier ou expliquer lavantage relatif et donc lchange international dans les diffrences de linterprtation factorielle de chacun des pays. La loi des proportions de facteur La loi des proportions de facteurs appels aussi le thorme de Heckscher et Ohlin peut tre nonc de cette manire : sous certaines hypothses, un pays lavantage relatif dans la production utilisant plus intensivement le facteur de production relativement plus abondant. Lanalyse reprend lensemble des hypothses du modle noclassique standard c'est-dire du principe de la concurrence pure et parfaite. Par ailleurs, dans sa version initiale, lanalyse se limite une configuration o on ne retient que deux pays qui changent deux biens qui sont produits chacun laide de deux facteurs qui sont le capital et le travail. En situation dautarcie, chacun des pays produit les deux biens.
A ces hypothses on peut en ajouter dautres qui permettent disoler les dotations factorielles comme dterminant de lavantage relatif. Les conditions de production vont dpendre simultanment des dotations en facteurs et des fonctions de production. La validation de ce thorme de Heckscher et Olhin va exiger dans un premier temps que soit neutralis linfluence potentielle des carts technologiques entre les pays. Cela signifie que lhypothse qui est faite est que pour chaque bien, on a une fonction de production identique
2
Ce sont les cots dinformation, de ngociation qui amne la conclusion des contrats. Le contrat est la forme principale dchange dans les mcanismes conomiques.
Page | 19
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
dans les deux pays. Avec cette hypothse, la question de la division internationale de linnovation technologique ne va pas se poser. Cette identit des fonctions de production va permettre de garantir que la comparaison des intensits factorielles peut tre effectue sur une base identique dans les deux pays. Mais cette hypothse nest pas suffisante. Il faut encore supposer une absence de renversement des intensits factorielles. Lintensit factorielle dune production peut tre dfinie par sa technique c'est--dire par le rapport des quantits de facteur qui sont utiliss. On distingue les facteurs substituables et les facteurs complmentaires. Si on prend le cas gnral dune production avec des facteurs substituables, le rapport des quantits de facteurs va varier en fonction du rapport de prix des facteurs. Une augmentation du prix relatif du travail par rapport au capital va induire une technique de production plus intensive dans le capital. La caractrisation des productions en termes dintensit factorielle nest possible que sil existe une invariance du classement de leurs techniques. Si la technique de production dun bien est moins capitalistique que celle de lautre bien pour une valeur donne du prix relatif des valeurs, elle doit le rester pour toute autre valeur de ce prix relatif. Cest lhypothse dirrversibilit des intensits factorielles. On peut tablir une relation entre les rapports de prix des biens et de facteurs. Si on prend lexemple dune augmentation du prix relatif du bien dont la production est relativement plus intensive en travail, ce mouvement daugmentation du prix relatif va inciter dvelopper la production de ce bien en rduisant celle de lautre bien. Etant donn les carts dintensit factorielle des deux secteurs la rduction de la seconde production va librer relativement plus de capital que de travail ce qui va conduire un dsquilibre sur le march des facteurs de production. Il rsulte de ce processus une augmentation du prix du premier facteur de production par rapport au second. Cela peut se rsumer travers le thorme de Stolper et Samuelson qui traite de la variation du prix dun bien qui sera associ une variation de mme sens du prix relatif du facteur qui est utilis intensivement dans la production de ce bien. Cette relation va permettre de fonder le thorme de Heckscher Ohlin Samuelson.
II-
Les nouvelles thories du commerce international
Depuis les travaux des premiers classiques jusquau modle de Heckscher et Olhin, on peut considrer que la thorie du commerce international a connu un dveloppement linaire. Finalement, chaque tape a tent de reformuler et dapprofondir la prcdente sans quil y ait de vritable rupture dans la dmarche qui avait t initi par les premiers classiques. A partir de la fin des annes 1950, on va assister une explosion des recherches dans le domaine du commerce international. Sans remettre fondamentalement en cause lapproche thorique traditionnelle, un certain nombre de travaux se sont efforcs de relcher certaines hypothses particulirement restrictives. Le renouvellement thorique sest encore amplifi avec le dveloppement dun certain nombre danalyse qui ont propos dexpliquer lchange international non plus sur la base dune logique dexploitation de diffrences entre les pays mais plutt sur une logique dexploitation dconomies dchelles. 1- Le paradoxe de Leontief3 La loi des proportions de facteurs qui se fonde sur une explication de lchange qui porte sur des caractristiques physiques et donc des caractristiques observables, se prte assez bien
3
Economiste Russe.
Page | 20
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
des travaux de validation empirique. Dans un premier temps une observation rapide des changes internationaux conduit accepter la proposition selon laquelle chaque pays exporte le bien qui utilise davantage le facteur dont il est relativement le mieux pourvu. Mais ce qui semblait vident tait remis en cause par les travaux de Wassili Leontief qui a tent pour la premire fois de mener une vrification empirique du thorme de Heckscher et Ohlin. Les travaux datent de 1953. Il est parti de lide que les Etats-Unis taient relativement mieux dots en capital que le reste du monde. Leontief a voulu montrer que leurs exportations avaient un contenu en capital plus lev que leurs importations. Il sest trouv confront un certain nombre de difficults. Pour valuer le contenu en facteur des biens qui sont changs, Leontief a mobilis les informations rassembles dans le tableau des changes inter industriel4. A partir de l, ltude de lintensit factorielle des secteurs amricains qui sont exportateurs pouvaient tre effectu de manire directe. Il sest retrouv coinc puisquil ne disposait pas dun tel tableau pour le reste du monde. De ce fait, il a valu le contenu en facteur productif des biens imports par les Etats-Unis partir de lintensit factorielle dans les secteurs amricains qui produisaient des biens concurrents des produits imports. Mme si il sagit dune approximation, cette procdure semble tout fait acceptable si on retient lhypothse de non renversement des intensits factorielles. Les rsultats auxquels Leontief est parvenu ont cr la surprise puisque selon ses calculs la production domestique de biens destins remplacer les importations des Etats-Unis ncessitent 30 % de capital par unit de travail en plus de ce qui est utilis dans les secteurs exportateurs. Ce rsultat contredit la loi de proportion de facteurs puisquen thorie les EtatsUnis auraient d utiliser moins de capital dans leurs secteurs importateurs que dans leurs secteurs exportateurs. On a pris lhabitude de dsigner sous lexpression de paradoxe de Leontief ce rsultat. Ce paradoxe de Leontief a aliment un nombre important de travaux la fois thorique et empirique. La plupart des tudes empiriques qui ont t ralises la suite des travaux de Leontief nont fait que confirmer les doutes quavaient fait naitre les premiers rsultats auxquels Leontief avait t parvenu. Leontief a poursuivit des tudes dans ce mme domaine et il a obtenu de nouveaux des rsultats en contradiction avec la loi des proportions de facteurs. Dautres travaux sont venus parfois confirmer ou infirmer les conclusions de ce thorme. Les tests empiriques qui ont t conduits la suite de Leontief ont soulev par leur rsultat la fois peut satisfaisant et parfois contradictoire un certain nombre de questions. Trois positions sont possibles face ce paradoxe : Rejeter purement et simplement le thorme de Heckscher et Ohlin Considrer que les tudes menes par Leontief et ses successeurs ne constituent pas un test fiable du modle thorique qui resterait valide. Approfondir lanalyse thorique pour dpasser les faiblesses du modle que les teste empiriques ont mis en vidence. Cest cette troisime voie qui a t emprunte de manire majoritaire dans les annes qui ont suivies puis partir des annes 1960, on a eu une closion, un essor du nombre de thories concurrentes qui sont plus ou moins htrodoxes. 2- Lapproche no technologique Quand on parle de technologie on parle dinnovation. Linnovation est dfinie comme tant un changement dans une fonction de production. Elle joue un rle central dans lapproche technologique en levant lhypothse dune identit des fonctions de production qui seraient
4
Tableau qui met en relation les biens et les facteurs de production
Page | 21
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
assurs par une diffusion internationale parfaite de la technologie. Posner (1961) va sefforcer de prciser cette approche en tudiant plus prcisment les composants de lcart technologique. Selon lui, linnovation va permettre une brche technologique en procurant un avantage temporaire pour les firmes qui innovent la fois dans la production et dans lexportation. Limportance de cet cart technologique va dpendre de deux dlais de rponses de la part des pays partenaires. Le premier concerne la rponse de la demande trangre face lapparition dun nouveau produit. Le second dlai est celui qui est ncessaire une raction de loffre trangre soit pour imiter soit pour acqurir cette nouvelle technologie. Posner va considrer que le premier de ces deux dlais est plus court que le second. Si bien quil existe une priode pendant laquelle les consommateurs trangers vont exprimer une demande que les producteurs trangers ne seront pas en mesure de satisfaire. Cest cet intervalle de temps durant lequel le pays innovateur va pouvoir exporter le nouveau produit. Cest en 1966 que Vernon va prolonger cette approche technologique en proposant une synthse originale de cette approche et dautres apports. Cest ce quon appelle la thorie du cycle de vie du produit. Cette thorie qui va agrger un certains nombres dapports thoriqu es multiples va proposer une approche, une conception biologique du cycle de vie du produit. Selon cette conception, la priode dexistence dun produit peut tre dcoupe en phase : La naissance La croissance La maturit Le dclin On va assister au cours du cycle de vie du produit une modification progressive des conditions qui caractrisent sa production, sa consommation et la structure de son march. Pour dfinir la dimension internationale du cycle de vie du produit, on va croiser les caractristiques de ce cycle avec les caractristiques de diffrents pays qui vont tre rpartis en trois groupes : Le pays leader : il doit cette position lexistence dun march intrieur large, des niveaux de revenus levs, une abondance de la main duvre qualifie et une forte capacit de recherche et dveloppement Le second groupe occupe une position intermdiaire et runit les pays industrialiss autre que le pays leader. Lensemble des caractristiques de ces pays sont lgrement infrieures celles du pays leader la fois en termes de revenus et en termes de capacit de recherche et dveloppement mais ces caractristiques vont faire apparaitre un avantage de dotation en capital et en main duvre moyennement qualifie. Les pays en dveloppement : il est caractris par de faibles niveaux de revenus et par une abondance de la main duvre non qualifie. En confrontant les caractristiques du cycle de vie du produit et celles des pays on va pouvoir dcrire lvolution de la production et de la consommation du produit par diffrents pays et donc den dduire les flux dchanges internationaux. La naissance du produit a lieu dans le pays leader. On assiste ensuite une priode de dveloppement du produit mais qui est limite au march interne du pays leader. Puis progressivement une extension vers les autres marchs. La diffusion du produit lchelle internationale, et en mme temps la diffusion de la technologie incorpore au produit qui se standardise, va provoquer une modification progressive de la distribution des avantages relatifs puisque les besoins en capacit de recherche et dveloppement et les besoins en main duvre hautement qualifie vont diminuer tandis que vont augmenter, par la suite, les besoins qui accompagnent le passage une production en grande srie. A partir de l, les pays industrialiss qui sont relativement bien dots en capital et qui ont t les premiers tre touch par la diffusion du produit vont pouvoir concurrencer le pays leader et ultrieurement Page | 22
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
lorsque la concurrence par les prix conduit rechercher la mise en uvre au moindre coup dune technologie banalise, on va assister un dernier basculement des avantages relatifs en faveur des pays en dveloppement. Cette thorie possde incontestablement des atouts puisquelle est une tentative dintgration dune varit dapports antrieurs varis la fois dans une vision globale et en mme temps dans une vision relativement cohrente. Tout dabord, elle possde une conception plus dynamique de la distribution des avantages relatifs qui est capable dexpliquer une volution des courants dchange des produits qui est donc un aspect positif de cette analyse. Cependant, mme si elle introduit une vision plus dynamique du commerce internationale, lanalyse semble toujours marque par un assez grand dterminisme5. Dterminisme qui apparait sous deux angles : la fois dans la hirarchisation des pays et dans le droulement du cycle. En effet, il parait tout fait concevable quun pays ou une firme puisse adopter une stratgie de remonte technologique dans une filire. Ds lors que lon accepte lide dun possible rattrapage technologique la conception dun pays leader doit tre relativise selon les produits ou selon les stratgies de dveloppement industriel mises en uvre. Le second aspect du dterminisme de lanalyse va rsider dans la conception mme du cycle. Lanalyse ne prtant pas quantifie la dure de chaque phase de ce cycle de vie mais elle semble admettre une forme dinluctabilit dans son droulement. Pourtant des stratgies industrielles ou encore commerciales peuvent altrer le droulement du cycle, par exemple en prolongeant certaines phases ou en abrgeant dautres phases, ceci afin de maintenir ou de renforcer une position sur le march mondial. La mondialisation des marchs et la multinationalisation des firmes ne peuvent que favoriser le dveloppement de telles stratgies, ceci afin dchapper au dterminisme du cycle de vie du produit. Vernon lui-mme en 1979 a reconnu ces phnomnes et la amen sensiblement nuancer le pouvoir explicatif du cycle de vie du produit compte tenu des modifications de lorganisation du commerce mondial.
On est condamn suivre un comportement donn, suivre une volution inluctable.
Page | 23
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
Chapitre 3 : Quelques lments dEconomie Politique Internationale
Lconomie internationale en tant que discipline constitue connait aujourdhui un certain essoufflement dans la mesure o elle ne parvient pas rendre compte de la complexit des relations qui se tissent dans le cadre de la mondialisation conomique car elle se focalise essentiellement sur les questions de commerce international et de finance. Berthau et Kebabdjan, La question politique en Economie Internationale, 2006, Paris, La Dcouverte, Collection Recherches. Prcisment Aubin et Norel prennent actes de cette transition qui sopre dans lanalyse conomique et ils temprent ds lors la pertinence des thories traditionnelles de lconomie internationale. Ils crivent en introduction de leur ouvrage : il nen reste pas
moins que toute analyse fine (positive ou interprtative) des situations relles doit immanquablement avoir recours lEconomie Politique Internationale, discipline relativement neuve qui conceptualise les comportements complexes des tats en interaction (avec la thorie des rgimes internationaux) et qui tudient le fait transnational .
Lconomie politique internationale serait-elle en mesure ds lors doffrir un cadre de rflexion pertinent pour penser les relations entre acteurs dans le contexte de la mondialisation conomique ?
I-
Les courants de lconomie politique internationale
Lconomie politique internationale vise expliciter les rapports de force entre les tats et donner un sens au dsordre mondial en analysant les jeux de pouvoirs conomique et politique des tats, des firmes multinationales, des organisations internationales et des ONG. Christian Chavagneux estime que lune des questions centrales auxquelles les thoriciens de lconomie politique internationale tentent de rpondre est la question suivante : qui dirige lconomie mondiale ? Cela lui permet de retenir trois courants qui se distinguent la fois par les outils quils vont mobiliser mais aussi par les visions du monde qui les sous tendent. Le premier courant est lEPI amricain, on parle aussi de lapproche no raliste. Les reprsentants sont Robert Gilpin, Robert Keohane et Joseph Nye. Ce premier courant va tenter danalyser le rle des tats dans lconomie mondiale ceux-ci exerant un pouvoir relationnel car ils sexpriment dans un affrontement direct entre les acteurs. Tout dabord, ce courant sinscrit dans une perspective de lgitimation de lordre tabli qui est port par la suprmatie amricaine et par la doctrine librale de la bonne gouvernance qui est dfendue par les institutions internationales. On cherche dfinir le bon modle qui suscitera les bonnes pratiques qui seront capables dassurer une action efficace des institutions intergouvernementales. Le second courant est lEPI Britannique, la reprsentante est Susan Strange. Ce courant montre que le pouvoir exercer par la prsence de quatre structures fondamentales, la structure Page | 24
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
de scurit, la structure de la production, la structure de la finance et la structure de la connaissance rgule les rapports de force entre les tats, les firmes multinationales, les ONG mais aussi dautres acteurs mergents comme les mafias. Chavagneux avance que cette approche structurelle du pouvoir permet de dcrypter la faon
dont sexerce le pouvoir dominant des Etats-Unis mais aussi les canaux dinfluence de la monte en puissance des acteurs privs internationaux . Si ce
second courant offre une perspective plus critique de ltat du monde, cest une approche htrodoxe, le troisime courant lest tout autant. Le troisime courant est port par Robert Cox, il sagit de lEPI Canadienne. Selon cette troisime vision, lhgmonie du modle no libral qui est fond sur la suprmatie du march est soutenue par une classe dirigeante qui sapproprie toutes les ficelles du pouvoir et qui impose sa vision du monde aux autres acteurs. Cette approche est caractrise par une critique de lidologie dominante et par un appel un contrle dmocratique des dcisions politiques et conomiques mondiales. Ce courant et Robert Cox en particulier souhaitent voir dans la constitution des mouvements internationaux alter mondialistes la voix dune mondialisation visage humain.
II-
De la thorie de la stabilit hgmonique la thorie des rgimes internationaux : lcole raliste amricaine
Mme si les concepts qui ont t forg par le courant amricain de lconomie politique internationale ont perdu la fin du 20me sicle une partie de leur pertinence avec notamment la fin de la Guerre Froide mais aussi avec lessor de la mondialisation conomique, les attentats du 11 septembre 2001 et lattitude trs offensive des Etats-Unis dans les annes qui ont suivies ont contribues renouveler lintrt pour cette approche de lconomie politique internationale. Cette cole amricaine sest constitue au cours des annes 1970 dans le prolongement du courant raliste des relations internationales. Elle a pris pour qualificatif de raliste puis de no raliste et elle propose une lecture des relations internationales fonde sur les hypothses suivantes. Les Etats nation constituent les principaux acteurs du systme international. Les autres acteurs nexercent pas dinfluence dterminante sur ce systme. Dans ce contexte, chaque tat va disposer de la mme lgitimit et en labsence dune autorit suprieure qui permet la coordination entre les tats lanarchie va devenir une caractristique fondamentale du systme. On retrouve linfluence de Hobbes et de son tat de nature c'est--dire la guerre de tous contre tous dans cette reprsentation de lconomie politique internationale. Chaque tat va agir rationnellement (sens de rationalit conomique). Chaque tat va agir rationnellement, il va faire une analyse des cots avantages de chaque situation. Chaque tat poursuit un objectif de puissance qui le conduit dfendre ses propres intrts. Comme le souligne Kebabdjan en 1999 la notion de puissance est une notion fortement subjective et sa mesure va poser des problmes mthodologiques. Est-ce quon va mesurer la puissance partir de facteurs objectifs (taille de la population par exemple, la quantit de ressources naturelle, le nombre de firmes) ou doit -elle prendre en compte des facteurs plus subjectifs (par exemple la capacit dintimidation) ? Il existerait une hirarchie dobjectifs qui va conduire donner la priorit aux questions de scurit extrieure et donc aux questions militaires (high politics) sur les Page | 25
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
questions conomiques et sociales (low politics). Lide est que le politique prime sur lconomique et le social. Ceci dit il ne faudrait pas minimiser limportance de lconomie. Mais on peut remarquer que cet aspect ne va tre peru pour ce courant que comme servant les objectifs de scurit internationale. Kebabdjan remarque ce propos en 1999 que lorsque les intrts conomiques
dun tat sopposent ses intrts politiques (faire une guerre coteuse sans contre partie conomique ou accepter de ne pas faire la guerre et enregistrer un recul politique), lorsque les arbitrages doivent tre fait entre lconomique et la politique lhypothse qui est associe au ralisme est que le politique prime sur lconomique
Cest en sappuyant sur ces trois sries dhypothse que la thorie de la stabilit hgmonique puis la thorie des rgimes internationaux ont t forgs. 1- La thorie de la stabilit hgmonique On doit Robert Keohane en 1980 davoir t le premier introduire dans le vocabulaire socio politique contemporain lexpression de thorie de la stabilit hgmonique. Ceci dit, cette thorie doit beaucoup Kindleberger dans un ouvrage publi en 1973 mme si celui-ci prfrait lexpression de leadership celle dhgmonie. Kindleberger a tudi la crise de 1929 et il va tenter dexpliquer les raisons de la persistance de cette crise tout au long des annes 1930. Il remarque en particulier que cette priode charnire concidait avec le dclin du Royaume-Uni et avec la monte en puissance des Etats-Unis mais sans que cet tat ne soit encore devenu la puissance dominante susceptible de stabiliser le systme financier international. Pour cet auteur, la ncessit dun leader ou dun hgmon rsulte du fait que lconomie mondiale a besoin de biens collectifs internationaux et la production de ces biens pose le problme du passager clandestin. La thorie de la stabilit hgmonique va sappuyer sur cette analyse pour affirmer que les tats ont intrts dans leur ensemble abdiquer une partie de leurs pouvoirs au profit de lun dentre eux (lhgmon) qui assurera la stabilit et la scurit internationale. Cet hgmon ne va pas assurer ce rle par simple gnrosit mais parce que lui-mme y trouve un intrt et notamment parce que ceci va garantir sa propre scurit. En outre, comme le souligne Grgory Vanel cet acteur en
promouvant le libre change et en produisant un bien public international cette fin prend sa charge la responsabilit de stabilisation du systme international. Aussi, deux lments complmentaires peuvent tre associs cette proposition thorique. Dune part cet acteur hgmonique provisionne un rgime de commerce international stable et, dautre part, mme si celui-ci en tire partie tous les tats en sont bnficiaires. Ces deux lments ont des implications normatives normes puisquils
Page | 26
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
reviennent justifier lexistence de lhgmonie par laugmentation gnrale du bien tre quelle produit en permettant la stabilit . Selon Gilpin la question de
la stabilit moyen et long terme du systme se pose notamment pour lhgmon dans le cadre dune socit librale. En assurant le bien tre collectif et la scurit de tous les pays, la stabilit hgmonique concoure diffuser les innovations de telle sorte que les pays qui bnficient de la scurit du systme peuvent concurrencer srieusement lhgmon luimme. Cette situation marquerait une priode de transition avec le passage dun hgmon en dclin un nouvel hgmon et les grandes puissances se livreraient une guerre hgmonique pour sassurer le pouvoir de lconomie mondiale. Cette thorie a suscit de nombreux travaux et de nombreux commentaires en particulier parce quelle offre une cl de lecture assez caricaturale des relations internationales. Ceci dit en prsence dun tat qui dclarait livrer une guerre sans merci contre les forces du mal pour assurer la scurit du monde et ceci en investissant des territoires sans aucun mandat des nations unies. Cette thorie semble encore dtenir un pouvoir explicatif ne serait ce que pour comprendre les schmas mentaux qui alimentent la rflexion et qui ont justifi la position de ce pays lgard des autres pays de la plante.
2- La thorie des rgimes internationaux Pour des auteurs cette thorie apparait comme un complment plutt que comme un concurrent de la thorie de la stabilit hgmonique. La notion de rgime international part de lide dun monde sans hgmonie. Dans ce contexte, la coordination entre les tats est rendue plus difficile mais la coopration peut conduire la constitution de rgimes internationaux. Robert Krasner dans un article paru en 1983 introduit une dfinition des rgimes internationaux qui fait aujourdhui encore figure de rfrence pour ses dfenseurs comme pour ses dtracteurs. Les rgimes internationaux dsignent les
principes, normes, rgles et processus de dcision autour desquelles convergent les anticipations des acteurs dans un domaine prcis dinteraction . Malgr
le caractre relativement flou de cette dfinition on retient la division hirarchique suivante entre les quatre attributs du rgime. Les deux premiers attributs (les principes et les normes) dsignent les finalits du rgime et se sont des lments invariants qui dsignent les buts fondamentaux (principes) et les droits et obligations (normes). Dun point de vue hirarchique ce sont les attributs principaux des rgimes. Les deux attributs suivants (rgles et processus de dcision) sont gnralement considrs comme secondaires. Il sagit dlments variables qui dsignent les instruments dont les rgimes disposent pour remplir leurs objectifs. Lide est que les rgimes sont multiples, ils oprent dans un nombre important de domaines, et cette multiplicit offre la possibilit daboutir une stabilit des relations internationales mme en labsence dun hgmon. Pour chaque domaine des relations conomiques et politiques internationales, dans le domaine du commerce ou de la finance par exemples, une ngociation sinstaure entre les pays pour aboutir une sorte de hirarchie enchevtre o les forces des uns vont contrebalance celles des autres. Le monde nest plus domin par un seul acteur mais la pluralit des rgimes va faire jouer des rapports de force qui sont beaucoup plus complexes. Dans cette approche de lEPI les questions de pouvoir ne sont pas absentes mais on a faire un pouvoir qui est beaucoup plus diffus et qui ne repose pas uniquement sur un rapport de force frontal pour quun seul vainqueur se dgage dans cette lutte. Toutefois, mme si cette Page | 27
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
thorie est bien distincte de la stabilit hgmonique. Elle partage les mmes hypothses que la thorie de la stabilit hgmonique puisque les tats demeurent les seuls acteurs importants sur la scne internationale. De nombreuses tudes empiriques ont tent dappliquer la thorie des rgimes internationaux. On peut retenir trois approches qui tentent dexpliquer la formation et la transformation des rgimes internationaux : lapproche par les intrts, lapproche par le pouvoir, lapproche par le savoir. Cette distinction on la doit Hasenclaver, Mayer et Rittberger (1997). La premire approche est lapproche par les intrts. Lide est que finalement les rgimes internationaux se mettent en place sous la pression des tats qui poursuivent chacun leurs propres intrts. Dans cette perspective, ces rgimes permettraient grce aux informations quils contribuent diffuser de rduire les incertitudes ce qui favoriserait ds lors la coopration entre les tats. Par exemple la constitution dun rgime ptrolier qui a t men suite au premier choc ptrolier par les pays de lOPEP (organisations des pays producteurs et exportateurs de ptrole) qui ont tous bien compris la ncessit de sunir pour dterminer et avoir un certain poids dans la dtermination du prix du ptrole. La seconde approche est lapproche par le pouvoir. Selon cette ide les relations de pouvoir quentretiennent les tats entre eux conduiraient la formation de rgimes dont la stabilit serait renforce par la prsence dun tat dominant. La troisime approche est lapproche par le savoir. Lide est que les rgimes se mettraient en place dans la mesure o les croyances et les savoirs normatifs des dcideurs dfinissent les relations entre les tats et influence la constitution de rgimes. En termes dapplication, la thorie des rgimes internationaux a t applique pour comprendre les coalitions qui se forment notamment au sein du commerce international et galement dans le cadre de rgimes montaires. Ceci dit un certains nombres dauteurs ont soulign le caractre assez dcevant des tudes empiriques qui ont t menes sur les rgimes internationaux. Par exemple une critique de Christian Chavagneux Economie Politique Internationale , 2004. En fait il sagit dune critique assez ancienne qui avait t formule ds 1982 par Susan Strange qui qualifiait le rgime international de concept mou. Au-del de ces critiques, il est possible de relever une srie de problmes que cette approche doit affronter pour passer dune dfinition et dune description des rgimes une vritable problmatique des rgimes. Le premier problme est la question du flou conceptuel de la notion de rgime. Dailleurs Hasenclaver, Mayer et Rittberger ont rpertori dans leur travail de synthse sur la thorie de rgimes internationaux au moins six cadres conceptuels diffrents. Et ils concluent la validit de la critique de Susan Strange. Le second problme est que le questionnement propos par la thorie des rgimes internationaux est jug trop amricano centr. Cela contribue lgitimer un certain ordre tabli. Le troisime problme est le fait que la thorie des rgimes internationaux prsente une vision trop statique et finalement elle ne donne quun cadre danalyse qui observe un ensemble de rgimes un moment donn mais elle ne sinterroge pas sur leur origine, sur les transformations de ces rgimes. On peut aussi se demander pourquoi ces rgimes sont supposs tre stables ? Toutes ces questions restent sans rponse quand on applique strictement la thorie des rgimes internationaux. Enfin, le quatrime problme est quon a toujours faire une approche qui est trop stato centre. Elle est proccupe par le rle des tats. Cest en se basant sur ces critiques quun certain nombre dauteurs ont tent de remobiliser la notion de rgime international mais en lui donnant une dimension beaucoup plus critique. Cest ce que va proposer Claude Serfati dans une contribution parue en 2006 dans louvrage de Hugon et Michalet (2006), Les nouvelles rgulations de lconomie mondiale , Paris, Karthala, Collection Economie et dveloppement . Il va remobiliser la notion de rgime international pour lappliquer la question de la dfense. Mais il va oprer un certains nombres dajustements. Premirement, il va relcher lhypothse de la dimension stato Page | 28
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
centre des relations internationales pour prendre en compte le rle des firmes et surtout les coalitions qui peuvent exister entre les firmes et les tats. Cest ce quon appel les systmes militaro-industriels qui montrent que les intrts des tats en lien avec les intrts des firmes de la production darmement sont souvent trs lis. Deuxime lment il va essayer de donner une dimension plus historique lanalyse. Toujours en mobilisant cette dimension de rgime international, il essaye de comprendre lvolution des rgimes internationaux. On peut identifier deux manires de se positionner dans la critique des rgimes internationaux. Cest soit de mener une critique interne au rgime (approche favorise par Serfati) ou on mne une critique externe ce qui revient rejeter la thorie des rgimes internationaux pour proposer une approche alternative. Cest lun des axes du programme de recherche que sest donn Strange.
III-
LEPI Britannique de Susan Strange
Lapproche htrodoxe6 de lEPI qui a t dvelopp par Susan Strange sest construite en raction aux propositions des ralistes et des no ralistes de lcole amricaine. Evidemment, lide est que leurs cadres danalyse sont juges trop troitement lis aux rles des tats et minimisent de fait le rle des autres acteurs de la mondialisation. Cest ce quelle va affirmer dans lun de ses derniers travaux en 1999 nous devons chapper et
rsister au statocentrisme inhrent lanalyse des relations internationales conventionnelles. Ltude de la mondialisation doit inclure celle du comportement des firmes tout autant que celle des autres formes de pouvoir politique. Lconomie politique internationale doit tre rassocie lconomie politique comparative au niveau infranational comme au niveau de ltat . Suivant cette
approche le pouvoir ne rsulte pas les seules pressions exerces par les tats mais il doit prendre en compte lensemble des autres acteurs. Celle-ci dfini le pouvoir comme la
capacit dune personne ou dun groupe de personnes dinfluer sur ltat des choses de telle sorte que ses prfrences aient la priorit sur les prfrences des autres. Lexercice du pouvoir relverait de quatre structures fondamentales : la structure de scurit, la structure de production, la structure financire et la structure du savoir, des connaissances.. Cest une approche du pouvoir structurelle qui se distingue
de lapproche du pouvoir amricaine, raliste qui est davantage relationnelle. 1- Les quatre structures du pouvoir
Htrodoxe : travail sur lhistorique. Critique de lapproche librale.
Page | 29
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
Comme le souligne Susan Strange, ce dcoupage na de sens que dans la mesure o les quatre dimensions sont mises en rseau pour faire apparaitre leur poids relatif et leurs interconnexions. Tout dabord, la structure de scurit. Susan Strange ne la jamais vraiment dvelopp par la suite. La structure de scurit dpasse le stricte cadre militaire puisquelle prend aussi en considration les questions de scurit sanitaire, de scurit alimentaire ou encore de scurit environnementale. Elle est dfinie comme lensemble des accords qui dterminent les conditions dans lesquelles est distribue la protection qui permet aux socits humaines de se mettre labri des menaces qui psent sur elle. La qute de scurit est une des caractristiques des socits modernes et Susan Strange estime quil est peu probable quun conflit militaire majeur oppose les grandes puissances occidentales qui ont plus intrt la paix qu la guerre. Cependant, elle se distingue dautres penseurs comme Auguste Comte ou Raymond Aron qui pensaient que le dveloppement du commerce international tait un facteur dharmonie et de paix. Selon elle, larrogance commerciale conduit des situations conflictuelles mais la paix se maintient nanmoins car la guerre peut occasionner des dgts considrables et ruiner les accords commerciaux qui ont t tablis. Dans ce contexte Strange affirme que depuis la deuxime moiti du 20 sicle lindustrie darmement occupe ct des tats un rle important et ce sont les alliances entre les tats et les industries darmement qui vont influencer cette structure de scurit. Dun point de vue mthodologique, le fonctionnement de cette structure de scurit va pouvoir tre analyse travers les marchandages auxquels se livrent les acteurs prsence. Cela dit, dans le contexte rcent la scurit militaire nest pas la menace la plus importante qui pse sur les tats et on peut mobiliser cette notion de structure de scurit pour adresser la question des catastrophes naturelles, la question des pidmies ou encore aux questions de changement climatique. La deuxime structure propose est la structure de production. Elle va dsigner lensemble des accords qui dterminent ce qui est produit, par qui, pour qui, quel endroit, avec quelles mthodes (combinaison de facteurs de production) et dans quelles conditions. Dans le contexte de la mondialisation actuelle, on peut dire que la structure de production est domine par les fusions acquisitions qui conduisent donner un poids croissant aux firmes multinationales. Selon Strange, cette concentration du capital dans les mains de grands groupes est le produit des innovations technologiques qui amnent les entreprises renouveler plus rapidement leurs quipements. Ceci conduit rendre plus coteux le capital et en mme temps diminuer sa dure de vie. Dans ce contexte particulier, la recherche du profit devient un objectif dautant plus important pour les entreprises. Comme le souligne Chavagneux, pour autant, les tats nont pas perdu tous leurs pouvoirs sur les entreprises puisquils conservent une capacit dinfluence sur les rgles du jeu conomique et social au niveau des marchs nationaux dans lesquels les firmes doivent sinscrire. Par exemple on a pu assister la fin des annes 90 la mise en place des 35 heures, qui est une mesure qui na pas fait fuir les FMN puisque la France est reste parmi les pays qui accueillent le plus dinvestissement directs ltrangers. Malgr tout, le pouvoir dinfluence des tats sur lorganisation de la production de biens et services a diminu. Ils ne peuvent aujourdhui que marchander leur place dans un environnement de concurrence exacerbe. La troisime structure est la structure financire. Elle est dfinie comme lensemble des accords qui dcident de la disponibilit des financements dans les diffrentes parties du monde et qui dfinissent le niveau des taux de change entre les devises. Dans ces domaines, les tats ont clairement perdu de leur pouvoir puisquils sont incapables de dterminer le niveau des taux de change ou encore le montant des crdits disponibles un endroit ou un autre. A ce sujet, Strange sest surtout attache retracer dans ses travaux sur la finance lhistoire des diffrentes dcisions comme le passage des taux de change fixes aux taux de change flottants ou encore la libralisation de capitaux mais aussi lhistoire de labsence de Page | 30
A.Closse
Economie Internationale
L3 AES
dcisions politiques comme par exemple le refus de lgifrer sur les paradis fiscaux qui ont amens la structure de finance dans son tat actuel c'est--dire une absence totale de maitrise des risques que cette structure financire a fait subir lconomie mondiale. Lide est de dmontrer que la finance est la principale zone de non droit ou de non gouvernance de lconomie mondiale. La quatrime structure est la structure du savoir. Elle peut se dfinir un niveau plutt abstrait comme lensemble des reprsentations du monde et donc lensemble des contraintes et des opportunits que chacun peut dvelopper en lien avec ses reprsentations. Et un niveau plus pratique elle concerne tous les accords qui dfinissent les conditions permettant de dcouvrir, daccumuler, de stocker et de communiquer des informations. Ces deux reprsentations du savoir sont lies selon Strange. Elle prcise que les quatre structures nvoluent pas de manires indpendantes. Les interactions qui peuvent exister entre ces structures vont dterminer les structures secondaires de la mondialisation dont les plus importantes sont la structure des transports, de laide public au dveloppement, de lnergie ou encore du commerce international. Une des grandes erreurs des spcialistes dconomie politique internationale est de se focaliser sur ces structures secondaires alors que ses yeux ils ngligent les structures juges les plus importantes part la structure de scurit. De ce point de vue elle rfute lapproche conomique traditionnelle qui est dabord proccup par les questions de commerce international et par le rle que jouent les tats dans ces questions de commerce international. Roger Tooze a poursuivit ses travaux dans la mme perspective. Tout comme Pierre Berthaud, conomiste luniversit de Grenoble. 2- Lapproche britannique de lEPI comme mthode de diagnostic Lide est de souligner que cette approche de lconomie politique internationale ne se prsente pas comme une thorie mais plutt une mthode de diagnostic articul en cinq points. Cette mthode de diagnostic serait valable pour nimporte domaine quon souhaite aborder. La premire tape consiste identifier le rseau complexe dautorit et de p ouvoir qui sont luvre. La seconde tape consiste mettre en vidence les accords que ces autorits ont passs entre elles et le rsultat qui en dcoule. La troisime tape est de mettre en vidence lensemble des valeurs qui sont retenues par ces autorits (valeurs de justice et dquit, de libert et dautonomie de dcision, la richesse et la prosprit, la scurit, lordre et la stabilit) et didentifier comment ces valeurs se rpartissent entre les groupes sociaux et les individus. La quatrime tape consiste identifier les points de fragilit des accords tudis. La cinquime tape consiste mettre en vidence les accords alternatifs possibles. Si on souhaite qualifier cette approche de lconomie politique internationale on peut reprendre ce quen dit Roger Tooze. Ce type dconomie politique internationale ne propose pas une thorie mais plutt un champ dinvestigation, un
ensemble particulier de questions et une srie dhypothses sur la notion de systme international et sur la faon dont on peut le comprendre .
Page | 31
A.Closse
Vous aimerez peut-être aussi
- LabsDocument21 pagesLabscuakaltaya0% (1)
- Cours Sociologie Du Travail L3 AESDocument29 pagesCours Sociologie Du Travail L3 AESPitchoune6289100% (17)
- Corrigé Dissert ProtectionnismeDocument2 pagesCorrigé Dissert ProtectionnismeMarianne Bachelet57% (7)
- Cours Contentieux Administratif, Licence AESDocument69 pagesCours Contentieux Administratif, Licence AESPitchoune6289100% (8)
- Recueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationaleD'EverandRecueil d'exercices d'économie: 330 questions et exercices corrigés de microéconomie, macroéconomie, et économie internationalePas encore d'évaluation
- French Ab Initio Paper 1 SL Markscheme FrenchDocument16 pagesFrench Ab Initio Paper 1 SL Markscheme FrenchSky RocketPas encore d'évaluation
- Cours Sociologie, L2 AESDocument21 pagesCours Sociologie, L2 AESPitchoune6289100% (3)
- Cours Économie D'entreprise, L2 AESDocument54 pagesCours Économie D'entreprise, L2 AESPitchoune6289100% (9)
- Cours de Macroéconomie Licence (S3-L2)Document106 pagesCours de Macroéconomie Licence (S3-L2)DEMBELE100% (1)
- Cours Théorie de Développement - 2020-1Document29 pagesCours Théorie de Développement - 2020-1Leonard Ilboudo75% (4)
- Cours Croissance Et Développement, Licence AESDocument30 pagesCours Croissance Et Développement, Licence AESPitchoune6289100% (6)
- Cours D'économie de DéveloppementDocument29 pagesCours D'économie de DéveloppementSerge100% (5)
- Économie Internationale - 8e ÉdDocument398 pagesÉconomie Internationale - 8e Édloubanita loubna100% (2)
- Correction Dissertation Mondialisation Et CroissanceDocument4 pagesCorrection Dissertation Mondialisation Et CroissanceMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Cours Croissance Et Développement, Licence AESDocument30 pagesCours Croissance Et Développement, Licence AESPitchoune6289100% (6)
- L3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEDocument37 pagesL3 AES, Cours ECONOMIE REGIONALEPitchoune628971% (7)
- Cours Economie Du Travail, L3 AESDocument26 pagesCours Economie Du Travail, L3 AESPitchoune6289100% (8)
- Cours Droit Des Contrats Publics, L2 AESDocument22 pagesCours Droit Des Contrats Publics, L2 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialeDocument37 pagesCours Création D'entreprise, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (18)
- Cours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialeDocument22 pagesCours Droit Administratif, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (3)
- L'union sacrée, le citoyen, et la démocratie: I. Une guerre unilatérale qui ne dit pas son nom.D'EverandL'union sacrée, le citoyen, et la démocratie: I. Une guerre unilatérale qui ne dit pas son nom.Évaluation : 3.5 sur 5 étoiles3.5/5 (2)
- Cours Economie Internationale Agdal ZouiriDocument124 pagesCours Economie Internationale Agdal ZouiriHicham Ait-bellaPas encore d'évaluation
- Les Relations Economique InternationalesDocument58 pagesLes Relations Economique InternationalesEvox50% (2)
- Economie Internationale S6 Prof YahyaDocument10 pagesEconomie Internationale S6 Prof YahyaAhmed JebariPas encore d'évaluation
- Relation Économique InternationaleDocument22 pagesRelation Économique InternationaleAyoub AdardorPas encore d'évaluation
- Cours de Tci - 2021-2022Document36 pagesCours de Tci - 2021-2022Roselin TouréPas encore d'évaluation
- Cours D'économie InternationaleDocument101 pagesCours D'économie InternationaleHamza Diouri86% (7)
- Balance Des PaiementDocument4 pagesBalance Des PaiementOujda Mohammed50% (2)
- Relations Économiques Internationales - Copie S6Document112 pagesRelations Économiques Internationales - Copie S6Hayate Zaher50% (2)
- MondialisationDocument15 pagesMondialisationmassipssaPas encore d'évaluation
- Fiche 1 - Les Fondements Du Commerce InternationalDocument6 pagesFiche 1 - Les Fondements Du Commerce InternationalMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Séance 7 Le ProtectionnismeDocument6 pagesSéance 7 Le ProtectionnismeMariam BouzouranePas encore d'évaluation
- Tableau Comparatif Avantages Et Inconvenients Du Libre EchDocument2 pagesTableau Comparatif Avantages Et Inconvenients Du Libre EchGRADUATE100% (1)
- Chapitre 1 - Les Théories Du Commerce International PDFDocument13 pagesChapitre 1 - Les Théories Du Commerce International PDFVictor Ollivier75% (8)
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- La Croissance ÉconomiqueDocument14 pagesLa Croissance ÉconomiqueHicham AtroniPas encore d'évaluation
- Résumé de La Pensé ÉconomiqueDocument11 pagesRésumé de La Pensé Économiquemalaga04100% (1)
- Chapitre 2 Le Développement ÉconomiqueDocument6 pagesChapitre 2 Le Développement ÉconomiqueChaimae Bouzagane100% (1)
- Commerce InternationalDocument33 pagesCommerce Internationalyoussef el omariPas encore d'évaluation
- Resumé de R.E.I S6Document14 pagesResumé de R.E.I S6ngadi el adel marouanePas encore d'évaluation
- Commerce InternationalDocument15 pagesCommerce InternationalKaneki GoulPas encore d'évaluation
- Economie Internationale I-1Document13 pagesEconomie Internationale I-1Salma ElkhatebPas encore d'évaluation
- Correction Devoir Comptabilité Nationale 2008 2009Document6 pagesCorrection Devoir Comptabilité Nationale 2008 2009Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Le Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson de La Théorie de CommerceDocument17 pagesLe Modèle Heckscher-Ohlin-Samuelson de La Théorie de Commerceoumaima faridiPas encore d'évaluation
- Fiche 3 À 5 Du Chapitre Croissance Et Développement 2010-2011Document12 pagesFiche 3 À 5 Du Chapitre Croissance Et Développement 2010-2011Mme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Libre Echange Et Protectionnisme WWW - Etudiant MarocDocument9 pagesLibre Echange Et Protectionnisme WWW - Etudiant MarocetudmarocPas encore d'évaluation
- Commerce Mondial ExposéDocument20 pagesCommerce Mondial ExposéKing Hai92% (13)
- Dissertation MondialisationDocument6 pagesDissertation MondialisationNoura ÉconomistePas encore d'évaluation
- Relations Economiques InternationalesDocument19 pagesRelations Economiques Internationalesdocisitt100% (2)
- Fiche 2 - Libre-Échange Et ProtectionnismeDocument4 pagesFiche 2 - Libre-Échange Et ProtectionnismeMme et Mr Lafon100% (3)
- Disertation Economique 2 PDFDocument16 pagesDisertation Economique 2 PDFTayeb BouguedraPas encore d'évaluation
- Accroche Dissertation EconomiqueDocument6 pagesAccroche Dissertation EconomiqueAdams Bothes100% (1)
- Chapitre 1) Les Échanges Internationaux de Biens Et Services Et Leur ÉvolutionDocument8 pagesChapitre 1) Les Échanges Internationaux de Biens Et Services Et Leur ÉvolutionAmel100% (2)
- Théorie Du Commerce InternationalDocument131 pagesThéorie Du Commerce Internationalvisiondafrique67% (6)
- Leçon 2 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Internationaux - OdtDocument15 pagesLeçon 2 - Avantages Et Inconvénients Des Échanges Internationaux - OdtMme et Mr Lafon100% (1)
- Chapitre 2) L'Évolution de La Structure Des Échanges Internationaux de Biens Et ServicesDocument6 pagesChapitre 2) L'Évolution de La Structure Des Échanges Internationaux de Biens Et ServicesAmel60% (5)
- Chapitre Introductif Croissance DéveloppementDocument13 pagesChapitre Introductif Croissance DéveloppementMme et Mr Lafon100% (11)
- 2131 - Comment Définir La MondialisationDocument2 pages2131 - Comment Définir La MondialisationMme et Mr Lafon100% (1)
- Dissertation Économique Et Commentaire de TexteDocument10 pagesDissertation Économique Et Commentaire de Textebeebac2009100% (2)
- Introduction À L - ÉconomieDocument19 pagesIntroduction À L - ÉconomieELAliPas encore d'évaluation
- Cours D'économie Monétaire 2ème Année. 2013 PDFDocument79 pagesCours D'économie Monétaire 2ème Année. 2013 PDFkoudougou100% (1)
- Politique Économique (Résumé)Document3 pagesPolitique Économique (Résumé)MouradBardach100% (1)
- Cours D EconomieDocument57 pagesCours D EconomieElena Laura Bejinariu0% (1)
- MONDIALISATIONDocument27 pagesMONDIALISATIONHala100% (2)
- 3 Les Firmes Multinationales Et Leur Rôle Dans L'économieDocument7 pages3 Les Firmes Multinationales Et Leur Rôle Dans L'économieaboucharaf50% (4)
- Inflation Et Chomage PDFDocument34 pagesInflation Et Chomage PDFSaad Hakawi63% (8)
- Avantages Comparatifs Et Des Dotations FactoriellesDocument31 pagesAvantages Comparatifs Et Des Dotations FactoriellesMme et Mr Lafon100% (3)
- Economie Generale Premiere AnneeDocument65 pagesEconomie Generale Premiere AnneeAndriambololosoa Hyacinthe TOVONIAINAPas encore d'évaluation
- Reconnexion de l Afrique a l economie mondiale: Defis de la mondialisationD'EverandReconnexion de l Afrique a l economie mondiale: Defis de la mondialisationÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- L3 AES, Finances PubliquesDocument74 pagesL3 AES, Finances PubliquesPitchoune628967% (3)
- Cours Sociologie, L3 AESDocument27 pagesCours Sociologie, L3 AESPitchoune6289100% (1)
- Cours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialeDocument35 pagesCours Politiques Économiques, L2 Administration Economique Et SocialePitchoune6289100% (9)
- Cours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESDocument20 pagesCours Villes Et Territoires Urbains, L2 AESPitchoune6289Pas encore d'évaluation
- Cours Démographie, L3 AESDocument21 pagesCours Démographie, L3 AESPitchoune6289100% (3)
- Cours Droit Pénal, L2 AESDocument43 pagesCours Droit Pénal, L2 AESPitchoune62890% (1)
- Cours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialeDocument69 pagesCours Droit Commercial, L2 Administration Economiqueet SocialePitchoune628950% (2)
- L21B7432 DS311 Machine CardDocument6 pagesL21B7432 DS311 Machine CardMiguel RomoPas encore d'évaluation
- 7 - PPT - La Gestion de Maintenance Assist e Par Ordinateur - FR D Ric Boutier 2Document15 pages7 - PPT - La Gestion de Maintenance Assist e Par Ordinateur - FR D Ric Boutier 2moPas encore d'évaluation
- S43 CoursChap2 7Document5 pagesS43 CoursChap2 7Samsung 7seriePas encore d'évaluation
- Devoir Corrigé de Contrôle N°2 - Sciences Physiques - Bac Sciences Exp (2014-2015) MR Sdiri AnisDocument9 pagesDevoir Corrigé de Contrôle N°2 - Sciences Physiques - Bac Sciences Exp (2014-2015) MR Sdiri AnisMohamedBenKacemPas encore d'évaluation
- Kouam KenmogneDocument8 pagesKouam KenmogneLucien Zeh MballaPas encore d'évaluation
- Plaquette AB-ENGINEERING - WebDocument3 pagesPlaquette AB-ENGINEERING - WebChrist MbiaPas encore d'évaluation
- Cahier Des Charges Telephone 2020Document2 pagesCahier Des Charges Telephone 2020MariaPas encore d'évaluation
- Le Livret Du Petit Scientifique 2021-1-2Document43 pagesLe Livret Du Petit Scientifique 2021-1-2Mehdi SbaaouiPas encore d'évaluation
- PRG Elec Anal PF2Document7 pagesPRG Elec Anal PF2DAP creatPas encore d'évaluation
- Skirandomag Numero 45Document59 pagesSkirandomag Numero 45Nm31Pas encore d'évaluation
- Cahier de Préparation PDFDocument33 pagesCahier de Préparation PDFMajda noujomPas encore d'évaluation
- MargineDocument6 pagesMarginemhoaamd22Pas encore d'évaluation
- Pressions Environnementales Et Nouvelles StrategieDocument12 pagesPressions Environnementales Et Nouvelles StrategieMohammed MedPas encore d'évaluation
- cc2 CorrigeDocument4 pagescc2 CorrigeAadilPas encore d'évaluation
- Cor Acti Modelisation Poutre Beton ArmeDocument15 pagesCor Acti Modelisation Poutre Beton ArmeMarius nanfackPas encore d'évaluation
- Carminat 2Document62 pagesCarminat 2habibcom_minePas encore d'évaluation
- Devoir de Contrôle N°4 - Math - 1ère AS (2011-2012) MR BELLASSOUED MOHAMEDDocument2 pagesDevoir de Contrôle N°4 - Math - 1ère AS (2011-2012) MR BELLASSOUED MOHAMEDPFEPas encore d'évaluation
- Rectification (Mecanique)Document3 pagesRectification (Mecanique)Hassen FJ0% (1)
- Maroc Fiche Pays CDVDocument6 pagesMaroc Fiche Pays CDVjulia.sels05Pas encore d'évaluation
- La Pedagogie Charlotte Mason 1 - Laffon, Laura PDFDocument123 pagesLa Pedagogie Charlotte Mason 1 - Laffon, Laura PDFAhmed AminePas encore d'évaluation
- Prod Levure42163210-J6013Document12 pagesProd Levure42163210-J6013suire.simonPas encore d'évaluation
- Programme D'entretien Ford Fiesta ST 2007Document2 pagesProgramme D'entretien Ford Fiesta ST 2007Seb NagelPas encore d'évaluation
- Cours Geologie Historique Version-2012Document43 pagesCours Geologie Historique Version-2012David Ahoua100% (3)
- Applications Générales ArcGisDocument23 pagesApplications Générales ArcGisNassima TabloulPas encore d'évaluation
- Intro Éloi TFCDocument18 pagesIntro Éloi TFCJACQUES FAUSTINPas encore d'évaluation
- Mines Ponts MP 2012 Chimie EnonceDocument8 pagesMines Ponts MP 2012 Chimie Enonceahmed aboulkacemPas encore d'évaluation
- Cours 1Document6 pagesCours 1mister633Pas encore d'évaluation
- Dolomie, MagnésiteDocument36 pagesDolomie, MagnésiteNajidYasserPas encore d'évaluation