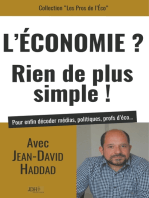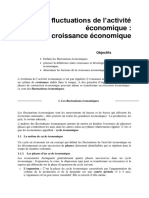Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (Livres IV, V & VI) - J. M. Keynes
Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (Livres IV, V & VI) - J. M. Keynes
Transféré par
torpe90Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (Livres IV, V & VI) - J. M. Keynes
Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaie (Livres IV, V & VI) - J. M. Keynes
Transféré par
torpe90Droits d'auteur :
Formats disponibles
John Maynard KEYNES (1936)
Thorie gnrale
de lemploi, de lintrt
et de la monnaie
Traduit de lAnglais par Jean- de Largentaye (1942)
Livres IV, V et VI
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 2
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
John Maynard KEYNES
Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (1936)
Livres IV, V et VI.
Traduit de lAnglais par Jean- de Largentaye (1942)
Une dition numrique ralise partir du livre de John Maynard Keynes,
Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (1936). Traduit de
lAnglais par Jean de Largentaye (1942). Paris : ditions Payot, 1942.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
Toutes les formules ont t ralises avec lditeur dquations du
traitement de textes, ce qui rend manipulable toutes les formules.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft
Word 2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 20 juin 2002 Chicoutimi, Qubec.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 3
Table des matires
Voir le premier fichier
Prface pour l'dition franaise, 1942
prface de l'dition anglaise, 1936
note du traducteur, 1942
Livre I
Introduction
I. - La thorie gnrale
II. - Les postulats de l'conomie classique
III. - Le principe de la demande effective
Livre II : Dfinitions et concepts
IV. - Le choix des units
V. - De la prvision en tant qu'elle dtermine le volume de la production et
de l'emploi
VI. - La dfinition du revenu, de l'pargne et de l'investissement
I. - Le revenu
II. - L'pargne et l'investissement
Appendice sur le Cot d'usage
VII. - Nouvelles considrations sur le sens des notions d'pargne et
d'investissement
Livre III : La propension consommer
VIII. - La propension consommer I. - LES facteurs objectifs
IX. - La propension consommer II. - LES facteurs subjectifs
X. - La propension marginale consommer et le multiplicateur
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 4
Livre IV : L'incitation investir
XI. - L'efficacit marginale du capital
XII. - L'tat de la prvision long terme
XIII. - La thorie gnrale du taux de l'intrt
XIV. - La thorie classique du taux de l'intrt
Appendice relatif aux taux de l'intrt tel qu'il apparat dans les Principes
d'conomie de Marshall, dans les Principes d'conomie Politique de
Ricardo, et en d'autres ouvrages
XV. - Les motifs psychologiques et commerciaux de la liquidit
XVI. - Observations diverses sur la nature du capital
XVII - Les proprits essentielles de l'intrt et de la monnaie
XVIII. - Nouvel expos de la thorie gnrale
Livre V : Salaires nominaux et prix
XIX. - Variations des salaires nominaux
Appendice sur la Thorie du Chmage du Professeur Pigou
XX. - La fonction de l'emploi
XXI. - La thorie des prix
Livre VI : Notes succinctes suggres par la thorie gnrale
XXII. - Notes sur le cycle conomique
XXIII. - Notes sur le mercantilisme, les lois contre l'usure, la monnaie
estampille, et les thories de la sous-consommation
XXIV. - Notes finales sur la philosophie sociale a laquelle la thorie gnrale
peut conduire
LEXIQUE
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 5
Livre IV
L'incitation investir
Retour la table des matires
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 6
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XI
L'efficacit, marginale du capital
I
Retour la table des matires
Quand un homme achte un bien de capital ou investissement, il achte le droit
la srie de revenus escompts qu'il espre tirer pendant la dure de ce capital de la
vente de sa production, dduction faite des dpenses courantes ncessaires obtenir
ladite production. Il sera commode d'appeler cette srie d'annuits
1
Q
,
2
Q
...
N
Q
le rendement escompt de l'investissement.
En regard du rendement escompt de l'investissement, nous avons le prix d'offre
du bien de capital. Ce terme dsigne, non le prix de march auquel un capital du m-
me type peut tre en fait achet sur le march, mais bien le prix qui est juste suffisant
pour dcider un fabricant produire une unit nouvelle supplmentaire de ce capital,
c'est--dire ce que l'on appelle parfois son cot de remplacement. La relation entre le
rendement escompt d'un capital et son prix d'offre ou cot de remplacement, i. e. la
relation entre le rendement escompt et le cot de production d'une unit supplmen-
taire de ce capital, nous donne l'efficacit marginale de ce capital. Plus prcisment
nous dfinirons l'efficacit marginale d'un capital le taux d'escompte qui, appliqu
la srie d'annuits constitue par les rendements escompts de ce capital pendant son
existence entire, rend la valeur actuelle des annuits gale au prix d'offre de ce
capital. Ceci nous donne les efficacits marginales des diffrents types de capital. La
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 7
plus leve de ces efficacits marginales peut tre considre comme l'efficacit
marginale du capital en gnral.
Le lecteur observera que l'efficacit marginale du capital est dfinie ici en fonc-
tion de la prvision de rendement d'un capital et de son prix d'offre courant. Elle
dpend de l'importance du revenu attendu de l'argent lorsqu'on l'investit dans un
capital nouveau, et non de la relation effective qu'aprs la fin de la vie d'un capital on
constate rtrospectivement entre son rendement rel et son cot originel.
Lorsque l'investissement dans un type quelconque de capital s'accrot durant une
certaine priode, l'efficacit marginale de ce capital diminue pour deux raisons
mesure que l'investissement augmente. D'abord le rendement escompt de ce capital
diminue lorsque son offre augmente. Ensuite la comptition autour des ressources
servant le produire tend normalement faire monter son prix d'offre. C'est en gn-
ral le second facteur qui dans un temps limit contribue principalement tablir
l'quilibre ; mais, plus la priode considre est longue. et plus le premier tend se
substituer au second. On peut donc tracer pour chaque type de capital une courbe
indiquant de combien l'investissement dans ce capital doit s'accrotre au cours de la
priode pour que la valeur de son efficacit marginale baisse un chiffre quelconque.
On peut ensuite, en additionnant pour tous les types de capital les flux d'investisse-
ment qui correspondent une mme valeur de l'efficacit marginale, tracer la courbe
reliant les divers flux globaux d'investissement aux valeurs de l'efficacit marginale
qui leur correspondent. Nous appellerons cette courbe tantt la courbe de la demande
de capital tantt la courbe de l'efficacit marginale du capital.
Ds lors il est vident que le flux effectif d'investissement tend augmenter
jusqu' ce qu'il n'y ait plus aucune catgorie de capital dont l'efficacit marginale soit
suprieure au taux de l'intrt courant. En d'autres termes, l'investissement tend
grossir jusqu' ce que sur la courbe de la demande de capital l'efficacit marginale
tombe au niveau du taux d'intrt du march
1
.
Cette ide peut tre exprime sous une autre forme. Si Q est le rendement es-
compt d'un capital l'poque future r, et
r d
la valeur actuelle calcule au moyen du
taux d'intrt courant de 1 disponible dans r annes, le prix de demande de ce
capital sera
r
r
Q
d
. L'investissement se dveloppera donc jusqu' ce que
r
r
Q
d
soit gal son prix d'offre, tel qu'il a t dfini au dbut du chapitre. Si au contraire
r
r
Q
d
est infrieur au prix d'offre, il n'y aura aucun investissement dans le capital
en question.
Il s'ensuit que l'incitation investir dpend en partie de la courbe de la demande
de capital et en partie du taux de l'intrt. On devra attendre la fin du Livre IV pour
embrasser sous la forme complexe quils revtent dans la ralit l'ensemble des
facteurs qui dterminent le flux d'investissement. Nanmoins nous demandons au
lecteur de noter tout de suite que ni la connaissance du rendement escompt d'un ca-
pital ni celle de son efficacit marginale ne permettent de dterminer le taux de
1
Pour la simplicit de l'expos nous avons nglig le fait que l'on a affaire une gamme de taux
d'intrt et de taux d'escompte correspondant aux priodes diffrentes qui doivent s'couler avant
que les divers rendements du capital apparaissent. Mais il est ais de refaire le raisonnement en
tenant compte cette difficult.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 8
l'intrt ou la valeur prsente de ce capital. Il faut tirer le taux de l'intrt d'une autre
source et C'est alors seulement qu'on peut connatre la valeur d'un. investissement en
capitalisant son rendement escompt.
II
Comment la dfinition de l'efficacit marginale du capital qui vient d'tre donne
se relie-t-elle l'usage courant ? La Productivit, le Rendement., l'Efficacit ou
l'Utilit marginales du capital sont des termes familiers dont nous nous sommes tous
frquemment servis, Mais il n'est pas facile de trouver dans la littrature conomique
une claire dfinition du sens que les conomistes ont gnralement voulu leur donner.
Trois quivoques pour le moins doivent tre dissipes. La premire porte sur le
point de savoir si l'on s'attache l'accroissement de production physique par unit de
temps qui rsulte de l'emploi supplmentaire d'une unit physique de capital, ou bien
l'accroissement de valeur qui rsulte de l'emploi additionnel d'une unit de valeur de
capital. Dans le premier cas la dfinition de l'unit physique de capital soulve des
difficults qui nous paraissent la fois insolubles et dpourvues d'intrt. Sans doute
peut-on dire que sur une aire dtermine dix laboureurs rcolteront plus de bl s'ils
sont en. mesure d'employer plus de machines ; mais nous ne voyons pas le-moyen de
rduire cette ide une expression arithmtique intelligible sans revenir la notion de
valeur. Maintes discussions sur ce sujet semblent nanmoins se rapporter la produc-
tivit physique du capital, entendue dans un certain sens ; mais les auteurs ne russis-
sent pas se faire clairement comprendre.
La deuxime question qui se pose est de savoir si l'efficacit marginale du capital
est une quantit absolue ou une proportion. Les contextes o elle intervient et le fait
qu'on la traite habituellement comme si elle avait la mme dimension que le taux
d'intrt exigent, semble-t-il, qu'elle soit une proportion. Mais il est rare qu'on indique
clairement la nature des quantits qui sont supposes constituer les deux termes du
rapport.
Reste enfin une distinction, dont la mconnaissance a t la principale source de
confusion et d'erreur, savoir, la distinction entre l'accroissement de valeur que l'em-
ploi d'une quantit additionnelle de capital doit procurer dans la situation actuelle et
la srie des accroissements de valeur qu'on espre obtenir pendant l'existence entire
du capital additionnel ; i. e. entre
1
Q
et la srie complte
1
Q
,
2
Q
...
r
Q
... Cette
distinction pose tout le problme du rle de l prvision dans la thorie conomique.
La plupart des discussions relatives l'efficacit marginale du capital semblent
ngliger les termes de la srie autres que
1
Q
. Une telle mthode ne pourrait se
justifier que dans une thorie statique o les valeurs de Q seraient toutes gales. La
thorie ordinaire de la distribution des richesses, qui suppose que le capital obtient
actuellement un revenu gal sa productivit marginale (dans un sens ou dans un
autre), ne vaut que dans une conomie stationnaire. Le revenu global dont le capital
bnficie - dans la priode Courante n'a pas de rapport direct avec son efficacit
marginale ; le revenu courant la limite de la production bnficiaire (i. e. le revenu
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 9
qui entre dans le prix d'offre de la production) n'est autre que le cot d'usage, lequel
n'est pas en relation immdiate avec l'efficacit marginale.
Il est remarquable qu'aucune explication claire n'ait t donne du sujet. Cepen-
dant, nous estimons que le sens dfini ci-dessus est trs voisin de celui qu'avait ce
terme dans l'esprit de Marshall. La propre expression dont il se sert est l'efficacit
marginale nette d'un facteur de production ; ou encore l'utilit marginale du
capital . On trouvera ci-dessous un rsum des passages les plus significatifs que
nous ayons pu trouver dans ses Principles (6e dition, pp. 519-520). Afin d'exprimer
l'essentiel de sa thse nous avons assembl des phrases qui ne se suivent pas dans son
texte :
Supposons que dans une fabrique un supplment de machines valant 100
puisse tre utilis en des conditions telles que leur emploi n'entrane aucune dpense
supplmentaire autre que leur cot et dtermine un accroissement de production nette
ayant une valeur de 3 par an, dduction faite de leur amortissement. Si les per-
sonnes qui investissent engagent d'abord leurs capitaux dans les emplois qui parais-
sent susceptibles de fournir un rendement lev et si, ces investissements une fois
raliss et l'quilibre tabli, l'emploi du supplment de machines considr est encore
une opration tout juste payante, on peut en dduire que le taux annuel de l'intrt est
3 pour cent. Mais des exemples de ce genre n'illustrent qu'en partie l'action des gran-
des causes qui gouvernent la valeur. On ne peut sans raisonner en cercle vicieux s'en
servir pour construire une thorie du taux de l'intrt ou mme une thorie des salai-
res... Supposons que le taux d'intrt affrent des obligations parfaitement garanties
soit 3 pour cent l'an et que l'industrie chapelire absorbe un million de Livres. Ceci
signifie que, jusqu' concurrence de l'quivalent d'un million de Livres, cette industrie
est en mesure de tirer du capital un profit suffisant pour qu'elle ait avantage payer
chaque anne 3 pour cent net pour l'utiliser plutt qu s'en passer. Il peut exister de
l'outillage dont l'industrie n'aurait pas voulu tre prive mme si le taux de l'intrt
avait t 20 pour cent l'an. Si le taux de l'intrt avait t 10 pour cent l'on aurait
employ plus d'outillage ; s'il avait t 6, plus encore; s'il avait t 4, plus encore; et
finalement, le taux de l'intrt tant 3 pour cent, l'on emploie un outillage encore plus
considrable. Lorsque ce volume d'outillage est employ, son efficacit marginale,
c'est--dire celle des machines qu'il est tout juste avantageux d'employer, a pour
mesure 3 pour cent .
Marshall avait donc vu, cela ne fait aucun doute, qu'on ne pouvait, sans s'engager
dans un cercle vicieux, chercher dterminer par un tel raisonnement la valeur effec-
tive du taux de l'intrt
1
. Dans ce passage, il semble adopter la conception expose
ci-dessus d'aprs laquelle le taux de l'intrt dtermine le montant que l'investisse-
ment nouveau tend atteindre lorsque la courbe de l'efficacit marginale est donne.
Si le taux de l'intrt est gal 3 %, ceci signifie qu'aucune personne n'achtera une
machine de 100 Livres moins qu'elle n'espre ajouter ainsi 3 sa production nette
annuelle, compte tenu de la dprciation de la machine et des cots qui rsultent de
son emploi. Mais nous verrons au Chapitre XIV qu'en d'autres passages Marshall se
1
Mais n'avait-il pas tort de supposer que la thorie des salaires fonde sur la productivit marginale
tait galement un cercle vicieux ?
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 10
montre moins circonspect, encore qu'il batte en retraite lorsque son raisonnement le
conduit sur un sol mouvant.
Bien qu'il n'emploie pas l'expression d' efficacit marginale du capital , le
Professeur Irving Fisher dans sa Theory of Interest (1930) donne de ce qu'il appelle le
taux de rendement par rapport au cot une dfinition identique la ntre. Le
taux de rendement par rapport au cot crit-il
1
- est le taux qui, employ pour
calculer la valeur actuelle de tous les cots et la valeur actuelle de tous les rende-
ments, rend ces deux quantits gales. Le Professeur Fisher explique que l'exten-
sion de l'investissement dans une direction quelconque dpend de la relation existant
entre le taux de l'intrt et le taux de rendement par rapport au cot. Pour provoquer
un investissement nouveau le taux de rendement par rapport au cot doit tre
suprieur au taux de l'intrt
2
Cette grandeur nouvelle (ou ce facteur nouveau)
introduite dans notre tude joue le rle principal dans la partie de la thorie de
l'intrt qui a trait l'opportunit de l'investissement
3
. La notion de taux de ren-
dement par rapport au cot du professeur Fisher et notre concept d' efficacit mar-
ginale du capital ont donc le mme sens et servent au mme usage.
III
La confusion la plus importante quant au sens et la porte de l'efficacit mar-
ginale du capital a eu pour origine la mconnaissance du fait que cette efficacit
marginale dpend du rendement escompt du capital, et non pas simplement de son
rendement courant. La meilleure faon d'illustrer ce fait sera d'indiquer l'effet produit
sur ladite efficacit marginale par une prvision de changements dans le cot es-
compt de la production, que ces changements soient attendus d'inventions et de tech-
niques nouvelles ou bien de variations dans le cot du travail, c'est--dire dans l'unit
de salaire. La production obtenue l'aide de l'quipement fabriqu aujourd'hui con-
courra pendant l'existence de cet quipement avec la production qui sera obtenue
l'aide d'quipements fabriqus plus tard. Il se peut que, au moment o ces derniers
quipements seront fabriqus, le cot du travail soit moins lev et la technique
meilleure. Ces quipements pourraient alors tre rmunrs, mme si leur production
tait vendue un prix moindre ; et leur quantit s'accrotrait jusqu' ce que le prix de
vente de leur production ft gal au chiffre minimum ncessaire les rmunrer.
D'autre part le profit (exprim en monnaie) que les entrepreneurs tireront de leur
quipement, ancien ou nouveau, se trouvera rduit s'il advient que la production tout
entire soit fabrique meilleur march. L'efficacit marginale actuelle du capital
diminue dans la mesure o de tels vnements paraissent probables ou simplement
possibles.
C'est par l que l'attente d'une variation de valeur de la monnaie influe sur le
volume de la production courante. La perspective d'une baisse de valeur de la mon-
naie stimule l'investissement et par suite, en rgle gnrale, l'emploi, parce qu'elle
lve la courbe de l'efficacit marginale du capital, i. e. la courbe de la demande de
1
Op. cit., p. 168.
2
Op. cit., p. 159.
3
Op. cit., p. 155.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 11
capital ; la perspective d'une hausse de valeur de la monnaie produit au contraire un
effet dprimant, parce qu'elle abaisse la courbe de l'efficacit marginale du capital.
Telle est la vrit contenue dans la thorie que le Professeur Irving Fisher a le
premier dnomme Apprciation et Intrt et qui distingue du taux nominal de
l'intrt le taux rel qui est gal au premier dment corrig pour tenir compte des
variations de valeur de la monnaie. Mais il est difficile de trouver un sens la thorie
ainsi prsente, car on ne sait pas si elle suppose que la variation de valeur de la
monnaie est ou non prvue. L'on ne sort pas du dilemme suivant : si la variation n'est
pas prvue, son effet sur les affaires courantes est nul ; si elle est prvue, le prix des
richesses existantes s'ajuste instantanment de manire rtablir l'galit d'avantages
entre la dtention de ces richesses et la conservation de la monnaie, il est alors trop
tard pour que les dtenteurs de monnaie puissent raliser sur le taux de l'intrt un
gain ou une perte qui compense la variation attendue dans la valeur de la monnaie
pendant la dure du prt. C'est en vain que le Professeur Pigou cherche sortir du
dilemme en supposant que la variation attendue dans la valeur de la monnaie est
prvue par les uns et non par les autres.
L'erreur consiste croire que les variations attendues dans la valeur de la monnaie
agissent directement sur le taux de l'intrt alors qu'en fait elles agissent sur l'effica-
cit marginale d'un stock donn de capital. Le prix des capitaux existants s'ajuste
toujours aux variations attendues dans la valeur future de la monnaie. Si ces varia-
tions attendues jouent un rle important, c'est parce que, en faisant varier l'efficacit
marginale du capital, elles agissent sur la tendance produire des capitaux nouveaux.
L'attente d'une hausse des prix a un effet stimulant, non parce qu'elle fait monter le
taux de l'intrt (ce serait une manire paradoxale de stimuler la production ; dans la
mesure o le taux de l'intrt monte, l'effet stimulant est au contraire annul par cette
hausse), mais bien parce qu'elle accrot l'efficacit marginale d'un stock donn de
capital. Si le taux de l'intrt devait monter de pair avec l'efficacit marginale du
capital, l'attente d'une hausse des prix ne produirait aucun effet stimulant. L'impul-
sion donne la production rsulte du fait que l'efficacit marginale d'un stock donn
de capital monte par rapport au taux de l'intrt. Il y aurait certainement avantage
refaire la thorie du Professeur Fisher en fonction d' un taux rel de l'intrt qui
serait par dfinition celui qui, lors d'un changement de l'tat de la prvision relative
la valeur future de la monnaie, devrait prvaloir pour soustraire la production cou-
rante l'influence de ce changement
1
.
Il convient de noter que l'attente d'une diminution du taux de l'intrt abaisse la
courbe de l'efficacit marginale du capital ; elle signifie que la production obtenue
l'aide de l'quipement cr aujourd'hui devra concourir pendant une partie de l'exis-
tence de cet quipement avec la production qui sera obtenue l'aide d'un quipement
auquel suffira un moindre revenu. L'effet dprimant d'une telle attente ne sera
d'ailleurs pas trs sensible; car les prvisions des gammes de taux d'intrt diff-
rents termes destines prvaloir aux poques futures se refltent en partie dans la
gamme des taux d'intrt diffrents termes qui prvaut aujourd'hui. Un certain effet
dprimant pourra nanmoins se produire, car il se peut qu' la fin de l'existence de
l'quipement fabriqu aujourd'hui la production obtenue avec son aide ait concourir
avec la production provenant d'quipements beaucoup plus rcents ; or un revenu
1
Cf. l'article de M. Robertson sur Les Fluctuations de l'Industrie et le Taux Naturel de l'intrt .
Economic Journal, dcembre 1934.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 12
moindre pourra suffire rmunrer ces derniers quipements si les taux d'intrt sont
moins levs pour les priodes postrieures la disparition du premier.
Il importe de comprendre l'influence des variations de la prvision sur l'efficacit
marginale d'un stock donn de capital, car c'est principalement cette influence qui
rend l'efficacit marginale du capital sujette ces fluctuations d'une certaine violence
qui expliquent le Cycle conomique. Au Chapitre XXII nous montrerons comment
on peut dcrire et analyser l'alternance d'essor et de dpression en fonction des varia-
tions de l'efficacit marginale du capital par rapport au taux de l'intrt.
IV
Deux sortes de risques influent sur l'importance de l'investissement ; entre eux la
distinction n'a pas souvent t faite encore qu'il importt de la faire. Le premier de ces
risques, celui de l'entrepreneur ou emprunteur, nat des doutes qu'il conoit lui-mme
quant la -probabilit d'obtenir effectivement le rendement qu'il espre. Lorsqu'un
homme expose son propre argent, c'est le seul risque qui intervient.
Mais, quand existe un systme de crdit, nous entendons par l, quand on peut
octroyer des prts en les entourant d'une marge de garantie relle ou, personnelle, il
intervient une seconde sorte de risque que nous appellerons le risque du prteur. Ce
risque peut tre d soit une contingence morale, carence volontaire ou autre man-
quement, lgal parfois, soit une insuffisance possible de la marge de garantie, c'est-
-dire un dfaut involontaire cause par une prvision due. On pourrait encore
mentionner un troisime risque d la possibilit d'une variation dfavorable de la
valeur de l'talon montaire, risque qui diminue concurrence de son montant la
scurit d'une crance montaire par rapport celle d'un capital rel, encore que la
totalit ou la majeure partie de ce risque soit dj reflte et donc incorpore dans le
prix des richesses relles durables.
Or le risque de la premire catgorie est, en un certain sens, une charge ncessaire
de la communaut, charge qui peut d'ailleurs tre allge par la division des risques et
par une exactitude plus grande de la prvision. Le risque de la seconde catgorie est,
au contraire, une pure addition au Cot de l'investissement ; il n'existerait pas, si le
prteur et l'emprunteur taient une mme personne. De plus une partie de ce dernier
risque double une fraction du risque de l'entrepreneur. Dans le calcul du minimum de
rendement escompt exig par l'investissement, cette fraction se trouve ajoute deux
fois au taux de l'intrt pur. Le caractre alatoire d'un investissement contribue
d'abord agrandir la marge entre la prvision de rendement de l'entrepreneur et le
taux d'intrt auquel il jugera avantageux d'emprunter ; et ce mme motif pousse en-
core le prteur exiger, pour consentir le prt, un cart plus fort entre sa rmunra-
tion et le taux, de l'intrt pur (sauf si la puissance et la richesse de l'emprunteur lui
permettent d'offrir une marge exceptionnelle de garantie).
L'espoir d'un rsultat trs favorable peut compenser le risque dans l'esprit de
l'emprunteur, mais il n'est pas de nature enhardir le prteur.
Le fait qu'une portion du risque entre deux fois en ligne de compte n'a pas notre
connaissance t encore mis en relief ; il peut cependant avoir de, l'importance dans
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 13
certains cas. En priode de hausse le public est capable de sous-valuer dans une
proportion anormale et dangereuse tant le risque de l'emprunteur que celui du prteur.
V
La courbe de l'efficacit marginale du capital est d'une importance fondamentale,
car c'est surtout par elle que la, prvision de l'avenir influe sur le prsent (beaucoup
plus que par le taux de l'intrt). En considrant que l'efficacit marginale du capital
est surtout fonction du rendement courant de l'quipement, ce qui n'est vrai que dans
une conomie stationnaire, o aucun changement futur ne peut agir sur le prsent, on
a commis une erreur qui rompt le lien thorique entre aujourd'hui et demain. Dj
l'intrt est virtuellement
1
un phnomne courant, si on rduit l'efficacit marginale
du capital la mme dimension, on renonce faire intervenir directement l'influence
du futur dans l'analyse de l'quilibre prsent.
Le fait que la thorie conomique contemporaine repose sur les hypothses de
l'tat stationnaire lui enlve beaucoup de sa porte pratique. L'introduction des con-
cepts de cot d'usage et d'efficacit marginale du capital contribuera, nous l'esprons,
la rapprocher de la ralit et rduira au minimum le degr d'adaptation ncessaire.
C'est l'existence d'un quipement durable qui rattache l'conomie future l'co-
nomie prsente. Que le futur influe sur le prsent par l'intermdiaire du prix de de-
mande des biens durables, c'est un fait qui se concilie et mme s'accorde pleinement
avec notre sentiment intuitif.
1
Mais non compltement, car le taux de l'intrt reflte en partie l'incertitude de l'avenir. De plus, la
relation entre les taux d'intrt diffrents termes dpend des prvisions.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 14
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XII
L'tat de la prvision long terme.
I
Retour la table des matires
Nous avons vu au chapitre prcdent que le flux effectif d'investissement dpend
de la relation entre le taux de l'intrt et la courbe qui exprime les variations de
l'efficacit marginale du capital en fonction du flux d'investissement, l'efficacit mar-
ginale du capital dpendant elle-mme de la relation qui existe entre le prix d'offre
d'un capital et son rendement escompt. Dans le prsent chapitre nous examinerons
de plus prs certains des facteurs qui dterminent le rendement escompt d'un capital.
Les valuations des rendements futurs sont fondes en partie sur des faits actuels,
qu'on peut supposer tre connus avec plus ou moins de certitude et en partie sur des
vnements futurs qui ne peuvent qu'tre prvus avec plus ou moins de confiance.
Dans la premire catgorie on citera le volume actuel des divers types de capitaux et
celui du capital en gnral ainsi que l'intensit de la demande actuelle des consom-
mateurs portant sur les richesses dont la production haut rendement exigerait une
participation relativement plus importante du capital. Dans la seconde catgorie
figurent les changements futurs dans l'espce et la quantit des divers capitaux et dans
les gots des consommateurs, l'ampleur de la demande effective diverses poques
de l'existence du capital en cause et enfin les variations qui peuvent apparatre, au
cours de son existence, dans la valeur montaire de l'unit de salaire. On peut res-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 15
serrer l'tat psychologique d'attente vis--vis des vnements de la seconde catgorie
dans l'expression d'tat de la prvision long terme- la prvision long terme ne
devant pas tre confondue avec la prvision court terme examine au Chapitre V,
qui sert de base aux producteurs lorsqu'ils valuent le prix qu'aprs son achvement
ils tireront d'un produit s'ils dcident d'en commencer tout de suite la fabrication avec
l'outillage existant.
II
Il serait absurde, lorsqu'on forme des prvisions, d'attacher beaucoup de poids aux
choses trs incertaines
1
. Il est donc raisonnable de se laisser guider dans une large
mesure par les faits dont on se sent suffisamment certain, mme s'ils n'ont pas pour le
rsultat considr une importance aussi dcisive que d'autres faits dont on n'a qu'une
connaissance limite et imprcise. C'est pourquoi les faits actuels jouent un rle en
quelque sorte disproportionn dans la formation de nos prvisions long terme ;
notre mthode habituelle consistant considrer la situation actuelle, puis la pro-
jeter dans le futur aprs l'avoir modifie dans la seule mesure o l'on a des raisons
plus ou moins prcises d'attendre un changement.
Par suite l'tat de la prvision long terme ne dpend pas seulement de l'ventua-
lit la plus probable qu'on puisse envisager. Il dpend aussi de la confiance avec
laquelle on la prvoit, c'est--dire, de l'valuation qu'on fait de la probabilit pour que
sa prvision la mieux tablie se rvle compltement fausse. Lorsqu'on s'attend des
variations. profondes, mais qu'on est trs incertain de la forme qu'elles revtiront, on
n'a qu'une confiance limite.
L'tat de la confiance, comme disent les hommes d'affaires, est une chose la-
quelle ils prtent toujours l'attention la plus stricte et la plus vigilante. Mais les co-
nomistes ne l'ont pas analyse avec soin et se sont contents le plus souvent d'en
disputer en termes gnraux. En particulier, ils n'ont pas clairement indiqu que son
importance dans les problmes conomiques vient de l'influence considrable qu'elle
exerce sur la courbe de l'efficacit marginale du capital. L'tat de la confiance et la
courbe de l'efficacit marginale du capital ne sont pas deux facteurs distincts, agissant
sparment sur le flux d'investissement. L'tat de la confiance intervient parce qu'il
est un des facteurs principaux qui gouvernent cette courbe, laquelle est la mme que
la courbe de la demande de capital.
Cependant il n'y a pas beaucoup dire a priori sur l'tat de la confiance. Nos
conclusions devront surtout s'inspirer de l'observation pratique des marchs et de la
psychologie des affaires. C'est pourquoi la digression qui va suivre ne prsentera pas
le mme degr d'abstraction que la majeure partie de cet ouvrage.
Pour la commodit de l'exposition, dans l'tude ci-aprs de l'tat de la confiance,
nous admettrons que le taux de l'intrt ne varie pas ; dans ls prochaines sections du
chapitre, nous raisonnerons constamment comme si les variations de valeur des in-
1
En disant trs incertaines nous ne voulons pas dire trs improbables . Cf. notre Treatise on
Probability, Chap. VI. Le poids des arguments .
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 16
vestissements provenaient uniquement des changements dans la prvision de leurs
rendements escompts et ne rsultaient en aucun cas des variations du taux d'intrt
auquel ces rendements escompts sont capitaliss. Il est d'ailleurs facile de superposer
l'effet des variations du taux de l'intrt l'effet des changements dans l'tat de la
confiance.
III
Le fait marquant en la matire est l'extrme prcarit des donnes l'aide des-
quelles nous sommes obligs d'effectuer nos valuations des rendements escompts.
Notre connaissance des facteurs qui gouverneront le rendement d'un investissement
quelques annes plus tard est en gnral trs limite et souvent ngligeable. A parler
franc, on doit avouer que, pour estimer dix ans ou mme cinq ans l'avance le
rendement d'un chemin de fer, d'une mine de cuivre, d'une fabrique de textile, d'une
marque pharmaceutique, d'un transatlantique ou d'un immeuble Londres, les
donnes dont on dispose se rduisent bien peu de choses, parfois rien. En fait ceux
qui cherchent effectuer srieusement une telle estimation forment souvent une si
petite minorit qu'ils n'ont pas d'influence sur le march.
Autrefois, lorsque les entreprises appartenaient pour la plupart ceux qui les
avaient cres ou aux amis et associs de leurs fondateurs, l'importance de l'investis-
sement tait fonction du nombre des individus de temprament sanguin et d'esprit
constructif qui s'embarquaient dans les affaires pour occuper leur existence sans
chercher rellement s'appuyer sur un calcul prcis de profit escompt. Les affaires
taient en partie une loterie, encore que leur rsultat final diffrt grandement selon
que les aptitudes et le caractre de leurs dirigeants taient suprieurs ou infrieurs la
moyenne. Les uns taient appels russir, les autres chouer. Mais personne ne
savait mme aprs coup si les rsultats moyens seraient avec les sommes engages
dans un rapport suprieur, gal ou infrieur au taux de l'intrt existant ; cependant, si
on excepte l'exploitation des ressources naturelles et celles des monopoles, il est
probable qu'en moyenne les rsultats effectifs des investissements mme pendant les
priodes de prosprit et de progrs ont du les espoirs qui les avaient fait natre.
Les hommes d'affaires jouent un jeu mixte d'adresse et de hasard dont les rsultats
moyens pour les joueurs ne sont pas connus de ceux qui prennent une main. Si la
nature humaine n'avait pas le got du risque, si elle n'prouvait aucune satisfaction
(autre que pcuniaire) construire une usine ou un chemin .de fer, exploiter une
mine ou une ferme, les seuls investissements suscits par un calcul froidement tabli
ne prendraient sans doute pas une grande extension.
Cependant, lorsqu'on dcidait de mettre de l'argent dans les affaires prives con-
ues l'ancienne mode, de telles dcisions taient en grande partie irrvocables non
seulement pour la communaut dans son ensemble mais encore pour les individus
pris isolment. La scission entre la proprit et la gestion du capital, qui prvaut
l'heure actuelle, et l'extension prise par les marchs financiers organiss ont fait inter-
venir un nouveau facteur d'une grande importance, qui facilite parfois l'investisse-
ment, mais qui parfois aussi contribue aggraver l'instabilit du systme. En l'absen-
ce de bourses de valeurs il n'y a pas der motif pour qu'on essaye de rvaluer
frquemment les investissements o l'on s'est engag. Mais le Stock Exchange rva-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 17
lue tous les jours un grand nombre d'investissements, et ses rvaluations fournissent
chaque individu (mais non la communaut dans son ensemble) une occasion
frquente de rviser ses engagements. C'est comme si un fermier, aprs avoir tapot
son baromtre au repas du matin, pouvait dcider entre dix et onze heures de retirer
son capital de l'exploitation agricole, puis envisager plus tard dans la semaine de l'y
investir de nouveau. Cependant les rvaluations journalires du Stock Exchange,
bien qu'elles soient surtout destines faciliter les transferts des capitaux anciens d'un
individu un autre, exercent ncessairement une influence dcisive sur le montant de
l'investissement courant. Il serait absurde en effet de crer une entreprise nouvelle
d'un certain cot si l'on peut acqurir une entreprise identique un prix moindre ;
inversement, on est incit dpenser dans une affaire nouvelle une somme qui peut
sembler extravagante, si cette affaire peut tre cde sur le march avec un bnfice
immdiat
1
. Ainsi certaines catgories d'investissement sont-elles gouvernes moins
par les prvisions vritables des entrepreneurs de profession que par la prvision
moyenne des personnes qui oprent sur le Stock Exchange, telle qu'elle est exprime
par le cours des actions
2
. Comment donc s'effectuent dans la pratique ces rvalua-
tions d'une si haute porte auxquelles les investissements existants sont soumis tous
les jours et mme toutes les heures ?
IV
Dans la pratique, nous sommes tacitement convenus, en rgle gnrale, d'avoir
recours une mthode qui repose vrai dire sur une pure convention. Cette conven-
tion rside essentiellement - encore que, bien entendu, elle ne joue pas toujours sous
une forme aussi simple - dans l'hypothse que l'tat actuel des affaires continuera
indfiniment moins qu'on ait des raisons dfinies d'attendre un changement. Ceci ne
signifie pas que nous pensions rellement que l'tat des affaires continuera indfini-
ment. L'exprience constante nous enseigne qu'une telle hypothse est des plus
improbables. Les rsultats d'un investissement qui apparaissent effectivement aprs
une priode de plusieurs annes concordent trs rarement avec la prvision initiale.
Nous ne pouvons pas non plus donner notre attitude un caractre rationnel en disant
qu'un homme en tat d'ignorance n'a qu'une chance sur deux de se tromper et qu'il
subsiste par consquent une prvision moyenne du point de vue actuariel base sur
des probabilits gales. Car on dmontre aisment qu' vouloir fonder des probabi-
lits arithmtiquement gales sur un tat d'ignorance, on aboutit des absurdits.
Nous supposons, en vertu d'une vritable convention, que l'valuation actuelle du
march, de quelque faon qu'elle ait t forme, est la seule correcte, eu gard la
1
Dans le Treatise on Money (vol. II, p. 195) nous avons signal que, si les actions d'une socit
sont cotes assez cher pour qu'elle puisse augmenter son capital en mettant des conditions
favorables des actions nouvelles, les consquences qui en dcoulent sont les mmes que si elle
pouvait emprunter un taux rduit. Nous dcririons maintenant cet tat de choses en disant que
l'lvation du cours des-titres existants entrane une hausse de l'efficacit marginale du type de
capital correspondant et produit par suite le mme effet qu'une baisse du taux de l'intrt (puisque
le flux d'investissement dpend de l'cart entre l'efficacit marginale du capital et le taux de
l'intrt).
2
Ceci ne s'applique videmment pas aux catgories d'entreprises qui ne peuvent tre ni facilement
cotes ni assimiles une valeur ngociable. Les catgories qui entrent dans cette exception
taient autrefois nombreuses. Leur importance par rapport la valeur totale de l'investissement
nouveau dcrot rapidement.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 18
connaissance actuelle des faits qui influeront sur le rendement de l'investissement, et
que cette valuation variera seulement dans la mesure o la connaissance actuelle de
ces faits sera modifie ; encore que sur le plan philosophique cette valuation ne puis-
se tre la seule correcte, car notre connaissance actuelle du futur ne saurait fournir la
base d'une prvision calcule mathmatiquement. En fait il entre dans l'valuation du
march toutes sortes de considrations qui n'ont aucun rapport avec le rendement
escompt.
Nanmoins la mthode conventionnelle de calcul indique ci-dessus est compa-
tible avec un haut degr de continuit et de stabilit dans les affaires, tant que l'on
peut compter sur le maintien de la convention.
Car, s'il existe des bourses de valeurs organises et si l'on est en droit de compter
sur le maintien de la convention, un individu qui investit peut lgitimement s'enhardir
par l'ide qu'il ne court pas d'autre risque que celui d'un changement rel dans les
informations relatives au proche avenir, risque sur la probabilit duquel il peut
essayer de se faire une opinion personnelle et qui au demeurant n'est pas susceptible
d'tre trs grand. A supposer que la convention subsiste, les risques de cet ordre sont
en effet les seuls qui puissent modifier la valeur de son investissement et il n'a pas
besoin de perdre le sommeil pour la seule raison qu'il n'a aucune ide du prix que son
investissement vaudra dix ans plus tard. De la sorte un investissement devient d'une
scurit raisonnable pour l'individu, considr isolment, qui investit pour de courtes
priodes et partant pour une succession de courtes priodes si nombreuses soient-
elles, condition qu'il puisse suffisamment compter sur la permanence de la conven-
tion et sur la possibilit de rviser son jugement et de changer son investissement
avant que beaucoup de choses aient eu le temps de se passer. Les investissements qui
sont fixes pour la communaut sont ainsi rendus liquides pour l'individu.
Ce fut, nous en sommes convaincu, suivant un tel processus que se sont dve-
lopps nos principaux marchs financiers. Mais il ne faut pas s'tonner qu'une
convention, si arbitraire d'un point de vue absolu, ait ses faiblesses. C'est de sa pr-
carit que proviennent une grande partie des difficults que l'on prouve aujourd'hui
maintenir un volume d'investissement suffisant.
V
Nous pouvons mentionner brivement quelques-uns des facteurs qui aggravent
cette prcarit.
1 Les personnes qui ne grent pas elles-mmes leurs affaires et qui n'ont aucune
connaissance particulire des circonstances actuelles ou ventuelles qui influent sur
elles possdent de jour en jour une fraction plus importante du capital global de la
communaut. Il en rsulte que, dans l'valuation des capitaux faite par leurs posses-
seurs ou par leurs acqureurs ventuels, l'lment de comptence relle est srieu-
sement diminu.
2 Les fluctuations au jour le jour des profits raliss dans les investissements
existants, bien qu'elles soient manifestement phmres et dpourvues de signifi-
cation, tendent exercer sur le march une influence tout fait exagre et mme
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 19
absurde. On rapporte par exemple qu'en Amrique les actions des socits qui
fabriquent la glace rafrachir se vendent en t lors de l'augmentation saisonnire
des bnfices des prix plus levs qu'en hiver lorsque personne n'a besoin de glace.
De mme, le retour d'une fte lgale est de nature accrotre de plusieurs millions de
Livres l'valuation boursire du rseau ferr britannique.
3 Une valuation conventionnelle, fruit de la psychologie collective d'un grand
nombre d'individus ignorants, est expose subir des variations violentes la suite
des revirements soudains que suscitent dans l'opinion certains facteurs dont l'in-
fluence sur le rendement escompt est en ralit assez petite. Les jugements man-
quent en effet des racines profondes qui leur permettraient de tenir. Dans les priodes
anormales notamment, lorsque la croyance la continuation indfinie de l'tat actuel
des affaires est particulirement peu plausible, mme s'il n'y a pas de raison formelle
de prvoir un changement dtermin, le march se trouve expos des vagues
d'optimisme et de pessimisme irraisonnes, mais aprs tout comprhensibles en l'ab-
sence d'une base solide de prvision rationnelle.
4 Un des aspects particuliers de la question mrite notre attention. Peut-tre a-t-
on suppos que la concurrence entre les professionnels comptents, dous d'un juge-
ment plus sr et de connaissances plus tendues que la moyenne des capitalistes
privs, corrigerait les fantaisies des individus ignorants livrs leurs propres lum-
ires. Or il se trouve que l'activit et l'habilet des spculateurs professionnels et des
spcialistes du placement s'emploient surtout ailleurs. En fait, la plupart d'entre eux se
soucient beaucoup moins de faire 'long terme des prvisions serres du rendement
escompt d'un investissement au cours de son existence entire que de deviner peu de
temps avant le grand public les changements futurs de la base conventionnelle
d'valuation. Ils se proccupent non de la valeur relle d'un investissement pour un
homme qui l'acquiert afin de le mettre en portefeuille, mais de la valeur que, sous
l'influence de la psychologie collective, le march lui attribuera trois mois ou un an
plus tard. Et cette attitude ne rsulte pas d'une lgret d'esprit particulire, elle est la
consquence invitable de l'organisation d'un march financier suivant le principe que
nous avons indiqu. Il serait absurde en effet de payer 25 pour un investissement dont
on juge que la valeur correspondant au rendement escompt est 30, si l'on estime
aussi que 3 mois plus tard le march l'valuera 20.
Pour le spcialiste du placement c'est donc une obligation imprieuse de s'attacher
anticiper les changements prochains dans l'ambiance et les informations, l'exp-
rience ayant appris que les changements de cet ordre taient ceux qui exeraient sur
la psychologie collective du march l'influence la plus profonde. Telle est la cons-
quence invitable de l'existence de marchs financiers conus en vue de ce qu'on est
convenu d'appeler la liquidit. De toutes les maximes de la finance orthodoxe, il n'en
est aucune, coup sr, de plus antisociale que le ftichisme de la liquidit, doctrine
qui fait un vritable devoir aux institutions de placement de concentrer leurs res-
sources sur des valeurs liquides . Une telle doctrine nglige le fait que pour la
communaut dans son ensemble il n'y a rien qui corresponde la liquidit du
placement. L'utilit sociale des placements- habiles devrait tre de vaincre les forces
obscures du temps et de percer le mystre qui entoure le futur. En fait, pour les
particuliers, les placements les plus habiles sont l'heure actuelle ceux .qui ont pour
objet de voler le dpart, comme disent si bien les Amricains, de piper le publie, de
refiler la demi-couronne fausse ou dcrie.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 20
Cet assaut d'intelligence pour anticiper de quelques mois la base conventionnelle
d'valuation bien plus que pour prvoir de longues annes l'avance le rendement
escompt d'un investissement n'exige mme pas qu'il y ait dans le public des pigeons
pour emplir la panse des professionnels; la partie peut tre joue paf les profession-
nels entre eux. Point n'est besoin non plus que certains persistent croire ingnument
que la base conventionnelle d'valuation a une valeur relle quelconque long terme.
Il s'agit, peut-on dire, d'une partie de chemin de fer, de vieux garon ou de chaise
musique, divertissements o le gagnant est celui qui passe la main ni trop tt ni trop
tard, qui cde le vieux garon son voisin avant la fin de la partie ou qui se procure
une chaise lorsque la musique s'arrte. On peut trouver ces jeux de l'agrment et de
la saveur bien que tout le monde sache qu'il y a un vieux garon en circulation ou que
lors de l'arrt de la musique certains se trouveront sans sige.
Ou encore, pour varier lgrement la mtaphore, la technique du placement peut
tre compare ces concours organiss par les journaux o les participants ont
choisir les six plus jolis visages parmi une centaine de photographies, le prix tant
attribu celui dont les prfrences s'approchent le plus de la slection moyenne
opre par l'ensemble des concurrents. Chaque concurrent doit donc choisir non les
visages qu'il juge lui-mme les plus jolis, mais ceux qu'il estime les Plus propres
obtenir le suffrage des autres concurrents, lesquels examinent tous le problme sous
le mme angle. Il ne s'agit pas pour chacun de choisir les visages qui, autant qu'il peut
en juger, sont rellement les plus jolis ni mme ceux que l'opinion moyenne consi-
drera rellement comme tels. Au troisime degr o nous sommes dj rendus, on
emploie ses facults dcouvrir l'ide que l'opinion moyenne se fera l'avance de
son propre jugement. Et il y a des personnes, croyons-nous, qui vont jusqu'au qua-
trime ou au cinquime degr ou plus loin encore.
Peut-tre le lecteur objectera-t-il que pendant une priode assez longue un homme
habile doit ncessairement raliser aux dpens des autres joueurs des bnfices
considrables si, indiffrent au passe-temps prdominant, il persiste acheter des
investissements la lumire des prvisions vritables long terme les plus parfaites
qu'il puisse tablir.
A ceci il convient de rpondre tout d'abord qu'il existe en effet des esprits srieux
de ce genre et que, suivant que leur influence ou celle des simples joueurs prvaut, la
physionomie d'un march financier diffre profondment. Mais nous devons ajouter
que plusieurs circonstances s'opposent la prdominance de semblables esprits sur
les marchs de capitaux modernes. Le placement fond sur une vritable prvision
long terme est de nos jours une tche trop difficile pour tre souvent possible. Ceux
qui s'y attlent sont srs de mener une existence beaucoup plus laborieuse et de courir
des risques plus grands que ceux qui essayent de deviner, les ractions du public plus
exactement que le public lui-mme ; et, galit d'intelligence dans les deux activi-
ts, ils risquent de commettre dans la premire des erreurs beaucoup plus dsas-
treuses. L'exprience ne prouve nullement que la politique de place-ment qui prsente
une utilit sociale concide avec celle qui rapporte le plus. Il faut plus d'intelligence
pour triompher des forces secrtes du temps et de l'ignorance de l'avenir que pour
voler le dpart . Au surplus la vie n'est pas assez longue pour cette tche ; la nature
humaine exige de prompts succs et l'enrichissement rapide a une saveur particulire,
l'homme moyen calculant la valeur actuelle des profits diffrs un taux d'escompte
fort lev. Le placement professionnel est une tche fastidieuse et astreignante au
point d'tre intolrable pour quiconque n'a aucunement le got du jeu, et ceux qui
l'ont doivent payer pour ce penchant la redevance approprie. Au surplus celui qui
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 21
veut investir sans se proccuper des fluctuations momentanes du march a besoin
pour sa scurit de ressources plus importantes et ne peut donc, au moins avec de
l'argent emprunt, oprer sur une chelle aussi considrable; nouvelle raison pour
qu' galit d'intelligence et de ressources il soit plus avantageux de se consacrer au
passe-temps. Finalement l'individu qui investit long terme et qui par l sert le mieux
l'intrt gnral est celui qui, dans la pratique, encourra le plus-de critiques, si les
fonds placer sont administrs par des conseils, des comits et des banques
1
. Son
attitude en effet doit normalement le faire passer aux yeux de l'opinion moyenne pour
un esprit excentrique, subversif et inconsidr. S'il connat d'heureux succs, l
croyance gnrale son imprudence s'en trouvera fortifie; et, si, comme c'est trs
probable, il subit des revers momentans, rares sont ceux qui le plaindront. La sages-
se universelle enseigne qu'il vaut mieux pour sa rputation chouer avec, les con-
ventions que russir contre elles.
5 Jusqu'ici nous avons eu surtout en vue l'tat de la confiance o se trouve lui-
mme le spculateur ou l'auteur d'un placement spculatif, et peut-tre avons-nous
paru implicitement supposer que, si personnellement il juge les perspectives favora-
bles, il peut disposer de sommes illimites au taux de l'intrt du march. Tel n'est
videmment pas le cas. Il nous faut donc aussi considrer un autre aspect de l'tat de
la confiance savoir, le degr de confiance que les institutions de prt tmoignent aux
personnes qui cherchent emprunter ; c'est ce qu'on appelle parfois l'tat du crdit.
Une chute des actions, qui produit un effet dsastreux sur l'efficacit marginale du
capital, peut tre provoque par l'affaiblissement ou de la confiance spculative ou de
l'tat du crdit. Mais alors qu'il suffit de l'affaiblissement d'un seul de ces facteurs
pour dterminer une chute, un redressement exige qu'ils soient tous deux restaurs.
L'affaiblissement du crdit suffit amener une crise, mais son renforcement, tout en
tant une condition ncessaire de la reprise, n'en est pas une condition suffisante.
VI
Ces considrations ne devraient pas sortir du champ de l'analyse conomique.
Mais encore faut-il les relguer leur vraie place. S'il nous est permis de dsigner par
te terme spculation l'activit qui consiste prvoir la psychologie du march et par
le terme entreprise celle qui consiste prvoir le rendement escompt des capitaux
pendant leur existence entire, on ne saurait dire que la spculation l'emporte toujours
sur l'entreprise. Cependant le risque d'une prdominance de la spculation tend
grandir mesure que l'organisation des marchs financiers progresse. Dans une des
principales Bourses des Valeurs du monde, New-York, la spculation au sens
prcdent du mot exerce une influence norme. Mme en dehors du terrain financier
la tendance des Amricains est d'attacher un intrt excessif dcouvrir ce que l'opi-
nion moyenne crot tre l'opinion moyenne, et ce travers national trouve sa sanction
la Bourse des Valeurs. Il est rare, dit-on, qu'un Amricain place de l'argent pour le
revenu ainsi que nombre d'Anglais le font encore; c'est seulement dans l'espoir
1
La coutume ordinairement juge prudente, qui veut qu'une socit de placement ou une compagnie
d'assurance calcule intervalles rapprochs non seulement le revenu mais encore la valeur
boursire de son portefeuille de titres, peut conduire donner une importance excessive aux
fluctuations momentanes du march.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 22
d'une plus-value qu'il est dispos acheter une valeur. Ceci n'est qu'une autre faon
de dire que, lorsqu'un Amricain achte une valeur, il mise moins sur le rendement
escompt que sur un changement favorable de la base conventionnelle d'valuation,
ou encore qu'il fait une spculation au sens prcdent du mot. Les spculateurs
peuvent tre aussi inoffensifs que des bulles d'air dans un courant rgulier d'entre-
prise. Mais la situation devient srieuse lorsque l'entreprise n'est plus qu'une bulle
d'air dans le tourbillon spculatif. Lorsque dans un pays le dveloppement du capital
devient le sous-produit de l'activit d'un casino, il risque de s'accomplir en des
conditions dfectueuses. Si on considre que le but proprement social des Bourses de
Valeurs est de canaliser l'investissement nouveau dans les directions les plus favo-
rables au rendement futur, on ne peut revendiquer le genre de succs obtenu par Wall
Street comme un clatant triomphe du laissez-faire capitaliste. Et il n'y a l rien de
surprenant, s'il est vrai, comme nous le pensons, que les meilleurs esprits de Wall
Street taient en fait proccups d'autre chose.
De telles tendances sont une consquence presque invitable du succs avec
lequel on a organis la liquidit des marchs de capitaux. Il est gnralement
admis que, dans l'intrt mme du publie, l'accs des casinos doit tre difficile et
coteux. Peut-tre ce principe vaut-il aussi en matire de Bourses. Le fait que le mar-
ch de Londres ait commis moins d'excs que Wall Street provient peut-tre moins
d'une diffrence entre les tempraments nationaux que du caractre inaccessible et
trs dispendieux de Throgmorton Street pour un Anglais moyen compare Wall
Street pour un Amricain moyen. L'cart des jobbers
1
, les courtages onreux des
brokers, les lourdes taxes d'tat sur les transferts, qui accompagnent les transactions
la Bourse de Londres, diminuent suffisamment la liquidit du march (l'usage des
rglements de quinzaine agissant d'ailleurs en sens inverse) pour en liminer une
grande partie des oprations qui caractrisent Wall Street
2
. La cration d'une lourde
taxe d'tat frappant toutes les transactions se rvlerait peut-tre la plus salutaire des
mesures permettant d'attnuer aux tats-Unis la prdominance de la spculation sur
l'entreprise.
Devant le spectacle des marchs financiers modernes, nous avons parfois t tent
de croire que si, l'instar du mariage, les oprations d'investissement taient rendues
dfinitives et irrvocables, hors le cas de mort ou d'autre raison grave, les maux de
notre poque pourraient en tre utilement soulags ; car les dtenteurs de fonds
placer se trouveraient obligs de porter leur attention sur les perspectives long terme
et sur celles-l seules. Mais il suffit d'un instant de rflexion pour comprendre qu'une
telle mthode pose un dilemme ; car, si la liquidit du march financier contrarie
parfois l'investissement nouveau, en revanche elle le favorise le plus souvent. Le fait
que chaque propritaire de valeurs pris individuellement se flatte d'tre engag dans
un placement liquide (ce qui ne saurait tre vrai de tous les propritaires pris
collectivement) calme ses nerfs et lui fait courir plus volontiers les risques. Si on
enlevait aux achats individuels de valeurs leur caractre liquide, de srieuses diffi-
cults pourraient en rsulter pour l'investissement, tant que s'offriraient aux individus
d'autres moyens de conserver leurs pargnes. C'est l que gt le dilemme. Tant que les
1
A Londres, le jobber est un intermdiaire qui centralise les ngociations sur certains titres et
fait la contre-partie des ordres transmis par les brokers. Son bnfice consiste dans l'cart entre le
prix d'achat et le prix de vente d'un mme titre. A la Bourse des Valeurs de Paris ce genre d'inter-
mdiaire n'existe pas (N. du T.).
2
On dit qu'en priode d'activit Wall Street plus de la moiti des achats et des ventes sont engags
par les spculateurs en vue d'tre compenss le mme jour. Et il en est souvent de mme des
transactions sur marchandises.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 23
individus auront l'alternative d'employer leur richesse, soit thsauriser ou prter de
l'argent, soit acheter des biens vritables, on ne pourra rendre le second terme de
l'alternative assez attrayant, surtout pour ceux qui n'administrent pas leurs biens et qui
n'ont aucune connaissance spciale leur sujet, qu'en organisant des marchs o ces
biens puissent tre aisment transforms en espces.
Le seul remde radical aux crises de confiance qui affligent la vie conomique
moderne serait de restreindre le choix de l'individu la seule alternative de consom-
mer son revenu ou de s'en servir pour faire fabriquer l'article de capital qui, mme
avec une faible vidence, lui parat tre l'investissement le plus intressant qui lui soit
offert. Peut-tre, certains moments, lorsqu'il serait plus que de coutume harcel par
des doutes au sujet de l'avenir, l'incertitude le conduirait-elle consommer plus et
investir moins. Mais on viterait par ce moyen les rpercussions dsastreuses, cumu-
latives et presque illimites du fait que les personnes envahies par le doute peuvent
s'abstenir de dpenser leur revenu d'une faon ou d'une autre.
Ceux qui ont insist sur les dangers sociaux rsultant de la thsaurisation de la
monnaie avaient en vue des considrations analogues celles qui prcdent. Mais ils
n'ont pas compris que le phnomne pouvait se produire en dehors de toute variation
ou au moins d'une variation proportionne du montant (le la monnaie thsaurise.
VII
Outre la cause due la spculation, l'instabilit conomique trouve une autre
cause, inhrente celle-ci la nature humaine, dans le fait qu'une grande partie de nos
initiatives dans l'ordre du bien, de l'agrable ou de l'utile procdent plus d'un opti-
misme spontan que d'une prvision mathmatique. Lorsqu'il faut un long dlai pour
qu'elles produisent leur plein effet, nos dcisions de faire quelque chose de positif
doivent tre considres pour la plupart comme une manifestation de notre enthou-
siasme naturel, comme l'effet d'un besoin instinctif d'agir plutt que de ne rien faire,
et non comme le rsultat d'une moyenne pondre de bnfices numriques multi-
plis par des probabilits numriques. L'entreprise ne fait croire qu' elle-mme que
le principal moteur de son activit rside dans les affirmations de son prospectus, si
sincres qu'elles puissent tre. Le calcul exact des bnfices venir y joue un rle
peine plus grand que dans une expdition au Ple Sud. Aussi bien, si l'enthousiasme
faiblit, si l'optimisme naturel chancelle, et si par suite on est abandonn au seul
ressort de la prvision mathmatique, l'entreprise s'vanouit et meurt, alors que les
craintes de pertes peuvent tre aussi dpourvues de base logique que l'taient aupa-
ravant les espoirs de profit.
On a raison de dire que l'entreprise suscite par la foi dans l'avenir bnficie la
communaut tout entire. Mais, pour que l'initiative individuelle lui donne une acti-
vit suffisante, il faut que la prvision rationnelle soit seconde et soutenue par l'en-
thousiasme. De mme que l'homme valide chasse la pense de la mort, l'optimisme
fait oublier aux pionniers l'ide de la ruine finale qui les attend souvent, l'exprience
ne leur laissant cet gard pas plus d'illusion qu' nous-mmes.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 24
Malheureusement, ceci ne signifie pas seulement que les crises et les dpressions
peuvent atteindre une ampleur excessive, mais encore que la prosprit conomique
est trop troitement subordonne l'existence d'un climat politique et social qui agre
la moyenne des hommes d'affaires. Lorsque la crainte d'un gouvernement travail-
liste ou d'un New Deal restreint l'entreprise, cette situation n'est pas forcment la
consquence de prvisions rationnelles ou de manuvres inspires par des fins
politiques, elle peut tre simplement l'effet d'un renversement de la dlicate balance
de l'optimisme naturel. Lorsqu'on examine les perspectives de l'investissement, il faut
donc tenir compte des nerfs et des humeurs, des digestions mme et des ractions au
climat des personnes dont l'activit spontane les gouverne en grande partie.
Ne nous htons pas de conclure que toute chose dpend de fluctuations psycho-
logiques irraisonnes. Au contraire, l'tat de la prvision long terme est souvent
assez stable; et, lors mme qu'il ne l'est pas, les autres facteurs tendent se com-
penser. Ce que nous voulons simplement rappeler, c'est que les dcisions humaines
engageant l'avenir sur le plan personnel, politique ou conomique ne peuvent tre
inspires par une stricte prvision mathmatique, puisque la base d'une telle prvision
n'existe pas ; c'est que notre besoin inn d'activit constitue le vritable moteur des
affaires, notre intelligence choisissant de son mieux entre les solutions possibles,
calculant chaque fois qu'elle le peut, mais se trouvant souvent dsarme devant le
caprice, le sentiment ou la chance.
VIII
Certains facteurs importants tendent attnuer dans la pratique des effets de notre
ignorance de l'avenir. Par suite du jeu de l'intrt compos et des chances qu'a le
capital de se dmoder sous l'action du temps, il existe de nombreux investissements
individuels dont le rendement escompt est juste titre domin par les revenus atten-
dus dans un avenir relativement prochain. Dans le cas des immeubles qui forment la
catgorie principale des investissements trs long terme, le risque peut tre souvent
transfr de la personne qui investit l'occupant, ou tout au moins il peut tre partag
entre eux grce aux baux de longue dure, le risque tant compens dans l'esprit de
l'occupant par la continuit et la scurit du droit de jouissance. Dans le cas des fonds
d'tat, qui forment une autre catgorie importante d'investissements long terme, une
forte proportion du rendement escompt est garanti en pratique par des privilges sur
des monopoles et par le droit d'en majorer les tarifs dans la mesure ncessaire
maintenir la marge de scurit stipule. Il y a enfin la catgorie de jour en jour plus
importante des investissements entrepris ou garantis par les tats. Les autorits
publiques, lorsqu'elles investissent, sont ouvertement influences par la prsomption
gnrale qu'on peut attendre certains avantages sociaux de l'investissement, quelque
doive tre dans une large limite le rendement commercial qui en sera tir. Elles se
proccupent peu de savoir si l'investissement satisfait ou non la condition que sa
prvision mathmatique de rendement soit suprieure au taux de l'intrt courant.
Toutefois le taux de l'intrt qu'elles sont obliges de payer peut encore jouer un rle
dcisif en limitant l'importance des investissements qu'elles peuvent se permettre.
Aprs avoir ainsi examin les changements de courte priode de l'tat de la pr-
vision long terme indpendamment des variations du taux de l'intrt, et avoir
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 25
donn tout son poids l'importance de leur action sur le flux d'investissement, nous
pouvons maintenant considrer les variations du taux de l'intrt en tant qu'elles
exercent sur le flux d'investissement, au moins en des circonstances normales, une
influence considrable, sinon dcisive. Toutefois, l'exprience seule pourra nous
indiquer dans quelle mesure la manuvre du taux de l'intrt est capable d'entretenir
en permanence un flux d'investissement suffisant.
Pour notre part, nous sommes aujourd'hui assez sceptique sur les chances de suc-
cs d'une politique purement montaire consistant agir sur le taux de l'intrt. L'tat
tant en mesure de calculer l'efficacit marginale des capitaux avec des vues lointai-
nes et sur la base des intrts sociaux de la communaut, nous nous attendons le
voir prendre une responsabilit sans cesse croissante dans l'organisation directe de
l'investissement. Car l'estimation de l'efficacit marginale des divers types de capi-
taux, telle qu'elle est faite sur le march d'aprs les principes prcdemment indiqus,
semble appele subir des fluctuations d'une ampleur trop considrable pour qu'on
puisse la compenser par les variations pratiquement possibles du taux de l'intrt.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 26
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XIII
La thorie gnrale
du taux de l'intrt
I
Retour la table des matires
Bien que certaines forces fassent crotre ou dcrotre le flux d'investissement de
telle sorte que l'efficacit marginale du capital reste gale au taux de l'intrt, nous
avons dmontr au Chapitre XI qu'intrinsquement l'efficacit marginale du capital
est autre chose que le taux de l'intrt. Nous pouvons dire que la courbe de l'efficacit
marginale du capital gouverne les conditions auxquelles on demande des fonds
placer pour de nouveaux investissements et que le taux de l'intrt gouverne les
conditions auxquelles ces fonds sont offerts chaque moment. Pour complter notre
thorie, il nous faut donc savoir quels sont les facteurs qui dterminent le taux de
l'intrt.
Au cours du Chapitre XIV et de son Appendice, nous examinerons les rponses
qui jusqu' ce jour ont t donnes cette question. Indiquons tout de suite qu'elles
font dpendre le taux de l'intrt de l'action combine de la courbe de l'efficacit mar-
ginale du capital et de la propension psychologique pargner. Le taux de l'intrt
serait le facteur d'quilibre qui tablit l'galit entre, d'une part, la demande d'pargne
rsultant de l'investissement nouveau qui peut tre ralis un taux d'intrt dter-
min et, d'autre part, l'offre d'pargne telle qu'elle rsulte de la propension psycho-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 27
logique de la communaut pargner ce taux. Mais cette thorie s'croule ds qu'on
a compris qu'il est impossible de dduire le taux de l'intrt de ces deux seuls fac-
teurs.
Quelle sera donc notre propre rponse cette question ?
II
Pour raliser pleinement ses prfrences psychologiques relatives au temps un
individu a deux sortes de dcisions prendre. Les premires ont trait cet lment de
la prfrence relative au temps que nous avons appel la propension consommer,
facteur qui, sous l'influence des divers motifs indiqus au Livre Ill, dtermine pour
chaque individu la partie de son revenu qu'il consomme et la partie qu'il rserve sous
la forme d'un droit quelconque une consommation future.
Mais, une fois cette dcision prise, une autre lui reste prendre. Il doit choisir la
forme sous laquelle il conservera le droit une consommation future qu'il s'est
rserv soit dans son revenu courant, soit dans ses pargnes antrieures. Dsire-t-il lui
conserver la forme d'un droit immdiat, liquide (i. e. la forme de monnaie ou d'qui-
valent montaire) ? Ou au contraire est-il dispos aliner ce droit immdiat pour
une priode spcifie ou indfinie, le taux auquel il pourra en cas de besoin convertir
son droit diffr des biens dtermins en un droit immdiat des biens indtermins
devant alors tre fix par les conditions futures du march ? En d'autres termes, quel
est le degr de sa prfrence pour la liquidit - la prfrence pour la liquidit d'un
individu tant donne par la courbe 'figurant le montant de ses ressources qu'il dsire
conserver sous forme de monnaie en diffrentes sries de circonstances, ce montant
tant calcul soit en units de monnaie soit en units de salaire ?
Nous verrons que, dans les thories admises, Terreur a consist vouloir dduire
le taux de l'intrt du premier de ces deux lments de la prfrence psychologique
relative au temps, et ngliger le second ; c'est cette omission qu'il nous faut essayer
de rparer.
Il devrait tre vident que le taux de l'intrt ne peut tre la rmunration de
l'pargne ou de l'abstinence en tant que telle. Lorsque un homme accumule ses par-
gnes sous forme d'argent liquide, il ne gagne aucun intrt bien qu'il pargne tout
autant qu'un autre. Au contraire la simple dfinition du taux de l'intrt nous dit mot
pour mot qu'il est la rcompense de la renonciation la liquidit pour une priode
dtermine. Car le taux de l'intrt en soi n'est pas autre chose que l'inverse du
rapport existant entre une somme de monnaie et ce qu'on peut obtenir en abandonnant
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 28
pour une priode dtermine
1
la libre disposition de cette somme en change d'une
crance
2
.
Le taux de l'intrt chaque instant, tant la rcompense de la renonciation la
liquidit, mesure la rpugnance des dtenteurs de monnaie aliner leur droit d'en
disposer tout moment. Le taux de l'intrt n'est pas le prix qui amne s'qui-
librer la demande de ressources investir et la propension s'abstenir de consom-
mations immdiates. Il est le prix auquel le dsir de maintenir la richesse sous la
forme liquide se concilie avec la quantit de monnaie disponible. Ceci signifie que, si
le taux de l'intrt tait moins lev, si en d'autres termes la rcompense de la renon-
ciation la liquidit tait moindre, le montant global de monnaie que le public
dsirerait conserver serait suprieur la quantit offerte et que, si le taux de l'intrt
tait plus lev, il y aurait un excdent de monnaie que personne ne voudrait con-
server. Pour autant que cette explication soit correcte, la quantit de monnaie est le
second facteur qui, joint la prfrence pour la liquidit, dtermine en des circons-
tances donnes le taux effectif de l'intrt. La prfrence pour la liquidit est une
tendance potentielle ou fonctionnelle qui fixe la quantit de monnaie que le public
conserve lorsque le taux de l'intrt est donn ; il en rsulte que, si r est le taux de
l'intrt, M la quantit de monnaie et L la fonction reprsentative de la prfrence
pour la liquidit, on a M = L (r). C'est par cette voie et de cette manire que la
quantit de monnaie pntre dans le schme conomique.
Qu'il nous soit permis ce stade du raisonnement de revenir en arrire et
d'examiner pourquoi il existe une chose telle que la prfrence pour la liquidit. En
pareille matire on peut avantageusement employer la vieille distinction entre l'usage
de la monnaie pour les transactions commerciales courantes et son usage pour la
conservation de la richesse. En ce qui concerne le premier de ces deux usages, il est
vident que jusqu' un certain point les avantages pratiques de la liquidit justifient le
sacrifice d'un certain montant d'intrt. Mais, tant donn que le taux de l'intrt n'est
jamais ngatif, pourquoi aime-t-on mieux conserver la richesse sous une forme qui
rapporte un intrt faible ou nul que sous une forme qui rapporte un certain intrt
(bien entendu, nous supposons pour l'instant qu'un avoir en banque et une obligation
sont exposs au mme risque de carence) ? L'explication intgrale de ce fait est
complexe et ne pourra tre donne qu'au Chapitre XV. Toutefois il faut qu'une
condition ncessaire soit remplie pour que puisse exister une prfrence pour l'argent
liquide en tant que moyen de conserver la richesse.
1
Dans l'argumentation gnrale, en tant qu'elle se distingue des problmes concrets o le terme des
crances est expressment spcifi, il sera commode de dsigner par l'expression taux d'intrt la
gamme des divers taux d'intrt courants termes diffrents, i. e. affrents des crances
d'chances diverses.
2
Sans contredire cette dfinition, on peut tracer la ligne de sparation entre la monnaie et les
crances au point qui convient le mieux l'tude de chaque problme particulier. Par exemple on
peut assimiler la monnaie tout droit un pouvoir d'achat gnral dont le titulaire ne s'est pas des-
saisi pour une priode suprieure trois mois et aux crances les droits alins pour une priode
plus longue. Au lieu de trois mois nous pouvons aussi bien choisir un mois, trois jours, trois
heures, ou une priode quelconque ; ou encore nous pouvons exclure de la monnaie toute richesse
qui n'a pas immdiatement pouvoir libratoire. Il est souvent commode dans la pratique d'tendre
le nom de monnaie aux dpts terme dans les banques et mme parfois certains instruments de
crdit tels que les Bons du Trsor. En principe nous supposerons, comme dans le Treatise on
Money, que la monnaie comprend les dpts de banque terme.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 29
Cette condition ncessaire est l'existence d'incertitudes quant l'avenir du taux de
l'intrt, i. e. quant aux gammes des taux d'intrt diffrents termes appeles
prvaloir des dates futures. Si toutes les valeurs futures du taux de l'intrt taient
connues l'avance avec certitude, on pourrait les rattacher aux valeurs prsentes des
taux d'intrt diffrents termes. et celles-ci s'ajusteraient aux valeurs connues des
taux d'intrt futurs. Par exemple, si pendant la prsente anne, que nous affecterons
du numro 1, la valeur de 1 disponible dans r annes est
1
r d
et si l'on savait de
manire certaine que dans n annes la valeur de 1 disponible r annes plus tard dt
tre
n
r d
, on aurait
n
r
n r
n
d
d
d
+
1
1
Ainsi le taux auquel une crance d'chance quelconque pourrait n annes plus tard
tre convertie en argent liquide serait donn par deux des taux d'intrt appartenant
la gamme courante. Si le taux d'intrt courant tait positif, quel que ft le terme du
prt, il serait toujours plus avantageux d'acheter une crance que de conserver la
richesse sous forme d'argent liquide.
Si la valeur future du taux de l'intrt est au contraire incertaine, on n'a plus le
droit d'infrer que, le moment venu,
n
r d
sera effectivement gal
1
1
n r
n
d
d
+
. Dans
le cas o un besoin d'argent liquide peut ventuellement se produire avant l'expiration
des n annes, on s'expose donc un risque de perte lorsque au lieu de conserver du
numraire, on achte une crance long terme pour la convertir ensuite en argent
liquide. Le profit actuariel ou l'esprance mathmatique de gain calcule sur la base
des probabilits existantes - si tant est qu'une telle base existe, ce qui est douteux -
doit suffire compenser le risque de perte.
La prfrence pour la liquidit trouve encore une nouvelle raison d'tre dans
l'existence d'incertitudes quant l'avenir du taux de l'intrt lorsqu'il existe un march
organis o se traitent les crances. Car chacun augure de l'avenir sa faon et toute
personne dont le sentiment diffre de l'opinion dominante telle qu'elle est exprime
par les cours du march peut tre logiquement conduite garder des ressources
liquides afin de profiter, si elle voit juste, du fait que, un moment donn, il appa-
ratra que les rapports entre les
1
r d
taient errons
1
.
Ce phnomne offre beaucoup d'analogie avec celui que nous avons assez lon-
guement tudi au sujet de l'efficacit marginale du capital. De mme que l'efficacit
marginale du capital est dtermine, nous l'avons vu, non par l'opinion la plus
claire, mais par l'valuation du march telle qu'elle rsulte du sentiment collectif,
ainsi les prvisions formes par le public au sujet de l'avenir du taux de l'intrt
influent sur la prfrence pour la liquidit ; mais de plus, lorsqu'une personne pense
que les valeurs futurs du taux de l'intrt seront suprieures aux valeurs prvues par le
1
Dans le Treatise on Money nous avons trait la mme question sous le titre des deux pronostics et
de la position la hausse et la baisse.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 30
march, elle est fonde garder actuellement de l'argent liquide
1
; et, lorsque son
opinion diffre en sens inverse de celle du march, elle est fonde emprunter de
l'argent pour de courtes priodes afin d'acheter des crances terme plus long. Le
prix du march se fixe au niveau o les ventes des baissiers quilibrent les achats des
haussiers.
Les trois lments que nous venons de distinguer dans la prfrence pour la
liquidit peuvent tre dfinis par les motifs qui les gouvernent : 1 le motif de tran-
sactions, i. e. le besoin de monnaie pour la ralisation courante des changes person-
nels et commerciaux ; 2 le motif de prcaution, i. e. la volont de soustraire aux
risques de variation la valeur montaire future d'une certaine proportion de ses
ressources totales ; et 3 le motif de spculation, i. e. le dsir de tirer. profit du fait
qu'on sait mieux que le march ce que rserve l'avenir. De mme qu'au moment o
nous examinions l'efficacit marginale du capital, la question de savoir s'il est
souhaitable d'avoir un march parfaitement organis pour ngocier les crances nous
place devant un dilemme. En l'absence d'un march organis la prfrence pour la
liquidit due au motif de prcaution serait sensiblement plus forte, mais d'autre part
l'existence d'un march organis permet de larges fluctuations de la prfrence pour
la liquidit due au motif de spculation.
Peut-tre la remarque suivante clairera-t-elle le raisonnement. Supposons que les
prfrences pour la liquidit dues au motif de transactions et au motif de prcaution
absorbent une quantit de monnaie qui varie peu sous l'influence directe des
variations du taux de l'intrt, abstraction faite de l'effet produit par ces variations sur
le montant du revenu. La quantit totale de monnaie diminue de cette quantit se
trouve ainsi disponible pour satisfaire les prfrences pour la liquidit dues au motif
de spculation. Le taux de l'intrt et le prix des obligations doivent alors se fixer au
niveau o la somme globale que certains individus dsirent garder liquide (parce qu'
ce niveau ils prvoient la baisse des obligations) est juste gale la quantit de
monnaie disponible pour rpondre au motif de spculation. Tout accroissement de la
quantit de monnaie dtermine donc dans les cours des obligations une hausse assez
forte pour dpasser les prvisions de certains haussiers et pour les dcider raliser
leurs obligations afin de rejoindre les rangs des baissiers. Et si, en dehors d'une courte
priode de transition, la demande de monnaie suscite parle motif de spculation est
ngligeable, une augmentation de la quantit de monnaie doit faire baisser presque
immdiatement le taux de l'intrt et par suite monter le niveau de l'emploi et l'unit
de salaire, dans une mesure suffisante pour que la quantit additionnelle soit absorbe
par les prfrences pour la liquidit dues au motif de transactions et au motif de
prcaution.
Nous pouvons admettre, en rgle gnrale, que la courbe de la prfrence pour la
liquidit unissant la quantit de monnaie au taux de l'intrt est une ligne rgulire le
long de laquelle le taux de l'intrt flchit mesure que la quantit de monnaie aug-
mente. Plusieurs causes concourent ce rsultat.
1
Lorsqu'une personne pense que le rendement escompt des investissements sera infrieur
l'valuation du march on pourrait croire qu'elle a aussi une raison suffisante de garder de l'argent
liquide. Mais il n'en est rien. Elle a une raison suffisante de garder de l'argent liquide ou des
crances plutt- que des actions; mais elle aimera mieux acheter une crance que garder de l'argent
liquide, moins qu'elle estime aussi que la valeur future du taux de l'intrt sera suprieure
l'valuation du march.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 31
En premier lieu, mesure que le taux de l'intrt baisse, une quantit croissante de
monnaie est normalement absorbe, toutes choses gales d'ailleurs, par les prf-
rences pour la liquidit dues au motif de transactions. Si la baisse du taux de l'intrt
accrot le revenu national, la quantit de monnaie qu'il est commode de conserver
pour les transactions augmente en effet avec le revenu sinon dans une proportion
strictement gale - en mme temps l'avantage d'une trsorerie largement calcule se
paie, en intrts perdus, de moins en moins cher. Des rsultats analogues se pro-
duisent si l'accroissement de l'emploi conscutif une baisse du taux de l'intrt
dtermine une hausse des salaires, i. e. une hausse de la valeur nominale de l'unit de
salaire, condition toutefois que la prfrence pour la liquidit soit mesure en units
de monnaie et non en units de salaire (comme il est parfois commode de le faire). En
second lieu, nous venons de le voir, toute baisse du taux de l'intrt peut accrotre la
quantit de monnaie que certaines personnes dsirent conserver parce que leur
opinion sur l'avenir du taux de l'intrt diffre de celle du march.
Cependant des circonstances peuvent se prsenter o un accroissement mme
considrable de la quantit de monnaie n'exerce qu'une influence relativement faible
sur le taux de l'intrt. Il est possible en effet qu'un fort accroissement de la quantit
de monnaie cause tant d'incertitude au sujet de l'avenir que les prfrences pour la
liquidit dues au motif de prcaution s'en trouvent renforces; et il est possible d'autre
part qu'il y ait sur les valeurs futures du taux de l'intrt une opinion si unanime
qu'une faible variation des taux actuels dtermine une variation massive de la deman-
de de monnaie. On doit se fliciter que la stabilit du systme et sa sensibilit aux
variations de la quantit de monnaie soient troitement subordonnes la diversit
des opinions sur les choses incertaines. Le mieux serait que nous connaissions
l'avenir. Mais dfaut d'une telle connaissance, si nous devons gouverner l'activit du
systme conomique en faisant varier la quantit de monnaie, il importe que les
opinions diffrent. Un semblable moyen d'action sera donc plus prcaire aux tats-
Unis o tout le monde tend adopter simultanment le mme avis qu'en Angleterre
o les divergences d'opinion sont plus frquentes.
III
Ainsi la monnaie se trouve introduite pour la premire fois dans notre chane de
relations causales et nous pouvons nous faire une premire ide de la faon dont les
variations de la quantit de monnaie interviennent dans le systme conomique. Mais,
si nous sommes tents de voir dans la monnaie un lixir qui stimule l'activit du
systme, rappelons-nous qu'il peut y avoir plusieurs obstacles entre la coupe et les
lvres. Alors qu'on peut esprer que, toutes choses restant gales, un accroissement de
la quantit de monnaie fasse baisser le taux de l'intrt, ceci ne se produira pas si les
prfrences du public pour la liquidit augmentent plus que la quantit de monnaie ;
alors qu'on peut esprer que, toutes choses restant gales, la baisse du taux de l'intrt
fasse crotre le flux d'investissement, ceci ne se produira pas si la courbe de l'effica-
cit marginale du capital baisse plus que le taux de l'intrt ; alors enfin qu'on peut
esprer que, toutes choses restant gales, une augmentation du flux d'investissement
accroisse l'emploi, ceci ne se produira pas si la propension consommer dcline.
Finalement, si l'emploi augmente, les prix monteront dans une mesure qui dpend en
partie des formes des fonctions physiques de l'offre et en partie de la tendance de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 32
l'unit de salaire crotre en valeur nominale. Et, lorsque la production aura aug-
ment et que les prix auront mont, l'effet qui en rsultera sur la prfrence pour la
liquidit sera d'accrotre la quantit de monnaie ncessaire au maintien d'un taux
d'intrt donn.
IV
Bien que la prfrence pour la liquidit due au motif de spculation corresponde
ce que nous avons appel dans le Treatise on Money la tendance la baisse , ces
deux concepts ne sont nullement identiques. La tendance la baisse a t dfinie
dans cet ouvrage la relation fonctionnelle qui unit non le taux de l'intrt ou le prix
des crances la quantit de monnaie, mais le prix cumul des capitaux et des
crances la quantit de monnaie. Cette mthode d'analyse entranait, entre les
rsultats dus aux variations du taux de l'intrt et les rsultats dus aux changements
de la courbe de l'efficacit marginale du capital, une confusion que nous esprons
avoir vite dans le prsent ouvrage.
V
Le concept de thsaurisation peut tre considr comme une premire approxima-
tion du concept de prfrence pour la liquidit. A vrai dire, si on remplaait la
thsaurisation par la tendance thsauriser , les deux concepts seraient stricte-
ment identiques. Mais, lorsque la thsaurisation signifie une augmentation effec-
tive des avoirs liquides, elle constitue une ide incomplte - et d'ailleurs gnratrice
de graves erreurs si elle accrdite l'opinion que la thsaurisation et la non-thsau-
risation sont des dcisions indpendantes. La dcision de thsauriser en effet n'est pas
prise arbitrairement ou sans gard aux avantages offerts par la renonciation la
liquidit, elle rsulte de la mise en balance des avantages de chaque solution, et on ne
doit pas ignorer ce qu'il y a dans l'autre plateau. Au surplus, tant que la thsauri-
sation signifie les avoirs liquides effectivement dtenus, son montant ne saurait
varier sous l'effet des dcisions prises par le publie. Car le montant de la thsauri-
sation est ncessairement gal la quantit de monnaie (ou encore - d'aprs certaines
dfinitions - la quantit totale de monnaie diminue de celle qui correspond au
motif de transactions); et la quantit de monnaie n'est pas dtermine par le publie.
Tout ce que la propension du public thsauriser peut faire, c'est dterminer le taux
de l'intrt auquel son dsir global de thsauriser est compatible avec la quantit de
monnaie mise sa disposition. L'habitude de ngliger la relation existant entre le taux
de l'intrt et la thsaurisation contribue peut-tre expliquer le fait qu'on ait gnra-
lement considr l'intrt comme la rcompense des dcisions de ne pas dpenser
alors qu'il est en ralit la rcompense des dcisions de ne pas thsauriser.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 33
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XIV
La thorie classique du taux de l'intrt
Retour la table des matires
En quoi consiste la thorie classique du taux de l'intrt ? Bien que cette thorie
ait servi de base notre formation tous et que, jusqu' une date rcente, nous l'ayons
tous admise presque sans rserve, il nous parat difficile de l'exposer avec prcision
ou d'en trouver un nonc explicite dans les ouvrages marquants de l'cole classique
moderne
1
.
Un point est toutefois hors de discussion ; pour la tradition classique le taux de
l'intrt est le facteur qui amne s'quilibrer la demande d'investissement et la dis-
position pargner. L'investissement reprsente la demande de ressources investir,
l'pargne reprsente l'offre, et le taux de l'intrt est le prix des ressources inves-
tir qui rend ces deux quantits gales. Tout comme le prix d'une marchandise se fixe
ncessairement au point o sa demande est gale son offre, de mme le taux de
l'intrt, sous l'action des forces du march, vient ncessairement se fixer au point o
le montant investi ce taux est gal au montant pargn au mme taux.
1
On trouvera dans l'Appendice au prsent chapitre un rsum de ce que nous avons pu dcouvrir.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 34
Ce raisonnement ne saurait tre trouv mot pour mot dans les Principles de
Marshall. Cependant telle semble bien tre sa thorie; c'est celle qui nous a t ensei-
gne a nous-mme et qu' notre tour nous avons professe pendant un grand nombre
d'annes. Prenons, par exemple, dans les Principles le passage suivant : L'intrt,
tant le prix pay sur un march pour l'usage du capital, tend vers un niveau d'qui-
libre tel que la demande globale de capital faite sur ce march, ce taux, soit gale au
stock total qui s'y prsente au mme taux
1
. De mme, dans Nature and Necessity of
Interest, le Professeur Cassel explique que l'investissement constitue la demande
d'abstinence , l'pargne l'offre d'abstinence , et que l'intrt est un prix qui
sert - ceci est sous-entendu - rendre les deux quantits gales, mais nous n'avons pas
trouv ici non plus de texte positif citer. Au Chapitre VI de sa Distribution of
Wealth le Professeur Carver considre formellement l'intrt comme le facteur qui
amne s'quilibrer la dsutilit marginale de l'abstinence et la productivit
marginale du capital
2
. Sir Alfred Flux crit dans ses Economic Principles, p. 95:
S'il y a du vrai dans les thses de notre argumentation gnrale, il faut admettre qu'il
se produit un ajustement automatique entre l'pargne et les occasions d'employer le
capital avec profit... L'pargne ne dpassera pas ses possibilits d'tre utilement
employe... tant que le taux net de l'intrt sera suprieur zro. Le Professeur
Taussig dans ses Principles (vol. II, p. 29) trace une courbe de l'offre d'pargne ainsi
qu'une courbe de la demande reprsentant la productivit dcroissante des divers
investissements de capital, aprs avoir expos dans un passage antrieur (p. 20) que
le taux de l'intrt s'tablit un point o la productivit marginale du capital suffit
provoquer l'investissement marginal de l'pargne
3
. Walras dans les lments
d'conomie pure (App. I, 3), o il tudie l'change d'pargnes contre capitaux
neufs
4
, soutient expressment qu' chacune des valeurs possibles de l'intrt
correspondent un certain montant des sommes que les individus pargnent et un
certain montant des sommes qu'ils investissent en capitaux nouveaux, que ces deux
montants tendent l'un vers l'autre et que le taux de l'intrt est la variable qui les am-
ne tre gaux ; le taux de l'intrt se fixe donc au point o l'pargne, qui reprsente
l'offre de capital nouveau, est gale la demande dont ce capital est l'objet. Cette
thse est strictement conforme la tradition classique.
Il est certain que le non spcialiste - banquier, fonctionnaire, homme public -
nourri de la thorie traditionnelle, autant que l'conomiste consomm, vivent dans
l'ide que, chaque fois qu'un individu accomplit un acte d'pargne, il fait une chose
qui abaisse automatiquement le taux de l'intrt, que cette baisse stimule automati-
quement la cration du capital, que le taux de l'intrt baisse autant qu'il faut pour que
la production additionnelle de capital soit gale l'accroissement de l'pargne et qu'en
1
Ce passage fera l'objet d'une analyse plus complte la page 201.
2
Il est difficile de suivre le raisonnement du Professeur Carver, d'abord parce qu'il ne prcise pas le
sens de la productivit marginale du capital de sorte que on ne sait pas s'il a en vue le volume
marginal de la production ou sa valeur marginale, et ensuite parce qu'il ne cherche pas dfinir la
quantit de capital.
3
Dans une trs rcente tude de ces problmes ( Capital, Temps, et Taux d'Intrt , par le Prof.
Knight, Economica, aot 1934), tude qui contient maintes observations intressantes et profondes
sur la nature du capital et qui montre combien l'cole de Marshall avait raison de juger l'analyse de
Boehm-Bawerk dpourvue d'intrt, la thorie de l'intrt est prsente sous une forme prcise,
conforme la tradition classique. L'quilibre dans le domaine de la production du capital exige,
selon le Prof. Knight, un taux d'intrt tel que l'pargne arrive sur le march avec un dbit ou une
vitesse exactement gale celle de son absorption parles investissements qui produisent un taux de
rendement gal celui qui est pay aux pargnants pour son usage .
4
En franais dans le texte original (N. du T.).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 35
outre il s'agit l d'un phnomne auto-rgulateur qui assure l'galit des deux facteurs
sans qu'il soit besoin d'intervention spciale ou de soins maternels de la part de l'au-
torit montaire. De mme, - et cette ide est encore plus rpandue, mme aujourd'hui
- tout acte supplmentaire d'investissement ferait ncessairement monter le taux de
l'intrt s'il n'tait compens par une variation de la disposition pargner.
Or l'analyse des chapitres prcdents ne doit laisser subsister aucun doute sur la
fausset de cette explication. Avant de remonter l'origine de la divergence des deux
opinions, occupons-nous d'abord de leurs points de concordance.
A la diffrence de l'cole no-classique, pour laquelle l'pargne et l'investissement
peuvent diffrer effectivement, l'cole classique proprement dite a admis le principe
de leur galit. Marshall pensait certainement, encore qu'il ne l'ait pas dit express-
ment, que l'pargne globale et l'investissement global sont ncessairement gaux. A
vrai dire, la plupart des membres de l'cole classique vont trop loin dans cette voie,
puisqu'ils soutiennent que tout acte individuel qui augmente l'pargne suscite nces-
sairement un acte correspondant qui augmente l'investissement. Il n'existe pas non
plus de diffrence srieuse, au regard du problme actuel, entre notre courbe de
l'efficacit marginale du capital ou de la demande de capital et la courbe de la de-
mande de capital telle que l'envisagent certains des auteurs classiques cits plus haut.
Lorsque nous en venons la propension consommer et son corollaire, la pro-
pension pargner, nous sommes plus prs d'une diffrence d'opinion, car les
conomistes classiques insistent plus que nous sur le rle jou par le taux de l'intrt
dans les variations de la propension a consommer. Mais sans doute admettraient-ils
que le montant du revenu a lui aussi une influence considrable sur le montant de
l'pargne et de notre ct nous n'entendons pas nier que le taux de l'intrt puisse
avoir une certaine influence (peut-tre diffrente, d'ailleurs, de celle qu'ils pensent)
sur le montant de l'pargne tire d'un revenu donn. Tous ces points de concordance
peuvent tre rsums dans une proposition que l'cole classique accepterait et que
nous ne contestons pas : si l'on suppose que le montant du revenu est donn, on peut
en infrer que le taux de l'intrt courant se trouve au point d'intersection des deux
courbes qui retracent, l'une les variations de la demande de capital en fonction du
taux de l'intrt, l'autre les variations en fonction du taux de l'intrt du montant de
l'pargne tire du revenu donn.
C'est alors qu'une erreur dcisive s'introduit dans la thorie classique. Si de la
proposition prcdente l'cole classique s'tait borne infrer que, lorsqu'on connat
la courbe de la demande de capital ainsi que l'influence des variations du taux de
l'intrt sur la disposition tirer de l'pargne de revenus donns, chaque montant du
revenu est associe une seule valeur du taux de l'intrt, il n'y aurait eu rien redire
cette conclusion. Elle et mme conduit naturellement une proposition qui contient
une vrit importante, c'est que, si on connat le taux de l'intrt, la courbe de la
demande de capital et l'influence du taux de l'intrt sur la disposition tirer de
l'pargne de montants donns de revenu, le montant du revenu est ncessairement le
facteur qui amne le montant de l'pargne concorder avec celui. de l'investissement.
Mais en fait la thorie classique, outre qu'elle nglige l'influence des variations du
revenu, enferme une erreur formelle.
Elle suppose en effet, comme le prouvent les citations prcdentes, qu'on peut
procder l'examen de l'effet produit sur le taux de l'intrt par un changement dans
la courbe de la demande de capital (par ex.), sans abandonner ni modifier l'hypothse
relative la fixit du revenu dont les divers montants d'pargne doivent tre tirs.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 36
Dans la thorie classique du taux de l'intrt les variables indpendantes sont la
courbe de la demande de capital et l'influence du taux de l'intrt sur le montant de
l'pargne tire d'un revenu donn ; et, quand une des variables, par exemple, la cour-
be de la demande de capital change, le taux nouveau de l'intrt, d'aprs cette thorie,
est donn par le point d'intersection de la nouvelle courbe de la demande de capital et
de la courbe qui relie le taux de l'intrt aux montants de l'pargne qui sera tire du
revenu donn. La thorie classique du taux de l'intrt parat supposer que, si un
changement se produit, soit dans la courbe de la demande de capital, soit dans la
courbe qui relie au taux de l'intrt les montants de l'pargne tire d'un revenu donn,
soit dans chacune de ces courbes, le taux nouveau de l'intrt est donn par le point
d'intersection des deux courbes dans leur position nouvelle. Mais une semblable
thorie ne peut avoir de sens, car l'hypothse que le revenu est constant est incom-
patible avec l'hypothse que les deux courbes peuvent changer indpendamment l'une
de l'autre. Si l'une ou l'autre de ces courbes change, en gnral le revenu varie aussi
et, par suite, toute la construction fonde sur l'hypothse d'un revenu donn s'croule.
Seule pourrait sauver la position une hypothse complexe admettant une variation
automatique de l'unit de salaire d'un montant juste suffisant pour tablir, par son
action sur la prfrence pour la liquidit, un taux d'intrt qui compenserait exacte-
ment la variation suppose, de telle sorte que le volume de la production reste le
mme qu'auparavant. En fait on ne trouve chez les auteurs cits prcdemment au-
cune allusion la ncessit d'une pareille hypothse, laquelle serait la rigueur plaus-
ible s'il s'agissait d'un quilibre de longue priode mais ne saurait servir de base une
thorie de la courte priode ; et il n'y a mme aucune raison de supposer qu'elle soit
vrifie dans la longue priode. A vrai dire la thorie classique a nglig et le rle
jou par les variations du revenu et le fait que le montant du revenu dpend effecti-
vement du flux d'investissement.
Ce qui prcde pour tre illustr par le diagramme suivant
1
:
Dans ce diagramme le montant de l'investissement I (ou de l'pargne) est mesur
verticalement et le taux de l'intrt r horizontalement. X
1
X
1
est la premire position
de la courbe de la demande de capital et X
2
X
2
est une seconde position de cette
1
Ce diagramme nous a t suggr par M. R. F. Harrod. Cf. galement une reprsentation en partie
semblable qui a t utilise par M. D. H. Robertson. Economic Journal, dcembre 1934, page 652.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 37
courbe. La courbe R
1
relie les montant de l'pargne tire d'un revenu R
1
aux diverses
valeurs du taux de l'intrt, les courbes R
2
R
3
tant les courbes correspondantes
lorsque les montants du revenu sont R
2
et R
3
. Supposons que R
1
soit la courbe R
compatible la fois avec un taux de l'intrt r
1
et une courbe de la demande de capital
X
1
X'
1
. Si la courbe de la demande de capital se dplace de X
1
X'
1
X
2
X'
2
, en gnral le
revenu variera aussi. Mais le diagramme ci-dessus ne contient pas assez de donnes
pour nous indiquer sa nouvelle valeur ; et par suite, ne sachant pas quelle est la
courbe R approprie aux conditions nouvelles, nous ne connaissons pas le point o
elle sera coupe par la nouvelle courbe de la demande de capital. Toutefois si nous
introduisons l'tat de la prfrence pour la liquidit et la quantit de monnaie et si,
connaissant ces deux facteurs, nous savons que le taux de l'intrt est r
2
, alors tous les
lments de la situation sont dtermins. Car la courbe R qui coup X
2
X'
2
au point
situ la verticale de r
2
, c'est--dire la courbe R
2
, sera la courbe approprie aux con-
ditions nouvelles. Ainsi les courbes X et les courbes R ne nous renseignent aucune-
ment sur le taux de l'intrt. Elles nous indiquent seulement quel sera le montant du
revenu, lorsque d'une autre source nous connaissons la valeur du taux de l'intrt. Si
aucun changement n'est intervenu dans l'tat de la prfrence pour la liquidit ni dans
la quantit de monnaie, si par consquent le taux de l'intrt n'a pas vari, la courbe
R'
2
qui coupe la nouvelle courbe de la demande de capital la verticale du point o la
courbe R
1
coupait l'ancienne courbe X
1
X'
1
est la courbe R approprie aux conditions
nouvelles et R'
2
est le nouveau montant du revenu.
Ainsi les fonctions utilises par la thorie classique, c'est--dire les ractions aux
variations du taux de l'intrt, d'une part, du montant de l'investissement et, de l'autre,
du montant de l'pargne tire d'un revenu donn, ne fournissent pas les lments
d'une thorie du taux de l'intrt; en revanche on peut s'en servir pour dterminer le
montant du revenu, lorsque (d'une autre source) on connat le taux de l'intrt ; ou
inversement pour savoir quelle valeur devra prendre le taux de l'intrt si le montant
du revenu doit tre maintenu un chiffre donn, par exemple au chiffre qui corres-
pond au plein emploi.
L'erreur consiste croire que le taux de l'intrt est la rmunration de l'absti-
nence en tant que telle, alors qu'on devrait y voir la rcompense de la dthsauri-
sation, de mme qu'on considre, trs juste titre, les taux de rendement des prts et
des investissements qui comportent un certain degr de risque comme la rcompense,
non de l'abstinence en tant que telle, mais de l'acceptation du risque. A vrai dire, il n'y
a pas de frontire marque entre ce genre de rmunration et ce qu'on appelle le taux
de l'intrt pur , tous deux sont la rcompense d'une incertitude d'une sorte ou d'une
autre. Ce n'est que dans le cas o la monnaie servirait uniquement d'instrument des
transactions et ne serait jamais employe comme rserv de valeur qu'une thorie
diffrente Ferait applicable
1
.
Cependant il existe deux points bien connus qui auraient pu signaler l'cole
classique la prsence &une erreur. En premier lieu, on s'accorde, au moins depuis la
publication de Nature and Necessity of Interest du Professeur Cassel, juger douteux
que l'pargne tire d'un revenu donn augmente ncessairement lorsque le taux de
l'intrt monte ; alors que personne ne doute que l'autre courbe, c'est--dire la courbe
de la demande de capital, baiss quand le taux de l'intrt monte. Or, si les courbes R
et les courbes X flchissent simultanment lorsque le taux de l'intrt monte, rien ne
garantit qu'une courbe R donne coupera une courbe X donne en un point quel-
1
Cf. Chapitre XVII.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 38
conque. C'est une premire raison de penser que les courbes R et les courbes X ne
peuvent elles seules dterminer le taux de l'intrt.
En second lieu, on admet communment qu'une augmentation de la quantit de
monnaie tend rduire le taux de l'intrt, au moins au premier instant et dans la
courte priode. Mais aucune raison n'a encore t donne pour qu'une variation de la
quantit de monnaie affecte ou la courbe de la demande de capital ou l disposition
tirer de l'pargne d'un revenu donn. L'cole classique a donc adopt deux thories du
taux de l'intrt foncirement distinctes, l'une dans le volume I o elle traite la thorie
de la valeur et l'autre dans le volume II o elle traite la thorie de la monnaie. Elle ne
semble d'ailleurs pas s'tre mue de la contradiction et n'a fait notre connaissance
aucun effort pour concilier les deux thories. Nous parlons bien entendu de l'cole
classique proprement dite ; car c'est en cherchant concilier les deux thories que
l'cole no-classique est arrive la pire des confusions. Elle a soutenu en effet que
l'offre de capital, pour s'ajuster la demande, devait procder de deux sources : les
pargnes vritables, c'est--dire les pargnes analyses par l'cole classique, et en
outre les sommes dont une augmentation de la quantit de monnaie permet de dispo-
ser (l'offre provenant de cette seconde source tant compense par une sorte de prl-
vement sur le public, qualifi d' pargne force ou d'un terme analogue). L'cole
no-classique a t ainsi conduite d'abord penser qu'il existe un taux d'intrt
naturel ou neutre
1
ou d'quilibre , c'est--dire un taux qui fait concorder
l'investissement avec les pargnes classiques vritables l'exclusion de tout apport
venant de l' pargne force , puis formuler la conclusion la plus vidente de
toutes, supposer qu'elle ait pris la bonne voie, au dpart, d'aprs laquelle, si la quan-
tit de monnaie pouvait en toute circonstance tre maintenue constante, aucune de ces
difficults ne se produirait puisque les maux qu'on attribue un prtendu excs de
l'investissement sur les pargnes vritables cesseraient d'tre possibles. Mais ici nous
perdons pied. Le canard sauvage a plong profondment, aussi loin qu'il pouvait
aller, et il s'est solidement cramponn aux herbes, la mousse et aux dbris qui
jonchent le fond ; il faudrait un chien extraordinairement adroit pour plonger sa
recherche et le rapporter.
Ainsi l'cole classique est en dfaut parce qu'elle n'a pas russi isoler correc-
tement les variables indpendantes du systme. L'pargne et l'Investissement sont les
facteurs dtermins et non les dterminants. Ils sont les rsultantes jumeles des
dterminants du systme, qui sont la propension consommer, la courbe de l'effica-
cit marginale du capital et le taux de l'intrt. A vrai dire ces dterminants sont eux-
mmes complexes et chacun d'eux peut tre affect par les variations escomptes des
autres. Mais ils restent indpendants en ce sens que leurs valeurs respectives ne
peuvent tre dduites les unes des autres. L'analyse traditionnelle a bien compris que
l'pargne dpendait du revenu, mais non, que le revenu tait uni l'investissement par
une relation telle que, lorsque l'investissement varie, le revenu est forc de varier
juste autant qu'il faut pour amener la variation de l'pargne concorder avec celle de
l'investissement.
Avec un gal insuccs on a cherch faire dpendre le taux de l'intrt de l'effi-
cacit marginale du capital . Il est exact qu'en tat d'quilibre le taux de l'intrt est
gal l'efficacit marginale du capital, puisqu'on a avantage accrotre (ou rduire)
le flux courant d'investissement jusqu' ce que l'galit s'tablisse. Mais c'est un
1
Le taux de l'intrt neutre des conomistes contemporains diffre la fois du taux naturel
de Boehm-Bawerk et du taux naturel de Wicksell.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 39
cercle vicieux de vouloir de ce fait tirer une thorie du taux de l'intrt ou dduire la
valeur de ce taux ; Marshall s'en est aperu alors qu'il se trouvait mi-chemin dans la
voie d'une explication du taux de l'intrt fonde sur ce principe
1
. L'efficacit margi-
nale du capital en effet dpend en partie du flux courant d'investissement et, pour
calculer ce flux, il faut d'abord connatre le taux de l'intrt. La conclusion qui impor-
te, c'est que le flux d'investissement se dveloppe jusqu' ce que l'efficacit marginale
du capital tombe au niveau du taux de l'intrt. Quant la courbe de l'efficacit
marginale du capital, elle indique non la valeur du taux de l'intrt mais le volume
que la production du capital tend atteindre lorsque le taux de l'intrt a une valeur
donne.
Le lecteur apprciera sans peine l'importance thorique fondamentale et la porte
pratique considrable du problme que nous examinons. Les conomistes ont presque
toujours fond leurs conseils pratiques sur le principe que, toutes choses gales d'ail-
leurs, une diminution de la dpense tend faire baisser le taux de l'intrt et une
augmentation du flux d'investissement le faire monter. Toutefois, si ces deux quan-
tits dterminent non le taux de l'intrt mais le volume global de l'emploi, le fonc-
tionnement du systme conomique nous apparatra sous un aspect bien diffrent. On
regardera d'un tout autre oeil un affaiblissement de la propension la dpense si, au
lieu de le considrer comme un facteur qui, toutes choses gales d'ailleurs, accrot
l'investissement, on y voit un facteur qui, toutes choses gales d'ailleurs, diminue
l'emploi.
1
Cf. l'Appendice au prsent Chapitre.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 40
Livre IV : Lincitation investir, chapitre XIV
Appendice
au chapitre XIV
Appendice relatif au taux de l'intrt tel qu'il apparat dans les
principes d'conomie de Marshall, dans les principes d'conomie
politique de Ricardo, et en d'autres ouvrages.
I
Retour la table des matires
Dans les uvres de Marshall, d'Edgeworth et du Professeur Pigou le taux de
l'intrt ne fait l'objet d'aucune tude suivie, mais seulement de quelques considra-
tions parses. En dehors du passage dj cit (p. 154) le seul fil sr qui puisse nous
conduire l'ide de Marshall au sujet du taux de l'intrt se trouve dans les pages 534
et 593 des Principles of Economics (6e dition), Livre VI. Les citations suivantes en
reproduisent l'essentiel.
L'intrt, tant le prix pay sur un march pour l'usage du. capital, tend vers un
niveau d'quilibre tel que la demande globale de capital faite ce taux sur ce march
soit gale au stock global
1
qui s'y prsente au mme taux. Si le march que l'on
1
On remarquera que Marshall emploie le mot capital et non le mot monnaie ainsi que le mot
stocks et non le mot prts ; or l'intrt est un paiement en contre-partie d'un prt de.
monnaie, et d'aprs le contexte la demande de capital devrait signifier la demande de prts de
monnaie pour acheter un stock de biens de capital . Mais l'galit entre le stock de biens de
capital offert et le stock demand est cre par le prix des biens de capital et non parle taux de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 41
considre est un march limit - par exemple une seule ville, ou une seule industrie
dans un pays en progrs - une augmentation dans la demande de capital sera vite
compense par une augmentation de l'offre provenant des rgions ou des industries
limitrophes. Mais, si on considre le monde entier ou seulement l'ensemble d'un
grand pays comme un mme march de capital, on ne peut penser qu'une variation du
taux de l'intrt produise dans un court dlai une modification importante de l'offre
globale de capital. Le fonds gnral de capital est en effet le produit du travail et de
l'abstinence ; or le surplus de travail
1
et le surplus d'abstinence que peut faire natre
en un Court dlai une hausse du taux de l'intrt sont d'une importance secondaire,
compars au travail et l'abstinence qui ont cr la totalit du stock existant de
capital. Un fort accroissement de la demande de s capital en gnral est donc
compens pendant un certain temps moins par un accroissement de l'offre que par une
hausse du taux de l'intrt
2
, et celle-ci amne le capital se dtourner partiellement
des emplois o son utilit marginale est la moins grande. La hausse du taux de
l'intrt n'entrane donc qu'une augmentation lente et progressive du stock global de
capital (p. 534).
Le terme taux d'intrt, on ne le rptera jamais assez, ne peut tre appliqu aux
investissements anciens qu'en un sens trs limit
3
. On pourrait, par exemple, estimer
qu'un capital industriel de quelque sept milliards de Livres est investi dans les
diffrentes industries de ce pays un taux d'intrt net d'environ 3 %. Mais cette
faon de parler, bien que commode et lgitime en de nombreux cas, n'est pas exacte.
Il faudrait s'exprimer ainsi: Supposons que le taux d'intrt net des investissements de
capital nouveau dans chacune des industries considres (i. e. des investissements
marginaux) soit 3 % environ, le revenu global net produit par tout le capital industriel
investi dans les diverses industries est tel que, capitalis au dernier, 33 (i. e. au taux
l'intrt. C'est l'galit entre la demande et l'offre de prts de monnaie qui est cre par le taux de
l'intrt.
1
Ceci suppose que le revenu n'est pas constant. Mais la raison pour laquelle la hausse du taux de
l'intrt fait natre un surplus d-, travail n'apparat pas clairement. Faut-il entendre que la hausse
du taux de l'intrt, parce qu'elle accrot l'attrait du travail en vue de l'pargne, doit-tre considre
comme constituant en quelque sorte une augmentation du salaire rel, qui incite les facteurs de
production travailler en change d'un salaire moindre. Telle est, pensons-nous, l'ide de M. D. H.
Robertson dans une matire analogue. Assurment, l'action de ce facteur est dans un court dlai
d'une importance secondaire , et il serait tmraire pour ne pas dire absurde de vouloir expliquer
de cette faon les fluctuations relles de l'investissement. Nous cririons la seconde moiti de la
phrase ainsi qu'il suit : Si un fort accroissement de la demande de capital en gnral, d une
hausse de la courbe de l'efficacit marginale du capital, n'est pas compens par une hausse du taux
de l'intrt, l'augmentation subsquente de l'emploi et du revenu, qui rsulte d'un accroissement de
la production des biens de capital, amnera un surcrot d'abstinence qui, mesur en monnaie, sera
juste gal la valeur du surplus de production courante des biens de capital et par suite fournira
exactement les ressources qui lui sont ncessaires .
2
Pourquoi pas par une hausse du prix d'offre des biens de capital ? Quid par exemple du cas o la
forte augmentation de la demande de capital en gnral est due une baisse du taux de l'intrt ?
La rdaction que nous proposerions serait celle-ci : Par suite, dans la mesure o une forte
augmentation de la demande de biens de capital ne peut tre immdiatement compense par une
augmentation du stock total, elle devra tre tenue en chec, aussi longtemps qu'il est ncessaire,
par une hausse du prix d'offre des biens de capital ; celle-ci devra tre d'une ampleur suffisante
pour maintenir l'efficacit marginale du capital au niveau du taux de l'intrt sans qu'il y ait de
variation sensible du montant de l'investissement ; entre temps (comme il arrive toujours) les
facteurs de production aptes produire les biens de capital seront employs produire ceux dont
l'efficacit marginale est, dans les conditions nouvelles, la plus grande.
3
En fait, il ne peut pas leur tre appliqu du tout. On ne peut parler de taux d'intrt, au sens strict
du mot, qu'au sujet de la monnaie emprunte pour acheter des capitaux anciens ou nouveaux (ou
pour tout autre objet).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 42
de 3 pour cent), il se chiffre quelque sept milliards de Livres. Car la valeur du capi-
tal dj investi en amliorations du sol, en constructions d'difices, en crations de
chemins de fer et de machines, est la valeur actuelle globale de l'estimation de ses
revenus nets futurs. (ou quasi-rentes) ; si son revenu escompt diminuait, sa valeur
baisserait en consquence et ne serait plus que la valeur capitalise du revenu
amoindri dduction faite de l'amortissement (p. 593).
Le Professeur Pigou dans ses Economics of Welfare (3e dit.) p. 163 crit : La
nature du service qu'on nomme abstinence a t trs mal comprise. On a parfois
suppos qu'elle consistait dans une mise en rserve de monnaie et parfois dans une
mise en rserve de temps, et on a soutenu, dans les deux hypothses, qu'elle n'appor-
tait aucune contribution au revenu. Ni l'une, ni l'autre des hypothses n'est exacte.
L'abstinence signifie simplement l'ajournement d'une consommation qu'une
personne a le pouvoir d'effectuer tout de suite, c'est--dire la possibilit pour les res-
sources qui auraient t dtruites de prendre la forme d'instruments de production
1
...
L'unit d'abstinence est donc l'usage d'une quantit donne de ressources
2
- par
exemple de travail ou d'outillage - pendant un certain temps- En termes plus gnraux
nous pouvons dire que l'unit d'abstinence est l'unit de valeur pendant un an, ou,
suivant l'expression plus simple sinon aussi exacte du Dr Cassel, une Livre-An... Il
n'est peut tre pas inutile, en outre, de mettre en garde contre l'ide commune que le
montant du capital accumul pendant une anne est ncessairement gal au moment
des R pargnes constitues pendant ladite anne. Tel n'est pas le cas, mme si on
interprte le mot pargnes dans le sens d' pargnes nettes , c'est--dire si on
limine les pargnes des uns qui sont prtes aux autres pour accrotre leur
consommation, et si on ignore les accumulations temporaires opus forme de monnaie
de banque de droits non exercs aux services de la communaut; car, parmi les
pargnes destines tre transformes en capital, nombreuses sont celles qui en fait
n'atteignent pas leur but, tant dtournes vers des emplois inutiles
3
.
notre connaissance le Professeur Pigou n'a fait qu'une seule allusion importante
aux facteurs qui dterminent le taux de l'intrt. C'est celle qui figure dans les
Industrial Fluctuations (1re dit. pp. 251-253), o il combat la thse que le taux
d'intrt, du fait qu'il est dtermin par les conditions gnrales de l'offre et de la
demande de capital rel, chappe l'action de la banque centrale ou des autres ban-
ques. A cette thse il oppose l'argument suivant : Quand les banques crent un
surplus de crdit destin aux hommes d'affaires, elles effectuent leur profit, ainsi
que nous l'avons expliqu au Chapitre XIII, 1re partie
4
, un prlvement forc sur les
1
Cette formule est ambigu ; elle ne nous dit pas si l'ajournement de la consommation a ncessai-
rement cet effet ou s'il a seulement pour rsultat de librer des ressources qui, suivant les
circonstances, resteront inemployes ou serviront des investissements.
2
Et non, ceci est noter, la quantit de monnaie que le bnficiaire du revenu pourrait dpenser
mais ne dpense pas en consommation; la rmunration de l'abstinence a donc le caractre, non
d'un intrt, mais d'une quasi-rente. Cette phrase semble admettre implicitement que les ressources
libres sont ncessairement utilises. Que serait, en effet, la rmunration de l'abstinence si les
ressources libres restaient sans emploi?
3
Ce passage ne nous dit pas si les pargnes nettes seraient ou non gales l'accroissement du
capital au cas o nous ngligerions les investissements malheureux et tiendrions compte des
accumulations temporaires sous forme de monnaie de banque de droits non exercs aux services
de la communaut . Mais le Prof. Pigou dans Industrial Fluctuations (P. 22) explique clairement
que les accumulations de cette nature n'ont pas d'effet sur ce qu'il appelle -les pargnes relles .
4
Le texte auquel l Professeur Pigou se rfre (op. cil. pp. 129-134.) expose sa manire de voir en
ce qui concerne la mesure dans laquelle les banques accroissent le courant de capital rel dont les
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 43
biens rels du publie; elles accroissent ainsi le courant de capital rel dont ils
disposent et font baisser le taux de l'intrt tant long terme qu' court terme. En
bref, il. est exact qu'entre le taux des avances des banques et le taux. rel de l'intrt
long terme il existe une liaison mcanique, mais non que ce taux rel soit dtermin
par ds facteurs qui chappent compltement l'action des banques .
Nous avons dvelopp dans les notes, au cours des passages qui prcdent, les
commentaires que ces textes appellent de notre part. Le point faible que nous trou-
vons l'explication du sujet donne par Marshall rside essentiellement dans l'intro-
duction du concept d'intrt, qui appartient une conomie montaire, dans un trait
qui ne tient pas compte de la monnaie. L'intrt n'a rellement rien faire dans les
Principles of Economics de Marshall ; il appartient une autre partie du sujet. Le
Professeur Pigou, en accord avec ses autres hypothses implicites, nous amne
conclure dans ses Economics of Welfare que l'unit d'abstinence est la mme que
l'unit d'investissement courant, et que la rmunration de l'abstinence a le caractre
d'une quasi-rente ; pratiquement il ne mentionne pas l'intrt et il a raison de ne pas le
mentionner. Cependant ces auteurs ne traitent pas d'une conomie sans monnaie (si
tant est qu'il existe une pareille chose). Ils admettent de toute vidence qu'on se sert
de monnaie et qu'il existe un systme bancaire. D'ailleurs, dans les Industrial
Fluctuations du Professeur Pigou (o il tudie surtout les fluctuations de l'efficacit
marginale du capital) ou dans sa Theory of Unemployment (o il tudie surtout les
causes de variation du volume de l'emploi, dans l'hypothse qu'il n'y a pas de
chmage involontaire), le taux de l'intrt ne joue gure un rle plus important que
dans, ses Economics of Welfare.
II
Le passage suivant, extrait des Principles of Political Economy (p. 511)
1
, contient
l'essentiel de la thorie de Ricardo sur le taux de l'intrt :
L'intrt de l'argent n'est pas rgi par le taux auquel la banque consent prter,
que ce taux soit 5, 3 ou 2 %, mais bien par le taux de profit qu'on peut tirer de
l'emploi du capital, taux qui est entirement indpendant de la quantit ou de la
valeur de la monnaie. Que la banque prte un, dix ou cent millions, elle ne modifie
entrepreneurs disposent; lorsqu'elles crent des crdits nouveaux. En fait, il cherche retrancher
du crdit flottant accord aux hommes d'affaires grce aux crations de crdit le capital flottant qui
et t fourni par d'autres moyens si les banques n'avaient pas t l . Ces soustractions une fois
faites, le raisonnement devient d'une obscurit profonde. A l'origine, les rentiers ont un revenu de
1500, qu'ils consomment concurrenc de 500 et pargnent concurrence de 1.000 ; la cration
de crdit rduit leur revenu 1.300, ils le consomment concurrence de 500 - x et l'pargnent
concurrence de 800 + x ; le Professeur Pigou conclut que x reprsente l'accroissement net de capi-
tal dont on dispose grce la cration de crdit. Suppose-t-il que le revenu des entrepreneurs est
grossi du montant qu'ils empruntent aux banques (sous les dductions indiques ci-dessus) ? Ou
bien leur revenu est-il grossi du montant, c'est--dire 200, de la diminution subie par le revenu des
rentiers ? Sont-ils censs, dans les deux cas, pargner intgralement le surcrot de revenu ? L'in-
vestissement supplmentaire est-il gal aux crdits crs moins les dductions ? Ou bien est-il gal
x ? Il semble que le raisonnement s'arrte juste au moment o il devrait commencer.
1
Voir la traduction franaise de MM. Constancio et Alc. Fonteyraud (1847) et notamment page 338
(N. du T.)
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 44
pas d'une faon permanente le taux d'intrt du march, mais seulement la valeur de
la monnaie ainsi mise. Il faudra dix ou vingt fois plus de monnaie pour exploiter une
mme affaire, dans un cas que dans l'autre. Les demandes d'argent la banque
dpendent donc du rapport entre le taux des profita que son emploi peut rapporter et
le taux auquel la banque est dispose le prter. Si elle prend moins que le taux
d'intrt du march, elle peut prter indfiniment ; si elle prend plus que ce taux,
seuls les dissipateurs et les prodigues consentent lui emprunter.
Ce texte est si net qu'il fournit une base de discussion meilleure que les phrases
des auteurs prcdents, lesquels sans rpudier ouvertement l'essentiel de la doctrine
de Ricardo s'y sentent assez inconfortables pour chercher un refuge dans les brumes.
Bien entendu, ce qui prcde, comme tout ce qui mane de Ricardo, doit tre inter-
prt comme une doctrine de longue priode, l'accent tant plac sur le mot per-
manente situ au milieu du passage ; et il est intressant d'examiner dans quelles
hypothses cette thorie est valable.
Une fois de plus, l'hypothse ncessaire est l'hypothse classique ordinaire que le
plein emploi est toujours ralis ; autrement dit, il faut que, si l'offre de travail
mesure en units de production reste fixe, il n'y ait dans un quilibre de longue
priode qu'un seul volume possible de l'emploi. Dans cette hypothse et sous la
condition habituelle que toutes choses restent gales, c'est--dire qu'il ne se produise
dans les prvisions et les tendances psychologiques aucun changement autre que ceux
qui rsultent d'une variation de la quantit de monnaie, la thorie Ricardienne doit
tre considre comme valable, car dans ces hypothses il n'existe qu'une seule valeur
de l'intrt compatible avec le maintien du plein emploi au cours de la longue prio-
de. Ricardo et ses successeurs n'ont pas compris que, mme dans la longue priode,
l'emploi loin d'tre ncessairement maximum peut prendre des volumes divers, qu'
chaque politique bancaire correspond un volume diffrent et que par suite il peut y
avoir dans la longue priode plusieurs positions d'quilibre correspondant aux
diverses politiques d'intrt susceptibles d'tre adoptes par l'autorit montaire.
Dans le cas o Ricardo aurait prsent sa thse comme applicable seulement aux
variations de la quantit de monnaie cre par l'autorit montaire, elle et encore t
correcte, supposer que les salaires nominaux fussent souples. En d'autres termes, s'il
avait soutenu que le taux de l'intrt ne varie pas d'une faon permanente parce que
l'autorit montaire fixe dix ou cent millions la quantit de monnaie, sa con-
clusion et t exacte. Mais, si le terme politique montaire signifie aussi les condi-
tions auxquelles l'autorit augmente ou diminue la quantit de monnaie, i. e. le taux
d'intrt auquel cette autorit doit augmenter ou diminuer ses avoirs soit en modifiant
le volume de l'escompte soit en oprant sur le march ouvert - et Ricardo dans la
citation prcdente adopte expressment cette interprtation - alors il n'est plus exact
que la politique montaire soit sans effet ou qu'une seule politique soit compatible
avec un quilibre de longue priode. Et encore l'erreur n'est-elle pas absolue, car dans
l'hypothse extrme o, en cas de chmage involontaire, sous l'effet d'une concur-
rence inutile entre les chmeurs dsireux de s'employer les salaires nominaux baisse-
raient sans limite, il n'y aurait que deux positions possibles de longue priode - le
plein emploi et l'emploi correspondant au niveau de l'intrt o la prfrence pour la
liquidit deviendrait absolue ( supposer que ce volume de l'emploi ft infrieur au
premier). L'influence de la quantit de monnaie en tant que telle est donc effecti-
vement ngligeable dans la longue priode si les salaires nominaux sont souples;
mais les conditions auxquelles l'autorit montaire fait varier la quantit de monnaie
interviennent dans le schme conomique comme un dterminant vritable.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 45
Il n'est pas inutile d'ajouter que, si on en juge par les dernires phrases de la
citation, Ricardo semble avoir ignor que l'efficacit marginale du capital peut varier
avec l'importance des investissements. Mais ceci peut tre interprt comme une
nouvelle preuve du caractre hautement logique de sa pense, compare celle de ses
successeurs. Car, si l'on prend comme donnes le volume de l'emploi et les tendances
psychologiques de la communaut, il ne peut exister qu'une seule vitesse d'accumu-
lation du capital, et, partant, qu'une seule valeur de l'efficacit marginale du capital.
Ricardo nous offre ce suprme chef-d'uvre d'intelligence, irralisable pour un esprit
moins puissant, qui consiste se placer dans un monde hypothtique loign du
monde rel, comme s'il tait dans le monde rel, et y vivre sans contradiction. La
plupart de ses successeurs n'ont pu empcher leur bon sens de parler, ce qui nuit la
cohrence logique de leurs doctrines.
III
Le Professeur Von Mises a propos une thorie particulire du taux de l'intrt qui
a t adopte par le Professeur Hayek et aussi, croyons-nous, par le Professeur
Robbins. D'aprs cette thorie on pourrait assimiler les variations du taux de l'intrt
aux variations du prix des biens de consommation par rapport celui des biens de
capital
1
. L'on ne voit pas clairement comment on arrive cette conclusion. Mais le
raisonnement parait tre celui-ci; Par une simplification hardie on considre que le
rapport entre le prix d'offre des nouveaux biens de consommation et celui des nou-
veaux biens de production mesure l'efficacit marginale du capital
2
; et on assimile
ensuite ce rapport au taux de l'intrt. C'est un fait d'exprience qu'une baisse du taux
de l'intrt est favorable l'investissement. Donc une baisse du rapport entre le prix
des biens de consommation et le prix des biens de production est favorable l'inves-
tissement.
Cette thorie cre un lien entre l'accroissement de l'pargne d'un individu et celui
de l'investissement global. C'est un fait connu, en effet, que l'augmentation de
l'pargne individuelle fait baisser le prix des biens de consommation; et il est tout
fait possible qu'elle fasse baisser ce prix plus que celui des biens de production; ceci
signifie, d'aprs le raisonnement prcdent, que le taux de l'intrt baisse et par suite
que l'investissement est stimul. Pourtant il est vident qu'une baisse de l'efficacit
marginale de certains capitaux et partant de la courbe de l'efficacit marginale du
capital en gnral produit un effet diamtralement, oppos celui que le raisonne-
ment prcdent suppose. L'investissement est en effet stimul soit par une hausse de
la courbe de l'efficacit marginale soit par une baisse du taux. de l'intrt. Pour avoir
confondu l'efficacit marginale du capital et le taux de l'intrt, le Professeur Von
Mises et ses disciples sont arrivs des conclusions exactement contraires la ralit.
1
The Theory of Money and Crdit, p. 339 et divers autres endroits, notamment p. 363.
2
Dans un quilibre de longue priode on pourrait concevoir des hypothses spciales o ce
raisonnement serait exact. Mais, lorsque les prix envisags sont ceux qui existent en priode de
dpression, il est srement inexact de supposer, titre de simplification, que l'entrepreneur fait ses
prvisions comme si ces prix devaient tre permanents. D'ailleurs, les entrepreneurs procderaient-
ils ainsi, que les prix des stocks existants de biens de production baisseraient dans la mme pro-
portion que les prix des biens de consommation.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 46
On trouve dans le passage suivant du Professeur Alvin Hansen
1
un bon exemple
d'une confusion de cette nature : Certains conomistes ont suggr qu'une rduction
de la dpense aurait pour rsultat net d'amener dans le prix des biens de consom-
mation une baisse suprieure celle qui se ft produite autrement, et que par suite
cette rduction contribuerait affaiblir le stimulant des investissements en capital
fixe. Or une telle conception est errone ; elle repose sur une confusion entre les
effets qu'exercent respectivement sur la formation du capital. : 1 la hausse ou la
baisse du prix des biens de consommation, et 2 les variations du taux de l'intrt. Il
est exact qu' la suite d'une diminution de la dpense et d'un accroissement de
l'pargne, les prix des biens de consommation baissent par rapport ceux des biens
de production. Mais ceci dans la ralit signifie que le taux de l'intrt baisse; et un
taux d'intrt plus bas provoque l'extension de l'investissement un domaine qui et
t improductif si les taux d'intrt avaient t plus levs.
1
Economic Reconstruction, p. 233.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 47
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XV
Les motifs psychologiques
et commerciaux de la liquidit
I
Retour la table des matires
Il nous faut maintenant analyser plus en dtail les motifs de la prfrence pour la
liquidit qui ont t prsents succinctement au Chapitre XIII. Le sujet est identique
celui qu'on a parfois trait sous la dsignation de la demande de monnaie. Il a aussi
des rapports troits avec ce qu'on appelle la vitesse de transformation de la monnaie
en revenu ; car cette vitesse de transformation mesure simplement la proportion de
ses revenus que le public dsire conserver sous forme liquide, et par suite une aug-
mentation de la vitesse de transformation de la monnaie en revenu dnote en gnral
une diminution de la prfrence pour la liquidit. Les deux sujets, toutefois, ne sont
pas identiques, car l'option ouverte chaque individu entre le maintien et l'abandon
de la liquidit porte non sur son revenu mais sur l'ensemble de ses pargnes accu-
mules. De toute faon, le terme vitesse de transformation de la monnaie en revenu
contient une indication trompeuse, car il fait prsumer que la demande de monnaie
prise dans son ensemble est proportionnelle au revenu ou lui est unie par une certaine
relation dtermine ; or nous verrons qu'une telle prsomption ne s'applique qu' une
portion des avoirs liquides du public et que par suite te terme ne tient pas compte du
rle jou par le taux de l'intrt.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 48
Dans le Treatise on Money, nous avons tudi la demande totale de monnaie sous
les trois titres de dpts de revenu, de dpts de fonds d'entreprise et de dpts
d'pargne, et il est inutile de rpter ici l'analyse faite au Chapitre III de cet ouvrage.
Cependant la monnaie conserve pour chacune des trois raisons prcdentes constitue
entre les mains de son dtenteur un fonds unique, qu'il n'est pas oblig de sparer en
trois compartiments tanches ; car ces compartiments peuvent n'tre pas nettement
distincts, mme dans son esprit, et une certaine somme peut tre conserve princi-
palement pour une raison et subsidiairement pour une autre. Il est donc tout aussi
lgitime, sinon prfrable, de considrer la totalit des demandes individuelles de
monnaie en des circonstances donnes comme une dcision unique, la formation de
laquelle concourent plusieurs motifs diffrents.
Lorsqu'on analyse ces motifs, il est encore commode de les classer sous certains
titres. Le premier correspondra aux dpts de revenu et aux dpts de fonds d'entre-
prise de notre ancienne division, les deux derniers correspondront chacun une partie
des anciens dpts d'pargne. Nous avons donn au Chapitre XIII un aperu rapide de
ces catgories en les dsignant par le motif de transactions, qui peut tre subdivis en
motif de revenu et motif d'entreprise, par le motif de prcaution, et par le motif de
spculation.
1 Le motif de revenu. - Une premire raison de conserver de la monnaie est de
combler l'intervalle entre l'encaissement et le dcaissement du revenu. Dans une
dcision de conserver un certain montant global de monnaie, ce motif intervient avec
une force qui dpend principalement du montant du revenu et de la longueur normale
de l'intervalle entre son encaissement et son dcaissement. Le concept de vitesse de
transformation de la monnaie en revenu* convient exactement cet aspect de la
question.
2 Le motif d'entreprise. - De mme on conserve de la monnaie pour combler
l'intervalle entre l'poque o on engage des dpenses professionnelles et celle o on
reoit le produit de la vente ; l'argent conserv par les ngociants pour combler
l'intervalle entre un achat et une ralisation appartient cette catgorie. L'intensit de
cette sorte de demande dpend principalement de la valeur de la production courante
(i. e. du revenu courant) et du nombre de mains entre lesquelles elle passe.
3 Le motif de prcaution. - Le souci de parer aux ventualits qui exigent des
dpenses inopines, l'espoir de profiter d'occasions imprvues pour raliser des achats
avantageux, et enfin le dsir de conserver une richesse d'une valeur montaire
immuable pour, faire face une obligation future stipule en monnaie sont autant de
nouveaux motifs conserver de l'argent liquide.
La puissance de ces trois sortes de motifs dpend en partie du cot et de la
scurit des mthodes qui permettent d'obtenir de l'argent en cas de besoin, par des
avances temporaires d'une forme quelconque et notamment par des dcouverts ou des
facilits du mme ordre. Il n'est pas ncessaire, en effet, de conserver de l'argent oisif
pour combler les intervalles entre les diverses chances, si on peut en obtenir sans
difficult au moment o l'on en a effectivement besoin. La puissance de ces motifs
dpend encore de ce que nous pouvons appeler le cot relatif de la dtention de
monnaie. Si l'on ne peut garder de la monnaie qu'en diffrant l'achat d'un capital
productif, cette circonstance augmente le cot relatif de sa dtention et affaiblit par
consquent le motif en conserver un montant donn. Si la monnaie rapporte un
intrt de dpt ou pargne des agios de banque, cette circonstance diminue au con-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 49
traire le cot relatif de sa dtention et renforce le motif en conserver un montant
donn. Il se peut cependant que l'importance de ce facteur soit secondaire, sauf en cas
de fortes variations du cot relatif de la dtention de monnaie.
4 Reste enfin le motif de spculation. - Ce motif appelle une tude plus dtaille,
d'abord parce qu'il est moins bien compris que les autres, et ensuite raison du rle
particulirement important qu'il joue en transmettant les effets d'une variation de la
quantit de monnaie.
En circonstances normales, la quantit de monnaie ncessaire pour satisfaire aux
deux motifs de transactions et de prcaution dpend surtout de l'activit gnrale du
systme conomique et du montant du revenu nominal. Mais c'est en faisant jouer le
motif de spculation que les autorits charges de la direction de la monnaie, ou en
l'absence d'une telle direction les variations fortuites de la quantit de monnaie, sont
amenes agir sur le systme conomique. La demande de monnaie dtermine par
les premiers motifs est en gnral insensible toute influence autre que celle d'une
variation effective de l'activit conomique gnrale et du niveau des revenus ;
l'exprience montre au contraire que la demande globale de monnaie dtermine par
le motif de spculation varie d'une manire continue sous l'effet d'une variation gra-
duelle du taux de l'intrt, c'est--dire qu'il existe une relation continue entre les
variations de la demande de monnaie dtermine par le motif de spculation et les
variations du taux de l'intrt, telles qu'elles ressortent des variations du cours des
obligations et des crances d'chances diverses.
S'il n'en tait pas ainsi, les oprations sur le march ouvert (open market
operations) seraient impossibles. Nous avons dit que l'existence de la relation
continue indique plus haut tait prouve par l'exprience, parce qu'en fait le systme
bancaire est toujours mme, en circonstances normales, d'acheter ou de vendre des
obligations contre espces, en faisant lgrement monter par une enchre ou flchir
par un rabais les prix du march ; plus est considrable la quantit de monnaie que les
banques cherchent crer ou annuler en achetant ou en vendant des obligations et
des crances, plus importante devra tre la baisse ou la hausse du taux de l'intrt.
Toutefois, lorsque les oprations sur le march ouvert ne portent (comme en 1933 et
en 1934 aux tats-Unis) que sur des titres d'chance trs rapproche, leur effet
principal peut videmment tre limit au taux de l'intrt trs court terme, et leur
action peut tre faible sur les taux d'intrt long terme, dont l'importance est
beaucoup plus considrable.
Lorsque on tudie le motif de spculation, il importe de distinguer parmi les
variations du taux de l'intrt, celles qui sont dues aux variations de l'offre de mon-
naie disponible pour la satisfaction de ce motif, lesquelles n'affectent pas la fonction
de liquidit, et celles qui ont pour cause initiale les changements de la prvision
influant directement sur la fonction de liquidit. Les oprations sur le march ouvert
peuvent agir sur le taux de l'intrt par l'une et l'autre voie ; elles peuvent d'une part
modifier la quantit de monnaie et de l'autre donner naissance des prvisions
nouvelles en ce qui concerne la politique future de la Banque Centrale ou du Gouver-
nement. Les changements propres de la fonction de liquidit, rsultant de change-
ments dans les informations qui entranent une rvision des prvisions, sont souvent
discontinus et engendrent des discontinuits correspondantes dans les variations du
taux de l'intrt. C'est seulement dans la mesure o un changement dans les informa-
tions est interprt diffremment par les divers individus ou affecte diffremment les
intrts individuels, que l'on constate sur le march des obligations une activit plus
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 50
grande des transactions. Lorsque un changement dans les informations affecte le
jugement et les besoins de chacun d'une manire strictement identique, le taux de
l'intrt (tel qu'il est exprim par les cours des obligations et des crances) s'ajuste
sur-le-champ la situation nouvelle sans qu'il soit besoin d'aucune transaction.
Ainsi, dans le cas le plus simple o les individus ont tous des opinions et des
intrts semblables, un changement dans les circonstances ou dans les prvisions ne
dterminera aucun dplacement de monnaie. Son seul effet sera de faire varier le taux
de l'intrt dans la mesure ncessaire contrebalancer le dsir qu'au niveau antrieur
de l'intrt chaque individu prouvait d'ajuster ses avoirs liquides aux circonstances
ou aux prvisions nouvelles ; et, puisque chacun fera subir son apprciation du taux
qui le dciderait modifier son avoir liquide une correction gale, aucune transaction
ne s'ensuivra. A chaque groupe de circonstances et de prvisions correspondra un
taux d'intrt appropri, et il ne sera jamais question que l'on modifie ses avoirs
liquides habituels.
Cependant, dans le cas gnral, un changement dans les circonstances ou les
prvisions amne certains rajustements dans les avoirs liquides individuels ; car, en
pratique, les effets produits par un tel changement sur les ides diffrent suivant !es
individus, d'abord parce qu'ils ne se trouvent pas tous dans les mmes circonstances
et n'ont pas tous les mmes raisons de conserver de la monnaie, ensuite parce qu'ils
connaissent et interprtent la situation nouvelle chacun sa faon. Aussi la nouvelle
position d'quilibre du taux de l'intrt est-elle associe une nouvelle rpartition de
la monnaie. Nanmoins, c'est la variation du taux de l'intrt plus que le mouvement
de la monnaie qui mrite notre attention. Ce mouvement n'est d qu' des diffrences
contingentes entre les individus, le phnomne essentiel est celui qui se produit dans
le cas le plus simple. Au surplus, mme dans le cas gnral, la variation du taux de
l'intrt est d'ordinaire l'effet le plus marquant d'un changement dans les informa-
tions. Les cours des obligations subissent, comme disent les journaux, des fluctua-
tions disproportionnes l'activit des transactions ; et il est normal qu'il en soit
ainsi, car les ractions des divers individus aux informations se ressemblent beaucoup
plus qu'elles ne diffrent.
II
A strictement parler, le montant de monnaie que le motif de transactions et le
motif de prcaution dcident un individu dtenir n'est pas indpendant du montant
qu'il conserve pour le motif de spculation. Cependant, c'est une premire approxi-
mation lgitime de considrer que ces deux catgories d'avoirs liquides sont dans une
large mesure indpendantes l'une de l'autre. Pour les besoins de l'analyse qui va
suivre nous aborderons le problme sous cet angle.
Soient M
1
le montant de monnaie dtenu pour les motifs de transactions et de
prcaution, et M
2
le montant conserv pour le motif de spculation. En regard de ces
deux compartiments de la masse montaire totale, nous avons deux fonctions de
liquidit L
1
et L
2
L
1
dpend principalement du montant du revenu et L
2
dpend
principalement de la relation entre le taux de l'intrt courant et l'tat de la prvision.
Par suite,
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 51
M = M
1
+ M
2
= L
1
(R) + L
2
(r),
o L
1
est la fonction de liquidit qui dtermine M
1
par rapport au revenu R, et L
2
la fonction de liquidit qui dtermine M
2
par rapport au taux de l'intrt r. Il s'ensuit
que nous avons trois questions examiner : 1 la relation entre les variations de M et
celles de R et r ; 2 les facteurs qui dterminent la forme de L
1
; 3 les facteurs qui
dterminent la forme de L
2
.
1 La relation entre les variations de M et celles de R et r dpend d'abord de
l'origine des variations de M. Supposons que M consiste en monnaies d'or et ne
puisse varier qu' la suite d'une augmentation du rendement dans les exploitations
minires appartenant au systme conomique considr. Dans ce cas les variations de
M sont au premier instant directement associes celles de R, puisque l'or nouveau
s'ajoute au revenu de quelqu'un. La situation est exactement la mme lorsque les
variations de M proviennent d'missions de papier monnaie faites par le Gouverne-
ment pour couvrir ses dpenses courantes - en ce cas encore la monnaie nouvelle
s'ajoute au revenu de quelqu'un. Cependant, le montant nouveau du revenu ne
demeurera pas assez lev pour que les besoins de M
1
absorbent intgralement
l'accroissement de M ; une portion de la monnaie cherchera un dbouch dans l'achat
d'obligations ou d'autres capitaux et fera dcliner r jusqu' ce que la baisse de l'intrt
ait dtermin, dans le montant de M
2
et en mme temps dans le revenu, des accrois-
sements suffisants pour que la monnaie nouvelle soit absorbe ou par M
2
ou par M
1
lorsque cette dernire quantit de monnaie se sera ajuste la hausse du revenu
provoque par la baisse de r. Ce cas revient donc peu de chose prs au mme que
l'autre cas o la monnaie nouvelle ne peut tre mise, en premire analyse, qu'au
moyen d'un adoucissement des conditions de crdit des banques qui incite quelqu'un
leur vendre une obligation ou une crance en change de monnaie nouvelle.
Le second cas peut donc tre considr comme typique. On peut admettre qu'une
variation de M produit son effet en faisant varier r ; et une variations de r conduit
un quilibre nouveau d'une part en modifiant M
2
et d'autre part en modifiant R et par
consquent M
1
. Dans la nouvelle position d'quilibre, le partage de la monnaie
additionnelle entre M
1
et M
2
dpendra de la raction de l'investissement une baisse
du taux de l'intrt et de celle du revenu une augmentation de l'investissement
1
.
Puisque R dpend en partie de r, une variation donne de M entranera une variation
de r suffisante pour que la somme des variations conscutives de M
1
et M
2
soit gale
la variation donne de M.
2 On n'a pas toujours indiqu clairement si par dfinition la vitesse de trans-
formation de la monnaie en revenu tait le rapport de R M ou le rapport de R M
1
.
Nous proposons d'employer ce terme dans le second sens. Si la vitesse de trans-
formation de la monnaie en revenu est V, on a donc
1 1 L M
R
R
V
( )
1
Il nous fait renvoyer au Livre V la question de savoir ce qui dtermine le caractre de l'quilibre
nouveau.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 52
Il n'y a, bien entendu, aucune raison de supposer que la valeur de V soit constante.
Cette valeur dpendra du caractre de l'organisation bancaire et industrielle, des
habitudes sociales, de la rpartition du revenu entre les diffrentes classes, et du cot
effectif de la dtention d'argent oisif. Nanmoins, si l'on a en vue une courte priode
et si aucun de ces facteurs ne semble devoir beaucoup changer, on peut sans erreur
excessive considrer V comme constant.
3 Reste enfin la question de la relation entre M
2
et r. Nous avons vu au Chapitre
XIII que l'incertitude au sujet des variations futures du taux de l'intrt est la seule
explication intelligible de la prfrence pour la liquidit du type L
2
, qui justifie la
conservation d'un avoir liquide M
2
. Il s'ensuit qu'entre un certain montant M
2
et une
certaine valeur de l'intrt r, il n'y a pas de relation quantitative dfinie - ce qui
importe ce n'est pas le niveau absolu de r, mais l'cart entre ce niveau et celui qui, au
regard des calculs de probabilit sur lesquels on s'appuie, parat offrir une scurit
suffisante. Nanmoins, il existe deux raisons de croire que dans un certain tat de la
prvision une baisse de r s'accompagne d'une augmentation de M
2
. En premier lieu, si
le niveau de r que l'opinion gnrale considre comme sr reste inchang, toute
baisse de r diminue le taux du march par rapport au niveau jug sr et accrot par
consquent le risque inhrent l'abandon de la liquidit ; en second lieu toute baisse
de r diminue comme le carr du taux de l'intrt la mesure dans laquelle le revenu
procur par l'abandon de la liquidit peut servir en quelque sorte de prime d'assurance
contre le risque de perte au compte capital. Par exemple, lorsque le taux d'intrt
d'une crance long terme est 4 %, il y a avantage sacrifier la liquidit, moins
qu'un bilan d probabilits ne fasse craindre une hausse du taux de l'intrt long
terme suprieure 4 % de sa valeur par an, c'est--dire suprieure 0,16 0/0 par an.
Or, lorsque le taux de l'intrt est 2 %, le revenu courant ne compense plus qu'une
hausse ventuelle de l'intrt de 0,04 % par an. Ce fait est sans doute l'obstacle
principal une baisse trs marque du taux de l'intrt. S'il n'y a pas de raison de
croire que les circonstances futures diffrent beaucoup des circonstances passes, un
taux d'intrt long terme de (disons) 2 % laisse plus craindre qu' esprer et
procure un revenu courant qui ne suffit compenser qu'un faible degr de crainte.
Il est donc vident que le taux de l'intrt est un phnomne psychologique au
plus haut degr. Nous verrons au Livre V qu'il est impossible qu'il reste en quilibre
un niveau infrieur celui qui correspond au plein emploi ; car un tel niveau il
s'tablirait un tat d'inflation vritable o M1 absorberait des quantits croissantes de
monnaie. Mais, au-dessus du niveau qui correspond au plein emploi, le taux d'intrt
long terme du march dpendra non seulement de la politique courante de l'autorit
montaire, mais aussi de sa politique future, telle que le march la prvoit. L'autorit
montaire gouverne sans peine le taux de l'intrt court terme, d'abord parce qu'il
lui est facile d'inculquer la conviction que sa politique ne changera pas sensiblement
dans un avenir trs proche et aussi parce que la perte craindre est faible compare
au revenu courant ( moins que celui-ci soit presque nul). Mais le taux long terme
peut se montrer plus rcalcitrant la baisse, lorsqu'il est tomb un niveau que,
d'aprs les enseignements du pass et les prvisions courantes de la politique mon-
taire future, l'opinion reprsentative juge alatoire. Par exemple, dans un pays ratta-
ch un talon or international, un taux d'intrt infrieur celui qui existe l'tran-
ger inspirera une dfiance lgitime ; et, si le taux d'intrt intrieur est maintenu la
parit du taux le plus lev (le plus lev compte tenu du risque) qui existe dans les
autres pays appartenant au systme international, ce taux intrieur pourra tre trs au-
dessus du niveau compatible avec le plein emploi.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 53
Lorsque une politique montaire qui se propose de rduire fortement le taux de
l'intrt long terme frappe l'opinion publique par son caractre empirique ou son
inconstance, elle peut manquer son but parce que, au dessous d'un certain chiffre, une
baisse de r peut s'accompagner d'une augmentation presque illimite de M
2
. La mme
politique, au contraire, russira facilement si l'opinion la juge possible, raisonnable et
conforme l'intrt publie, si elle s'appuie sur une conviction solide, et si elle est
soutenue par une autorit qui ne risque pas d'tre supplante.
Peut-tre, au lieu de dire que le taux de l'intrt est au plus haut degr un ph-
nomne psychologique, serait-il plus exact de dire qu'il est au plus haut degr un
phnomne conventionnel, car sa valeur effective dpend dans une large mesure de sa
valeur future telle que l'opinion dominante estime qu'on la prvoit. Un taux d'intrt
quelconque que l'on accepte avec une foi suffisante en ses chances de durer durera
effectivement, sous cette rserve vidente que dans une socit mouvante le taux rel
varie pour toutes sortes de raisons de part et d'autre du niveau qu'on juge devoir tre
normal. Dans le cas particulier o M
1
crot plus que M le taux de l'intrt monte et
vice-versa. Mais il peut osciller pendant des dizaines d'annes autour d'un niveau
constamment trop lev pour permettre le plein emploi. Cette ventualit est surtout
craindre lorsque l'opinion dominante croit que l'ajustement du taux de l'intrt se fait
d'une faon automatique. Le niveau tabli par convention est alors cens avoir une
base objective beaucoup plus rsistante qu'une convention et il ne vient l'ide ni du
public ni de l'autorit d'tablir un lien entre l'existence d'une gamme inadquate de
taux d'intrts et l'impossibilit pour l'emploi d'atteindre son niveau optimum.
Le lecteur devrait parfaitement comprendre maintenant combien il est difficile
d'entretenir une demande effective suffisante pour assurer le plein emploi, alors qu'un
taux d'intrt long terme conventionnel et assez stable se trouve associ une
efficacit marginale du capital mobile et fort instable.
Si l'on peut tirer quelque rconfort de considrations plus encourageantes, il faut
le chercher dans l'espoir que la convention, prcisment parce qu'elle ne repose pas
sur une connaissance certaine, n'opposera pas toujours une rsistance excessive une
politique montaire quelque peu stable et persvrante. L'opinion publique peut
s'accoutumer assez vite une baisse modre du taux de l'intrt et la prvision con-
ventionnelle de l'avenir peut tre modifie en consquence ; la voie est alors ouverte
un nouveau progrs et ainsi de suite jusqu' un certain point. La baisse du taux de
l'intrt long terme en Grande-Bretagne aprs l'abandon de l'talon-or fournit un
exemple intressant d'une telle volution. Les principaux mouvements furent accom-
plis par une suite de bonds discontinus, mesure que la fonction de liquidit du
publie, s'tant adapte chacune des rductions successives, se trouvait prte
rpondre une nouvelle impulsion venant des informations ou de la politique des
autorits.
III
Nous pouvons rsumer ce qui prcde dans la proposition suivante : Un tat
quelconque de la prvision tant donn, il existe dans l'esprit du public une tendance
dtenir de l'argent liquide en quantit suprieure celle que requirent le motif de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 54
transactions et le motif de prcaution, et cette dtention potentielle se ralise en
dtention effective dans une mesure qui dpend des conditions auxquelles l'autorit
montaire est dispose crer de la monnaie. C'est cette dtention potentielle que
traduit la fonction de liquidit L
2
.
A chaque montant de la quantit de monnaie cre par l'autorit montaire corres-
pondra donc, toutes choses gales d'ailleurs, une valeur dtermine du taux de
l'intrt ou plus exactement une gamme de valeurs dtermines des taux d'intrt
termes diffrents. La mme proposition serait d'ailleurs vraie de tout autre lment du
systme conomique considr isolment. La prsente analyse particulire n'est
importante et utile qu'autant qu'il existe une relation spcialement directe ou fconde
entre les variations de la quantit de monnaie et celles du taux de l'intrt. Notre
motif supposer qu'il existe une telle relation est, en gros, que les transactions du
systme bancaire et de l'autorit montaire portent sur la monnaie et les crances et
non sur les capitaux ou sur les marchandises consommables.
Si l'autorit montaire acceptait des conditions dfinies d'oprer dans les deux
sens sur les crances de toutes chances, et plus encore si elle consentait oprer sur
les crances prsentant diffrents degrs de risque, la relation entre la gamme des
taux d'intrts et la quantit de monnaie serait immdiate. La gamme des taux
d'intrt ne ferait qu'exprimer les conditions auxquelles le systme bancaire accep-
terait d'acqurir ou de cder les crances ; et la quantit de monnaie serait gale au
montant qui pourrait se loger entre les mains des individus qui, compte tenu de toutes
les circonstances en jeu, aimeraient mieux disposer d'avoirs liquides que les cder,
aux conditions exprimes par le taux d'intrt du march, en change de crances.
Peut-tre l'amlioration pratique la plus importante que l'on pourrait apporter la
technique de la direction de la monnaie consisterait-elle substituer au taux de l'es-
compte unique sur les effets court terme, une offre complexe obligeant la banque
centrale acheter et vendre prix fermes les effets de premier ordre de toutes
chances.
Mais, dans le monde actuel o nous vivons, le prix des crances tel qu'il est fix
par le systme bancaire n'est pas entirement effectif , en ce sens qu'il ne gouverne
pas absolument les prix rels du march, et la mesure dans laquelle ce prix est effectif
varie suivant les systmes. Parfois il est plus effectif dans un sens que dans l'autre ;
ceci signifie que le systme bancaire peut s'engager acheter les crances un certain
prix sans tre ncessairement oblig de les vendre au mme prix, ou au moins un
prix dont la diffrence avec le premier ne dpasse pas l'ordre de grandeur d'un cour-
tage, encore qu'il n'y ait aucune raison qui empche que le prix soit rendu effectif
dans les deux sens l'aide d'oprations sur le march ouvert. Il existe d'ailleurs une
exception plus importante, due au fait qu'en gnral l'autorit montaire n'opre pas
aussi volontiers sur les crances de toutes chances. En pratique, elle tend con-
centrer son activit sur les crances court terme et abandonner le prix des crances
long termes l'action tardive et incomplte du prix des crances court terme - bien
qu'ici encore il n'y ait aucune raison qui l'oblige agir ainsi. Dans la mesure o ces
exceptions interviennent, la relation entre le taux de l'intrt et la quantit de monnaie
est moins immdiate. Il semble qu'en Grande-Bretagne le champ d'une direction
mthodique de l'intrt aille s'largissant. Mais chaque fois qu'on applique la prsente
thorie des cas particuliers, on doit tenir compte des caractristiques spciales de la
mthode qui est en fait suivie par l'autorit montaire. Lorsque celle-ci n'opre que
sur les crances court terme il convient d'examiner quelle influence le prix effectif
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 55
et le prix escompt des crances court terme exercent sur les crances d'chance
plus loigne.
L'autorit montaire n'est donc pas en mesure de faire rgner une gamme quel-
conque de taux d'intrt relatifs aux prts d'chances et de garanties diverses. Son
pouvoir comporte des limites que nous pouvons rsumer comme il suit :
1 Il est des limites que l'autorit montaire s'impose elles-mme en refusant
d'oprer sur les crances qui n'entrent pas dans un type particulier ;
2 Pour les raisons exposes plus haut, il se peut que, une fois le taux d'intrt
rendu un certain niveau, la prfrence pour la liquidit devienne virtuellement abso-
lue, en ce sens que presque tout le monde aime mieux garder un avoir liquide qu'une
crance rapportant un taux d'intrt aussi faible. L'autorit montaire perd alors la
direction effective du taux de l'intrt. Peut-tre ce cas limite prendra-t-il une impor-
tance pratique dans l'avenir, mais nous n'en connaissons pas d'exemple dans le pass.
A vrai dire, tant donn la rpugnance de la plupart des autorits montaires oprer
rsolument sur les crances long terme, on n'a pas eu souvent l'occasion d'en faire
l'exprience. D'ailleurs, si une pareille situation se produisait, elle signifierait que
l'autorit montaire pourrait elle-mme un taux d'intrt purement nominal emprun-
ter sans limite au systme bancaire.
3 Lorsque la fonction de liquidit s'aplatit compltement en raison d'une hausse
ou d'une baisse rapide des prix, le taux de l'intrt peut perdre toute stabilit. Les
exemples les plus frappants d'un tel phnomne ont t constats en des circonstances
trs anormales. La Russie et l'Europe Centrale ont connu aprs la Guerre une crise
montaire ou fuite devant la monnaie au cours de laquelle on ne pouvait dcider per-
sonne conserver de la monnaie aucune condition ; si lev et si rapidement crois-
sant que ft le taux de l'intrt, il n'arrivait pas rattraper l'efficacit marginale du
capital (celle des stocks de biens liquides en particulier) sur laquelle agissait la prvi-
sion d'une baisse toujours plus grande de la valeur de la monnaie. Aux tats-Unis on
a constat pendant certaines priodes de l'anne 1932 une crise du genre oppos, i. e.
une crise financire ou crise de liquidation, au cours de laquelle on ne pouvait dcider
presque personne se dessaisir de ses avoirs liquides des conditions raisonnables.
4 Reste enfin l'obstacle, dj examin au Chapitre XI, section IV, p. 159, qui em-
pche le taux effectif de l'intrt de baisser au-dessous d'un certain chiffre ; cet
obstacle, qui peut s'avrer srieux une poque de taux d'intrt faibles, rside dans
les cots intermdiaires de la mise en contact de l'emprunteur et du dernier prteur et
dans la rmunration que le prteur exige en sus de l'intrt pur en considration du
risque, spcialement du risque moral. Lorsque le taux de l'intrt pur flchit, il ne
s'ensuit pas que les sommes alloues pour les frais et pour les risques flchissent de
pair avec lui. Le taux de l'intrt que l'emprunteur type est oblig de payer peut donc
dcliner plus lentement que le taux de l'intrt pur, et, dans l'tat actuel des mthodes
bancaires et de l'organisation financire, il peut tre impossible de l'amener au-des-
sous d'un certain minimum. Ce fait revt une importance particulire, lorsque le
risque moral est estim une valeur apprciable. Car, si le, risque provient de doutes
que le prteur conoit sur l'honntet de l'emprunteur, l'emprunteur qui n'a pas l'inten-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 56
tion d'tre malhonnte n'a aucun moyen de compenser le supplment indu de charge
qui pour lui en est la consquence. Ce fait a aussi de l'importance dans le cas des
prts court terme (des avances bancaires, par exemple), qui sont grevs de frais
relativement levs, une banque pouvant tre oblige de compter ses dbiteurs 1 1/2
ou 2 %, alors mme que le taux de l'intrt pur au profit du prteur est nul.
IV
Bien que ceci nous oblige anticiper sur une matire qui appartient plus pro-
prement au Chapitre XXI, peut-tre y aura-t-il avantage indiquer d'un mot cet
endroit le rapport qui existe entre le sujet prcdent et la Thorie Quantitative de la
Monnaie.
Dans une socit statique ou dans une socit o, pour toute autre raison, person-
ne n'a d'incertitude au sujet des taux d'intrt futurs, la Fonction de Liquidit L
2
ou
propension thsauriser (comme nous pouvons l'appeler) est toujours nulle en tat
d'quilibre. Ainsi, en tat d'quilibre, M
2
est nul et M est gal M
1
; toute variation
donne de M fait donc varier le taux de l'intrt autant qu'il est ncessaire pour que le
revenu atteigne un niveau o la variation de M
1
soit gale la variation donne de M.
Or, V tant la vitesse de transformation de la monnaie en revenu, telle qu'elle a t
dfinie plus haut, et R le revenu global, on a M
1
V = R. Par suite, s'il est possible de
mesurer la quantit Q et le prix P de la production courante, on a R = QP et partant
MV = QP, relation qui a beaucoup d'analogie avec la forme traditionnelle de la
Thorie Quantitative de la Monnaie
1
.
Un grave dfaut de la Thorie Quantitative lorsqu'on l'applique aux faits, c'est
qu'elle ne distingue pas dans les variations des prix celles qui proviennent des
variations de la production et celles qui proviennent des variations de l'unit de
salaire
2
. Peut-tre cette omission peut-elle s'expliquer par la double hypothse qu'il
n'y a jamais de propension thsauriser et qu'il y a toujours plein emploi. Dans ce cas
Q est constant et M
2
est nul ; il s'ensuit que, si on peut aussi considrer V comme
constant, l'unit de salaire et le niveau des prix sont l'un et l'autre directement propor-
tionnels la quantit de monnaie.
1
Bien entendu, si dans la dfinition choisie V tait gal non R/M
1
mais R/M, la Thorie
Quantitative constituerait une identit. Elle serait alors vrifie en toute circonstance, mais n'aurait
aucune porte.
2
Ce point fera l'objet de dveloppements supplmentaires au Chapitre XXI.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 57
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XVI
Observations diverses
sur la nature du capital
I
Retour la table des matires
Un acte d'pargne individuelle signifie - pour ainsi dire - une dcision de ne pas
dner aujourd'hui. Mais il n'implique pas ncessairement une dcision de commander
un dner ou une paire de chaussures une semaine ou une anne plus tard, ou de
consommer un article dtermin une date dtermine. Il produit donc un effet dpri-
mant sur l'industrie intresse la prparation du dner d'aujourd'hui sans stimuler
aucune des industries qui travaillent en vue d'un acte futur de consommation. Il ne
consiste pas dans la substitution d'une demande pour la consommation future une
demande pour la consommation prsente, mais seulement dans une diminution nette
de cette dernire demande. En outre la prvision d'une consommation future est si
largement fonde sur la connaissance d'une consommation prsente que toute rduc-
tion de celle-ci est de nature nuire la premire; l'acte d'pargne ne fait donc pas
seulement baisser le prix des biens de consommation indpendamment de l'efficacit
marginale du capital existant, mais il peut encore affaiblir effectivement cette effica-
cit marginale elle-mme. Dans ce cas il contracte la demande en vue de l'investis-
sement actuel aussi bien que la demande en vue de la consommation actuelle.
Si l'pargne ne consistait pas seulement s'abstenir d'une consommation prsente
mais encore et simultanment passer une commande en vue d'une consommation
future, le rsultat pourrait tre tout diffrent. Car J'espoir de tirer (in certain revenu de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 58
l'investissement serait alors accru et les ressources libres de la prparation d'une
consommation prsente pourraient tre affectes la prparation de la consommation
future. Les ressources ainsi libres ne seraient pourtant pas toutes, mme dans ce
cas, ncessairement remployes, car l'intervalle la fin duquel on souhaiterait
ajourner la consommation pourrait exiger une mthode de production d'une longueur
si incommode que son efficacit marginale serait trs infrieure au taux de l'intrt
courant ; alors l'effet favorable l'emploi produit par une commande en vue de la
consommation future ne se manifesterait pas sur-le-champ mais une date ultrieure,
et l'effet immdiat serait encore dfavorable l'emploi. En tout cas une dcision indi-
viduelle d'pargner n'implique pas en fait la passation d'une commande dfinie en vue
de la consommation future, mais uniquement la renonciation une commande cou-
rante. Puisque l'attente d'une consommation est la seule raison d'tre de l'emploi, il ne
devrait donc y avoir aucun paradoxe conclure que l'affaiblissement de la propension
consommer produit, toutes choses gales d'ailleurs, un effet dprimant sur l'emploi.
L'origine du mal, c'est que l'acte d'pargne n'implique pas le remplacement d'une
consommation courante par un surcrot dfini de consommation future dont la prpa-
ration exigerait autant d'activit conomique que celle de la consommation quiva-
lente la somme pargne, mais bien un dsir portant sur la richesse en tant que
telle, c'est--dire sur le pouvoir de consommer un article indtermin une date
indtermine. L'ide absurde, encore qu' peu prs universelle, qu'un acte d'pargne
individuelle est tout aussi favorable la demande effective qu'un acte de consom-
mation individuelle procde du sophisme suivant, lequel est beaucoup plus spcieux
que la conclusion qui en a t dduite : le dsir de possder plus de richesse, tant
trs peu de chose prs identique au dsir de possder plus de capitaux, doit, en
accroissant la demande de capitaux, fournir un aiguillon leur production ; par suite
l'pargne individuelle favorise l'investissement courant* dans la mesure mme o elle
diminue la consommation prsente.
C'est de ce sophisme qu'on a le plus de peine dsabuser l'opinion. Il vient de
l'ide que le possesseur de richesse dsire un capital en tant que tel, alors que l'objet
rel de son dsir c'est le rendement escompt de ce capital. Orle rendement escompt
repose entirement sur la prvision d'une demande effective future d'une certaine
marchandise, compte tenu des conditions futures de l'offre de la mme marchandise.
Par consquent, si un acte d'pargne n'est aucunement favorable au rendement es-
compt d'un capital, il ne contribue en rien stimuler l'investissement. En outre, pour
qu'un pargnant individuel, puisse atteindre son but, qui est d'acqurir de la richesse,
il n'est pas ncessaire qu'un capital nouveau soit cr en vue de le satisfaire. L'acte
d'pargne d'un individu, du fait qu'il est bilatral, comme nous l'avons indiqu, oblige
lui seul un autre individu transfrer au premier un certain article de richesse
ancien ou nouveau. Tout acte d'pargne a pour consquence invitable un transfert
forc de richesse celui qui pargne; et celui-ci peut son tour avoir souffrir de
l'pargne des autres. Ces transferts de richesse ne sont pas subordonns la cration
de richesse nouvelle ; vrai dire, ils peuvent, comme nous l'avons vu, lui tre gran-
dement contraires. La cration de richesse exige uniquement que le rendement
escompt de la richesse nouvelle dpasse le seuil fix Par le taux de l'intrt courant.
Le rendement escompt de l'investissement nouveau le moins productif n'est pas
accru par le fait que quelqu'un dsire accrotre sa richesse, puisqu'il dpend de la pr-
vision d'une demande portant une date dtermine sur un article dtermin.
On n'chappe pas non plus cette conclusion en disant que le dsir du possesseur
de richesse n'a pas pour objet un rendement escompt dtermin, mais le plus avan-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 59
tageux des rendements escompts qui lui sont offerts et que par suite un accroisse-
ment du dsir de possder de la richesse diminue le rendement escompt dont les pro-
ducteurs d'investissement nouveau doivent se contenter. Ce raisonnement nglige le
fait qu'on a toujours le choix entre la proprit de capitaux rels et la proprit de
monnaie ou de crances ; le rendement escompt dont les producteurs d'investisse-
ment nouveau doivent se contenter ne peut baisser au-dessous du seuil fix par le
taux de l'intrt courant. Et le taux de l'intrt courant dpend, nous l'avons vu, non
de l'intensit du dsir de possder de la richesse, mais de l'intensit du dsir de la
possder respectivement sous forme liquide et non liquide, jointe l'importance rela-
tive de l'offre de richesse sous l'une et l'autre forme. Si le lecteur prouve encore des
doutes, qu'il se demande pourquoi, si la quantit de monnaie ne varie pas, un acte
d'pargne nouveau diminuerait la, somme qu'au niveau existant de l'intrt on dsire
garder sous forme liquide.
Nous examinerons au chapitre suivant certaines difficults plus srieuses qui
peuvent se prsenter lorsqu'on essaye d'approfondir les pourquoi et les comment.
II
Ail lieu de dire du capital qu'il est productif, il vaut beaucoup mieux en dire qu'il
fournit au cours de son existence lin revenu suprieur son cot originel. Car la seule
raison pour laquelle on peut attendre d'un capital qu'il rende au cours de son existence
des services dont la valeur globale soit suprieure son prix d'offre initial, c'est qu'il
est rare ; et il reste rare parce que le taux d'intrt attach la monnaie permet
celle-ci le lui faire concurrence. A mesure que le capital est moins rare, l'excs de son
revenu sur son prix d'offre diminue, sans qu'il devienne pour cela moins productif -
au moins au sens physique du mot.
Nos prfrences vont par consquent la doctrine prclassique que c'est le travail
qui produit toute chose, avec l'aide de l'art comme on disait autrefois ou de la
technique comme on dit maintenant, avec l'aide des ressources naturelles, qui sont
libres ou greves d'une rente selon qu'elles sont rares ou abondantes, avec l'aide enfin
des rsultats du travail pass, qui ont eux aussi un prix variable suivant leur raret ou
leur abondance. Il est prfrable de considrer le travail, y compris bien entendu les
services personnels de l'entrepreneur et de ses assistants, comme le seul facteur de
production ; la technique, les ressources naturelles, l'quipement et la demande effec-
tive constituant le milieu dtermin o ce facteur opre. Ceci explique en partie pour-
quoi nous avons pu considrer que l'unit de travail tait, en dehors des units de
monnaie et de temps, la seule unit physique qui ft ncessaire dans notre systme
conomique.
Certains procds longs ou mdiats sont physiquement efficaces. Mais certains
procds courts le sont aussi. Les procds longs ne sont pas physiquement efficaces
par ce que longs. Certains d'entre eux, la plupart sans doute, seraient physiquement
trs inefficaces du fait des pertes et des dommages causs par le temps
1
. Si on
1
Cf. la note de Marshall sur Boehm-Bawerk, Principles, p. 583.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 60
dispose d'une force de travail donne, il y a une limite dfinie la quantit de travail
susceptible d'tre incorpore en des procds mdiats dont on ait avantage se servir.
En dehors de toute autre considration, il faut qu'il existe une proportion dtermine
entre la quantit de travail employe construire les machines et la quantit de travail
employe les utiliser. La quantit ultime de valeur obtenue n'augmente donc pas
indfiniment par rapport la quantit de travail employ, mesure que les procds
adopts deviennent de plus en plus mdiats, mme si leur rendement physique
continue crotre. Si le dsir d'ajourner la consommation tait assez fort pour crer
une situation o le plein emploi exigerait un flux d'investissement suffisant rendre
l'efficacit marginale du capital ngative, alors seulement un procd deviendrait
avantageux cause de sa longueur ; dans ce cas on adopterait des procds physi-
quement inefficaces condition qu'ils eussent une longueur suffisante pour que leur
inefficacit ft compense par le bnfice rsultant de l'ajournement de la consom-
mation. On se trouverait en fait dans un situation o les procds courts devraient
rester assez rares pour que leur efficacit physique compenst le dsavantage inhrent
la proximit de la date de livraison du produit. Une thorie correcte doit tre rver-
sible; elle doit pouvoir s'appliquer aussi bien lorsque le taux de l'intrt sur lequel
l'efficacit marginale du capital s'aligne est ngatif que lorsqu'il est positif ; la thorie
de la raret bauche ci-dessus est, croyons-nous, la seule qui possde cette proprit.
Il existe d'ailleurs toutes sortes de raisons pour que les divers genres de services
ou de facilits soient rares et par suite coteux, eu gard la quantit de travail qui y
est incorpore. Les procds malodorants, par exemple, doivent tre rmunrs un
taux relativement lev, car on ne trouverait sans cela personne pour les entreprendre.
Et il en va de mme des procds prilleux. Mais notre dessein n'est pas de faire une
thorie de la productivit relative des procds malodorants ou dangereux considrs
comme tels. En bref, les divers genres de travail ne sont pas tous accomplis en des
circonstances particulires galement agrables ; une situation d'quilibre exige que
les articles produits en des circonstances propres moins agrables (circonstances
caractrises par l'odeur, le risque, ou la dure) restent assez rares pour que leurs prix
s'lvent. Mais, si la dure devient une circonstance agrable, ce qui peut trs bien
tre le cas et l'est dj pour nombre d'individus, ce sont alors, nous l'avons dit, les
procds rapides qui doivent rester suffisamment rares.
La mesure optimum o l'on peut employer des procds mdiats tant donne, on
choisira bien entendu, parmi les procds mdiats, les plus efficaces qu'on puisse
trouver jusqu' ce que le total optimum soit atteint. Mais ce total optimum devrait lui-
mme tre tel que puisse tre satisfaite aux dates convenables la partie de la demande
des consommateurs dont l'ajournement est dsir. Autrement dit, dans les conditions
optima, la production devrait tre organise suivant les mthodes de fabrication les
plus efficaces compatibles avec les dates o on s'attend que la demande des consom-
mateurs devienne effective. Il ne sert rien de produire en vue de dates de livraison
diffrentes de celles-ci, mme si le changement des dates de livraison pouvait accro-
tre le montant des units physiques produites - sauf dans la mesure o, pour ainsi
parler, la perspective d'une chre plus abondante incite le consommateur avancer ou
retarder lheure du dner. Le consommateur tant instruit de tout le dtail des mets
qu'il peut obtenir en fixant le dner des heures diffrentes, si l'on prvoit qu'il se
dcidera pour 8 heures, c'est l'affaire du chef de prparer le meilleur dner qui puisse
tre servi 8 heures, sans qu'il importe de savoir si c'est 7 h. 30, 8 heures ou 8 h. 30
qui lui aurait le mieux convenu dans le cas o le temps ne ft pas entr en ligne de
compte d'une faon ou d'une autre et o sa seule tche et consist prparer le
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 61
meilleur dner qui se pt faire. Peut-tre certaines poques obtiendrait-on des repas
matriellement meilleurs en dnant plus tard qu'on ne le fait. Mais il se peut aussi qu'
d'autres poques on obtiendrait des repas meilleurs en dnant plus tt. Notre thorie,
nous l'avons dit, doit tre applicable aux deux contingences.
Si le taux de l'intrt tait nul, il existerait pour tout article donn entre l'poque
moyenne de sa fabrication et l'poque de sa consommation un intervalle optimum
pour lequel le cot du travail serait minimum - un procd de production plus court
tant techniquement moins efficace et un procd plus long tant lui aussi moins
efficace en raison de la dtrioration et des frais de magasinage. Si le taux de l'intrt
est suprieur zro, il intervient un nouvel lment de cot qui crot avec la longueur
du procd; l'intervalle optimum diminue et la fabrication courante en vue de la
livraison ventuelle de l'article doit tre rduite jusqu' ce que le prix escompt ait
assez mont pour couvrir l'augmentation du cot, augmentation provenant la fois
des charges d'intrt et de l'efficacit moindre de la mthode de production plus
courte. Si au contraire le taux de l'intrt tait infrieur zro (admettons que ce soit
techniquement possible), c'est l'inverse qui se produirait. Le montant escompt de la
demande des consommateurs tant donn, on se trouverait dans l'alternative, ou de
procder aujourd'hui la fabrication courante, ou de commencer la fabrication une
date ultrieure ; par suite la fabrication courante ne se justifierait que si le revenu
provenant de l'intrt ngatif tait suprieur l'conomie qu'un ajournement de la
production permettrait de raliser grce une efficacit technique plus grande ou
une variation escompte des prix. L'efficacit technique de la production de la grande
majorit des articles dcline fortement quand on commence leur fabrication une
poque prcdant de plus d'une trs courte priode la date escompte de leur consom-
mation. Mme si le taux de l'intrt est nul, la proportion de la demande escompte
des consommateurs laquelle il est avantageux de commencer pourvoir l'avance
est donc strictement limite ; et, lorsque le taux de l'intrt n'est pas nul, cette pro-
portion diminue mesure qu'il augmente.
III
Nous avons vu que, dans la longue priode, le capital reste ncessairement assez
rare pour que son efficacit marginale soit au moins gale au taux de l'intrt corres-
pondant la dure de son existence, tel qu'il est dtermin par les conditions psycho-
logiques et les facteurs de structure. Quelles sont les consquences de cet tat de
choses pour une communaut qui se trouve quipe au point que l'efficacit margina-
le du capital est nulle et deviendrait ngative sous l'effet d'un investissement addition-
nel, qui, d'autre part, possde un systme montaire o la monnaie garde sa valeur et
n'engendre que (les frais de garde et de conservation ngligeables de sorte que prati-
quement le taux de l'intrt ne peut tre ngatif, et qui enfin, lorsque le plein emploi
est ralis, est dispose pargner ?
Ces circonstances tant runies et une situation de plein emploi tant prise comme
point de dpart, les entrepreneurs feront ncessairement des pertes s'ils continuent
offrir de l'emploi sur une chelle utilisant plein le stock de capital existant. Par suite
le stock de capital et le volume de l'emploi diminueront ncessairement jusqu' ce
que la communaut se trouve assez pauvre pour que l'pargne globale soit nulle, c'est-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 62
-dire pour que l'pargne positive de certains individus ou groupes d'individus soit
compense par l'pargne ngative des autres. Dans une communaut telle que nous
l'avons suppose, la situation d'quilibre en rgime de laissez-faire sera donc une
situation o l'emploi sera assez faible et le niveau de vie assez misrable pour que les
pargnes soient nulles. Ou plutt il est probable qu'une oscillation cyclique se dessi-
nera autour de cette position d'quilibre. Car, s'il subsiste de l'incertitude au sujet de
l'avenir, l'efficacit marginale s'lvera occasionnellement au-dessus de zro, ce qui
entranera un essor des investissements, et la dpression conscutive pourra ramener
pour un temps le stock de capital au-dessous de la position d'quilibre qui, la lon-
gue, rendrait l'efficacit marginale nulle. Bien entendu le stock d'quilibre du capital
qui, les prvisions tant supposes exactes, aura une efficacit marginale juste nulle
sera infrieur au stock correspondant au plein emploi de la main-d'uvre disponible ;
car ce stock sera celui qui correspond la proportion de chmage ncessaire pour que
l'pargne soit nulle.
La seule autre position d'quilibre possible serait une situation o un stock de
capital assez important pour avoir une efficacit marginale nulle reprsenterait aussi
une quantit de richesse suffisante pour assouvir pleinement, mme en tat de plein
emploi, le dsir global du public de faire des rserves pour l'avenir, les circonstances
tant telles qu'aucun revenu ne puisse tre obtenu sous forme d'intrt. Toutefois ce
serait une concidence singulire que la propension pargner dans les conditions de
plein emploi se trouve prcisment satisfaite au moment o le stock de capital atteint
le montant qui rend son efficacit marginale nulle. Aussi bien, si cette contingence
favorable intervient, doit-elle normalement se produire non au moment prcis o le
taux d'intrt s'annule, mais une poque antrieure pendant qu'il dcline progressi-
vement.
Nous avons admis jusqu'ici qu'intervenait, sous forme d'une monnaie greve de
frais de conservation ngligeables, un facteur qui empchait le taux de l'intrt d'tre
ngatif. En fait, il existe des facteurs de structure et des facteurs psychologiques qui.
fixent au dclin possible du taux de l'intrt une limite bien suprieure zro. Deux
d'entre eux, qui ont dj t examins, sont d'une importance particulire ; les cots
de la mise en contact des emprunteurs et des prteurs et l'incertitude quant l'avenir
du taux de l'intrt fixent en effet une limite minimum qui, dans les circonstances
prsentes, n'est peut tre pas infrieure 2 ou 2 1/2 % long terme. Si ceci s'avre
exact, nous pourrions bientt connatre dans la ralit pratique les difficults qui
peuvent natre d'un stock croissant de capital lorsque les principes de laissez-faire ne
permettent pas au taux de l'intrt de baisser davantage. Au surplus, si le minimum
au-dessous duquel il est pratiquement impossible de faire baisser l'intrt est sensible-
ment suprieur zro, il y a d'autant moins de chance que le dsir global d'accumuler
de la richesse puisse tre assouvi avant que le taux d'intrt ait atteint ce minimum.
Au cours des annes d'aprs guerre aux tats-Unis et en Grande-Bretagne, la
richesse s'est accumule un rythme tel que la baisse de l'efficacit marginale de ca-
pital s'est trouve tre plus rapide que le dclin du taux de l'intrt compatible avec
l'tat des facteurs de structure et des facteurs psychologiques existants ; et l'histoire
de cette priode fournit des exemples pratiques de l'obstacle que la capitalisation peut
opposer dans un rgime principalement fond sur le principe du laissez-faire un
volume d'emploi satisfaisant et au niveau de vie qui les conditions techniques de la
production permettent d'tablir.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 63
De ce qui prcde il rsulte que, si deux communauts identiques disposent de la
mme technique mais de stocks de capital diffrents, la communaut la moins bien
quipe pourra jouir pendant un certain temps d'un niveau de vie plus lev que la
communaut la mieux quipe. Toutefois, lorsque la communaut la plus pauvre aura
rejoint la plus riche - comme cela doit normalement arriver - elles connatront toutes
deux le sort de Midas. Bien entendu cette conclusion pessimiste suppose que la
propension consommer et le flux d'investissement, au lieu d'tre judicieusement
gouverns en vue de l'intrt gnral, soient entirement abandonns aux influences
du laissez-faire.
Si - pour une raison quelconque - le dclin du taux de l'intrt ne peut tre aussi
rapide que la baisse de l'efficacit marginale du capital dtermine par une capitalisa-
tion correspondant au montant que la communaut dsire pargner en situation de
plein emploi, alors, mme une diversion du dsir de possder de la richesse vers des
biens qui, en fait, ne fournissent aucun produit conomique, contribue effectivement
accrotre la prosprit. Tant qu'il plat aux millionnaires de construire de vastes de-
meures pour se loger pendant leur vie et des pyramides pour abriter leurs dpouilles
aprs leur mort, ou que, regrettant leurs pchs, ils difient des cathdrales et dotent
des monastres ou des missions trangres, l'poque laquelle l'abondance du capital
s'oppose l'abondance de la production peut tre recule. En creusant des trous
dans le sol aux frais de l'pargne on accrot non seulement l'emploi mais encore le
revenu rel national en biens et services utiles. Mais il n'est pas raisonnable qu'une
communaut sense accepte de rester tributaire de semblables expdients, fortuits et
souvent inefficaces, ds lors qu'on connat les facteurs qui gouvernent la demande
effective.
IV
Supposons que l'on prenne des mesures pour que le taux d'intrt soit compatible
avec le flux d'investissement qui correspond au plein emploi. Supposons, en outre,
que l'action de l'tat entre en jeu comme lment compensateur pour ralentir le
grossissement du capital et empcher qu'il ne tende vers son point de saturation une
vitesse qui impose la gnration prsente une rduction excessive de son niveau de
vie.
Nous estimons que, dans ces hypothses, une communaut correctement gouver-
ne, quipe de ressources techniques modernes, et dont la population n'augmente
pas rapidement, serait capable en l'espace d'une seule gnration d'abaisser l'efficacit
marginale du capital un niveau d'quilibre voisin de zro ; ainsi se trouveraient
ralises les conditions qui caractrisent une conomie quasi stationnaire ; les chan-
gements et les progrs rsulteraient uniquement des modifications de la technique,
des gots, des institutions et du chiffre de la population ; les produits obtenus l'aide
du capital se vendraient un prix proportionn au travail et aux autres valeurs qui y
sont incorpores, suivant des principes identiques ceux qui gouvernent les prix des
biens de consommation o les charges de capital entrent dans une proportion
insignifiante.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 64
Si nous avons raison de croire qu'il est relativement facile de multiplier les biens
d capital jusqu' ce que leur efficacit marginale soit nulle, ce moyen constitue sans
doute la faon la plus raisonnable d'liminer graduellement la plupart des caractres
choquants du capitalisme. Un instant de rflexion montrera en effet les normes chan-
gements sociaux qu'entranerait la disparition progressive d'un taux de rendement
propre la richesse capitalise. Un homme serait encore libre d'conomiser le revenu
de son travail afin de le dpenser une date ultrieure. Mais sa richesse capitalise ne
s'accrotrait pas. Il se trouverait dans la situation du pre de famille de Pope, qui,
lorsqu'il se retira des affaires, emporta une caisse de guines dans sa villa de
Twickenham et s'en servit pour couvrir ses dpenses au fur et mesure de ses
besoins.
Malgr la disparition des rentiers, il y aurait encore place pour l'entreprise et pour
l'habilet dans l'estimation des rendements escompts susceptibles d'tre apprcis
diversement. Ce qui prcde, en effet, concerne essentiellement la taux de l'intrt pur
en dehors de toute prime de risque ou d'allocation analogue, et non le rendement brut
des capitaux y compris la prime de risque. Sauf si le taux de l'intrt tait maintenu
au-dessous de zro, les investissements judicieux dans les affaires individuelles d'un
rendement alatoire auraient encore un rendement positif. L'ensemble de ces inves-
tissements aurait lui aussi au cours d'une priode assez longue un rendement net
positif condition qu'il existe une certaine rpugnance courir des risques. Mais il se
pourrait ,qu'en des circonstances pareilles il y et un tel dsir de tirer du revenu des
investissements alatoires, que dans l'ensemble leur rendement net s'avrt ngatif.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 65
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XVII
Les proprits essentielles de l'intrt et
de la monnaie
I
Retour la table des matires
Le taux d'intrt de la monnaie semble donc jouer dans la limitation du volume de
l'emploi un rle particulier, puisqu'il fixe un seuil que l'efficacit marginale d'un type
de capital est oblige d'atteindre pour que ce capital puisse faire l'objet d'une pro-
duction nouvelle. Si l'on se demande pourquoi il en est ainsi, on est premire vue
fort embarrass. Il est donc naturel de chercher en quoi consiste la particularit qui
distingue la monnaie des autres richesses, si seule la monnaie possde un taux d'int-
rt, et enfin ce qui se passerait dans une conomie non montaire. Tant que nous
n'aurons pas rpondu ces questions le sens de notre thorie ne sera pas entirement
clair.
Le taux d'intrt de la monnaie, rappelons-le au lecteur, n'est rien d'autre que le
pourcentage d'excs d'une certaine somme de monnaie stipule livrable terme, par
exemple un an plus tard, sur ce que nous pouvons appeler le prix comptant ou
cash de ladite somme livrable terme. Pour toute catgorie de richesse de capital
il semble donc qu'il doive exister un facteur analogue au taux &intrt de la monnaie,
puisqu'il y a une quantit dtermine de bl par exemple, livrable un an plus tard, qui
a aujourd'hui, la mme valeur d'change que 100 quarters de bl livrables immdia-
tement. Si la premire quantit est 105 quarters nous pouvons dire que le taux
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 66
d'intrt du bl est 5 % l'an, et si elle est 95 quarters nous pouvons dire que ce taux
est - 5 % l'an. Pour toute espce de richesse nous avons ainsi un taux d'intrt mesur
au moyen de cette richesse elle-mme prise comme talon - un taux d'intrt du bl,
un taux d'intrt du cuivre, un taux d'intrt des maisons et mme un taux d'intrt
des aciries.
Pour une richesse telle que le bl, la diffrence entre les contrats terme et
comptant qui sont cots sur le march est lie par une relation dtermine au taux
d'intrt du bl; mais, puisque le contrat terme est cot en monnaie livrable
ultrieurement et non en bl livrable immdiatement, cette diffrence dpend aussi du
taux d'intrt de la monnaie. La relation exacte est la suivante :
Soit 100 les 100 quarters le prix du bl comptant, soit 107 les 100 quarters le
prix du contrat terme de bl livrable un an plus tard, et soit 5 % le taux d'intrt
de la monnaie; quel est le taux d'intrt du bl ? 100 comptant s'changent contre
105 terme, et 105 terme contre 105 / 107 x100 (ou 98) quarters livrables
terme. Or 100 comptant s'changent aussi contre 100 quarters de bl livrables
immdiatement. Ainsi 100 quarters de bl livrables immdiatement s'changent
contre 98 quarters livrables terme.
Il s'ensuit que le taux d'intrt du bl est - 2 % l'an
1
.
Il rsulte de ceci qu'il n'y a pas de raison pour que les taux d'intrt des diffrentes
richesses soient identiques - pour que le taux d'intrt du bl soit gal au taux d'intrt
du cuivre. Car les rapports entre les contrats comptant et terme tels qu'ils
sont cots sur le march varient notoirement d'une marchandise une autre. Ce fait,
nous le verrons, va nous fournir le fil conducteur que nous cherchons. Peut-tre est-
ce, en effet, le plus lev des taux d'intrt spcifiques, comme nous pouvons les
appeler, qui fixe la hauteur du seuil (parce que c'est le plus lev de ces taux que doit
atteindre l'efficacit marginale d'un type de capital pour qu'il fasse l'objet d'une
production nouvelle); et peut-tre y a-t-il des raisons pour que ce soit le taux d'intrt
de la monnaie qui soit souvent le plus lev (parce que, comme nous le verrons,
certaines forces qui contribuent rduire les taux d'intrt spcifiques des autres
richesses n'agissent pas dans le cas de la monnaie) ?
On peut ajouter que, tout comme il existe chaque moment des taux d'intrt
spcifiques diffrents suivant les marchandises, les taux d'intrt affrents deux
monnaies diffrentes, par exemple la Livre et au Dollar, ne sont mme pas identi-
ques; c'est un fait que les cambistes connaissent bien. Car ici encore l'cart entre les
contrats terme et comptant d'une monnaie trangre contre Livres varie g-
nralement d'une monnaie une autre.
Or, chacune des richesses prise comme talon nous offre autant de facilits que la
monnaie pour mesurer l'efficacit marginale du capital. Nous pouvons en effet pren-
dre notre choix une richesse quelconque, le bl par exemple, et calculer la valeur en
bl des rendements escompts de chaque type de capital ; le taux d'escompte qui rend
la valeur actuelle de cette srie d'annuits de bl gale au prix d'offre actuel en bl du
type de capital dont il s'agit nous donnera, exprime en bl, l'efficacit marginale de
ce capital. Si aucune variation n'est attendue dans la valeur relative de deux talons
1
Cette relation a t signale pour la premire fois par M. Sraffa, Economic Journal, mars 1932, p.
50.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 67
diffrents, l'efficacit marginale d'un type de capital sera la mme quel que soit celui
avec lequel on la mesurera, puisque le numrateur et le dnominateur de la fraction
qui l'exprime varieront dans la mme proportion lorsque l'talon changera. Mais, si
on s'attend, une variation de valeur d'un certain pourcentage d'un des deux talons
par rapport l'autre, l'efficacit marginale de tous les types de capitaux diffrera du
mme pourcentage selon qu'elle sera mesure avec l'un ou l'autre talon. Pour
illustrer cette observation, prenons le cas le plus simple o l'on pense que l'un des
deux talons, le bl, s'apprciera par rapport la monnaie une cadence rgulire de
a pour cent par an ; l'efficacit marginale d'un type de capital qui s'exprime en mon-
naie par x %, s'exprimera en bl par x - a %. Puisque les efficacits marginales des
divers types de capital varieront toutes d'un gal montant, il s'ensuit que l'ordre de
leurs grandeurs restera le mme quel que soit l'talon choisi.
S'il y avait une richesse composite que l'oit pt considrer comme reprsentative
au sens strict du mot, on pourrait estimer que le taux de l'intrt et l'efficacit margi-
nale du capital dtermins au moyen de cette richesse seraient, en un sens, le vri-
table Taux de l'intrt et la vritable Efficacit marginale du capital. Mais ceci
soulve, videmment, les mmes difficults que l'instauration d'un talon unique de
valeur.
Jusqu'ici cependant le taux d'intrt de la monnaie, loin de se singulariser, se trou-
ve exactement sur le mme pied que les autres taux d'intrt. En quoi consiste donc la
particularit dont il tire l'importance pratique prdominante qui lui a t reconnue
dans les chapitres prcdents ? Pourquoi les volumes de la production et de l'emploi
dpendent-ils plus troitement du taux d'intrt spcifique de la monnaie que du taux
d'intrt spcifique du bl ou du taux d'intrt spcifique des maisons ?
II
Examinons dans le cas des diffrents types de richesses ce que doivent tre
normalement pour une priode d'un an par. exemple les divers taux d'intrt spcifi-
ques. Puisque nous prenons tour tour les diffrentes richesses comme talon, il nous
faut dans cet esprit calculer les revenus affrents chaque type de richesse en prenant
cette richesse elle-mme comme talon de mesure.
Il y a trois attributs que les diffrents types de richesses possdent des degrs
divers :
1 Certaines richesses engendrent un rendement ou produit q mesur au moyen de
ces richesses elle-mmes, raison des facilits qu'elles procurent un procd de
production ou des services qu'elles rendent un consommateur.
2 La plupart des richesses, l'exception de la monnaie, sont sujettes des
dtriorations ou sont greves de frais du seul fait que le temps passe (en dehors de
toute variation de leurs valeurs relatives), qu'elles soient utilises ou non produire
un rendement ; autrement dit chacune de ces richesses possde un cot de conserva-
tion c mesur au moyen de cette richesse elle-mme. Pour notre objet actuel, il im-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 68
porte peu de savoir exactement o nous plaons la ligne de sparation entre les frais
que nous dduisons dans le calcul de q et ceux que nous incluons dans c, car c'est
seulement q - c qui nous intressera par la suite.
3 Enfin le pouvoir de disposer d'une richesse pendant un certain temps peut offrir
un degr de scurit ou de commodit virtuelle qui n'est pas gal pour des richesses
de nature diffrente, mme si ces richesses elles-mmes ont l'origine une valeur
gale. Ceci ne laisse, pour ainsi parler, aucune trace sous la forme d'une production
la fin de la priode considre ; c'est pourtant une chose pour laquelle les gens sont
disposs payer un prix- Nous appellerons prime de liquidit l d'une certaine richesse
la somme, mesure au moyen de cette richesse elle-mme, que les gens sont disposs
payer pour la commodit ou la scurit virtuelle procure par le pouvoir d'en
disposer (abstraction faite du rendement ou des frais de conservation qui lui sont
propres).
Il s'ensuit que le revenu total attendu de la proprit d'une richesse pendant une
certaine priode sera gale son rendement moins son cot de conservation plus sa
prime de liquidit, c'est--dire q - c + l. En d'autres termes, q - c + l sera le taux
d'intrt spcifique de chacune des richesses, q, c et l tant mesurs au moyen de cette
richesse elle-mme prise comme talon.
La caractristique d'un capital en service, qu'il s'agisse d'un capital instrumental
(par exemple une machine) ou d'un capital de consommation (par exemple une mai-
son) est d'avoir un rendement dpassant normalement son cot de conservation et une
prime de liquidit gnralement ngligeable ; la caractristique d'un stock de biens
liquides ou encore d'un excdent de capital instrumental ou de capital de consomma-
tion est d'tre grev d'un cot de conservation, exprim dans ce capital lui-mme,
qu'aucun rendement ne compense, la prime de liquidit, dans ce cas encore, tant
ngligeable ds que les stocks dpassent un volume modr, mais pouvant nanmoins
tre apprciable en des circonstances particulires ; la caractristique de la monnaie
enfin est d'avoir un rendement nul, un cot de conservation ngligeable, mais une
prime de liquidit substantielle. A vrai dire, des richesses diffrentes peuvent avoir
diffrents degrs de prime de liquidit l'une par rapport l'autre, et la monnaie peut
tre dans une certaine mesure greve de cots de conservation, constitus par exem-
ple par des frais de garde. Ce n'en est pas moins une diffrence essentielle entre la
monnaie et la totalit (ou la plupart) des autres richesses que dans le cas de la mon-
naie la prime de liquidit excde de beaucoup le cot de conservation, alors que dans
le cas des autres richesses le cot de conservation excde de beaucoup la prime de
liquidit. Afin d'illustrer ce qui prcde, supposons que dans le cas des maisons le
rendement soit q
1
et que le cot de conservation ainsi que la prime de liquidit soient
ngligeables ; que dans le cas du bl le cot de conservation soit c
2
et que le rende-
ment ainsi que la prime de liquidit soient ngligeables; que dans le cas de la mon-
naie la prime de liquidit soit l
3
et que le rendement ainsi que le cot de conservation
soient ngligeables. Ceci revient dire que q
1
est le taux d'intrt des maisons, - c
2
le
taux d'intrt du bl, et l
3
le taux d'intrt de la monnaie.
Pour dterminer quels sont entre les revenus attendus des diffrents types de
richesse les rapports compatibles avec l'quilibre, il faut encore connatre les varia-
tions attendues de leurs valeurs relatives au cours de l'anne. Prenons la monnaie
comme talon de mesure (pour notre but actuel il suffit d'une monnaie de compte et
nous pourrions aussi bien prendre le bl) et supposons que le pourcentage attendu
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 69
d'apprciation (ou de dprciation) soit a
1
pour les maisons et a
2
pour le bl. Nous
avons appel q
1
, - c
2
et l
3
, les taux d'intrt spcifique des maisons, du bl et de la
monnaie, mesures au moyen de ces richesses elles-mmes prises comme talon de
valeur ; autrement dit q
1
est le taux d'intrt des maisons mesur en maisons, - c
2
le
taux d'intrt du bl mesur en bl, et l
3
le taux d'intrt de la monnaie mesur en
monnaie. Il sera utile de mme d'appeler a
1
+ q
1
, a
2
- c
2
et l
2
les expressions de ces
quantits lorsqu'elles sont rapportes la monnaie comme talon de valeur, i. e.
respectivement le taux d'intrt montaire des maisons, le taux d'intrt montaire du
bl, et le taux d'intrt montaire de la monnaie. Grce cette notation il est ais de
voir que la demande des possesseurs de richesse s'orientera vers les maisons, le bl
ou la monnaie suivant que a
1
+ q
1
, a
2
- c
2
ou l
3
sera le plus lev. En tat d'quilibre,
le prix de demande des maisons et le prix de demande du bl exprims au moyen de
la monnaie seront donc tels qu'il n'y ait aucun avantage possder l'une des trois
richesses plutt que les autres ; autrement dit a
1
+ q
1
, a
2
- c
2
et l
3
. seront gaux. Le
choix de l'talon de valeur n'intervient pas dans cette conclusion, car l substitution
d'un talon l'autre fera subir tous les termes une mme variation, plus prcisment
une variation d'un montant gal au pourcentage attendu d'apprciation (ou de
dprciation) du nouvel talon par rapport l'ancien.
Or les richesses dont le prix normal de l'offre est moindre que le prix de la
demande feront l'objet d'une production nouvelle; et ces richesses seront celles qui
possdent une efficacit marginale suprieure (sur la base du prix normal de leur
offre) au taux de l'intrt (les deux quantits tant mesures au moyen du mme
talon de valeur, quel qu'il soit). A mesure que s'accrotra le stock des richesses qui
ont l'origine une efficacit marginale au moins gale au taux de l'intrt, leur
efficacit marginale tendra diminuer (pour les raisons suffisamment videntes que
nous avons dj donnes). Un moment viendra donc o il ne sera plus avantageux de
continuer les produire, moins que le taux de l'intrt ne baisse en mme temps.
Quand il n'y aura plus de richesse dont l'efficacit marginale soit au moins gale au
taux de l'intrt, la production nouvelle des biens de capital s'arrtera.
Supposons (c'est une simple hypothse que nous faisons ce stade du raisonne-
ment) qu'il y ait une certaine richesse (par exemple la monnaie) dont le taux d'intrt
soit fixe (ou dcline, mesure que sa production crot, plus lentement que le taux
d'intrt de toute autre richesse), comment la situation s'quilibrera-t-elle ? Puisque a
1
+ q
1
, a
2
- c
2
, et l
3
sont forcment gaux, et puisque par hypothse l
3
est fixe ou dcline
plus lentement que q
1
ou - C
2
, il s'ensuit que a
1
et a
2
tendront ncessairement crotre.
Autrement dit les prix nominaux actuels de toutes les richesses autres que la monnaie
tendront baisser par rapport aux prvisions des prix futurs. Par suite, si q
1
et - c
2
continuent dcliner, un moment viendra o il ne sera plus avantageux de produire
aucune richesse moins que l'on s'attende une hausse du cot de production futur
par rapport au cot actuel, d'une ampleur suffisante pour couvrir le cot de conser-
vation du stock produit entre le moment prsent et l'poque de la hausse de cot
attendue.
Il apparat maintenant que, lorsque nous avons dit prcdemment que le taux
d'intrt de la monnaie fixait une limite au volume de la production, ce n'tait pas
rigoureusement exact. Nous aurions d dire que c'est celui des taux d'intrt qui
dcline le plus lentement lorsque le stock des richesses en gnral s'accrot, qui peut
tenir en chec la production bnficiaire de toutes les, richesses autres que celle
laquelle il se rapporte - sauf dans le cas, ci-dessus mentionn, d'un rapport spcial
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 70
entre le cot de production actuel et l'estimation du cot de production futur. A me-
sure que la production crot, les taux d'intrt spcifiques s'abaissent des niveaux
auxquels les richesses tombent l'une aprs l'autre au-dessous du seuil de production
bnficiaire ; - jusqu' ce que finalement un ou plusieurs taux d'intrt spcifiques se
fixent un niveau suprieur l'efficacit marginale de toute richesse quelconque.
Si par monnaie nous entendons l'talon de valeur, il est clair que ce n'est pas
ncessairement du taux d'intrt de la monnaie que vient le mal. Il ne suffirait pas
pour chapper aux difficults (comme certains l'ont cru) de dcrter que le bl ou les
maisons remplaceront l'or et le sterling comme talon de valeur; car il apparat main-
tenant que l'existence d'une richesse quelconque continuera causer les mmes diffi-
cults, si le taux d'intrt de cette richesse n'est Pas susceptible de dcliner mesure
que sa production augmente. L'or, par exemple, pourra conserver une influence de
cette nature dans un pays qui lui aura substitu un talon de papier inconvertible.
III
Ainsi, en attribuant un rle particulirement important au taux d'intrt de la
monnaie, nous avons implicitement suppos que le genre de monnaie auquel nous
sommes accoutums prsente certaines caractristiques spciales raison desquelles
son taux d'intrt spcifique, exprim au moyen de la monnaie prise comme talon,
est moins susceptible de flchir mesure que sa production augmente, que le taux
d'intrt spcifique de toute autre richesse exprim au moyen de cette richesse elle-
mme. Cette supposition est-elle justifie ? La rflexion prouve, notre avis, qu'elle
l'est suffisamment par les particularits suivantes, qui caractrisent d'ordinaire la
monnaie telle que nous la connaissons. Dans la mesure o l'talon de valeur en usage
prsente ces particularits, il est lgitime de dire, sous une forme rsume, que c'est le
taux d'intrt de la monnaie qui est le taux d'intrt significatif.
1 La premire caractristique qui appuie la conclusion prcdente est la proprit
de la monnaie d'avoir, dans la longue comme dans la courte priode, une lasticit de
production gale zro ou au moins trs petite, sous rserve qu'on s'en tienne aux
seules possibilits de l'entreprise prive en tant qu'elle se distingue de l'autorit
montaire ; l'lasticit de production
1
d'une richesse signifiant ici l'accroissement
relatif de la quantit de travail affecte sa production qui rsulte d'un accroissement
de la quantit de travail contre laquelle une unit de cette richesse s'change. La mon-
naie, autrement dit, ne peut pas tre produite aisment ; le travail ne peut au gr des
entrepreneurs tre affect sa production en quantits croissantes mesure que son
prix s'lve en units de salaire. Dans le cas d'une circulation inconvertible dirige
cette condition est rigoureusement remplie. Mais dans le cas d'une circulation fonde
sur l'talon-or, elle l'est aussi d'une manire approximative, en ce sens que le maxi-
mum de la quantit de travail supplmentaire susceptible d'tre employ de la sorte
est proportionnellement trs petit, sauf, bien entendu, dans les pays o l'industrie
principale consiste en extraction d'or.
1
Voir Chapitre XX.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 71
Dans le cas des richesses dont la production tmoigne d'une certaine lasticit, si
nous avons suppos que leurs taux d'intrt spcifiques dclinaient sous l'effet d'un
accroissement de leur production, c'est parce que nous supposions qu'un tel accrois-
sement tait de nature . augmenter les stocks de ces richesses. Or dans le cas de la
monnaie l'offre est fixe (nous ne considrons pas, pour le moment, les effets d'une
rduction de l'unit de salaire ou d'un accroissement dlibr de l'offre provoqu par
l'autorit montaire). Le fait caractristique que la monnaie ne puisse tre aisment
cre par le travail nous fait donc entrevoir tout de suite que son taux d'intrt spci-
fique sera relativement rfractaire la baisse. Si la monnaie pouvait au contraire tre
produite comme une crale ou fabrique comme une automobile, les dpressions
seraient vites ou attnues. Lorsque les prix en monnaie des autres richesses
tendraient baisser, une plus grande quantit de travail serait dtourne vers la pro-
duction de la monnaie. Ce phnomne a t maintes fois constat dans les pays de
mines d'or ; mais la quantit maximum de travail susceptible d'tre divertie de cette
faon est presque ngligeable, compare au travail total disponible dans le monde
entier.
2 Il est vident toutefois que la condition prcdente se trouve remplie non seule-
ment par la monnaie mais encore par toutes les richesses dont la production est
compltement inlastique et qui apparaissent de ce fait comme de purs facteurs de
rentes. Une deuxime condition est donc ncessaire pour distinguer la monnaie des
autres richesses de cette sorte.
Le deuxime caractre spcifique de la monnaie est qu'elle a une lasticit de
substitution gale ou presque gale zro ; ce qui signifie que, lorsque sa valeur
d'change s'lve, il n'apparat aucune tendance lui substituer un autre facteur, si ce
n'est peut-tre dans une mesure infime quand les mtaux prcieux servent aussi
l'industrie ou aux arts. Ceci dcoule de la particularit qu'offre la monnaie d'avoir une
utilit qui procde uniquement de sa valeur d'change, de sorte que l'une et l'autre
s'lvent ou s'abaissent en mme temps. Lorsque sa valeur d'change s'lve, il n'y a
donc pas, comme dans le cas des autres facteurs de rente, de motif ni de tendance
lui substituer un autre facteur.
Ainsi, non seulement il est impossible d'employer plus de travail produire de la
monnaie lorsque son prix s'lve par rapport aux salaires, mais encore la monnaie
constitue un rceptacle sans fond pour le pouvoir d'achat lorsque sa demande s'ac-
crot, car il n'existe pas, comme dans le cas des autres facteurs de rente, une valeur
au-dessus de laquelle cette demande est dvie vers l'autres objets.
La seule limite un tel tat de choses vient de l'incertitude que la hausse de valeur
de la monnaie fait parfois natre quant sa propre dure ; dans ce cas les pourcenta-
ges attendus d'apprciation a
1
et a
2
montent, ce qui quivaut une hausse du taux de
l'intrt spcifique montaire des richesses autres que la monnaie et ce qui par
consquent stimule la production de ces richesses.
3 Il nous faut examiner en troisime lieu si ces conclusions ne sont pas infirmes
par le fait suivant. Lors mme qu'il est impossible d'accrotre la quantit de monnaie
en affectant plus de travail sa production, on n'a pas le droit de supposer que son
offre effective soit rigoureusement immuable. Une telle hypothse soulverait notam-
ment deux objections. En premier lieu toute baisse de l'unit de salaire, en librant
une certaine quantit de monnaie de ses autres fonctions, lui permet de servir la
satisfaction du motif de liquidit. En outre, lorsque la valeur nominale des autres
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 72
richesses diminue, le stock montaire forme une proportion plus leve de la richesse
totale de la communaut.
Il est incontestable qu'en thorie pure cette double action pourrait amener un fl-
chissement adquat du taux d'intrt de la monnaie. Mais, pour plusieurs raisons qui,
runies, sont d'une force dcisive, il est trs probable que dans une conomie du type
habituel une baisse suffisante du taux de l'intrt s'avrera souvent impossible :
a) Il faut tenir compte, en premier lieu, des effets qu'une baisse de l'unit de
salaire produit sur les efficacits marginales, exprimes en monnaie, des richesses
autres que la monnaie ; - car c'est la diffrence entre les efficacits marginales de ces
richesses et le taux d'intrt de la monnaie qui nous intresse. Si la baisse de l'unit de
salaire engendre une prvision de hausse ultrieure, le rsultat sera pleinement favo-
rable. Si, au contraire, cette baisse engendre une prvision de nouvelle baisse, l'effet
produit sur l'efficacit marginale du capital pourra contrebalancer le flchissement du
taux de l'intrt
1
.
b) Le fait que les salaires ont tendance tre rigides par rapport la monnaie, leur
valeur nominale tant plus stable que leur valeur relle, contribue limiter les possi-
bilits de baisse de l'unit de salaire exprime en monnaie. Au surplus, s'il n'en tait
pas ainsi, la situation au lieu d'tre meilleure serait peut-tre pire ; car, si les salaires
nominaux devaient baisser facilement, ceci contribuerait souvent faire natre une
prvision de nouvelle baisse qui aurait des consquences dfavorables pour l'effica-
cit marginale du capital. Ajoutons que, si les. salaires taient stipuls en quelque
autre marchandise, en bl par exemple, ils ne continueraient sans doute pas tre
rigides. C'est cause des autres caractristiques de la monnaie, spcialement de celles
qui lui donnent sa liquidit, que les salaires lorsqu'ils sont stipuls en monnaie tmoi-
gnent d'une certaine rigidit
2
.
c) Nous en arrivons, en troisime lieu, la considration essentielle en cette
matire, c'est--dire aux proprits de la monnaie qui satisfont la prfrence pour la
liquidit. Car, en certaines circonstances comme il s'en produit souvent, c'est cause
de ces proprits que le taux de l'intrt reste insensible, spcialement au-dessous
d'un certain chiffre
3
, une augmentation mme importante de la quantit de monnaie
par rapport aux autres formes de richesses. En d'autres termes, la baisse qu'un ac-
croissement de la quantit de monnaie dtermine dans le revenu que la monnaie
procure raison de sa liquidit devient au-dessous d'un certain niveau insignifiante
par rapport la baisse du revenu des autres richesses qui accompagne un accroisse-
ment comparable de leur quantit.
A cet gard la modicit (ou l'insignifiance) des frais de conservation de la mon-
naie joue un rle essentiel. Car, si ces frais taient apprciables, ils compenseraient
l'effet des prvisions portant sur la valeur de la monnaie aux poques futures. La
facilit avec laquelle le public accrot son stock de monnaie sous l'effet d'un stimulant
relativement faible vient de ce que les avantages (rels ou supposs) de la liquidit
1
C'est une question qui sera examine plus fond au Chapitre XIX.
2
Si les salaires (et les contrats) taient stipuls en bl, il se pourrait que le bl jouisse d'une certaine
prime de liquidit propre la monnaie. Nous reviendrons sur cette question dans la Section 4 de ce
Chapitre.
3
Voir chapitre XIII, 2 ci-dessus.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 73
n'ont aucun contrepoids qui les balance sous forme de frais de conservation chiffrant
rapidement quand le temps passe. Un stock limit d'une richesse autre que la monnaie
peut tre commode pour ceux qui emploient cette richesse. Mais, alors mme qu'un
stock plus important aurait quelque attrait en tant que rserve de richesse possdant
une valeur stable, cet avantage serait compens par le cot de conservation de ladite
richesse, c'est--dire par les frais de magasinage, la dperdition, etc. Par suite, il est
impossible de conserver un stock dpassant un certain montant sans essuyer une
perte.
Dans le cas de la monnaie, ainsi que nous l'avons vu, il n'en est pas de mme; et
ce pour nombre de raisons, plus prcisment pour les raisons qui dans l'esprit du
public rendent la monnaie liquide au plus haut degr. Par suite, lorsque certains
rformateurs ont vu un remde dans la cration de frais artificiels grevant la conser-
vation de la monnaie et lorsque cette fin ils ont propos, entre autres moyens,
d'exiger que les instruments de paiement ayant cours lgal fussent priodiquement
frapps d'une estampille d'un cot dtermin pour conserver leur qualit de monnaie,
ces rformateurs taient dans la bonne voie et la valeur pratique de leurs propositions
mrite considration.
Ainsi l'importance significative du taux d'intrt de la monnaie s'explique par le
fait que la monnaie runit trois proprits : d'abord, sous l'influence du motif de liqui-
dit, son taux d'intrt peut tre plus ou moins insensible aux variations du rapport
entre sa quantit et celle, mesure en monnaie, des autres formes de richesses; ensui-
te, son lasticit de production est (ou peut tre) nulle (ou ngligeable) ; enfin son
lasticit de substitution est galement (ou peut tre) nulle (ou ngligeable). La
premire proprit signifie que la demande peut se concentrer sur la monnaie, la
seconde que dans ce cas le travail ne peut tre employ produire un supplment de
monnaie, et la troisime que cette situation, quelle que soit sa gravit, ne peut tre
pallie par l'intervention d'un autre facteur capable, s'il est assez bon march, de
rendre les mmes services que la monnaie. Le seul remde possible, en dehors des
variations de l'efficacit marginale du capital, rside (aussi longtemps que la prf-
rence pour la liquidit reste constante) dans l'accroissement de la quantit de
monnaie, ou - ce qui revient exactement au mme - dans la hausse de la valeur de la
monnaie, qui permet une quantit donne de numraire de fournir des services
montaires accrus.
Un accroissement du taux d'intrt de la monnaie ralentit donc la production des
richesses dans toutes les branches o elle est lastique sans stimuler celle de la mon-
naie qui, par hypothse, est parfaitement inlastique. Le taux d'intrt de la monnaie,
en dterminant le niveau des taux d'intrt de toutes les autres richesses, contrarie
l'investissement dans la production de ces richesses sans pouvoir stimuler l'investisse-
ment dans la production de la monnaie, qui, par hypothse, ne peut tre produite. Au
surplus, tant donn l'lasticit de la demande d'argent liquide en change de
crances, un faible changement dans les conditions qui gouvernent cette demande ne
saurait faire beaucoup varier le taux d'intrt de la monnaie et, d'autre part, tant
donn l'inlasticit de la production de la monnaie, il n'est pas possible. non plus (en
dehors de l'intervention officielle) que les forces naturelles fassent baisser le taux
d'intrt par leur effet sur l'offre. Dans le cas d'une richesse ordinaire, la demande de
stocks liquides tant peu lastique, une faible variation de cette demande se traduit
par une hausse ou une baisse immdiate du taux d'intrt spcifique, cependant que
l'lasticit de l'offre empche la prime de la livraison immdiate sur la livraison
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 74
diffre d'atteindre une proportion excessive. Si les autres richesses taient abandon-
nes elles-mmes, les forces naturelles , i. e. les forces ordinaires du march,
tendraient donc faire baisser leurs taux d'intrt spcifiques jusqu' ce que l'appa-
rition du plein emploi ait tendu ces richesses dans leur ensemble l'inlasticit de
l'offre que nous avons suppos tre une des proprits normales de la monnaie. Ainsi,
en l'absence de monnaie et en l'absence - cette hypothse, bien entendu, est ncessaire
elle aussi - d'une richesse runissant les proprits que nous avons suppos caractris-
tiques de la monnaie, les taux d'intrt ne s'quilibreraient que lorsque le plein emploi
serait ralis.
Ceci revient dire que le chmage se dveloppe parce qu'on demande la lune. Les
hommes ne peuvent tre employs lorsque l'objet de leur dsir (i. e. la monnaie) est
une chose qu'il n'est pas possible de produire et dont la demande ne peut tre facile-
ment endigue. Le seul remde consiste persuader le public que lune et fromage
sont pratiquement la mme chose et faire fonctionner une fabrique de fromage (i. e.
une banque centrale) sous le contrle de l'autorit
1
.
Il est intressant de noter que c'est la proprit laquelle la doctrine traditionnelle
attribue la vocation spciale de l'or servir d'talon de valeur, c'est--dire l'inlasticit
de son offre, qui se trouve tre prcisment la source du mal.
Notre conclusion peut tre nonce sous sa forme la plus gnrale (la propension
consommer tant considre comme donne) dans les termes suivants: Le montant
de l'investissement ne peut plus tre accru lorsque le plus lev de tous les taux
d'intrt spcifiques des richesses dont on dispose, exprims dans un certain talon,
est gal la plus leve des efficacits marginales de toutes les richesses, exprime
dans le mme talon.
Dans une situation de plein emploi, cette condition est ncessairement remplie.
Mais elle peut l'tre galement avant que le plein emploi soit atteint, s'il existe une
richesse dont les lasticits de production et de substitution sont nulles ou relative-
ment petites
2
, et dont le taux d'intrt dcline, mesure que sa production augmente,
plus lentement que les efficacits marginales des biens de capital exprimes au
moyen de cette richesse.
IV
Nous avons dmontr ci-dessus qu'il ne suffit pas qu'une richesse soit l'talon de
valeur pour que le taux d'intrt de cette richesse soit le taux significatif. Il est int-
ressant cependant d'examiner dans quelle mesure les proprits de la monnaie telle
que nous la connaissons, qui confrent son taux d'intrt une importance signifi-
cative, sont lies au fait qu'elle est l'talon dans lequel les crances et les salaires sont
habituellement stipuls. La question doit tre considre sous deux aspects.
En premier lieu, le fait que les contrats sont stipuls en monnaie et qu'en monnaie
les salaires sont gnralement assez stables, contribue incontestablement dans une
1
En Angleterre on raconte aux enfants que la lune est un. fromage (N. du T.).
2
Il n'est pas ncessaire que les lasticits soient tout fait nulles.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 75
large mesure donner la monnaie une prime de liquidit aussi leve. Il y a un
avantage manifeste dtenir des richesses dans le mme talon que celui dans lequel
pourront choir des engagements futurs et dans lesquels on pense que le cot de la vie
restera relativement stable. Il se pourrait en mme temps qu'on n'accordt qu'une
confiance limite la prvision d'une stabilit relative du cot de la production par
rapport . la monnaie, si l'talon de valeur tait une richesse dont la production offrit
une grande lasticit. Au surplus la modicit des frais de conservation de la monnaie
contribue tout autant que l'importance de sa prime de liquidit donner son taux
d'intrt une importance significative. Ce qui importe, en effet, c'est la diffrence
entre la prime de liquidit et les frais de conservation ; or toutes les richesses, hormis
quelques-unes comme l'or, l'argent et les billets de banque, sont grevs de frais de
conservation au moins aussi levs que la prime habituelle de liquidit affrente
l'talon dans lequel les contrats et les salaires sont stipuls ; et il est peu probable que
le taux d'intrt du bl par exemple s'lverait au-dessus de zro mme si la prime de
liquidit actuellement attache la Livre par exemple tait transfre cette mar-
chandise. Il n'en reste pas moins que l'emploi de la monnaie dans la stipulation des
contrats et des salaires, s'il rehausse considrablement l'importance du taux d'intrt
de la monnaie, ne pourrait lui seul suffire confrer ce taux les proprits qui lui
ont t reconnues.
Le second point considrer est plus dlicat. Si normalement on s'attend que la
valeur de la production reste plus stable lorsqu'elle est exprime en monnaie qu'en
toute autre richesse, ce n'est pas, bien entendu, parce que les salaires sont stipuls en
monnaie, mais parce que, par rapport la monnaie, ils ont relativement rigides.
Qu'arriverait-il donc si l'on s'attendait qu'ils fussent plus rigides (i. e. plus stables) par
rapport une ou plusieurs richesses autres que la monnaie que par rapport la
monnaie elle-mme ? Une telle expectative exigerait, non seulement que l'on s'atten-
dt une fixit relative du cot, exprim en units de salaire, de la richesse en
question, quelque forte ou faible que ft sa production et dans la courte et dans la
longue priode, mais encore que toute quantit de cette richesse excdant sa demande
normale au prix de revient pt tre stocke sans frais, i. e. que sa prime de liquidit
ft suprieure ses frais de conservation (autrement, en effet, puisqu'aucun profit ne
saurait tre attendu d'une hausse des prix, la conservation d'un stock entranerait
ncessairement une perte). Si l'on pouvait trouver une richesse remplissant cette dou-
ble condition, rien n'empcherait qu'elle devint une rivale de la monnaie. Il n'est donc
pas logiquement impossible qu'il y ait une richesse par rapport laquelle la valeur de
la production paraisse devoir tre plus stable que par rapport la monnaie. Mais il ne
semble pas probable qu'il existe une telle richesse.
Notre conclusion sera donc que la richesse dans laquelle la mesure des salaires
parat devoir tre la plus rigide ne peut pas ne pas tre une richesse qui possde une
lasticit de production minimum et un excs des frais de conservation sur la prime
de liquidit minimum. En d'autres termes, l'expectative d'une rigidit relative des
salaires exprims en monnaie est un corollaire du fait que l'excs de la prime de
liquidit sur les frais de conservation est plus considrable dans le cas de la monnaie
que dans le cas de toute autre richesse.
Il apparat ainsi que les diverses proprits qui concourent donner au taux
d'intrt de la monnaie une importance significative exercent les unes sur les autres
des actions cumulatives. Le fait que les lasticits de production et de substitution de
la monnaie sont faibles et que ses frais de conservation sont modiques tend crer
l'expectative d'une certaine stabilit des salaires exprims en monnaie ; cette
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 76
expectative son tour hausse la prime de liquidit de la monnaie et empche qu'il
s'tablisse entre le taux d'intrt de la monnaie let les efficacits marginales des autres
richesses une corrlation occasionnelle qui, si elle pouvait exister, dpouillerait le
taux d'intrt de la monnaie de son venin.
Le Professeur Pigou (entre autres) avait coutume de supposer qu'il existait une
prsomption que les salaires rels fussent plus stables que les salaires nominaux. Ceci
ne pourrait tre vrai que s'il y avait une prsomption en faveur de la stabilit du
niveau de l'emploi. Et encore faudrait-il compter avec la difficult inhrente au fait
que les biens de consommation ouvrire sont grevs de frais de conservation levs.
En vrit, si on tentait d'accrotre la stabilit des salaires rels en stipulant la rmu-
nration du travail en biens de consommation ouvrire, il ne pourrait en rsulter
qu'une violente oscillation des prix exprims en monnaie. Car toute variation, mme
faible, de la propension consommer et de l'incitation investir ferait osciller
brutalement les prix exprims en monnaie entre zro et l'infini. Les salaires nominaux
doivent tre plus stables que les salaires rels pour que le systme ait une stabilit
intrinsque.
Attribuer aux salaires rels une stabilit relative c'est commettre non seulement
une erreur de fait et d'observation mais encore une erreur de logique, si on suppose
que le systme considr est stable, i. e. que des variations limites de la propension
consommer et de, l'incitation investir ne produisent pas d'effets violents sur les prix.
V
A titre de commentaire aux dveloppements (lui prcdent peut-tre sera-t-il utile
d'insister sur le fait, dj signal plus haut, que la liquidit autant que les frais de
conservation sont affaires de degr, et que c'est uniquement dans l'importance de la
premire par rapport aux derniers que rside la particularit de la monnaie .
Considrons, par exemple, une conomie o il n'y ait aucune richesse qui possde
une prime de liquidit toujours suprieure ses frais de conservation ; une telle dfi-
nition est la meilleure que nous puissions donner d'une conomie dite non mon-
taire . En d'autres termes, il n'y aura dans cette conomie pas autre chose que des
biens de consommation particuliers, ainsi que des quipements particuliers, plus ou
moins diffrencis suivant la nature des biens de consommation qu'en un espace de
temps plus ou moins long ils produisent ou aident produire ; tous ces biens, la
diffrence de l'argent liquide, se dtriorant ou tant grevs de frais en cas de
stockage, concurrence d'une valeur suprieure toute prime de liquidit qui pourrait
leur tre attache.
Dans une telle conomie les quipements se distingueront les uns des autres : a)
par la diversit des biens de consommation dont ils peuvent faciliter la production ; b)
par la stabilit de valeur-de leur production (en ce sens que la valeur du pain est plus
stable dans le temps que la valeur des nouveauts en vogue) ; et c) par la rapidit avec
laquelle la richesse qui leur est incorpore peut devenir liquide , i. e. par la rapidit
avec laquelle ils crent des biens dont le produit de la vente peut tre rincorpor, si
on le dsire, sous une forme entirement diffrente.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 77
Les possesseurs de richesse mettront alors en balance le manque de liquidit ,
au sens indiqu ci-dessus, des diffrents quipements en tant que moyens de conser-
ver la richesse et l'valuation actuarielle la plus parfaite possible de leurs rendements
escompts, compte tenu du risque. On observera que, si la prime de liquidit ressem-
ble en partie la prime de risque, elle en diffre aussi en partie ; la diffrence
correspond celle qui existe entre les valuations des probabilits les plus parfaites
qu'on puisse faire et la confiance avec la quelle on les fait
1
. Lorsque nous traitions
dans les chapitres prcdents de l'valuation du rendement escompt,nous n'avons pas
examin en dtail comment cette valuation tait faite; et, pour ne pas compliquer le
raisonnement, nous nous sommes abstenus de faire la distinction entre les diffrences
portant sur la liquidit et les diffrences portant sur le risque proprement dit. Il est
vident toutefois que, dans le calcul du taux d'intrt spcifique, nous devons faire
tat des unes et des autres.
Il est clair qu'il n'existe pas d'talon absolu de liquidit mais qu'il y a seulement
une chelle de liquidit, une prime variable dont il doit tre tenu compte, en sus du
rendement tir de l'usage de chaque forme de richesse et de ses frais de conservation,
lorsqu'on value l'attrait comparatif qu'offre sa possession. C'est une notion assez
vague que celle des lments qui contribuent la liquidit ; elle change de temps
en temps et dpend des coutumes sociales et des institutions. Cependant, il existe
dans l'esprit des possesseurs de richesse un ordre de prfrence bien dfini dans
lequel ils expriment tout moment leur sentiment touchant la liquidit et nous
n'avons pas besoin d'autre chose pour analyser le fonctionnement du systme cono-
mique.
Peut-tre, en certaines circonstances au cours de l'histoire, la possession de la terre
a-t-elle t caractrise par l'existence dans l'esprit des possesseurs de richesse d'une
prime de liquidit leve; et, puisque la terre partage avec la monnaie la proprit
d'avoir, en principe, des lasticits de production et de substitution trs faibles
2
, il est
concevable qu'il y ait eu dans l'histoire des cas o le dsir de possder de la terre ait
jou dans le maintien du taux de l'intrt un niveau trop lev le mme rle que
rcemment le dsir de possder de la monnaie. Il est difficile de mesurer cette influ-
ence dans le pass faute d'un prix, exprim en terre, de la terre livrable terme, qui
soit en tous points comparable au taux de l'intrt d'une crance stipule en monnaie.
Toutefois un facteur qui, certaines poques, a jou un rle trs analogue, nous est
fourni par les taux levs de l'intrt hypothcaire
3
. Les taux d'intrt levs sur les
hypothques grevant la terre, taux qui dpassaient souvent le rendement net probable
de sa culture, ont t l'un des aspects familiers de maintes conomies agricoles. Les
lois sur l'usure taient surtout diriges contre les servitudes de cette sorte; et juste
titre, car, dans les organisations sociales antrieures, alors que les obligations long
1
Voir la note du chapitre XII, section II.
2
L'attribut de liquidit ne saurait exister en l'absence de ces deux proprits, car, si l'offre d'une
richesse peut tre aisment accrue ou bien si le dsir dont elle est l'objet peut en tre facilement
dtourn par une variation de son prix comparatif, il est peu vraisemblable que cette richesse
jouisse de l'attribut de liquidit dans l'esprit des possesseurs de richesse. La monnaie elle-
mme lie tarde pas perdre cet attribut lorsque on s'attend de fortes variations (le son offre.
3
A la vrit, les hypothques et les intrts qui y sont attachs sont stipuls en monnaie. Mais le fait
que le dbiteur a la facult de se librer en cdant la terre et qu'il est mme oblig de le faire s'il ne
peut se procurer de l'argent la demande du crancier a parfois rapproch le prt hypothcaire
d'ou contrat portant cession future d'une terre contre remise immdiate. L'on a vu des ventes (le
terres faites aux exploitants en change d'engagements hypothcaires souscrits par eux, qui en fait
ressemblent beaucoup une transaction de cette nature.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 78
terme au sens-moderne du mot n'existaient pas encore, il est bien possible qu'en
raison de leurs taux levs les prts hypothcaires aient fait concurrence aux inves-
tissements dans la production d'quipements nouveaux et que, par suite, l'lvation de
leurs taux ait ralenti le dveloppement de la richesse conscutif ces investissements,
comme l'a fait rcemment l'lvation de l'intrt des crances long terme.
Qu'aprs plusieurs millnaires d'une pargne individuelle ininterrompue le monde
ait accumul si peu de biens de capital, il ne faut pas l'expliquer notre avis par la
tendance de l'espce humaine l'imprvoyance, ni mme parles destructions causes
par la guerre, mais bien par l'importance des primes de liquidit attaches autrefois
la possession de la terre et aujourd'hui celle de la monnaie. Notre opinion diffre en
cela de la doctrine ancienne telle que Marshall l'a exprime. avec un dogmatisme rare
dans ses Principles of Economics, p. 581.
Chacun sait que l'accumulation de la richesse est tenue en chec et que le taux
de l'intrt est maintenu aussi lev par la prfrence que la grande masse de l'huma-
nit donne aux satisfactions immdiates sur les satisfactions diffres, ou, en d'autres
termes, par sa rpugnance attendre .
VI
Dans notre Treatise on Money, nous avons dfini le sens que nous voulions
attribuer au taux d'intrt unique que nous appelions le taux naturel de l'intrt. Ce
taux devait tre celui qui, dans la terminologie du Treatise, maintiendrait l'galit
entre le montant de l'pargne courante (suivant la dfinition alors adopte) et celui de
l'investissement courant. Nous pensions ainsi dvelopper et clarifier la notion de
taux naturel de l'intrt de Wicksell, qui tait, selon lui, le taux propre maintenir
la stabilit d'un certain niveau de prix, niveau dont, au demeurant, la dfinition n'tait
pas d'une clart parfaite.
Or nous mconnaissions le fait que, d'aprs cette dfinition, dans toute socit il y
a pour chaque volume thorique de l'emploi un taux naturel de l'intrt diffrent. Et
de mme chaque valeur de l'intrt correspond un volume de l'emploi tel que cette
valeur soit le taux naturel , en ce sens qu'avec cette valeur de l'intrt et ce volume
de l'emploi le systme se trouve en quilibre. C'tait donc une erreur de parler du
Taux naturel de l'intrt ou de faire croire que la dfinition ci-dessus n'admettait
qu'une seule valeur de l'intrt quel que soit le volume de l'emploi. Nous n'avions pas
compris alors qu'en certaines circonstances le systme pouvait tre en quilibre au-
dessous du plein emploi.
Nous ne sommes plus d'avis que le concept d'un taux naturel de l'intrt, qui,
prcdemment, nous semblait une ide des plus intressantes, puisse apporter notre
analyse une contribution vraiment utile ou importante. Ce taux de l'intrt est simple-
ment celui qui maintient le statu quo et, en gnral, nous n'avons pas un intrt pr-
dominant au maintien du statu quo en tant que tel.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 79
S'il existe un taux d'intrt de cette nature, qui soit seul de son espce et signifi-
catif, ce taux ne peut tre que celui que nous appellerions le taux neutre de l'intrt
1
,
i. e. le taux naturel de l'intrt au sens indiqu ci-dessus qui, les autres paramtres du
systme tant donns, est compatible avec le plein emploi. Peut-tre d'ailleurs serait-
il prfrable de le dsigner sous le nom de taux optimum ?
On pourrait donner du taux neutre de l'intrt une dfinition plus rigoureuse en
disant qu'il est le taux d'quilibre qui prvaut lorsque la production et l'emploi sont
tels que l'lasticit de l'emploi dans son ensemble soit gale zro
2
.
Ce qui prcde nous fournit, une fois encore, la rponse la question de savoir
quelle hypothse il faut admettre implicitement pour que la thorie classique du taux
de l'intrt ait un sens. Cette thorie suppose ou bien que le taux rel de l'intrt est
toujours gal au taux neutre tel que nous venons de le dfinir ou encore que le taux
rel de l'intrt est toujours gal au taux qui maintient l'emploi un certain niveau
constant spcifi. Si la thorie traditionnelle est ainsi comprise, ses conclusions
pratiques n'appellent de notre part que des rserves faibles ou nulles. Elle suppose
que l'autorit bancaire ou les forces naturelles amnent le taux de l'intrt du march
remplir l'une ou l'autre des conditions indiques ci-dessus; et elle recherche les lois
qui gouvernent, dans cette hypothse, l'utilisation et la rmunration des ressources
productives de la communaut. Une semblable restriction tant admise, le volume de
la production ne dpend plus que du niveau suppos constant de l'emploi, joint la
technique et l'quipement existants ; et l'on se trouve install l'abri dans un monde
Ricardien.
1
Cette dfinition ne correspond aucune des diverses dfinitions de la monnaie neutre donnes par
des auteurs modernes, encore qu'elle ait peut-tre un certain rapport avec l'objet qu'ils ont eu en
vue.
2
Cf. Chapitre XX.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 80
Livre IV : Lincitation investir
Chapitre XVIII
Nouvel expos de la thorie gnrale
de l'emploi
I
Retour la table des matires
Nous sommes maintenant en mesure d'assembler les fils de notre raisonnement.
Tout d'abord il pourra tre utile d'indiquer quels lments du systme conomique
nous prenons habituellement comme donnes, quelles sont les variables indpendan-
tes de notre systme, et quelles sont le-, variables dpendantes.
Nous prenons comme donnes la capacit et la quantit actuelles des forces de
travail dont on dispose, le volume et la qualit actuels de l'quipement qu'on possde,
la technique existante, le degr de la concurrence, les gots et les habitudes des con-
sommateurs, la dsutilit des divers volumes de travail et celle des activits de con-
trle et d'organisation. Nous prenons aussi comme donne la structure sociale. en tant
qu'elle comprend les forces, autres que les variables numres ci-dessous, qui gou-
vernent la rpartition du revenu national. Ceci ne signifie pas que nous supposions
ces facteurs constants, mais simplement que pour le moment nous nous abstenons
d'analyser ou mme de prendre en considration les consquences de leurs variations.
Nos variables indpendantes sont, en premire analyse, la propension consom-
mer, la courbe de l'efficacit marginale du capital et le taux de l'intrt, ces, variables
pouvant elles-mmes, comme nous l'avons dj vu, tre dcomposes en plusieurs
lments.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 81
Nos variables dpendantes sont le volume de l'emploi et le revenu national (ou
dividende national) mesur en units de salaires.
Les facteurs que nous avons pris comme donnes influent sur nos variables ind-
pendantes, mais ne les dterminent pas compltement. Par exemple, la courbe de
l'efficacit marginale du capital dpend en partie du volume actuel de l'quipement,
lequel est un. des facteurs donns, mais en partie aussi de l'tat de la prvision long
terme, qui ne peut tre dduit des facteurs donns. Il existe, en revanche, d'autres
lments que les facteurs donns dterminent si compltement que ces lments dri-
vs peuvent tre traits comme s'ils taient eux-mmes donns. Les facteurs donns
permettent par exemple de savoir quel montant de revenu national mesur en units
de salaires correspond un volume quelconque de l'emploi; ainsi, lorsqu'on prend
l'armature conomique comme donne, le revenu national est gouvern par le volume
de l'emploi, i. e. par la quantit d'effort consacre pendant la priode courante la
production, en de sens que chaque montant de l'un se trouve associ un seul
montant de l'autre
1
. Des facteurs donns nous pouvons encore dduire la forme des
courbes de l'offre globale, qui pour les diffrents types de produits rendent compte
des conditions physiques de l'offre, c'est--dire du volume de l'emploi exig par la
production qui correspond chaque montant de la demande? effective mesure en
units de salaire. Les facteurs donns fournissent enfin la fonction de l'offre de travail
(ou d'effort) ; ils indiquent notamment quel point la fonction de l'emploi
2
relative
la main-d'uvre dans son ensemble cesse d'tre lastique.
La courbe de l'efficacit marginale du capital dpend en partie des facteurs donns
et en partie du rendement escompt des diverses sortes de capitaux. Quant au taux de
l'intrt, il dpend en partie de l'tat de la prfrence pour la liquidit (i. e. de la fonc-
tion de la liquidit) et en partie de la quantit de monnaie mesure en units de salai-
re. Nous pouvons donc en de nombreux cas considrer comme variables- indpen-
dantes lmentaires : 1 les trois facteurs psychologiques fondamentaux : la propen-
sion psychologique consommer, l'attitude psychologique touchant la liquidit, et
l'estimation psychologique du rendement futur des capitaux ; 2 l'unit de salaire telle
qu'elle est dtermine par les conventions conclues entre les employeurs et les
employs ; 3 la quantit de monnaie telle qu'elle est dtermine par l'action de la
Banque Centrale. Ainsi ces variables dterminent le revenu (ou dividende) national et
la quantit d'emploi, lorsqu'on, prend comme donnes les facteurs indiqus au dbut
du chapitre. Mais elles sont encore susceptibles d'tre subdivises et ne constituent
pas nos lments indpendants ultimes ou, pour ainsi parler, atomiques.
Sans doute la rpartition des dterminants du systme conomique entre le groupe
des facteurs donns et le groupe des variables indpendantes est-elle, d'un point de
vue absolu, compltement arbitraire. Elle doit tre faite l'aide des seules donnes de
l'exprience, de manire correspondre d'un ct aux facteurs dont les variations
paraissent tre assez lentes et importer assez peu pour n'avoir sur la variable tudie
qu'une influence court terme limite et comparativement ngligeable, et de l'autre
aux facteurs dont les variations s'avrent dans la pratique exercer sur la variable
tudie une influence dominante. Notre objet actuel est de dcouvrir ce qui, dans un
1
Nous laissons de ct pour le moment certaines difficults qui apparaissent lorsque pour les
valeurs de l'emploi considrer les fonctions de l'emploi ont des courbures diffrentes suivant les
produits. Voir ci-dessous, Chapitre XX.
2
Dfinie ci-dessous au Chapitre XX.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 82
systme conomique donn, dtermine tout moment le revenu national et (ce qui
revient presque au mme) le volume de l'emploi ; c'est--dire, dans une matire aussi
complexe que l'conomie, o il serait vain d'esprer faire des gnralisations en tout
point exactes, les facteurs qui contribuent principalement dterminer la variable
tudie. Quant notre tche finale, elle pourrait tre de choisir, dans le genre de
systme o nous vivons rellement, les variables dont l'autorit centrale peut assurer
bon escient le contrle ou la manuvre.
II
Efforons-nous maintenant de rsumer la thse des chapitres antrieurs, en pre-
nant les facteurs dans l'ordre inverse de celui dans lequel ils ont t introduits.
Il existe une force qui pousse accrotre le flux de l'investissement nouveau
jusqu' ce que la hausse du prix d'offre de chaque type de capital soit suffisante, eu
gard son rendement escompt, pour faire tomber l'efficacit marginale du capital
en gnral au voisinage du taux de l'intrt. Ceci signifie que les conditions physiques
de l'offre dans les industries qui produisent les biens de capital, l'tat de la prvision
long terme, l'attitude psychologique touchant la liquidit, et la quantit de monnaie
(calcule de prfrence en units de salaire) dterminent conjointement le flux d'in-
vestissement nouveau.
Mais une augmentation (ou une diminution) du flux d'investissement s'accom-
pagne ncessairement d'une augmentation (ou d'une diminution) du flux de consom-
mation, car l'tat d'esprit du public est en gnral tel qu'il ne consent largir (ou
rtrcir) l'cart entre son revenu et sa consommation que si son revenu est lui-mme
accru (ou diminu). Ceci signifie que les variations du flux de consommation sont, en
gnral, de mme sens (mais de grandeur moindre) que les variations du flux de reve-
nu. La relation entre un accroissement donn de la consommation et l'accroissement
de l'pargne auquel il est associ est dfinie par la propension marginale consom-
mer. Le rapport, ainsi dtermin, entre un accroissement de l'investissement et l'ac-
croissement correspondant du revenu global, mesurs tous deux en units de salaire,
est donn par le multiplicateur d'investissement.
Enfin, si nous supposons (en premire approximation) que le multiplicateur d'em-
ploi est gal au multiplicateur d'investissement, nous pouvons, en appliquant le
multiplicateur l'augmentation (ou la diminution) que les facteurs prcdemment
indiqus dterminent dans le flux d'investissement, en dduire l'augmentation ou la
diminution de l'emploi.
Or une augmentation (ou une diminution) de l'emploi est de nature lever (ou
abaisser) la courbe de la prfrence pour la liquidit ; il existe trois raisons pour
qu'une telle augmentation accroisse la demande de monnaie ; d'abord parce que la va-
leur de la production crot quand l'emploi augmente, mme si l'unit de salaire et les
prix (exprims en units de salaire) ne changent pas, ensuite parce que l'unit de
salaire elle-mme tend monter lorsque l'emploi augmente, enfin parce que l'aug-
mentation du volume de la production s'accompagne d'une hausse des prix (exprims
en units de salaire) due l'accroissement des cots pendant la courte priode.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 83
La situation d'quilibre sera donc affecte par ces rpercussions; et par d'autres
aussi. Au demeurant, il n'est pas un seul des facteurs prcdents qui ne soit sujet
varier, parfois dans une large mesure, sans qu'on en soit bien prvenu. De l l'extrme
complexit du cours rel des vnements. Nanmoins, tels paraissent tre les facteurs
qu'il est utile et commode d'isoler. Lorsque on examine un problme concret suivant
le schme qui prcde, il est plus facile d'en venir bout; et l'intuition pratique (qui
peut embrasser un ensemble de faits plus dtaill qu'une tude fonde sur des prin-
cipes gnraux) s'exerce sur une matire moins rbarbative.
III
Ce qui prcde est un rsum de la Thorie Gnrale. Mais les phnomnes rels
du systme conomique empruntent aussi leur physionomie certaines proprits
spciales de la propension consommer, de la courbe de l'efficacit marginale du
capital et du taux de l'intrt, au sujet desquelles il est lgitime de gnraliser les.
donnes de l'exprience, mais qui n'ont pas un caractre de ncessit logique.
En particulier, c'est une des proprits essentielles du systme conomique o
nous vivons de ne pas tre violemment instable, tout en tant sujet en ce qui concerne
la production et l'emploi des fluctuations svres. A la vrit, ce systme parat apte
rester pendant un temps considrable dans un tat d'activit chroniquement infrieur
la normale, sans qu'il y ait de tendance marque la reprise ou l'effondrement
complet. En outre il apparat clairement que le plein emploi ou mme une situation
voisine du plein emploi est rare autant qu'phmre. Les fluctuations peuvent s'amor-
cer brusquement, mais elles semblent s'amortir avant d'avoir pris une ampleur extr-
me; et notre sort normal consiste en une situation intermdiaire qui n'est ni dses-
pre ni satisfaisante. C'est sur le fait que les fluctuations tendent s'amortir avant
d'avoir atteint des limites extrmes et qu'elles tendent finalement s'inverser, qu'on a
fond la thorie des cycles conomiques de phase rgulire. La situation est la mme
en ce qui concerne les prix ; lorsqu'ils sont soumis une action perturbatrice nou-
velle, ils semblent aptes trouver un niveau o ils peuvent demeurer pour un temps
relativement stables.
Or, puisque ces faits d'exprience ne procdent pas d'une ncessit logique, il faut
admettre qu'ils peuvent tre expliqus par les tendances psychologiques et par les
circonstances du monde moderne. Il sera donc utile, d'abord d'examiner quelles sont
les tendances psychologiques thoriquement propres rendre un systme stable, et
ensuite de vrifier s'il est plausible, eu gard notre connaissance gnrale de la na-
ture actuelle de l'homme, d'attribuer ces tendances au monde dans lequel nous vivons.
D'aprs l'analyse antrieure, les conditions de stabilit propres expliquer les
rsultats observs sont les suivantes :
1 Lorsque dans une communaut donne la production augmente (ou diminue)
parce qu'on augmente (ou diminue) l'emploi dans les industries d'investissement, la
propension marginale consommer doit tre telle que le multiplicateur unissant les
deux augmentations (ou les deux diminutions) soit suprieur l'unit, mais non trs
lev.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 84
2 Lorsque une variation se produit dans le rendement escompt du capital ou
dans le taux de l'intrt, la courbe de l'efficacit marginale du capital doit tre telle
que la variation du flux d'investissement ne soit pas trs. disproportionne cette
variation ; autrement dit les variations modres du rendement escompt du capital
ou du taux de l'intrt ne doivent pas tre associes des variations trs considrables
du flux d'investissement.
3 Lorsque le volume de l'emploi varie, les salaires nominaux doivent varier dans
le mme sens, mais sans qu'il y ait une grande disproportion entre les deux varia-
tions ; autrement dit les variations modres de l'emploi ne doivent pas tre associes
des variations trs considrables des salaires nominaux. C'est la stabilit des prix
plus que celle de l'emploi qui est subordonne cette condition.
4 Nous pourrions ajouter une quatrime condition, qui concerne moins la sta-
bilit du systme que la tendance des fluctuations s'inverser en temps voulu, c'est
qu'un flux d'investissement suprieur (ou infrieur) celui qui existait prcdemment
doit commencer provoquer dans l'efficacit marginale du capital des ractions dfa-
vorables (ou favorables) ds qu'il se prolonge au del d'un laps de temps qui, mesur
en annes, n'est pas trs considrable.
1 En ce qui concerne notre premire- condition de stabilit, savoir: que le mul-
tiplicateur tout en tant suprieur l'unit ne soit pas trs lev, il est trs plausible,
qu'elle corresponde un caractre psychologique de la nature humaine. Lorsque le
revenu rel augmente, outre que les besoins non satisfaits se font moins pressants, la
marge au-dessus du niveau de vie tabli s'accrot; et, lorsque le revenu rel diminue,
le contraire se produit. Il est donc naturel - au moins si on considre la moyenne de la
communaut - qu'en cas d'augmentation de l'emploi la consommation courante crois-
se, mais seulement d'une quantit infrieure l'augmentation totale du revenu rel, et
qu'en cas de diminution de l'emploi elle dcroisse, mais seulement d'une quantit
infrieure la diminution totale du revenu rel. Au surplus il est probable que ce qui
est vrai de la moyenne des individus est galement vrai des gouvernements, particu-
lirement une poque o le dveloppement progressif du chmage oblige gnrale-
ment l'tat fournir des secours prlevs sur fonds d'emprunts.
Mais, qu'a priori cette loi psychologique paraisse ou non plausible au lecteur, il
est certain que, si elle n'tait pas vrifie, la ralit serait tout autre. Car, dans ce cas,
une augmentation de l'investissement, si faible ft-elle, dclencherait une srie d'ac-
croissements cumulatifs de la demande effective jusqu' ce qu'on ait atteint une
situation de plein emploi ; et une diminution de l'investissement dclencherait une
srie de flchissements cumulatifs de la demande effective jusqu' ce que personne ne
soit plus employ. Or l'exprience montre que nous sommes en gnral dans une
situation intermdiaire. Il n'est pas impossible qu'il y ait une zone o en fait l'insta-
bilit rgne. Mais, dans ce cas, il s'agit probablement d'une zone troite hors de
laquelle, d'un ct et de l'autre, notre loi psychologique est incontestablement vri-
fie. Il est d'ailleurs vident que le multiplicateur, tout en dpassant l'unit, n'est pas
en des circonstances normales extrmement lev; car, s'il l'tait, une variation
donne du flux d'investissement entranerait une variation considrable (limite seule-
ment par la plnitude ou la nullit de l'emploi) du flux de consommation.
2 Tandis que la premire condition nous garantit qu'une variation modre du
flux d'investissement n'entranera pas une variation d'une ampleur indfinie dans la
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 85
demande des biens de consommation, la seconde condition nous garantit qu'une
variation modre du rendement escompt des capitaux ou du taux de l'intrt n'en-
tranera pas une variation d'une ampleur indfinie du flux d'investissement. Les
choses paraissent bien se passer ainsi dans la ralit, eu gard l'accroissement du
cot unitaire de la production qui, galit d'quipement, accompagne une forte
augmentation de son volume. A la vrit, si on part d'une situation dans laquelle les
ressources aptes la production des biens de capital sont largement surabondantes, il
peut y avoir dans une certaine limite une instabilit considrable ; mais il n'en sera
plus de mme ds que l'excdent de ressources aura t en grande partie utilis. Au
surplus cette seconde condition fixe une limite l'instabilit qui rsulte des variations
rapides du rendement escompt des capitaux, comme il s'en produit en cas de brus-
ques changements d'opinion dans les milieux d'affaires ou la suite de dcouvertes
faisant poque . Mais une telle limite est sans doute plus effective dans le sens de la
hausse que dans celui de la baisse.
3 La troisime condition concorde avec ce que nous savons de la nature humaine.
Bien que la lutte dont les salaires nominaux sont l'objet ait pour but essentiel, ainsi
que nous l'avons signal plus haut, de maintenir le salaire relatif un niveau lev, il
semble que, lorsque l'emploi augmente, elle doive se faire plus intense dans chaque
cas individuel. D'abord l'ouvrier bnficie dans les ngociations d'une position plus
favorable. Ensuite l'utilit marginale moindre de son salaire et sa marge financire
accrue le rendent plus enclin assumer des risques. Toutefois ces influences, comme
les prcdentes, restent limites ; la main-duvre ne demande pas un salaire nominal
beaucoup plus lev lorsque l'emploi augmente; et, plutt que de consentir une
rduction trs sensible des salaires, elle prfre endurer un certain degr de chmage.
Mais ici encore, que cette conclusion soit plausible ou non a priori, l'exprience
prouve qu'il existe dans la ralit une loi psychologique de cette nature. Car, si la
concurrence entre les travailleurs sans emploi conduisait toujours une forte rduc-
tion des salaires nominaux, le niveau des prix tmoignerait d'une violente instabilit.
Bien plus, il pourrait n'y avoir aucune position d'quilibre stable, sauf dans les condi-
tions compatibles avec le plein emploi ; car il pourrait se faire que l'unit de salaire
dt baisser sans arrt jusqu' ce que l'abondance de la monnaie compte en units de
salaires suffise, par son action sur le taux de l'intrt, rtablir un niveau de plein
emploi. En aucun autre point il ne pourrait y avoir d'quilibre durable
1
.
4 Notre quatrime condition, qui concerne l'alternance des dpressions et des
reprises plus que la stabilit du systme, est simplement fonde sur la prsomption
que les biens de capitaux datent d'poques diverses, qu'ils s'usent avec le temps, et
qu'ils ne durent pas tous trs longtemps; si le flux d'investissement tombe au-dessous
d'un certain minimum, il suffit donc d'un certain laps de temps pour dterminer dans
l'efficacit marginale du capital une hausse assez forte pour rtablir le flux d'investis-
sement au-dessus de ce minimum (hors le cas de grandes fluctuations dans les autres
facteurs). Et bien entendu, si l'investissement crot, il suffit de mme d'un certain laps
de temps pour dterminer dans l'efficacit marginale du capital une baisse assez forte
pour provoquer une nouvelle dpression, moins que des variations compensatrices
ne se produisent dans les autres facteurs.
Pour cette raison les reprises et les dpressions, mme de l'importance de celles
qui peuvent se produire dans les limites tablies par les autres conditions de stabilit,
1
Les effets des variations de l'unit de salaire seront examins en dtail au Chapitre XIX.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 86
sont de nature, si elles persistent pendant un laps de temps suffisant et ne sont pas
contraries par des variations dans les autres facteurs, provoquer un mouvement de
sens oppose, jusqu' ce que des forces analogues aux premires inversent de nouveau
le mouvement.
Ces quatre conditions prises conjointement suffisent expliquer les traits mar-
quants de l'conomie que nous connaissons, c'est--dire le fait que, sans que les
fluctuations de l'emploi et des prix prennent une ampleur extrme, elle oscille autour
d'une situation intermdiaire sensiblement infrieure au plein emploi et sensiblement
suprieure l'emploi minimum au-dessous duquel l'existence serait compromise.
Mais, si certaines tendances naturelles , c'est--dire certaines tendances qui
paraissent devoir persister dfaut de mesures expressment destines les corriger,
dterminent ainsi une situation moyenne, nous ne devons pas en conclure que cette
situation soit pour autant fonde sur des lois ncessaires. La libre prdominance des
conditions qui prcdent est un fait d'observation caractristique du monde tel qu'il
est et a t, mais non un principe ncessaire qu'il n'est pas en notre pouvoir de
modifier.
FIN DU LIVRE IV.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 87
Livre V
Salaires nominaux et prix
Retour la table des matires
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 88
Livre V : Salaires nominaux et prix
Chapitre XIX
Variations des salaires nominaux
I
Retour la table des matires
Il et t prfrable que les effets des variations dans les salaires nominaux
pussent tre examins plus tt, car la thorie classique a coutume de fonder sur une
prtendue fluidit des salaires nominaux l'aptitude suppose du systme conomique
s'ajuster de lui-mme, et lorsque lesdits salaires nominaux sont rigides, d'imputer
cette rigidit le dfaut- d'ajustement.
Mais il n'tait pas possible de faire une tude complte de cette question avant
d'avoir dvelopp notre propre thorie. Car les consquences d'une variation des
salaires nominaux Sont complexes. En certaines circonstances l'abaissement de ces
salaires peut parfaitement fournir un aiguillon la production, ainsi que la thorie
classique le suppose. La distinction entre cette thorie et la ntre rside essentielle-
ment en une diffrence d'analyse ; elle ne pouvait tre mise en lumire avant que le
lecteur ft familiaris avec notre propre mthode.
L'explication gnralement admise est, si nous la comprenons bien, des plus sim-
ples. Elle ne fait intervenir aucune rpercussion indirecte, semblable celles que nous
examinerons par la suite. Le raisonnement est simplement le suivant: toutes choses
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 89
gales d'ailleurs, une rduction des salaires nominaux, en diminuant le prix des
produits finis, stimule la demande et par suite dveloppe la production et l'emploi jus-
qu' ce que la rduction des salaires nominaux consentie par la main-d'uvre soit
exactement compense parla baisse du rendement marginal du travail qui accom-
pagne ncessairement l'accroissement de la production (lorsque l'quipement ne
change pas).
Dans sa forme la plus Sommaire un tel raisonnement revient supposer que la
rduction des Salaires nominaux laisse la courbe de la demande inchange. Peut-tre
certains conomistes soutiendraient-ils qu'il n'y a pas de raison pour que la demande
varie, puisque son montant global dpend de la quantit de monnaie multiplie par la
vitesse de transformation de la monnaie en revenu et qu'il n'y a pas de raison vidente
pour qu'une rduction des, salaires nominaux diminue soit la quantit de monnaie soit
sa vitesse de transformation en revenu. Ces conomistes pourraient mme soutenir
que la baisse des salaires grossit ncessairement les profits. Mais plus habituellement,
croyons-nous, on reconnat qu'une baisse des salaires nominaux, en rduisant le pou-
voir d'achat de certains travailleurs, peut avoir quelque effet sur la demande globale ;
en revanche on soutient que la demande relle des autres facteurs de production, dont
les revenus nominaux n'ont pas t rduits, se trouve stimule par la baisse des prix et
que trs probablement, du fait de l'accroissement de l'emploi, la demande globale des
travailleurs eux-mmes est accrue, sauf si la demande de main-duvre dans sa rac-
tion aux variations des salaires nominaux tmoigne d'une lasticit infrieure un.
Lorsque le nouvel quilibre est tabli, il y a donc plus d'emploi qu'il n'y en aurait eu
autrement, hors peut tre quelque rare cas limite qui ne se rencontre pas dans la
ralit.
C'est ce type d'analyse que la ntre s'oppose essentiellement, ou plutt l'ana-
lyse qu'on devine derrire des considrations comme celles qui prcdent ; car, si
nous croyons avoir bien rendu l'esprit dans lequel parlent et crivent maints cono-
mistes, il n'en reste -pas moins que l'analyse sur laquelle ils se fondent a t rarement
dcrite en dtail.
Il apparat cependant qu'on a t probablement amen cette faon de penser de
la manire suivante: Dans chaque industrie existe une courbe de la demande du pro-
duit reliant aux prix exigs les volumes qui peuvent tre vendus ; il existe aussi une
sri de courbes de l'offre indiquant les prix qui seront exigs pour la vente des diff-
rents volumes sur chaque base de cot ; la combinaison de ces courbes permet d'en
obtenir une nouvelle qui, supposer que les autres cots restent constants ou tout au
moins qu'ils varient uniquement sous l'effet des changements de volume de la pro-
duction, constitue la courbe de la demande de main-duvre dans l'industrie consi-
dre et relie le volume de l'emploi aux diffrents niveaux des salaires. La forme de
cette courbe en chacun de ses points fournit l'lasticit de la demande de main-
duvre. On transfre alors cette conception, sans y apporter de changement notable,
l'ensemble de l'industrie, et on suppose par analogie qu'il existe dans l'industrie tout
entire une courbe de la demande de main-d'uvre unissant le volume de l'emploi
aux diffrents niveaux des salaires. Que l'on raisonne sur -les salaires nominaux ou
sur les salaires rels, on estime que cela ne fait pas une grande diffrence. Si on rai-
sonne sur les salaires nominaux, on doit videmment faire les corrections correspon-
dant aux variations de valeur de la monnaie; mais l'orientation gnrale du raisonne-
ment ne s'en trouve pas modifie, car les prix ne varient certainement pas dans une
proportion aussi forte que les salaires nominaux.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 90
Si tel est bien le principe du raisonnement (et sinon nous ignorons quel il peut
tre), l'argumentation est certainement fallacieuse. Car, pour tracer la courbe de la
demande dans une industrie particulire, on est oblig d'adopter certaines hypothses
fixes quant la forme des courbes de l'offre et de la demande dans les autres indus-
tries et quant au montant de la demande effective globale. Il n'est donc pas lgitime
de transfrer le raisonnement l'industrie dans son ensemble moins d'y transfrer
aussi l'hypothse de la fixit de la demande effective globale. Or cette hypothse
rduit l'argumentation une ptition de principe. Personne en effet ne songerait nier
que, lorsque la demande effective reste constante, une rduction des salaires nomi-
naux s'accompagne d'une augmentation de l'emploi ; mais la question qui se pose est
prcisment de savoir si les salaires nominaux rduits se trouveront ou non associs
une demande effective globale qui, mesure en monnaie, sera gale la demande
antrieure ou qui, au moins, n'aura pas subi une rduction pleinement proportionnelle
celle des salaires nominaux (i. e. qui, mesure en units de salaire, sera plus ou
moins suprieure la demande initiale). Mais, s'il est interdit la Thorie Classique
d'tendre par analogie l'industrie dans son ensemble ses conclusions relatives une
industrie particulire, elle est tout fait incapable d'indiquer l'effet qu'une rduction
des salaires nominaux produit sur l'emploi, car elle n'a aucune mthode d'analyse qui
lui permette de rsoudre le problme. La Theory of Unemployment du professeur
Pigou nous semble extraire de la Thorie Classique tout ce qu'on peut en tirer ;
l'ouvrage est donc une preuve saisissante de l'inutilit de cette thorie lorsque on
l'applique la recherche des facteurs qui en fait dterminent le volume global de
l'emploi
1
.
II
Appliquons donc la solution du problme notre propre mthode d'analyse.
L'opration comprendra deux parties : 1 Toutes choses gales d'ailleurs, une rduc-
tion des salaires nominaux a-t-elIe pour effet direct d'augmenter l'emploi ? - l'incise
toutes choses gales d'ailleurs signifiant que dans la communaut tout entire il n'y
a aucune variation de la propension consommer, de la courbe de l'efficacit
marginale du capital, ni du taux de l'intrt. 2 Une rduction des salaires nominaux
a-t-elle pour effet certain ou probable de modifier l'emploi dans un sens particulier du
fait de ses rpercussions certaines ou probables sur ces trois facteurs ?
A la premire question nous avons dj dans les chapitres prcdents rpondu par
la ngative. Nous avons dmontr en effet que le volume de l'emploi dpend uni-
quement du montant de la demande effective mesure en units de salaires, et que la
demande effective, tant la somme de la consommation et de l'investissement atten-
dus, ne peut varier si la propension consommer, la courbe de l'efficacit marginale
du capital et le taux de l'intrt restent constants. Si, en l'absence de variation de ces
facteurs, les entrepreneurs augmentent le volume de l'emploi, leur produit tombe
ncessairement au-dessous de leur prix d'offre.
1
L'on trouvera dans un Appendice au prsent chapitre une critique dtaille de la Theory of
Unemployment du Professeur Pigou.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 91
Pour carter la conclusion sommaire aux ternies de laquelle une rduction des
salaires nominaux augmenterait l'emploi parce qu'elle rduit le cot de produc-
tion , peut-tre sera-t-il utile de suivre le cours des vnements dans le cas le plus
favorable o, au dbut, les entrepreneurs esprent que la rduction des salaires nomi-
naux produira cet effet. De fait il n'est pas invraisemblable que chaque entrepreneur
pris individuellement, voyant diminuer les. lments de son propre cot, nglige au
dbut les rpercussions qui doivent en rsulter sur la demande de son produit, et qu'il
agisse en se fondant sur l'hypothse qu'il sera capable de vendre avec profit une
production plus importante qu'auparavant. Si l'ensemble des entrepreneurs rglent
leur attitude sur cette hypothse, russiront-ils en fait accrotre leurs profits ? En
deux cas seulement: d'abord si la propension marginale de la communaut consom-
mer est gale un, de sorte qu'il n'y ait pas d'cart entre l'accroissement du revenu et
celui de la consommation; et ensuite si l'investissement augmente assez pour
compenser l'cart entre l'accroissement du revenu et celui de la consommation, ce qui
exige que la courbe de l'efficacit marginale du capital s'lve par rapport au taux de
l'intrt. Le produit . que les entrepreneurs tireront de leur production accrue dce-
vra donc leur attente et l'emploi retombera son chiffre antrieur, moins que la
propension marginale consommer soit gale un ou bien que la rduction des salai-
res nominaux ait pour rsultat d'accrotre l'efficacit marginale du capital par rapport
au taux de l'intrt, c'est--dire d'augmenter l'investissement. Car, si les entrepreneurs
offrent au public assez d'emploi pour que, des revenus correspondant cet emploi,
ledit public tire une pargne suprieure l'investissement courant, ils sont forcs
d'enregistrer une perte gale la diffrence ; et ceci est vrai quel que puisse tre le
niveau des salaires nominaux. Tout au plus l'poque de leur dception sera-t-elle re-
tarde pendant le laps de temps o l'cart se trouve combl par les investissements
qu'ils font eux-mmes en accroissant leur capital circulant.
Ainsi la rduction des salaires nominaux ne saurait d'une faon durable accrotre
l'emploi, si ce n'est par ses rpercussions sur la propension de la communaut con-
sommer, sur la courbe de l'efficacit marginale du capital, ou sur le taux de l'intrt.
Pour analyser les consquences d'une telle rduction, il n'y a pas d'autre mthode que
de suivre ses effets possibles sur ces trois facteurs.
Dans la pratique les rpercussions les plus importantes paraissent tre les sui-
vantes :
1 Une rduction des salaires nominaux diminuera plus ou moins les prix. Elle
entranera donc un certain transfert de revenu rel : a) des salaris aux autres facteurs
qui entrent dans le cot premier marginal et dont la rmunration n'a pas t rduite ;
b) des entrepreneurs aux rentiers, qui un certain revenu nominal fixe a t garanti.
Quel sera l'effet de ce changement de rpartition sur la propension de la commu-
naut consommer ? Le transfert de revenu des salaris aux autres facteurs de pro-
duction est de nature diminuer la propension consommer. Quant au transfert de
revenu des entrepreneurs aux rentiers, son effet est plus douteux. Mais, si dans la
communaut les rentiers reprsentent en gros la clame la plus riche et celle dont le
niveau de vie est le moins lastique, l'effet sera encore dfavorable. Quel sera le
rsultat net de ces transferts, compte tenu de toutes les considrations qui intervien-
nent ? On ne peut que le conjecturer. Sans doute y a-t-il plus de chances qu'il soit
contraire que favorable.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 92
2 Si on a affaire un systme ouvert et si la rduction des salaires nominaux est
une rduction par rapport- aux salaires nominaux l'tranger, les uns et les autres
tant rapports une mme unit, la variation est videmment favorable l'investis-
sement puisqu'elle tend amliorer la balance commerciale
1
. Ceci suppose videm-
ment que le bnfice ne soit pas annihil par une modification des tarifs douaniers,
des contingentements, etc. Si la croyance traditionnelle l'efficacit d'une rduction
des salaires nominaux en tant que moyen d'augmenter l'emploi est plus dveloppe en
Angleterre qu'aux tats-Unis, c'est probablement parce que les tats-Unis possdent
plus que l'Angleterre le caractre d'une conomie ferme.
3 Dans le cas d'un systme ouvert une rduction des salaires nominaux, tout en
augmentant le solde crditeur de la balance commerciale, est de nature rendre
moins favorable le taux du troc extrieur. Les revenus rels autres que ceux des ch-
meurs remploys subiront donc une rduction qui pourra contribuer augmenter la
propension consommer.
4 Si la rduction des salaires nominaux parat devoir tre une rduction par rap-
port aux salaires nominaux futurs, elle sera favorable l'investissement, parce que,
comme nous l'avons vu, elle augmentera l'efficacit marginale du capital ; pour la
mme raison elle pourra galement tre favorable la consommation. En revanche, si
elle donne naissance une prvision ou simplement une srieuse possibilit de nou-
velle rduction dans l'avenir, elle produira l'effet exactement inverse, car elle dimi-
nuera l'efficacit marginale du capital et entranera la fois l'ajournement de l'in-
vestissement et celui de la consommation.
5 La rduction des salaires nominaux, qui s'accompagne en gnral d'une cer-
taine baisse des prix et des revenus nominaux, affaiblira le besoin d'argent liquide
pour les transactions commerciales et le paiement du revenu ; par suite elle fera bais-
ser d'autant la courbe de la prfrence pour la liquidit relative la communaut tout
entire. Toutes choses restant gales, elle diminuera donc le taux de l'intrt et se
montrera favorable l'investissement. Dans ce cas l'action des prvisions sera de sens
contraire celle que nous venons d'examiner au 4. Si on s'attend un redressement
ultrieur des salaires et des prix, l'effet favorable sur les prts long terme sera
beaucoup moins marqu que sur les prts court terme. De plus, si la rduction des
salaires en causant du mcontentement dans le peuple nuit sur le plan politique la
confiance, le renforcement de la prfrence pour la liquidit qui en sera la cons-
quence absorbera une quantit d'argent liquide suprieure celle qui se trouvera
libre de la circulation active.
6 Puisque une rduction des salaires nominaux particulire une entreprise ou
une industrie est toujours profitable cette entreprise ou cette industrie prise indi-
viduellement, il se peut qu'une rduction gnrale des salaires, bien qu'elle produise
en ralit des effets diffrents, fasse natre, elle aussi, un tat d'esprit optimiste chez
les entrepreneurs ; il se peut qu'une brche soit ainsi ouverte dans le cercle vicieux
des apprciations indment pessimistes de l'efficacit marginale du capital et que les
choses se trouvent remises en train sur la base de prvisions plus normales. En
revanche il se peut que l'agitation ouvrire compense cet effet favorable, si la main-
d'uvre prte une rduction gnrale des salaires les mmes consquences errones
que les patrons. Cette ventualit est d'autant plus craindre qu'il n'y a d'ordinaire
aucun moyen de raliser la fois dans toutes les industries une rduction uniforme
1
On n'oubliera pas que les exportations constituent un investissement extrieur (N. du T.).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 93
des salaires nominaux et que par consquent chaque travailleur a intrt s'opposer
la rduction dans son cas particulier. En fait, l'effort des entrepreneurs en vue de
rduire les salaires nominaux par la rvision des accords qui les dterminent ren-
contre beaucoup plus de rsistance que la baisse graduelle et automatique des salaires
rels qui rsulte d'une hausse des prix.
7 D'autre part l'influence dprimante que l'alourdissement des dettes exerce sur
les entrepreneurs peut contrebalancer en partie toute consquence heureuse de la
rduction des salaires. A la vrit, si la baisse des salaires et des prix prend une cer-
taine extension, les entrepreneurs qui sont fortement endetts peuvent se trouver
rapidement gns au point de devenir insolvables, ce qui porte une grave atteinte
l'activit de l'investissement. Au surplus la baisse des prix, aggravant la charge relle
de la Dette Publique et par consquent celles des impts, est de nature provoquer
dans les milieux d'affaires un profond affaiblissement de la confiance.
L'numration prcdente n'est pas une liste complte des consquences qui, dans
le monde complexe o nous vivons, peuvent rsulter d'une rduction des salaires.
Mais elle comprend celles qui nous paraissent tre d'ordinaire les plus importantes.
Ds lors, si on limite le raisonnement au ras d'un systme ferm et si on admet
qu'il n'y a rien, ou en tout cas rien de bon, attendre des rpercussions que les
transferts de revenu rel produisent sur la propension de la communaut consom-
mer, l'espoir qu'une rduction des salaires nominaux puisse agir favorablement sur
l'emploi doit tre surtout fond sur l'amlioration que la hausse de l'efficacit mar-
ginale du capital vise au 4 ou la baisse du taux de l'intrt vise au 5 peuvent
amener dans l'investissement. Examinons de plus prs ces deux possibilits.
La contingence favorable l'efficacit marginale du capital est celle o l'on croit
que les salaires nominaux ont atteint leur minimum et que leurs variations ultrieures
seront orientes vers la hausse. La contingence la plus dfavorable est celle o les
salaires nominaux flchissent lentement et o chaque rduction affaiblit la confiance
dans leurs chances de se maintenir par la suite. Au dbut d'une priode de dclin de la
demande effective une rduction soudaine et importante des salaires nominaux, qui
les amnerait un niveau o personne ne pourrait croire la continuation indfinie de
leur baisse, serait l'ventualit la plus favorable la restauration de la demande
effective. Mais une rduction de ce genre ne peut tre accomplie que par une dcision
administrative ; dans un rgime de libre discussion des salaires elle ne semble gure
possible. D'autre part, il vaudrait bien mieux que les salaires fussent fixs rigidement
et jugs peu prs irrductibles que d'accuser en priode de dpression une tendance
progressive la baisse qui fait interprter chaque augmentation du chmage, attei-
gnant disons 1 %, comme l'annonce d'une nouvelle baisse modre des salaires. Sup-
posons titre d'exemple qu'on s'attende une Paisse de 2 % des salaires au cours de
l'anne suivante, cette prvision produira un effet peu prs quivalent celui d'une
hausse de 2 % de l'intrt payable pour un prt d'gale dure. Et les mmes observa-
tions s'appliquent mutatis mutandis une priode d'essor.
Il s'ensuit que, eu gard aux coutumes et institutions telles qu'elles existent dans le
monde contemporain, il est plus expdient de chercher suivre une politique rigide
de salaires nominaux qu'une politique souple s'adaptant par petites tapes aux varia-
tions du chmage - pour autant, bien entendu, qu'on considre l'efficacit marginale
du capital. Mais cette conclusion n'est-elle pas infirme lorsqu'on en vient au taux de
l'intrt ?
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 94
Ainsi l'effet produit sur la demande de monnaie par la baisse des salaires et des
prix apparat comme la seule base solide sur laquelle ceux qui prtent au systme
conomique la proprit de s'ajuster de lui-mme peuvent fonder leur raisonnement ;
encore qu' notre connaissance ils ne l'aient jamais fait. D'ailleurs, si la quantit de
monnaie est elle-mme fonction du niveau des salaires et des prix, il n'y a rien
esprer dans cette voie. Mais, si la quantit de monnaie est virtuellement fixe, il est
vident qu'au moyen d'une rduction suffisante des salaires nominaux la quantit de
monnaie mesure en units de salaire peut tre indfiniment augmente ; et que le
rapport entre cette quantit et l'ensemble des revenus peut tre grandement accru, la
limite de l'accroissement dpendant d'une part de la proportion du cot des salaires
dans le cot premier marginal et d'autre part de la raction des autres lments du
cot premier marginal la baisse de l'unit de salaire.
On peut donc, tout au moins thoriquement, produire exactement les mmes effets
sur le taux de l'intrt, en rduisant les salaires sans modifier la quantit de monnaie,
et en augmentant la quantit de monnaie sans modifier le niveau des salaires. Par
suite il n'est pas moins difficile d'assurer le plein emploi par la rduction des salaires
que par l'augmentation de la quantit de monnaie. Nous avons expos prcdemment
les raisons qui limitent l'efficacit des accroissements de la quantit de monnaie en
tant que moyen de porter l'investissement son montant optimum. Les mmes rai-
sons s'appliquent mutatis mutandis aux rductions de salaires. De mme qu'un ac-
croissement modr de la quantit de monnaie peut avoir une influence insuffisante
sur le taux de l'intrt long terme, et qu'un accroissement immodr risque de porter
la confiance une atteinte qui annule ses autres avantages, de mme exactement une
rduction modre des salaires nominaux peut se montrer insuffisamment efficace,
tandis qu'une rduction immodre, supposer qu'elle soit ralisable, risque de ruiner
la confiance.
Il n'y a donc pas de raison de croire qu'une politique souple de salaires puisse
maintenir un tat permanent de plein emploi, pas plus qu'il n'y a de raison de croire
qu'une politique montaire de march ouvert puisse elle seule obtenir ce rsultat. De
tels moyens ne sauraient confrer au systme conomique la proprit de s'ajuster de
lui-mme.
A la vrit, si chaque fois qu'on s'cartait du plein emploi la main-d'uvre tait en
mesure d'intervenir (et qu'elle ft dispose le faire) pour rduire par une action
concerte ses demandes de monnaie, jusqu' ce que l'abondance de la monnaie par
rapport l'unit de salaire suffise faire baisser le taux de l'intrt au niveau com-
patible avec le plein emploi, ce seraient alors les syndicats ouvriers et non le systme
bancaire qui, en fait, assureraient la direction de la monnaie en vue de maintenir le
plein emploi.
Bien qu'une politique souple de salaires et une politique montaire souple revien-
nent analytiquement au mme, puisqu'elles sont toutes deux des moyens de modifier
la quantit de monnaie mesure en units de salaire, il n'en est pas moins vrai qu'
d'autres gards elles se distinguent par un monde de diffrences. Rappelons brive-
ment au lecteur les trois considrations essentielles.
1 Sauf dans une communaut socialise o les salaires sont fixs par dcret, il n'y
a aucun moyen de raliser une rduction uniforme des salaires dans toutes les cat-
gories de la main-duvre. La baisse ne peut tre obtenue qu'au prix d'une srie de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 95
flchissements graduels et dsordonns, qu'aucun critre de justice sociale ou d'utilit
conomique ne justifie, et qui ne s'accomplissent d'ordinaire qu'aprs des luttes
vaines et dsastreuses, o ceux qui pour ngocier se trouvent dans la position la plus
faible ptissent comparativement aux autres. Quant la modification de la quantit de
monnaie, la plupart des Gouvernements ont dj le pouvoir de la raliser par des
oprations sur le march ouvert ou par des mesures analogues. Eu gard la nature
humaine et aux institutions existantes, il faudrait tre dpourvu de bon sens pour
prfrer une politique souple de salaires une politique souple de la monnaie, alors
qu'on ne peut invoquer en faveur de la premire aucun avantage qui ne puisse tre
reconnu la seconde. Au surplus, galit de convenance en d'autres domaines, une
mthode dont l'application est comparativement aise devrait tre prfre une
mthode qui est sans doute trop difficile pour tre pratiquement applicable.
2 Lorsque les salaires nominaux restent constants, les prix ne peuvent varier
(exception faite des prix contrls ou des prix de monopole, qui sont gouverns
par des facteurs autres que le cot marginal) qu' raison de la diminution du rende-
ment marginal de l'quipement qui accompagne l'accroissement de la production.
Ainsi se trouve maintenue dans toute la mesure du possible l'galit de traitement
entre la main-duvre et les facteurs auxquels une rmunration nominale fixe est
garantie par contrat, c'est--dire notamment les rentiers et les titulaires d'moluments
fixes appartenant aux cadres permanents des entreprises, des tablissements et de
l'tat. Lorsqu'une partie importante de la population possde une rmunration nomi-
nale qui reste fixe en tous cas, la justice et l'utilit sociales exigent que tous les
facteurs aient une rmunration nominale offrant une certaine rigidit. Eu gard
l'importance des revenus dont le montant nominal est relativement rigide, il faudrait
tre dpourvu d'esprit de justice pour prfrer une politique souple de salaires une
politique souple de la monnaie, alors qu'on ne peut invoquer en faveur de la premire
aucun avantage qui ne puisse tre reconnu la seconde.
3 Des deux mthodes propres augmenter la quantit (le monnaie mesure en
units de salaire, l'une, celle qui consiste diminuer l'unit de salaire, accrot propor-
tionnellement le fardeau des dettes, l'autre, celle qui consiste augmenter la quantit
de monnaie sans changer l'unit de salaire, produit l'effet contraire. Eu gard au poids
excessif de maintes catgories de dettes, il faudrait tre dpourvu d'exprience pour
prfrer la premire la seconde.
4 Lorsqu'un dclin progressif du taux de l'intrt doit provenir d'une rduction
progressive des salaires, il existe, pour les motifs indiqus ci-dessus, une double
influence dfavorable l'efficacit marginale du capital, une double raison de diffrer
l'investissement, et par suite un double obstacle la reprise.
III
Si la main-d'uvre, en cas d'une baisse progressive de l'emploi, devait offrir ses
services un salaire nominal de plus en plus bas, il n'en rsulterait en rgle gnrale
aucune diminution des salaires rels ; peut-tre mme ces salaires rels augmen-
teraient-ils, puisque le volume de la production tendrait dcrotre. L'effet principal
d'une telle politique serait de causer une grande instabilit des prix, instabilit qui
pourrait tre assez violente, dans une socit conomique fonctionnant comme celle
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 96
o nous vivons, pour enlever toute porte aux calculs des hommes d'affaires. C'est
une contre-vrit qu'une politique souple de salaires soit un attribut normal et propre
d'un systme fond dans son ensemble sur le principe Au laissez-faire. Une telle
politique ne pourrait russir que dans une socit soumise une forte autorit,
capable d'imposer des rductions de salaires soudaines, profondes et gnrales. Sa
mise en oeuvre pourrait se concevoir en Italie, en Allemagne ou en Russie, mais non
en France, aux tats-Unis ou en Grande-Bretagne.
Si on tentait, comme en Australie, d'assurer par voie lgislative la fixit des salai-
res rels, il y aurait un certain volume de l'emploi qui correspondrait au niveau des
salaires rels. Le volume effectif de l'emploi, dans un systme ferm, oscillerait
violemment entre ce volume et l'absence totale d'emploi, selon que l'investissement
serait suprieur ou infrieur au montant compatible avec le dit volume. Quant aux
prix, ils se trouveraient en quilibre instable tant que l'investissement resterait au
montant critique, ils s'effondreraient zro lorsqu'il serait plus faible et s'lveraient
l'infini lorsqu'il serait plus fort. L'lment de stabilit, si tant est qu'il en ft, consis-
terait en une dtermination des facteurs qui gouvernent la quantit de monnaie, telle
qu'il existe toujours un niveau des salaires nominaux o cette quantit de monnaie
soit celle qui tablit entre le taux de l'intrt et l'efficacit marginale du capital la rela-
tion qui maintient l'investissement au montant critique. L'emploi serait alors constant
(au niveau compatible avec le salaire rel lgal). Quant aux salaires nominaux et aux
prix, ils oscilleraient rapidement dans la mesure exactement ncessaire pour main-
tenir l'investissement au montant convenable. Dans le cas Concret de l'Australie la
solution a t trouve en partie bien entendu dans l'impuissance invitable de la
lgislation atteindre son but, mais en partie aussi dans le fait que l'Australie n'est
pas un systme ferm ; le niveau des salaires nominaux tait lui-mme un facteur
dterminant de l'investissement extrieur et partant de l'investissement total, tandis
que le taux du troc extrieur exerait une influence sensible sur le prix des biens de
consommation ouvrire.
A la lumire de ces considrations nous estimons maintenant, compte tenu de tous
les intrts en cause, que le maintien du niveau des salaires nominaux un chiffre
stable constitue la politique la plus sage dans un systme ferm. La mme conclusion
reste valable dans un systme ouvert, pourvu que l'quilibre avec le reste du monde
puisse tre assur par les variations du change. Il est dsirable que dans les industries
particulires les salaires possdent un certain degr de souplesse de manire hter
les transferts de main-duvre de celles qui dclinent celles qui progressent, par
rapport la moyenne. Mais le niveau gnral des salaires nominaux devrait tre
maintenu aussi stable que possible, tout le moins dans la courte priode.
Une telle politique se traduirait par une stabilit assez grande du niveau des prix -
stabilit plus grande en tout cas que dans l'hypothse d'une politique souple de
salaires. Dans la courte priode les prix (autres que les prix contrls et les prix
de monopole) ne varieraient que dans la mesure o les variations de l'emploi affecte-
raient les cots premiers marginaux. Dans la longue priode ils ne varieraient qu'
raison de la baisse du cot de production due aux progrs techniques, l'amlioration
de l'quipement ou son extension.
Il n'en est pas moins vrai que, s'il se produisait de fortes variations de l'emploi,
elles s'accompagneraient de fluctuations notables du niveau des prix. Mais celles-ci,
nous l'avons dit, seraient moins importantes que dans l'hypothse d'une politique
souple de salaires.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 97
Ainsi, dans le cas d'une politique rigide de salaires, la stabilit des prix dans la
courte priode est lie l'absence de fluctuations de l'emploi. D'autre part, en ce qui
concerne la longue priode, il reste encore choisir entre une politique de salaires
stables laissant les prix flchir lentement mesure que la technique et l'quipement
progressent et une politique de prix stables laissant les salaires monter lentement. A
tout prendre, c'est la dernire que va notre prfrence, eu gard au fait qu'il est plus
facile de maintenir un certain degr de plein emploi lorsqu'on s'attend la hausse des
salaires que lorsqu'on s'attend leur baisse, et aussi en considration des avantages
sociaux de l'allgement graduel des dettes, de la facilit plus grande des dplacements
de main-d'uvre des branches de l'industrie qui dclinent celles qui progressent, et
enfin du stimulant moral qui rsulte d'ordinaire d'une tendance modre des salaires
nominaux la hausse. Mais ceci ne soulve aucune question de principe; nous ne
pourrions sans sortir des limites de notre sujet exposer en dtail les arguments pour et
contre.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 98
Livre V : Salaires nominaux et prix : chapitre XIX
Appendice
au chapitre XIX
La thorie du chmage
du professeur Pigou
Retour la table des matires
Dans sa Theory of Unemployment, le Professeur Pigou fait dpendre le volume de
l'emploi de deux facteurs fondamentaux : 1 le taux des salaires rels stipul par la
main d'uvre, et 2 la forme de la Courbe de la Demande Relle de Travail. Les par-
ties centrales de son livre sont consacres dterminer la forme de cette courbe. Il
n'ignore pas, qu'en fait les ouvriers stipulent un taux nominal et non un taux rel de
salaires. Mais il admet pratiquement que le taux effectif du salaire nominal divis par
le prix des biens de consommation ouvrire peut servir de mesure du taux rel
demand.
Les quations qui, comme il dit, forment le point de dpart de l'tude sur la
Courbe de la Demande Relle de Travail sont donnes la page 90. Mais, comme les
hypothses tacites ncessaires la validit de l'analyse se dissimulent dans les pre-
mires Pages, nous allons rsumer l'argumentation jusqu'au point dcisif.
Le Professeur Pigou distingue deux sortes d'industries: celles qui produisent les
biens de consommation ouvrire l'intrieur et les richesses exportables dont la vente
cre l'tranger des droits des biens de consommation ouvrire et les autres
industries ; il sera commode de les dsigner respectivement sous le nom d'industries
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 99
produisant les biens de consommation ouvrire et d'industries produisant les biens
non destins la consommation ouvrire. Il suppose que x hommes s'ont employs
dans les premires et y hommes dans les dernires. Il appelle F(x) la valeur des biens
de consommation ouvrire produits par les x hommes et F'(x) le taux gnral des
salaires. Ceci, bien qu'il ne s'attarde pas le dire, revient supposer que le cot
marginal des salaires est gal au cot premier marginal
1
. De plus, il suppose que
x y x + ( ), c'est--dire que le nombre d'hommes employs dans les industries -
produisant les biens de consommation ouvrire est fonction de l'emploi total. Il
montre ensuite que l'lasticit de la demande relle globale de travail (qui donne la
forme de la courbe tudie, i. e. de la courbe de la Demande Relle de Travail) peut
s'crire
r E
x
x
F x
F x
' ( )
( )
.
' ( )
' ' ( )
Pour autant que la figuration symbolique ait un sens, ceci ne diffre gure de nos
propres modes d'expression. Si on peut assimiler les biens de consommation
ouvrire du Professeur Pigou nos biens de consommation et ses autres biens
nos biens d'investissement,
F x
F x
( )
' ( )
, ou la valeur en units de salaire ds biens de
consommation ouvrire produits, est gal notre
S C
. De plus ( condition d'assimi-
ler les biens de consommation ouvrire aux biens de consommation) est fonction
de ce que nous avons appel plus haut le multiplicateur de l'emploi k'. Car
x k y '
et
' ( )
'
x
k
+ 1
1
L'lasticit de la demande relle globale de travail du Professeur Pigou est
donc un facteur complexe semblable certains des ntres. Il dpend en partie des
conditions physiques et techniques de l'industrie (traduites par sa fonction F) et en
partie de la propension consommer les biens de consommation ouvrires (traduite
1
L'habitude trompeuse d'assimiler le cot marginal des salaires au cot premier marginal vient
peut-tre d'une ambigut dans le sens du premier terme. il peut signifier soit le cot d'une unit
additionnelle de production, lorsqu'elle n'est greve d'aucun cot additionnel autre que celui des
salaires, soit le cot additionnel des salaires qu'entrane la production d'une unit additionnelle de
richesse, lorsqu'elle est ralise dans les conditions les plus conomiques avec l'aide de l'quipe-
ment existant et des autres facteurs inemploys. Dans le premier cas on s'interdit d'associer au
travail additionnel tout supplment d'entreprise, de capital circulant ou de choses autres que le
travail qui s'ajouterait au cot, on refuse mme d'admettre que le travail additionnel puisse aug-
menter la vitesse d'usure de l'quipement. Puisque on exclut du cot premier marginal tout lment
de cot autre que le travail, le cot marginal des salaires et le cot premier marginal sont videm-
ment gaux. Mais les conclusions d'une analyse fonde sur les prmisses sont presque dpourvues
d'application. Dans la pratique en effet l'hypothse de base est rarement ralise ; on n'est pas
assez insens pour refuser d'associer au travail additionnel les supplments appropris des autres
facteurs pour autant qu'ils sont disponibles. 'Aussi l'hypothse ne s'applique-t-elle qu'au cas o les
facteurs autres que le travail sont tous dj employs au maximum.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 100
par sa fonction [lettre grecque]) ; condition, bien entendu, qu'on s'en tienne au cas
spcial o le cot marginal du travail est gal au cot premier marginal.
Pour dterminer le volume de l'emploi, le Professeur Pigou associe alors sa
courbe de la demande relle de travail une courbe de l'offre de travail. Il suppose
que celle-ci dpend du salaire rel et de ce salaire seul. Mais, comme il a dj admis
que le salaire rel est fonction du nombre d'hommes x employs dans les industries
produisant les biens de consommation ouvrire, il suppose en dfinitive que l'offre
globale de travail disponible au salaire rel existant est fonction de x et de x seul. En
d'autres termes, si n reprsente l'offre de travail disponible au salaire rel F' (x), n =
x(x).
Ainsi, dgage de toute complication, l'analyse du Professeur Pigou se rsume
un essai de dtermination du volume effectif de l'emploi au moyen des quations
x y x + ( )
et
n x x ( )
Mais il y a ici trois inconnues et deux quations seulement. Il apparat clairement que
le Professeur Pigou tourne la difficult en considrant que n est gal x + y. Il
suppose qu'il n'y a pas de chmage involontaire au sens strict de mot, c'est--dire
qu'en fait la main d'uvre disponible au salaire rel existant est tout entire
employe. La valeur de x est alors celle qui vrifie l'quation
( ) ( ) x x x ;
et lorsque on sait que x est gal par exemple n
1
, y doit tre gal x(n
1
) - n
1
, et
l'emploi total x (n
1
).
Arrtons-nous un instant pour examiner le sens de cette thorie. Elle signifie que,
lorsque la courbe de l'offre de travail se modifie de manire qu'une quantit plus
grande de main-duvre s'offre sur la base d'un salaire rel donn (n
1
+ dn
1
tant
alors la valeur de x qui vrifie l'quation ( ) ( ) x x x ), la demande de biens non
destins la consommation ouvrire est telle qu'automatiquement l'emploi dans les
industries qui les produisent crot juste autant qu'il faut pour maintenir l'galit de
(n
1
+ dn
1
) et de x (n
1
+ dn
1
). L'emploi global ne peut varier que d'une seule autre
manire; dans le cas o la propension acheter respectivement des biens de consom-
mation ouvrire et des biens non destins la consommation ouvrire volue de telle
sorte qu'il y ait une augmentation de y accompagne d'une diminution plus forte de x.
Supposer n gal x + y quivaut, bien entendu, supposer que la main-duvre
est toujours en mesure de dterminer son propre salaire rel. Cette dernire hypothse
signifie donc que la demande de biens non destins la consommation ouvrire obit
aux lois prcdentes. En d'autres termes le taux de l'intrt est cens s'ajuster toujours
la courbe de l'efficacit marginale du capital de manire maintenir le plein emploi.
Sans cette hypothse l'analyse s'croule et ne permet plus de dterminer le volume
effectif de l'emploi. Il est trange en vrit que le Professeur Pigou ait cru pouvoir
prsenter une thorie de l'emploi qui ne fasse aucune allusion aux cas o les varia-
tions de l'investissement (i. e. les variations de l'emploi dans la production des biens
non destins la consommation ouvrire) ne proviennent pas de changements dans la
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 101
courbe de l'offre de travail, mais de modifications (par exemple) du taux de l'intrt
ou de l'tat de la confiance.
Le titre de Thorie du Chmage n'est donc pas pertinent. En ralit, le livre ne
traite pas cette question. C'est une tude relative, au volume pris par l'emploi, lorsque
la courbe de l'offre de travail est donne et que les conditions du plein emploi se
trouvent remplies. L'objet du concept d'lasticit de la demande relle globale de
travail est d'indiquer la variation du plein emploi qui correspond une modification
donne de la courbe de l'offre de travail. Ou - encore et peut tre plus exactement - on
peut considrer cet ouvrage comme une tude non causative de la relation fonction-
nelle qui dtermine le niveau des salaires rels lorsque le volume de l'emploi est
donn. Mais il ne peut nous dire ce qui dtermine le volume effectif de l'emploi ; et il
n'a pas de rapport direct avec le problme du chmage involontaire.
Mme si le Professeur Pigou contestait, comme il le ferait peut-tre, la possibilit
du chmage involontaire au sens que nous avons donn prcdemment ce mot, il
serait encore difficile de voir comment son analyse pourrait s'appliquer. Car, en
s'abstenant de rechercher ce qui dtermine le rapport entre x et y, c'est--dire entre le
volume respectif de l'emploi dans les industries produisant les biens de consomma-
tion ouvrire et dans les autres industries, il commet encore une omission irrparable.
De plus, il reconnat que dans une certaine limite la main-d'uvre contracte
souvent en fait sur la base non d'un salaire rel mais d'un salaire nominal donn.
Alors la courbe de l'offre de travail ne dpend plus seulement de F'(x) seul, mais
encore du prix nominal des biens de consommation ouvrire. L'analyse prcdente se
trouve donc en dfaut, puisqu'un nouveau facteur intervient sans qu'il y ait une
quation nouvelle pour dterminer cette inconnue supplmentaire. On ne saurait
mieux illustrer les dangers d'une mthode pseudo-mathmatique qui ne progresse
qu'en rapportant tout une seule variable et en supposant les diffrentielles partielles
nulles. Il est inutile de reconnatre plus tard qu'en fait il y a d'autres variables, si on
poursuit le raisonnement sans remettre en question tout ce qui a t dit jusque-l.
Lorsque dans une certaine limite c'est un salaire nominal que la main-d'uvre stipule,
le nombre des donnes est encore insuffisant mme si on suppose n gal x + y, sauf
si les facteurs qui dterminent le prix nominal des biens de consommation ouvrire
sont connus. Ce prix nominal dpend en effet du volume global de l'emploi. On ne
peut donc savoir quel sera le volume global de l'emploi tant qu'on ne connat pas le
prix nominal des biens de consommation ouvrire, et on ne peut savoir quel sera le
prix nominal des biens de consommation ouvrire tant qu'on ne connat pas le volume
global de l'emploi. Comme nous l'avons dit, il manque une quation. Cependant c'est
lorsqu'on suppose provisoirement les salaires nominaux plus rigides que les salaires
rels, que la thorie se rapproche sans doute le plus de la ralit. En Grande-Bretagne,
par exemple, malgr le dsordre, l'incertitude et les fortes fluctuations de prix qui ont
marqu la dcade 1924-1934, les salaires nominaux n'ont vari que de 6 % alors que
les salaires rels variaient de plus de 20 %. Une thorie ne peut prtendre la gn-
ralit lorsqu'elle ne s'applique pas dans le cas (ou dans la limite) o les salaires
nominaux sont fixes, tout aussi bien que dans les autres cas. Libre aux politiciens de
gmir sur la prtendue ncessit d'une grande souplesse des salaires nominaux; mais
un thoricien doit tre prt traiter indiffremment toutes les situations qui se
prsentent. Une thorie scientifique ne peut contraindre les faits se plier ses
hypothses.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 102
Lorsque le Professeur Pigou en vient examiner expressment les consquences
d'une rduction des salaires nominaux, il est manifeste qu'encore une fois les donnes
introduites sont insuffisantes pour qu'une solution dfinie puisse tre obtenue. Il
commence par rejeter l'argument (op. cit., p. 101) d'aprs lequel, si le cot premier
marginal est gal au cot marginal des salaires, les revenus des non-salaris varient
en cas de baisse des salaires nominaux dans la mme proportion que ceux des sala-
ris ; il faudrait, dit-il, pour que cet argument ft valable, que le volume de l'emploi
restt constant - et c'est prcisment la question qu'on discute.
Mais la page suivante (op. cit., p. 102) il commet lui-mme la mme erreur en
supposant qu'au dbut il n'y a rien de chang dans le revenu nominal des non-
salaris ; ceci ne serait vrai, il vient de le dire, que si le volume de l'emploi ne res-
tait pas constant - et c'est prcisment la question qu'on discute. En ralit le pro-
blme n'admet aucune solution tant qu'on n'introduit pas d'autres facteurs dans les
donnes.
Le fait que la main d'uvre stipule un salaire nominal et non un salaire rel donn
(pourvu que le salaire rel ne tombe pas au-dessous d'un certain minimum) met l'ana-
lyse en dfaut d'une manire que l'on peut encore montrer en signalant que l'hypo-
thse fondamentale dans presque tout le raisonnement, d'aprs laquelle une quantit
plus grande de travail ne s'offre qu'en change d'un salaire rel plus lev, n'est pas
vrifie. Le Professeur Pigou rejette par exemple la thorie du multiplicateur (op. cit.,
p. 75) en supposant que le taux des salaires rels est donn, i. e. en supposant que, le
plein emploi tant dj atteint, aucun supplment de travail ne s'offrira en change
d'un salaire rel infrieur. Dans le cadre de cette hypothse son raisonnement est
videmment correct. Mais il critique dans ce passage une proposition qui a trait la
politique pratique. En un temps o, d'aprs les statistiques, le chmage dpasse en
Grande-Bretagne 2.000.000 d'units (i. e. o il y a 2.000.000 d'hommes dsireux de
travailler au salaire nominal existant), il faut tre mille lieues de la ralit pour
supposer que toute hausse du cot de la vie, si faible soit-elle, par rapport au salaire
nominal, puisse amener le retrait du march d'une quantit de main-d'uvre sup-
rieure l'quivalent de ces 2.000.000 d'hommes.
Il importe d'insister sur le fait que l'ouvrage du Professeur Pigou repose tout entier
sur l'hypothse qu'une hausse du cot de la vie, si faible quelle soit, par rapport au
salaire nominal dcide se retirer du march du travail un nombre d'ouvriers
suprieur tout l'effectif inemploy.
De plus le Professeur Pigou ne remarque pas dans ce passage (op. cit., p. 75) que
l'argument qu'il oppose l'emploi secondaire , qui rsulterait de travaux publics,
est dans les mmes hypothses tout aussi valable l'encontre d'un accroissement de
l'emploi primaire d cette politique. Car, lorsque le taux des salaires rels en
vigueur dans les industries produisant les biens de consommation ouvrire est donn,
aucun accroissement de l'emploi n'est possible, sauf toutefois si les non salaris rdui-
sent leurs dpenses en biens de consommation ouvrire. Les personnes intresses
par l'accroissement de l'emploi primaire augmentent vraisemblablement leurs dpen-
ses en biens de consommation ouvrire; le salaire rel s'en trouve diminu, et (dans
ces hypothses) une partie de la main-d'uvre qui tait employe ailleurs se retire du
march. Le Professeur Pigou parat admettre nanmoins la possibilit d'un accroisse-
ment de l'emploi primaire. La ligne qui spare l'emploi primaire de l'emploi secon-
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 103
daire semble tre sur le plan psychologique le point critique o son bon sens lucide
cesse de prvaloir contre sa mauvaise thorie.
Les diffrences prcdentes d'hypothses et de raisonnement crent entre les
conclusions du Professeur Pigou et les ntres une divergence qui apparat bien dans
cet important passage o il rsume sa manire de voir : Si la concurrence entre les
ouvriers est parfaitement libre et si la main-duvre est parfaitement mobile, la natu-
re de la relation sera des plus simples (il s'agit de la relation entre le taux des salaires
rels stipuls par la main-duvre et la courbe de la demande de travail). Une
impulsion nergique s'exercera toujours sur les salaires pour maintenir entre leur taux
et la demande une relation telle que tout le monde soit employ. Dans une situation
stable tout le monde sera donc effectivement employ. En consquence le chmage,
quelle que soit son importance, est uniquement d au fait que les conditions de la
demande varient sans cesse et que les rsistances de frottement empchent la rali-
sation immdiate des ajustements de salaire devenus ncessaires
1
.
Le Professeur Pigou conclut (op. cit., p. 253) que le chmage est d avant tout
une politique de salaires qui ne russit pas s'adapter suffisamment aux modifica-
tions de la courbe de la demande relle de travail.
Il estime donc que l'ajustement des salaires peut la longue supprimer le
chmage
2
; nous prtendons au contraire que le salaire rel (dans la seule limite d'un
minimum fix par la dsutilit marginale de l'emploi) n'est pas dtermin au premier
chef par les ajustements de salaires (encore que ceux-ci puissent intervenir), mais
par les autres forces du systme. Parmi celles-ci il en est (notamment la relation entre
la courbe de l'efficacit marginale du capital et le taux de l'intrt) que le Professeur
Pigou n'est pas parvenu introduire dans son schme reprsentatif.
Enfin, lorsque le Professeur Pigou en arrive aux causes du chmage, il parle bien,
tout comme nous-mme, des fluctuations de l'tat de la demande. Mais il assimile
l'tat de la demande la courbe de la demande relle du travail, oubliant combien,
aux ternies de sa propre dfinition, cette notion est troite. Par dfinition, la courbe de
la demande relle de travail dpend exclusivement (nous l'avons vu plus haut) de deux
facteurs : 1 le rapport existant dans un milieu donn entre le nombre total d'hommes
employs et le nombre de ceux qui doivent tre employs dans les industries pro-
duisant les biens de consommation ouvrire pour leur fournir ce qu'ils consomment,
et 2 l'tat de la productivit marginale dans les industries qui produisent les biens de
consommation ouvrire. Cependant, dans la Ve partie de la Theory of Unemployment,
il attribue un rle important aux fluctuations de la demande relle de travail . Il
considre la demande relle de travail comme un facteur capable de varier forte-
ment dans la courte priode (op. cit., Part. V, Chap. VI-12), et il semble indiquer que
les oscillations de la demande relle de travail combines avec le dfaut de
sensibilit ces oscillations de l politique des salaires expliquent en grande partie le
cycle conomique. A premire vue, tout ceci parat au lecteur raisonnable et familier.
S'il ne se reporte pas la dfinition, les fluctuations de la demande relle de
travail voquent en lui le mme genre d'ides que nos fluctuations dans l'tat de la
demande globale. Mais, si l'on se reporte la dfinition, tout ceci cesse d'tre
1
Op. cit., p. 252.
2
On ne trouve d'ailleurs aucune allusion au fait que cet ajustement se ralise grce aux ractions du
taux de l'intrt.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 104
plausible. On dcouvre que ce facteur est la chose du monde la moins capable de
varier fortement dans la courte priode.
La demande relle de travail du Professeur Pigou ne dpend par dfinition que
de F(x), qui reprsente les conditions physiques de la production des biens de
consommation ouvrire, et de (x), qui reprsente la relation fonctionnelle entre
l'emploi dans les industries qui produisent les biens de consommation ouvrire et
l'emploi total qui lui correspond. On voit mal pourquoi l'une ou l'autre de ces fonc-
tions changerait, si ce n'est d'une faon progressive au cours de la longue priode. Il
n'y a certainement aucune raison de croire qu'elles puissent changer pendant un cycle
conomique. F(x) ne peut changer que lentement, et dans un sens favorable si la
communaut ralise des progrs techniques ; quant la fonction (x), elle reste
stable, moins qu'il ne se produise un brusque accs d'conomie dans les classes ou-
vrires ou, d'une manire plus gnrale, une brusque variation de la propension
consommer. Nous croirions donc que la demande relle de travail reste virtuellement
constante pendant toute la dure d'un cycle conomique. L'analyse du Professeur
Pigou, rptons-le, omet compltement le facteur instable, c'est--dire les fluctuations
de l'investissement, qui sont le plus souvent la base des fluctuations de l'emploi.
Nous avons critiqu longuement la thorie du chmage du Professeur Pigou, non
parce qu'elle nous semble plus critiquable que d'autres thories des conomistes
classiques, mais parce qu', notre connaissance elle reprsente le seul effort qui ait t
tent pour exposer avec prcision la doctrine de l'cole classique au sujet du ch-
mage. Nous nous devions de combattre cette doctrine sous la forme la plus redoutable
qui lui ait t donne.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 105
Livre V : Salaires nominaux et prix
Chapitre XX
La fonction de l'emploi
1
I
Retour la table des matires
La fonction de l'offre globale Z = (N), qui relie l'emploi au prix de l'offre
globale de la production, a t dfinie au Chapitre III (p. 47). La fonction de l'emploi
diffre uniquement de la prcdente parle fait que pratiquement elle en est la fonction
inverse et qu'elle est exprime en units de salaire. Son objet est d'tablir, soit dans
une entreprise ou une industrie donne, soit dans l'industrie tout entire, une relation
entre chaque montant de la demande effective et le volume de l'emploi pour lequel le
prix d'offre de la production est gal ce montant. Si un montant
SR D
, mesur en
units de salaire, de la demande effective intressant une entreprise ou une industrie
fait apparatre dans cette entreprise ou dans cette industrie un volume d'emploi
R N
,
la fonction de l'emploi s'crira
R R S N F D
r ( ). Ou, d'une manire plus gnrale,
s'il est lgitime de supposer qu' chaque montant
S D
de la demande effective totale
correspond une seule valeur de
Sr D
, la fonction de l'emploi pourra s'crire
1
Ceux qui ( juste titre) craignent l'algbre peuvent sauter la premire partie du chapitre sans perdre
grand chose.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 106
r r s N F D
( ). Autrement dit
r N
personnes seront employes dans l'industrie r,
lorsque la demande effective sera
s D
.
Dans le prsent chapitre nous exposerons certaines proprits de la fonction de
l'emploi. Mais, quel que soit l'intrt de ces proprits, la substitution de la fonction
de l'emploi la courbe habituelle de l'offre convient pour une double raison aux buts
et aux mthodes de ce livre. En premier lieu cette fonction dcrit les faits qui nous
intressent au moyen des seules units auxquelles nous avons dcid de nous en tenir,
l'exclusion de toute unit ayant un caractre quantitatif douteux. En second lieu elle
se prte mieux que la courbe habituelle de l'offre l'tude des problmes relatifs
l'industrie ou la production toute entire, en tant que distincts des problmes relatifs
une seule entreprise ou une seule industrie considre en des circonstances
donnes ; - et ce pour les raisons suivantes.
La courbe habituelle de la demande d'une marchandise particulire est trace dans
l'hypothse o les revenus du public sont d'un montant donn ; elle doit tre retrace
chaque fois que ces revenus varient. De mme la courbe habituelle de l'offre d'une
marchandise particulire est trace dans l'hypothse o la production de l'industrie
tout entire est d'un montant donn ; elle peut se modifier quand ce montant global
varie. Lorsqu'on examine la raction des industries individuelles aux variations de
l'emploi global, on se trouve donc ncessairement en prsence, dans chaque industrie,
non d'une seule courbe de la demande et d'une seule courbe de l'offre, mais d'un
ensemble de courbes appartenant ces deux familles et correspondant chacune
l'hypothse d'un volume donn de l'emploi global. Il est plus facile avec la fonction
de l'emploi d'obtenir une fonction exprimant dans l'industrie tout entire les variations
globales de l'emploi.
Supposons, comme premire tape, que l'on prenne comme donnes la propension
consommer ainsi que les autres facteurs considrs comme tels au chapitre XVIII,
et qu'on examine les variations de l'emploi rsultant des variations de l'investisse-
ment. Dans cette hypothse, tout montant de la demande effective mesure en
units de salaire correspondra un volume global de l'emploi, et la demande effective
sera divise dans une proportion dtermine entre la consommation et l'investisse-
ment. Chaque montant de la demande effective sera mme associ une certaine
rpartition du revenu. Il est donc raisonnable de supposer en outre qu' chaque mon-
tant de la demande effective correspondra une seule rpartition de cette demande
effective entre les diverses industries.
Ces hypothses permettent de dterminer le volume de l'emploi propre chaque
industrie qui correspond un volume donn de l'emploi global. En d'autres termes
elles permettent de connatre dans toute industrie particulire le volume de l'emploi
qui correspond chaque montant de la demande effective globale mesure en units
de salaires. Les conditions se trouvent ainsi remplies pour que la fonction de l'emploi
propre une industrie puisse tre mise sous la seconde (les formes indiques plus
haut,
r r s N F D
( ). Les fonctions individuelles de l'emploi ont alors l'avantage
d'tre additives. Autrement dit, le volume d'emploi qui, dans l'industrie tout entire,
correspond un certain montant de la demande effective est gal la somme des
volumes d'emploi qui, dans chaque industrie particulire, correspondent ce
montant :
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 107
F N
s r r s D N F D
( ) ( )
Dfinissons maintenant l'lasticit de l'emploi. Lorsque ce facteur se rapporte
une industrie donne, il s'crit
er
r
sr
sr
r
e
N
D
D
N
d
d
.
et mesure la raction du nombre des units de travail employes dans cette industrie
aux variations du nombre escompt des units de salaire qui seront dpenses pour
l'achat de sa production. Lorsque l'lasticit de l'emploi se rapporte l'industrie tout
entire, elle s'crit
er
S
S
e
D
D
dN
d N
.
Si on dispose d'une mthode satisfaisante pour mesurer la volume de la produc-
tion, il y a intrt dfinir aussi ce qu'on peut appeler l'lasticit de la production. Ce
facteur mesure l'accroissement relatif d volume accus par la production d'une
industrie, lorsque le montant, mesur en units de salaire, de la demande effective
dirige vers cette industrie croit,
qr
r
sr
sr
r
e
Q
D
D
Q
d
d
.
Si le prix peut tre suppos gal au cot premier marginal, il apparat que
ae
qr
r D
e
P
1
1
,
o
r P
reprsente le profit escompt
1
. En consquence, si
QR e
0, i. e. si la pro-
duction est parfaitement inlastique, on prvoit que l'accroissement d la demande
1
En effet, si
sr
p
est, exprim en units de salaires, le prix prvu d'une unit de production,
sr
sr r sr r r sr
D
p Q p Q Q p
+ ( )
+
sr
f
r r sr
D
Q
Q Q p
,
de sorte que
r sr
sr qr
Q p
D e
( ) 1
ou
sr
r sr
qr
D
Q p
e
1
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 108
effective (mesure en units de salaire) cherra entirement aux entrepreneurs sous
forme de profit, i. e. que
sr r D P
. Si au contraire eqr = 1, i. e. si l'lasticit de
la production est gale un, on prvoit qu'aucun supplment de profit ne rsultera de
l'accroissement de la demande effective, celui-ci tant totalement absorb par les
lments qui entrent dans le cot premier marginal.
De plus, si le volume de la production dans une industrie est une fonction ( )
r N
du travail qui y est employ, on a
1
1
2
qr
er
r r
st
r
e
e
N N
p
N
' ' ( )
[ ' ( )]
o
sr
p
est, en units de salaire, le prix prvu d'une unit de production. La condition
qr e
1 signifie donc que ' ' ( )
r N
0, i. e. que la productivit des units de travail
reste constante, lorsque l'emploi augmente.
Mais
r sr
sr
sr r
Q p
D
p Q
sr
r
D
Q
cot premier m inal ( arg )
r P
Par suite
sr
qr
r D
e
P
1
1
1
En effet, puisque la valeur marginale de la production est gale au salaire, on a
sr r
r
p Q
N
d d ou
sr
r
p
N
1
' ( )
,
or
sr
sr r
D
p Q
donc 1 +
sr
r
SR
r
sr
sr
p
Q
D
Q
p
D
d
d
d
d
+
1
]
1
1
sr
r
sr
r
r
r
r
sr
p
Q
D
Q
N
N
N
D
d
d d
d
d
1
' ( )
.
+
[ ]
1
]
1
1
1
qr
r
r
r
er
r
sr
e
Q
N
N
e
N
D
' ' ( )
' ( )
2
.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 109
Dans la mesure o la thorie classique suppose que les salaires rels sont toujours
gaux la dsutilit marginale du travail et que celle-ci crot en mme temps que
l'emploi, c'est--dire que, toutes choses gales d'ailleurs, l'offre de travail diminue
lorsque les salaires rels baissent, cette thorie suppose qu'en fait il est impossible
d'accrotre la dpense mesure en units de salaire. S'il en tait ainsi, le concept
d'lasticit de l'emploi n'aurait aucune application. Dans ce cas on ne pourrait pas
davantage augmenter l'emploi en accroissant le montant nominal de la dpense ; les
salaires nominaux augmenteraient dans la mme proportion et il n'y aurait en dfi-
nitive aucun accroissement de la dpense mesure en units de salaire ni par cons-
quent de l'emploi. S'il apparat au contraire que l'hypothse classique ne s'applique
pas, on peut, en accroissant le montant nominal de la dpense, augmenter l'emploi
jusqu' ce que les salaires rels atteignent l'tiage fix par la dsutilit marginale du
travail, c'est--dire jusqu'au point o, par dfinition, il y a plein emploi.
Ordinairement, bien entendu, la valeur de
qr e
est intermdiaire entre zro et un.
La mesure dans laquelle les prix (Mesurs en units de salaire) montent, i. e. dans
laquelle les salaires rels baissent, quand le montant nominal de la dpense crot,
dpend donc de l'lasticit de la production ragissant l'accroissement de la dpense
mesure en units de salaire.
Soit
pr e'
l'lasticit du prix escompt ragissant aux variations de la demande
effective a demande effective
sr D
i.e.
d
d
sr
sr
sr
sr
p
D
D
p
.
Puisque
r ae
rs
Q p
D
. , on a
d
d
d
d
r
sr
sr
r
S
sr
sr
sr
Q
D
D
Q
p
D
D
p
. . + 1
ou
pr qr e e '
+ 1
La somme des lasticits du prix et du volume de la production ragissant aux
variations de la demande effective (mesure en units de salaire) est gale un. La
variation de la demande effective est entirement absorbe par les variations qu'elle
suscite conformment cette loi dans le volume et dans le prix de la production.
Si on considre l'industrie tout entire et si on veut bien supposer qu'il existe une
unit permettant de mesurer la production dans son ensemble, le mme genre de
raisonnement s'applique. On a donc
p q e e
+ 1, o les lasticits -non affectes de
l'indice r se rapportent l'ensemble de l'industrie.
Mesurons maintenant les valeurs non plus en units de salaire mais en units de
monnaie, et tendons ce cas nos conclusions relatives l'industrie dans son
ensemble.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 110
Si S reprsente le salaire nominal d'une unit de travail et p le prix nominal es-
compt d'une unit de la production globale, on peut dsigner par
p
dp
e
D
pdD
_
,
l'las-
ticit des prix nominaux, et par
s e
DdS
SdD
_
,
l'lasticit du salaire nominal, ragissant aux variations de la demande effective
mesure en monnaie. On dmontre alors facilement que
p q s e e e
1 1 ( )
1
.
Nous verrons dans le chapitre suivant que cette quation constitue une premire
tape vers une forme gnrale de la Thorie Quantitative de la Monnaie. Si
q e
0 ou
si
s e
1, le volume de la production ne varie pas, lorsque le montant nominal de la
demande effective crot; et les prix croissent dans la mme proportion. Sinon ils
croissent dans une proportion moindre.
II
Revenons maintenant la fonction de l'emploi. Nous avons suppos jusqu' pr-
sent qu' tout niveau de la demande effective globale correspondait une seule rparti-
tion de cette demande entre les produits des diverses industries particulires. Or,
quand le montant de la dpense globale varie, le montant correspondant de la dpense
portant sur les produits d'une industrie particulire ne varie pas en gnral dans la
1
Puisque p S
s
p
. et D S
s D
. , on a
p S
p
S
S
s
p
+
+ S
p
S
S
p
s
s
S e
p
D
D
.
'
+
p e
p
D
D
D
S
S
p
S
S
'
( )
+
p p e e
p
D
D S
p
S
' '
( ) 1
de sorte que
p p p e e e
D p
p D
D
p D
S p
S
+
' '
.
.
( ) 1
+
p s p e e e ' '
( ) 1
1 1
q x e e
( )
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 111
mme proportion. D'abord les individus n'augmentent pas dans une gale proportion,
quand leurs revenus croissent, les sommes qu'ils consacrent l'achat des produits de
chaque industrie. Ensuite les prix des diverses marchandises ragissent ingalement
aux variations de la dpense dont elles sont l'objet.
L'hypothse que les variations de l'emploi dpendent uniquement des variations
de la demande effective (mesure en units de salaire), hypothse sur laquelle nous
avons fond jusqu'ici notre raisonnement, n'a donc que la valeur d'une premire ap-
proximation, lorsqu'on admet qu'il y a plus d'une manire de dpenser un accroisse-
ment de revenu. La rpartition prvue d'un accroissement de demande globale entre
les diverses marchandises peut en effet influer grandement sur le volume de l'emploi.
Par exemple, si la demande supplmentaire est en grande partie dirige vers des in-
dustries possdant une forte lasticit de l'emploi, l'accroissement global de l'emploi
sera plus grand que si elle est dirige vers des industries possdant une faible las-
ticit de l'emploi.
De mme l'emploi peut flchir sans que la demande globale varie, si l'orientation
de la demande change au bnfice des industries o comparativement l'lasticit de
l'emploi est faible.
Ces considrations revtent une importance particulire lorsque on a affaire des
phnomnes de courte priode, c'est--dire des variations du montant ou de l'orien-
tation de la demande qui n'ont pas t prvues quelque temps l'avance. La pro-
duction de certaines richesses exige du temps et il est pratiquement impossible d'en
accrotre l'offre dans un court dlai. Si, en l'absence de pravis, la demande addi-
tionnelle est dirige vers une richesse de cette nature, sa production tmoignera d'une
faible lasticit de l'emploi, alors mme que son lasticit de l'emploi et t voisine
de un dans le cas d'un pravis donn assez longtemps l'avance.
C'est cet gard que l'ide d'une priode de production nous parait avoir le plus
d'importance. A notre avis
1
, il vaudrait mieux dire qu'une richesse une priode de
production n, lorsque les entrepreneurs doivent tre prvenus des variations de sa
demande n units de temps l'avance. pour que sa production ait une lasticit de
l'emploi maximum. Il est vident qu'en ce sens la priode de production la plus
longue est celle des biens de consommation pris dans leur ensemble, puisqu'ils appa-
raissent au dernier stade de toute opration productive. Par consquent, si l'expansion
de la demande effective a pour cause premire un accroissement de la consommation,
la valeur initiale de l'lasticit de l'emploi sera spare de sa valeur ventuelle
d'quilibre par un cart plus grand que si la cause premire est une augmentation de
l'investissement. En outre, si la demande additionnelle est dirige vers des industries
possdant une lasticit de l'emploi comparativement faible, une proportion plus forte
de cette demande ira grossir les revenus des entrepreneurs, et une proportion plus
faible les revenus des salaris et des autres facteurs entrant dans le cot premier ; les
rpercussions pourront alors se montrer un peu moins favorables la dpense, puis-
que les entrepreneurs pargneront probablement une Partie de leur supplment de
revenu suprieure celle qu'eussent pargne les salaris. Nanmoins la diffrence
entre les deux cas ne doit pas tre exagre ; les ractions y sont en grande partie les
mmes
2
.
1
Cette dfinition n'est pas la mme que la dfinition habituelle, mais elle nous parat contenir ce
qu'il y a d'important dans l'ide.
2
On trouvera dans le Treatise on Money, Livre IV, un examen plus approfondi de cette question.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 112
Si longtemps l'avance que les entrepreneurs soient prvenus d'une variation pro-
bable de la demande, il n'est pas possible, en cas d'un accroissement donn de l'inves-
tissement, que la valeur initiale de l'lasticit de l'emploi soit aussi forte que sa valeur
ventuelle d'quilibre, moins qu'il existe tous les stades de la production des exc-
dents de stocks et de capacit productrice. La rsorption des excdents de stocks
affaiblit d'ailleurs l'accroissement global de l'investissement. Si on suppose qu' l'ori-
gine il existe des excdents tous les stades de la production, l'lasticit initiale de
l'emploi pourra tre voisine de un ; plus tard, lorsque les stocks auront t puiss et
avant qu'une offre supplmentaire suffisante apparaisse dans les premiers stades de la
production, l'lasticit de l'emploi dclinera ; puis elle tondra de nouveau vers un
lorsqu'on approchera de la nouvelle position d'quilibre. Cette rgle admet d'ailleurs
des attnuations; d'abord dans la mesure o il existe des facteurs de rente qui absor-
bent une partie grandissante de la dpense lorsque l'emploi augmente; et ensuite dans
le cas o le taux de l'intrt s'lve. Pour ces raisons une parfaite stabilit des prix
n'est pas possible dans une conomie mouvante, sauf toutefois s'il existe un mcanis-
me particulier qui dtermine dans la propension consommer des fluctuations tempo-
raires ayant exactement l'ampleur voulue. Mais l'instabilit des prix qui nat de cette
faon ne saurait faire apparatre le genre de profit dont l'action stimulante peut engen-
drer une capacit excessive de production. La totalit du gain imprvisible choit en
effet aux entrepreneurs qui, dans un stade relativement avanc de la production, se
trouvent avoir des marchandises ; ceux qui ne disposent pas des ressources ncessai-
res les produire n'ont aucun moyen d'attirer . eux cette sorte de gain. L'invitable
instabilit des prix due aux changements de la demande globale ne peut donc influer
sur les actes des entrepreneurs, elle ne fait que procurer une vritable aubaine aux
plus heureux d'entre eux (mutatis mutandis lorsqu'on suppose une variation de sens
contraire). Ceci nous parat avoir t mconnu dans certaines rcentes controverses
relatives aux modalits pratiques d'une politique de stabilisation des prix. Il est exact
que dans une socit mouvante une telle politique ne saurait connatre un plein suc-
cs. Mais il ne s'ensuit pas qu'une faible atteinte temporaire la stabilit des prix
dclenche ncessairement un dsquilibre effet cumulatif.
III
Nous avons dmontr que, en cas d'insuffisance de la demande effective, la main-
d'uvre est sous-employe, en ce sens qu'il y a des hommes sans emploi dsireux de-
travailler pour un salaire rel infrieure celui qui existe. A mesure que la demande
effective crot, l'emploi augmente donc, sur la base d'un salaire rel gal ou infrieur
au taux existant, jusqu' ce qu'il ne reste plus de main-d'uvre dispose travailler
pour le salaire rel alors en vigueur, c'est--dire jusqu' un point o il n'y a plus
d'hommes disponibles (ou d'heures de travail disponibles), sauf si ( partir de ce
point) les salaires nominaux montent plus vite que les prix. Une fois ce -point atteint,
qu'arrivera-t-il si la dpense continue crotre ? C'est ce que nous allons maintenant
examiner.
Jusqu'au point considr la diminution de rendement qui accompagnait l'augmen-
tation de la main-duvre affecte un quipement donn tait compense par la
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 113
baisse de salaire rel dont elle saccommodait, Mais au del de ce point, pour dcider
une unit supplmentaire de main-d'uvre travailler, il faudrait lui offrir l'quiva-
lent d'une quantit plus grande de richesses, alors que l'emploi d'une unit suppl-
mentaire de main-d'uvre ne permet de produire qu'une quantit plus petite de riches-
se. L'quilibre rigoureux exige donc que les salaires et les prix, et aussi par cons-
quent les profits, augmentent tous dans la mme proportion que la dpense; la posi-
tion relle , comprenant le volume de la production et de l'emploi, n'tant alors
aucunement change. Ceci signifie qu'on a atteint une situation o la Thorie Quanti-
tative de la Monnaie sous sa forme grossire est pleinement vrifie (la vitesse de
circulation tant entendue dans le sens de vitesse de transformation en revenu), car le
volume de la production reste invariable, et les prix montent dans une mesure
exactement proportionnelle M. V.
Toutefois cette conclusion appelle dans la pratique certaines rserves qu'il faut
avoir-prsentes l'esprit lorsqu'on l'applique un cas concret :
1 La hausse des prix, par les illusions qu'elle fait natre chez les entrepreneurs,
peut les amener au moins pendant un certain temps accrotre l'emploi au del du
volume qui porte au maximum leurs profits individuels mesurs en richesse relle. Ils
sont tellement habitus voir dans l'augmentation du produit nominal de la vente
le signal d'un dveloppement de la production qu'ils peuvent agir de mme lorsque
cette politique a cess d'tre pour eux la plus profitable ; il est possible, autrement dit,
que dans le cadre des prix nouveaux ils sous-estiment leur cot d'usage marginal.
2 Puisque la partie de son profit que l'entrepreneur est oblig de cder au rentier
se mesure en monnaie par une somme constante, la hausse des prix, mme si elle
n'est accompagne d'aucune variation du volume de la production, entrane au profit
de l'entrepreneur et au dtriment du rentier un transfert de revenu qui peut ragir sur
la propension consommer. Cette tendance ne se manifeste pas seulement partir du
moment o le plein emploi est atteint ; elle se dveloppe d'une faon rgulire pen-
dant la priode d'accroissement de la dpense. Si le rentier est moins enclin dpen-
ser que l'entrepreneur, le flchissement progressif de son revenu rel signifie que le
plein emploi exigera une augmentation de la quantit de monnaie et une rduction du
taux de l'intrt moindres que dans le cas contraire. Une fois le plein emploi atteint,
une nouvelle hausse des prix signifie dans le premier cas qu'il faudra relever quelque
peu le taux de l'intrt pour que les prix ne montent pas indfiniment, et que l'accrois-
sement relatif de la quantit de monnaie sera infrieur celui de la dpense ; dans
l'autre cas c'est le contraire qui sera vrai. Un moment peut d'ailleurs arriver,, pendant
que le revenu rel du rentier dcline, o, par suite de l'aggravation de sa pauvret
relative, on passe de l'un l'autre cas; ce moment peut se situer soit avant soit aprs
l'apparition du plein emploi.
IV
Peut-tre y a-t-il quelque chose d'un peu troublant dans l'asymtrie qui se mani-
feste entre l'Inflation et la Dflation. Tandis qu'une inflation de la demande effective
au del du montant qui correspond au plein emploi agit exclusivement sur les prix,
une dflation de la demande effective en de de ce montant entrane concurremment
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 114
la baisse de l'emploi et des prix. Pourtant cette asymtrie dcoule simplement du fait
que la main-d'uvre est toujours capable de refuser un supplment d'effort lorsque le
volume de l'emploi est suffisant pour que le salaire rel tombe au-dessous de la
dsutilit marginale du travail, alors qu'elle n'a pas le pouvoir de dcider qu'il lui sera
offert de l'emploi en quantit suffisante pour empcher le salaire rel d'tre suprieur
la dsutilit marginale du travail.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 115
Livre V : Salaires nominaux et prix
Chapitre XXI
La thorie des prix
I
Retour la table des matires
Tant que les conomistes s'occupent de ce qu'on appelle la Thorie de la Valeur,
ils ont coutume d'enseigner que les prix sont rgis par les conditions de l'offre et de la
demande. Les variations du cot marginal, notamment, et l'lasticit de l'offre dans la
courte priode jouent dans leur formation un rle prpondrant. Mais, lorsque dans
un tome II ou plus souvent dans un ouvrage spar, ces conomistes abordent la
Thorie de la Monnaie et des Prix, on n'entend plus parler de ces notions simples sans
doute, mais faciles comprendre. On volue dans un monde o les prix sont
gouverns par la quantit de monnaie, par sa vitesse de transformation en revenu, par
le rapport entre la vitesse de circulation et le -volume des transactions, parla thsauri-
sation, par l'pargne force, pur l'inflation et la dflation, et tous autres facteurs du
mme ordre. Jamais ou presque jamais on n'a tent de rattacher ces expressions plus
vagues nos anciens concepts d'lasticit de J'offre et de la demande.. Lorsqu'on
rflchit aux thories qui nous ont t enseignes et qu'on essaye de leur donner une
forme rationnelle, dans les analyses les plus simples on constate que l'lasticit de
l'offre est considre comme nulle, et la demande comme proportionnelle - la quan-
tit de monnaie ; dans les analyses plus savantes, on se perd dans un brouillard o
rien n'est clair et o tout est possible. Il nous est arriv tous de nous trouver tantt
dans un nuage tantt dans un autre, sans savoir quel espace les spare ou quel trajet
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 116
les relie, la forme de notre existence de veilles et de notre existence de songes consti-
tuant, apparemment, leur seule relation
Au cours des chapitres prcdents nous avons cherch nous vader de cette
double existence et rtablir une troite connexit entre la Thorie des Prix dans leur
ensemble et celle de la Valeur. La division de l'conomie en Thorie de la Valeur et
de la Distribution d'une part et en Thorie de la Monnaie de l'autre nous parat impro-
pre. La division correcte serait, notre avis, d'envisager d'abord la Thorie de
l'Entreprise ou de l'Industrie individuelle, la Thorie de la Rpartition d'une quantit
donne de ressources entre les diffrents usages et celles de la Rmunration de ces
ressources, et ensuite la Thorie de la Production et de l'Emploi dans leur ensemble.
Tant qu'on s'en tient l'tude de l'industrie ou de l'entreprise individuelle en suppo-
sant la quantit globale des ressources employes constante et en admettant provisoi-
rement que les conditions des autres entreprises ou des autres industries restent
inchanges, il est exact que les proprits caractristiques de la monnaie n'ont pas
intervenir. Mais lorsqu'on s'attaque la recherche des facteurs qui dterminent les
volumes globaux de la production et de l'emploi, la Thorie complte d'une cono-
mie Montaire devient indispensable.
Peut-tre la ligne de sparation pourrait-elle encore tre place entre la thorie de
l'quilibre stationnaire et la thorie de l'quilibre mouvant, i. e. la thorie d'un syst-
me o les variations des vues sur l'avenir peuvent influer sur la situation prsente ;
car l'importance de la monnaie dcoule essentiellement du fait qu'elle constitue un
lien entre le prsent et l'avenir. On examinerait d'abord la rpartition des ressources
entre les divers usages que les motifs conomiques normaux feraient prvaloir en tat
d'quilibre, si les vues sur l'avenir taient dans tous les domaines sres et invariables.
Une subdivision serait peut-tre faite entre une conomie immuable et une conomie
qui pourrait changer, mais dans laquelle tout serait prvu depuis l'origine. De cette
analyse simplifie on passerait aux problmes du monde rel, o les prvisions
passes peuvent se rvler fausses et o l'avenir escompt influe sur les actes pr-
sents. C'est aprs cette transition qu'il conviendrait d'introduire dans les calculs les
particularits de la monnaie en tant que lien rattachant le prsent l'avenir. Mais, bien
que la thorie de l'quilibre mouvant doive ncessairement tre conue dans le cadre
d'une conomie montaire, elle n'en reste pas moins une thorie de la valeur et de la
distribution et ne peut tre considre comme une thorie de la monnaie indpen-
dante. La monnaie, envisage dans ses attributs spcifiques, est par-dessus tout un
procd subtil permettant de relier le prsent au futur; sans elle on ne pourrait mme
pas commencer l'analyse de l'effet produit sur les activits courantes par des prvi-
sions changeantes. C'est en vain qu'on chercherait s'en dbarrasser en liminant l'or,
l'argent et les moyens lgaux de paiement. Tant qu'il subsistera un type de richesse
durable, il sera susceptible de possder les attributs de la monnaie
1
et pourra donner
naissance aux problmes qui caractrisent l'conomie montaire.
1
Cf. le Chapitre XVII.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 117
II
Dans une industrie particulire le niveau des prix dpend en partie du taux de
rmunration des facteurs de production qui entrent dans le cot marginal et en partie
de l'chelle de production. Il n'y a aucune raison de modifier cette conclusion
lorsqu'on envisage l'industrie dans son ensemble. Le niveau gnral des prix dpend
en partie du taux de rmunration des facteurs de production entrant dans le cot
marginal et en partie de l'chelle globale de la production, i. e. du volume de l'emploi
(l'quipement et la technique tant pris comme donnes). Il est vrai que, lorsqu'on
considre la production dans son ensemble, les cots de production dans chaque
industrie sont en partie fonction du volume de la production dans les autres
industries. Mais la diffrence principale, celle qu'on ne peut ngliger, c'est que les
variations de la demande agissent la fois sur les cots et sur le volume de la pro-
duction. Lorsqu'on tudie la demande dans son ensemble, et non plus celle d'un seul
produit prise isolment dans l'hypothse o la demande globale ne varie pas, c'est
donc du ct de la demande que des ides entirement nouvelles doivent tre
introduites.
III
Supposons d'abord, titre de simplification, que les taux de rmunration des
divers facteurs de production entrant dans le cot marginal varient tous dans une pro-
portion gale, c'est--dire dans la mme proportion que l'unit de salaire. Le niveau
gnral des prix dpendra alors (l'quipement et la technique tant pris comme
donnes) en partie de l'unit des salaires et en partie du volume de l'emploi. L'effet
des variations de la quantit de monnaie sur le niveau des prix pourra donc tre consi-
dr comme la somme des effets produits par ces variations sur l'unit de salaire et
sur l'emploi.
Afin de mettre en lumire les ides contenues dans cette proposition, simplifions
encore nos hypothses. Supposons : 1 que les ressources inemployes soient toutes
homognes et interchangeables en ce qui concerne leur aptitude produire ce dont on
a besoin; 2 que les facteurs de production entrant dans le cot marginal se contentent
d'un mme salaire nominal tant qu'ils ne sont pas tous employs. Les rendements
seront alors constants et l'unit de salaire sera rigide, aussi longtemps qu'il restera des
facteurs inemploys. Tant qu'il subsistera du chmage, l'accroissement de la quantit
de monnaie ne produira donc aucun effet sur les prix ; toute augmentation qui en
rsultera dans la demande effective se traduira par une augmentation exactement pro-
portionnelle de l'emploi. Aussitt que le plein emploi sera atteint, ce sont, au con-
traire, l'unit de salaire et les prix qui s'lveront dans une mesure exactement propor-
tionnelle l'augmentation de la demande effective. Par suite, si l'offre demeure par-
faitement lastique tant qu'il subsiste du chmage, et devient parfaitement inlastique
ds que le plein emploi est atteint, si d'autre part la demande effective varie dans la
mme proportion que la quantit de monnaie, la Thorie Quantitative de la Monnaie
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 118
peut tre nonce dans les termes suivants: Tant qu'il existe du chmage, l'emploi
varie proportionnellement la quantit de monnaie ; lorsque le plein emploi est ra-
lis, les prix varient proportionnellement la quantit de monnaie .
Ayant ainsi sacrifi l'usage en introduisant assez d'hypothses simplificatrices
pour tre mme d'noncer une Thorie Quantitative de la Monnaie, examinons les
diverses complications qui, en fait, peuvent influer sur les vnements :
1 Les variations de la demande effective ne sont pas exactement proportionnelles
celles de la quantit de monnaie.
2 Les ressources n'tant pas homognes, les rendements n sont pas constants,
mais diminuent lorsque l'emploi augmente.
3 Les ressources n'tant pas interchangeables, l'offre de certaines richesses
devient inlastique alors qu'il reste des ressources inemployes capables de servir la
production d'autres richesses.
4 L'unit de salaire tend crotre avant que le plein emploi soit atteint.
5 Les rmunrations des facteurs entrant dans le cot marginal ne varient pas
toutes dans la mme proportion.
Il faut donc examiner en premier lieu l'effet produit par les variations de la
quantit de monnaie sur le montant de la demande effective. L'augmentation de la
demande effective se traduit en rgle gnrale, partie par l'augmentation de l'emploi
et partie parla hausse des prix. Dans la ralit les prix, au lieu d'tre constants
lorsqu'il existe du chmage et d'augmenter proportionnellement la quantit de mon-
naie lorsque le plein emploi est ralis, montent progressivement mesure que l'em-
ploi augmente. La Thorie des Prix, i. e. l'analyse de la relation entre la quantit de
monnaie et le niveau des prix, qui permet de dterminer l'lasticit des prix ragissant
aux variations de la quantit de monnaie, roulera donc sur les cinq difficults
numres ci-dessus.
Nous les examinerons tour tour. Mais cette mthode ne doit pas nous faire sup-
poser qu'elles soient strictement parler indpendantes. La relation entre la quantit
de la monnaie et le montant de la demande effective peut tre influence, par exem-
ple, par la proportion dans laquelle une augmentation de la demande effective partage
son effet entre l'accroissement de l'emploi et la hausse des prix, ou encore par les
diffrences entre les variations relatives des rmunrations alloues aux divers
facteurs de production. Le but de notre analyse n'est pas de fournir un systme auto-
matique, i. e. une recette qui, applique les yeux ferms, donne une rponse infail-
lible, mais de nous munir d'une mthode organise et ordonne permettant de rsou-
dre les problmes particuliers. Lorsque nous avons obtenu une conclusion provisoire
en examinant les difficults une une, il faut revenir sur nos pas et tenir compte,
autant que possible, des ractions probables des lments de complication les uns sur
les autres. Telle est la nature du raisonnement conomique. Toute autre faon d'appli-
quer nos principes essentiels de raisonnement (sans lesquels nous serions en tout cas
perdus dans la nuit) nous induirait en erreur. Les mthodes pseudo-mathmatiques,
comme celle que nous dcrirons dans la section VI - qui donnent une figuration
symbolique d'un systme d'analyse conomique - ont le grave dfaut de supposer
expressment l'indpendance rigoureuse des facteurs qu'elles utilisent et de perdre
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 119
leur force et leur autorit lorsque cette hypothse n'est pas vrifie. Dans le raisonne-
ment ordinaire, o nous n'avanons pas les yeux ferms mais o, au contraire, nous
savons tout moment ce que nous faisons et ce que les mots signifient, nous pouvons
garder derrire la tte Ies rserves ncessaires ainsi que les attnuations et les
adaptations que nous aurons faire par la suite, alors qu'il n'est pas possible de
transporter de la mme manire des diffrentielles partielles complexes en marge
de plusieurs pages d'algbre o on les suppose toutes nulles. Trop de rcentes
conomies mathmatiques ne sont que pures spculations; aussi imprcises que
leurs hypothses initiales, elles permettent aux auteurs d'oublier dans le ddale des
symboles vains et prtentieux les complexits et les interdpendances du monde rel.
IV
L'effet premier d'une variation de la quantit de monnaie sur le montant. de la
demande effective rsulte de son influence sur le taux de l'intrt. Si cette raction
tait la seule qui intervint, son effet quantitatif pourrait tre connu ait moyen des trois
lments suivants : a) la courbe de la prfrence pour la liquidit qui indique de
combien le taux de l'intrt doit baisser pour que la monnaie nouvelle soit absorbe
par les personnes dsireuses de conserver de l'argent liquide ; b) la courbe de l'effi-
cacit marginale du capital qui indique de combien un flchissement donn du taux
de l'intrt augmente l'investissement, et c) le multiplicateur d'investissement qui
indique de combien une augmentation donne de l'investissement accrot la demande
effective globale.
Une telle analyse a le mrite d'introduire de l'ordre et de la mthode dans le
problme, mais elle serait d'une simplicit fallacieuse si on oubliait que les trois
facteurs a), b) et c) sont eux-mmes influencs par les difficults 2), 3), 4) et 5), qui
n'ont pas encore t examines ; la courbe de la prfrence pour la liquidit dpend en
effet de la quantit de monnaie nouvelle absorbe par les besoins des paiements
commerciaux et privs, quantit qui dpend elle-mme de l'accroissement de la
demande effective et de la manire dont il est rparti entre la hausse des prix, la
hausse des salaires, et l'augmentation de la production et de l'emploi. Quant la
courbe de l'efficacit marginale, elle dpend en partie de l'effet que les circonstances
accompagnant l'augmentation de la quantit de monnaie produisent sur la prvision
des perspectives montaires futures. Le multiplicateur enfin est influenc par la faon
dont le revenu nouveau cr par l'augmentation de la demande effective est rparti
entre les diffrentes classes de consommateurs. Encore s'en faut-il que cette liste
contienne toutes les ractions possibles. Nanmoins, si on prend en considration tous
les faits qui interviennent, on dispose d'un nombre suffisant d'quations simultan-
ment satisfaites pour fournir un rsultat dtermin. Il existera un accroissement de la
demande effective d'un montant dtermin qui, compte tenu de tous les facteurs en
jeu, correspondra et fera quilibre l'accroissement de la quantit de monnaie. De
plus il faudrait des circonstances trs exceptionnelles pour qu'une augmentation de la
quantit de monnaie s'accompagne d'une diminution de la demande effective.
Le rapport entre le montant de la demande, effective et la quantit de monnaie
s'apparente troitement ce qu'on appelle souvent la vitesse de transformation de la
monnaie en revenu - encore que la demande effective ne corresponde pas au revenu
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 120
dj ralis mais au revenu dont l'attente a t le motif de la production, et que d'autre
part elle soit gale au revenu brut et non au revenu net. Mais la vitesse de
transformation de la monnaie en revenu n'est en soi qu'un terme qui n'explique rien.
Il n'y a aucune raison de croire qu'elle doive tre constante ; l'analyse prcdente
prouve qu'elle dpend d'un grand nombre de facteurs complexes et variables. L'em-
ploi de cette expression obscurcit, notre avis, la nature relle de l'enchanement
causal et n'a t en fait qu'une source de confusion.
2 Ainsi que nous l'avons expos prcdemment (p. 61). la distinction entre les
rendements dcroissants et les rendements constants dpend en partie du mode de
rmunration de la main-duvre. Si le salaire est strictement proportionnel au rende-
ment, le cot du travail (exprim en units de salaire) est constant quand l'emploi
augmente. Si au contraire le salaire d'une certaine classe de travailleurs est uniforme
quel que soit le rendement des individus, le cot du travail monte indpendamment
de la diminution d'efficacit de l'quipement. Lorsque en outre l'quipement n'est pas
homogne et que l'emploi de certaines de ses parties se traduit par un cot premier
plus lev par unit de production, l'augmentation des cots premiers marginaux est
suprieure celle qui rsulterait de la seule hausse du cot du travail.
En rgle gnrale le prix d'offre a donc tendance monter lorsque la production
obtenue l'aide d'un quipement donn augmente. Il en rsulte qu'en dehors de toute
variation de l'unit de salaire l'accroissement de la production s'accompagne d'une
hausse des prix.
3 Nous avons vu au 2 qu'il tait possible que l'offre ne ft pas entirement
lastique. S'il y avait un quilibre parfait dans la rpartition quantitative entre les
diffrentes branches de la production des ressources spcialises non employes, le
plein emploi apparatrait en mme temps dans toutes ces branches. Mais, en gnral,
la demande de certaines marchandises et de certains services atteint un montant o
leur offre perd pour un temps toute son lasticit alors qu'en d'autres branches de
l'industrie il reste un reliquat apprciable de ressources inemployes. A mesure que la
production augmente on parvient successivement une srie d' tranglements , o
l'offre de certaines richesses cesse d'tre lastique et o leurs prix sont obligs de
monter autant qu'il faut pour dtourner la demande vers d'autres objets.
Il est peu probable que l'accroissement de la production s'accompagne d'une
hausse sensible du niveau gnral des prix tant qu'on dispose de ressources disponi-
bles non employes de toutes les catgories. Mais, quand la production s'est suffisam-
ment accrue pour atteindre la zone des tranglements , il faut au contraire s'atten-
dre une forte hausse du prix de certaines richesses.
Dans ce paragraphe, comme dans le prcdent, l'lasticit de l'offre est en partie
fonction du temps. Si on considre une priode assez longue pour que le volume de
l'quipement lui-mme varie, les lasticits de l'offre seront sensiblement plus fortes
la fin de la priode. Une variation modre de la demande effective, survenant une
poque o le chmage est considrable, peut donc se traduire principalement par
l'augmentation de l'emploi et dans une mesure trs limite par la hausse des prix.
D'autre part, lorsqu'une variation plus forte qui n'a pas t prvue fait apparatre pour
un temps certains tranglements , elle agit plus sur les prix et moins sur l'emploi
au dbut que par la suite.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 121
4 Le fait que l'unit de salaire puisse accuser une tendance la hausse avant
qu'on ait atteint le plein emploi appelle quelques commentaires ou explications. Puis-
que chaque groupe de travailleurs tire avantage, toutes choses restant gales, d'une
hausse de ses propres salaires, il s'exerce naturellement, de la part de la main-duvre
dans son ensemble, une pression dans le sens de la hausse, laquelle les entrepre-
neurs cdent plus volontiers lorsqu'ils font de meilleures affaires. C'est pour cela que
normalement toute augmentation de la demande effective est en partie utilise satis-
faire la tendance de l'unit de salaire la hausse.
Outre le point critique ultime du plein emploi, o un accroissement de la demande
effective exprime en monnaie entrane une hausse des salaires nominaux pleinement
proportionnelle la hausse des prix des biens de consommation ouvrire, il existe
donc une succession de points semi-critiques pralables, o l'accroissement de la
demande effective dtermine une hausse des salaires nominaux non entirement pro-
portionnelle celle der, biens de consommation ouvrire ; et il en va de mme en cas
d'une diminution de la demande effective. Dans la pratique, l'unit de salaire expri-
me en monnaie ne ragit pas d'une faon continue aux faibles mouvements de la
demande effective; les variations sont discontinues, et les points de discontinuit
dpendent de l'tat d'esprit des ouvriers et de la politique des employeurs et des
syndicats. Dans un systme ouvert, o ces points correspondent une variation du
cot des salaires par rapport l'tranger, et dans un cycle commercial, o, mme au
sein d'un systme ferm, ils marquent une variation par rapport aux cots escompts
des salaires dans l'avenir, leur importance pratique peut tre considrable. D'un
certain point de vue on estimera peut tre que ces points, o un nouvel accroissement
de la demande effective est de nature causer une hausse discontinue de l'unit de
salaire, jalonnent des tats de semi-inflation offrant une certaine analogie ( vrai (lire
trs imparfaite) avec l'inflation absolue, laquelle rsulte d'un accroissement de la
demande effective en situation de plein emploi (cf. p. 318 ci-dessous). Sur le plan
historique l'importance de ces points est certaine, mais sur le plan thorique ils se
prtent mal la gnralisation.
5 Notre premire simplification a consist supposer que les rmunrations des
divers facteurs entrant dans le cot marginal variaient toutes dans la mme propor-
tion. Mais en fait les rmunrations normales des diffrents facteurs de production
prsentent des degrs diffrents de rigidit. En outre l'offre de chacun de ces facteurs
peut ragir avec une lasticit ingale aux variations de la rmunration nominale
offerte. N'taient ces motifs, on pourrait dire que le niveau des prix est la rsultante
de deux facteurs, l'unit de salaire et le volume de l'emploi.
Parmi les lments du cot premier marginal susceptibles de varier dans une
proportion diffrente de l'unit de salaire et dans des limites beaucoup plus tendues.,
peut-tre le plus important est-il le cot d'usage marginal. Ce cot peut augmenter
fortement quand l'emploi commence crotre, si (comme c'est probable) l'augmenta-
tion de la demande effective provoque un changement rapide de l'opinion prdomi-
nante au sujet de la date laquelle il sera ncessaire. de remplacer l'quipement.
Bien que ce soit une premire approximation souvent fort utile de supposer que
les rmunrations des facteurs entrant dans le cot premier marginal varient toutes
dans la mme proportion que l'unit de salaire, il vaudrait sans doute mieux consid-
rer une moyenne pondre de ces rmunrations, que l'on appellerait l'unit de cot.
Ainsi l'unit de cot ou, sous le bnfice de l'approximation prcdente, l'unit de
salaire peut tre regarde comme l'talon de valeur essentiel. D'ans un tat donn de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 122
la technique et de l'quipement, le niveau des prix dpend en partie de l'unit de cot
et en partie de l'chelle de production et, en vertu du principe des rendements
dcroissants dans la courte priode, sa variation relative quand la production augmen-
te est suprieure celle de l'unit de cot. Le plein emploi est ralis lorsque la pro-
duction atteint le montant o le volume marginal produit par une unit reprsentative
des facteurs de production tombe au minimum ncessaire pour que ces facteurs
s'offrent en nombre suffisant pour le produire.
V
Lorsqu'un nouvel accroissement du montant de la demande effective ne produit
plus de nouvelle augmentation du volume de la production et se traduit par un ac-
croissement de l'unit de cot qui lui est pleinement proportionnel, on est parvenu
un tat qu'on peut proprement qualifier d'inflation vritable. Jusque l l'effet de
l'expansion montaire tait une pure affaire de degr. En aucun point antrieur on
n'aurait pu tracer une ligne dfinie et dclarer qu'un tat d'inflation s'tait tabli. Une
augmentation de la quantit de monnaie, pour autant qu'elle agissait sur la demande
effective, se traduisait en partie par une hausse de l'unit de cot et en partie par une
augmentation de la production.
Une certaine asymtrie se manifeste donc entre les deux .zones spares par le
point critique o l'inflation vritable apparat. En de de ce point une contraction de
la demande effective, mesure en units montaires, rduit son montant en units de
cot, tandis qu'au del de ce point une expansion de la demande effective ne se
traduit, en gnral, par aucune augmentation de son montant mesur en units de
cot. Ce rsultat dcoule de l'hypothse que les facteurs de production, la main-
d'uvre notamment, cherchent rsister la rduction des rmunrations nominales
et qu'il n'existe aucun motif analogue faisant obstacle l'accroissement de ces
rmunrations. Une telle hypothse est videmment confirme par les faits, car une
variation qui n'a pas un caractre gnral entrane pour les facteurs qu'elle touche un
bnfice s'il s'agit d'une hausse et un prjudice s'il s'agit d'une baisse.
Si les salaires nominaux devaient au contraire baisser sans limite chaque fois
qu'on tend s'carter du plein emploi, l'asymtrie, il est vrai, disparatrait. Mais dans
ce cas il n'y aurait au-dessous du plein emploi aucune position d'quilibre possible
tant que le taux de l'intrt pourrait encore baisser ou que les salaires ne seraient pas
nuls. En fait il est obligatoire que, dans un systme montaire, il y ait un certain
facteur dont la valeur exprime en monnaie soit rigide, sinon fixe, pour donner quel-
que stabilit aux valeurs.
L'ide que toute augmentation de la quantit de monnaie est une inflation (si
inflation ne signifie-pas simplement une hausse des prix) est lie l'hypothse de
base de la thorie classique, d'aprs laquelle on serait toujours dans une situation o
une baisse de la rmunration relle des facteurs de production entranerait une
rduction de leur offre.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 123
VI
Les notations adoptes au Chapitre XX nous permettent d'exprimer sous une
forme symbolique l'essentiel de ce qui prcde.
Nous pouvons crire l'quation MV = D, o M reprsente la quantit de monnaie,
V sa vitesse de transformation en revenu (dont la dfinition se distingue de la dfi-
nition usuelle par les particularits secondaires indiques plus haut), et D la demande
effective. Par suite, si V est constant, pour que les prix varient proportionnellement
la quantit de monnaie, il faut que
p e
Ddp
pdD
_
,
soit gale un. Cette condition est
remplie (voir p. 302, ci-dessus) si
q e
0 ou si
s e
1. Que
s e
soit gale un, cela
signifie que l'unit de salaire exprime en monnaie crot proportionnellement la
demande effective, puisque
s e
DdS
SdD
. Que
q e
soit nulle, cela signifie que le volu-
me de la production ne ragit plus l'augmentation de la demande effective, puisque
q e
DdQ
QdD
. Dans les deux cas le volume de la production reste inchang.
Nous pouvons ensuite examiner le cas o la vitesse de transformation de la mon-
naie en revenu n'est pas constante. Il suffit d'introduire une nouvelle lasticit, celle
de la demande effective ragissant aux variations de la quantit de monnaie,
d e
MdD
DdM
Ceci nous donne
Mdp
pdM
p d e e
. o
p e q s e e e e
1 1 ( )
de sorte que
e
d s d e q e e e e e
( ) . . 1
+
d e q e q s e e e e e e
( . . . ) 1
o e sans indice
_
,
Mdp
pdM
reprsente le sommet de cette pyramide et mesure la
raction des prix nominaux aux variations de la quantit de monnaie.
Puisque cette dernire formule indique la variation relative des prix qui rsulte
d'une variation de la quantit de monnaie, on peut la considrer comme une expres-
sion gnralise de la Thorie Quantitative de la Monnaie. Personnellement, nous
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 124
n'attribuons pas une. grande valeur aux jongleries de ce genre. Du moment qu'elles
supposent les variables indpendantes (en ngligeant systmatiquement les diffren-
tielles partielles), elles impliquent, nous l'avons dj signal, tout autant d'hypothses
tacites que le raisonnement ordinaire, et nous doutons qu'elles conduisent beaucoup
plus loin. Peut-tre leur plus grande utilit est-elle de mettre en lumire l'extrme
complexit de la relation existant entre les prix et la quantit de monnaie lorsqu'on
cherche en donner une reprsentation formelle. Rappelons toutefois le sens des
quatre termes
d e
,
S e
,
e e
q e
, qui gouvernent l'effet des variations de la quantit de
monnaie sur les prix ;
d e
correspond aux facteurs de liquidit qui dterminent la
demande de monnaie dans chaque situation,
S e
aux facteurs ouvriers (ou plus exac-
tement aux facteurs entrant dans le cot premier) qui dterminent la mesure dans
laquelle les salaires nominaux montent quand l'emploi augmente, enfin
e e
et
q e
aux
facteurs physiques qui dterminent la rapidit avec laquelle les rendements dcrois-
sent lorsqu'on associe plus d'emploi l'quipement existant.
Si le public conserve sous forme de monnaie une proportion constante de son
revenu,
d e
= 1 ; si les salaires nominaux sont fixes,
S e
= 0 ; si le rendement de
toutes les units de travail est le mme, de telle sorte que le rendement marginal est
gal au rendement moyen,
C q e e
. 1 ; s'il y a plein emploi de la main-duvre ou de
l'quipement,
e q e e
. 0.
Dans ces conditions, e = 1, si
d e
1 et
S e
1 ; ou si
d e
1,
S e
0 et
e q e e
. 0 ; ou encore si
d e
1 et
q e
0. Et il existe videmment bien d'autres cas
spciaux o e est gal un. Mais, en gnral, la valeur de e n'est pas gale un; et
l'on a peut-tre le droit de poser en principe gnral qu'elle est infrieure un
lorsqu'on fait au sujet du monde rel des hypothses plausibles et qu'on carte le cas
d'une fuite devant la monnaie , dans lequel
d e
et
S e
prennent une valeur leve.
VII
Jusqu' prsent nous nous sommes surtout occups de la faon dont les variations
de la quantit de monnaie agissent sur les prix dans la courte priode*. Mais, si on
considre la longue priode, n'existe-t-il pas une relation plus simple ?
Cette question relve plus de l'analyse historique que de la thorie pure. Si l'tat
de la prfrence pour la liquidit fait preuve d'une certaine tendance l'uniformit
dans la longue priode, il est trs possible qu'il existe une sorte de relation grossire
entre le revenu national et la moyenne, calcule la fois sur des priodes de
pessimisme et d'optimisme, de la quantit de monnaie exige par la prfrence pour
la liquidit. A condition que le taux de l'intrt reste suprieur a un certain minimum
psychologique, il peut y avoir, par exemple, une proportion assez stable du revenu
national que le public ne laissera pas dpasser pendant une suite de longues priodes
par les avoirs qu'il conserve sous une forme improductive. Si la quantit de monnaie
excdant les besoins de la circulation active dpasse cette proportion du revenu
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 125
national, tt ou tard le taux de l'intrt tombera au voisinage du minimum psycholo-
gique. Toutes choses restant gales, la baisse du taux de l'intrt fera crotre la
demande effective, et celle-ci dans son essor atteindra le ou les points semi-critiques
qui sont marqus par une hausse discontinue de l'unit de salaire et par celle cons-
cutive des prix. Les tendances opposes se feront jour si la quantit de monnaie
disponible baisse d'une faon anormale par rapport au revenu national. Le rsultat net
des fluctuations sera donc d'tablir aprs un certain temps un niveau moyen des
salaires et des prix compatible avec la proportion stable que les tendances psycholo-
giques du public tendent ramener tt ou tard entre la quantit de monnaie et le
revenu national.
Ces mouvements rencontreront sans doute moins de rsistances de frottement
dans le sens de la hausse que dans celui de la baisse. Mais, si pendant une longue
priode de temps la quantit de monnaie demeure trs insuffisante, on recourra en
principe un changement de l'talon montaire ou du systme montaire qui augmen-
tera la quantit de monnaie, plutt qu' une compression de l'unit de salaire qui
alourdirait le fardeau des dettes. Aussi les mouvements de trs longue dure du
niveau des prix sont-ils presque toujours orients vers la hausse. Car, lorsque la
monnaie est relativement abondante, l'unit de salaire s'lve; et, lorsque elle est
relativement rare, on trouve des moyens pour en augmenter la quantit effective.
Pendant le XIXe sicle les progrs de la population et de l'invention, la mise en
valeur de nouvelles contres, l'tat de la confiance, et la frquence des guerres lors-
qu'on considre la moyenne des dcades, semblent avoir Suffi, conjointement avec la
propension consommer, maintenir une courbe de l'efficacit marginale du capital
qui permt un volume satisfaisant de l'emploi d'tre compatible avec un taux
d'intrt assez lev pour tre psychologiquement acceptable pour les dtenteurs de
richesse. Si on envisage une priode de quelque cent cinquante ans, il est vident que
le taux normal de l'intrt long terme a t dans les principaux centres financiers de
5 % environ, que le taux des obligations de premier ordre a oscill entre 3 et 3,5 %, et
que ces taux taient assez modiques pour susciter un flux d'investissement compatible
avec un volume moyen de l'emploi qui ne ft pas d'une faiblesse insupportable.
Parfois l'unit de salaire, mais plus souvent l'talon montaire ou le systme mon-
taire ( la faveur du dveloppement de la monnaie bancaire en particulier) s'ajustaient
de sorte que la quantit de monnaie mesure en units de salaire sufft satisfaire la
prfrence normale pour la liquidit sans que les taux d'intrt tombassent sensible-
ment au-dessous des chiffres normaux indiqus plus haut. Dans l'ensemble, l'unit de
salaire tendait d'ordinaire crotre d'une faon rgulire, mais le rendement du travail
croissait lui aussi. Les forces en prsence assuraient une certaine stabilit des prix - la
moyenne quinquennale la plus leve des nombres indices de Sauerbeck entre 1820
et 1914 ne dpasse que de 50 % la moyenne la plus basse. Ce fait n'est pas fortuit et
c'est juste titre qu'on l'attribue l'quilibre qui a exist durant cette priode entre les
forces antagonistes. Les groupes individuels d'employeurs taient en effet assez
puissants pour empcher l'unit de salaire de s'lever beaucoup plus vite que le rende-
ment de la production ; et les systmes montaires taient la fois assez souples et
assez permanents pour assurer une offre moyenne de monnaie, mesure en units de
salaire, suffisante pour maintenir le taux moyen de l'intrt au niveau le plus bas que
les dtenteurs de richesse pussent accepter, eu gard leurs prfrences pour la
liquidit. Bien entendu, le volume moyen de l'emploi tait sensiblement infrieur au
plein emploi, mais l'cart n'tait pas insupportable au point de provoquer des chan-
gements rvolutionnaires.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 126
A l'heure actuelle, et il en sera sans doute de mme l'avenir, la courbe de
l'efficacit marginale du capital est, pour, un grand nombre de raisons, beaucoup plus
basse qu'au XIXe sicle. La gravit et la particularit des problmes contemporains
viennent donc du fait que le taux moyen de l'intrt compatible avec un volume
moyen raisonnable de l'emploi peut tre tellement inacceptable pour les dtenteurs de
richesse qu'il est impossible de l'tablir facilement par de simples manipulations de la
quantit de monnaie. Tant qu'il a suffi pour assurer un volume supportable de
l'emploi sur une moyenne d'une, deux ou trois dcades, de maintenir l'offre de mon-
naie mesure en units de salaire un niveau adquat, le XIXe sicle a encore pu
trouver des solutions. Si ce problme tait le seul qui se post maintenant, s'il ne nous
fallait qu'une dvaluation suffisante, nous aussi, l'heure actuelle, nous trouverions
certainement une solution.
Mais l'lment le plus stable et le plus difficile modifier de notre conomie con-
temporaine a t jusqu' prsent, et s'affirmera sans doute dans l'avenir, le taux
d'intrt minimum acceptable pour la gnralit des dtenteurs de richesse
1
. Si un
volume supportable de l'emploi exige un taux d'intrt trs infrieur aux taux moyens
qui ont prvalu au XIXe sicle, il est trs douteux qu'on puisse y parvenir par de
simples manipulations de la quantit de monnaie. Avant d'arriver au produit net offert
au dtenteur de richesse pour le dcider sacrifier sa liquidit, il faut en effet prlever
sur le pourcentage de gain que la courbe de l'efficacit marginale du capital permet
l'emprunteur d'esprer, 1 le cot de la mise en contact des emprunteurs et des
prteurs, 2 l'impt cdulaire et l'impt gnral sur le revenu, et 3 la somme exige
par le prteur pour couvrir le risque et l'incertitude. S'il est ncessaire, pour que le
volume moyen de l'emploi soit supportable, que ce produit net devienne infinitsimal,
les mthodes prouves par le temps pourront se montrer inefficaces.
Pour revenir notre sujet immdiat, la relation existant dans la longue priode
entre le revenu national et la quantit de monnaie dpend du degr de la prfrence
pour la liquidit. La stabilit ou l'instabilit des prix dans la longue priode est fonc-
tion de la rapidit avec laquelle l'unit de salaire (ou -plus exactement l'unit de cot)
tend crotre par rapport au rendement du systme productif.
1
Cf. la maxime du XIXe sicle cite par Bagehot : John Bull peut supporter bien des choses, mais
non un taux d'intrt de 2 %.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 127
Livre VI
Notes succinctes
suggres parla thorie
gnrale
Retour la table des matires
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 128
Livre VI : Notes succinctes suggres par la thorie gnrale
Chapitre XXII
Notes sur le cycle conomique
Retour la table des matires
Puisque nous prtendons avoir dtermin dans les chapitres prcdents les
facteurs qui gouvernent tout moment le volume de l'emploi, notre thorie, si elle est
exacte, doit pouvoir expliquer le phnomne du cycle conomique.
Lorsqu'on examine en dtail un pisode concret de ce cycle, on y dcouvre une
grande complexit, et on constate que son explication complte fait intervenir toutes
les parties de notre analyse. Il apparat en particulier que les fluctuations de la
propension consommer, celles de l'tat de la prfrence pour la liquidit et celles de
l'efficacit marginale du capital ont toutes un rle jouer. Nanmoins, c'est aux
modes de variation de l'efficacit marginale du capital qu'il faut surtout attribuer,
notre avis, les caractristiques essentielles du cycle conomique; notamment la cons-
tance de sa dure et la succession rgulire de ses phases, qui justifient l'appellation
de cycle. La meilleure faon d'analyser le cycle conomique nous parat tre de
considrer qu'il a pour cause une variation cyclique de l'efficacit marginale du capi-
tal, encore qu'il soit compliqu et souvent aggrav par les variations corrlatives des
principales autres variables agissant dans la courte priode sur le systme cono-
mique. L'expos de cette thse exigerait un volume plutt qu'un chapitre et ncessi-
terait une analyse minutieuse des faits. Toutefois les quelques notes qui vont suivre
suffiront indiquer le caractre gnral de l'tude qui pourrait tre faite d'aprs ce
principe.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 129
I
Quand nous parlons d'un mouvement cyclique, nous voulons dire que, lorsque le
systme volue par exemple dans une direction ascendante, les forces qui le stimulent
acquirent tout d'abord de l'intensit et s'augmentent les unes les autres, mais qu'elles
s'puisent peu peu jusqu'au moment o elles sont remplaces par des forces diriges
dans l'autre sens; ces forces leur tour acquirent de l'intensit pendant un certain
temps et s'accroissent les unes les autres jusqu' ce que, ayant atteint leur maximum,
elles dclinent et cdent la place aux forces opposes. Pour nous l'expression mouve-
ment cyclique ne signifie donc pas seulement que les mouvements conomiques une
fois dclenchs, au lien de rester orients toujours dans le mme sens, finissent par
s'inverser, mais encore qu'il existe un degr visible de rgularit dans l'ordre et la
dure des phases ascendantes et descendantes.
Notre explication, si elle est correcte, doit encore nous rendre compte d'une autre
caractristique de ce qu'on appelle le cycle conomique. Nous voulons parler du
phnomne de la crise , c'est--dire du fait que le passage d'une phase ascendante
une phase descendante est souvent violent et soudain, alors que la transition d'un
mouvement de baisse un mouvement de hausse n'est gnralement pas aussi
marque.
Toute fluctuation de l'investissement, non compense par une variation correspon-
dante de la propension consommer, se traduit ncessairement par une fluctuation de
l'emploi. Or, le flux d'investissement tant soumis des influences trs complexes, il
y a lieu de croire que les diverses catgories de fluctuations, soit de l'investissement
lui-mme, soit de l'efficacit marginale du capital, ne sont pas toutes d'une nature
cyclique. Un cas particulier de variations non cycliques, celui des fluctuations asso-
cies aux mouvements de la production agricole, fera l'objet d'un examen spcial
dans la dernire section du chapitre. Toutefois, dans le cas des cycles conomiques du
type industriel normal au XIXe sicle, nous pensons qu'il existe des raisons dfinies
qui expliquent que les fluctuations de l'efficacit marginale du capital aient eu une
allure cyclique. Ces raisons sont bien connues en elles-mmes et on n'ignore pas leur
rle dans le cycle conomique. Nous voulons seulement ici les rattacher ntre
thorie gnrale.
II
Pour la clart de l'expos il vaudra mieux commencer par les derniers stades de
l'essor et par le dbut de la crise .
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 130
Nous avons vu prcdemment que l'efficacit marginale du capital
1
ne dpend
pas seulement de l'abondance ou de la raret actuelles du capital et du cot actuel de
sa production, mais encore des prvisions courantes relatives son rendement futur.
Par suite, lorsque l'investissement porte sur des richesses durables, il est naturel et
raisonnable que les prvisions jouent un rle essentiel dans la dtermination de
l'chelle qu'il parat convenable de lui assigner. Mais la base de ces prvisions est,
nous l'avons vu, des plus prcaires. Fondes sur des indices mouvants et incertains,
elles sont sujettes des variations soudaines et violentes.
Or, dans nos explications du phnomne de la crise , nous avons t habitus
insister sur le fait que le taux de l'intrt tend monter sous l'effet d'une demande de
monnaie accrue simultanment par les besoins commerciaux et spculatifs. Ce facteur
est certes capable de l'aggraver et peut-tre dans certains cas de la dclencher. Toute-
fois, notre avis, ce n'est pas la hausse du taux de l'intrt mais la chute soudaine de
l'efficacit marginale du capital qui fournit l'explication la plus normale et souvent
l'explication essentielle de la crise.
Dans les derniers stades de l'essor les prvisions relatives au rendement futur des
biens de capital sont assez optimistes pour compenser l'abondance croissante de ces
biens, la hausse de leurs cots de production, et en gnral aussi la hausse du taux de
l'intrt. Puisque les marchs financiers organiss sont soumis l'influence d'ache-
teurs qui ignorent pour la plupart ce qu'ils achtent et de spculateurs qui s'intressent
plus la prvision du prochain changement de l'opinion boursire qu' l'estimation
rationnelle du rendement futur des capitaux, il est normal, lorsqu'une dception
frappe un march survalu et trop optimiste, que les cours baissent d'un mouvement
soudain et mme catastrophique
2
. De plus l'incertitude au sujet de l'avenir et le d-
couragement qui accompagnent la chute de l'efficacit marginale du capital suscitent
une forte augmentation de la prfrence pour la liquidit et par suite une hausse du
taux de l'intrt. Le fait que la chute de l'efficacit marginale du capital s'accompagne
souvent d'une hausse du taux de l'intrt peut aggraver srieusement le dclin de l'in-
vestissement. Mais il n'en reste pas moins que c'est la chute de l'efficacit marginale
du capital qui caractrise la situation, et surtout la chute de l'efficacit marginale des
catgories de capital qui, au cours de la phase antrieure, ont le plus particip l'essor
de l'investissement nouveau. La prfrence pour la liquidit, abstraction faite de ses
lments qui sont fonction de l'activit commerciale et spculative, ne commence
augmenter que lorsque l'efficacit marginale du capital s'est effondre.
C'est pourquoi il est si difficile d'enrayer la baisse. Aprs un certain temps, le d-
clin du taux de l'intrt contribue grandement au redressement de l'activit et consti-
tue sans doute une condition ncessaire de la reprise. Mais pour le prsent la baisse
de l'efficacit marginale du capital peut tre si profonde qu'aucune rduction possible
du taux de l'intrt ne suffirait la contrebalancer. Si la baisse du taux de l'intrt
constituait par elle-mme un remde effectif, la reprise pourrait tre obtenue en un
court laps de temps et avec l'aide de moyens qui dpendent plus ou moins directe-
ment de l'autorit montaire. Mais en fait tel n'est pas le cas habituel ; il n'est pas
facile de ranimer l'efficacit marginale du capital, telle que la dtermine l'tat d'esprit
1
Lorsque le contexte exclut toute quivoque, il est souvent commode de parler de l' efficacit
marginale du capital , alors qu'on a en vue la courbe de l'efficacit marginale du capital .
2
Les particuliers qui font des placements ont rarement l'initiative de l'investissement nouveau ; mais
nous avons vu au Chapitre XII que, pour les entrepreneurs qui ont cette initiative, il est financi-
rement avantageux et souvent obligatoire de se conformer aux ides du march financier, mme si
personnellement ils sont mieux clairs.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 131
capricieux et drgl des milieux d'affaires. C'est le retour de la confiance, pour user
du langage courant, qu'il est difficile de provoquer dans une conomie fonde sur le
capitalisme individuel. Les banquiers et les hommes d'affaires insistent avec raison
sur cet aspect de la dpression, et les conomistes qui ont cru l'efficacit d'un
remde purement montaire ne lui ont pas accord l'importance qu'il mrite.
Nous voici au cur du sujet. L'lment de temps dans le cycle conomique, i. e. le
fait qu'un laps de temps d'un ordre de grandeur dtermin doit en gnral s'couler
avant le commencement de la reprise, s'explique par les influences qui gouvernent la
restauration de l'efficacit marginale du capital. Il y a certaines raisons, d'abord la
longvit des capitaux durables combine avec le rythme normal de leur accumu-
lation, ensuite les cots de conservation des excdants de stocks, qui expliquent que
la priode descendante ne soit pas d'un ordre de grandeur fortuit, qu'elle n'oseille pas,
par exemple, entre un an et dix ans, mais qu'elle tmoigne d'une certaine rgularit et
reste comprise en des limites rapproches, disons trois et cinq ans.
Revenons aux vnements qui marquent le dbut de la crise. Tant que l'essor se
poursuit, le rendement courant de l'investissement nouveau se montre plutt satisfai-
sant. La dception vient du fait que la confiance dans le rendement escompt se
trouve tout coup branle. Parfois ce phnomne se produit parce que le rendement
courant donne des signes de flchissement lorsque le stock de capitaux durables
nouvellement crs s'accrot fortement. Et, si l'on prvoit une baisse des cots de
production, une telle circonstance est pour l'efficacit marginale du capital une nou-
velle cause de faiblesse. Le doute, aussitt apparu, se propage avec rapidit. Aussi
bien, au dbut de la crise, une bonne partie du capital a-t-elle normalement une effi-
cacit marginale infime ou mme ngative. Mais l'intervalle de temps qui doit s'cou-
ler avant que l'usure, le dprissement et la dsutude dterminent une insuffisance
du stock de capital assez sensible pour que son efficacit marginale croisse peut
former une fonction relativement stable de la longvit moyenne de l'quipement
une poque donne. L'intervalle normal peut d'ailleurs varier lorsque les caractristi-
ques de l'poque changent. Si, par exemple, on passe d'une priode d'accroissement
une priode de dclin de la population, la phase caractristique du cycle deviendra
plus longue. Toutefois les considrations prcdentes nous fournissent une bonne
raison de croire qu'il existe une relation dfinie entre d'une part la longueur de la pha-
se descendante et de l'autre la longvit des capitaux durables combine avec le
rythme normal de leur accumulation une poque donne.
Le second facteur d'galit des priodes descendantes rside dans les cots de
conservation des excdants de stocks, qui rendent obligatoire leur rsorption dans un
certain dlai, qui n'est ni trs long ni trs court. La brusque cessation de l'investisse-
ment nouveau au moment de la crise entrane normalement une accumulation
surabondante de produits non achevs. Le cot de conservation de ces produits est
rarement infrieur 10 %. Leurs prix doivent donc baisser suffisamment pour amener
une restriction de la production qui assure la rsorption des stocks surabondants dans
un dlai de trois cinq ans environ. Or la rsorption des stocks reprsente un
investissement ngatif, qui contribue encore affaiblir l'emploi ; et, lorsqu'elle est
termine, une amlioration manifeste se fait sentir.
D'autre part la rduction du capital circulant qui accompagne ncessairement le
dclin de la production est un nouveau facteur, important parfois, de dsinvestisse-
ment ; lorsque le recul a commenc, ce facteur exerce dans le sens de la baisse une
puissante action cumulative. Dans les premiers moments d'une phase descendante
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 132
normale il se produit du fait de l'augmentation des stocks un investissement qui
compense plus ou moins le dsinvestissement dans le capital circulant ; il peut y avoir
ensuite une courte priode de dsinvestissement et dans les stocks et dans le capital
circulant ; aprs le point le plus bas de la dpression il apparat, en gnral, un dsin-
vestissement supplmentaire dans les stocks qui compense en partie la renaissance de
l'investissement dans le capital circulant, et finalement, lorsque la reprise est bien
amorce, les deux facteurs se montrent la fois favorables l'investissement. C'est
dans un tel cadre qu'il convient d'examiner les effets additionnels dus aux fluctuations
de l'investissement dans les capitaux durables. Lorsqu'un dclin de cet investissement
dclenche une fluctuation cyclique, il y a peu de chance qu'il se rtablisse avant
qu'une partie du cycle ait t parcourue
1
.
Malheureusement une chute profonde de l'efficacit marginale du capital est de
nature affaiblir aussi la propension consommer. Elle entrane en effet une forte
baisse de la valeur boursire des actions; et cette baisse exerce une influence des plus
dprimantes sur les personnes qui suivent de prs leurs placements en Bourse, surtout
lorsqu'elles emploient de l'argent emprunt. Il arrive que leur penchant la dpense
soit plus sensible la hausse et la baisse de leurs valeurs qu' l'tat de leurs revenus.
Aussi, lorsque le public s'intresse la Bourse, comme aux tats-Unis, la hausse des
cours apparat-elle comme une condition quasi essentielle de l'existence d'une pro-
pension suffisante consommer ; cette circonstance, qu'on avait coutume de ngliger
jusqu' une date rcente, aggrave encore l'effet dprimant d'une baisse de l'efficacit
marginale du capital.
La reprise une fois commence, la manire dont elle s'entretient et se dveloppe
est vidente. Mais pendant la phase descendante, alors qu'il y a pour un certain temps
des excdants de capital fixe et de marchandises et qu'on procde une contraction
du capital circulant, la courbe de l'efficacit marginale du capital peut s'effondrer au
point qu'il soit presque impossible, par une rduction pratiquement ralisable du taux
de l'intrt, de remdier sa chute et de maintenir un flux satisfaisant d'investisse-
ment. Dans l'tat actuel de l'organisation des marchs financiers et des influences qui
s'exercent sur eux, l'estimation boursire de l'efficacit marginale du capital est expo-
se subir des fluctuations trop considrables pour qu'elles puissent tre efficacement
compenses par une modification du taux de l'intrt. Et les fluctuations boursires
associes ces mouvements affaiblissent, nous l'avons vu, la propension consom-
mer au moment le moins opportun. Dans un rgime de laissez-faire la suppression
des larges fluctuations de l'emploi exigerait un profond changement des conditions
psychologiques des marchs financiers ; et il n'y a aucune raison de prvoir un tel
changement. Nous concluons qu'on ne peut sans inconvnient abandonner l'initia-
tive prive le soin de. rgler le flux courant d'investissement.
III
L'analyse prcdente peut sembler conforme la manire de voir de ceux qui
prtendent qu'un surinvestissement est la caractristique d'une priode d'essor, que la
lutte contre le surinvestissement est le seul moyen d'empcher la crise subsquente, et
que, si pour les raisons prcdentes la baisse du taux de l'intrt est incapable de
1
Une partie du Livre IV du Treatise on Money est consacre cette question.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 133
pallier la dpression, en revanche la hausse de ce taux peut contrecarrer l'essor.
L'argument qu'un taux d'intrt lev est plus efficace contre l'essor qu'un taux d'int-
rt rduit contre le dclin n'est certes pas sans valeur.
Cependant, ce serait mal interprter notre analyse et commettre notre sens une
grave erreur que de tirer ces conclusions des observations qui prcdent. Le terme de
surinvestissement est quivoque. Il peut tout d'abord s'appliquer des investissements
qui sont destins dcevoir les esprances qui les ont fait natre, ou qui en priode de
chmage intense perdraient leur utilit. Mais il peut aussi s'appliquer une situation
caractrise par une telle abondance de capital qu'il n'y ait plus aucun investissement
nouveau qui paraisse capable mme dans l'hypothse du plein emploi* de rapporter
pendant son existence entire plus que son cot de remplacement. C'est seulement
dans cette dernire situation qu'il y a strictement parler surinvestissement, en ce
sens que tout investissement supplmentaire serait un pur gaspillage de ressources
1
.
Au surplus, mme si le surinvestissement ainsi entendu tait une caractristique nor-
male de la priode d'essor, le remde ne consisterait pas assner une forte hausse du
taux de l'intrt, qui entranerait probablement l'abandon de certains investissements
utiles et affaiblirait encore la propension consommer, mais prendre des mesures
nergiques, comme un changement de rpartition du revenu, qui stimuleraient la
propension consommer.
Or, d'aprs notre analyse, seul le surinvestissement de la premire espce peut tre
considr comme caractristique de la priode d'essor. La situation qui nous parat
typique n'est pas celle o le capital est si abondant que la communaut dans son en-
semble ne puisse raisonnablement en employer davantage, mais celle o l'investisse-
ment, du fait qu'il est suscit par des espoirs destins tre dus, s'effectue en des
conditions instables et phmres.
Il est certes possible et mme probable que sous l'effet des illusions de la phase
ascendante la production de certains types de capital se dveloppe au point de consti-
tuer en partie un gaspillage de ressources, quel que soit le critre appliqu ; - ajoutons
que cela se produit parfois en l'absence de tout essor. En d'autres termes, les illusions
se traduisent par une mauvaise orientation de l'investissement. Mais, en dehors de ce
phnomne, une caractristique essentielle de la priode d'essor, c'est que les
investissements qui en situation de plein emploi rapporteraient effectivement 2 %, par
exemple, sont raliss dans l'espoir d'un rendement de 6 %, par exemple, et sont
valus sur cette base. Lorsque la dception survient, cet espoir est remplac par une
prvision exagrment pessimiste. Les investissements qui en situation de plein
emploi rapporteraient effectivement 2 % paraissent devoir rapporter moins que rien.
Le dclin de l'investissement nouveau qui en rsulte amne un tat de chmage o les
investissements qui en situation de plein emploi eussent rapport 2 % rapportent en
fait moins que rien. On aboutit une situation o il y a une insuffisance de maisons,
mais o personne n'a cependant les moyens de vivre dans celles qui existent.
Le remde l'essor n'est donc pas la hausse mais la baisse du taux de l'intrt
2
.
Car il se peut que cette dernire permette l'tat qu'on nomme essor de durer. Le
1
On peut d'ailleurs concevoir une rpartition dans le temps de la propension consommer telle que
les investissements rapportant un revenu ngatif soient avantageux, en ce sens que dans la
communaut tout entire ils rendent la satisfaction maximum.
2
On trouvera ci-dessous (p. 339) quelques arguments qui pourraient tre invoqus en sens contraire.
S'il est impossible de modifier profondment les mthodes actuelles, nous convenons qu'en
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 134
vrai remde au cycle conomique ne consiste pas supprimer les phases d'essor et
maintenir en permanence une semi-dpression, mais supprimer les dpressions et
maintenir en permanence une situation voisine de l'essor.
L'essor destin tre suivi d'une crise rsulte donc de l'association d'un taux
d'intrt qui dans un tat correct de la prvision et t trop lev pour permettre le
plein emploi et d'un tat fallacieux de la prvision qui, aussi longtemps qu'il persiste,
empche le taux de l'intrt de jouer son rle modrateur. L'essor est une situation o
le super-optimisme l'emporte sur un taux d'intrt qui, envisag de sang-froid, et
t jug trop lev.
Sauf pendant la guerre, nous doutons qu'il y ait eu des exemples rcents d'un essor
assez vigoureux pour avoir amen le plein emploi. Aux tats-Unis, en 1928 et en
1929, la situation de l'emploi tait trs satisfaisante eu gard son volume normal ;
mais nous n'avons constat aucun signe vident d'une insuffisance de main-duvre,
si ce n'est dans quelques catgories trs spcialises. Certains tranglements
furent atteints, mais la production dans son ensemble tait encore capable de s'accro-
tre. Il n'y avait pas non plus surinvestissement, en ce sens que la qualit et la quantit
des habitations n'taient pas telles que les besoins de logement en situation de plein
emploi fussent tous satisfaits un prix au plus gal pour la dure des immeubles
leur cot de remplacement abstraction faite de tout intrt ; d'autre part, les transports,
les services publics et les exploitations agricoles n'avaient pas atteint un stade o il
ft draisonnable d'attendre que des amliorations nouvelles rapportassent plus que
leur cot de remplacement, bien au contraire. Il serait absurde de prtendre qu'il ait
exist en 1929 aux tats-Unis un surinvestissement au sens strict du mot. La situation
vritable tait tout autre. A vrai dire, l'investissement nouveau dans son ensemble
avait t si considrable au cours des cinq annes prcdentes que, pour un observa-
teur impartial, le rendement futur des investissements supplmentaires flchissait
avec rapidit. Une prvision correcte et fait ressortir une efficacit marginale du
capital d'une faiblesse sans prcdent ; l'essor n'aurait donc pu continuer sur une base
saine que si on avait rduit le taux de l'intrt un chiffre infime et si on avait
empch l'investissement de dvier vers les branches d'industrie qui risquaient d'tre
exploites sur une chelle trop vaste. Pratiquement l taux d'intrt est rest assez
lev pour faire chec l'investissement nouveau, sauf dans les industries qui subis-
saient une pousse spculative et o par consquent le danger d'une exploitation
excessive tait particulirement craindre. Un taux d'intrt suffisant pour triompher
du mouvement spculatif et interdit du mme coup tout investissement nouveau si
raisonnable qu'il ft. La hausse du taux de l'intrt, comme antidote la situation
cre par la persistance d'un flux anormal d'investissement, appartient cette cat-
gorie de remdes qui suppriment la maladie en tuant le malade.
A vrai dire, dans un pays aussi riche que la Grande-Bretagne ou les tats-Unis, le
flux d'investissement qui dans l'tat actuel de la propension consommer correspond
peu prs au plein emploi, pourrait trs bien, s'il devait persister pendant un certain
nombre d'annes, faire apparatre une situation de plein investissement, i. e. une
situation dans laquelle un calcul raisonnable ne permettrait plus d'attendre d'aucune
catgorie de biens durables un rendement brut total suprieur leur cot de rempla-
cement. Au surplus, un tel tat pourrait apparatre dans un avenir relativement pro-
chain, disons vingt-cinq ans, ou moins. Qu'on n'aille pas croire que nous contestons la
certaines circonstances la hausse du taux de l'intrt pendant la priode d'essor peut tre un
moindre mal.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 135
possibilit du plein investissement au sens strict du mot, parce que nous soutenons
qu'un tel tat n'a encore jamais exist, ft-ce provisoirement.
D'ailleurs, mme si les essors contemporains pouvaient amener temporairement
une situation de plein investissement ou de surinvestissement vritable, il serait
encore absurde de considrer la hausse du taux de l'intrt comme le remde perti-
nent. Car les postulats de ceux qui attribuent le mal la sous-consommation se
trouveraient alors pleinement vrifis. Le remde consisterait donc modifier la
rpartition des revenus ou prendre toute autre mesure propre accrotre la propen-
sion consommer, de manire qu'un volume donn d'emploi pt tre maintenu
l'aide d'un flux d'investissement moindre.
IV
Peut-tre conviendra-t-il de dire un mot cet endroit des coles conomiques
marquantes qui professent sous des formes diverses que la tendance chronique des
socits contemporaines au chmage est imputable la sous-consommation, c'est--
dire des habitudes sociales et une rpartition de la richesse qui se traduisent par
une trop faible propension consommer.
Dans les conditions actuelles - ou du moins dans les conditions qui ont prvalu
jusqu' une poque rcente - le flux d'investissement n'tant ni gouvern ni dirig,
mais se trouvant au contraire abandonn aux fantaisies d'une efficacit marginale qui
dpend des opinions personnelles d'individus ignorants ou spculateurs, et l'influ-
ence d'un taux d'intrt long terme qui ne baisse jamais ou presque jamais au-des-
sous d'un niveau conventionnel, ces coles en tant que guides d'une politique concrte
ont certainement raison. La mthode qu'elles prconisent est la seule qui puisse
amener le volume moyen de l'emploi un chiffre plus favorable. S'il est matrielle-
ment impossible d'augmenter l'investissement, l'accroissement de la consommation
est videmment le seul moyen d'amliorer l'emploi.
Pratiquement la seule diffrence entre ces doctrines et la ntre, c'est qu' une
poque o il y a encore beaucoup d'avantages sociaux attendre d'une augmentation
de l'investissement, elles semblent accorder une importance quelque peu excessive au
dveloppement de la consommation. Sur le plan thorique on peut d'ailleurs leur
reprocher de ngliger le fait qu'il y a deux moyens d'accrotre la production. Mme si
on estime prfrable de ralentir l'accumulation du capital et de consacrer tout l'effort
l'accroissement de la consommation, on doit prendre cette dcision en pleine con-
naissance de cause, aprs avoir envisag les deux termes de l'alternative. Per-
sonnellement, nous sommes frapp par les avantages sociaux d'une accumulation du
capital qui suffirait mettre fin sa raret. Mais ce n'est l qu'un jugement pratique et
non un prcepte thorique.
Nous sommes d'ailleurs tout dispos reconnatre que la sagesse serait de pro-
gresser dans les deux directions la fois. Tout en souhaitant que le flux d'investisse-
ment soit, dans un esprit social, gouvern de manire que l'efficacit marginale du
capital dcline progressivement, nous admettrions qu'on applique en mme temps
toutes sortes de mesures propres accrotre la propension consommer. Les deux
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 136
politiques ne s'excluent nullement; rien n'empche d'accrotre l'investissement et,
dans le mme temps, de porter la consommation non seulement au niveau qui dans
l'tat actuel de la propension consommer correspond au flux accru de l'investisse-
ment, mais un niveau plus lev encore.
Supposons par exemple qu'en chiffres ronds le niveau moyen de la production
d'aujourd'hui soit infrieur de 15 % au niveau qu'elle atteindrait s'il y avait conti-
nuellement plein emploi, que d'autre part l'investissement net reprsente 10 % de
cette production et la consommation 90 % et qu'enfin, pour faire apparatre le plein
emploi dans l'tat existant de la propension consommer, une augmentation de 50 %
de l'investissement net soit ncessaire; de telle sorte que l'instauration du plein emploi
ferait passer la production de 110 115, la consommation de 90 100, et l'inves-
tissement net de 10 15 ; dans ces conditions on pourrait se proposer de modifier la
propension consommer de manire que l'instauration du plein emploi fasse passer la
consommation de 90 103 et l'investissement net de 10 12.
V
D'aprs une autre cole, le remde au cycle conomique ne consiste pas accro-
tre la consommation ou l'investissement mais rduire l'offre de main-d'uvre en
qute d'emploi, c'est--dire modifier la rpartition du volume actuel de l'emploi sans
accrotre ce volume ni celui de la production.
Une telle politique serait notre avis prmature - et notre sentiment est beaucoup
plus net ce sujet qu' l'gard d'une politique d'accroissement de la consommation. Il
existe un point o tous les individus mettent en balance les avantages respectifs d'un
accroissement de loisir et ceux d'un accroissement de revenu. Mais, l'heure actuelle,
il nous parat d'une vidence manifeste que la grande majorit des individus prfrent
l'augmentation de leurs revenus l'augmentation de leurs loisirs ; et nous ne voyons
pas de raison valable d'obliger ceux qui prfrent un supplment de revenus jouir
d'un supplment de loisirs.
VI
Si trange que cela paraisse, il existe une cole pour laquelle le remde au cycle
conomique consiste briser l'essor ds son origine en levant le taux de l'intrt. Le
seul genre d'argument qui puisse lgitimer une telle politique est celui que met en
avant M. D. H. Robertson lorsqu'il prtend que le plein emploi est un idal pratique-
ment irralisable et qu'on peut tout au plus esprer un volume de l'emploi beaucoup
plus stable et peut tre eu moyenne un peu plus lev qu' l'heure actuelle.
Si on exclut la possibilit d'une rforme profonde de la politique en ce qui con-
cerne soit le rgime de l'investissement soit la propension consommer et si on
suppose qu'en gros la situation actuelle des affaires est appele durer, il ne nous
parait pas absurde de soutenir qu'on obtiendrait en moyenne un tat plus favorable de
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 137
la prvision par une politique bancaire consistant touffer dans luf tout germe
d'essor au moyen d'une hausse du taux de l'intrt assez forte pour dcourager l'opti-
misme le plus drgl. Les diffrences que la crise fait natre entre les prvisions et la
ralit sont capables d'entraner tant de pertes et de gaspillages qu'on augmenterait
peut-tre le montant moyen de l'investissement utile par des mesures propres
empcher l'essor. Il est difficile de savoir si cette doctrine s'accorde ou non avec ses
hypothses. C'est une question d'apprciation pratique o les lments de certitude
font dfaut. Il se peut qu'elle mconnaisse les avantages sociaux du supplment de
consommation dont l'investissement s'accompagne alors mme que sa direction est
compltement fausse; car un investissement mal orient peut tre plus avantageux
que l'absence totale d'investissement. D'ailleurs l'autorit montaire la plus claire
peut se trouver en difficult devant un essor comme celui que l'Amrique a connu en
1925, si elle n'a pas d'autre arme que celles dont le Federal Reserve System disposait
cette poque ; et il se peut que les diverses politiques possibles soient toutes inca-
pables de changer grand chose au rsultat. Quoi qu'il en soit, une telle manire d'envi-
sager l'avenir nous parat dangereusement et inutilement pessimiste. Elle recom-
mande ou tout au moins suppose l'acceptation dfinitive d'un degr d'imperfection
suprieur celui que comporte en ralit notre organisation conomique actuelle.
Cependant, l'appui de la doctrine austre qui conseille, lorsque l'emploi tend
s'lever sensiblement au-dessus du volume moyen d'une certaine priode antrieure,
disons des dix annes prcdentes, de combattre cette tendance par la hausse du taux
de l'intrt, on invoque plus souvent des arguments qui n'ont aucune base, si ce n'est
le dsordre des ides. On soutient parfois qu'au cours de l'essor l'investissement a
tendance crotre plus vite que l'pargne et qu'une hausse de l'intrt rtablit l'quili-
bre tant en contrariant l'investissement qu'en stimulant l'pargne. Cette thse suppose
que l'pargne puisse diffrer de l'investissement ; elle n'a donc pas de sens moins
que ces termes aient t dfinis d'une faon particulire. Ou encore on suggre que
l'accroissement de l'pargne qui accompagne l'accroissement de l'investissement n'est
ni souhaitable ni juste parce qu'il se trouve aussi associ une hausse des prix. Mais,
s'il en est ainsi, toute hausse du niveau de la production et de l'emploi devrait tre
considre comme regrettable. Car la cause essentielle de la hausse des prix n'est pas
l'accroissement de l'investissement - c'est la hausse du prix d'offre qui, lorsque la
production crot, se produit normalement dans la courte priode, soit en raison du fait
physique de la diminution du rendement, soit parce que l'unit de cot tend crotre
en valeur nominale lorsque la production augmente. Si les conditions taient telles
que le prix d'offre ft constant, il ne se produirait videmment aucune hausse des prix
; cependant l'accroissement de l'pargne s'accompagnerait d'un accroissement de
l'investissement tout comme dans les autres cas. C'est l'extension de la production qui
engendre l'accroissement de l'pargne ; la hausse des prix n'est qu'un sous-produit de
cette extension, qui apparat tout aussi bien lorsque c'est la propension consommer,
et non l'pargne, qui augmente. Aucun intrt lgitime constitu n'exige que les
achats puissent tre faits des prix dont la modicit est uniquement due la faiblesse
de la production.
On attribue parfois le mal au fait que l'extension de l'investissement a eu pour
origine une baisse de l'intrt provoque par une augmentation de la quantit de
monnaie. Or le taux prexistant de l'intrt ne possde aucune vertu particulire. La
monnaie nouvelle n'est impose personne - elle est cre pour satisfaire la prf-
rence supplmentaire pour la liquidit due l'accroissement du volume des transac-
tions ou la baisse du taux de l'intrt - et elle est conserve par les personnes qui
aiment mieux garder de l'argent liquide que le prter au taux rduit de l'intrt. Citons
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 138
encore la thse d'aprs laquelle l'essor est caractris par une consommation de
capital , ce qui signifie sans doute que l'investissement net est ngatif ou que la pro-
pension consommer est excessive. Mais, moins de confondre le phnomne du
cycle conomique avec les phnomnes de fuite devant la monnaie qui se sont
produits en Europe au cours des effondrements montaires qui ont suivi la guerre, on
est oblig de reconnatre que cette explication est directement contraire aux faits. Au
surplus, mme si les choses se passaient ainsi, le remde le plus plausible une
situation de sous-investissement n'en serait pas moins la baisse et non la hausse du
taux de l'intrt. Ces diffrentes doctrines nous paraissent incomprhensibles, sauf
peut-tre si elles se fondent sur l'hypothse tacite que la production globale ne saurait
varier. Mais une thorie qui suppose une production constante n'est videmment
d'aucun secours pour expliquer le cycle conomique.
VII
Dans les tudes anciennes et notamment dans celles de Jevons, le cycle conomi-
que a t attribu aux fluctuations de la production agricole plutt qu' un phnomne
d'ordre industriel. A la lumire de la thorie prcdente, cette explication du probl-
me apparat trs plausible. Mme l'poque actuelle les fluctuations des stocks
agricoles d'une anne l'autre sont encore une des causes principales des variations
de l'investissement courant. Il est trs possible que, l'poque o Jevons crivait et
plus encore durant la priode que ses statistiques concernent, ce facteur l'ait emport
sur tous les autres.
La Thorie de Jevons que le cycle conomique est surtout d l'abondance in-
gale des rcoltes peut tre reprise sous la forme suivante. Lorsque la rcolte est d'une
abondance exceptionnelle, le stock report aux annes postrieures augmente en g-
nral fortement. L'augmentation du stock fournit un produit qui s'ajoute aux reve-
nus courants des fermiers et qui est trait par eux comme un revenu; or elle n'entrane
aucun prlvement sur la dpense de consommation du reste de la communaut mais
se trouve finance par les pargnes. Ceci revient dire que le stock supplmentaire
est une addition l'investissement courant. Et cette conclusion garde toute sa valeur
dans le cas o les prix baissent fortement. De mme, lorsque la rcolte est mauvaise,
la consommation courante est en partie prleve sur le stock; et la portion corres-
pondante de la dpense de consommation ne cre aucun revenu courant au profit des
fermiers. Ceci revient dire que le prlvement opr sur le stock implique une dimi-
nution correspondante de l'investissement courant. Si l'investissement dans les autres-
branches de la production reste constant, il peut exister un cart sensible entre l'inves-
tissement global d'une anne o le stock a beaucoup grossi et l'investissement global
d'une anne o le stock a beaucoup diminu ; et dans une communaut o l'agricul-
ture est l'industrie principale ce facteur est incomparablement plus important que les
autres causes de variation de l'investissement. Il est donc naturel que le point de
dpart des phases ascendantes soit marqu par les bonnes rcoltes et celui des phases
descendantes par les mauvaises rcoltes. Quant la thorie complmentaire selon
laquelle il existerait des raisons physiques motivant un cycle rgulier de bonnes et de
mauvaises rcoltes, elle est videmment d'une tout autre nature et n'entre pas dans
notre sujet actuel.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 139
D'aprs une thorie plus rcente, ce seraient les mauvaises rcoltes et non les
bonnes qui stimuleraient l'activit conomique, soit parce qu'elles incitent la popula-
tion travailler en change d'un salaire rel moindre, soit parce qu'elles s'accom-
pagnent d'un changement de rpartition du pouvoir d'achat qui est cens favoriser la
consommation., Il est inutile de dire que dans la description prcdente des phno-
mnes agricoles qui expliquent le cycle conomique, ce ne sont pas ces thories que
nous avions en vue.
Dans le monde contemporain les causes agricoles des fluctuations conomiques
jouent un rle beaucoup plus secondaire et ce pour deux raisons. En premier lieu la
proportion de la production agricole dans la production totale est sensiblement moin-
dre qu'autrefois. En second lieu la plupart des produits agricoles se traitent aujour-
d'hui sur un march mondial qui s'tend sur les deux hmisphres et o les effets des
campagnes bonnes et mauvaises tendent se compenser, car le pourcentage de varia-
tion de la rcolte mondiale est sensiblement moindre que le pourcentage de variation
des rcoltes nationales. Mais, dans les poques passes o les pays devaient surtout
compter sur leur propre rcolte, il est difficile de dcouvrir une cause de fluctuation
de l'investissement autre que la guerre, qui ait pu avoir une importance comparable
aux variations des stocks agricoles.
Mme l'heure actuelle il importe de prter la plus grande attention au rle jou
par les variations des stocks de matires premires agricoles et minrales dans la
dtermination du flux d'investissement courant. La lenteur de la reprise lorsque le
mouvement descendant s'est renvers nous parat imputable l'effet de dflation qui
rsulte de la rduction des stocks leur volume normal. L'accumulation des stocks
qui marque la fin de l'essor ralentit au dbut le rythme de la baisse ; mais cet adoucis-
sement se paye plus tard par la stagnation du mouvement ascendant. Il arrive mme
que la reprise ne se fasse sentir d'une faon apprciable que lorsque la rsorption des
stocks est virtuellement termine. Car un flux d'investissement dans le reste du capi-
tal qui suffirait provoquer un mouvement ascendant s'il n'tait pas compens par un
dsinvestissement dans les stocks peut tre trs insuffisant pour produire cet effet
aussi longtemps qu'un tel dsinvestissement persiste.
Les premires phases du New Deal amricain nous semblent fournir un exem-
ple remarquable de ce phnomne. Lorsque le Prsident Roosevelt engagea d'impor-
tantes dpenses sur fonds d'emprunt, le volume des stocks de toute nature et parti-
culirement des stocks agricoles tait encore considrable. Le New Deal consistait en
partie dans un effort nergique pour rsorber ces stocks, soit par des restrictions de la
production, soit par tout autre moyen. La rduction des stocks leur volume normal
tait une opration ncessaire, une phase qu'il fallait endurer. Mais pendant tout le
temps qu'elle dura, c'est--dire perdant deux annes environ, elle opposa une forte
action compensatrice aux dpenses sur fonds d'emprunt qui taient engags en
d'autres secteurs. C'est seulement aprs la fin de cette opration que la voie se trouva
libre pour une reprise vritable.
Les vnements qui se sont drouls en Amrique au cours des dernires annes
fournissent aussi de bons exemples du rle que les variations des stocks de produits
finis et non finis, des marchandises sous inventaire comme on dit maintenant,
jouent dans la naissance des oscillations mineures qui se superposent au mouvement
principal du cycle conomique. Les industriels, lorsqu'ils adaptent l'chelle de pro-
duction au volume de consommation dont ils prvoient l'existence quelques mois plus
tard, sont sujets faire dans leurs calculs des erreurs de second ordre qui consistent
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 140
en gnral aller un peu plus vite que les vnements. Lorsqu'ils s'aperoivent de
leur erreur, ils sont obligs pour un temps de ramener la production au-dessous de la
consommation, afin de permettre la rsorption des excdants de marchandises sous
inventaire. La diffrence de rythme de la production suivant qu'elle devance un peu la
consommation ou qu'elle retombe un niveau infrieur influe suffisamment sur le
flux d'investissement courant pour se dtacher avec une grande nettet sur le fond de
tableau des statistiques si compltes qu'on trouve maintenant aux tats-Unis.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 141
Livre VI : Notes succinctes suggres par la thorie gnrale
Chapitre XXIII
Notes sur le mercantilisme, les lois
contre l'usure, la monnaie estampille,
et les thories de la sous-consommation.
I
Retour la table des matires
Pendant quelque deux cents ans ni les thoriciens de l'conomie ni les hommes
d'affaires n'ont jamais dout qu'une balance commerciale favorable ft un srieux
avantage pour un pays et une balance dfavorable un grave danger surtout lorsqu'elle
entrane des sorties de mtaux prcieux. Mais durant les cent dernires annes il a
exist cet gard une remarquable divergence d'opinion. Dans la plupart des pays la
majorit des hommes d'tat et des hommes d'affaires, et mme en Grande-Bretagne,
berceau de la conception oppose, prs de la moiti d'entre eux sont rests fidles
l'ancienne doctrine ; l'inverse, la presque totalit des thoriciens de l'conomie
soutenaient que, si l'on voit plus loin que l'avenir immdiat, les proccupations de cet
ordre sont dnues de tout fondement, car le mcanisme du commerce extrieur se
rgle de lui-mme, et que les obstacles qu'on cherche lui opposer ne sont pas
seulement vains mais encore qu'ils appauvrissent grandement les pays en les privant
des avantages de la division internationale du travail. Il sera commode de donner
selon la tradition le nom de Mercantilisme l'opinion ancienne et le nom de Libre
change l'opinion nouvelle, encore que ces termes, qui ont chacun un sens large et
un sens troit, doivent tre interprts en se rfrant au contexte.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 142
D'une manire gnrale, les conomistes modernes n'ont pas seulement soutenu
que la division internationale du travail impliquait un bnfice net suprieur tous les
avantages que l'cole mercantiliste pouvait lgitimement revendiquer, mais encore
que le raisonnement 'de cette cole reposait de bout en bout sur une erreur.
Marshall
1
, par exemple, encore que ses allusions aux Mercantilistes ne tmoi-
gnent pas leur gard d'une entire hostilit, s'abstient d'examiner leur thorie fonda-
mentale en tant que telle et ne mentionne pas mme les lments de vrit qui, nous
le montrerons par la suite, peuvent y tre trouvs
2
. De mme les concessions thori-
ques faites par l'cole du Libre change dans les discussions contemporaines, en ce
qui concerne par exemple l'encouragement aux industries naissantes ou l'amlioration
du taux du troc extrieur, n'intressent pas la substance mme de la thorie mercan-
tiliste. Au cours des discussions fiscales des vingt-cinq premires annes du sicle, il
ne nous souvient pas qu'aucune concession ait jamais t faite la thse d'aprs
laquelle la protection douanire peut accrotre l'emploi l'intrieur d'un pays. Nous
ne pouvons mieux faire que citer, titre d'exemple, des phrases que nous avons nous-
mmes crites. En 1923 encore, disciple fidle de l'cole classique, ne mettant pas en
doute les principes qu'on nous avait inculqus et que nous acceptions sans rserve,
nous crivions : S'il est une chose que la protection ne peut faire, c'est supprimer le
chmage... Il existe en faveur de la protection des arguments fonds sur ses avantages
possibles encore qu'improbables, auxquels il n'est pas simple de rpondre. Mais
prtendre qu'elle puisse remdier au chmage, c'est commettre l'erreur protectionniste
sous sa forme la plus lourde et la plus grossire
3
. Quant la thorie mercantiliste
primitive, on n'en pouvait trouver d'expos intelligible et nous avions t levs dans
l'ide qu'elle n'avait peu prs aucun sens. Telle tait la domination souveraine et
absolue qu'exerait l'cole classique.
II
Exprimons tout d'abord dans notre langage habituel ce qui aujourd'hui nous parat
constituer l'lment de vrit scientifique contenu dans la doctrine mercantiliste.
Nous comparerons ensuite cet expos avec les arguments effectivement soutenus par
ses disciples. Il doit tre entendu que les avantages invoqus sont de l'aveu gnral
des avantages nationaux et qu'ils ont peu de chance de profiter au monde entier.
Lorsque la richesse d'un pays croit avec quelque rapidit, il arrive qu'en rgime de
laissez-faire l'volution favorable de la situation soit arrte par l'insuffisance des
1
Voir Industry and Trade, Appendice D ; Money, Credit and Commerce, p. 130 ; et Principes
d'conomie, Appendice 1.
2
Son opinion sur les Mercantilistes est assez bien rsume dans une note de la premire dition des
Principles, p. 51 : De nombreuses tudes ont t consacres en Angleterre et en Allemagne aux
ides qui avaient cours au Moyen Age sur les relations entre la monnaie et la richesse nationale.
En dfinitive, il convient plutt de les considrer 'comme 'confuses en raison d'une insuffisante
comprhension des fonctions de la monnaie que de les juger fausses parce que fondes sur
l'hypothse explicite que l'augmentation des rserves de mtaux prcieux peut seule accrotre la
richesse nette d'une nation.
3
The Nation and the Athenaeum, 24 novernbre 1923.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 143
forces qui incitent raliser des investissements nouveaux. Les circonstances sociales
et politiques ainsi que les caractristiques nationales qui dterminent la propension
consommer tant donnes, la prosprit d'une conomie qui progresse exige, pour les
raisons dj exposes, que cette incitation investir soit suffisante. Les motifs
investir peuvent tre trouvs soit dans le domaine des investissements intrieurs soit
dans le domaine des investissements extrieurs (qui comprennent l'accumulation de
mtaux prcieux), ces deux catgories d'investissement composant l'investissement
global. Lorsque le montant de l'investissement global n'obit aucun autre motif que
le profit, c'est le taux d'intrt national qui gouverne la longue le volume des inves-
tissements intrieurs ralisables et c'est ncessairement le solde crditeur de la ba-
lance commerciale qui rgit le volume de l'investissement extrieur. Dans une socit
o les Pouvoirs Publics ne sauraient prendre l'initiative d'investissements directs, les
deux problmes conomiques qui doivent lgitimement les proccuper sont donc le
taux de l'intrt intrieur et le balance du commerce extrieur.
Or, si l'unit de salaire est quelque peu stable et n'est pas sujette des variations
spontanes de grande amplitude (condition qui est presque toujours ralise), si le
degr moyen de la prfrence pour la liquidit au cours de ses fluctuations de courte
priode offre une certaine stabilit et si enfin les pratiques bancaires sont elles-mmes
assez stables, le taux de l'intrt dpend du montant, mesur en units de salaire, des
mtaux prcieux dont la communaut dispose pour satisfaire ses besoins d'argent
liquide. D'autre part, aux poques o il est presque impossible de faire des prts subs-
tantiels l'tranger et de jouir en pleine proprit de biens sis au dehors, l'aug-
mentation ou la diminution des stocks de mtaux prcieux dpend pour une large part
du caractre favorable ou dfavorable de la balance du commerce.
En s'efforant de maintenir une balance commerciale favorable, les autorits se
sont donc trouves servir la fois ces deux fins; et, qui plus est, elles n'avaient aucun
autre moyen de les servir. En un temps o elles ne pouvaient agir directement sur le
taux de l'intrt intrieur ni sur les autres motifs qui gouvernent le montant de
l'investissement national, les mesures propres amliorer la balance commerciale
taient leurs seuls moyens directs d'augmenter l'investissement extrieur ; et les en-
tres de mtaux prcieux rsultant d'une balance commerciale favorable taient en
mme temps leurs seuls moyens indirects de rduire le taux de l'intrt intrieur,
c'est--dire d'accrotre l'incitation raliser des investissements internes.
Le succs d'une telle politique comporte toutefois une double limite qu'on ne doit
pas mconnatre. Si la baisse du taux de l'intrt intrieur stimule assez l'investis-
sement pour porter l'emploi au-del des points critiques o l'unit de salaire croit, la
hausse du niveau intrieur des cots tend exercer une action dfavorable sur la
balance du commerce extrieur, de telle sorte que l'effort pour amliorer cette balance
se dtruit et s'annule lui-mme. D'autre part, si la diffrence entre les taux d'intrt
trangers et le taux d'intrt intrieur est assez grande pour provoquer des prts ext-
rieurs disproportionns au solde crditeur de la balance commerciale, il peut en
rsulter un exode de mtaux prcieux suffisant pour annihiler les avantages prc-
demment obtenus. Lorsque l'extraction courante de mtaux prcieux est relativement
restreinte, ces limites, dans le cas d'un pays vaste et prsentant une importance inter-
nationale, ont d'autant plus de chances d'tre atteintes qu'un apport de mtaux
prcieux dans un pays correspond un exode de ces mtaux hors d'un autre pays ; les
effets dfavorables qui rsultent de la hausse des cots et de la baisse de l'intrt
l'intrieur d'un pays peuvent donc tre accentus (lorsque la politique mercantiliste
est pousse trop loin) par la baisse des cots et la hausse de l'intrt l'tranger.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 144
L'histoire conomique de l'Espagne pendant la fin du XVe sicle et pendant le
XVIe sicle nous fournit l'exemple d'un pays dont le commerce extrieur a t ruin
par la hausse de l'unit de salaire rsultant d'une abondance excessive de mtaux pr-
cieux. La Grande-Bretagne au cours des annes du XXe sicle qui ont prcd la
guerre nous offre l'exemple d'un pays o les facilits excessives accordes aux prts
extrieurs et l'achat de biens trangers ont souvent fait obstacle la baisse du taux
d'intrt qui et t ncessaire l'intrieur pour assurer le plein emploi. L'histoire de
l'Inde toutes les poque, fournit l'exemple d'un pays appauvri par une prfrence
pour la liquidit allant jusqu' la passion, et si forte que malgr un afflux norme et
permanent de mtaux prcieux le taux de l'intrt n'a pu baisser jusqu'au niveau
compatible avec le dveloppement de la richesse relle.
Nanmoins, si l'on considre une socit o l'unit de salaire est assez stable, o il
existe des caractristiques nationales suffisant dterminer la propension consom-
mer et la prfrence pour la liquidit, et o le systme montaire tablit un lien rigide
entre la quantit de monnaie et les stocks de mtaux prcieux, le maintien de la pros-
prit exige que les autorits surveillent de trs prs l'tat de la balance commerciale.
Car une balance du commerce favorable, pourvu qu'elle ne le soit pas l'excs, peut
tre un stimulant extrmement nergique, tandis qu'une balance dfavorable peut
amener rapidement un tat de dpression durable.
Il ne s'ensuit pas que ce soit par une restriction maximum des importations que
l'on obtienne un excdent maximum de la balance commerciale. Les premiers mer-
cantilistes ont vivement insist sur ce point, et on les a souvent vus combattre des
restrictions commerciales parce qu' la longue ces restrictions auraient t un obstacle
une balance commerciale favorable. On peut certainement soutenir que dans les cir-
constances particulires o se trouvait la Grande-Bretagne au milieu du XIXe sicle
une libert commerciale presque absolue tait la politique la plus propre amliorer
la balance du commerce. Les expriences contemporaines de restrictions commer-
ciales dans lEurope d'aprs guerre offrent des exemples nombreux d'attentes la
libert mal conues qui tant destines amliorer la balance du commerce, ont
abouti en fait au rsultat inverse.
Pour cette raison et pour d'autres encore le lecteur ne doit pas tirer une conclusion
prmature relativement la politique pratique qui dcoule de notre thse. Il existe
de fortes prsomptions d'un caractre gnral contre les restrictions commerciales que
des raisons particulires ne justifient pas. Les avantages de la division internationale
du travail sont rels et importants, quoique l'cole classique les ait fortement exa-
grs. Le fait que l'avantage procur un pays par une balance commerciale favora-
ble se trouve compens par un prjudice gal caus un autre pays (fait dont les mer-
cantilistes avaient pleinement conscience) ne signifie pas seulement qu'une grande
modration est ncessaire afin qu'aucun pays ne retienne un stock de mtaux prcieux
suprieur sa part lgitime et raisonnable, mais encore qu'une insuffisante modra-
tion dans la poursuite d'une balance favorable peut dclencher une absurde compti-
tion internationale, galement prjudiciable tous
1
. Enfin une politique de restric-
tions commerciales, mme si on l'utilise pour son but apparent, est une arme deux
tranchants, car les intrts privs, l'incomptence des fonctionnaires et la difficult
1
Pour la mme raison le remde consistant en une unit de salaire souple, permettant de combattre
la dpression par une baisse des salaires, offre l'inconvnient de ne profiter un pays qu'aux
dpens des pays voisins.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 145
intrinsque de la tche peuvent la fausser au point de lui faire produire des effets
directement opposs ceux. qu'on en attend.
Ainsi l'objet principal de notre critique, c'est l'insuffisance des bases thoriques de
la doctrine de laissez-faire qui nous a t apprise et que nous avons enseigne de
nombreuses annes durant, c'est l'ide que le taux de l'intrt et le montant de l'inves-
tissement se fixent d'eux-mmes aux chiffres optima, de telle sorte qu'il faut avoir du
temps perdre pour se proccuper de la balance commerciale. Car on peut lgitime-
ment nous reprocher, nous autres professeurs d'conomie politique, d'avoir fait
preuve d'une prsomption coupable en considrant comme une obsession purile ce
qui avait t pendant des sicles le but principal de la politique pratique.
Sous l'influence de cette thorie errone la Cit de Londres inventa peu peu pour
assurer l'quilibre conomique la technique la plus dangereuse qui se puisse imaginer,
consistant faire varier le taux de l'escompte tout en maintenant le change une
parit fixe. Le sens de cette politique tait qu'on renonait compltement faire r-
gner l'intrieur du pays le taux d'intrt compatible avec le plein emploi. Comme il
n'tait pas possible en fait de ngliger la balance des paiements, on forgea pour
maintenir l'quilibre un moyen qui au lieu de prserver le taux d'intrt intrieur,
l'abandonnait au jeu de forces aveugles. Les banquiers de la Cit ont beaucoup appris
au cours des annes dernires, et il semble permis d'esprer que, sous prtexte de
dfendre la balance commerciale, on n'emploiera plus jamais la technique du taux de
l'escompte d'une manire qui, l'intrieur du pays, puisse crer du chmage.
Envisage Comme thorie de l'industrie individuelle et de la rpartition des pro-
duits rsultant de l'emploi d'un volume donn de ressources, la thorie classique a
fourni la pense conomique une contribution incontestable. On ne saurait avoir des
ides claires sur ce sujet sans se l'tre assimile. Nous ne songeons pas le nier lors-
que nous appelons l'attention sur l'omission qu'elle a commise en mconnaissant la
part de vrit contenue dans les thories antrieures. Mais si l'on envisage la contri-
bution apporte par la doctrine la politique gouvernementale, laquelle doit consid-
rer le systme conomique comme un tout et chercher employer au maximum la
totalit de ses ressources, il se peut que les mthodes des pionniers de la pense
conomique des XVIe et XVIIe sicles aient abouti certains fragments de sagesse
pratique que les abstractions si peu ralistes de Ricardo ont fait ngliger d'abord et
oublier ensuite. Il y avait de la sagesse dans leur extrme proccupation de maintenir
un faible taux d'intrt par les lois contre l'usure (sur lesquelles nous reviendrons dans
la suite du chapitre), par la dfense du stock montaire intrieur et par la lutte contre
la hausse de l'unit de salaire ; et aussi dans leur promptitude recourir en dernier
ressort la dvaluation pour reconstituer le stock montaire lorsqu'un drainage irr-
sistible de monnaie vers l'tranger, une hausse de l'unit de salaire
1
ou toute autre
cause l'avaient rendu par trop insuffisant.
1
L'exprience, qui remonte au moins l'ge de Solon et qui pourrait sans doute remonter bien des
sicles en arrire s'il existait des statistiques, nous apprend une vrit que la connaissance de la
nature humaine aurait pu nous rvler, c'est que sur de longues priodes de temps l'unit de salaire
marque une tendance constante la hausse et que sa rduction entrane le dclin et la dissolution
des socits conomiques. Pour des raisons entirement indpendantes du progrs technique et de
l'accroissement de la population, il est donc indispensable que le stock montaire augmente
graduellement.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 146
III
Il est possible que les premiers pionniers de la pense conomique aient adopt
leurs maximes de sagesse pratique sans avoir bien discern les bases thoriques sur
lesquelles elles reposaient. Nous allons examiner rapidement les motifs qu'ils don-
naient et les pratiques qu'ils prconisaient. Le travail nous est grandement facilit par
l'important ouvrage consacr par le Professeur Heckscher au Mercantilisme, ouvrage
qui, pour la premire fois, met la porte du grand public conomique les traits
essentiels qui ont caractris la pense conomique pendant deux sicles. Les cita-
tions suivantes sont pour la plupart empruntes ce livre
1
.
1 Les mercantilistes n'ont jamais cru que le taux de l'intrt tendt se fixer
automatiquement au niveau adquat. Ils affirmaient au contraire avec insistance
qu'une lvation excessive de l'intrt constituait le principal obstacle au dveloppe-
ment de la richesse ; et ils avaient mme compris que le taux de l'intrt dpendait de
la prfrence pour la liquidit et de la quantit de monnaie. Ils cherchaient la fois
diminuer la prfrence pour la liquidit et augmenter la quantit de monnaie ;
plusieurs d'entre eux ont indiqu clairement que leur souci d'accrotre la quantit de
monnaie tait d leur dsir de faire baisser le taux de l'intrt. Le Professeur
Heckscher rsume cet aspect de leur thorie dans les lignes suivantes :
A cet gard comme beaucoup d'autres la position des mercantilistes les plus
perspicaces tait dans certaines limites d'une clart parfaite. La monnaie tait leurs
yeux - pour user du langage actuel - un facteur de production au mme titre que la
terre ; encore qu'elle ft parfois considre comme une richesse artificielle par
opposition la richesse naturelle; l'intrt du capital tait un paiement pour l'usage
de la monnaie et s'apparentait la rente du sol. Dans la mesure o les mercantilistes
se sont efforcs de trouver des raisons objectives l'lvation du taux de l'intrt -ce
qu'ils firent de plus en plus au cours de cette priode - ils ont fait rsider ces raisons
dans le volume global de la monnaie. Parmi les nombreux matriaux dont on dispose,
on ne choisira que les exemples les plus typiques pour dmontrer en tout premier lieu
combien cette ide fut durable, profonde, et indpendante de toute considration
pratique.
Les deux protagonistes de la polmique qui, au dbut de 1620, s'instaura en
Angleterre au sujet de la politique montaire et du commerce des Indes Orientales
taient pleinement d'accord sur ce point. Grard Malynes affirmait, en s'appuyant sur
une argumentation minutieuse, que l'abondance de la monnaie s'oppose au caractre
usuraire des prix et des taux (Lex Mercatoria et Maintenance of Free Trade, 1622).
Son truculent et peu scrupuleux adversaire, Edouard Misselden, rpondait que Le
remde l'usure pouvait rsider dans l'abondance de monnaie (Free Trade or the
Meanes to make Trade Florish, 1622). Parmi les crivains marquants un demi sicle
plus tard, Child, le directeur tout puissant et le plus habile avocat de la Compagnie
des Indes Orientales, se demandait (1668) dans quelle mesure la limitation lgale du
taux de l'intrt, qu'il rclamait avec insistance, contribuerait chasser d'Angleterre
1
Elles conviennent d'autant mieux notre thse que le Professeur Heckscher est, somme toute, un
partisan de la thorie classique et qu'il tmoigne aux ides mercantilistes beaucoup moins de
sympathie que nous-mme. Il n'y a donc aucun risque que le choix des citations ait t inspir par
le dsir de faire ressortir la justesse de ces ides.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 147
l'argent des Hollandais. Pour remdier cet inconvnient redoutable il eut l'ide
d'augmenter les facilits de transfert des lettres de change lorsqu'elles taient em-
ployes en guise de monnaie. Par ce moyen, disait-il, on pourrait certainement
remplacer une bonne moiti du numraire disponible, utilis dans le pays . Un autre
crivain notoire, Petty, qui tait entirement tranger aux intrts en prsence, se
trouvait d'accord avec le reste des auteurs pour expliquer par l'augmentation du stock
montaire la baisse naturelle de l'intrt de 10 6 % (Political Arithnetik, 1676)
et pour prconiser le prt intrt comme remde adquat une abondance excessive
de numraire dans un pays (Quantulumcunque concerning Money, 1682).
Naturellement cette faon de penser n'tait pas spciale l'Angleterre. Quelques
annes plus tard (1701 1706) les ngociants et les hommes d'tat franais dplo-
raient la disette existante des espces, qui tait cause de l'lvation du taux de
l'intrt; et ils s'efforaient de faire baisser ce taux en accroissant la circulation
montaire
1
.
Le grand Locke, dans sa controverse avec Petty
2
, fut peut-tre le premier qui ait
exprim en termes abstraits le rapport existant entre le taux de l'intrt et la quantit
de monnaie. A l'encontre de la proposition de Petty, qui voulait fixer un maximum au
taux de l'intrt, il soutenait qu'une telle limitation tait aussi impossible que celle de
la rente du sol, car la valeur naturelle de la monnaie, c'est--dire son aptitude
fournir un revenu sous forme d'intrt, dpend du rapport entre la quantit globale des
espces circulant dans le Royaume et le commerce total dudit Royaume (i. e. les
ventes totales de toutes les marchandises)
3
. Locke explique que la monnaie a deux
valeurs : elle possde une valeur d'usage mesure par le taux de l'intrt et en cela
elle a la mme nature que la terre, le revenu de l'une tant appel Rente et celui de
l'autre Intrt . Elle possde ensuite une valeur d'change et en cela elle a la nature
d'une marchandise , car sa valeur d'change est uniquement fonction du rapport
entre l'abondance ou la raret de la monnaie et celles des produits ; et le ne dpend
nullement du niveau de l'Intrt . Locke est donc l'auteur d'une double thorie quan-
titative. Il affirme d'abord que le taux de l'intrt dpend de la proportion entre le
volume de la monnaie (compte tenu de sa vitesse de circulation) et le chiffre total du
commerce. Il soutient ensuite que la valeur d'change de la monnaie dpend de la
proportion entre la quantit de monnaie et le volume total des biens existant sur le
march. Mais, ayant un pied dans le monde mercantiliste et l'autre dans le monde
classique
4
, il ne parvient pas lucider la relation existant entre ces deux proportions
1
Heckscher, Mercantilism, voir vol. II, les pages 200 et 201, que nous avons lgrement rsumes.
2
Some considerations of the consequences of the Lowering of Interest and Raising the Value of
Money, ouvrage publi en 1692 mais crit quelques annes auparavant.
3
Il ajoute : Outre le volume de la monnaie, il faut prendre en considration sa vitesse de circu-
lation.
4
Quelques annes plus tard Hume eut un pied et demi dans le monde classique. C'est lui qui intro-
duisit chez les conomistes la coutume de donner la position d'quilibre plus d'importance qu'aux
situations constamment changeantes qui y conduisent. Toutefois il restait assez mercantiliste pour
ne pas ignorer qu'en fait nous vivons dans ces situations transitoires : C'est uniquement dans l'in-
tervalle, ou dans la, situation intermdiaire, qui spare l'acquisition de la monnaie de la hausse des
prix que l'augmentation des stocks d'or et d'argent est favorable l'industrie... Il n'importe
nullement la prosprit intrieure d'un tat que le volume de la monnaie soit plus ou moins
grand. La sagesse chez le souverain ne consiste qu' le maintenir, autant que possible, croissant.
Car c'est ainsi qu'il soutient l'esprit d'entreprise de la nation et qu'il accrot l'activit du travail en
quoi rside toute la puissance et la richesse relles. Pendant tout le temps que le stock Montaire
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 148
et nglige compltement le fait que la prfrence pour la liquidit peut varier. Cepen-
dant, il explique volontiers que la baisse du taux de l'intrt n'a pas d'effet direct sur
le niveau des prix et qu'elle agit sur lui uniquement dans la mesure o les variations
de l'intrt commercial entranent des entres ou des sorties de monnaie et de
marchandises, modifiant ainsi la longue la proportion existant en Angleterre entre
leurs volumes respectifs , ce qui revient dire que la baisse du taux de l'intrt agit
sur les prix uniquement dans la mesure o elle provoque une sortie de numraire ou
un accroissement de la production. Mais il ne semble jamais avoir procd une
vritable synthse de ces diffrentes ides
1
.
L'aisance avec laquelle la doctrine mercantiliste distinguait le taux de l'intrt de
l'efficacit marginale du capital ressort d'Une Lettre Un Ami au sujet de l'Usure,
dont le passage suivant (publi en 1621) a t cit par Locke : L'lvation de
l'intrt ruine le commerce. L'avantage tir de l'intrt tant suprieur au profit laiss
par le commerce, les commerants les plus riches se retirent et les plus pauvres font
faillite . Fortrey (England's Interest and Improvement, 1663) nous offre un autre
exemple de cette insistance affirmer que la faiblesse du taux de l'intrt est un
facteur d'augmentation de la richesse.
Les mercantilistes n'ignoraient pas que, lorsqu'une prfrence excessive pour la
liquidit dtourne vers la thsaurisation les mtaux prcieux imports, le taux de
l'intrt n'en tire aucun avantage. Le dsir. de renforcer le pouvoir du Gouvernement
a nanmoins amen certains d'entre eux (Mun, par exemple) prconiser la consti-
tution d'un trsor d'tat. Mais il en est d'autres qui ont combattu ouvertement cette
politique :
Schrtter, par exemple, emploie les arguments habituels des mercantilistes, lors-
qu'il brosse un sombre tableau du prlvement qu'au del d'une certaine limite
l'augmentation du Trsor d'tat opre sur les espces en circulation... et il tablit aussi
un parallle parfaitement logique entre l'accumulation de trsors par les monastres et
les sorties de mtaux prcieux, qui taient certainement ses yeux la pire chose qui
se pt imaginer. Pour Davenant l'extrme pauvret de maintes nations orientales, qui
passaient pour avoir plus d'or et d'argent que tout autre pays du monde, s'expliquait
par le fait qu' elles supportaient que ces trsors restassent stagnants dans les coffres
des princes ... La thsaurisation d'tat tant considre tout au plus comme d'une
utilit douteuse et prsente souvent comme un grave danger, il va sans dire que la
thsaurisation prive tait redoute comme la peste. C'est une des tendances contre
lesquelles d'innombrables crivains mercantilistes ont lanc leurs foudres, et nous ne
croyons pas qu'on puisse trouver une seule note discordante
2
.
d'une nation diminue, elle est rellement plus faible et plus malheureuse qu'une autre nation dont
le stock montaire n'est pas plus important mais qui se trouve sur la pente ascendante (Essai sur
la Monnaie, 1752).
1
Pour montrer dans quel oubli total est tombe l'ide mercantiliste que l'intrt signifie l'intrt de
l'argent (ide qui nous parat aujourd'hui incontestablement exacte), reproduisons le commentaire
par lequel le Professeur Heckscher, en bon conomiste classique, rsume son expos de la thorie
de Locke : Le raisonnement de Locke serait irrfutable... si l'intrt tait identique au prix pay
pour un prt d'argent; comme il n'en est pas ainsi, ce raisonnement est tout fait inapplicable (op.
cit., vol. II, p. 204).
2
Heckscher, op. cit., vol. II, pp. 210-211.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 149
2 Les mercantilistes n'ignoraient pas l'erreur qu'implique la baisse des prix et
savaient que le dveloppement exagr de la concurrence dans un pays risque d'ame-
ner une volution dfavorable ce pays du taux du troc extrieur. C'est ainsi que
Malynes crivait dans sa Lex Mercatoria (1622) : Ne vous efforcez pas au dtri-
ment de la communaut de vendre meilleur march que les autres sous couleur de
dvelopper le commerce ; le commerce ne se dveloppe pas lorsque les marchandises
sont trs bon march, car la faiblesse des prix rsulte de la modicit de la demande et
de la raret de la monnaie qui font le bon march des choses; c'est au contraire lors-
qu'il y a abondance de monnaie, et que les marchandises tant demandes deviennent
plus chres, que le commerce se dveloppe
1
. Le Professeur Heckscher rsume ainsi
ce chapitre de la doctrine mercantiliste :
Pendant un sicle et demi on a exprim maintes et maintes fois cette opinion, en
disant qu'un pays relativement moins riche en numraire que les autres est oblig de
vendre bon march et d'acheter cher ...
Cette tendance apparaissait dj dans l'dition originale du Discours de la Ri-
chesse Publique, c'est--dire au milieu du XVIe sicle. Hales disait en effet: Et
mme si les trangers ne prenaient que nos marchandises en change des leurs,
qu'est-ce qui les empcherait de faire monter les prix des autres choses (ce qui signi-
fiait les prix entre autres des choses que nous leur achetons), bien que nos marchan-
dises soient pour eux trs bon march. Nous serons encore lss et les trangers
garderont l'avantage sur nous, tant qu'ils nous vendront cher et nous achteront bon
march, de manire s'enrichir en nous appauvrissant. Aussi nous semble-t-il prf-
rable d'accrotre, comme on le fait maintenant, les prix de nos marchandises mesure
qu'ils accroissent le prix des leurs; sans doute certains y perdent-ils, mais ils sont
moins nombreux qu'avec l'autre mthode . Sur ce point il recueillit plusieurs dcades
plus tard (1581) l'adhsion pleine et entire de son diteur. Au XVIIe sicle la mme
opinion reparut avec une importance sensiblement gale. Malynes estimait par exem-
ple que les difficults de l'poque rsultaient de ce qu'il redoutait par-dessus tout : la
sous-estimation du change anglais l'tranger... La mme conception se retrouvait
sans cesse cette poque. Dans Verbum Sapienti (crit en 1665, publi en 1691)
Petty soutenait que les efforts violents pour accrotre la quantit de monnaie ne pour-
raient cesser que lorsque, en proportion arithmtique comme en proportion gom-
trique, lAngleterre aurait un stock montaire suprieur (si peu que ce soit) celui de
toute autre nation voisine. Pendant la priode qui s'coule entre la rdaction et la
publication de ce livre, Coke dclare : Pourvu que notre trsor soit suprieur celui
des nations voisines, peu m'importe qu'il tombe au cinquime de son montant actuel
(1675)
2
.
3 Les mercantilistes ont t les auteurs de la thse qui fait rsider les causes du
chmage dans la fuite devant les biens rels et dans la raret de la monnaie, thse
que deux sicles plus tard les classiques ont dclare absurde.
Un des premiers cas o le chmage ait servi d'argument pour prohiber les impor-
tations se rencontre Florence en 1426 ... l'a lgislation anglaise sur ce point remonte
au moins 1455 ... Un dcret presque contemporain, qui date de 1466 et qui a t la
base de l'industrie lyonnaise de la soie destine devenir si fameuse par la suite, est
moins intressant, car il n'est pas rellement dirig contre l'introduction des mar-
1
Heckscher, op. cit., vol. II, p. 228.
2
Heckscher, op. cit., vol. II, p. 235.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 150
chandises trangres. Mais il mentionne lui aussi la possibilit de donner du travail
des dizaines de milliers de chmeurs des deux sexes. On voit combien l'poque
cette ide tait dans l'air...
Cette question comme la plupart des problmes conomiques et sociaux fut pour
la premire fois srieusement discute en Angleterre sous les rgnes d'Henri VIII et
d'Edouard VI, vers le milieu du XVIe ou plutt un peu avant. A cet gard nous ne
pouvons pas ne pas mentionner une srie d'crits qui semblent avoir t composs au
plus tard vers 1530 et qui sont attribus au moins en ce qui concerne deux d'entre eux
Clment Armstrong... Il s'exprime par exemple de la faon suivante : L'abondance
des marchandises et des denres introduites annuellement en Angleterre n'a pas
seulement rarfi la monnaie, elle a encore ruin tous les mtiers grce auxquels la
grande masse du peuple devrait trouver du travail et en tirer l'argent ncessaire
payer le boire et le manger, au lieu d'tre rduite comme aujourd'hui vivre dans
l'oisivet, mendier et voler
1
.
Le plus bel exemple, notre connaissance, d'une discussion typiquement mercan-
tiliste sur une situation de cette nature est le dbat relatif la raret de la monnaie qui
eut lieu la Chambre des Communes en 1621, une poque o il existait une crise
grave, particulirement dans les industries exportatrices de textiles. La situation fut
expose trs clairement par un des membres les plus influents du Parlement, sir
Edwyn Sandys. Il dclara que les fermiers et les artisans souffraient un peu partout,
que les mtiers taient arrts par l'insuffisance de la monnaie circulant dans le pays,
et que les paysans se trouvaient dans l'impossibilit d'excuter leurs contrats, non
(grce Dieu) cause de l'insuffisance des produits du sol, mais en raison du manque
de monnaie . Cette situation motiva des enqutes minutieuses destines dterminer
o avait pu aller la monnaie dont l'absence se faisait si svrement sentir. De
nombreuses attaques furent diriges contre toutes les personnes que l'on souponnait
d'avoir contribu soit une exportation (non compense par une importation) de
mtaux prcieux, soit la disparition de ces mtaux par suite d'oprations du mme
ordre ralises l'intrieur
2
.
Les mercantilistes n'ignoraient pas que, suivant l'expression du Professeur
Heckscher, leur politique faisait d'une pierre deux coups . Le pays tait d'abord
dbarrass d'un excdant indsirable de marchandises, qui tait cens produire du
chmage, et ensuite le stock total de monnaie existant dans le pays se trouvait
accru
3
, ce qui avait l'avantage de faire baisser le taux de l'intrt.
Il est impossible d'tudier les ides auxquelles les mercantilistes ont t conduits
par leurs expriences concrtes, sans constater qu'au cours de toute l'histoire de
l'humanit la propension pargner a constamment tendu tre plus forte que
l'incitation investir. La faiblesse de l'incitation investir a t de tout temps la clef
du problme conomique. Il est possible qu'aujourd'hui la raison de cette faiblesse
rside dans l'importance des capitaux accumuls, alors qu'autrefois les risques et les
dangers de toute sorte ont pu jouer un rle plus important. Mais le rsultat est le
mme. Le dsir de l'individu d'augmenter sa fortune personnelle en s'abstenant de
1
Heckscher, op. cit., vol. II, p. 122.
2
Heckscher, op. cit., vol. II, p. 223.
3
Heckscher, op. cit., vol. Il, p. 178.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 151
consommer est en gnral plus puissant que le motif de l'entrepreneur accrotre la
richesse nationale en employant de la main-d'uvre la cration de richesses
durables.
4 Les mercantilistes ne se faisaient pas d'illusions sur le caractre nationaliste de
leur politique et sa tendance favoriser la guerre. C'taient de leur propre aveu des
avantages nationaux et une puissance relative qu'ils recherchaient
1
.
Nous pouvons leur reprocher l'indiffrence apparente avec laquelle ils acceptaient
cette consquence invitable d'un systme montaire international. Mais sur le plan
intellectuel leur ralisme est bien prfrable aux ides confuses des contemporains
qui prconisent un talon-or international fixe et le laissez-faire en matire d'em-
prunts internationaux, estimant que cette double politique est la plus favorable au
maintien de la paix.
Car, dans une conomie soumise des contrats libells en monnaie et des habi-
tudes plus ou moins stables, o le stock de monnaie et le taux d'intrt intrieurs
dpendent surtout de la balance des paiements, comme c'tait le cas en Grande-
Bretagne avant la guerre, les autorits n'ont leur disposition qu'un seul moyen ortho-
doxe de lutter contre le chmage, c'est de crer un excdant d'exportations et d'impor-
ter le mtal montaire au dtriment des nations voisines. On n'a jamais invent au
cours de l'histoire de systme plus efficace que celui de l'talon-or ou autrefois de
l'talon-argent - international pour dresser les intrts des diffrentes nations les uns
contre les autres. Dans ce systme en effet la prosprit intrieure de chaque pays
dpend directement du rsultat d'une lutte pour la possession des marchs et pour la
satisfaction des besoins de mtaux prcieux. La comptition a pu tre un peu moins
pre certaines poques lorsque par un heureux hasard la production d'or et d'argent
tait relativement abondante. Mais le dveloppement de la richesse et l'affaiblisse-
ment de la propension consommer ont tendu la rendre de plus en plus meurtrire.
Le rle jou par les conomistes orthodoxes, dont le bon sens n'a pas suffi triom-
pher de la mauvaise logique, a t dsastreux jusqu'au bout. Lorsque certains pays,
dans leur effort aveugle pour se tirer d'affaire, brisrent les chanes qui s'opposaient
l'existence d'un taux d'intrt autonome, ces conomistes dclarrent que le rta-
blissement de ces chanes tait la premire tape obligatoire d'une reprise gnrale.
C'est le contraire qui est vrai. Une politique de taux d'intrt autonome, exempte
de toute proccupation internationale, et d'investissements nationaux raliss suivant
un programme propre rendre maximum le volume de l'emploi intrieur est double-
ment salutaire, en ce sens qu'elle profite tout la fois au pays qui l'applique et aux
pays voisins. Et c'est la mise en oeuvre simultane de ces deux politiques dans tous
les pays qui peut sur le plan international rtablir la sant et la force conomiques,
1
A l'intrieur du pays, les mercantilistes poursuivaient des fins totalement dynamiques. Mais la
chose importante est qu'une telle manire de voir se conjuguait avec une conception statique des
ressources conomiques globales du monde ; c'est de l qu'est n le dsaccord fondamental qui a
entretenu des luttes commerciales sans fin... Tel fut le drame du mercantilisme. Le Moyen Age
avec son idal universel statique et le laissez-faire avec son idal universel dynamique ont tous
deux chapp cette consquence (Heckscher, op. cit., vol. Il, pp. 25-26).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 152
qu'on les mesure au montant de l'emploi intrieur ou au volume du commerce
international
1
.
IV
Les mercantilistes avaient bien senti la prsence d'une difficult; mais, faute
d'avoir pouss assez loin l'analyse, ils n'avaient pu la rsoudre. Les conomistes clas-
siques, au contraire, ont ignor le problme : ils avaient introduit dans leurs prmisses
des conditions incompatibles avec son existence ; de l vient le divorce entre les
conclusions de la thorie conomique et celles du bon sens. La thorie classique a
remport un succs extraordinaire en triomphant, bien qu'elle fut fausse, des croyan-
ces de l'homme moyen. Comme le dit le Professeur Heckscher :
Si les ides essentielles relatives la monnaie et sa substance n'ont pas vari
depuis les Croisades jusqu'au XVIIIe sicle, c'est qu'on se trouve en prsence de
notions fortement enracines. Peut-tre mme ces notions ont-elles persist aprs
cette priode de cinq cents ans, mais avec beaucoup moins de force que la notion de
fuite devant les biens rels . Aucune poque autre que celle du laissez-faire n'a
chapp l'empire de ces ides. Seule l'extraordinaire tnacit de l'ide de laissez-
faire a pu triompher pour un temps des croyances de l'homme moyen en cette
matire
2
.
Il n'a fallu rien moins que la foi absolue des doctrinaires du laissez-faire pour
effacer l'ide de fuite devant les richesses ... (qui) dans une conomie montaire
est l'attitude la plus naturelle l'homme moyen. Le libre change niait l'existence de
facteurs qui paraissaient vidents ; il tait vou tomber en discrdit dans l'opinion
de l'homme de la rue le jour o l'cole du laissez-faire ne tiendrait plus les esprits
enchans son idologie
3
.
Il nous souvient du complexe d'irritation et de perplexit que ressentait Bonar
Law devant les conomistes, ngateurs d'vidence ; en vain cherchait-il les com-
prendre. L'empire de l'cole classique vous fait songer naturellement celui de certai-
nes religions. Il faut plus de pouvoir pour vaincre l'vidence que pour introduire les
ides de mystre et de surnaturel dans les notions habituelles de l'esprit humain.
V
Reste un domaine connexe mais distinct o, pendant des sicles, voire mme
pendant des millnaires, l'opinion claire a tenu pour certaine et vidente une doc-
trine que l'cole classique a limine comme purile. Cette doctrine, qui mrite d'tre
rhabilite et considre avec gards, est que le taux de l'intrt ne se fixe pas de lui-
1
La proclamation nergique de cette vrit par le Bureau* International du Travail, d'abord sous
Albert Thomas et ensuite sous M. H. B. Butler, tranche d'une faon remarquable parmi les
dclarations publies par les nombreux organismes internationaux d'aprs-guerre.
2
Heckscher, op. cit., t. II, pp. 176-177.
3
Heckscher, op. cit., vol. Il, p. 335.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 153
mme au niveau le plus conforme l'utilit sociale, mais qu'il tend constamment vers
un niveau trop lev, de telle sorte que la sagesse commande aux Gouvernements de
le modrer par la lgislation et la coutume, voire mme en invoquant les sanctions de
la loi morale.
Les lois contre l'usure figurent parmi les mesures conomiques les plus anciennes
que l'histoire nous ait rapportes. L'Antiquit et le Moyen-Age considraient la
disparition de l'incitation investir sous l'effet d'une prfrence excessive pour la
liquidit comme le mal essentiel, l'obstacle principal au dveloppement de la riches-
se. Et c'tait bien naturel ; certains des risques et des hasards de la vie conomique
diminuent en effet l'efficacit marginale du capital tandis que les autres renforcent la
prfrence pour la liquidit. Dans un monde que personne ne jugeait sr, il tait
presque invitable que le taux de l'intrt, moins d'tre rduit par tous les moyens
dont la socit disposait, ft trop lev pour rendre possible une incitation suffisante
investir.
Nous avons t instruit dans la croyance que l'attitude de lglise du Moyen-Age
envers le taux de l'intrt tait essentiellement absurde et que les argumentations
subtiles destines tablir une distinction entre le revenu des prts et le revenu des
investissements actifs n'taient que moyens jsuitiques pour chapper une thorie
draisonnable. Aujourd'hui ces argumentations nous apparaissent au contraire comme
un effort intellectuel loyal en vue de maintenir une sparation entre deux facteurs que
la thorie classique a confondus d'une manire inextricable : le taux de l'intrt et
l'efficacit marginale du capital. Il semble vident l'heure actuelle que les travaux
des scolastiques taient destins trouver une formule permettant tout la fois
d'accrotre l'efficacit marginale du capital et de faire appel la lgislation, la cou-
tume et la loi morale pour maintenir un taux d'intrt faible.
Adam Smith lui-mme s'est montr extrmement 'modr dans son apprciation
des lois contre l'usure. Il savait bien que l'pargne individuelle peut tre absorbe soit
par les investissements soit par les prts et qu'on n'est jamais sr qu'elle trouvera un
dbouch dans les investissements. Il a mme prconis la baisse du taux de l'intrt
parce que, plus le taux de l'intrt est faible, plus il y a de chances que l'pargne trou-
ve un dbouch dans les investissements nouveaux, et moins il y a de chance qu'elle
s'oriente vers les prts; c'est pourquoi, dans un passage qui lui a valu d'tre svre-
ment pris partie par Bentham
1
, il recommande une application modre des lois
contre l'usure
2
. D'ailleurs les critiques de Bentham portent principalement sur la
rigueur excessive qu'Adam Smith, cossais prudent, tmoigne aux pionniers et sur
le fait qu'un taux d'intrt maximum ne laisse pas une marge suffisante pour la rmu-
nration des risques lgitimes et socialement utiles. Par pionniers Bentham entend
toute personne qui, dans la poursuite de la richesse ou de tout autre but, s'efforce,
avec l'aide du capital, de frayer des voies nouvelles l'invention... et surtout les
personnes qui, dans l'ordre de leurs occupations quelles qu'elles soient, cherchent
raliser ce qu'on peut appeler une amlioration... Il s'agit en bref de toute application
des forces humaines dans lesquelles l'ingniosit ne saurait se passer de l'aide de la
richesse . A coup sr, Bentham a raison de protester contre les lois qui empchent de
prendre des risques lgitimes. Dans ces conditions , continue Bentham, un
1
Dans sa Lettre Adam Smith jointe sa Defence of Usury.
2
La Richesse des Nations, Livre Il, Chap. IV.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 154
homme ne cherchera pas distinguer les bons et les mauvais projets, il se tiendra
l'cart de toute entreprise
1
.
On peut se demander si ce qui prcde correspond bien l'ide d'Adam Smith. Ou
bien les paroles de Bentham ne sont-elles pas plutt la voix de l'Angleterre du XIXe
sicle s'adressant celle du XVIIIe (bien qu'il les ait crites au mois de mars 1787 de
Crichoff en Russie Blanche ) ? Il a fallu toute l'exubrance conomique qui a
marqu l'ge d'or de l'incitation investir pour faire oublier la possibilit thorique de
son insuffisance.
VI
Il convient de mentionner cette place l'trange prophte Silvio Gesell (1862-
1930), qui a t injustement mconnu. Son oeuvre contient des clairs de perspicacit
pntrante et il s'en fallut de peu qu'il n'atteignit le fond du problme. Pendant les
annes d'aprs-guerre ses disciples nous bombardrent d'exemplaires de ses ouvrages
; mais, en raison de certains dfauts manifestes de l'argumentation, nous fmes trs
loin d'en dcouvrir le mrite. Comme cela arrive souvent dans le cas d'ides imparfai-
tement analyses, leur importance ne nous apparut clairement que lorsque nous fmes
arrives par nos propres moyens des conclusions personnelles. Dans l'intervalle nous
estimions, comme les autres conomistes universitaires, que ses efforts profondment
originaux ne mritaient gure plus d'attention que luvre d'un dsquilibr. La plu-
part des lecteurs du prsent ouvrage n'auront sans doute pas eu l'occasion d'apprcier
l'importance des travaux de Gesell. Aussi leur accorderons-nous une place qui sans
cela serait disproportionne.
Gesell tait un commerant allemand prospre
2
, install Buenos Ayres. Il fut
amen l'tude des problmes montaires par la crise des dernires annes de la
dcade 1880-1890, qui, en Argentine, fut particulirement violente. Il publia
Buenos Ayres, en 1891, son premier ouvrage : Die Reformation im Mnzwesen als
Brcke zum socialen Staat
3
. Un livre intitul Nervus Rerum, publi galement
Buenos Ayres la mme anne, contient ses ides principales sur la monnaie. Maints
autres livres et brochures suivirent, jusqu'en 1906, date laquelle il se retira en
Suisse. Il avait alors une certaine aisance et put consacrer les dernires dcades de
son existence aux deux occupations les plus agrables lorsqu'on n'a pas gagner sa
vie : crire et cultiver la terre.
La premire partie de son oeuvre matresse fut publie, en 1906, aux Hauts
Geneveys, Suisse, sous le titre Die Verwirklichung des Rechtes auf dem vollen
1
Puisque nous avons commenc citer Bentham, nous ne pouvons nous dispenser de rappeler au
lecteur une de ses plus jolies phrases: On peut considrer le domaine de la technique, cette
grand'route o cheminent les pionniers, comme une plaine vaste, illimite peut-tre, toute parse-
me de gouffres comme celui o Curtius fut prcipit, Il faut que chacun d'eux reoive une victime
humaine avant qu'on puisse le combler. Mais une fois qu'il est combl, il est clos pour ne plus
s'ouvrir; et la scurit de la route se trouve accrue d'autant pour ceux qui suivent.
2
N prs de la frontire de Luxembourg d'un pre allemand et d'une mre franaise.
3
La rforme du rgime montaire, tape vers un tat social.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 155
Arbeitsertrag
1
, et la seconde partie en 1911, Berlin, sous le titre Die Neue Lekre
vom Zins
2
. Elles furent runies dans un mme ouvrage, publi Berlin et en Suisse
pendant la guerre (1916) et dit six fois du vivant de l'auteur sous le nom de Die
natrliche Wirtschaftordnung durch Freiland und Freigeld
3
; la traduction anglaise
faite par M. Philip Pye a t intitule The Natural Economic Order. En avril 1919
Gesell entra dans l'phmre Soviet de Bavire comme Ministre des Finances et fut
ultrieurement traduit devant une cour martiale. Il passa les dix dernires annes de
sa vie Berlin et en Suisse et se consacra la propagande. Attirant lui la ferveur
quasi religieuse dont Henry George avait jadis t l'objet, Gesell devint le prophte
vnr d'un culte groupant travers le monde des milliers de disciples. Le premier
congrs international de la Ligue Suisse et Allemande pour l'affranchissement du sol
et de la monnaie et des associations analogues existant en de nombreux pays se tint
Ble en 1923. Depuis la mort de Gesell survenue en 1930 une grande partie de la
ferveur spciale que suscitent les doctrines comme les siennes s'est porte sur d'autres
prophtes (moins minents notre avis). Le mouvement est dirig en Angleterre par
le Docteur Bchi, dont les publications semblent d'ailleurs provenir de San Antonio,
Texas ; son foyer principal est aujourd'hui aux tats-Unis, o Irving Fisher est le seul
conomiste d'Universit qui en ait reconnu l'importance.
Malgr l'appareil prophtique dont ses disciples l'ont orn, le livre principal de
Gesell est crit dans une langue froide et scientifique, encore qu'il soit tout imprgn
d'un amour de la justice sociale atteignant un degr de chaleur et de passion que
d'aucuns jugent excessifs chez un savant. La partie qui drive de Henry George
4
,
bien que sans aucun doute elle ait beaucoup contribu la puissance du mouvement,
est d'un intrt tout fait secondaire. On peut dire que le but gnral du livre est de
construire un socialisme anti-marxiste, de lutter contre le laissez-faire en utilisant des
raisons thoriques entirement diffrentes de celles de Marx, puisqu'elles reposent sur
la rpudiation et non sur l'acceptation des hypothses classiques, sur la suppression
des entraves la concurrence et non sur son abolition. Nous estimons que l'avenir
aura plus tirer de la pense de Gesell que de celle de Marx. Le lecteur qui se repor-
tera la prface de l'Ordre conomique Naturel pourra apprcier la valeur morale de
Gesell. C'est dans cette prface qu'il faut chercher notre avis la rponse au
Marxisme.
La contribution propre de Gesell la thorie de la monnaie et de l'intrt est la
suivante. En premier lieu il fait nettement la distinction entre le taux de l'intrt et
l'efficacit marginale du capital, et il soutient que c'est le taux de l'intrt qui fixe une
limite la vitesse d'accroissement du capital rel. Il montre ensuite que le taux de
l'intrt est un phnomne purement montaire, que la particularit de la monnaie qui
donne au taux d'intrt de la monnaie son importance est le fait que sa possession en
tant que moyen de constituer une rserve de richesse n'entrane pour ceux qui la
dtiennent que des frais de conservation ngligeables, et que les richesses comportant
des frais de conservation apprciables, comme les stocks de marchandises, fournis-
sent en fait un revenu cause du niveau fix par la monnaie. Il trouve dans la stabilit
relative du taux de l'intrt travers les ges une preuve que ce taux ne peut dpendre
1
La ralisation pratique du droit au produit intgral du travail.
2
Les lois nouvelles de l'Intrt.
3
L'ordre conomique naturel fond sur l'affranchissement du Sol et de la Monnaie.
4
Gesell, la diffrence de George, recommande de payer des indemnits en cas de nationalisation
de la terre.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 156
de facteurs purement physiques, car les variations des facteurs de cet ordre d'une
poque l'autre ont t sans aucun doute infiniment plus fortes que celles qu'on
observe dans le taux de l'intrt ; ceci revient dire (dans notre langage) que le taux
de l'intrt, lequel dpend de facteurs psychologiques constants, est rest stable et que
les facteurs trs instables qui agissent en premier lieu sur la courbe de l'efficacit
marginale du capital ont dtermin, non le taux de l'intrt, mais la -vitesse laquelle
le taux de l'intrt (qui dans une certaine mesure tait donn) a permis au stock de
capital rel de s'accrotre.
Cette thorie prsente toutefois un grave dfaut. Gesell dmontre que c'est unique-
ment parce qu'il existe un taux d'intrt de la monnaie qu'on peut obtenir un revenu
en prtant des stocks de marchandises. Son dialogue entre Robinson Cruso et un
tranger
1
est une excellente parabole conomique - une des meilleures qu'on ait
crites l'appui de cette affirmation. Mais, une fois qu'il a donn la raison pour
laquelle le taux d'intrt de la monnaie, la diffrence de la plupart des taux d'intrt
de marchandises, ne peut tre ngatif, il ne voit nullement la ncessit d'expliquer
pourquoi ce taux d'intrt est positif, et il ne parvient pas dmontrer que ce n'est pas
le niveau fix par le rendement du capital productif qui gouverne le taux de l'intrt
(comme le soutient l'cole classique). La notion de prfrence pour la liquidit lui a
en effet compltement chapp. Il n'a construit qu' moiti la thorie du taux de
l'intrt.
C'est srement cause de ses lacunes que la thorie de Gesell n'a gure retenu
l'attention des milieux universitaires. Pourtant il l'avait suffisamment approfondie
pour aboutir une recommandation pratique qui, sans tre applicable sous la forme
qu'il a propose, n'en contient peut-tre pas -moins l'essentiel du remde ncessaire. Il
soutient que le dveloppement du capital rel est contrari par le taux d'intrt de la
monnaie et que, en l'absence d'un tel obstacle, ce dveloppement dans le monde
moderne serait Bi rapide qu'un taux d'intrt de la monnaie nul se trouverait justifi
sinon immdiatement du moins dans un dlai relativement court. Il importe donc
avant tout d'abaisser le taux d'intrt de la monnaie et Gesell montre qu'on peut y
parvenir en faisant supporter la monnaie des frais de conservation semblables
ceux qui grvent les autres stocks de marchandises improductives. Ceci le conduit au
fameux systme de la monnaie estampille , auquel on a surtout associ son nom
et qui a reu le suffrage du Professeur Irving Fisher. Dans ce systme les billets en
circulation (et il est clair qu'au moins certaines formes de monnaie de banque de-
vraient tre soumises au mme rgime) ne pourraient conserver leur valeur qu' la
condition d'tre revtus chaque mois (comme une carte d'assurances) d'une estampille
dlivre par les bureaux de poste. On pourrait bien entendu fixer le prix de l'estam-
pille au chiffre convenable. Selon notre thorie ce prix devrait tre approximative-
ment gal l'excs du taux de l'intrt de la monnaie (abstraction faite des estam-
pilles) sur l'efficacit marginale du capital qui correspond au flux d'investissement
nouveau compatible avec le plein emploi. En fait, Gesell proposa un droit de 1 % par
semaine, soit 5,2 % par an. Ce chiffre serait trop lev dans les circonstances actu-
elles ; seuls des ttonnements et des preuves pourraient indiquer le chiffre correct,
lequel devrait d'ailleurs tre modifi de temps autre. L'ide sur laquelle repose la
monnaie estampille est juste. Il est possible qu'on trouve le moyen de l'appliquer sur
une chelle restreinte. Mais elle soulve de nombreuses difficults que Gesell a igno-
res. Il n'avait pas compris en particulier que la monnaie n'est pas la seule richesse
assortie d'une prime de liquidit, qu'il n'y a qu'une diffrence de degr entre elle et
1
The Natural Economic Order, pp. 297 et suiv.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 157
beaucoup d'autres articles, et qu'elle tire son importance du fait qu'elle a une prime de
liquidit plus forte qu'aucun autre article. Si les billets en circulation devaient tre
privs de leur prime de liquidit, toute une srie de succdans viendraient prendre
leur place, monnaie de banque, crances vue, monnaies trangres, pierreries,
mtaux prcieux en gnral, etc. A certaines poques, ce fut sans doute, comme nous
Pavons indiqu prcdemment, le got de la proprit foncire, abstraction faite de
son rendement, qui contribua maintenir l'lvation du taux de l'intrt - dans le
systme de Gesell ce phnomne serait rendu impossible par la nationalisation des
terres.
VII
Les thories que nous avons examines ci-dessus concernent essentiellement
l'lment de la demande effective qui repose sur l'existence d'une incitation suffisante
investir. Ce n'est pourtant pas une nouveaut, d'attribuer le chmage l'insuffisance
de l'autre lment, c'est--dire l'insuffisance de la propension consommer. Mais
cette autre explication des maux conomiques contemporains, galement impopulaire
auprs des conomistes classiques, a jou un rle bien moindre dans la pense du
XVIe et du XVIIe sicles; c'est seulement une date relativement rcente qu'elle a
acquis de l'importance.
Bien que les dolances contre la sous-consommation n'aient t qu'un aspect
secondaire de la pense mercantiliste, le Professeur Heckscher cite un certain nombre
d'exemples de, ce qu'il appelle la ferme croyance l'utilit du luxe et la nuisance
de l'conomie: En fait, l'pargne tait considre comme la cause du chmage; et ce
pour deux raisons : d'abord parce qu'on estimait que le revenu rel diminuait de la
quantit de monnaie qui n'entrait pas dans les changes, ensuite parce que l'pargne
tait cense retirer de la monnaie de la circulation
1
. En 1598 Laffemas (Les Trsors
et Richesses pour mettre l'Estat en Splendeur) combattait les adversaires de l'emploi
des soieries franaises, parce que les acqureurs de produits franais de luxe
procuraient aux pauvres des moyens de subsistance, alors que les avares les faisaient
mourir de misre
2
. En 1662, Petty justifiait les ftes, les spectacles somptueux, les
arcs de triomphe , etc. en arguant que leurs cots entraient dans la poche des bras-
seurs, boulangers, tailleurs, bottiers et autres. Fortrey approuvait la prodigalit dans
le vtement . Von Schrtter (1686) attaquait les lois somptuaires et souhaitait qu'il y
et plus de faste dans l'habillement et les autres lments du train de vie. Barbon
(1690) crivait que la Prodigalit est un vice prjudiciable l'Homme, mais non au
Commerce ... et que l'Avarice est un vice prjudiciable la fois l'Homme et au
Commerce
3
. En 1695 Cary soutenait que, si tout le monde dpensait plus, chacun
aurait un revenu suprieur et pourrait vivre plus. largement
4
.
1
Op. cit., vol. II, p. 208.
2
Op., cit., vol. II, p. 290.
3
Op., cit., vol. II, p. 291.
4
Op. cit., vol. II, p. 209.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 158
Mais c'est la Fable des Abeilles de Bernard de Mandeville qui contribua le plus
vulgariser l'opinion de Barbon. Ce livre fut dclar subversif par le Grand Jury de
Middlesex en 1723, et sa rputation scandaleuse lui assigne une place marquante dans
l'histoire des sciences morales. Un seul homme a dit un mot en sa faveur, le Docteur
Johnson, qui reconnat que l'ouvrage, loin de l'avoir indign, lui a grandement
ouvert les yeux sur la vie relle . L'analyse de Leslie Stephen dans le Dictionnaire
de Biographie Nationale fera ressortir mieux que tout autre commentaire en quoi
consiste l'immoralit du livre :
Mandeville a caus un grand scandale en publiant ce livre, dans lequel un syst-
me moral cynique est rendu attrayant par d'ingnieux paradoxes... Sa doctrine d'aprs
laquelle la dpense contribue plus que l'pargne la prosprit s'accordait avec de
nombreux sophismes conomiques qui taient en cours cette poque et qui n'ont pas
encore entirement disparu
1
. En supposant avec les asctes que les dsirs humains
sont essentiellement mauvais et partant qu'ils donnent naissance des vices prives
, puis en admettant l'opinion commune que la richesse est un bienfait public , il
dmontre aisment que toute civilisation implique le dveloppement de tendances
vicieuses...
La Fable des Abeilles est un pome allgorique Les Murmures de la ruche ou
les Fripons devenus honntes . L'auteur y dpeint la situation pouvantable d'une
communaut prospre o brusquement, dans l'intrt de l'pargne, les citoyens dci-
dent de renoncer la vie luxueuse et l'tat d'arrter les armements.
Aucun seigneur maintenant ne s'honore
De vivre aux dpens de ses cranciers.
Les livres s'amassent chez les fripiers.
On abandonne vil prix ses carrosses,
On vend de magnifiques attelages,
Et des villas pour rembourser ses dettes ;
On fuit la dpense comme une faute ;
On n'entretient plus d'arme au dehors ;
On mprise l'opinion trangre,
Et aussi la vaine gloire des armes.
On se bat encore, mais pour le pays,
Lorsque Droit et Libert sont en cause.
Chlo la Hautaine
Retranche sur ses menus dispendieux
Et porte un an entier la mme robe.
Et quel est le rsultat ?
Contemplez maintenant la Ruche illustre.
Comment s'accordent Commerce et Vertu ?
1
Dans son History of English Thought in the Eighteenth Century (p. 297), Stephen crit au sujet du
sophisme rendu clbre par Mandeville que sa rfutation complte rside dans la doctrine
d'aprs laquelle la demande de marchandises ne constitue pas une demande de travail, doctrine si
rarement comprise que son intelligence parfaite est peut-tre le meilleur brevet d'conomiste .
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 159
De son luxe il ne reste plus de trace ;
Elle apparat sous un aspect tout autre.
Car ceux qui faisaient de grosses dpenses
Ne sont pas les seuls qui doivent partir ;
Les multitudes qu'ils entretenaient
Sont forces aussi chaque jour de fuir.
C'est en vain qu'on cherche un autre mtier ;
Tous, ils sont galement encombrs.
Le prix des terres et des maisons s'effondre.
Les palais enchants, dont les murailles
Comme celles de Thbes avaient t
Bties dans la joie, sont abandonns.
...............................................................
Dans la construction l'arrt est total ;
Les artisans ne trouvent plus d'emploi ;
La peinture n'illustre plus personne ;
On ne cite aucun sculpteur ni graveur.
La morale est donc que
La Vertu seule ne peut faire vivre
Les nations dans la Splendeur. Qui veut
Ramener l'ge d'or doit accueillir
galement le Vice et la Vertu.
Par les deux passages ci-aprs, extraits du commentaire qui fait suite l'allgorie,
on verra que celle-ci ne manquait pas de base thorique.
Une sage conomie, que d'aucuns appellent pargne, est dans les familles pri-
ves le moyen le plus sr d'augmenter les patrimoines. Certains estiment que dans
l'ensemble d'un pays, fertile ou non, la mme mthode peut tre applique et doit
produire le mme effet. Ils pensent par exemple que les Anglais pourraient tre beau-
coup plus riches qu'ils le sont, s'ils taient aussi conomes que certains de leurs
voisins. C'est notre avis une erreur
1
.
Mandeville conclut au contraire :
Tout l'art de rendre une nation heureuse et florissante consiste donner chacun
la possibilit d'tre employ. Pour y parvenir, le premier souci d'un Gouvernement
doit tre de favoriser tous les genres de manufactures, d'arts et de mtiers, que l'hom-
me peut inventer ; le second d'encourager l'agriculture et la pche afin que la nature
tout entire soit, comme l'homme, mise contribution. C'est par cette politique et non
par une futile rglementation de la prodigalit et de l'conomie qu'on peut accrotre la
grandeur et le bonheur des nations. Que la valeur de l'or et de l'argent croisse ou
dcroisse, la satisfaction des socits dpendra toujours des fruits de la terre et du
1
Ce passage est rapprocher de la phrase suivante crite par Adam Smith, le prcurseur de l'cole
classique, qui s'y est peut-tre rfr : Ce qui est sage dans la conduite d'une famille prive peut
tre presque fou dans la conduite d'un grand tat.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 160
travail des hommes ; lesquels forment ensemble un trsor plus sr, plus inpuisable et
plus rel que l'or du Brsil ou l'argent de Potosi.
Il n'est pas surprenant que des sentiments aussi pervers aient t fltris par deux
sicles de moralistes et d'conomistes, qui se sentaient beaucoup plus vertueux en
possession de leur austre doctrine d'aprs laquelle, hors la pratique de l'pargne la
plus stricte par les individus et par l'tat, il n'existe pas de salut. Les ftes, les
spectacles somptueux, les arcs de triomphe, etc. , de Petty firent place aux cono-
mies de bout de chandelle de la finance gladstonienne et un systme politique qui
n'avait pas les moyens de crer des hpitaux, des esplanades ou de beaux btiments,
ni mme d'entretenir ses monuments anciens, ni encore moins de favoriser l'clat de
la musique et du thtre, toutes choses qu'on abandonnait la charit prive ou la
munificence de particuliers imprvoyants.
Cette doctrine ne reparut dans les cercles distingus qu'un sicle plus tard, au
cours de la dernire priode de la vie de Malthus, lorsque la notion d'insuffisance de
la demande effective acquit une certaine importance parmi les explications scientifi-
ques du chmage. Nous avons dj trait assez longuement cette question dans notre
Essai sur Malthus
1
. Il nous suffira donc de reproduire ici un ou deux passages
caractristiques, qui ont dj t cits dans le dit Essai.
Dans presque toutes les parties du monde on voit d'immenses forces productives
qui ne sont pas mises en oeuvre ; nous expliquons ce phnomne en disant que, faute
d'une bonne distribution des produits existants, il n'y a pas de motifs suffisants de
continuer produire... Nous affirmons expressment qu'un trs grand effort de capita-
lisation, qui implique une diminution considrable de la consommation improductive,
doit, en affaiblissant grandement les motifs habituels de la production, entraner un
arrt prmatur du dveloppement de la richesse... Mais, s'il est vrai qu'un trs grand
effort de capitalisation provoque entre le travail et le profit un divorce assez profond
pour faire disparatre presque compltement le motif et le moyen de s'enrichir par la
suite, pour supprimer par consquent la possibilit de maintenir une population crois-
sante et de lui fournir de l'emploi, ne faut-il pas reconnatre qu'un tel effort de capita-
lisation, ou en d'autres termes une pargne exagre, peut causer un pays un rel
prjudice
2
?
La question est de savoir si cette stagnation du capital et la stagnation subsquente
de la demande de main-d'uvre, due un accroissement de la production qui n'est
pas accompagn d'un accroissement suffisant de la consommation improductive chez
les propritaires et les capitalistes, peut se produire sans qu'il en rsulte un dommage
pour le pays, un affaiblissement du degr de bonheur et de prosprit par rapport
celui qui et exist si la consommation improductive des propritaires et des capita-
listes avait t proportionne au surplus naturel de ressources de la socit, de ma-
nire maintenir une parfaite continuit dans les motifs de la production et emp-
cher d'abord l'lvation anormale de la demande de main-d'uvre, puis son flchisse-
ment ncessaire et soudain. Mais, s'il en est ainsi, comment serait-il exact de dire que
la parcimonie, qui est prjudiciable aux producteurs, ne peut tre prjudiciable
l'tat ; ou que l'accroissement de la consommation improductive des propritaires et
1
Essays in Biography, pp. 139-147.
2
Lettre de Malthus Ricardo du 7 juillet 1821.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 161
des capitalistes n'est jamais le remde spcifique un tat de choses caractris par
l'affaiblissement des motifs produire
1
.
Adam Smith a affirm que la parcimonie dveloppe le capital, qu'un homme co-
nome est un bienfaiteur public et que l'accroissement de la richesse dpend de
l'excdent de la production sur la consommation. Il est indubitable que ces proposi-
tions contiennent une grande part de vrit... Mais il est bien vident qu'elles sont
vraies seulement dans certaines limites, et que le principe de l'pargne, pouss
l'extrme, dtruirait le motif de la production. Si chacun se contentait de la nourriture
la plus simple, du vtement le plus pauvre et de la maison la plus humble, il est
certain qu'il n'existerait pas d'autre sorte de nourriture, de vtement ni de maisons...
Les deux extrmes sont vidents, il existe donc ncessairement un point interm-
diaire, mme si les moyens de lconomie politique ne permettent pas de le dter-
miner, ou compte tenu de la capacit du production et de la volont de consommer le
motif accrotre la richesse est maximum
2
.
De toutes les opinions que nous avons rencontres chez des hommes intelligents
et inventifs, celle de M. Say qui dclare qu'un produit consomm ou dtruit est un
dbouch ferm (1, 1, chap. 15) nous semble la plus directement contraire une saine
doctrine et la plus invariablement contredite par l'exprience. Elle dcoule immdia-
tement de la thorie nouvelle qu'il faut considrer les marchandises les unes par
rapport aux autres et non dans leurs rapports avec les consommateurs. Qu'on nous
dise ce que deviendrait la demande de marchandises, si toute consommation autre que
celle de pain et d'eau tait suspendue pour six mois. Quelle accumulation de mar-
chandise ! Quels dbouchs ! Quel prodigieux march cet vnement ferait surgir
3
!
Ricardo, cependant, resta compltement sourd aux observations de Malthus. On
trouve le dernier cho de cette controverse dans l'expos fait par John Stuart Mill de
sa Thorie du Fonds des Salaires
4
; ce fut cette thorie qui lui, parut jouer le rle
essentiel dans la rfutation des dernires ides de Malthus, et non les raisonnements
qu'on n'avait pas manqu de lui apprendre. Les successeurs de Mill rejetrent sa
thorie du Fonds des Salaires, mais ne s'aperurent pas que sa rfutation de Malthus
reposait sur elle. Leur mthode consista faire disparatre le problme du domaine de
la science conomique, non en le rsolvant, mais en le passant sous silence. Le
problme fut entirement ray de la discussion. M. Cairncross, qui rcemment en a
cherch les traces chez les conomistes secondaires de l'poque Victorienne
5
, en a
peut-tre trouv moins encore qu'on aurait pu s'y attendre
6
. Les thories de la sous-
consommation restrent sous le boisseau jusqu' la publication en 1889 de la
Physiology of Industry de J. A. Hobson et A. F. Mummery. Ce livre est le premier et
le plus important des nombreux ouvrages dans lesquels avec ardeur et courage M.
Hobson a lutt pendant prs de cinquante ans sans dfaillance mais aussi presque sans
1
Lettre de Malthus Ricardo du 16 juillet 1821.
2
Prface aux Principles of Political Economy de Malthus, pp. 8 et 9.
3
Principles of Political Economy de Malthus, pp. 363 en note.
4
conomie Politique de J. S. Mill, Livre I, Ch. V. Dans la Physiology of Industry, pp. 38 et suiv., de
Mummery et Hobson, on trouve une discussion trs approfondie et importante de cette partie de la
thorie de Mill et en particulier de sa thse que une demande de marchandises n'est pas une
demande de main-d'uvre (thse que Marshall a cherch rfuter dans sa discussion trs peu
satisfaisante de la Thorie du Fonds des Salaires).
5
Les conomistes de l'poque victorienne et l'Investissement Economic History, 1936.
6
La plus intressante de ses dcouvertes est le tract de Fullarton, Comment doivent tre gouvernes
les circulations montaires, (1844).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 162
succs contre les forces de l'cole orthodoxe. La publication de ce livre si complte-
ment oubli aujourd'hui fait poque, en un certain sens, dans l'histoire de la pense
conomique
1
.
La Physiology of Industry fut crite en collaboration avec A. F. Mummery. M.
Hobson a expliqu comment il avait t amen composer cet ouvrage
2
.
C'est seulement vers 1885 que mes ides conomiques htrodoxes ont com-
menc prendre forme. La campagne de Henry Georges contre l'lvation des fer-
mages, l'agitation naissante de divers groupes socialistes contre l'oppression manifes-
te subie par la classe ouvrire et aussi les rvlations des deux Booth sur le paup-
risme Londres avaient profondment mu ma sensibilit, mais elles n'avaient pas
dtruit ma foi dans l'conomie politique. Ce rsultat devait tre la consquence d'une
rencontre fortuite. Alors que j'tais professeur Exeter, j'entrai en relations avec un
homme d'affaires appel Mummery. Mummery, connu cette poque et surtout plus
tard comme un grand alpiniste, avait dcouvert un nouvel accs au Cervin et se tua en
1895 en tentant l'ascension de la fameuse montagne Nanga Parbat dans l'Himalaya.
Mes rapports avec lui ne s'tablirent videmment pas sur ce plan physique. Mais au
moral il tait aussi un grand alpiniste, dou d'une aptitude naturelle sortir des
sentiers battus et d'une indiffrence magnifique l'gard des autorits intellectuelles.
Cet homme m'entrana dans une controverse sur l'excs d'pargne qui lui paraissait
tre en priode de dpression la cause de l'inactivit du capital et de la main-duvre.
Pendant longtemps j'essayai de combattre ses arguments avec les armes de l'co-
nomie orthodoxe. Mais il finit par me convaincre et je m'associai lui pour construire
la thorie de l'excs d'pargne dans un livre intitul The Physiology of Industry, qui
fut publi en 1889. Ce fut le premier pas notoire que je fis dans ma carrire
d'hrtique, et j'tais loin d'en mesurer les consquences. Je venais en effet d'aban-
donner mon emploi dans l'enseignement secondaire et me consacrais des travaux
nouveaux en qualit de matre de confrence d'conomie Politique et de Littrature
la University Extension Society. Ma premire avanie vint du conseil l'Extension de
Londres, qui m'interdit de professer l'conomie Politique. Cette dcision rsultait,
parat-il, de l'intervention d'un professeur d'conomie Politique qui avait lu mon
ouvrage et n'y avait pas trouv plus de logique que dans une tentative pour dmontrer
que la terre est plane. Comment aurait-il pu exister des limites l'utilit de l'pargne,
alors que tout acte d'pargne contribuait augmenter l'difice du capital et le fonds
qui servait payer les salaires ? Des conomistes senss ne pouvaient que considrer
avec horreur un raisonnement qui visait tarir la source de tout progrs industriel
3
.
Une autre aventure de quelque intrt qui m'arriva contribua me convaincre du
sentiment de mon iniquit. Bien qu'on m'et interdit d'enseigner l'conomie Politique
Londres, j'avais t autoris, grce l'extrme libralit du Mouvement pour
l'Extension de l'Universit d'Oxford, faire des confrences en province, la
1
The Fallacy of Saving (le Sophisme de l'pargne) de J. M. Robertson, publi en 1892. soutient
l'hrsie de Mummery et Hobson. Mais c'est un livre d'une valeur et d'une porte assez restreintes ;
les intuitions pntrantes de la Physiology of Industry lui font compltement dfaut.
2
Dans une allocution intitule Confession d'un conomiste hrtique , prononce devant la
Socit Morale de Londres Conway Hall, le dimanche 14 juillet 1935. Nous la reproduisons avec
l'autorisation de AL Hobson.
3
Hobson avait irrvrencieusement crit dans la Physiology of Industry, p. 26 : L'pargne est la
source de la richesse nationale et plus une nation est conome plus elle devient riche. Telle est la
doctrine commune de presque tous les conomistes ; il en est beaucoup parmi eux qui adoptent un
ton d'une dignit toute morale pour dmontrer la valeur infinie de l'pargne ; dans leur ennuyeuse
chanson c'est la seule note qui ait plu l'oreille du public .
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 163
condition de m'en tenir aux questions pratiques concernant la vie de la classe
ouvrire. Or il advint qu' cette poque la Charity Organisation Society projetait une
campagne de confrences sur des sujets conomiques et me demanda d'en prparer
une srie. J'avais accept ce nouveau travail de confrences quand tout coup l'invi-
tation fut contremande sans explication. Je ne me rendis pas bien compte mme ce
moment qu'en paraissant mettre en doute la vertu de l'pargne, quand elle dpasse
certaines limites, j'avais commis la faute irrmissible.
Dans ce premier ouvrage de M. Hobson (et de son collaborateur) la doctrine
classique qui lui avait t enseigne fait l'objet d'allusions plus directes que dans ses
autres oeuvres ; pour cette raison et aussi parce que ce livre est la premire expression
de sa thorie nous en citerons plusieurs passages, qui montreront l'importance et le
bien fond des critiques et des intuitions des auteurs. La nature des conclusions qu'ils
attaquent est indique comme il suit dans la prface.
L'pargne enrichit et la dpense appauvrit la communaut en mme temps que
l'individu, et on peut affirmer d'une manire gnrale que l'amour effectif de l'argent
est, dans l'ordre conomique, la source de tout bien. Non seulement il enrichit celui
qui pargne, mais il fait monter les salaires, donne du travail aux chmeurs et rpand
partout ses bienfaits. Dans les journaux quotidiens comme dans les rcents traits
d'conomie, dans les chaires comme la Chambre des Communes, on rpte et on
renouvelle cette affirmation au point qu'il est devenu sacrilge de la mettre en doute.
Cependant, jusqu' la publication de l'uvre de Ricardo, la partie instruite de la popu-
lation, appuye sur la majorit des thoriciens de l'conomie, niait nergiquement
cette doctrine et, si elle finit par l'accepter, ce fut uniquement faute de pouvoir rfuter
la doctrine aujourd'hui discrdite du Fonds des salaires. Seule l'autorit indiscute
des esprits considrables qui ont soutenu cette conclusion peut expliquer qu'elle ait
survcu au raisonnement qui en tait la base logique. Des critiques d'conomie politi-
que se sont risqus attaquer la thorie dans ses dtails, mais ils ont recul d'pou-
vante l'ide de toucher ses conclusions principales. Nous avons dessein de prouver
que ces conclusions ne sont pas dfendables, qu'il peut y avoir une pratique exagre
des habitudes d'pargne, qu'une telle pratique appauvrit la communaut, prive la
main-duvre de ses emplois, comprime les salaires et rpand dans le monde des
affaires le marasme et le dcouragement connus sous le nom de crise conomique...
L'objet de la production est de fournir aux consommateurs des marchandises et
des services , et l'opration suit une marche continue depuis le moment o la matire
premire commence tre traite jusqu'au moment o elle est compltement consom-
me sous forme de marchandises ou de services. La seule utilit du capital tant de
faciliter la production de ces marchandises et de ces services, la quantit totale de
capital employ varie ncessairement avec la quantit totale de marchandises et de
services consomms chaque jour ou chaque semaine. Or l'pargne accrot la masse du
capital existant tout en rduisant la quantit des marchandises et des services con-
somms ; la pratique exagre de l'pargne entrane donc ncessairement une accu-
mulation de capital suprieure la quantit dont l'emploi est ncessaire ; la diffrence
se manifeste par la surproduction gnrale
1
.
L'origine de l'erreur de Hobson apparat dans la dernire phrase du passage. Il
suppose en effet que la consquence d'une pargne exagre est une accumulation
effective de capital excdant les besoins, alors qu'en ralit il s'agit l d'un mal secon-
1
Hobson et Mummery, Physiologie of Industry, pp. III-IV.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 164
daire d uniquement des erreurs de prvisions ; le mal essentiel rside dans la
propension en tat de plein emploi pargner des sommes suprieures la valeur du
capital qui est requis et dans l'obstacle la ralisation du plein emploi qui en rsulte,
hors le cas de prvisions errones. Nanmoins, une page ou deux plus loin, il expose
la moiti de la question avec une prcision qui nous parat absolue, encore qu'il
nglige l'action possible des variations du taux de l'intrt et de l'tat de la confiance
chez les hommes d'affaires, facteurs qu'il prend sans doute comme donnes :
Nous sommes ainsi amens conclure que l'ide d'aprs laquelle les quantits
totales des agents naturels, du capital et du travail disponibles dterminent le volume
de la production annuelle, ide qui est la base de tout l'enseignement conomique
depuis Adam Smith, est errone. Sans pouvoir dpasser la limite impose par ces
quantits totales, le volume de la production annuelle peut au contraire tre maintenu
au-dessous du maximum, et se trouve en fait maintenu bien au-dessous du maximum,
par l'obstacle qu'opposent la production une pargne excessive et l'accumulation
subsquente d'offres surabondantes ; en d'autres termes dans l'tat normal des com-
munauts industrielles modernes, c'est la consommation qui limite la production et
non la production qui limite la consommation
1
.
Hobson indique enfin que sa thorie infirme les arguments orthodoxes en faveur
du libre change :
Nous remarquerons aussi que l'accusation d'imbcillit dans l'ordre commercial, si
gnreusement formule par les conomistes orthodoxes contre les cousins d'Amri-
que et les autres communauts protectionnistes, ne peut plus tre taye sur les
arguments libre-changistes mis en avant jusqu'ici, puisqu'ils sont tous fonds sur
l'hypothse qu'un excs d'offre est impossible
2
.
Le raisonnement qui suit est vrai dire incomplet. Mais c'est la premire fois
qu'on nonce de faon explicite le fait que le capital est cr, non par la propension
pargner mais en rponse la demande rsultant de la consommation actuelle et
escompte. Les quelques citations suivantes indiqueront les grandes lignes du raison-
nement :
Il devrait tre clair qu'on ne peut avoir avantage accrotre le capital d'une com-
munaut en l'absence d'un accroissement subsquent de la consommation de mar-
chandises... Un accroissement, d'pargne et de capital ne peut tre efficace que si un
accroissement correspondant de la consommation se produit dans la priode cons-
cutive
3
... Et, quand nous parlons d'une consommation future, nous n'avons pas en
vue une consommation qui se produira dix, vingt ou cinquante ans plus tard, mais une
consommation qui se produira dans un avenir trs peu loign... Si une conomie ou
une prvoyance accrues incitent pargner plus dans le moment prsent, il faut qu'on
consente consommer plus dans l'avenir
4
... Or aucun stade de la production le
capital ne peut conomiquement exister en quantit suprieure celle qu'exige
l'alimentation en marchandises du flux courant de consommation
5
... Il est clair que
mon pargne n'affecte en rien l'pargne totale de la communaut, elle ne fait que
1
Hobson et Mummery, Physiology of Industry, p. VI.
2
Op. cit., p. IX.
3
Op. cit., p. 27.
4
Op. cit., pp. 50-51.
5
Op. cit., p. 69.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 165
dterminer si telle portion de l'pargne totale sera constitue par moi ou par quelqu'un
d'autre. Nous montrerons comment l'pargne d'une partie de la communaut a la
proprit de forcer une autre partie de la communaut dpenser plus que son
revenu
1
... La plupart des conomistes modernes nient que la consommation puisse en
aucun cas tre insuffisante. Peut-on dcouvrir une force conomique dont l'action
incite une communaut pargner avec excs; et, si une telle force existe, le mca-
nisme du commerce ne fournit-il pas des moyens efficaces d'y rsister ? Nous
dmontrerons d'abord que dans toute socit industrielle trs organise s'exerce d'une
faon continue une force qui tend naturellement susciter une pargne excessive, et
ensuite que les moyens de rsistance que le mcanisme du commerce est cens four-
nir sont ou bien totalement inefficaces ou bien insuffisants pour prvenir de srieux
dommages conomiques
2
... La plupart des conomistes postrieurs Ricardo sem-
blent avoir jug satisfaisante la rponse succincte qu'il fit aux affirmations de Malthus
et de Chalmers : Les produits s'achtent toujours au moyen de produits ou de
services; la monnaie n'est que le moyen par lequel s'effectue l'change. Puisqu'un
accroissement de la production est toujours accompagn d'un accroissement corres-
pondant du pouvoir d'achat et de consommation, il n'est pas possible qu'il y ait sur-
production (Ricardo, Princ. of Pol. Econ., p. 362)
3
.
Hobson et Mummery avaient compris que l'intrt n'tait rien d'autre qu'un
paiement pour l'usage de la monnaie
4
. Ils savaient aussi fort bien que leurs adver-
saires objecteraient qu'il se produit une baisse du taux de l'intrt (ou du profit)
suffisante pour dcourager l'pargne et rtablir le rapport convenable entre la produc-
tion et la consommation
5
. Ils font observer en rponse que la baisse du profit ne
peut entraner une diminution de l'pargne que de deux faons, soit en incitant
dpenser plus, soit en amenant produire moins
6
. En ce qui concerne le premier
moyen, ils remarquent qu'en cas de baisse du profit le revenu global de la com-
munaut flchit et qu'on ne peut supposer que, lorsque le revenu moyen diminue, les
individus soient incits augmenter le montant de leurs consommations par le fait
que la prime l'pargne diminue elle aussi ; quant au second moyen, ils ont si peu
l'intention de nier qu'une baisse du profit due une offre surabondante puisse faire
obstacle la production que la reconnaissance du rle de cet obstacle est la base
mme de leur raisonnement
7
. Nanmoins leur thse reste inacheve, surtout parce
qu'ils n'ont pas de thorie indpendante du taux de l'intrt. M. Hobson est ainsi
amen trop insister (notamment dans ses derniers ouvrages) sur le fait que la sous-
consommation conduit au surinvestissement dans le sens d'investissements dsavan-
tageux, au lieu d'expliquer qu'une propension relativement faible consommer
contribue causer du chmage parce qu'il faudrait qu'elle ft accompagne - alors
qu'en fait elle ne l'est pas - d'un volume compensateur d'investissement nouveau, et
parce que celui-ci, s'il peut parfois apparatre temporairement la suite d'erreurs opti-
mistes, est en gnral rendu impossible par la baisse du profit escompt au-dessous
du niveau fix par le taux de l'intrt.
1
Op. cit., p. 113.
2
Op. cit. p. 100.
3
Op. cit., p. 101.
4
Op. cit., p. 79.
5
Op. cit., p. 117.
6
Op. cit., p. 130.
7
Hobson et Mummery, Physiology of Industry, p. 131.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 166
Depuis la guerre on a vu foisonner les thories hrtiques de sous-consommation ;
les plus clbres sont celles du Major Douglas. La force de l'argumentation du Major
Douglas vient d'ailleurs en grande partie du fait que l'cole orthodoxe n'a pu tablir le
mal fond de ses critiques destructives. Car les dtails de son analyse et notamment le
thorme connu sous le nom de A + B contiennent une grande part de mystification
pure. S'il avait limit la catgorie B aux provisions financires que les entrepreneurs
constituent indpendamment de toute dpense de remplacement ou de renouvelle-
ment, il eut t beaucoup plus prs de la vrit. Toutefois, il faut tenir compte mme
dans ce cas du fait que les provisions peuvent tre contrebalances soit par des
investissements nouveaux en d'autres secteurs soit par des dpenses de consommation
supplmentaires. Le Major Douglas, la diffrence de ses adversaires orthodoxes, a
au moins le mrite de n'avoir pas totalement oubli le problme essentiel de notre
systme conomique. Mais on peut difficilement le mettre sur le mme rang (dans la
vaillante arme hrtique peut-tre a-t-il grade de soldat, mais non de capitaine) que
Mandeville, Malthus, Gesell et Hobson, qui, fidles leurs intuitions, ont mieux aim
se contenter d'une connaissance obscure et imparfaite de la vrit que soutenir une
erreur, tablie sans doute sur une logique simple, claire et cohrente, mais drivant
d'hypothses incompatibles avec les faits.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 167
Livre VI : Notes succinctes suggres par la thorie gnrale
Chapitre XXIV
Notes finales sur la philosophie sociale
laquelle la thorie gnrale peut
conduire
I
Retour la table des matires
Les deux vices marquants du monde conomique o nous vivons sont le premier
que le plein emploi n'y est pas assur, le second que la rpartition de la fortune et du
revenu y est arbitraire et manque d'quit. Le rapport entre la thorie qui prcde et le
premier de ces vices est vident. Mais il existe deux points importants o elle touche
aussi le second.
Depuis la fin du XIXe sicle la taxation directe des revenus cdulaires, des reve-
nus globaux et des successions a permis de raliser, surtout en Grande-Bretagne, de
srieux progrs dans la rduction des trs grandes ingalits de fortune et de revenu.
Certains souhaiteraient qu'on allt beaucoup plus loin dans cette voie, mais ils sont
retenus par deux ordres de considrations. D'abord ils craignent de rendre les va-
sions fiscales trop avantageuses et aussi d'affaiblir l'excs le motif qui incite
assumer des risques. Mais ce qui, notre avis, les arrte surtout, c'est l'ide que le
dveloppement du capital est en relation avec la puissance du motif de l'pargne
individuelle et qu'il est en grande partie fonction du montant de l'pargne que la
classe riche tire de ses superfluits. Notre thse est sans influence sur les premires
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 168
considrations, mais elle conduit envisager les secondes sous un jour bien diffrent.
Nous avons vu en effet qu'une faible propension consommer, loin de stimuler le
dveloppement du capital, ne fait que le contrarier tant que le plein emploi n'est pas
ralis; et qu'elle ne lui est favorable que dans une situation de plein emploi. De plus
l'exprience enseigne que, dans les conditions actuelles, la politique des collectivits
et le jeu des fonds d'amortissement assurent une pargne plus que suffisante ; elle
enseigne aussi que des mesures modifiant la rpartition du revenu dans un sens
favorable la propension consommer sont propres acclrer grandement le dve-
loppement du capital.
En cette matire il existe dans les esprits une confusion qu'illustre bien l'ide si
rpandue que les droits de succession sont cause d'une rduction de la richesse en
capital du pays. Si le Gouvernement affecte le produit de ces droits la couverture de
ses dpenses ordinaires de manire rduire ou ne pas augmenter les impts sur le
revenu et sur la consommation, il est certes exact qu'une politique fiscale tendant
accrotre les droits de succession renforce la propension de la communaut consom-
mer. Mais, puisque un accroissement de la propension habituelle consommer
contribue en gnral (c'est--dire hors le cas de plein emploi) renforcer l'incitation
investir, la conclusion qu'on a coutume d'en tirer est l'exact contraire de la vrit.
L'analyse qui prcde nous amne donc conclure que dans les conditions con-
temporaines l'abstinence de la classe aise est plus propre contrarier qu' favoriser
le dveloppement de la richesse. Ainsi disparat l'une des principales justifications
sociales d'une grande ingalit des fortunes. Ce n'est pas dire que d'autres raisons
indpendantes de notre thse ne puissent justifier en certaines circonstances un
certain degr d'ingalit dans les fortunes. Mais notre thse limine la principale des
raisons pour lesquelles on a pens jusqu'ici qu'une grande circonspection tait nces-
saire dans l'accomplissement des rformes. Elle influe tout particulirement sur notre
faon d'envisager les droits de succession. Car certaines considrations qui lgitiment
l'ingalit des revenus ne justifient pas en mme temps l'ingalit des hritages.
Pour notre part, nous pensons qu'on peut justifier par des raisons sociales et
psychologiques de notables ingalits de fortune, mais non des disproportions aussi
marques qu' l'heure actuelle. Il existe des activits humaines utiles qui, pour porter
tous leurs fruits, exigent l'aiguillon du lucre et le cadre de la proprit prive. Bien
plus, la possibilit de gagner de l'argent et de constituer une fortune peut canaliser
certains penchants dangereux de la nature humaine dans une voie o ils sont relative-
ment inoffensifs. Faute de pouvoir se satisfaire de cette faon, ces penchants pour-
raient trouver une issue dans la cruaut, dans la poursuite effrne du pouvoir per-
sonnel et de l'autorit et dans les autres formes de l'ambition personnelle. Il vaut
mieux que l'homme exerce son despotisme sur son compte en banque que sur ses
concitoyens; et, bien que la premire sorte de tyrannie soit souvent reprsente com-
me un moyen d'arriver la seconde, il arrive au moins dans certains cas qu'elle s'y
substitue. Mais, pour stimuler ces activits et pour satisfaire ces penchants, il n'est pas
ncessaire que la partie se joue a un taux aussi lev qu'aujourd'hui. Des taux beau-
coup plus bas seraient tout aussi efficaces ds l'instant que les joueurs y seraient
habitus. La transformation et la conduite de la nature humaine sont deux tches qu'il
importe de ne pas confondre. Peut-tre dans la rpublique idale les hommes
pourraient-ils avoir t habitus, inclins ou forms se dsintresser du jeu. Mais,
tant que l'homme moyen ou mme une fraction notable de la communaut sera forte-
ment adonne la passion du lucre, la sagesse et la prudence commanderont sans
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 169
doute aux hommes d'tat d'autoriser la pratique du jeu sous certaines rgles et dans
certaines limites.
II
Mais il y a une seconde partie de notre analyse dont les consquences sont
beaucoup plus importantes pour l'avenir des ingalits de fortune ; c'est notre thorie
du taux de l'intrt. On justifiait jusqu'ici une certaine lvation du niveau de l'intrt
par la ncessit de fournir l'pargne un encouragement suffisant. Mais nous avons
dmontr que le montant effectif de l'pargne est rigoureusement dtermin par le
flux de l'investissement et que l'investissement grossit sous l'effet d'une baisse du
taux de l'intrt, pourvu qu'on ne cherche pas le porter au del du montant qui
correspond au plein emploi. La politique la plus avantageuse consiste donc faire
baisser le taux de l'intrt par rapport la courbe de l'efficacit marginale du capital
jusqu' ce que le plein emploi soit ralis.
Ce critre conduira, sans aucun doute, un taux de l'intrt beaucoup plus faible
que celui qui a rgn jusqu'ici, et pour autant qu'on puisse faire des conjectures au
sujet des courbes de l'efficacit marginale qui correspondent un quipement en
capital de plus en plus dvelopp, il y a lieu de croire que le maintien plus ou moins
continu d'une situation de plein emploi exigera une baisse profonde du taux de
l'intrt, sauf toutefois si dans la communaut tout entire (tat compris) il se produit
une forte variation de la propension consommer.
Nous sommes convaincu que la demande de capital est strictement limite, en ce
sens qu'il ne serait Pas difficile d'accrotre l'quipement jusqu' ce que son efficacit
marginale tombe un chiffre trs faible. Ceci ne veut pas dire que l'usage des biens
de capital ne coterait presque plus rien, mais seulement que le revenu qu'on en tire-
rait aurait tout au plus couvrir la dprciation due l'usure et la dsutude, et une
certaine marge destine rmunrer les risques ainsi que l'exercice de l'habilet et du
jugement. En bref, les biens durables de mme que les biens phmres fourniraient
au cours de leur existence un revenu global couvrant tout au plus le cot du travail
ncessaire les produire, augment des cots de l'habilet et de la surveillance et
d'une allocation correspondant aux risques.
Cet tat de choses serait parfaitement compatible avec un certain degr d'indivi-
dualisme. Mais il n'en impliquerait pas moins la disparition progressive du rentier et
par suite la disparition progressive chez le capitaliste du pouvoir oppressif d'exploiter
subsidiairement la valeur confre au capital par sa raret. L'intrt ne rmunre
aujourd'hui aucun sacrifice vritable non plus que la rente du sol. Le dtenteur du
capital peut obtenir un intrt parce que le capital est rare, de mme que le dtenteur
du sol peut obtenir une rente parce que le sol est rare. Mais, tandis que la raret du sol
s'explique par une raison intrinsque, il n'y a aucune raison intrinsque qui justifie la
raret du capital. Il n'existerait de faon durable une raison intrinsque de cette raret,
c'est--dire un sacrifice vritable que l'offre d'une rcompense sous forme d'intrt
pourrait seule faire accepter, que si la propension individuelle consommer tait
assez forte pour que l'pargne nette en situation de plein emploi devienne nulle avant
que le capital ft suffisamment abondant. Et, mme dans ce cas, les Pouvoirs Publics
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 170
auraient encore la ressource d'entretenir une pargne commune assez importante pour
permettre au capital de se dvelopper jusqu' ce qu'il cesst d'tre rare.
Dans l'volution du capitalisme, la prsence de rentiers nous semble marquer une
phase intermdiaire qui prendra fin lorsqu'elle aura produit tous ses effets. Et la
disparition du rentier entranera bien d'autres changements radicaux dans ce rgime.
Le grand avantage du programme que nous prconisons, c'est que la disparition du
rentier ou du capitaliste sans profession n'aura rien de soudain, qu'elle n'exigera aucu-
ne rvolution, qu'elle rsultera de la simple persistance pendant un certain temps de
l'volution graduelle que la Grande-Bretagne a connue rcemment.
Pratiquement on pourrait se proposer (tout ceci n'a rien d'irralisable) d'abord
d'augmenter l'quipement jusqu' ce le capital cesse d'tre rare, de manire suppri-
mer la prime attribue au capitaliste sans profession; ensuite de crer un systme de
taxation directe obligeant les financiers, les entrepreneurs et les autres hommes
d'affaires mettre au service de la communaut des conditions raisonnables leur
intelligence, leur caractre et leurs capacits professionnelles (ces hommes d'affaires
aimant certainement assez leur mtier pour consentir travailler bien meilleur
compte qu' prsent).
Il faut avouer cependant que l'exprience seule peut indiquer dans quelle mesure il
convient d'orienter la volont publique, telle qu'elle s'exprime par la politique du
Gouvernement, vers le renforcement de l'incitation investir; et dans quelle mesure il
est possible d'accrotre la propension moyenne consommer sans renoncer suppri-
mer la raret, du capital en l'espace d'une ou deux gnrations. Il se peut que la baisse
du taux de l'intrt dtermine un tel accroissement de la propension consommer
qu'il suffise pour tablir le plein emploi d'une lgre augmentation du flux d'investis-
sement actuel. Dans ce cas l'augmentation des taxes sur les gros revenus et sur les
grosses successions pourrait avoir l'inconvnient d'abaisser le flux d'investissement
correspondant au plein emploi trs au-dessous du niveau qui existe en fait l'heure
actuelle. Nous ne songeons pas nier qu'une telle consquence soit possible, voire
mme probable. Il serait tmraire en ce domaine de prdire la raction de l'homme
moyen en face de circonstances nouvelles. Si l'on pouvait sans difficult assurer
approximativement le plein emploi par une lgre augmentation du flux d'investisse-
ment actuel, on aurait dj rsolu un problme essentiel. Et il resterait fixer par une
dcision spare l'ampleur et les modalits des restrictions de consommation qu'il
serait juste et raisonnable d'appeler la gnration actuelle consentir afin que ses
successeurs puissent bnficier le moment venu d'un tat de plein investissement.
III
Les consquences de la thorie expose dans les chapitres prcdents apparaissent
d'autres gards assez conservatrices. Bien que cette thorie montre qu'il est d'une
importance vitale d'attribuer des organes centraux certains pouvoirs de direction
aujourd'hui confis pour la plupart l'initiative prive, elle n'en respecte pas moins un
large domaine de l'activit conomique. En ce qui concerne la propension consom-
mer, l'tat sera conduit exercer sur elle une action directrice par sa politique fiscale,
par la dtermination du taux de l'intrt, et peut-tre aussi par d'autres moyens. Quant
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 171
au flux d'investissement, il est peu probable que l'influence de la politique bancaire
sur le taux de l'intrt suffise l'amener sa valeur optimum. Aussi pensons-nous
qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avrera le seul moyen d'assurer
approximativement le plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure les
compromis et les formules de toutes sortes qui permettent l'tat de cooprer avec
l'initiative prive. Mais part cela, on ne voit aucune raison vidente qui justifie un
socialisme d'tat embrassant la majeure partie de la vie conomique de la commu-
naut. L'tat n'a pas intrt se charger de la proprit des moyens de production. S'il
est capable de dterminer le volume global des ressources consacres l'augmenta-
tion de ces moyens et le taux de base de la rmunration alloues leurs dtenteurs, il
aura accompli tout le ncessaire. Les mesures indispensables de socialisation peuvent
d'ailleurs tre appliques d'une faon graduelle et sans bouleverser les traditions
gnrales de la socit.
Notre critique de la thorie classique admise a consist moins relever des erreurs
logiques dans son analyse qu' mettre en vidence le fait que ses hypothses impli-
cites ne sont jamais ou presque jamais vrifies et que par suite elle se trouve inca-
pable de rsoudre les problmes conomiques du monde concret. Mais aussitt que
les organes centraux auront russi tablir un volume de production correspondant
une situation aussi voisine que possible du plein emploi, la thorie classique repren-
dra tous ses droits. Si le volume de la production est pris comme donne, c'est--dire
si on le suppose gouvern par des forces extrieures la conception de l'cole
classique, il n'y a rien objecter l'analyse de cette cole concernant la manire dont
l'intrt individuel dtermine la nature des richesses produites, les proportions dans
lesquelles les facteurs de production sont associs pour les produire et la rpartition
entre ces facteurs de la valeur de la production obtenue. De mme, si l'on a pos
autrement le problme de l'pargne, il n'y a rien objecter la thorie classique
moderne relative au degr de concidence de l'intrt gnral et de l'intrt particulier,
tant dans un rgime de concurrence parfaite que dans un rgime de concurrence
imparfaite. Hors la ncessit d'une direction centrale pour maintenir la correspon-
dance entre la propension consommer et l'incitation investir, il n'y a pas plus de
raison qu'auparavant de socialiser la vie conomique.
Pour placer la question sur un plan concret, nous ne voyons pas pourquoi le syst-
me actuel ferait un trs mauvais usage des facteurs de production employs. Sans
doute des erreurs de prvision sont-elles commises, mais on ne les viterait pas en
centralisant les dcisions. Lorsque sur dix millions d'hommes dsireux et capables de
travailler il y en a neuf millions employs, il n'est pas vident que le travail de ces
neuf millions d'individus soit mal orient. Il ne faut pas reprocher au systme actuel
d'employer ces neuf millions d'hommes aux tches qui leur sont imparties, mais de
n'avoir pas d'ouvrage disponible pour le dernier million. C'est le volume et non la
direction de l'emploi que le systme actuel dtermine d'une faon dfectueuse.
D'accord avec Gesell, nous estimons donc que la suppression des lacunes de la
thorie classique ne conduit pas abandonner le Systme de Manchester mais
simplement indiquer la nature du cadre qu'exige le libre jeu des forces conomiques
pour que les possibilits de la production puissent tre toutes ralises. L'existence
des organes centraux de direction ncessaires assurer le plein emploi entranera,
bien entendu, une large extension des fonctions traditionnelles de l'tat. D'ailleurs la
thorie classique moderne a elle-mme appel l'attention sur les divers cas o il peut
tre ncessaire de modrer ou de diriger le libre jeu des forces conomiques. Mais un
large domaine n'en subsistera pas moins, o l'initiative et la responsabilit prives
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 172
pourront encore s'exercer. Dans ce domaine les avantages traditionnels de l'indivi-
dualisme garderont toute leur valeur.
Arrtons-nous un moment pour nous les rappeler. Ils consistent d'abord dans une
amlioration du rendement, rsultant de la dcentralisation et du jeu de l'intrt
personnel. L'amlioration du rendement due la responsabilit individuelle et la
dcentralisation des dcisions est peut-tre mme plus importante qu'on ne l'a cru au
XIXe sicle, et il se peut qu'on ait trop ragi contre l'influence de l'intrt personnel.
Mais surtout l'individualisme, s'il peut tre dbarrass de ses dfauts et de ses excs,
est la sauvegarde de la libert personnelle, en ce sens qu'il largit plus que tout autre
systme le champ des dcisions personnelles. Il est aussi la meilleure sauvegarde de
la varit de l'existence, varit dont la source rside prcisment dans l'ampleur du
champ des dcisions personnelles et dont la privation est la plus sensible de toutes
celles qu'entranent les rgimes homognes et totalitaires. La varit de l'existence
prserve les traditions, qui incorporent les dcisions les plus sages et les plus heu-
reuses des gnrations passes ; elle colore le prsent des nuances changeantes de son
caprice ; servante de l'exprience et aussi de la tradition et de la fantaisie, elle est le
plus puissant facteur d'amlioration du futur.
L'largissement des fonctions de l'tat, ncessaire l'ajustement rciproque de la
propension consommer et de l'incitation investir, semblerait un publiciste du
XIXe sicle ou un financier amricain d'aujourd'hui une horrible infraction aux
principes individualistes. Cet largissement nous apparat au contraire et comme le
seul moyen d'viter une complte destruction des institutions conomiques actuelles
et comme la condition d'un heureux exercice de l'initiative individuelle.
Car, lorsque la demande effective est insuffisante, non seulement le gaspillage de
ressources cause dans le public un scandale intolrable, mais encore l'individu entre-
prenant qui cherche mettre ces ressources en oeuvre a trop peu de chances de son
ct. Le jeu qu'il joue contient plusieurs zros et les joueurs dans leur ensemble sont
obligs de perdre s'ils ont assez d'nergie et de confiance pour donner toutes les
cartes. L'accroissement de la richesse individuelle jusqu' ce jour a t moindre que la
somme des pargnes positives individuelles. La diffrence correspond aux pertes
subies par les individus dont le courage et l'initiative n'ont pas t doubls d'une
chance ou d'une habilet exceptionnelles. Si la demande effective tait suffisante, il
suffirait au contraire pour russir d'une chance et d'une habilet moyennes.
Les rgimes autoritaires contemporains paraissent rsoudre le problme du ch-
mage aux dpens de la libert et du rendement individuels. Il est certain que le monde
ne supportera plus trs longtemps l'tat de chmage qui, en dehors de courts inter-
valles d'emballement, est une consquence, et notre avis une consquence invi-
table, de l'individualisme tel qu'il apparat dans le rgime capitaliste moderne. Mais
une analyse correcte du problme permet de remdier au mal sans sacrifier la libert
ni le rendement.
IV
Nous avons dit en passant que le nouveau systme pourrait tre plus que l'ancien
favorable la paix. Il convient de revenir et d'insister sur ce sujet.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 173
Les causes de la guerre sont multiples. Les dictateurs et leurs semblables, qui la
guerre procure, au moins en perspective, un stimulant dlectable, n'ont pas de peine
exciter le sens belliqueux de leurs peuples. Mais, ceci mis part, leur tche est
facilite et l'ardeur du peuple est attise par les causes conomiques de la guerre,
c'est--dire par la pousse de la population et par la comptition autour des dbou-
chs. Ce dernier facteur, qui a jou au XIXe sicle et jouera peut-tre encore un rle
essentiel, a un rapport troit avec notre sujet.
Nous avons signal dans le chapitre prcdent que sous un rgime de laissez-faire
intrieur et d'talon-or international, comme celui qui tait orthodoxe pendant la
seconde moiti du XIXe sicle, le seul moyen pour les Gouvernements de soulager la
dtresse conomique de leur pays tait de lutter pour la conqute des marchs
extrieurs. Les remdes efficaces au chmage chronique ou intermittent se trouvaient
tous exclus l'exception des mesures destines amliorer la balance extrieure des
revenus.
Les conomistes avaient coutume de clbrer le systme international existant
parce qu'il procurait les fruits de la division internationale du travail tout en conciliant
les intrts des diffrentes nations ; mais ils laissaient dans l'ombre une consquence
moins bienfaisante de ce systme. Et certains hommes d'tat faisaient preuve de bon
sens et d'une juste comprhension de l'ordre rel des choses lorsqu'ils soutenaient
qu'un pays riche et ancien qui nglige la lutte pour les dbouchs voit sa prosprit
dcliner et s'vanouir. Or, si les nations pouvaient apprendre maintenir le plein
emploi au moyen de leur seule politique intrieure (et aussi, faut-il ajouter, si leur
population pouvait atteindre un niveau d'quilibre), il ne devrait plus y avoir de force
conomique importante capable de dresser les intrts des divers pays les, uns contre
les autres. Il y aurait encore place dans certaines circonstances pour le crdit
international et pour la division internationale du travail. Mais les pays n'auraient plus
un motif pressant d'imposer leurs marchandises au voisin et de refuser ses offres,
comme ils le font aujourd'hui, non parce que cette politique est ncessaire pour leur
permettre de payer ce qu'ils dsirent acheter l'tranger, mais parce qu'ils cherchent
ouvertement rompre l'quilibre des paiements de manire rendre leur balance
commerciale crditrice. Le commerce international cesserait d'tre un expdient
dsespr pour protger l'emploi l'intrieur des pays par des ventes au dehors et par
des restrictions d'importation ; moyen qui, lorsqu'il russit, ne fait que transfrer le
problme du chmage au pays le moins bien plac dans la lutte. Il deviendrait un
change de marchandises et de services, ralis librement et sans obstacle, en des
conditions comportant des avantages rciproques.
V
Est-il chimrique d'esprer que ces ides se raliseront ? Sont-elles trop trangres
aux motifs qui gouvernent l'volution des socits organises. Les intrts qu'elles
desservent sont-ils plus puissants et plus apparents que ceux qu'elles favorisent ?
Nous n'entreprendrons pas de rpondre ici ces questions. Pour indiquer, ne ft-
ce que dans les grandes lignes, les mesures pratiques qu'on pourrait chafauder
progressivement sur ces ides, il faudrait un ouvrage bien diffrent de celui-ci. Mais,
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 174
si les ides sont justes - et il est difficile l'auteur de faire une autre hypothse - on
aurait tort, nous le prdisons, de mconnatre l'influence qu' la longue elles doivent
acqurir. Le monde se trouve aujourd'hui dans une impatience extraordinaire d'un
diagnostic mieux fond ; plus que jamais il est prt l'accepter et dsireux de l'prou-
ver, mme s'il n'est que plausible. Abstraction faite de cette disposition d'esprit
particulire l'poque, les ides, justes ou fausses, des philosophes de l'conomie et
de la politique ont plus d'importance qu'on ne le pense gnralement. A vrai dire le
monde est presque exclusivement men par elles. Les hommes d'action qui se croient
parfaitement affranchis des influences doctrinales sont d'ordinaire les esclaves de
quelque conomiste pass. Les visionnaires influents, qui entendent des voix dans le
ciel, distillent des utopies nes quelques annes plus tt dans le cerveau de quelque
crivailleur de Facult. Nous sommes convaincu qu'on exagre grandement la force
des intrts constitus, par rapport l'empire qu'acquirent progressivement les ides.
A la vrit, elles n'agissent pas d'une faon immdiate, mais seulement aprs un laps
de temps. Dans le domaine de la philosophie conomique et politique, rares sont les
hommes de plus de vingt-cinq ou trente ans qui restent accessibles aux thories nou-
velles. Les ides que les fonctionnaires, les hommes politiques et mme les agitateurs
appliquent la vie courante ont donc peu de chance d'tre les plus neuves. Mais ce
sont les ides et non les intrts constitus qui, tt Ou tard, sont dangereuses pour le
bien comme pour le mal.
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 175
Lexique
1
Retour la table des matires
Le mot capital ou quipement en capital (capital quipment) s'applique aux
richesses utiles de toutes sortes. Le capital comprend par consquent les moyens de
production, l'outillage, les stocks de marchandises, les maisons d'habitation, etc. En
aucun cas ce mot n'est pris dans le sens restreint de monnaie qu'on lui donne parfois,
par exemple lorsqu'on parle de mouvements internationaux de capitaux.
Le capital fixe (fixed capital) est le capital qui existe sous une forme durable et
dont les rendements s'chelonnent sur une certaine priode. Sa participation la pro-
duction n'entrane pour lui qu'une usure graduelle. Il comprend les immeubles,
l'outillage, etc.
Le capital circulant ou capital d'exploitation (working capital) comprend les
marchandises en cours de fabrication.
Le capital liquide (liquid capital) comprend les produits achevs prts tre
vendus.
La crise (crisis), au sens restreint du mot, est caractrise par la baisse soudaine
de l'efficacit marginale du capital au dbut d'une phase de dpression.
L'efficacit marginale d'un type de capital (marginal efficiency of a type of
capital) est le taux d'escompte qui rend la valeur actuelle de la srie d'annuits consti-
1
Le prsent lexique, qui est l'uvre du traducteur, est uniquement destin faciliter au lecteur l'in-
telligence du texte franais. Les dfinitions qu'il contient ont souvent un caractre explicatif et il
convient de ne pas leur accorder la mme porte qu'aux dfinitions de l'auteur figurant dans le
corps de l'ouvrage. Lorsque celles-ci ont t reproduites littralement, elles sont entre guillemets et
la rfrence au texte est indique (N. du T.).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 176
tue par les rendements escompts d'une unit supplmentaire de ce capital gale
son prix d'offre (i. e. approximativement son prix de revient). L'efficacit margi-
nale du capital (marginal efficiency of capital) est la plus leve des efficacits
marginales des divers types de capital (p. 150).
L'efficacit marginale du capital dcrot lorsque, toutes choses gales d'ailleurs,
l'investissement courant augmente. La courbe de l'efficacit marginale du capital ou
courbe de la demande de capital (schedule of the marginal efficiency of capital or
investment demand schedule) relie l'efficacit marginale du capital au montant de
l'investissement courant (p. 151). Cette courbe est une des trois variables
indpendantes du systme, c'est--dire qu'elle change pour des causes autonomes.
Le chiffre d'affaires A (sales-turnover) est le montant des ventes effectues, tant
aux consommateurs qu'aux entrepreneurs, pendant la priode considre.
La dpense pour la consommation (expenditure on consumption) est la valeur
des biens vendus aux consommateurs durant la priode considre (p. 80). Son
montant global est gal au chiffre d'affaires A diminu des ventes A
1
faites aux autres
entrepreneurs, c'est--dire A A
1
. La ligne de sparation entre les entrepreneurs et
les consommateurs peut tre place en un point arbitrairement choisi.
L'adjectif courant (current) dsigne le montant d'une grandeur variable l'poque
que l'on considre, ou encore pendant la priode que l'on considre si la grandeur
qualifie a la dimension d'une quantit par unit de temps, comme le revenu, la con-
sommation, l'pargne ou l'investissement. Lorsqu'on a affaire ces dernires gran-
deurs, on dsigne leur mesure par le mot montant, tant entendu qu'il s'agit du mon-
tant par unit de temps, ou d'une faon plus prcise par le mot flux.
Le cot de facteur (factor cost) d'un certain volume d'emploi est le montant
pay par l'entrepreneur aux facteurs de production (autres que les entrepreneurs) en
change de leurs services courants (p. 45).
Le cot d'usage (user cost) est la diminution de valeur subie par l'quipement au
cours de la priode considre du fait de sa participation la production (p. 89). La
diffrence entre G' - B', valeur maximum qu'aurait pu avoir l'quipement la fin de la
priode s'il tait rest inactif et G valeur qu'il a rellement la fin de la priode
provient d'une part de la diminution de valeur U rsultant de sa participation la
production, d'autre part de l'augmentation de valeur A, rsultant des achats au dehors.
On a donc
(G' - B') - G = U A
1
, et par suite
et par suite
U = (G' - B') - (G A
1
).
Lorsque la fin de la priode la valeur relle de l'quipement dpasse, d'un
montant suprieur aux achats faits hors de l'entreprise, la valeur maximum qu'il aurait
pu avoir s'il tait rest inactif, le cot d'usage est ngatif.
Le cot premier (prime cost) est la somme du cot de facteur et du cot
d'usage (p. 72).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 177
Le cot supplmentaire (supplementary cost) est la diminution de valeur de
l'quipement qui ne dpend pas de la volont de l'entrepreneur mais que celui-ci peut
prvoir. C'est encore l'excs de la dprciation attendue sur le cot d'usage (p. 75).
Le cot supplmentaire ne rsulte pas de la participation de l'quipement la pro-
duction, mais de la dsutude et des pertes assez rgulires pour constituer dans
l'ensemble de la communaut des risques assurables. On distingue le cot supplmen-
taire fondamental (basic), qui est dtermin l'origine compte tenu du cot de
l'quipement et de sa dure prvue, et le cot supplmentaire courant (current), qui
est rvalu ultrieurement sur la base de la valeur courante de l'quipement et de
l'estimation courante de sa dure future d'existence.
La courbe de la demande globale (aggregate demand function) relie les divers
volumes globaux de l'emploi aux produits que les entrepreneurs esprent en tirer.
Conjointement avec la courbe de l'offre globale, elle dtermine la demande effective
et l'emploi.
La demande effective (effective demand) est le montant du produit attendu
au point de la courbe de la demande globale o elle est coupe par la courbe de l'offre
globale (p. 47). En d'autres termes elle est la somme des dpenses de consommation
et des dpenses d'investissement, telles que les entrepreneurs les prvoient lorsqu'ils
fixent le volume de l'emploi. La demande effective a la nature d'une commande ou
d'une dpense et ne doit pas tre confondue avec la demande potentielle qui intervient
dans la loi de l'offre et de la demande. De plus elle est une demande attendue et c'est
par l qu'elle se distingue du revenu.
La dsutilit (disutility) du travail ou de l'emploi est l'ensemble des raisons qui
font qu'on ne travaille pas pour un salaire infrieur un certain minimum. De mme
que l'utilit est l'aptitude satisfaire un besoin, la dsutilit est l'aptitude contrarier
un besoin. Un travail ou un emploi est dsutile parce qu'il empche de se consacrer
une autre occupation utile ou non, ou simplement parce qu'il contrarie le got de ne
rien faire. La dsutilit se distingue de la nuisance par son caractre subjectif - elle
n'existe que par rapport au travailleur lui-mme - et aussi par le fait que normalement
elle est compense par une utilit qui lui est gale ou suprieure.
L'emploi (employment) est le nombre des units de travail employes. Pour fixer
les ides, on pourrait dire qu'il est le nombre des heures de travail fournies. Dans la
dfinition plus prcise donne au Chapitre IV, il est indiqu que chaque unit de tra-
vail est affecte d'un coefficient de pondration gal au rapport entre sa rmunration
et l'unit de salaire. L'emploi est gouvern par la demande effective. Il varie parallle-
ment au revenu, et ces deux quantits sont les variables dpendantes du systme.
Le mot entreprise (enterprise) est gnralement employ dans le sens ordinaire.
Mais en l'emploie aussi dans un sens restreint applicable au march financier. Dans
ce sens, il s'oppose au mot spculation et dsigne l'activit qui consiste prvoir le
rendement des capitaux au cours de leur existence tout entire (p. 174).
L'pargne (saving) est l'excs du revenu sur la consommation (P. 80).
L'pargne nette (net saving) est l'excs du revenu net sur la consommation (p.
81).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 178
quipement (equipment) : voir Capital.
Seul est considr comme facteur de production (factor of production) dans le
prsent ouvrage le travail y compris les services personnels de l'entrepreneur et de ses
assistants.
L'incitation investir (inducement to invest) est le motif qui pousse investir.
Elle dpend de la courbe de lefficacit marginale du capital et du taux de l'intrt
(p. 152).
L'investissement courant (current investment) est l'addition la valeur de
l'quipement qui rsulte de l'activit productrice de la priode (p. 81). Il est donc
gal aux achats A, faits par les entrepreneurs diminu du dsinvestissement rsultant
de la production, c'est--dire du cot d'usage ;
I = A
1
- U.
L'investissement net (net investment) est l'adjonction nette la valeur des qui-
pements de toute nature, aprs dduction des variations de valeur des anciens
quipements qui entrent dans le calcul du revenu net (p. 95)
I (net) = A
1
- U - V.
L'investissement et l'investissement net sont gaux respectivement l'pargne et
l'pargne nette.
Le terme placement que l'usage tend distinguer du terme investissement a t
rserv au march financier.
La prfrence pour la liquidit (liquidity preference) est la prfrence donne
l'argent liquide sur les autres formes de richesse. Elle se mesure par le montant de ses
ressources qu'on dsire conserver chaque instant sous forme de monnaie.
La courbe de la prfrence pour la liquidit (schedule of liquidity preference) est
la courbe indiquant le montant de leurs biens que les individus dsirent conserver
sous forme de monnaie en diffrentes sries de circonstances notamment lorsque le
taux de l'intrt varie, ce montant tant calcul en units de monnaie ou en units de
salaire (p. 181).
Le montant marginal ( marginal) de l'attribut d'une chose est le montant de
l'attribut possd par la dernire unit existante de cette chose, c'est--dire par l'unit
qui disparatrait si la quantit de cette chose tait rduite d'une unit. Par exemple, le
salaire marginal ou la production marginale est le salaire ou la production de l'unit
de travail qui disparatrait si l'emploi tait rduit d'une unit. Dans le calcul diff-
rentiel, le montant marginal de l'attribut est le rapport des variations corrlatives de
l'attribut et de la chose laquelle il se rapporte lorsque les deux variations tendent
vers zro.
Un procd mdiat (roundabout process) de production est un procd qui met en
oeuvre le capital. Il se divise en plusieurs stades. Les stades primaires correspondent
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 179
la cration du capital et les stades secondaires l'utilisation du capital pour la
production des biens de consommation.
Le multiplicateur d'investissement (investment multiplier) k indique que, lorsque
l'investissement crot, le montant du revenu augmente de k fois l'accroissement de
l'investissement (p. 132).
Le multiplicateur de l'emploi (employment multiplier) est le rapport entre
l'augmentation de l'emploi total et l'augmentation de l'emploi primaire (c'est--dire de
l'emploi dans les industries produisant les biens de capital) auquel il est associ (p.
132).
Le prix de l'offre globale (aggregate supply price) de la production rsultant d'un
certain volume d'emploi est le produit attendu qui est juste suffisant pour qu'aux
yeux des entrepreneurs il vaille la peine d'offrir ce volume d'emploi (p. 46). On
remarquera que le cot d'usage n'est pas compris dans le prix de l'offre globale (p.
46, note 1).
La courbe de l'offre globale (aggregate supply function) relie les divers volumes
globaux de l'emploi aux prix de l'offre globale de la production qui en rsulte.
L'emploi cesse de crotre lorsque le prix de l'offre globale est gal au prix de deman-
de globale, c'est--dire lorsque le volume de l'emploi est tel que le produit espr
par les entrepreneurs est juste suffisant pour les dcider offrir ce volume d'emploi.
Le prix d'offre de courte priode d'une richesse (short period supply price) est
gal au cot premier marginal (p. 87), c'est--dire la somme des valeurs
marginales du cot de facteur et dit cot d'usage. Le prix d'offre de courte priode
s'apparente ce qu'on appelle parfois le prix de revient partie], encore que celui-ci ne
paraisse pas comprendre l'intgralit du cot d'usage.
Le prix d'offre de longue priode (long period supply price) est suprieur au prix
d'offre de courte priode. On y peut distinguer le cot premier, le cot supplmen-
taire, le cot de risque et le cot d'intrt (p. 87).
La courte priode (short period) est une notion usuelle dans l'conomie classique.
Elle correspond une priode assez courte pour que le volume de l'quipement ne
puisse pas changer sensiblement.
La longue priode (long period) correspond une priode au cours de laquelle le
volume de l'quipement peut subir des variations apprciables.
La perte imprvisible (windfall loss) est la diminution de valeur de l'quipement
qui est tout la fois involontaire et, au sens large, imprvue (p. 76). Elle peut tre
due une variation des valeurs de march, une catastrophe, etc.
Le plein emploi ( full employment) est une situation telle que les facteurs de
production dsireux de travailler soient tous employs. Elle se caractrise par le fait
que l'augmentation du montant de la demande effective ne s'accompagne d'aucun
accroissement des volumes de la production et de l'emploi. Le plein emploi peut
encore tre dfini le volume maximum de l'emploi compatible avec un salaire rel
donn (p. 34).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 180
La prvision court terme (short terni expectation) a trait au prix qu'un fabri-
cant, au moment o il s'engage dans une fabrication, peut esprer obtenir en change
des produits qui en rsulteront (p. 65).
La prvision long terme (long term expectation) a trait aux sommes que
l'entrepreneur peut esprer gagner sous forme de revenus futurs s'il achte (ou parfois
s'il fabrique) des produits finis pour les adjoindre son quipement en capital (p.
65).
Le produit (proceeds) d'un certain volume de l'emploi est le montant en argent
du revenu global qui rsulte de ce volume d'emploi, i. e. la somme du cot de fac-
teur global et du profit global (p. 45). Le produit est le revenu global envisag
du point de vue des entrepreneurs, i. e. le chiffre d'affaires diminu du cot d'usage.
La propension consommer (propensity to consume est la relation fonctionnelle
(ou potentielle) entre un revenu global et la dpense de consommation laquelle il
donne naissance, les deux quantits tant mesures en units de salaire (p. 107).
Elle est, en quelque sorte, la relation entre les divers volumes possibles du revenu rel
et les volumes de la consommation relle qui leur correspondent.
La propension consommer est la deuxime variable indpendante du systme.
La propension marginale consommer est le rapport entre l'accroissement du
revenu et l'accroissement corrlatif de la consommation, les deux quantits tant
mesures en units de salaires (p. 132).
Les ressources (resources) comprennent les facteurs de production, la richesse
naturelle et le capital accumul.
Le revenu (income) est la valeur de la production due l'activit de la priode
considre. Il comprend le revenu de l'entrepreneur et le revenu des autres facteurs de
production, Le revenu de l'entrepreneur est gal la diffrence entre le chiffre
d'affaires et le cot premier, i. e. la somme du cot de facteur et du cot d'usage. Le
revenu des autres facteurs de production est gal au cot de facteur. Donc le revenu
est gal la diffrence entre le chiffre d'affaires et le cot d'usage
R = A - U.
Le revenu et l'emploi varient paralllement et sont les variables dpendantes du
systme.
Ajoutons que le revenu est gal la somme de la consommation et de l'inves-
tissement.
Le revenu net (net income) est gal au revenu diminu du cot supplmentaire,
A - U - V. Il est gal la somme de la consommation et de l'investissement net.
La spculation (speculation), au sens boursier du mot, est l'activit qui consiste
prvoir l'tat psychologique du march financier (p. 173).
J. M. Keynes(1936), Thorie gnrale de lemploi, de lintrt et de la monnaie (livres IV VI) 181
Le taux du troc extrieur (terms of trade) ou rapport rel des changes extrieurs
est une notion qui tient une place importante dans les tudes classiques et no-
classiques consacres aux avantages respectifs que les pays tirent de leurs changes.
Plusieurs mesures de ce taux ont t proposes. Le taux net du troc extrieur de
Taussig est le rapport entre l'index de prix des produits imports et l'index des
produits exports. Le taux du troc extrieur de Marshall est en gros le rapport entre
une quantit de travail tranger et la quantit de travail national qui s'change contre
la premire sous forme de marchandises et de services.
Le taux d'intrt d'une richesse quelconque (own rate of interest), dtermin au
moyen de cette richesse elle-mme, est le pourcentage d'excs d'une certaine quantit
de cette richesse livrable terme sur la quantit immdiatement disponible de cette
richesse qui s'change contre la premire.
Toute richesse durable a un taux d'intrt propre qu'on appelle son taux d'intrt
spcifique.
Le taux d'intrt spcifique d'une richesse, dtermin au moyen d'un talon de
valeur quelconque (own rate of interest in terms of a standart of value), est le
pourcentage d'excs de la valeur d'une certaine quantit de cette richesse livrable
terme sur la valeur de la quantit immdiatement disponible de cette richesse qui
s'change contre la premire quantit, les deux valeurs tant exprimes au moyen de
l'talon choisi.
Le taux d'intrt spcifique montaire (own rate of money interest) est le taux
d'intrt d'une richesse dtermin au moyen de la monnaie prise comme talon de
valeur.
Le taux d'intrt de l'argent (money rate of interest) est le pourcentage d'excs
d'une certaine somme de monnaie livrable terme sur la somme immdiatement
disponible qui s'change contre la premire.
Le taux d'intrt de l'argent, qui est la troisime variable indpendante du syst-
me, est gouvern par la quantit de monnaie et par la prfrence pour la liquidit.
L'unit de travail (labour unit) est l'unit qui sert mesurer l'emploi.
L'unit de salaire (wage unit) est le salaire montaire de l'unit de travail (p.
60).
La valeur nominale ou montaire (money value) est le nombre des units de
monnaie contenu dans une valeur ou un prix. La valeur montaire et l'emploi sont les
deux seules grandeurs quantitatives utilises dans l'analyse du systme conomique.
Pour suivre les variations des valeurs relles, il est souvent commode, en premire
approximation, de considrer les valeurs montaires, mesures en units de salaire.
La vitesse de transformation de la monnaie en revenu (income velocity of money)
est un concept de l'cole classique qui-peut tre dfini le rapport entre le revenu et la
quantit de monnaie.
Vous aimerez peut-être aussi
- Guide pratique des passeports financiers européens: Fiches de guidanceD'EverandGuide pratique des passeports financiers européens: Fiches de guidancePas encore d'évaluation
- Cours Sur Le Financement Des Programmes Et Projets 2020Document39 pagesCours Sur Le Financement Des Programmes Et Projets 2020AKPANGODE100% (1)
- Economie de MarcheDocument24 pagesEconomie de MarcheBennaceur Thami100% (1)
- Petit Bréviaire Des Idées Reçus en ManagementDocument286 pagesPetit Bréviaire Des Idées Reçus en ManagementFatima EzzahaPas encore d'évaluation
- La Monnaie Et Ses MécanismesDocument129 pagesLa Monnaie Et Ses MécanismesIssam Hafid100% (13)
- Régulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionD'EverandRégulation bancaire et financière européenne et internationale: 5e éditionÉvaluation : 1 sur 5 étoiles1/5 (1)
- Théorie Générale de L'emploi Et de La MonnaieDocument107 pagesThéorie Générale de L'emploi Et de La MonnaieStansIIIPas encore d'évaluation
- JM Keynes: Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La MonnaieDocument3 pagesJM Keynes: Théorie Générale de L'emploi, de L'intérêt Et de La Monnaiebeebac2009100% (1)
- Cours de Macroeconomie Monetaire Et Financiere-1Document35 pagesCours de Macroeconomie Monetaire Et Financiere-1Yann Metuschelah Kouassi100% (1)
- L'Economie? Rien de plus simple!: Avec Jean-David Haddad, pour enfin décoder médias, politiques, profs d'éco...D'EverandL'Economie? Rien de plus simple!: Avec Jean-David Haddad, pour enfin décoder médias, politiques, profs d'éco...Pas encore d'évaluation
- Economie Monetaire Et FinanciereDocument322 pagesEconomie Monetaire Et FinanciereepoptaePas encore d'évaluation
- Theorie Microeconomique Du ConsommateurDocument34 pagesTheorie Microeconomique Du ConsommateurHamza TamesnaPas encore d'évaluation
- Bernard Baudry - Economie de La Firme (2007, LA DECOUVERTE) PDFDocument129 pagesBernard Baudry - Economie de La Firme (2007, LA DECOUVERTE) PDFseydinaPas encore d'évaluation
- Théorie Économique ContemporaineDocument12 pagesThéorie Économique ContemporaineBoubaker NafiaPas encore d'évaluation
- Théorie Economique Contemporaine Cours 2020Document30 pagesThéorie Economique Contemporaine Cours 2020Meryem BouchemamaPas encore d'évaluation
- La Monnaie Et Ses PiegesDocument271 pagesLa Monnaie Et Ses PiegesTouriaBenKhouya100% (1)
- Économie KeynésienneDocument6 pagesÉconomie KeynésienneFaty M'qPas encore d'évaluation
- John Maynard Keynes-Essais Sur La Monnaie Et L'économie - Payot (1990)Document151 pagesJohn Maynard Keynes-Essais Sur La Monnaie Et L'économie - Payot (1990)Mladi Antifašisti ZagrebaPas encore d'évaluation
- Résume de H.P.EDocument19 pagesRésume de H.P.Eabdel hakim100% (1)
- Nationalite Des Entreprises Multinationales Et MondialisationDocument164 pagesNationalite Des Entreprises Multinationales Et MondialisationMihai Popa100% (1)
- Economie Monetaire PDFDocument91 pagesEconomie Monetaire PDFproximastar100% (1)
- M1 Chap1 Part1 16 PDFDocument30 pagesM1 Chap1 Part1 16 PDFJackdarwin Ilunga6100% (1)
- L'incertitude Dans Les Theories Economiques Nathalie Moureau, Dorothee Rivaud-Danset - La Découverte (2007) PDFDocument126 pagesL'incertitude Dans Les Theories Economiques Nathalie Moureau, Dorothee Rivaud-Danset - La Découverte (2007) PDFMarwaneEl-lamraniPas encore d'évaluation
- École ClassiqueDocument4 pagesÉcole Classiquejames_hetfild005Pas encore d'évaluation
- La Théorie Générale Et Le KeynésianismeDocument226 pagesLa Théorie Générale Et Le KeynésianismeJaaPas encore d'évaluation
- Politique Économique Chapitre-1Document60 pagesPolitique Économique Chapitre-1clémence_forestPas encore d'évaluation
- Disertation Economique 2 PDFDocument16 pagesDisertation Economique 2 PDFTayeb BouguedraPas encore d'évaluation
- Chapitre Introductif. Les Marchés DérivésDocument14 pagesChapitre Introductif. Les Marchés Dérivéssahar0% (1)
- Cours TEC CompletDocument70 pagesCours TEC CompletMARYAM BAISSYPas encore d'évaluation
- Modèle IS-LMDocument39 pagesModèle IS-LMYopp Bob100% (2)
- Aglietta - Le Risque SystémiqueDocument56 pagesAglietta - Le Risque Systémiquevalentbr100% (1)
- InvestissementDocument6 pagesInvestissementMarie NdyPas encore d'évaluation
- Ch3. L'investissementDocument6 pagesCh3. L'investissementFiras KACHROUDIPas encore d'évaluation
- SUPPORT COURS Economie Monétaire Et Financière IDocument163 pagesSUPPORT COURS Economie Monétaire Et Financière IBoujnah Salma12Pas encore d'évaluation
- Chapitre5 LES NEOCLASSIQUESDocument4 pagesChapitre5 LES NEOCLASSIQUESJEAN OUMAR THIANEPas encore d'évaluation
- Cycle Économique Et Analyses ConjoncturellesDocument114 pagesCycle Économique Et Analyses Conjoncturellesmgracien100% (5)
- Economie MonétaireDocument5 pagesEconomie MonétaireEM Anas100% (1)
- Les Nouvelles Théories ÉconomiquesDocument17 pagesLes Nouvelles Théories ÉconomiquesRif SpiritPas encore d'évaluation
- TD 3 - Méthodologie de Box-Jenkins Pour Les Modèles ARIMA SARIMADocument43 pagesTD 3 - Méthodologie de Box-Jenkins Pour Les Modèles ARIMA SARIMABouchra RadPas encore d'évaluation
- Keynes, Les Keynésiens Et Les Anti-Keynésiens (Menia, Combemale, Tutin & Dostaler)Document21 pagesKeynes, Les Keynésiens Et Les Anti-Keynésiens (Menia, Combemale, Tutin & Dostaler)LunePas encore d'évaluation
- Econometrie Suite LareqDocument109 pagesEconometrie Suite LareqSarah Rose100% (3)
- Chapitre 1la MonnaieDocument5 pagesChapitre 1la MonnaieAhmed AmghoughPas encore d'évaluation
- Histoire Pensee EconomiqueDocument41 pagesHistoire Pensee EconomiqueanasPas encore d'évaluation
- Cours PESDocument71 pagesCours PESOURIQUA0% (1)
- Anticipation RationnelleDocument6 pagesAnticipation RationnellemurielPas encore d'évaluation
- Les Politiques Économiques PrésentationDocument13 pagesLes Politiques Économiques PrésentationAnas Elmonfaloti100% (2)
- 10-Rapport Sur L'efficience-Des-MarchésDocument20 pages10-Rapport Sur L'efficience-Des-Marchésmarouane belbahiPas encore d'évaluation
- La Pensée ÉconomiqueDocument65 pagesLa Pensée ÉconomiqueAmine Adel BENGHERABI0% (1)
- Les Instruments de La Politique MonétaireDocument2 pagesLes Instruments de La Politique MonétaireOSCAR100% (1)
- Politique Économique (Résumé)Document3 pagesPolitique Économique (Résumé)MouradBardach100% (1)
- La Crise 2008Document41 pagesLa Crise 2008Bennaceur Thami100% (1)
- Théorie Economique Contemporaine Partie 1Document12 pagesThéorie Economique Contemporaine Partie 1Hamza AzdouzPas encore d'évaluation
- Stationnarité Des Variables, EconometrieDocument22 pagesStationnarité Des Variables, EconometrieIbrahim Elansari100% (1)
- Courants Economiques Resume 2020-2021Document29 pagesCourants Economiques Resume 2020-2021عبداللهبنزنوPas encore d'évaluation
- R - Sum - de TH - Orie - Conomique ContemporaineDocument22 pagesR - Sum - de TH - Orie - Conomique ContemporaineMed Elbatani100% (1)
- Introduction À La Microéconomie CH 7Document22 pagesIntroduction À La Microéconomie CH 7karim kobeissiPas encore d'évaluation
- P2-Chapitre 3 La Théorie Quantitative de La MonnaieDocument15 pagesP2-Chapitre 3 La Théorie Quantitative de La Monnaiemalaga04Pas encore d'évaluation
- Croissance Economique1Document10 pagesCroissance Economique1Oumaima AnnabaPas encore d'évaluation
- Les Capitalistes du XXIème siècle: La montée en puissance des nouveaux gestionnaires financiers. Un résumé généralement compréhensibleD'EverandLes Capitalistes du XXIème siècle: La montée en puissance des nouveaux gestionnaires financiers. Un résumé généralement compréhensiblePas encore d'évaluation
- Libéralisme Contre CapitalismeDocument276 pagesLibéralisme Contre CapitalismeHamzaPas encore d'évaluation
- Keynes Reforme MonetaireDocument121 pagesKeynes Reforme MonetaireandjongoPas encore d'évaluation
- Grands Auteurs Economie Ebooks-LandDocument284 pagesGrands Auteurs Economie Ebooks-LandHamzaPas encore d'évaluation
- Economie Republique Populaire ChineDocument20 pagesEconomie Republique Populaire ChineHamzaPas encore d'évaluation
- Solution Absorbante Detient Des Titres de L'absorbeeDocument2 pagesSolution Absorbante Detient Des Titres de L'absorbeeAdama BerthePas encore d'évaluation
- Module 1 - TranscriptionDocument41 pagesModule 1 - TranscriptionFélix NganduPas encore d'évaluation
- EExercices IAS IFRS Avec CorrigésDocument34 pagesEExercices IAS IFRS Avec Corrigésimanebelharcha7Pas encore d'évaluation
- Comptabilité AnalytiqueDocument177 pagesComptabilité AnalytiqueKallelcd80% (10)
- Capital InvestissementDocument189 pagesCapital InvestissementIbrahim Khadraoui100% (1)
- Support Macro TDDocument41 pagesSupport Macro TDkhardiata diattaPas encore d'évaluation
- Comptabilite Des SocietesDocument220 pagesComptabilite Des Societeszadou abdel-azizPas encore d'évaluation
- Les Fondements Du Capitalisme en 1000 Mots - Jeremie RostanDocument2 pagesLes Fondements Du Capitalisme en 1000 Mots - Jeremie RostanCopeauPas encore d'évaluation
- Analyse Fin LiceDocument48 pagesAnalyse Fin Licengock isom herve danielPas encore d'évaluation
- Avs NVDDocument94 pagesAvs NVDImed ShelbiPas encore d'évaluation
- Commissariat Aux ApportsDocument26 pagesCommissariat Aux ApportsDadimiliana DadiPas encore d'évaluation
- Comptabilite Generale 1: Oukassi MustaphaDocument76 pagesComptabilite Generale 1: Oukassi MustaphachahdiPas encore d'évaluation
- TD Couts Complets 2024Document7 pagesTD Couts Complets 2024kipreezechielkouadioPas encore d'évaluation
- Correction Des Exercices Analyse Financière Partie 1Document3 pagesCorrection Des Exercices Analyse Financière Partie 1Orlik Ferraud MAISSA MBERAPas encore d'évaluation
- Fiche 2-1 - Comment L'entreprise Produit-ElleDocument8 pagesFiche 2-1 - Comment L'entreprise Produit-ElleMme et Mr Lafon100% (2)
- Brunhoff, S. Notes Sur La Finance, Une Perspective MarxisteDocument4 pagesBrunhoff, S. Notes Sur La Finance, Une Perspective MarxisteAll KPas encore d'évaluation
- Approche PatrimonialeDocument3 pagesApproche PatrimonialeAc MarouaPas encore d'évaluation
- Achats Et Creation de ValeurDocument41 pagesAchats Et Creation de ValeurDavid K. Cophie0% (1)
- Moucharaka DefinitionDocument2 pagesMoucharaka DefinitionunessPas encore d'évaluation
- USA Lutte Contre Le Blanchiment Des CapitauxDocument45 pagesUSA Lutte Contre Le Blanchiment Des CapitauxmohamedPas encore d'évaluation
- TC-AA-Gestion Documentaire Manuel Travaux PratiquesDocument37 pagesTC-AA-Gestion Documentaire Manuel Travaux PratiquesAhmed Bakrim100% (1)
- Plan de Financement 3ans 2016.93576Document1 pagePlan de Financement 3ans 2016.93576gbessaya cathianePas encore d'évaluation
- Informatique de Gestion - 2013-2014Document186 pagesInformatique de Gestion - 2013-2014badibangaisrael01Pas encore d'évaluation
- Steve Keen L Imposture Economique PDFDocument431 pagesSteve Keen L Imposture Economique PDFbienaimé100% (1)
- Christian Topalov - Le Profit, La Rente Et La Ville (1984, Economica) - Libgen - LiDocument234 pagesChristian Topalov - Le Profit, La Rente Et La Ville (1984, Economica) - Libgen - LiWesley MarinhoPas encore d'évaluation
- 21croissance Et Fluctuations ÉconomiquesDocument8 pages21croissance Et Fluctuations ÉconomiquesAli LaminPas encore d'évaluation
- TD1 Speedway CorrigéDocument21 pagesTD1 Speedway CorrigéGILLES Manon100% (1)
- QCM Fiscalité SECTION 1 CHAP 1pdf - 221106 - 120920Document6 pagesQCM Fiscalité SECTION 1 CHAP 1pdf - 221106 - 120920imane bousslimePas encore d'évaluation
- Séance 9 (7-12-2021)Document9 pagesSéance 9 (7-12-2021)Maarouf SalmPas encore d'évaluation