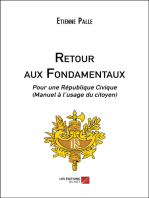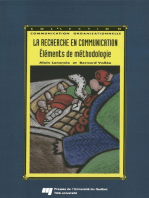Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
La Communication Politique PDF
La Communication Politique PDF
Transféré par
Ismail DehlatTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
La Communication Politique PDF
La Communication Politique PDF
Transféré par
Ismail DehlatDroits d'auteur :
Formats disponibles
La communication politique
Dcembre 2005
Par Vincent Georis, chercheur-associ dtopia
Plus leve est linformation, plus il est difficile de la communiquer. Plus le message se communique clairement, moins il informe. Umberto Eco, Luvre ouverte
Int ro d u c t io n 1
La distinction entre les notions de communication et dinformation, gnralement indistinctes dans le langage courant, est une condition pralable. Communiquer trouve sa racine dans lide d changer , informer signifie donner forme . La communication politique, quant elle, peut se dfinir au sens strict comme un moteur dadhsion et de gouvernance au sein de lagora. Dsignant depuis lantiquit un lieu public exclusivement matriel o se tenait le commerce et les changes dides, lagora est aujourdhui un espace public dmatrialis (mdias), ou un lieu de rencontre(s) occasionnelles (confrences, vnements, cafs, porte--porte ...). La communication politique implique une entre en relation, verbale et non-verbale. Ces deux lments, souvent oublis en cours de processus, sont deux moteurs de pouvoir et de dcodage, largement utilis en techniques de ngociation pour mieux comprendre les comportements, lire les intentions ou faire passer un message. Pour obtenir de ladhsion, communiquer en politique, implique lutilisation des codes et des canaux de lespace public et une matrise de son langage verbal et non-verbal. Lobjectif est de crer de lempathie ou, parfois, de la dysempathie lgard des adversaires politiques (syndrome de llve isol). La communication politique donne de la visibilit aux acteurs du pouvoir (sujet) et aux orientations de la mdiation politique (objet). Ces considrations ne catgorisant pas pleinement la communication politique, il convient dajouter la spcificit du langage politique : la situation de reprsentation (mandat) dans laquelle se trouve le sujet, ou lmetteur. De fait, le politicien a des comptes rendre dans lespace public, lequel est limit par un champ de conscience collective assimilable lordre juridique dans lequel il se trouve. La consquence de ce rapport de reprsentation, largement cod depuis lmergence de la dmocratie reprsentative, est que laffirmation lisible vaut intentionnalit (la parole correspond ce que je veux). Cette considration est importante car elle conditionne limage mme du politique dans lespace public. Chaque mot entrane une responsabilit, mais aussi, chaque projet politique ne pourra exister qu travers des mots. Communiquer, en politique comme ailleurs, cest se dpasser pour donner vie un projet et le transmettre. Cest donc, pour beaucoup, une question daptitude, dentranement et de matrise.
Ces notes sont illustres par le diaporama prsent dans le cadre de la formation etopia_ sur la Communication politique le 12 mars 2005 Namur. Il peut tre consult sur le site detopia_
La Communication
Cest la conscience de soi quest lie linaptitude communiquer, ou plus exactement au fait que celle-ci demeure contracte et crispe. On distingue deux niveaux o la communication devient relle : lun est celui de la navet ou de ce que lon appelle lesprit denfance qui prcde la conscience de soi, lautre, infiniment plus lev, o celle-ci a triomph delle-mme Gabriel Marcel
1.1
Dfinitions : de linformation la communication, de la matire au troc Communication Lat. Communicatio : troc . Minimaliste - modle tlgraphique (Shannon, 1949) : transmission dun signal entre lmetteur et le rcepteur. Maximaliste (Bateson, 1987) : tout vnement qui dclenche une raction de la part dun organisme. Petit Robert : Echange dides et dinformations, mais aussi les moyens techniques et outils par lesquels ces informations sont transmises . Winkin (1981) : fourre-tout. Fatras smantique. Jakobson : opration par laquelle un metteur transforme une reprsentation en une suite de signaux selon les rgles dun code et la transmet destination dun rcepteur qui dcode le message.
Information Donner forme une matire (me -Aristote) Faire connatre quelque chose quelqu'un ( les ides forment lesprit - Descartes) Exemple : information gntique : forme de la vie transmise gntiquement Phobie du sens (Hillman): ncessit de retrouver le sens originaire des mots 2005 : la socit de linformation et la surinformation - Lhomme, conscient quil n est pas infini a besoin dinformation - Linformation est-elle une finalit ?
Ces deux approches nous permettent de comprendre toute lambigut qui circule lorsque la diffrence entre information et communication nest pas clairement tablie. Dans quel dosage, par exemple, le journal de la tlvision publique de la RTBF est-il constitu dinformation ou de communication politique ? Aprs avoir visionn celui-ci, les tlspectateurs se considreront le plus souvent comme inform . Combien dentre eux auront fait un effort de dcodage ? Il convient, demble, dluder le modle tlgraphique de Shannon, largement dpass : la communication nest pas simplement un moyen de transmettre une information, mme si celle-ci se communique. Cest bien plus. Le schma de Jakobson, quant lui, permet dapprhender cette distinction et de dcouvrir, progressivement, le vritable flux de pouvoir que vhicule la communication politique.
1.2
Schma de Jakobson Jakobson a mis en avant six lments dans la communication. 1) Emetteur : intention produit le message ou les signes, mais pas forcment son contenu . Il peut sagir dune chane dmetteurs. 2) Rcepteur : soit affectifs (tous ceux mis en prsence) soit cibl(s) (destinataire(s) prcis). 3) Canal : auditif - visuel - tactile -gustatif. Simple ou multiple : audiovisuel. 4) Code : ensemble de signes potentiellement utilisables, gnralement subdivisable en sous-ensembles (paradigmes). 5) Contexte : rfrent, ce sur quoi porte le message, ce dont il parle. 6) Message : ensemble particulier de signes choisis au sein dun ou plusieurs codes. Ne pas confondre avec linformation.
A ces six lments, sont lies six fonctions du message. 1) Expressive : permet lmetteur dexprimer son attitude, son motion, son affectivit (intonation, timbre ) 2) Conative : centre sur le rcepteur. Intention de lmetteur (ordre, question). Manipulation. 3) Phatique : fonction de contact ( all , bonjour ). Sert tablir la communication. Convivialit, efficacit. 4) Rfrentielle : informative, concerne le rfrent. La question dont parle le message. 5) Potique : rhtorique, met en vidence le message. 6) Mtalinguistique : expliciter les formes du langages, s assurer quon met sur la mme longueur donde .
Application - Dterminer les fonctions utilises dans ces trois symboles
Rponse : cercle : conatif (ordre); carr : rfrentiel (information); triangle : conatif et rfrentiel
1.3
Les formes de la communication Le tableau reste incomplet si on najoute pas aux fonctions les formes de la communication. Celle-ci est soit digitale, soit analogique. Digitale : symboles, mots employs pour dsigner les choses. Fait partie dune convention smantique propose par un langage. Logique, souple, prcise. Dfinit le contenu de la relation. Analogique : simiesque, primitive, animale, riche de sens et directement comprhensible. Intuitive et signifiante. Manque de souplesse. Dfinit la relation.
1.4
La communication, relation avant tout physique (non-verbale) La communication, au-del de son rapport avec linformation, est un moyen dtre au monde, dexister. Il convient donc de se dpartir de lunivers de la pense pour prendre conscience que lorsque lon parle de communication, on produit avant tout une image et du sens. En moyenne toute communication implique 25% dlments verbaux et 75% de nonverbaux. Laspect analogique, voire simiesque, est donc prdominant dans les rapports humains. Bien entendu, cette proportion variera en fonction de la finalit de ces rapports (cours duniversit, achats, rapport amical).
1.5
Communication et cyberntique Vu le rapport entre le verbal et le non-verbal, la distinction entre les formes analogiques et digitales, il apparat clairement que le schma de Jakobson est purement thorique. Il ne vaut que dans la mesure de lapplication des combinaisons de ses diffrents lments. Dans la ralit, la transmission de l'information n'est pas qu'un transfert par flux cod et canalis, mais bien plus, un processus de l'information la fois physique et humain o toute transformation est possible. Dans ce processus, la rtroaction est un pralable lefficacit de la communication politique. Les sondages, par exemple, sont un excellent retour faisant aujourdhui partie intgrante de la communication politique. Ils sont, en dehors de toute reconnaissance institutionnelle de leur existence, bel et bien vecteurs de pouvoir. Voire un cinquime pouvoir. On en vient reconstituer de la sorte un art aussi vieux que la dmocratie : la cyberntique. La cyberntique, lart de gouverner (Platon), implique les flux de communication suivants :
Le meilleur exemple reste celui du navire et du gouvernail : chaque poste, chaque rle de marin sur un navire implique un flux dinformation vers le dtenteur du gouvernail, et passe par le capitaine . La rtroaction le retour dinformation sur leffet dun acte ou dune dcision est un lment dterminant. Lorganisation de cette rtroaction est la cl de vote de ldifice dcisionnel. Ce flux dinformations est prsent chaque stade de la communication politique, vecteur de pouvoir.
1.6
La communication, reconnaissance de lidentit individuelle et sociale La communication politique se distingue galement de la communication simplement intersubjective (discussion etc..), mme si lune peut procder de lautre. La communication intersubjective suppose un metteur et un destinataire. Elle prfigure le stade du miroir , fondateur de la personnalit. Cest travers la communication intersubjective que lindividu contribue construire son identit et celle de lautre. La communication politique, dans sa spcificit, implique un metteur, acteur dans lespace public et des destinataires, qui interagissent dans la reprsentation (symboles) et la gouvernance.
2
2.1
La Communicat ion polit ique
Dfinition Moteur central dadhsion et de gouvernance, la communication politique suppose la formulation des objectifs des forces politiques en rapport avec les attentes des lecteurs. Sa fonction gnralement reconnue est dtre constitutive de lidentit par la transmission de pratiques symboliques dans lequel llecteur se reconnat.
2.2
Spcificit Si lon se rfre au schma de Jakobson, la spcificit de la communication politique est que lmetteur est un sujet politique fait de rel, dimaginaire et sexprimant en utilisant une symbolique. Rel : exprience telle quelle figure avant la socialisation (dimension singulire). Imaginaire : mise en mouvement du dsir une fois que le sujet existe dans lespace public, projection. Symbolique : ensemble des codes par lesquels le sujet va exprimer sa filiation collective.
2.3
Communication politique, propagande et publicit politique En dmocratie reprsentative, le sujet politique sexprime dans lespace public en utilisant la communication politique, qui repose sur ladhsion de lmetteur au signifiant, en quelque sorte au message quil dlivre. La dmarche se diffrencie de la propagande politique, dans laquelle lmetteur se disjoint du signifiant. Cette dernire est propre aux Etats totalitaires. Ici, le message est dordre totalitaire dans la mesure o il tend conditionner les destinataires vers une valeur dite absolue (par exemple, la famille dans le rgime ptainiste). Une troisime catgorie, la publicit politique, utilise de plus en plus en dmocratie, cre quant elle une disjonction entre lmetteur (gnralement non identifi comme porteur du message) et le destinataire. Cette catgorie fait largement appel limaginaire pour provoquer ladhsion une ide, et non un systme totalitaire. Le dclin des idologies globalisantes dans les dmocraties reprsentatives nest pas tranger un mode de communication du politique tendant de plus en plus vers lusage de la publicit politique, qui vhicule des rfrents, finalement, puiss dans limaginaire collectif et non la politique stricto sensu.
2.4
Communication politique et pouvoir Le pouvoir circule partout, et bien au-del des structures et des fonctions institutionnelles de la dmocratie. Lmergence de la communication politique est indissociable de lvolution du pouvoir et de lexpression de la contrainte. La mtaphore du renard (metis) et de la pieuvre (octopus), permet de comprendre comment lhomme sest positionn dans cette volution, de lusage de la ruse la violence physique dans les rapports individuels et collectifs, lusage de largent et de la communication dans les socits complexes. Durant lAntiquit et le Moyen-Age, on assiste la prdominance de la ruse, limage du renard, qui fascinait les guerriers, car il tait un des seuls animaux pouvoir faire le mort pour attraper sa proie. Une ruse que lon dcouvre dans les rcits transmis jusqu nous. Lautre instrument de domination est la contrainte physique. Le droit interdisait le regroupement en collectivits fortes qui auraient permis de contrer le pouvoir de lEtat. A partir du 17me sicle, apparaissent les grandes organisations (octopus) et le bannissement de la contrainte physique dans les rapports avec lEtat, qui va tre remplace progressivement par des degrs dadhsion divers allant de lacte volontaire lemprise psychique et la manipulation . Les stades traditionnellement reconnus sont lloquence, la rhtorique, linstrumentalisation, lendoctrinement et la rification. Les rvolutionnaires de 1789 font usage, pour la premire fois, de la rhtorique qui se substituera, dans les usages politiques franais, la guillotine. Au dbut du 21me, cette tendance se poursuit avec le dveloppement de la psychologie et mne, des degrs divers, la communication politique, qui induit une acceptation libre ou consentie par des gestes dadhsion volontaires (ex. : ptition lectronique). Aujourdhui, certaines techniques ne sont pas loin des drives de la communication utilise dans le marketing : voir le marketing viral, ou encore neuromarketing. Lusage, par exemple, des images subliminales lors des campagnes de Georges Bush contre Al Gore (un spot invisible lil nu mais peru par le cerveau traitant ce dernier de rat ), est plus quun avertissement.
2.5
La manipulation : une mise en scne phmre Lapproche de la communication politique ne peut tre dissocie dune prise en compte - gnrale - de la manipulation. Le concept de manipulation nest pas trs ancien, il est apparu au 17me sicle dans le sens de lutilisation dun objet en alchimie. Prcisment, la manipulation est une mise en scne et qui vise clipser la conscience. Elle se fonde sur une matrise du temps dinformation et lintroduction de fausses informations dans un processus. Elle peut se caractriser par la mise en uvre de violence et de mcanismes visant faire oublier lusage de la force physique ou mentale. De la ruse du renard laction tentaculaire de loctopus, de lusage de la force au neuromarketing (images subliminales, ), la manipulation se fonde sur un artifice qui, est gnralement, limit dans le temps. Il en est ainsi, par exemple, des techniques de propagandes qui nont pas rsist, en France par exemple, aux annes septante, en raison du dveloppement dun esprit critique qui allait de paire avec la fin dun systme. Moralement rejete, juridiquement souvent accepte, surtout lorsque le dol vite une emprise matrielle ou factuelle, la manipulation a vocation a tre dcouverte.
2.6
La propagande politique Le premier usage de la notion de propagande remonte 1622, avec la publication par le Vatican de Congregassio de propaganda fide, destin la propagation de la foi par les missionnaires. Elle sest aussi manifeste lors de la Rvolution franaise par un usage rpandu de lloquence. Larrive du suffrage universel au dbut du 20me sicle a pos la question de lorientation dun nombre de plus en plus grand dlecteurs. Comment toucher les masses ? En rponse, et en drive, sest dveloppe la propagande. Elle varie selon les systmes. LAgit-prop de Lnine (agitation externe par rvolution propagande interne par endoctrinement) fut une application des tudes de Pavlov sur le conditionnement. La Minculpop de Mussolini se caractrisait par une concentration de la culture, des relations presse et de lencadrement des partisans dans un seul ministre. Le Nazisme a, quant lui, pouss lextrme laberration en prnant la cration dun homme nouveau par lusage dune propagande irrversible, un individu reconstruit. En 1970, lvolution culturelle et politique aboutit au rejet de la propagande de tous les programmes politiques.
2.7
La communication politique Dj, aux Etats-Unis en 1936, llection de Roosevelt se fonde en grande partie sur lutilisation de la technique du sondage, ralis par le clbre institut Gallup. Contrairement lendoctrinement en cours en Europe, on assiste au dveloppement progressif dun merchandising politique (campagnes tlphoniques, sondages) o un feed-back est ralis de manire rgulire pour dterminer un instantan de lopinion publique et construire une rponse approprie. Il en rsulte lusage dune communication plus douce , vers les lecteurs. Le comportement des candidats change en consquence, de Roosevelt Kennedy, lhomme politique amricain devient de plus en plus empathique, souriant. Il faut attendre 1960 pour dcouvrir en France le premier sourire sur une affiche politique (Lecanuet). Cette tendance nest pas vcue en Europe comme aux Etats-Unis. Sur le vieux continent on critique aisment, tort ou raison, ce que certains voient comme une complaisance ou un sourire commercial. La pratique se renforce dans certaines dmocraties par la prparation de lopinion publique, en dveloppant des argumentaires sur base des sondages et de campagnes tlphoniques. A tel point que dans les annes 80, il est de plus en plus ncessaire que le politicien sentoure de conseillers en communication, quip et expriment, gnralement issus du secteur priv. Cest le temps des gourou, reprsent en France par lagence de Jacques Seguela, auteur de la campagne de Franois Mitterrand en 1981, intitule La force tranquille . Le ressort de cette campagne repose sur une affiche du candidat posant en gros plan, avec, derrire lui, un village franais cr de toute pice, sous un ciel discrtement bleu-blanc-rouge et une petite Eglise pour rassurer les catholiques susceptibles de voter gauche. En 2005, la tendance dominante est une communication euphmise, cest--dire crant une atmosphre lgre, rassurante et empathique, comme pour se prmunir de toute rvolte ou de tout bouleversement dans une socit de plus en plus envahie par les images dun monde extrieur en crise. Depuis les annes nonante, le politique a rsolument quitt son attitude institutionnelle de retrait pour devenir un vritable aspirateur dides du marketing.
Hritage dun capitalisme de plus en plus agressif, allant du tout juste tolrable la drive, les applications vont du neuromarketing, au transfert dattitude (usage de messages simplistes) lutilisation des relais. On en est arriv conditionner linformation et non plus llecteur : les relais transmettent linformation. Les lus et les lecteurs sont disjoints. Lespace public a t progressivement dmatrialis. Limage est donc devenue prpondrante et, paradoxe des mdias, le politique coexiste avec la publicit dans le mme espace. Limage est dailleurs bien plus prpondrante que le peroit, consciemment, le sujet. Par exemple, un test laveugle a dmontr que si les consommateurs aux yeux bands prfrent le got du Pepsi, lorsquils voient les canettes, ils prfrent le Coca en raison de la couleur rouge (stimulante).
2.8
Les relations publiques : de labus lutilit Un des fondateurs des relations publiques est Edward Bernay, un neveu de Freud. Son leitmotiv : La dmocratie qui est la ntre doit tre une dmocratie administre par une minorit intelligente qui sait comment enrgimenter et guider les masses. Sans revenir sur le dveloppement des techniques de marketing dans la sphre politique, il convient de mettre laccent sur les abus les plus rcents, o le marketing lui-mme et non plus les techniques font intrusion dans le champ politique par un lobbying agressif. La firme Monsanto, par exemple, utilise abondamment le ressort compassionnel et le marketing viral. Il y a quelques annes, pour contrer les anti-OGM, Monsanto a propag via une socit de relations publiques (Limagrain) une information compassionnelle dans les mdias (tudes pseudo scientifiques, publicits etc.). Le message tait simple : les OGM permettent de fabriquer des mdicaments efficaces et bon march. Les relations publiques sont, de fait, devenues incontournables, et dpendent de lthique de leur utilisateur. Elles sont, de toute faon, invitables lors dvnements, pour installer une fonction phatique (accueil, structure, mise en scne symbolique).
2.9
Les travers de la communication politique Parmi les travers de la communication politique, outre une utilisation non-thique des techniques usuelles de relations publiques, on relve la propagande de dnonciation et la dsinformation, deux contre-feux limits dans le temps. La propagande de dnonciation : construire une identit politique ngative (Commedia dell arte, Guignols). Limite : disparat avec ladversaire. Dsinformation (1945, KGB) : se fonde sur des faits, des images et des paroles relles, qui deviennent la cl de la dsinformation.
2.10 La communication de crise Les annes 80 ont t caractrises par lapparition et le dveloppement de crises lies des questions denvironnement et de qualit de vie. Les forces conservatrices, un temps dstabilises, ont mis en place la fin des annes nonante des stratgies de sortie. Dans lordre : le comit dexperts, le plan durgence, la responsabilit juridique, le bouc missaire.
La disparition, o la matrise, de la crise entrane la disparition de lopposant. Exemple : Vache folle, dioxine, DHL, vols de nuit
2.11 Vers une communication durable Il est devenu impossible de gouverner ou de prtendre une place utile sans connatre et utiliser positivement les notions de base de la communication politique, connaissance qui fait lobjet la fois dun processus dapprentissage personnel, dune assistance ponctuelle et dune dimension inne. Sous cet angle, la communication politique fournit deux axes de gouvernance : 1. 2. La cyberntique : la mise ne place de mcanismes de rtroaction de linformation (sans quoi on ne peut rorienter le gouvernail) La reconnaissance (miroir social) de lautre, lempathie (sans quoi on rompt le contact).
En synthse, on peut isoler quatre conditions de la communication politique : 1. 2. 3. 4. Respect de la temporalit et des symboles constituant lespace collectif (connaissance du terrain) Apprentissage et mise jour des techniques de communication Utilisation positive et thique des techniques, des symboles collectifs, projection des objectifs Diversification : usage de mdias alternatifs (Internet, mdias locaux, lieux publics ).
La communication non-verbale
Comme dcrit plus haut, la communication non-verbale constitue en moyenne 75% de la communication. A. Merhabian (UCLA) a affin cette approche (3.1). Bien videmment, le contexte (confrence, discussion de comptoir ) fait varier ce pourcentage (3.2). Cette observation permettant, par exemple, de dcoder les attitudes de ngociation (3.3), voire des brouillages de communication. La premier contact entre deux individus se fait donc avec les yeux, et il prend deux minutes avant quun premier jugement ne stablisse, et le tout dans lordre suivant : - Visages, yeux - Corps (poigne), vtements - Contenu du message
3.1
Impact du non-verbal Jugements Visuel Vocal Verbal Langage Corps Ton de la voix Mots prononcs 7 % Pourcentages 55 % 38 %
10
3.2
Incidence du contexte Exemple : une prsentation importante (argumentaire, confrence) - la rpartition des sources dimpact sinverse : Langage du corps Ton de la voix Mots de 55 % 32 % de 38 % 15 % de 7 % 53 %
3.3
Exemple : dcoder les attitudes de ngociation OUVERTE : - dboutonner la veste, dcroiser les jambes - s'asseoir en avant, se dplacer plus prs de l'autre partie, ouvrir les bras, poser les mains, toucher - utiliser les mots qui font ressortir les besoins communs
DEFENSIVE : - bras et jambes croiss, mains tordues - peu de regard, regards frquents vers la gauche - rire nerveux - s asseoir en arrire chevilles et poings serrs
3.4
Brouillages de communication Position verticale = comptence, confiance Epaules effondres = vulnrabilit, incertitude. Les 12 gestes parasites les plus frquents, exprimant l'anxit : gestes de mains, toucher ses cheveux, mouvements de la bouche, soupirs, gestes des bras, regarder sa montre, manipuler un objet, ajuster ses vtements , mouvement du corps, changer de place, taper du pied.
B ibliographie sommaire
Fabrice dAlmeida, La manipulation, P.U.F., Que sais-je Gerstl, La communication politique, P.U.F., Que Sais-je Machiavel, Le prince, Folio. Neveu, Une socit de communication, Paris, Montchrestien, 1994 Vladimir Volkof, Petite histoire de la dsinformation, Paris, Ed. du Rocher, 1998 Wolton, Les mdias, maillons faibles de la communication politique, Herms, 1991 Paul Watzlawick, la ralit de la ralit. Confusion, dsinformation, communication, Paris, Le Seuil, 1978
Vous aimerez peut-être aussi
- Les Fondements de La Communication PDFDocument22 pagesLes Fondements de La Communication PDFAlanSmithee3175% (4)
- COURS Communication Et DéveloppementDocument19 pagesCOURS Communication Et DéveloppementMangalaPas encore d'évaluation
- Communication PolitiqueDocument39 pagesCommunication PolitiqueThi-son FallPas encore d'évaluation
- Communication Politique Et Sociale PDFDocument2 pagesCommunication Politique Et Sociale PDFTrent100% (1)
- Vocabulaire PublicitéDocument4 pagesVocabulaire Publicitépilar67100% (2)
- A2tests PDFDocument45 pagesA2tests PDFAlianza Francesa Tres ArroyosPas encore d'évaluation
- La Communication Des OrganisationsDocument13 pagesLa Communication Des OrganisationswayPas encore d'évaluation
- CH1 Information Et CommunicationDocument3 pagesCH1 Information Et Communicationworry38100% (1)
- Relations publiques et journalisme à l'ère numérique: Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentementD'EverandRelations publiques et journalisme à l'ère numérique: Dynamiques de collaboration, de conflit et de consentementPas encore d'évaluation
- Marketing PolitiqueDocument32 pagesMarketing Politiquediemperdidi100% (2)
- Communication PolitiqueDocument3 pagesCommunication PolitiqueOlivier IhlPas encore d'évaluation
- Communication PolitiqueDocument9 pagesCommunication Politiques_verdebout100% (2)
- Intro Science Politi QueDocument62 pagesIntro Science Politi QueFranck YvesPas encore d'évaluation
- Anthony Escurat: Le Lobbying: Outil DémocratiqueDocument48 pagesAnthony Escurat: Le Lobbying: Outil DémocratiqueFondapolPas encore d'évaluation
- La Communication Politique Etat Des Savoirs Enjeux Et PerspectivesDocument306 pagesLa Communication Politique Etat Des Savoirs Enjeux Et Perspectivesirina17irina100% (6)
- Les MediasDocument22 pagesLes Mediasabbraxas100% (2)
- Communication PolitiqueDocument3 pagesCommunication PolitiqueHIBA HADDAR100% (1)
- Exercice Individuel de Communication PolitiqueDocument3 pagesExercice Individuel de Communication PolitiqueachiPas encore d'évaluation
- Mémoire Sur La Communication PubliqueDocument70 pagesMémoire Sur La Communication PubliqueAmeth SANKHARE100% (1)
- Domaines de La Communication D'entrepriseDocument6 pagesDomaines de La Communication D'entrepriseOverDoc100% (3)
- Media Et SociétéDocument36 pagesMedia Et SociétéAl AkhPas encore d'évaluation
- Communication Commerciale PDFDocument2 pagesCommunication Commerciale PDFRuthPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Sciences de L Information Et de La CommunicationDocument2 pagesIntroduction Aux Sciences de L Information Et de La CommunicationArysnet Genuine100% (1)
- Introduction Science PolitiqueDocument29 pagesIntroduction Science PolitiqueYazid RouahiPas encore d'évaluation
- La Communication InstitutionnelleDocument26 pagesLa Communication Institutionnellemyelamine67% (6)
- Cours Communication Politique - L1 RIDASP - R1Document44 pagesCours Communication Politique - L1 RIDASP - R1Abdoul-Anziz Fahad Ben0% (1)
- Concepts Généraux de CommunicationDocument17 pagesConcepts Généraux de Communicationemmaziguiz100% (1)
- La Communication de MasseDocument11 pagesLa Communication de MasseYAS SERPas encore d'évaluation
- Histoires de communication politique: Pratiques et état des savoirsD'EverandHistoires de communication politique: Pratiques et état des savoirsPas encore d'évaluation
- Politiques Publiques - Définition Et ObjetDocument6 pagesPolitiques Publiques - Définition Et ObjetHichaam100% (12)
- Communication InternationaleDocument4 pagesCommunication InternationaleKokou Defly100% (2)
- La Liberte D Expression Doit Elle Etre LimiteeDocument12 pagesLa Liberte D Expression Doit Elle Etre LimiteeYoussef SadkPas encore d'évaluation
- Économie Des Médias 1 (Enregistré Automatiquement) - 8Document58 pagesÉconomie Des Médias 1 (Enregistré Automatiquement) - 8OUTHMAN EL QARI100% (1)
- La Communication Territoriale123Document4 pagesLa Communication Territoriale123Abdoul sallPas encore d'évaluation
- Communication CommercialeDocument165 pagesCommunication Commercialemounirkorchi100% (1)
- Communication Institutionnelle PDFDocument38 pagesCommunication Institutionnelle PDFdidier_o80% (5)
- Examen Relations Publiques Presse Par Alioune NDiayeDocument12 pagesExamen Relations Publiques Presse Par Alioune NDiayelittlebouddha100% (2)
- Communication PubliqueDocument14 pagesCommunication PubliqueGABANIGABANIPas encore d'évaluation
- Les Types D'analyse Du Discours PolitiqueDocument16 pagesLes Types D'analyse Du Discours PolitiqueIrinel DomentiPas encore d'évaluation
- Communication Et Discours Politiques (PDFDrive)Document146 pagesCommunication Et Discours Politiques (PDFDrive)جمعية مبادرات تربوية للتجديد والبحث التربويPas encore d'évaluation
- Communication Des Ong PDFDocument2 pagesCommunication Des Ong PDFMike100% (1)
- Le Discours PolitiqueDocument7 pagesLe Discours PolitiqueMatteo LorenzoniPas encore d'évaluation
- Science Politique (2e Année)Document6 pagesScience Politique (2e Année)Olivier Ihl100% (1)
- Culture Médiatique - Typologie Des MédiasDocument3 pagesCulture Médiatique - Typologie Des MédiasAllisPPas encore d'évaluation
- La Communication Politique - Arnaud MercierDocument232 pagesLa Communication Politique - Arnaud Merciercmmartine28avPas encore d'évaluation
- Stratégie Communication COVID-19 HaitiDocument23 pagesStratégie Communication COVID-19 HaitiPrimature Haiti67% (3)
- Theme Iii La Communication Des OrganisationsDocument24 pagesTheme Iii La Communication Des OrganisationsARIF LO100% (1)
- Communiquer, C'est Negocier - Dominique WoltonDocument149 pagesCommuniquer, C'est Negocier - Dominique WoltonSimon Copet100% (1)
- Communication PubliciteDocument29 pagesCommunication PubliciteChaimae Es-salmanyPas encore d'évaluation
- De La Science PolitiqueDocument42 pagesDe La Science PolitiqueHassanElbohaly0% (1)
- Communication PublicitaireDocument51 pagesCommunication PublicitaireIbrahim Moutia100% (1)
- Communication Professionnelle CoursDocument39 pagesCommunication Professionnelle CoursOumaima LahmidiPas encore d'évaluation
- Science PolitiqueDocument50 pagesScience Politiquesunw00100% (1)
- La Presse 4e Pouvoir Démocratique Ou Instrument Politique.Document8 pagesLa Presse 4e Pouvoir Démocratique Ou Instrument Politique.Saĩda KamounaPas encore d'évaluation
- Analyse Des Politiques PubliquesDocument11 pagesAnalyse Des Politiques PubliquesfatiPas encore d'évaluation
- Communication D'influenceDocument88 pagesCommunication D'influencepmdebernyPas encore d'évaluation
- Des Campagnes de communication réussies, Tome 2: 42 études de cas primésD'EverandDes Campagnes de communication réussies, Tome 2: 42 études de cas primésPas encore d'évaluation
- Retour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)D'EverandRetour aux Fondamentaux: Pour une République Civique (Manuel à l’usage du citoyen)Pas encore d'évaluation
- Médias et démocratie en Afrique : l'enjeu de la régulationD'EverandMédias et démocratie en Afrique : l'enjeu de la régulationPas encore d'évaluation
- La recherche en communication: Éléments de méthodologieD'EverandLa recherche en communication: Éléments de méthodologiePas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document11 pagesChapitre 3Yessine BouhamedPas encore d'évaluation
- Le Système ClimatiqueDocument5 pagesLe Système ClimatiqueNatacha DUROSEPas encore d'évaluation
- Types de CommutationDocument6 pagesTypes de CommutationMuhamed Yussuf H'ajji100% (2)
- Cinquante +Document148 pagesCinquante +SPORTIFSMAGAZINEPas encore d'évaluation
- BVH2083FRDocument10 pagesBVH2083FRFranck Aristide DoyaPas encore d'évaluation
- 985 PDFDocument28 pages985 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Classification GenDocument3 pagesClassification GenolfaPas encore d'évaluation
- Geometrie CM1Document39 pagesGeometrie CM1girardPas encore d'évaluation
- BBU Guide-bonnes-pratiques-V7 WEBDocument59 pagesBBU Guide-bonnes-pratiques-V7 WEBHa NanePas encore d'évaluation
- Fiche PDFDocument4 pagesFiche PDFDadati SouPas encore d'évaluation
- Les Sons Complexes Cartes Mentales3Document3 pagesLes Sons Complexes Cartes Mentales3fatimatou2607Pas encore d'évaluation
- 3chap0 Fiche 1 PDFDocument1 page3chap0 Fiche 1 PDFPout InePas encore d'évaluation
- Thèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETDocument135 pagesThèse Tensegrite Vers Une Biomecanique Osteopathique Jean-Francois MEGRETMélanie LE ROYPas encore d'évaluation
- Rapport D'activité 2011 - Fondation Pour La Mémoire de La ShoahDocument54 pagesRapport D'activité 2011 - Fondation Pour La Mémoire de La ShoahFondation pour la Mémoire de la ShoahPas encore d'évaluation
- Marketing Interne Rapport FinalDocument23 pagesMarketing Interne Rapport FinalSalwa MoumènPas encore d'évaluation
- Fiches Sons Période 3Document11 pagesFiches Sons Période 3hichbivk hichbivkPas encore d'évaluation
- MemoireDocument71 pagesMemoireAissa JupiterPas encore d'évaluation
- Didactique Des Langues Approche CulturelleDocument4 pagesDidactique Des Langues Approche CulturelleM'barkiAbdellahElPas encore d'évaluation
- Decembre 07Document10 pagesDecembre 07Best OffensivePas encore d'évaluation
- ARTICLE FINALE PAR DR IKAPIDocument10 pagesARTICLE FINALE PAR DR IKAPIntoutoume.scientoPas encore d'évaluation
- Genette NarratologieDocument3 pagesGenette Narratologieismail yassinePas encore d'évaluation
- Brevet Polynesie Sept 2003Document3 pagesBrevet Polynesie Sept 2003vik 006Pas encore d'évaluation
- Fiches Pedagogiques Asc2 Francais Au College STR IDocument89 pagesFiches Pedagogiques Asc2 Francais Au College STR IFatii MaPas encore d'évaluation
- L3 TheorieGroupes - TD2 CorrigeDocument15 pagesL3 TheorieGroupes - TD2 CorrigeJonah LJDPas encore d'évaluation
- d6.1 Cawtar FinalDocument23 pagesd6.1 Cawtar FinalMahmoud YagoubiPas encore d'évaluation
- Le 11 Octobre 2020Document2 pagesLe 11 Octobre 2020Houcem TrabelsiPas encore d'évaluation
- Cameroun Le Temps de La Diplomatie ScientifiqueDocument142 pagesCameroun Le Temps de La Diplomatie ScientifiqueandelajoelPas encore d'évaluation