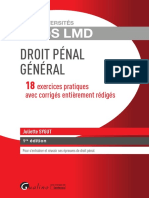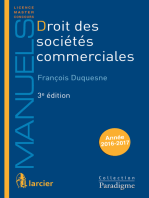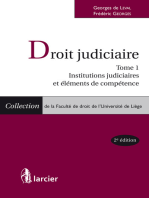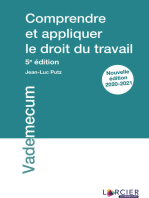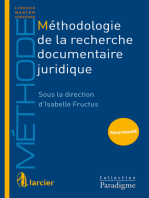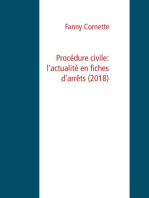Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Intro Droit Le Droit Objectif Et Ses Sources
Intro Droit Le Droit Objectif Et Ses Sources
Transféré par
WafaeFadil0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
23 vues18 pagesCopyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
23 vues18 pagesIntro Droit Le Droit Objectif Et Ses Sources
Intro Droit Le Droit Objectif Et Ses Sources
Transféré par
WafaeFadilDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 18
7
Universit Ibn Zohr
Ecole Nationale de Commerce et de Gestion
d' Agadi r
,rtiJl
{lJg
9
4"ti5'6
IO3
-$J P)rl**ll
E-lni,G, *rts
O1
:$F.+f,g
:
-r;L:r\l
Intfoducti'on' I'Etud de,Droit
llliveau : Premire Anne
(7"t
Semestre)
Document nol
Anne universitaire : 2006 -2007
i:i
''ii'*''r
Professett, iM, M. AI{RI
I
Comme l a
ptn"entent humain
ultime
finalit).
Ll particularit du Droit, en tant que phnomne humain, lui vient
tl"organiser les rnpports des individus ttittctttt en
'socit.
de son objet qui est
Le clroit est apparu quand la conscience
ftr
acquise du pril qti s'attache pt'ivilgier
ln.force con'me principe rgulateur des relations au sein d.1,tne communaut-
Naturellement, )'acces.sion du Droit son njveau actuel de dveloppement fut lente.
Eile s'est dveloppe sur plusieurs millnaires. Mais ce dveloppement reste encore,
pr'sent, limit, ce qui dmontrent d'ailleurs les diffrentes modifrcations qu'il subit par l'effet
dr:s rformes continues en matire de lgislation et de rglementations.
Le droit y trouve des dveloppements, cies appiications, dans tous ies coinporierrrenis
dr: la condition individuelle et tous les secteurs de I'activit humaine.
On note par l l'intrt d'tre avis, inform, voire simplement tre conscient cle la
chose
juridique (le particulier, le pre de la famille, le professionnel. le citoyen, vivent chaque
jour
dans un environnement
juridique,
souvent diffus et complexe, mais auquel, ils ne dewont
pits tre trangers et indiffrents).
Avant
-ProPos
:
religion, la morale, la science ori I'art, te DROIT est un phnomne
(il
fi"out,e sd source dans I'intelligence humaine et I'homme constittre son
$:
7'
Introduction
Pour l'tudiant qui commence des tudes
juridiques,
il est ncessaire de dfinir le sens
du mot
(
DROIT >.
Que
signifie ce mot ?
Diffrentes expressions telles que :
- faire son droit
;
- avoir, ou ne pas avoir le droit de faire telle ou telle chose
;
-
droit civil, commercial, pnal, administratifl ... ont - elles les mmes sens, recouvrent-
elles les mmes notions ?
On distingue, en gnral, deux notions essentielles :
-
le droit objectif;
-
et les drots subjectifs
.
Le droit objectif, ou rgle de droit, est constitu par I'ensemble des rgles
juridiques, qui rgissent la vie des hontmes en socit
;
.
Les droits subjectfs, sont les prrogatives dont peuvent se prvaloir les
personnes prises indivirellement. Ces personnes sont appeles des < sujets de
droit >.
Les diffrents droits subjectifs seront tudis dans /e titre -II- de ce cours. Pour le
moment, nous allons examiner la notion et I'objectif du droit objectif (titre I). Aprs, une
tr,cisinte partie sera consacre une prsentation sommaire de l'organisation
juridictionnelle
du systme
juridique
marocain, et enfin, dans une quatritne parlie, nous prsenterons ses
diffrentes professions juridiques.
s,E.-i-Jl
451J9 g i+is'4
1O3
5J 3)4"'*rll
E-N.G.G *rpJ
01 S[,4q
1
' r1' ; i ' !
\ r
Titre I : Le droit au sens obiectif
Plan du titre nol :
Chapitre
preFier
: Les caractres et Ie contenu du droit objectif.
Deuxime chapitre : Les sources du droit objectif.
,-U...tt
{St-rS
g d#5*
!O3
-J
p)f*dl
H.N.G.G,*ra
61 ,fi#,d$'q ,
-ti-.+-d'l
..8i4-Jl
i5l.,r9
S
a+e
1O3 r5'2
P)rLurJl
o,,91;1''''
Chapitre
premier
: Les caractres et le contenu du droit
obi ecti f.
Dans le prsent chapitre, nous commencerons par une brve dfinition sur la notion de
droit (section no1). Aprs, nous tudierons ses caractristiques (section no2) et enfin, son
contenu (section n'3)
Section nol - Dfinition de la notion de droit :
Le droit est 1'ensemble des rgles qui s'appliquent aux individus depuis le
jour
de leur naissance
jusqu'au jour
de leur dcs. I1 concerne tous les domaines de
I'activit humaine qu'il s'agisse du milieu familial, social ou professiorurel.
Le droit peut
-
tre considr sous derx aspects : le droit obiectif et les droits
subiectifs.
- Le droit au sens objectif est I'ensemble des rgles
juridiques
. caractre gnral et
impersonnel cpi organisent les relations des hommes ente eux et fixent les limites de
ieur activit au sein de la socit et qui sont sanctionne,s par l'autorit publique.
Exemple : le droit interdit et punit le crime, et oblige les citoyens (contibuables)
payer les impts. Ces rgles procdent d'un droit qui se dfinit par son objet, c'est
poulquoi il est appel droit objectif.
- Les 'oits subjectif,s; signifient I'ensemble des prrogatives que possdent /es
indivirs.Il s'agit des droits de chacun, exemple : droit de proprit, droit la pension
alimentaire,. . .
Le dloit objectif et les droits subjectifs enh'etiennent des rapports profondment
n'oits; les droits subjectifs ne peuvent exister et s'exercer que s'ils ne contredisent
pas les lois dictes dans I'intrt social, c'est dire, c'est le droit objectif qui fixe
l'ensemble des dloits de chaque individu et permet ainsi toute personne d'invoquer
ses droits subjectifs.
De mme, l'volution des droits subjectifs est conditionne par celle du droit objectif
lui-mrne.
Section no? Les caractres de la rgle de droit
(ou
droit
Avant de prsenter ses caractristiques, il faudrait d'abord dfinir qu'est ce
qu'entend par rme rgle de droit ?
Une << rgle de droit t est une rgle de conduite sociale dont Ie respeet est
assur par I'autorit publique,
La rgle de droit a, donc, I'aspect d'un certain commandement; c'est pour cefa qu'elle
est obligatoire, gnrale, permanentet coercitive
{{'.
l t
o, !
' '
\-{"
;
a
\
A - Lu rgle de droit u t{n caructre obligatoire :
La rgle de dloit est obligatoire pour toute les personnes qui elle s'applique.
Pour examiner I'action de la rgle de droit, ou rgle
juridique, on dit gnralernent que
la rgle de droit permet, ordonne, dfend, ot.t pttnit.
Dfendre, ordonuer, expriment clailement l'ide d' o b Ii gati on.
Exempl es:
- Le mdecin n'a pas I'obligation de gurir son client (malade) mais seulement de lui
prodiguer des soins de manire affentive et claire, conformment aux demires
connaissances scientifiques dans le domaine.
- Le contribuable a I'obligation de payer leurs impts aux chances prwes.
La rgle de droit du fait qu'elle est
qqntraiglqt,-toute
violation Ia concernant fait
l'objet de sanctions de la part des pottt,oirs publics' (eJle-ae*r.erte,.pta$,-&
conseil ouder4ceux, tout individu doit se conformer 1'galit).
Cependant, il faut noter qu'il existe des degrs (niveaux) dans cette I'obligation des
rgles
juridiques
: Certaines se regroupent dans la catgorie des rgles dites
impratittes ott d'ordre public qui s'irnposent de ntanire absolue: ni les particuliers
ni les tribunaux ne peuvent carter leur application (exemples : rgles de dloit pnal,
rgles de dloit public,. . .). Le caractre impratif de ces rgles se
justifie,
surtout, par le
fait qu'elles s'attachent aux principes fondamentaux de la socit.
Et il existe, aussi, d'autres rgles clites: rjryInj"lWLkalion qui sont plvs souples,
dans la mesrile o les parties concerrres peuvent soit en modifier le contenu soit les
carter (il s'agit des lois dites suppl.tives ou in.terprtatives). On renconte ce type de
lois surtout dans Ie domaine des conats ou les con'actants peuvent choisir ou
arnnager les modalits de leurs conventions selon leru volont. A ce moment, contme
le prvoit, par exemple, I'article 230 du Dahir des Obligations et Contrats marocain
(D.O.C.), l'obligation conh'actuelle tiendra cle loi vis vis des parties et revtila leur
regald un caractre obligatoire, sanctionn pall'autorit publique ( tie d'exemple :
I'article 502 du D.OC.qui prvoit la liwaison de I'objet achet aura lieu au magasin de
vente, moins que les contlactants dcident d'un autre endloit. Si les parties ne
manifestent pas de volont conh'aire cette prescription suppltive, cette clernire
deviendra obligatoire2).
En plus du caractre obligatoile, la rgle de droit est gnrale.
\,l;''Jl
{5l.rg
I
4+15.o
ros r-E-,
rryr .
'
E' N' (}' G *rFc
i
1 5r ?"' l
qn
t
A I'origlne (temps de I'antiquit), la vengeance prive tait admise : chacun se faisait justice
lui-mme:en
exerant des reprsailles. Actuellement, c'est la socit qui inten'ient pour sanctionner le non respect ds lois.
I
Nous pourons donc clire que la loi imprative ordonne ou clfend et que I'inclividu est tenu de s'v soumeltr, il
ne peut y clupper. Par contrg Ia Joi suppltir ou interprtative ae s'impose aur iadivjdus que s'ilsa'en ont pas
cartet' appl i caton.
r.'
[-i..lt {SfJg g 4i5.
1O3
5J
p)l-.sJl
*,,3Hgi'o,,
B
-
Le droit a un cuuctre
gnral :
Cela siguifie qu'elle s'applique d'une mme faon tous les ildividus sans
exception, dans une socit donne. Elle est impersonnelle et ne tient pas compte des
particularisrnes individuels
;
c'est pour cela qu'on peut dire, qu'elle a un caractre
objectiJi
La rgle de droit est rdige en lernxes abslraits; cela veut dire qu'elle ne s'appiique
pas telle, ou telle personne nofilmment dsigne; mais toutes les personnes sans
distinctioru ou bien une catgorie de persomes dtermines.
Ce calactre gnral de la rgle de droit est thoriquement une garantie cotl.e toute
discrintination personnelle, en vertu du principe d'galit que reconnat la constitution
marocaine.
MaiS*Ulit-dest'pa5
ncessairement
/'unifortnit; car il est lgitime de tailer
cliJfremment, en droit ce qui est dffirent en
fait
(exemple : le droit de vote est accord
aux uns et refus aux auhes pour des motifs diffrents (ge, peines privatives,...).
Par ailleurs, il faut signaler l'existence d'un certain droit de classe, qui s'est cre et
dvetopp au fil du temps, dans la mesure o certaines rgles de droit ne seront
applicables qu' telle ou telle classe sociale : les commeratrts, ies locatailes,...
Mais, I'intrieur de chaque classe considre, la rgle de droit s'appliquera de
manire uniforme tout le monde (lments de classe).
Ce calactre gnral est une manifestation de l'application du principe < /'galit de
tous devant la loi >.
Obligatoire, gnrale, la rgle de droit est aussipermanentc-
C
-
La rgle de droit a un caructre permanent :
Comme les individus, les rgles de droit ne sont pas ternelles. Elles ont un
commencement et une fin.
La permanence de la rgle, est son applicabilit constante, durant toute son existence.
Cette rgle s'appliquera chaque fois que les conditions qu'elle prvoit sont remplies
(peu importe, que son application effective soit plus ou moins frquente).
En plus des caractres, obligatoires, gnral, et permanent, la rgle de droit est enfin
coercitve.
D
-
La rgle de droit a un coractre coercitif :
Pour pouvoir remplir son but (assurer la scurit dans la socit), la rgle de
droit doit tr.e obligatoire, et tre assortie de sanctions, excutes par l'autorit
publiEte. On distingue diverses infractions en
fonction
de leur nalure e lettr grmtit
par rapport la rgle de droit.
On distingue, ainsi, des sanctions civiles, des sanctions adntinistralives et des
sanctions pnales.
Sanctions civiles, lorsque celles-ci ne concernent que les rapports des individus
entre eux (condamnation du responsable d'un accident au versement d'une somme
d'argent, pour indemniser la victime qui a subi des prjudices);
San.ctions adntinistratives, lorsque I'in'action met en
jeu
les rapports des individus
avec I'adminisffation
(une plainte porte pal un individu l'gard d'un
fonctionnail' .,...)
;
P Sanctions pnales,lorsque I'infi'action met en
jeu
les rapports des individus avec la
socit
(conamnation d'un dlinquant qui a commis une infraction, telle que le vol,
une peine d' emprisonnement).
Parfois, on se trouve devant des situations o deux ou trois sortes de sanctions
qui
peuvent tre encourues en mme temps.
xemple : le conducteul d'un vhicule automobile
qui blesse un piton, en brflant un
feu rouge, sera pnalis pour avoir viol les dispositions du code de la route, et sera
conditiomr verser des dommages intr'ts la victime, en plus de la sanction pnale.
Ces caractres spcifiques de la rgle de droit permettent de la distinguer d'autres
rgles de conduite, telle que la morale (rgte individuelle fonde sur les principes de la
justice
et de la charit. Elle cherche atteindre le perfectionnement individuel de la
personne), Ia religion, (rgle d'origine divine) et les rgle,s de contenance (ptvtes
pour uniformiser les relations sociales ente les personnes).
Il faut, toutefois signaler qu'une rgle religieuse ou morale poun'ait, dans cefiains cas,
soit inspirer une rgle de droit, soit accder intgralement au rang des rgles
juridiques
(exemple : il est interdit de rompre le
jene
en public, pendant le mois de ramadan).
Nous poouorrr, aussi, citer I'exmple donn par Boris STRAK3
qui crivait que < ...si
panrri deux fi'res, l'un est fortun et I'autre se trouve clans la misre, Ia morale la plus
lmentaire commande au riche de venir au secours du pauu'e. Les tnoralistes par'lent
de ce cas, de justice distribwive. Or, ce devoir moral n'est pas sanctionn en tant que
rgle de droit, il n'existe pas de moyen lgal permettant au fr're dans le besoin de
rclamer quoi que ce soit son frre fortun... >.
Mais cette rgle pourait voluer pour devenir une rgle de droit. Nous savons que le
devoir de porter secours une personne en danger n'tait pas sanctionn dans le pass.
Mais, il en est auflement aujourd'hui puisque la non assistance une personne en
danger est considre comme une infraction. mnte pnale.
Aprs avoir tudi les caractres de la rgle droit (ou droit objectif), nous
dcrivons maintenant son contenu.
Section no? - Le contenu du droit obiectif :
Il existe plusieu's catgories de rgles
juridiques,
selon les domaines viss, qui
ne cesse de se multiplier paralllement l'loltion de la socit.
Traditionnellement, on classe les branches de droit en deux catgories essentielles :
- Le droit public et.le drott priv
;
-
Le droit national et le droit nternational.
A ces disciplines principales, on pet ajouter, aussi, des disciplines n accessoires >,
appeles 7es < sciences atrxiliaires du droit ts.
'
n. STnACK, < Inuoduction l'hrde de droit >, Litec, 3[re dition 1991. p.10.
D - Le droit internstional :
Ce droit est compos de I'ensemble des rgles qui rgissent Jes relailons
internationales entre Etats, Ies Collectittis Locales et les Indit,idus relevant de pays
dffirents. Le droit international se divise galement en droit public international et en
dloit priv international.
D.1 - Le droit internutionul
pr'tblic :
n s'agit de l'ensemble des rgles qui rgissent les rapports entre Etats
souverains diune part, et entre les Etats souverains et les aues sujets de la socit
internationale d'autre part. La plupart des rgles du droit international public reposent
sru'c/es conventions diplomatiqttes, des traits ou de simples usages'
La faiblesse du dloit international public, c'est que les rgles de conduite qu'il dicte
l'ga1d des Etats ne sont pas sanctionnes fficacemen.I,
polrl ne pas dire qu'elles ne
sont pas sanctionnes du tout.
Cela est d I'absence d'une aorit stper-tatique, disposant d'un pouvoir de
conffainte l'gard de I'Etat qui viole les rgles du droit international public.
I1 existe cependant des tribunaux internationaux notamment la Cour International de
Justice (C.I.J.), qui sige LAHAYE; mais les clcisions de cette Cour ne s'appliquent
que si l'Etat auquel elles s'adressent veut bien s'y soumethe (cette infriorit du droit
public international a fait dile certains autetus, qu'il ne s'agit pas waiment de dloit,
mais d'un ensemble d'usages dpossds de caractre obligatoile).
D.2 - Le droit rternational
priv :
Cette branche de droit se proccupe des rapports privs compofiant un lnrent
international, exemple, mariage mixte, problmes de nationalit, conditions des
t' angers,.. .
A ct de ces branches traditionnelles du clroit, il existe d'aul.res scien.ces arniliaires
du droit objectf
E - Les sciences nnxiliaires du droit obiectif :
Plusieurs sciences (et parmi elles, certaines qui n'ont rien voir priori, avec le
droit) permettent soit une meilleure contprhension du. droit existant, et sont mrne
quelqufoi s ncessaires cetle comprhension, soit une meilleule laboration de la
rgle de droit par le lgislateur, ou par les
juges.
8.1 - Les sciences ncessaires l'luborstion dtt droit :
Dans son effort de rflexion, le
juriste
a le plus souvent recour-s deux
disciplines fondamentales, en matire de sciences sociales, pour- laborer une rgle de
dloit :
- L'conomie politique
;
- Et la sociologie
jaridique.
8.2 - L'conomie politique :
Est rure science qui a poul objet la connaissance des phnomnes concernanl Ia
production, Ia distribution et la consontftration des richesses, et des biens nr1ftriels,
dans la soci huntaine.
I U
ncl.usseJ r
f
!a.
wra
cltr<
)
potu.
ce fai1e, elle tudie les besoins, les facteurs de la production (t'avail, capital,
dmographie, richesses naturelles,...), les prix, la monnaie, la rpartition des richesses,
et le rle de I'Etat dans la production, la rpartition et la consommation.
Cette science conomique pour devenil une politique conomique, devfait employer
certains moyen,J qui sont le plus souvent des nroyens
.ittridiques
(il est certain qu'un
juriste qui ignorait de 1'conomie politique, serait un ts mauvais
juriste).
8.3 - La sociologie
iuridique
:
La sociologie est l'tucle des
fails
sociaux humains, considrs cofirme
appartenant un ordre particulier, et tudis dans leur ensemble.
La sociologie tudie les structures, les fonctions des formes sociales et leur volution.
La sociologie.fotm.it donc, le,s donnes ncessaires Ia cr,ation et la modification
cles rgles de droit, elle permel de connatre l'ffit des lois sur les murs'
Le lien qui entre la sociologie et le droit, est une discipline qui s'appelle:. la sociologie
juridicpe.
La sociologie
juridiEte a don pour objet, d'tudier les institutions
juridiques en tant
que faits sociaux. Cette tude se fait, grce aux fonctions d'une part, et aux moyens
d'autre part, de la sociologie
juridique.
.D Les
fonctions
tle la sociologie
iuridique
:
Ces fonctions se distinguent aussi bien sur le plan pratique, que sur le plan
scientiJique.
- Strr le plan scientfiEte,la sociologie, permet de comprendre la spcificit du dloit, et
de mesurer son domaine effectif (c'est dire que les rgles
juridiques
sont dgages
partil de I'observation des faits et des comportements sociaux).
- Le droit est le reflet de I' obsentalion d' uneralit sociale; et c' estla socit qui cre
elle-mme ses propres rgles de droit, grce ses comportements et sa moralit.
Les ntoyens de la sociologie
juridique :
Ce sont les mthodes qui ont poru' objet de h'aduire I'adaptation de moyens
fr'quemment utiliss, en sociologie gnrale (enqute sur' le terrain, sondages,
statistiques,...); ou bien l'laboration de mthodes qui sont lies aux manifestations
particulires des phnomnes
juridiques (recherche dans les recueils cle
jurisprudence,
anaiyse d' an' ts,. . .).
E.4
-
Les sciences ncesssires lu comprhension du droit :
Ce sont les exprience passes et prsentes des socits voisines, qui vont nous
permeth'e d'apporter une rponse cette question, d'o, donc, l'importance des riches
enseignernents tir's dt droit compar et de l'histoire du droit.
8.4.1
-
Le droit compar :
Est la discipline qui a pour but de procder l'tude, et Ia comparaison drt
droit national mtec les autres systntes de droits trangers.
On classe gnralement les diffrents droits en cinq systmes fondamentaux:
franaii;
gernmni que, angl o-s axon, ex-s ovitique e t musulman..
11
I I
Le systnte
juridiqtte
franais:
ce systme comprend les.pays qui ont adopt le
cod civil h.onri, ai tgO+
,
ou ceux qui se sont inspirs de ses principales
dispositions.
Le systnte gerntaniEte : 7l 1egloupe les pays qui ont imit le" code civil
Allemand, .ntt .o vigueur en 1900. Ce code reprsentait une cuvre lourde et
compacte
(il prvoyaii toutes les difficults de dtail, et ne laissant, ainsi, que
peu d'initiatives aux tribunarx).
L, grogpu anglo-saxon : ii comprend
particulirement les systmes
juridiques
ae Ien4e Tene et des U.S.A.
(droit essentiellement coutumier,
qui rsulte des
dcisions
judiciailes).
Le systie sottiriqrrc; Il regroupait les anciennes rpubliques de I'ex-URSS et
les
iays
satellites. 1l conespond un droit de tendance socialiste,
qui sacrifie
I'intrt de I'individu au profit de I'intrt social.
Le droit musriltnan, ce sont cles systmes
juridiques, dans lesquels, certaines
disciplines sont soumises la Charia IslamiEte-
Le drloit compar est utile la formation du droit national, c'est dile inteme,
parce qu'il est de nattu'e permetffe au lgislateu la connaissance des solutions
donnes dans les diffrents pays au problme clont il se proccupe.
8.4.2 -
L'histoire du droit :
Les rgles de droit ne peuvent pas tre pleinement comprises si eiles ne sont pas
situes dans une perspectirre historique-
-
D'abord, parce que les rgles actuelles sont souvent Ie rsultat de la tradi iQA,
parce qu'il y a, dans certains domaines, des nturs e des comportements
qui
n'voluent clue tr's lentement, et ce n'est que par l'histoire qu'on pourrait
comprendre la permanence de certaines legles.
Exemple :
IigEgIgS15g
de la femme marie en droit franais
jusqu'en 1938 et de
la femme marocaine
jusqu'au fin du 20sicle.
-
Ensuite, une mme institution peut tre techniquement consetve, mais elle peut
recouvrir, en droit moderne, une ralit cliffrente.
-
Et enfm, la cration d'institutions nouvelles, d'instruments nouveaux, est mieux
saisie travers l'histoile.
Ce qui est nouveau n'a pas toujours pour objet de combler une lacune, un vide. Ce
peut t'e la ncessit de satisfaction d'ur besoin qui n'existait
pas auparavant. Il est
alors important de cornprendre pourquoi et comment le besoin est appalu, ce qui ne
peut t'e expliqu que par l'fusto'e.
'
Cependant, l'tude. des
''calactres
et du contenu du droit objectif, appellent
ncessair-ement celle cle ses sources.
t z
r
.-a
i^ rf
{sl.ls
9
A,$s.
?O3
6J
p}t*rJl
^,
f;3;1,i_*,
Chapitre -II- Les sources du droit obiectif :
L'expressi on < soLtrce du droit ) peut avoil plusieus significations :
- Dans un sens, on entend par sources de droit un certain nombre de donnes
proforldes telles que les principes de la religion, de morale, d'idologie, de politique e
ffitrre
fondemeni
phitoiophiEte qui inspirent le droit positiJi Tous-ces lments
constituent (Comme&frgcratricei de droit) ses sources sub,stantielles.
Cessu'a^{iclk'''J
-
Dans un aue sens, oi ntend pal soutces du droit, Ies origines lstoriEtes des rgles
.jttridiques
clu droi positif . Dans ce sens, les sources du droit ma:'ocajn sont le droit
musulman, le droit coutumier, le droit issus de la colonisation et le droit moderne aprs
le protectorat (rformes proglessives).
-
Et enfin, dans un hoisime sens, les sources du droit expriment les modes de cration
des normes
juridiques constituant ainsi des sources formelles et techniques du droit.
Les sources du droit peuvent s'apprter plusieurs classifications. On peut distinguer
les sources traditionnelles et les sources modernes
;
les sources crites et les sources
non crites
,
les sources directes et les sources non indirectes
;
les sources officielles et
les soulces non officielles
;
les sources principales et les sources d'interprtation.
Section
=
I- La dtermination des sources de la rgle de droit :
Poru' cornprendre le problme en dloit moderne, ture distinction est ncessaire
entre ies sources internes et les sources interna.tionales.
A - Les
principales
sources internes :
Ces sources sont la Constiltttion, le,c lois, les dcrits-loi,s, les rglements, les
colttwtes et les rgles du droit ntusulntan.
4.1 - La constitutiort :
La Constitution est le texte
juridique le plus irnportant dans le systme
juridique,
le texte
fondamental
qui est au sontmet de la hirarchie des normes.
La Constitution organise essentiellement les institutions politiques et les diffrents
pouvoirs dans l'Etat et'constifue ainsi le cadre de rfrence pour I'ensemble des
pouvoirs.
Avant le 14 dcernbre 1962, date de la premire constiftrtion mzuocaine; le l\{aroc
vivait sous le rgime
de
la confusion des pouvoirs. Cela signifre que les lois et les
rglements taient pris sous formes de dahirs.
Mais partk de dcembrc 1962, la constitutin est vnue fixer la comptence du
pouvoil lgislatif et excutif qui vont intervenil dans la cration du dloit;' les lois
of{rnateg allaient dornavant maner du pouvoil lgislatif et les rglements seront'
sev{tentpdsparl' autoritadministrative,relevantdupouvoirexcutif.
Vue I'importance de la constitution dans la hirarchie des lois et eu' gard
f importance des dispositions qu'elle contient, sa rvision est soumise au rfrendum.
. .
s
C'est la rgle de droit telle qu'elle existe un noment donn dans un pays donn.
tl
I T
I
t
I
73
7
%-
.2
ee'"8gFJ!^
e'w't''v[
L'initiative de cette rvision appartient au Roi ou aux deux tiers des mernbres de la
chambre des reprsentants ou d la chambre des Conseillers
(articles 103 et 104 de la
constitution).
A.2 - Les Lois :
Les lois sont des norntes
jttridiqt.tes qui relvent du pouvoir lgislatif. Elles sont
donc votes par le Parlement (article 5 de la constitution).
Nous .*u*ioonr, dans ce qui suit, successivement la distinction entre /es lois
organiques et les lois orclinaires ;
le domaine de la loi ordinaire et la procdure
I gisl ative ordinai re.
F Lois organiques :
Les lois oi.ganiqttes sont des lois prvues par la Constitution et ont poul objet de
fixer les modaliis d'application de certaines dispositions constitutionnelles
qui
concerlent essentiellement le fonctionnement de quelques institutions conditionnelles'
Il s'agit donc de matires pzuticulirement importantes vises qxpressment titre
limjtatif par la constitution (exemple : loi de finances, conseil conomique et social,
conditions et fotmes d'exercice du droit de grve, 1e tginre lectoral,.
'
.).
F Lois ordinaires :
Ces lois concernent I'ensemble de rgles
julidiques labores par le pouvoir
Igislatif et dans les domaines sont prciss par la constitution (Cf. ar-ticle 46). Parmi
les domaines cits par cet atticle, nous pouvons noter :
- Les dloits individuels et collectifs nurnrs au tih'e premier de la Constitution;
- Le statut gnral de la fonction publique
;
- Le statut des magistrats
;
-Le rgime des obligations civiles et commerciales,. . .
FProcdure d' l aborati on d' une l oi :
La procdure suivie pour laborer une loi consiste, de la part des Reprsentants,
soumeth'e une proposition de loi ou, tle la parl des Ministres, dposer un projet de
loi la chambre des Reprsentants. Aprs examen, la proposition ou le projet de loi
porrrra tre adopt. La mise en vigueur requiert son approb.ation pal le Roi et sa
promulgation par Dahir, avant sa publication dans le Bulletin Officiel clu Royaume. Il
convierit de prciser que la loi peut fe galement laborer par le pouvoir excutif
dans deux cas :
- Le premier est
justifi par l'tat de ncessit qui se ralise entre les sessions
pallementaires et par l'urgence prendre des dispositions lgislatives. Le pouvoir
excutif agit dans ces conditions en prenant des djI$s-&i en collaboration avec les
nrissionsparlementailes. pr".i-tS r ln^*larive-
o(a
-A^1.
+*l
{ie"-lt
-fu-\
c=<>\t
A.3 - Les Rglements ou lois secondaires :
Il s'agit des rgles labores par' le pouvoir excutif. Cela conerne les
dcisions administatives, rglementaires, prises soit dans le but d'excutei les lois,
soit dans le but
d
ilganisg et de grer les services publics ou encore dans le but de
protger I'ordre public, la scurit et l'hygine publique
;
les premiers : 'sont'dits
t 4
rglements excutifs, les seconds : rglements d'organisation et les derniers :
rglemens de police.
Le pouttoir rglementaire appartient au Premier Ministre qui l'exerce notamrnent par
dcret. Les actes rglementailes clu Premier Ministre sont contresigns par les
Ministres chargs de leur excufion, et cloivent tre, au pralable, approuvs en conseil
des Ministres (article 65 de la Constitution).
A.4- Les sources traditionnelles :
Elles comprennent essentiellement Je droil nrusulman eI Je droil. cottltntier.
4.4.1- Le droi t musul man ou Chari :
D'origine religieuse, te droit musulman est compos des rgles qui s'appliquent
oblig4loireqt dans un pays musulman, elles proviennent des versets coraniques, des
hadiths et des explications issues de la doctrine musulmane.
Concernant cette question, il s'agit surtout de s'interroger sur le rle que joue
ie droit
musulman dans le droit positif.
Il convient de dire, cet gard, que le Maroc dispose d'un patrimoine important qui
sert de soru'ces fondamentale la mafire du statut persomel, familial et successoral. Il
convient aussi d'ajouter que le Maroc, tout en s'appuyant sur les gtands principes du
droit musulman classique, a introduit des innovations
justifies pil' 1'volution sociale
comme c'tait le cas de la rvision de la moudawana en 1993.
Les soulces du droit rnusulman sont le Coran, le Sunna, le
Quiyas
l'Ijma.
Le cora4 texte sacr rvl par Dieu au prophte Sidna Mohammed, ne se limite pas
l' aspectreligieux, e@
La Sunna est I'enseble des Hadites ou
[gles
et principes caractre
juridique,
du prophte Sidna Mohammed qui
compltent le Coran.
Le
Quiyas
est /a mthode ddnctive par laquelle on dgage une rgle religieuse ou
juridique
non prvue par le Coran ou le Surura pardr d'une autre rgle pose par
I'une ou l'autre de ces deux premires soruces.
L'Ijma est I'accord de tous les Oulrnas ou docterus cle I'Islam sur une solution
dtemine ou une dmalche partir de l'effet crateur ou Ijtihad.
C'est partir de ces sources que les Oulrnas, les savants ont labors, au couls des
sicles une vaste science
juridique qui constitue le Fiqh, avec ses fondements: ses
branches et ses coles.
4.4.2 - Le droi t coutumi er:
Le droit coutumier est compos de rgles provenant dilectement et
spontanment des pfalfque_g__pgpl3ue5. Ce sont des usages habituellernent et
continuellement suivis par les hommes. De ce fait, ils deviennent obligatoires et
chacun est tenu de s'y conformer.
Les rgles coutimires peuvent s'appliquer tous. Mais peuvent aussi n'e
Hites
un domaine d'activit seulement.
:
:
Le parricularisme des rgles coutumires rside dans le fait qu'elles se tansmttent de
faon orale, il s'agit d'un droit non crit, d'oir la difficult de son application,
l 5
Lrr couturne suppose la runion de deux lments
'.
un lntent ntatriel et un lmenl
psychologique.
- t-,'lment matriel.: Cet lment veut dire qu'une pratique constante, rnrntertompue,
d6it exister. Il faut qu'il y ait uue suite suffisante d'actes, et que ces actes soient
rpts pendant un cefiain temps.
- ,i,'l*rrt psychologiqtte : C'est le sentiment des personnes qui pratiquent cet usage,
cl'agir en confrmit 'irne rgle, qui bien qu'elIe ne soit pas exprime, s'impose ces
pcrsonnes, comme s'il s'agissait d'une rgle de droit objectif'
) Le rgime
juridique de la coutume :
La coutum e est sottple et aclaptable aux circonstances, mais elle reste imprcise
et manque de scurit. D;o le peu d'importance
que lui accorde le lgislateur, et le
juge
en matires civile et pnale (il n'est pas admis d'appliquer le droit coutumier en
.tir. pnale : cela contredit le principe qui dit : gas
d'inJraction ni de peine sans
Iexe >).
Piu'confie, la coutume a une place impofiante dans le droit commercial, dzt droit dtr
tr:wail et cles droits anglo-smons.
E:xempl e:
- en droit bancaire, le rgime
juridique du compte courant, est constitu par les usages
bimcailes
;
- en droit maritime la vente D.U, FOB,...
.
-!a, n/s+
Jeyu^s
-ta.
oLopct*
9in&.
(u"
,l;^t-d
t"L'P",:lfira""srtart
.{"
4.5- Les sources Complmentaires
(ou sources interprtatives):
Les sources complmentaires se rsument essentielle ment dans la
jtnispndence
I
)kb tl
et Ig ip1lUn_e. Elles permettent, surtout, d'expliquer et d'analyser la loi qui, souvent,
labore en termes gnrau-x et absfiaits, a besoin d''e interprte au moment de son
allplication pour son adaptation aux circonstances particulires de chaque litige. La
jr,risprudence
et la doctrine permettent de dgager la vritable signification de la loi et
4.5.1 - La
j uri sprudence :
E[le est constitue essentiellement
par l'ensemble cle dcisions prises par les
ju:ridictions. Il s'agit surlout des dcisions rendues par les Cours d'Appel et la Coru
Suprme et qui contribuent rellement compltet et interprter le droit. La
jrnisprudence joue
un rle apprciable dans la mesure o les textes de loi ne peuvent
envisager et prvoil toutes les situations de fait, qui ne peuvent te apprcies que par
le' s
juges.
Ces diffrentes
juridictions
rendent des dcisions appeles
jugementS
ou artts.
Let usdci si or r s, qui dgagent dessol ut i onsdes- @pour descas
drffrents, finissent pal constituer des
jurisprudences constantes. Celles de la Cour
Suprme bnficient d'uns cefiaine autodt, du fait cle ta position de cette
juridiction
arr sornmet de la hirarchie
judiciaire.
A,.5.2 -La Doctrine :
La Doctrine constitue I'ensemble des travaux
de recherche, de
cr:itiques fait par les
juristes,
les professerus et les praticiens du droit.
iflexions et de,
Les.pinions et
\
l 6
les avis des
juristes contribuent la formation et au dveloppement
du droit' En effet,
les ouvragei et les articles
publis dans les reules ont une valeur scientifique
indniabte et par les dbats ,pr'ilt suscitent
peuvent influencer,
guider ou clairer les
juges
et le igirlut * E; expliquant te aroit venir', Ia docine contibue
indirectement l'volution clu droit.
B- Les sources internationales
:
temes, les sources d'origine
intemationale du cJ:'oit
sont constitues
par les rgles qui sont labores dans un cadre qui dpasse celui de
I'Etat. Elles sont principalem.t t , l.s traits et accords internationaux,
la coutume
intemationale et les principes gnraux du droit'
8.1- Les traits et accords internationaux
:
Les accords conclu entre deux (traits bilatraux)
ou plusieurs (traits
multilatraux) Etats ont poru objet l'laboration d'une rgle du droit international
public, ou du droit international
priv.
^Co*-.
la loi, le Trait est une source crite du droit. Mais une diffrence importante
existe entre la loi et le nait
;
c'est que, conair-ement la loi du di'oit intetne, le t'ait
n'est pas un acte d'autorit du pouvoir politique. Au contraile, il tait i'objet d'une
1gociation enffe Etats, et par consquent il se rapproche davantage des principes d'un
contrat.
La source du droit qui constitue le nait est vritablement d'origine internationale.
8.2 - La coutume internationale :
La coutume consfinre en droit internafional public rme soru'ce cle dloits et
obligations pour les Etats reconnue par les statuts de la Cour internationale de
justice.
La coutume est mme considre comme une
(
source beaucoup
plus vivante et
fconde > en droit international qu'en droit interne.
8.3 - Les principes gnraux de droit :
Ce sont dei rgles exprims ou non dans les textes, mais appliques par' la
jurisprudence.
L'article 38 d1 statut de la Cour intemationale de
justice
renvoie ainsi aux < principes
gnraux de droit reconnus par les nations civilises >.
Parmi ces principes, on fouve, pal exemple, le principe du respect de l'indpendance
et de la souverainet des Etats.
(PIus Annexes)
I 7
A -Le droit Public :
Cette branche de droit est compose de rgles qui ont pour objet I'organisafion et le
fonctionnement des pouvoirs publics. Il rgit galement les rapports des collectivits
pnbliques avec les particuliers. C'est un droit
(
protectellr > de I'intrt gnral, par
exernple :
-
Le droit constitutionnel s'occupe de la rglementation des comptences de
I'Etat et du fonctionnement des institutions politiques
;
-
Le droit administarif s'occupe de la rglementation des socits publiques et
des activits caractre conomique et social prises en charge pal les
collectivits et tablissements
publics
;
-
Le droit
fiscai
s'occupe de la dtermination des impts et taxes dont les
citoyens sont redevables et de l'utilisation des fonds perus
;
- Le droit pnal qui, pour faire rgner l'ordre, prcise les sanctions corporelles et
pcuniailes dont l'Eta peut fi'apper ceux qui n'obissent pas cet ordre.
B - Le droit Priv :
Ce dloit reprsente I'ensemble des rgles qui organisent les rapports des
personnes prittes entre elles, c'est un droit libral qui met en vidence Ia volont des
individus.Il comprend essentiellement le droit civil. Essentiellement, car l droit civil,
contient les rgles de droit commun qui s'appliquent aux rapports des particuliers entre
eux.
Le droit priv compode galement d'auhes matires spcialises, qui se sont
progressivment dtaches du droit civil4 qui reste le tonc conlmun, telles que le droit.'
commercial, le droit adntinistratrt b droit des assurances,...
- l-e droit conunercial est le rglement destin rgir les commerants et les
oprations commerciales (actes de commerce,...);
- Le droit du trattail traite les rapports ente les ernployeurs et les salaris, c'est dire,
il rgle les relations entre ceux qui fournissent leur force de travail et ceux qui
emploient cette force,...
C - Le droit interne :
Le droit national priv et le dloit national public, forment ce que nous appelons
le droit interne.
Le droit national, est celui qui igit, des relations dans lesquelles nlinterviennent pas
d'lments trangers. Exemple : le contrat de vente d'une maison qui se trouve au
Maroc, enEe marocains, et le prix pay au Maroc, en monnaie marocainq.
I1 n'y a aucun lment tranger dans les rapports
jwidiques
que fera natre ce contrat
devente.Cesrapportsre1ventdoncdudroi tnati onal .
'
te droit civil est la branche de droit qui rgit les rapports des particuliers ente eux, sur Ie plan individuel,
familial et pcuniaire. Ce droit s 'applique chaque fois, qu'aucune autre rgle particulire ne rgit la situation,
soit en fonction de la qualit de la persorure, soit enconsidration de la natrue des actes.
Rfrences Bi bl i osraphi ques
(l i ste
non exhausti ve)
Franois de FONTETTE,
((
Grandes dates du droit >, Collection
Que
Sais-Je, Presses
Universitaires de France, l"' Edition, 1994. (Cote :
QC0/5).
Jean IMBERT,
((
Droit antique >, Collection
Que
Sais-Je, Presses Universitaires de
France, 4me Edition, 1994. (Cote:
QC0/6).
F.A. FIAYEK, << droit, lgislatron et libert >>, Presses Universitailes cle France, Vol 3,
1e83. (CO/23).
Franois TERRE, < Introduction gnrale au droit >, Dalloz. 2"'" Edition, 1994.
(cot22).
F. BERHO, M.L. BORDENAVE, < Droit : notions essentielles >, Edition Nathan,
ree0. (cotz).
Mohamed BENI'AHYA,
(
Introduction gnrale au droit >, Editions fuIaghr'bines,
4"" Edition, 2001.
(co/2s).
Boris STARK, < Introduction au droit >, Edition Litec, 3n" Edition, 1991. (C0/20).
J.F.BOCQUILLON, M. MARIAGE,
((
Introduction au dloit de I'ent'eprise >>, Dunod
2' "" Edition, 2000.(C 0127).
H. BATIFFD,
((
La philosophie du clroit >>, Collection
Que
- sais - Je, Presses
Universitailes de France, 9Edition, 1993. (QC0/3).
M. FONTAINE, R. CAVALAIRE, J-A. HASSENFORDER, < Dictionnaile de
droit >>, Foucher; 2n'" Editioq 2000.
[N"
inventaire ENCG : 15113).
18
Vous aimerez peut-être aussi
- Plus Malin Que Le DiableDocument32 pagesPlus Malin Que Le DiableRodrigue Malela94% (17)
- L1 - Corrigé Introduction Au DroitDocument8 pagesL1 - Corrigé Introduction Au Droitstef67% (3)
- Martin Heidegger Batir Habiter PenserDocument12 pagesMartin Heidegger Batir Habiter PenserLou Fio100% (2)
- La Méthodologie Juridique - Cours CompletDocument30 pagesLa Méthodologie Juridique - Cours Completp4 ifmia100% (1)
- Cours de L - Introduction À L - Études Du Droit PDFDocument34 pagesCours de L - Introduction À L - Études Du Droit PDFFsjes Guelmim100% (9)
- Introduction À L'étude de Droit - Contrôle Continu 2006/2007Document1 pageIntroduction À L'étude de Droit - Contrôle Continu 2006/2007OverDoc100% (2)
- Methode Des Science Juridique Et Sociale 1Document9 pagesMethode Des Science Juridique Et Sociale 1nouna1nouna83% (6)
- Droit CommercialDocument24 pagesDroit CommercialIs SamPas encore d'évaluation
- Cours de Droit Administratif-1Document71 pagesCours de Droit Administratif-1MARYAM100% (1)
- I - Principes Généraux Du Système Judiciaire Marocain-1Document50 pagesI - Principes Généraux Du Système Judiciaire Marocain-1Larbi Fsjes Kenitra100% (3)
- Reponse QCM DroitDocument7 pagesReponse QCM Droithajjouji83% (6)
- L2 - Droit Pénal (Corrigé)Document5 pagesL2 - Droit Pénal (Corrigé)stef0% (1)
- Droit des sociétés commerciales et coopératives dans l'espace OHADAD'EverandDroit des sociétés commerciales et coopératives dans l'espace OHADAPas encore d'évaluation
- L'essentiel en AlgorithmeDocument8 pagesL'essentiel en AlgorithmeOverDoc100% (2)
- Exercices Corrigés D'algorithmiqueDocument24 pagesExercices Corrigés D'algorithmiqueOverDoc88% (26)
- Recueil D'exercices Corrigés de MicroéconomieDocument134 pagesRecueil D'exercices Corrigés de MicroéconomieOverDoc100% (15)
- Cours de Microéconomie (Diapo)Document136 pagesCours de Microéconomie (Diapo)OverDoc83% (6)
- Gestion de Production - Recueill Indicatif de Cas Et Exercices en Management IndustrielDocument13 pagesGestion de Production - Recueill Indicatif de Cas Et Exercices en Management IndustrielOverDoc100% (2)
- Dissertation Le Regroupement Familial Et L'ordre PublicDocument2 pagesDissertation Le Regroupement Familial Et L'ordre PublicMickaël MoemersheimPas encore d'évaluation
- Droit S3Document50 pagesDroit S3lami100% (1)
- Droit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétenceD'EverandDroit judiciaire: Tome 1 : Institutions judiciaires et éléments de compétencePas encore d'évaluation
- Comprendre et appliquer le droit du travailD'EverandComprendre et appliquer le droit du travailÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (1)
- Méthodologie de la recherche documentaire juridiqueD'EverandMéthodologie de la recherche documentaire juridiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (2)
- Le contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesD'EverandLe contrat de travail : aspects théoriques et pratiquesPas encore d'évaluation
- Droits S3 PDFDocument34 pagesDroits S3 PDFChaymae ChamittaPas encore d'évaluation
- Cours Introduction A Letude Du Droit Semestre 1Document36 pagesCours Introduction A Letude Du Droit Semestre 1Chaimaa Hamdoune100% (2)
- Introduction Au Droit MarocainDocument2 pagesIntroduction Au Droit MarocainDr_nitr0s86% (7)
- Introduction Au Droit S1Document83 pagesIntroduction Au Droit S1Birgit Vynckier83% (6)
- Résumé Introduction Générale À L27étude de DroitDocument7 pagesRésumé Introduction Générale À L27étude de DroitBentebbaa Amine100% (2)
- Introduction Aux Sciences Juridiques AgadirDocument18 pagesIntroduction Aux Sciences Juridiques AgadirAnass Yio83% (6)
- DROIT SOCIAL - PR - ESSAGHIR Hassan Séance N°1Document53 pagesDROIT SOCIAL - PR - ESSAGHIR Hassan Séance N°1Alexis Sanchez100% (1)
- Droit s3Document6 pagesDroit s3Mestre Abdelhaq100% (2)
- Introduction A L Etude de DroitDocument14 pagesIntroduction A L Etude de DroitHoussam AouraghPas encore d'évaluation
- Introduction À L'Etude de DroitDocument14 pagesIntroduction À L'Etude de DroitSaid BoutallouztPas encore d'évaluation
- Introduction Aux Sciences JuridiquesDocument12 pagesIntroduction Aux Sciences JuridiquesAnass Yio87% (23)
- ENCG Systeme PolitiqueDocument8 pagesENCG Systeme PolitiqueAbdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- Organisation Judiciaire 2020 (S4)Document107 pagesOrganisation Judiciaire 2020 (S4)mohamedmerrouni603100% (1)
- Introduction Au DroitDocument7 pagesIntroduction Au DroitmahrouguiPas encore d'évaluation
- Introduction À L - Étude Du Droit JALAL ASSAIDDocument22 pagesIntroduction À L - Étude Du Droit JALAL ASSAIDBilal BilaloPas encore d'évaluation
- Dissertation de Madame Boukhima La Règle de DroitDocument8 pagesDissertation de Madame Boukhima La Règle de DroitAya BougrinePas encore d'évaluation
- Liste Des Modules Licence Droit FrancaisDocument1 pageListe Des Modules Licence Droit FrancaisReda El Kati50% (2)
- Introduction À L'étude de Droit - Semestre1 - GA - SERGHINI Anas - PDFDocument82 pagesIntroduction À L'étude de Droit - Semestre1 - GA - SERGHINI Anas - PDFsaidPas encore d'évaluation
- QCM DroitDocument8 pagesQCM Droithajjouji100% (2)
- Chapitre 4 Acte Et Faits ProfDocument7 pagesChapitre 4 Acte Et Faits Profouadich hichamPas encore d'évaluation
- Partie 3: Les Moyens de L'action AdministrativeDocument6 pagesPartie 3: Les Moyens de L'action Administrativecocharrinho100% (3)
- Resume de Droit Commercial MarocainDocument16 pagesResume de Droit Commercial MarocainAbdo Slimane50% (2)
- La Règle de DroitDocument7 pagesLa Règle de DroitMohamed Amine Benayad75% (4)
- Organisation Judiciaire.. 1Document47 pagesOrganisation Judiciaire.. 1Sanae Sajid100% (1)
- L'Organisation Judiciaire Du Royaume Du MarocDocument26 pagesL'Organisation Judiciaire Du Royaume Du MarocSara Masmar100% (2)
- SYLLABUS - Cours de Dr. Philippe KETOURE, Introduction À La Science Politique, Année 2019-2020, L1DroitDocument8 pagesSYLLABUS - Cours de Dr. Philippe KETOURE, Introduction À La Science Politique, Année 2019-2020, L1DroitMonsieur Kev100% (3)
- Droit CivilDocument44 pagesDroit Civiltibo74100% (3)
- 1 Droit (Partie.1) - (Chapitre.3) - (L.organisation - Judiciaire)Document7 pages1 Droit (Partie.1) - (Chapitre.3) - (L.organisation - Judiciaire)beebac2009Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Droit Commercial PDFDocument9 pagesChapitre 1 Droit Commercial PDFAymane ZidaniPas encore d'évaluation
- Cours Module Droit Des Societes s4 Fsjes Fes Fassi Fihri PDFDocument316 pagesCours Module Droit Des Societes s4 Fsjes Fes Fassi Fihri PDFSoukaina El Tazy100% (3)
- Introduction Au Droit FSJES SaléDocument100 pagesIntroduction Au Droit FSJES SaléHamza Glili100% (1)
- Langue Et Terminologie Juridique 1Document3 pagesLangue Et Terminologie Juridique 1Ayoub Mhamda71% (7)
- Loi N 42-10 Portant Organisation Des Juridictions de Proximité Et Fixant Leurs Competences.Document9 pagesLoi N 42-10 Portant Organisation Des Juridictions de Proximité Et Fixant Leurs Competences.Mouad Morchid ElouallousPas encore d'évaluation
- Résumé de Droit Commercial MarocainDocument10 pagesRésumé de Droit Commercial MarocainSaloua Ben67% (12)
- Filiere Droit FrancaisDocument2 pagesFiliere Droit FrancaisZakaria Hadraoui100% (1)
- Droit International PrivéDocument46 pagesDroit International Privétibo7488% (8)
- Cours DIP M.mehrez S2Document31 pagesCours DIP M.mehrez S2Hachad Hamza100% (1)
- Cours Théorie Générale Des Obligations - Boutaieb - S2 2010-2011Document13 pagesCours Théorie Générale Des Obligations - Boutaieb - S2 2010-2011bappof90% (42)
- Cours Organisation Administrative S2 Fac SaléDocument53 pagesCours Organisation Administrative S2 Fac Saléwikilik86% (42)
- Droit International PublicDocument86 pagesDroit International Publictibo74100% (2)
- Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)D'EverandProcédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)Pas encore d'évaluation
- Travaux Dirigés en Algorithmique (Exercices Corrigés)Document23 pagesTravaux Dirigés en Algorithmique (Exercices Corrigés)OverDoc76% (33)
- Recueil de Management Général, Cas, Exercices Et Mises en SituationDocument17 pagesRecueil de Management Général, Cas, Exercices Et Mises en SituationOverDoc100% (1)
- Exercices D'application en Comptabilité AnalytiqueDocument8 pagesExercices D'application en Comptabilité AnalytiqueOverDoc70% (10)
- Comment Traiter Un Sujet de DissertationDocument5 pagesComment Traiter Un Sujet de DissertationOverDoc100% (1)
- Em & TB - TD N°2 La Masse Monétaire Et Ses Contreparties - La Création MonétaireDocument1 pageEm & TB - TD N°2 La Masse Monétaire Et Ses Contreparties - La Création MonétaireOverDocPas encore d'évaluation
- Cours D'algorithmiqueDocument108 pagesCours D'algorithmiqueOverDoc100% (2)
- Le Ppbs Et Sa TerminologieDocument4 pagesLe Ppbs Et Sa TerminologieOverDocPas encore d'évaluation
- (s2) Informatiques - Examen 2005 (Session de Rattrapage)Document5 pages(s2) Informatiques - Examen 2005 (Session de Rattrapage)OverDocPas encore d'évaluation
- Mahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonDocument11 pagesMahdi Elmandjra Et Samuel HuntingtonOverDoc100% (1)
- La Planification Au MarocDocument2 pagesLa Planification Au MarocOverDocPas encore d'évaluation
- Analyse Des Données - Travail Dirigé 1Document3 pagesAnalyse Des Données - Travail Dirigé 1OverDocPas encore d'évaluation
- Analyse Des Données - Travail Dirigé 3Document5 pagesAnalyse Des Données - Travail Dirigé 3OverDoc100% (2)
- Statistiques Appliquées - TD 4Document1 pageStatistiques Appliquées - TD 4OverDoc100% (3)
- Moyens D'évaluationDocument7 pagesMoyens D'évaluationOverDocPas encore d'évaluation
- Auguste Comte (Exposé 2008-2009)Document17 pagesAuguste Comte (Exposé 2008-2009)OverDoc100% (4)
- Marketing Opérationnel - Examen 2008-2009Document1 pageMarketing Opérationnel - Examen 2008-2009OverDoc100% (3)
- Gestion de Production - Contrôle Continu 2003-2004Document1 pageGestion de Production - Contrôle Continu 2003-2004OverDoc100% (2)
- Fiscalite Approfondie Controle ContinuDocument1 pageFiscalite Approfondie Controle Continu077725201Pas encore d'évaluation
- Gestion de Production - Examen 2000-2001Document2 pagesGestion de Production - Examen 2000-2001OverDoc100% (2)
- Fiscalité Approfondie - Examen 2006-2007Document1 pageFiscalité Approfondie - Examen 2006-2007OverDoc100% (2)
- Analyse de Données - Contrôle Continu 2008-2009Document1 pageAnalyse de Données - Contrôle Continu 2008-2009OverDocPas encore d'évaluation
- Fiscalité Approfondie - Contrôle Continu 2007-2008Document2 pagesFiscalité Approfondie - Contrôle Continu 2007-2008OverDocPas encore d'évaluation
- Franc-Maçonnerie - Rites Et Cérémonies: Rameau Religion EthnonymesDocument20 pagesFranc-Maçonnerie - Rites Et Cérémonies: Rameau Religion EthnonymesbelmavouanguiPas encore d'évaluation
- Une Lecture de L Être Et Le NéantDocument77 pagesUne Lecture de L Être Et Le Néantdrmartens4822100% (3)
- Details Des Cours Parole Benefique Tawhid - LavoiedroiteDocument2 pagesDetails Des Cours Parole Benefique Tawhid - LavoiedroiteJamel NadaPas encore d'évaluation
- Exposé EthiqueDocument16 pagesExposé EthiqueChanane WalidPas encore d'évaluation
- Les Oromo À La Conquête Du Trône Du Roi Des Rois - (XVIe-XVIIIe Siècle - )Document17 pagesLes Oromo À La Conquête Du Trône Du Roi Des Rois - (XVIe-XVIIIe Siècle - )Bam BAPas encore d'évaluation
- Céline - Mea CulpaDocument9 pagesCéline - Mea CulpacsalmeePas encore d'évaluation
- 1 CaremeDocument2 pages1 CaremearlegilPas encore d'évaluation
- Ronsard Pierre de (1524-1585) - Oeuvres Complètes.T. 2 - Les OdesDocument490 pagesRonsard Pierre de (1524-1585) - Oeuvres Complètes.T. 2 - Les OdesFitniPas encore d'évaluation
- 272 - Krumm Heller Huiracocha Rose Croix PDFDocument256 pages272 - Krumm Heller Huiracocha Rose Croix PDFGnangui LazardPas encore d'évaluation
- Module - Histoire de La Littérature S2 (G1) - Suite Du CoursDocument8 pagesModule - Histoire de La Littérature S2 (G1) - Suite Du CoursJihad El haririPas encore d'évaluation
- Khadime RassoulDocument8 pagesKhadime RassoulSerigne Fallou Diouf100% (1)
- Brehier Arta CrestinaDocument468 pagesBrehier Arta Crestinatrancalina100% (1)
- La Planche À BilletsDocument89 pagesLa Planche À BilletsdavidPas encore d'évaluation
- DM École Des Femmes 2023Document3 pagesDM École Des Femmes 2023wgb9kwzds9Pas encore d'évaluation
- Silvestre de Sacy. Grammaire Arabe de Silvestre de Sacy. 3. Ed., Pub. Par L'institut de Carthage Et Rev. Par L. Machuel. Vol. 2. 1904.Document808 pagesSilvestre de Sacy. Grammaire Arabe de Silvestre de Sacy. 3. Ed., Pub. Par L'institut de Carthage Et Rev. Par L. Machuel. Vol. 2. 1904.Patrologia Latina, Graeca et Orientalis100% (1)
- Les Dessins Et Caricatures Humoristiques Dans La Presse Française Et EspagnoleDocument24 pagesLes Dessins Et Caricatures Humoristiques Dans La Presse Française Et EspagnolePhilippine GangnonPas encore d'évaluation
- 6161 Dernier CroissantDocument82 pages6161 Dernier CroissantNicolas GruelPas encore d'évaluation
- L Attachement A La Terre Chez Tahar Ben JellounDocument18 pagesL Attachement A La Terre Chez Tahar Ben JellounElenushChiriacPas encore d'évaluation
- Lecon N 2 de La Naissance de L Islam A La Prise de BagdadDocument49 pagesLecon N 2 de La Naissance de L Islam A La Prise de Bagdadlilia Bennaceur FarahPas encore d'évaluation
- Introduction Au Droit S1Document83 pagesIntroduction Au Droit S1Birgit Vynckier83% (6)
- CONSTANTINDocument16 pagesCONSTANTINAbraham TeramPas encore d'évaluation
- 0 1LiberteChretienne1 PDFDocument7 pages0 1LiberteChretienne1 PDFJef Angoula100% (1)
- Méditation Sportive Atteignez Vos Objectifs en Pensant AutremenDocument180 pagesMéditation Sportive Atteignez Vos Objectifs en Pensant AutremenEtoilePas encore d'évaluation
- Le Voile Ou Le Gouvernement de DieuDocument15 pagesLe Voile Ou Le Gouvernement de Dieunkapnangluther309950% (2)
- 9782910246495Document12 pages9782910246495Benit MvuezoloPas encore d'évaluation
- Kitab at - Tawhid Le Livre de L'unicite de Mohammad Ibn Abdoul WahabDocument168 pagesKitab at - Tawhid Le Livre de L'unicite de Mohammad Ibn Abdoul WahabBabbaYoussoufaAbdoulayePas encore d'évaluation
- Point D'une PredicationDocument4 pagesPoint D'une Predicationdavid100% (1)