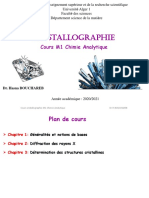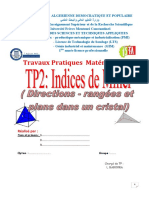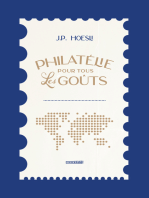Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
1 Cristallographie PDF
1 Cristallographie PDF
Transféré par
droopy007Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
1 Cristallographie PDF
1 Cristallographie PDF
Transféré par
droopy007Droits d'auteur :
Formats disponibles
Un peu de cristallographie
Les minraux sont constitus d'atomes
Si, comme Gulliver, nous pouvions diminuer de taille jusqu'au point de nous
promener l'intrieur d'un minral, nous verrions un empilement de sphres
plus ou moins volumineuses, les plus petites prenant place dans les interstices
laisss libres par les plus grosses. Ce sont des atomes. Ils ont des poids, des
volumes et des proprits chimiques trs diffrents les uns des autres.
Par ailleurs, ces atomes sont trs divers : pour certains minraux ce sont des
atomes de chlore et de sodium, pour d'autres de soufre et de fer ou, pour
d'autres encore, de calcium, de carbone et d'oxygne. Ces combinaisons
d'atomes, caractristiques pour chaque minral, constituent la composition
chimique.
Pour plus de dtails, consultez, du mme auteur,
la ction amusante Le Monde trange des Atomes
Les atomes sont trs divers
On compte environ 90 sortes d'atomes diffrents dans la nature. On les appelle
aussi lments chimiques. Certains sont trs abondants, d'autres trs rares. Dans
la crote terrestre continentale, soit dans les trente kilomtres environ qui se
trouvent sous nos pieds, une dizaine d'lments constituent eux seuls 99.3 % de
cette partie de notre plante (voir tableau page 24). Ce sont eux qui, par leurs
diverses combinaisons, constituent les minraux des roches.
J. Deferne & N. Engel, 8 juin 2010
Les atomes sont trs disciplins
lintrieur de chaque espce minrale, les atomes adoptent un arrangement
gomtrique parfaitement ordonn. Les plus gros sarrangent de manire
remplir lespace le mieux possible, les plus petits occupent les interstices laisss
libres entre les plus gros.
Les minraux sont donc caractriss par la faon dont les atomes sont arrangs
dans leur intimit profonde. Cet arrangement gomtrique parfait qui se
prolonge indfiniment dans toutes les directions de lespace constitue ce que les
minralogistes nomment la structure cristalline.
Pour chaque espce minrale, la faon dont sont disposs les atomes
l'intrieur de la structure a pour effet de dfinir l'orientation et le dveloppement
des faces des cristaux. Grce aux techniques de la diffraction des rayons X, on
peut aujourd'hui dterminer la structure atomique de chaque espce minrale.
Par exemple, la structure de la prowskite (CaTiO
3
) peut tre dcrite de la
manire suivante :
- Les atomes de titane (Ti) sont situs aux sommets d'un cube imaginaire de 3.8
1
d'arte.
- L'atome de calcium (Ca) est situ au centre du cube.
- Les atomes d'oxygne (O) occupent le milieu des artes.
Calcium
Titane
Oxygne
Comment dcrire la structure d'un minral ?
La structure de la prowskite s'tend indfiniment dans les trois directions de
l'espace par juxtaposition successive de cubes lmentaires. La structure est alors
compltement dcrite lorsqu'on a dfini :
- le motif, c'est--dire le plus petit groupement d'atomes qui, indfiniment
rpt dans les trois directions de l'espace, constitue le minral,
Perowskite, Val Malenco, Italie,
(photo Fernando Metelli)
2
Extrait de Au Coeur des minraux
1[] est le symbole de l'ngstrm qui vaut un dix millionime de mm.
- la maille lmentaire, le paralllpipde qui, par juxtaposition successive
dans les trois directions de l'espace, construit le minral dans son entier. La
maille lmentaire dfinit en fait le schma de rptition du motif.
Dans le cas de la prowskite, la maille lmentaire est un cube de 3.8 d'arte.
Cest donc un paralllpipde dont il faut, pour chaque espce minrale,
dterminer la longueur des artes ainsi que les angles que celles-ci forment entre
elles. Dfinir le motif revient alors dcrire les positions des atomes l'intrieur
de la maille lmentaire.
Comme sur un papier peint
On peut comparer une structure cristalline un papier peint. On observe un
motif dcoratif indfiniment rpt par translation d'une maille lmentaire qui
se rsume, dans le plan, un paralllogramme, un losange, un carr ou un
rectangle, sur toute l'tendue de la paroi.
Description d!un papier peint :
par analogie, on a un motif, ici une eur, rpt sur toute la paroi par juxtaposition
d!une maille lmentaire, soit un rectangle, un losange ou un paralllogramme.
3
Extrait de Au Coeur des minraux
La notion d'espce minrale
La notion d'espce minrale n'est pas du tout
comparable celle d'espce animale ou
vgtale. Elle repose uniquement sur deux
entits qui sont :
- la composition chimique d'une part,
- la structure cristalline d'autre part.
Halite, NaCl
le minral est parfaitement dcrit lorsqu!on connat
sa composition chimique et sa structure cristalline
L'tude de la minralogie fait donc appel la chimie qui permet dtablir la
composition chimique du minral et la cristallographie qui permet den
dterminer la structure intime.
L'tat cristallin
L'tat cristallin n'est pas uniquement restreint aux beaux cristaux des
collectionneurs, mais il s'tend aussi la presque totalit des substances solides
du rgne minral, en particulier aux minraux constitutifs des roches et aux
mtaux. Les cristaux parfaitement bien dvelopps sont rares. Pour les obtenir, il
faut que leur croissance ait lieu dans un milieu libre de toutes contraintes, dans
un liquide par exemple, sans que leur dveloppement soit limit par l'obstacle
d'autres minraux en voie de formation.
Par opposition l'tat cristallin, on distingue l'tat amorphe dans lequel les
atomes ne sont pas ordonns. L'tat amorphe ne concerne gure que les verres et
certaines matires plastiques. Il est d une consolidation htive qui n'a pas
laiss aux atomes le temps de s'arranger de manire ordonne.
4
Extrait de Au Coeur des minraux
Les cristaux prsentent une "certaine symtrie"
Les cristaux bien dvelopps montrent des faces planes limites par des artes
qui, elles-mmes, convergent vers des sommets.
En observant attentivement les cristaux, on
constate qu'ils prsentent une certaine
symtrie.
Ce terme de symtrie recouvre en fait une
discipline abstraite qui relve des lois de la
gomtrie.
Comme toute gomtrie, il y a des thormes et
des dmonstrations. Il s'agit de lois de rptitions
des lments d'un objet qui restituent cet objet
dans son intgralit. Ici lobjet est le cristal et les
lments sont une face, une arte ou un sommet.
Ces rptitions sont effectues par des oprateurs
de symtrie dont les principaux sont :
- plan de symtrie,
- l'axe de symtrie
- le centre d'inversion (ou centre de symtrie)
Le plan de symtrie est un miroir
C'est un plan qui caractrise les symtries bilatrales. Il ddouble les lments
d'un objet, agissant comme un miroir. Toutes les faces, artes et sommets d'un
cristal retrouvent une image identique, mais non superposable, de lautre ct du
plan. Ainsi la main droite aura lair dune main gauche vue dans le miroir.
P
sommet
arte
face
5
Extrait de Au Coeur des minraux
Les axes de symtrie : comme un carrousel
Ici, toutes les faces, artes et sommets sont comme "rpts" par rotation
autour d'un axe.
Au cours d'une rotation complte (360), chaque lment est rpt 2, 3, 4 ou 6
fois, suivant l'ordre de l'axe. On appelle donc lordre de laxe le nombre de fois
que cet axe rpte lobjet au cours dune rotation complte. Dans les cristaux, il
n'existe que des axes d'ordre 2, 3, 4 et 6.
Axes de rotation d!ordre 2, 3, 4 et 6
Le centre d'inversion est l'ami des paralllpipdes
1
Toutes les faces dune forme cristalline sont reproductibles deux deux par
inversion de leurs faces, de leurs sommets et de leurs artes par rapport un
centre d'inversion appel parfois centre de symtrie.
Toutes les faces d'un solide qui possde un centre d'inversion sont parallles
deux deux. Les paralllpipdes ont donc tous un centre d'inversion.
centre d'inversion
A
B
C
C'
A'
B'
Rptition d!une face par le centre d!inversion
A6 A4 A3 A2
6
Extrait de Au Coeur des minraux
1 Mot horrible qui dnit des solides dont toutes les faces sont parallles deux deux.
Les oprateurs de symtrie aiment jouer ensemble
Sur un cristal, on n'observe que rarement un seul oprateur
de symtrie. Ils s'associent presque toujours plusieurs
pour dfinir la symtrie du cristal. Ainsi l'hmimorphite
(un silicate de zinc) possde deux plans de symtrie et un
axe d'ordre 2 passant par l'intersection des plans.
Quelques rares cristaux n'ont qu'une faible symtrie : un
seul axe, un plan, alors que d'autres prsentent une
symtrie leve caractrise par la prsence de nombreux
oprateurs. Le cube, par exemple, comporte trois axes
dordre 4, quatre axes dordre 3, six axes dordre 2, un
centre d'inversion et neuf plans de symtrie !
La symtrie est dite ponctuelle
L'ensemble des oprateurs de symtrie d'un cristal constitue sa formule de
symtrie. Notons encore que tous les oprateurs de symtrie caractrisant la
symtrie d'un objet ont un point commun au centre de cet objet. Pour cette
raison, on parle de symtrie ponctuelle.
La rigueur rgne parmi les oprateurs de symtrie
Les combinaisons d'oprateurs de symtrie obissent des lois trs strictes qui
en limitent le nombre. Ce sont les thormes de symtrie.
Dans le monde minral, on ne trouve que 32 combinaisons possibles qui
dfinissent ce qu'on appelle les 32 classes de symtrie. Chaque espce minrale
appartient ncessairement l'une de ces 32 classes.
Les sept systmes cristallins
Les 32 classes de symtrie se rpartissent leur tour en 7 systmes cristallins,
dfinis chacun par un polydre gomtrique simple. Toutes les formes des
cristaux drivent de l'un ou l'autre de ces polydres par troncatures symtriques
de leurs artes ou de leurs sommets. Cela signifie que si on opre une troncature
sur le sommet d'un cube, celle-ci sera automatiquement rpte sur les autres
sommets par les oprateurs de symtrie prsents.
Hmimorphite
A2
P
p
p'
7
Extrait de Au Coeur des minraux
Les sept polydres qui dfinissent les sept systmes cristallins
Cubique
Cube
Quadratique
Prisme droit
base carre
Orthorhombique
Prisme droit
base rectangle
Hexagonal
Prisme droit
base hexagonale
Rhombodrique
rhombodre
Monoclinique
prisme oblique
base rectangle
Triclinique
prisme oblique sur
toutes les artes
Formes simples et formes composes
Le cube, l'octadre, le ttradre ou le dodcadre sont des formes simples. Mais
le plus souvent, les cristaux sont forms de plusieurs formes simples associes : ce
sont alors des formes composes. Dans les systmes basse symtrie, certaines
formes simples ne peuvent exister seules. Ainsi une pyramide base carre (une
des formes simples du systme quadratique) ne peut exister seule. Il faut
imprativement lui associer une base pour que la forme soit "ferme". Les
minralogistes appellent pdion cette base qui est une face unique dans une
position telle qu'elle n'est rpte par aucun oprateur de symtrie.
dodcadre octadre dodcadre + octadre
f or mes si mpl es f or me compose
8
Extrait de Au Coeur des minraux
Les formes cristallines du systme cubique
Les formes cristallines portent des noms qui drivent gnralement du grec. Les
formes appartenant au systme cubique ont une nomenclature particulire. Elle
est assez simple et se base sur le nombre de faces : ttradre, hexadre, octadre,
dodcadre etc... On ajoute parfois un qualificatif qui dcrit le contour d'une
face. Ainsi on distingue le dodcadre rhombodal du dodcadre pentagonal,
ces qualificatifs dsignant alors le contour de la face
2
. Le tableau suivant rsume
cette nomenclature. Il indique aussi l'orientation de chaque face vis--vis des
lments de symtrie propres au cube.
Nomenclature des formes cristallines du systme cubique
nb. faces nb. faces nom de la forme ori entati on des faces
6 faces: cube (ou hexadre) ! aux axes A
4
8 faces: octadre
! aux axes A
3
12 faces: dodcadre rhombodal
! aux axes A
2
24 faces: cube pyramid
parallle aux axes A
4
24 faces: octadre pyramid
parallle aux axes A
3 (1re orientation)
24 faces: trapzodre
parallle aux axes A
3 (2me orientation)
48 faces hexakisoctadre orientation quelconque
Cube Octadre Dodcadre rhombodal Cube pyramid
Octadre pyramid Trapzodre Hexakisoctadre
On peut obtenir les formes cristallines du systme cubique par troncatures
symtriques sur les sommets ou les artes dun cube :
9
Extrait de Au Coeur des minraux
2 Ces qualicatifs prcisent le contour de la forme simple. Toutefois, ds qu'on a affaire des
formes composes, le contour de chaque face n'a plus de signication.
gauche : octadre obtenu par
troncature symtrique sur les
sommets
droite : dodcadre rhombodal
obtenu par troncature symtrique
des douze artes.
gauche : triakisoctadre , ou
octadre pyramid, est obtenu par
troncature oblique des sommets.
droite : cube pyramid obtenu
par troncature oblique des artes.
gauche : hexakisoctadre obtenu
par troncature asymtrique des
sommets.
droite : trapzodre obtenu par
troncature oblique des sommets.
Les formes cristallines dcrites ci-dessus obissent toutes la totalit des
oprateurs de symtrie du systme cubique. Les minralogistes les nomment
holodries (qui ont toutes les faces).
On trouve cependant des formes drives des prcdentes, qui, par diminution
du nombre des oprateurs de symtrie, ont perdu une moiti, voire les trois-
quarts de leurs faces. Par opposition aux prcdentes, on les appelles mridries.
Parmi celles-ci citons :
Principales formes cristallines symtrie cubique incomplte
nb. faces nb. faces nom de la forme ancienne forme originelle
10
Extrait de Au Coeur des minraux
4 faces : ttradre moiti des faces de l'octadre
12 faces : dodcadre pentagonal moiti des faces du cube pyramid
12 faces : dodcadre deltode moiti des faces de l'octadre pyramid
12 faces : triakisttradre moiti des faces du trapzodre
12 faces : dodc. pentag. ttradrique quart des faces de l'hexakisoctadre
24 faces : gyrodre moiti des faces de l'hexakisoctadre
24 faces : diplodre autre moiti de l'hexakisoctadre
Ttradre Dodcadre pentagonal Dodcadre deltode Triakisoctadre
Dodcadre pentagonal Gyrodre Diplodre ttradrique
Dans les autres systmes cristallins
Alors que toutes les formes du systme cubique sont "fermes" sur elles-mmes,
certaines formes simples des autres systmes sont "ouvertes" et ne peuvent
exister qu'en combinaison avec une autre forme. Par exemple une pyramide ne
peut exister sans sa base.
D'une manire gnrale, un des axes de symtrie joue le rle d'axe principal et
sert de rfrence pour l'orientation des faces.
11
Extrait de Au Coeur des minraux
Les pinacodes sont
constitus de deux faces
parallles.
Les prismes sont un ensemble de faces
quivalentes parallles un axe principal
Pyramide Bipyramide Sphnodre Disphnodre Trapzodre
12
Extrait de Au Coeur des minraux
Nomenclature des formes cristallines autres que celles du systme cubique : Nomenclature des formes cristallines autres que celles du systme cubique :
Nom Description de la forme
Pinacode deux faces parallles (les bases d'un prisme, par exemple).
Prisme ensemble de faces quivalentes parallles un axe principal.
Pyramide
ensemble de faces quivalentes dont les artes convergent vers
un sommet situ sur l'axe principal.
Bipyramide deux pyramides accoles par leur base.
Trapzodre
bipyramide dont une a tourn d'un angle quelconque autour
de l'axe commun.
Scalnodre ditrigonal
bipyramide ditrigonale dont une a tourn de 60 par rapport
l'autre.
Rhombodre
trapzodre trigonal (ou bipyramide trigonale dont une des
pyramide a tourn de 60 par rapport l'autre). On peut le
dfinir aussi comme un paralllpipde dont les faces ont des
formes de rhombe (qui si signifie losange).
Sphnodre dformation ttragonale ou orthorhombique du ttradre.
Pdion face unique non rpte par les lments de symtrie.
Les prismes, pyramides et bipyramides sont qualifis de trigonaux,
quadratiques, rhombiques, hexagonaux, ditrigonaux, dittragonaux ou
dihexagonaux suivant le contour de leur section.
trigonal quadratique hexagonal rhombique
ditrigonal dittragonal dihexagonal
13
Extrait de Au Coeur des minraux
On peut aller plus loin dans la symtrie
Nous n'avons examin que les problmes de symtrie ponctuelle, celle o tous
les oprateurs de symtrie, plans, axes et centre passent par un point commun.
Cette symtrie ponctuelle ne s'applique donc qu un objet unique, un cristal par
exemple. Elle correspond aux classes de symtrie.
Si nous reprenons l'exemple du papier peint, les rgles de la symtrie ponctuelle
ne s'appliquent qu' chaque motif.
Mais si nous voulons dcrire l'ensemble de tous les motifs, nous devons ajouter
un oprateur de symtrie supplmentaire dcrivant la translation, opration qui
permet de passer d'un motif l'autre. L'interaction de ce nouvel oprateur sur
ceux que nous connaissons dj entrane l'apparition de deux nouveaux
oprateurs de symtrie : l'axe hlicodal et le plan avec glissement. Les thormes
de symtrie qui s'appliquent cet ensemble largi d'oprateurs ont comme
consquence que la symtrie n'est plus ponctuelle mais spatiale.
Les combinaisons d'oprateurs ne sont alors plus limites aux 32 classes dcrites
prcdemment, mais elles atteignent le nombre lev de 230 possibilits. Ce sont
les 230 groupes despace qui dcrivent les rapports gomtriques entre tous les
atomes d'une structure minrale, c'est--dire de sa maille lmentaire et de la
manire dont les atomes occupent l'espace l'intrieur de celle-ci.
Chaque espce minrale appartient donc non seulement l'une des 32 classes
de symtrie ponctuelle, mais encore l'un des 230 groupes despace qui
dcrivent les lois de rptition des atomes l'intrieur de sa structure.
Lidentification du groupe despace auquel appartient un minral est une
opration difficile qui ncessite lemploi dun appareillage complexe.
Espce minrale et varit
Nous avons vu que la notion d'espce minrale reposait sur la composition
chimique d'une part, la structure cristalline d'autre part.
Cette dfinition n'est pas rigide et, d'un gisement l'autre, les individus d'une
mme espce minrale peuvent montrer une variabilit qui se marque soit par une
diffrence de morphologie ou de couleur, soit encore par une composition
chimique lgrement diffrente. Il s'agit alors d'une varit. Ainsi l'amthyste est
une varit violette de quartz, l'meraude une varit transparente verte de bryl,
le rubis et le saphir des varits colores de corindon, l'adulaire une varit
d'orthose caractrise par une forme particulire.
14
Extrait de Au Coeur des minraux
Orthose, USA Adulaire, Grisons
Les atomes ont parfois le choix
Pour une mme composition chimique, on peut observer parfois des structures
cristallines diffrentes : c'est le polymorphisme. L'exemple le plus frappant est
celui du carbone qui, suivant la faon dont les atomes sont arrangs, peut
donner des minraux aussi diffrents que le diamant et le graphite. Pour un
mme compos chimique ce sont les conditions de cristallisation qui dterminent
l'apparition d'une structure plutt qu'une autre. Pour cristalliser dans sa forme
cubique, le diamant a besoin d'une pression norme alors qu' faible pression le
carbone cristallise en graphite.
structure du diamant
structure du graphite
L'isomorphisme est le phnomne inverse : dans une mme structure certains
atomes peuvent en remplacer d'autres. Dans le cas de la calcite (CaCO
3
), l'atome
de calcium peut tre remplac par du magnsium, du fer, du manganse ou du
zinc, donnant respectivement la magnsite (MgCO
3
), la sidrite (FeCO
3
), la
rhodochrosite (MnCO
3
), ou la smithsonite (ZnCO
3
). Pour que ces remplacements
soient possibles, les atomes interchangeables doivent avoir des tailles
comparables et des caractristiques lectroniques semblables.
15
Extrait de Au Coeur des minraux
Structure des carbonates rhombodriques :
on distingue les groupes CO
3
(sphres blanches). Les sites en
noir sur le dessin peuvent tre
occups par le calcium, le
magnsium, le fer, le
manganse ou le zinc.
Calcite, Cumberland
16
Extrait de Au Coeur des minraux
La calcite et lorigine de la cristallographie
La calcite est un minral fascinant qui prsente une trs grande diversit de
formes. Le point commun de toutes ces formes est leur mode de fragmentation
sous un choc. Lorsquon casse un cristal de calcite, on obtient, non pas des
fragments informes qui rappelleraient le verre bris, mais des paralllpipdes
qui font penser des cubes dforms que les cristallographes nomment
rhombodres. Ceux-ci se fragmentent eux-mmes en d'autres rhombodres plus
petits, aussi loin que le pouvoir sparateur du microscope permet de les observer.
A partir de cette observation, l'abb Ren-Just Hay a imagin qu'il devait
exister une "brique lmentaire" - le rhombodre, dans le cas de la calcite - qu'il
appela molcule constituante. Par empilement de rhombodres, selon diverses
rgles gomtriques, il tait parvenu expliquer toutes les formes observes de
calcite. Dans son Essai d'une thorie de la structure des cristaux, paru en 1784, il
dfinit le terme de structure comme le mode d'arrangement des molcules
constituantes.
Modle d!Hay pour expliquer la forme du scalnodre
partie d!empilement de rhombodres lmentaires.
17
Extrait de Au Coeur des minraux
En ralit, les minraux ne sont pas constitus d'un empilement de briques
lmentaires au sens o Hay l'entendait, mais il avait pressenti, sans la
dcouvrir vraiment, l'existence de la maille lmentaire. Cette dcouverte a t le
point de dpart de la cristallographie moderne.
L!Abb Ren-Just Hay (1743-1822), professeur de minralogie
au Jardin des Plantes Paris, pre de la cristallographie moderne
18
Extrait de Au Coeur des minraux
Les minraux ne sont pas toujours bien dans leur peau
Certains minraux prsentent parfois des formes trangres leur propre
symtrie. Ce sont des pseudomorphoses. Elles sont dues la transformation
chimique d'une espce minrale en une autre, sans modification de sa forme
extrieure. L'ancienne forme joue en quelque sorte le rle d'un moule
l'intrieur duquel la transformation s'est effectue. Des cubes de pyrite, FeS
2
peuvent, par exemple, s'oxyder en goethite, FeO(OH) tout en conservant la forme
originelle du cube.
Pseudomorphoses classiques
minral nouveau minral remplac
quartz
goethite
malachite
pyromorphite
talc
calcite, fluorine, asbeste, talc
pyrite, sidrite, magntite
cuprite, azurite
galne
quartz
On peut rapprocher ce phnomne de celui de la fossilisation : une ammonite
pyritise peut tre considre comme de la pyrite qui a "emprunt" la forme
d'une ammonite. Un cas intressant est celui de la varit de silice connue sous le
nom d'il-de-tigre qui est le rsultat de la silicification plus ou moins complte
de la crocidolite, une amiante bleue. C'est du quartz qui a conserv la structure
fibreuse de l'amiante. Suivant le degr d'oxydation, les rsidus ferreux qui
subsistent encore, confrent l'il-de-tigre des teintes brun jaune dor avec
des zones bleutres pour les parties les moins oxydes.
Ammonite pyritise Talc, pseudomorphose de quartz
19
Extrait de Au Coeur des minraux
Au cur de la matire par la diffraction des rayons X
Dcouverts en 1885 par W. Rntgen, les
rayons X ont permis d'explorer le monde
intime des minraux. Grce eux, on a pu
dterminer les structures des minraux,
mesurer avec prcision les dimensions des
mailles lmentaires, dterminer le groupe
despace auquel ils appartiennent et tablir
une mthode didentification des espces
minrales.
Tout comme la lumire, le rayonnement X est
de nature lectromagntique. Sa longueur
donde, beaucoup plus courte que celle du spectre visible, est de lordre de
grandeur des distances qui sparent les atomes dans les cristaux. Lorsquon
irradie un cristal avec un rayonnement X, les lectrons de tous les atomes du
cristal entrent en vibration et chaque atome devient son tour une source de
rayonnement X, de mme longueur donde que le rayon incident.
Ces innombrables metteurs vont interfrer entre eux, renforant le
rayonnement dans certaines directions privilgies, lannulant totalement dans
les autres directions.
Lorsquon envoie un rayon X sur un petit agglomrat de poudre trs fine dun
minral, le rayonnement diffract prend laspect dune srie de cnes embots.
Le phnomne est tout fait analogue aux cercles concentriques lumineux que
provoquent les bougies de larbre de Nol vues travers la trame trs fine des
cheveux dange.
Diffrents modles de camra ont t construits pour "photographier" le
rayonnement diffract. Toutes sont conues selon le mme principe.
Camra de diffraction
En 1895, lAllemand W. Rntgen dcouvre un rayonnement invisible qui
rend fluorescentes certaines substances et impressionne les plaques
photographiques. Il le baptise rayonnement X. En 1912, un autre savant
allemand, M. von Laue tablit la nature lectromagntique des rayons X et
parvient en dterminer la longueur donde grce aux interfrences
obtenues par diffraction travers un cristal de blende (ZnS). Cette
exprience marque une date importante dans lhistoire de la cristallographie
et permet le dveloppement rapide dune nouvelle technique, la
20
Extrait de Au Coeur des minraux
Un film, plaqu contre les parois dun cylindre plat, enregistre les segments de
cnes de diffraction produits par lchantillon plac au centre de la camra.
Aprs dveloppement, les segments de cnes apparaissent sur le film sous forme
d'une suite de raies dintensit variable. Cet enregistrement photographique
porte le nom de diagramme de diffraction.
Comme une empreinte digitale
Un diagramme de diffraction constitue, en quelque sorte, lempreinte digitale
dun minral. En effet, aucun diagramme de diffraction nest semblable un
autre. Et, de mme que la police possde des fichiers dempreintes digitales des
malfaiteurs, de mme les minralogistes utilisent des fichiers de diagrammes de
diffraction pour identifier srement les minraux. Cette mthode est intressante
car un seul grain d'un quart de millimtre de diamtre est suffisant pour tablir
un diagramme de diffraction.
Diagramme de diffraction
On peut aller encore plus loin
Au-del de l'identification des minraux, les rayons X permettent aussi de
dterminer les structures atomiques des minraux. En effet, la position des raies
sur un diagramme ne dpend que de la gomtrie de la maille lmentaire alors
que leur intensit dpend de la nature et de la position des atomes l'intrieur la
maille.
Les rayons X au service de la minralogie
lment du diagramme Renseignements obtenus
position des raies gomtrie de la maille lmentaire
intensit des raies nature et position des atomes l'intrieur de la maille.
21
Extrait de Au Coeur des minraux
La dtermination de la gomtrie de la maille lmentaire ainsi que
l'identification du groupe spatial auquel appartient le minral ncessite des
camras plus sophistiques que celles ncessaires la simple dtermination
d'une espce minrale. On peut alors dterminer le groupe despace du minral
parmi les 230 groupes possibles.
Quant la dtermination complte d'une structure cristalline, seuls des
laboratoires de radiocristallographie quips de diffractomtres trs
perfectionns peuvent les mener bien.
Diffractomtre 4 cercles ENRAF-NONIUS CAD4
22
Extrait de Au Coeur des minraux
Vous aimerez peut-être aussi
- Exercices d'intégrales et d'équations intégro-différentiellesD'EverandExercices d'intégrales et d'équations intégro-différentiellesPas encore d'évaluation
- Coursmtallurgie 111011084551 Phpapp02Document167 pagesCoursmtallurgie 111011084551 Phpapp02Goud VraiPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Et 2 CristallographieDocument107 pagesChapitre 1 Et 2 Cristallographienour benPas encore d'évaluation
- CristallographieDocument131 pagesCristallographieKurosaki BilyPas encore d'évaluation
- L'édifice CristallinDocument49 pagesL'édifice CristallinMabrouk BouabdallahPas encore d'évaluation
- Calculs Dans Les Reseaux Et Groupes PonctuelsDocument142 pagesCalculs Dans Les Reseaux Et Groupes PonctuelsNeatStick100% (1)
- TP MineralogieDocument40 pagesTP MineralogieSamir MoussPas encore d'évaluation
- Métal Amorphe: Le verre métallique mince du futur ressemble à du papier d'aluminium, mais essayez de le déchirer, ou voyez si vous pouvez le couper, de toute votre puissance, pas de chanceD'EverandMétal Amorphe: Le verre métallique mince du futur ressemble à du papier d'aluminium, mais essayez de le déchirer, ou voyez si vous pouvez le couper, de toute votre puissance, pas de chancePas encore d'évaluation
- Flint - Principes de Cristallographie - Mir - 1981Document233 pagesFlint - Principes de Cristallographie - Mir - 1981Hicham YangPas encore d'évaluation
- F 452 FCDocument25 pagesF 452 FCBRONDON NDJANKOUMPas encore d'évaluation
- Jean Dubuis 1 Fond A MentalDocument74 pagesJean Dubuis 1 Fond A Mentalphilippe30100% (1)
- 2 L'Etat CristallinDocument23 pages2 L'Etat CristallinSurbroPas encore d'évaluation
- Au Coeur Des Mineraux PDFDocument125 pagesAu Coeur Des Mineraux PDFdroopy007Pas encore d'évaluation
- Diffraction-RayonsX Nimes 2013 PDFDocument119 pagesDiffraction-RayonsX Nimes 2013 PDFKahlouche HichemPas encore d'évaluation
- Cristallographie PDFDocument98 pagesCristallographie PDFRyad KheloufPas encore d'évaluation
- TP2 Matériaux1 2020Document7 pagesTP2 Matériaux1 2020Dj Gs RayPas encore d'évaluation
- Cours de Physique Du Solide Chapitre 2 Analyse Par Diffraction Aux Rayons XDocument17 pagesCours de Physique Du Solide Chapitre 2 Analyse Par Diffraction Aux Rayons XETUSUPPas encore d'évaluation
- Structure Des Materiaux III DiffractionDocument27 pagesStructure Des Materiaux III DiffractionAnas HasniPas encore d'évaluation
- Etude de Cristaux Par Rayons - XDocument76 pagesEtude de Cristaux Par Rayons - XRafael V. Tolentino HdzPas encore d'évaluation
- Cours No2 Geologie PDFDocument6 pagesCours No2 Geologie PDFMoham Ed AlnPas encore d'évaluation
- Cristal Propr PDFDocument28 pagesCristal Propr PDFsumaleePas encore d'évaluation
- Structures Des Metaux Et Des Alliages1Document10 pagesStructures Des Metaux Et Des Alliages1hidouriabdelmoumen9802Pas encore d'évaluation
- TP DiffractionRX PDFDocument20 pagesTP DiffractionRX PDFwilliam lyPas encore d'évaluation
- Minéraux CristallographieDocument9 pagesMinéraux CristallographieDorra TanfousPas encore d'évaluation
- Structure Des Materiaux I CristallographieDocument37 pagesStructure Des Materiaux I CristallographieAnas HasniPas encore d'évaluation
- CristallographieDocument46 pagesCristallographieAchref HamedPas encore d'évaluation
- SMC - S4 - Séries TD Cristallographie Géomètrique I ZouihriDocument6 pagesSMC - S4 - Séries TD Cristallographie Géomètrique I ZouihriTHAMI EL GOSPas encore d'évaluation
- 1 Notions de Cristallographie 16 PagesDocument16 pages1 Notions de Cristallographie 16 Pagesrahma rahma100% (1)
- Métaux Et Alliages Non FerreuxDocument158 pagesMétaux Et Alliages Non FerreuxKali AbdennourPas encore d'évaluation
- ClassificationDocument45 pagesClassificationKarima SarsoPas encore d'évaluation
- 1.2.1 - ComplétéeDocument4 pages1.2.1 - Complétéemordant100% (1)
- OptiqueDocument29 pagesOptiqueAbdelmajid ElmansouriPas encore d'évaluation
- SOLUTION DE L'EXAMEN DE CRISTALLOGRAPHIE ET CRISTALLOCHIMIE DE LA SESSION DE RATTRAPAGE DE 2020-2021-SMC-SMP-S4 - PR A. BRITELDocument18 pagesSOLUTION DE L'EXAMEN DE CRISTALLOGRAPHIE ET CRISTALLOCHIMIE DE LA SESSION DE RATTRAPAGE DE 2020-2021-SMC-SMP-S4 - PR A. BRITELismailPas encore d'évaluation
- Structures Roches SedimentairesDocument14 pagesStructures Roches SedimentairesSoùkaîna S'möuni100% (1)
- 2110a2003 Chap01Document38 pages2110a2003 Chap01jimi1990Pas encore d'évaluation
- Catalogue MantaguaDocument19 pagesCatalogue MantaguapujolthierryPas encore d'évaluation
- Chapt 2 - Symétrie CristallineDocument11 pagesChapt 2 - Symétrie CristallinemokadrissiPas encore d'évaluation
- Diffraction de Rayon XDocument18 pagesDiffraction de Rayon XAymen 01Pas encore d'évaluation
- Cours 5Document3 pagesCours 5Beatrice Florin100% (3)
- SNDocument19 pagesSNagusrahayuPas encore d'évaluation
- Premiere Partie-Gpm - CristallographieDocument21 pagesPremiere Partie-Gpm - Cristallographieamina cheurfiPas encore d'évaluation
- Physique Des Matériaux - 2014-1 PDFDocument59 pagesPhysique Des Matériaux - 2014-1 PDFالفتى الخجولPas encore d'évaluation
- Cristallographie PDFDocument7 pagesCristallographie PDFعادل الحمديPas encore d'évaluation
- Solution de L'Examen DE Cristallographie SMC - S5: Abderrafî BRITELDocument7 pagesSolution de L'Examen DE Cristallographie SMC - S5: Abderrafî BRITELChokri AtefPas encore d'évaluation
- Cristallographie Geometrique Extrait Chapitre2Document16 pagesCristallographie Geometrique Extrait Chapitre2darmal100% (1)
- EXAMEN SR CristalloDocument7 pagesEXAMEN SR Cristallohéma tologiePas encore d'évaluation
- MOODLE Métallurgie Diaporama9Document20 pagesMOODLE Métallurgie Diaporama9assoumouPas encore d'évaluation
- Exercice SR Les PhononsDocument30 pagesExercice SR Les PhononsMbaye Gning100% (1)
- Elément CristallographieDocument86 pagesElément Cristallographiekamisnv2017Pas encore d'évaluation
- Diffraction de Rayons X (DRX) Ou XRD: X-Ray Diffraction: Les Divers Type de L'état Du SolideDocument25 pagesDiffraction de Rayons X (DRX) Ou XRD: X-Ray Diffraction: Les Divers Type de L'état Du SolideYoussef EnnajmyPas encore d'évaluation
- Géom A5 (CM1)Document6 pagesGéom A5 (CM1)14navarroPas encore d'évaluation
- TP Projection StériographiqueDocument10 pagesTP Projection Stériographiquehéma tologie100% (1)
- Cours D-Optique Des SolidesDocument66 pagesCours D-Optique Des SolidesMatthias Belloeil100% (1)
- Structures AlgébriquesDocument6 pagesStructures AlgébriquesIdris SirdiPas encore d'évaluation
- Chapitre DRX PDFDocument51 pagesChapitre DRX PDFomar sahamoudiPas encore d'évaluation
- CHAP I CristalloDocument50 pagesCHAP I CristalloMyriam MarioumaPas encore d'évaluation
- Chapitre1 CRISTALLOGRAPHIEDocument12 pagesChapitre1 CRISTALLOGRAPHIEXray34100% (1)
- Cours Cristallo 1 Partie 2018Document34 pagesCours Cristallo 1 Partie 2018Chaouki100% (1)
- Chapitre IDocument15 pagesChapitre Ihassane ayiPas encore d'évaluation
- La Physique Classique: Comment Les Images Et Les Choses Bougent - Elles?Document164 pagesLa Physique Classique: Comment Les Images Et Les Choses Bougent - Elles?la physique selon le programme Français100% (5)
- Tableau SVTDocument4 pagesTableau SVTMioraaPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Structure Cristalline Des Mat PDFDocument22 pagesChapitre 1 Structure Cristalline Des Mat PDFrahma rahmaPas encore d'évaluation
- S 1-3 Structure de La MatièreDocument16 pagesS 1-3 Structure de La Matièrenkpebe aliPas encore d'évaluation
- Cours 4 Geologie 1Document16 pagesCours 4 Geologie 1ReL AxEPas encore d'évaluation
- UMAPON Cours de Cristallograohie Et Minéralogie 2022-1Document280 pagesUMAPON Cours de Cristallograohie Et Minéralogie 2022-1Arsene MunanaPas encore d'évaluation
- Premiere Partie-Gpm - CristallographieDocument21 pagesPremiere Partie-Gpm - Cristallographieamina cheurfiPas encore d'évaluation
- Cristallo 6Document31 pagesCristallo 6Hind Hindou100% (1)
- Cours Physique Du Solide - FouddadDocument79 pagesCours Physique Du Solide - FouddaddendaniPas encore d'évaluation
- 4-Mineraux Et RochesDocument61 pages4-Mineraux Et RochesSohaib SFAIRIPas encore d'évaluation
- Cours Minéralogie PDFDocument68 pagesCours Minéralogie PDFKOMCIPas encore d'évaluation
- Cours Cristallographie - EPSTDocument29 pagesCours Cristallographie - EPSTDr ChimiePas encore d'évaluation
- TD1 Radio 2021Document2 pagesTD1 Radio 2021Lamsaaf MohamedPas encore d'évaluation
- Letexte04 PDFDocument4 pagesLetexte04 PDFSalah LáálámPas encore d'évaluation
- Système CristallinsDocument4 pagesSystème CristallinsAouini IbtihelPas encore d'évaluation
- Polycopié CristallographieDocument69 pagesPolycopié Cristallographieاجي تقرىPas encore d'évaluation
- Chap 1Document95 pagesChap 1Barthélemy HoubenPas encore d'évaluation
- Etat SolideDocument20 pagesEtat SolideAhmedPas encore d'évaluation
- Cours Minéraux Et Roches UNZDocument168 pagesCours Minéraux Et Roches UNZmramrafirstPas encore d'évaluation
- Cours Matériaux Électrotechnique 04Document76 pagesCours Matériaux Électrotechnique 04Aymen BhdPas encore d'évaluation
- Cours de MineralogieDocument60 pagesCours de Mineralogiejack100% (1)
- 5 SystemesDocument21 pages5 SystemesJoSe Wilk ManPas encore d'évaluation
- Wa0004Document75 pagesWa0004Yc YacinePas encore d'évaluation
- 1-Initiation CristallographieDocument68 pages1-Initiation CristallographieFloriane KoutouanPas encore d'évaluation
- Garreau PDFDocument65 pagesGarreau PDFAbdelhadi Bentouami100% (1)
- Module: Chimie Minérale 1: CoursDocument47 pagesModule: Chimie Minérale 1: CoursNajoua RaguaniPas encore d'évaluation