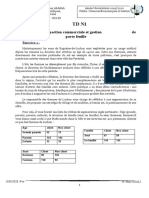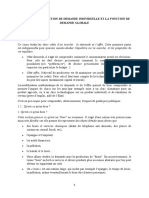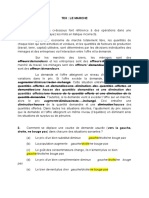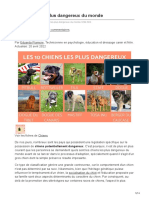Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Beaute Du Paradoxe. Le Cheval Barbe
Transféré par
babiouCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Beaute Du Paradoxe. Le Cheval Barbe
Transféré par
babiouDroits d'auteur :
Formats disponibles
BEAUTÉ DU PARADOXE
LE CHEVAL BARBE
DANS SON DESTIN FRANCO-ALGÉRIEN
(1542-1914)
par
Blandine HUSSER
diplômée de master, élève de l’École normale supérieure de Paris
INTRODUCTION
Étymologiquement, le terme « Barbe » désigne sans distinction tout cheval origi-
naire de Barbarie, l’actuel Maghreb. Naturellement sans équivalent en Afrique du
Nord, il apparaît entre la fin du xve siècle et le début du siècle suivant en Europe
occidentale pour désigner les chevaux originaires de cette immense région,
encore très mal connue au-delà des côtes. Lorsque les Français commencent à
importer à la même époque un très petit nombre de ces équidés comme montures
de luxe ou reproducteurs d’élite, cette vaste définition géographique est ample-
ment suffisante. Dès le début en effet, la description morphologique du Barbe
type par les Européens, très succincte et imprécise, se confond généralement
avec celle, plus homogène, des individus sélectionnés parmi des milliers d’autres
pour leurs aptitudes à la fois physiques et mentales à la haute école. Aux yeux
des contemporains, les qualités comportementales qui sont attribuées au Barbe
– proximité avec l’homme, intelligence, apprentissage rapide – sont de fait déjà
aussi importantes sinon plus dans sa caractérisation que ses qualités physiques.
Les premières décennies du xixe siècle connaissent néanmoins un double
bouleversement qui vient changer la donne. Les races domestiques modernes,
caractérisées par une rigoureuse sélection, par la perpétuelle recherche d’une
adaptation optimale à une fonction donnée, et par conséquent par la prépondé-
rance absolue du critère morphologique, s’imposent depuis la fin du xviiie siècle
2 THÈSES 2017
comme une avancée majeure en matière d’élevage équin. En parallèle, la
conquête de la régence d’Alger, entamée au printemps 1830, amène progressi-
vement la France à prendre le contrôle de l’élevage algérien sur ces nouvelles
bases zootechniques, tout en se confrontant à la population équine locale dans
son ensemble et donc à son incompressible diversité. C’est ici que le bât blesse
dans le cas du Barbe, notion européenne alors déjà vieillie, qui accède sans
aucune transition à un statut occidental nouveau, le tout plaqué sur une réalité
équestre maghrébine irréductiblement différente.
De manière logique, le terme « Barbe » aurait dû soit se restreindre à un type
particulier de cheval nord-africain, soit littéralement disparaître. Pour autant,
il persiste au contraire pleinement dans sa vieille définition de la Renaissance
tout au long du xixe siècle pour caractériser l’ensemble des équidés maghrébins,
et ce jusqu’à aujourd’hui. Une telle constance – à la fois unique et anormale –
interroge simultanément la pertinence du mot et de ce qu’il recouvre. Comment
un vocable très spécifique dans le temps et dans l’espace a-t-il pu perdurer pen-
dant près de quatre siècles, malgré son inadéquation de plus en plus flagrante
avec la réalité de ce qu’il désigne ?
Un triple paradoxe géographique, zootechnique et culturel s’enracine ainsi
profondément à partir du xixe siècle. Ces hésitations sur la définition du Barbe
orientent sa reproduction et ses rôles, et ont de ce fait de lourdes conséquences
sur l’animal lui-même, dans sa morphologie, son tempérament, ses usages et
enfin son vécu. L’illusion, entretenue par la majorité des promoteurs comme
des détracteurs de la race, d’un cheval qui n’aurait que très peu évolué entre
le xvie siècle et le xxe siècle, voire depuis l’Antiquité, demande ainsi à être
déconstruite, permettant par la même occasion d’observer de manière parti-
culièrement précise et documentée les évolutions multiples d’un même animal
domestique sur le temps long.
SOURCES
Les principaux ouvrages et périodiques phares du monde équestre français,
mais aussi européen, du xvie siècle au xxe siècle, ont constitué la base de départ
de cette recherche. Ils sont conservés dans les bibliothèques spécialisées du
musée de la Cavalerie de Saumur, de l’École nationale d’équitation, du Service
historique de la Défense à Vincennes, voire pour les plus rares au sein de col-
lections privées. Le travail préalable sur les imprimés a permis d’estimer, puis
de déterminer et localiser avec précision les fonds d’archives pertinents, sans
se perdre dans une masse et une diversité de documents éblouissantes. Aux
Archives nationales, la série O, et plus particulièrement les sous-séries O1 et O2,
Blandine HUSSER 3
conservant les documents de la maison du Roi, puis de l’Empereur, ont permis
de retracer non seulement la nature, le rôle et le nombre de chevaux barbes
des écuries impériales et royales, mais aussi les modalités de leur acquisition
en Afrique du Nord. La série AP, renfermant les archives personnelles et fami-
liales, a offert plusieurs lettres et rapports intéressants ; de même, la série F
propose quelques documents issus du versement des ministères de l’Intérieur, de
l’Agriculture et du Commerce et de l’Industrie. Les archives du commandement
de l’armée d’Afrique, conservées au Service historique de la Défense dans la
sous-série 1H, présentent l’avantage de disposer d’un grand nombre de sources
indispensables sur la question, mais également l’inconvénient de les proposer
de manière extrêmement éparse et parfois inaccessible. Ces difficultés ont aisé-
ment été contournées grâce à la richesse des sources conservées aux Archives
nationales d’outre-mer à Aix-en-Provence, issues des services des ministères de
la Guerre et de l’Intérieur ayant eu en charge l’Algérie (sous-série F10), ainsi que
de la correspondance du Gouvernement général de l’Algérie (séries E et EE).
En revanche, spécificité inhérente au contexte de recherche algérien, la majorité
des archives de fonctionnement des établissements hippiques est restée sur place
après l’indépendance en 1962 et demeure actuellement quasiment inaccessible
même aux chercheurs de nationalité algérienne.
PREMIÈRE PARTIE
LE BARBE, ANIMAL ENTRE DEUX RIVES (1542-1847)
CHAPITRE PREMIER
L’HÉRITAGE :
DES FEUX DE LA RENAISSANCE AUX EXPÉRIENCES NAPOLÉONIENNES
À l’époque moderne, la définition française du Barbe est en parfaite cohé-
rence avec la morphologie et les aptitudes de la poignée d’individus importés
en Europe. Difficile à acquérir, un Barbe est systématiquement un animal
d’importation, issu d’une drastique sélection à l’achat et doté d’un physique
et d’un tempérament caractérisés : de taille moyenne (entre 1,40 et 1,50 mètre
au garrot), carré, rond, au chanfrein busqué, vif mais posé, intelligent et extrê-
mement proche de l’homme. Cette définition ne prend naturellement pas en
compte l’ensemble de la population chevaline nord-africaine mais les seules
caractéristiques recherchées en Europe, qui motivent et orientent les achats.
Monture royale par excellence, le Barbe se distingue par ses aptitudes au manège
et à la parade. Dans ces activités, son caractère semble séduire davantage que
son modèle, parfois irrégulier en comparaison avec d’autres chevaux réputés
4 THÈSES 2017
pour leurs formes, à l’image du Napolitain ou de l’Espagnol. Il est un véritable
emblème du cheval idéal de l’Ancien Régime, consacré comme meilleur étalon
améliorateur de selle par l’ensemble des hippologues et véritable phénomène de
mode au sein de la haute noblesse.
Comme pour l’ensemble des modes, l’intérêt pour le Barbe finit cependant
par décroître à partir de la seconde moitié du xviiie siècle, sous l’effet conjugué
de plusieurs facteurs que sont : son coût exorbitant dans une conjoncture éco-
nomique plus difficile ; la militarisation de l’équitation savante, qui ne demande
plus une monture spécialement prédisposée aux airs relevés ; l’apparition de la
course comme nouveau loisir ; et enfin l’émergence de nouveaux chevaux d’élite
que sont le pur-sang anglais et le pur-sang arabe. À l’exception de quelques rares
sujets, le Barbe est quasiment absent de la geste militaire du Premier Empire.
Néanmoins, c’est à cette époque que se forge en France un nouvel idéal du cheval
de guerre, basé sur les modèles des peuples cavaliers de l’Est, plus particulière-
ment les Cosaques. Cette prise de conscience est lourde de conséquences pour
le cheval algérien en 1830.
CHAPITRE II
LA RENCONTRE :
L’EXPÉDITION D’ALGER ET LA GUERRE DE CONQUÊTE
À la Restauration, le Barbe est définitivement oublié en France comme monture
d’élite et comme améliorateur. Il est absent au début du grand débat du siècle
entre anglomanes et arabomanes, et sombre peu à peu dans l’oubli, situation
renforcée par les difficultés que rencontre la régence d’Alger à ce même moment.
La décision de Charles X de lancer l’expédition d’Alger en 1830 marque un
tournant majeur. Inadaptés aux difficiles conditions naturelles du Maghreb, les
chevaux français du corps expéditionnaire ne survivent pas au-delà de quelques
mois, obligeant la cavalerie à se remonter en chevaux locaux. Les vétérans de
la Grande Armée reconnaissent alors chez les « Barbes » cette même symbiose
avec leur environnement qu’ils avaient observée chez les petits équidés polonais
et russes : désormais, le cheval algérien n’est plus l’incarnation du cheval de
manège idéal mais celle du seul cheval de guerre résilient et exploitable dans le
contexte nord-africain.
Malgré leur résistance et leur frugalité, héritées d’un élevage algérien très
sélectif, les effectifs équins engagés dans les deux camps sont ravagés par les
blessures de guerre, mais aussi et surtout par les maladies contagieuses et les
déplorables conditions de vie. Des lignées entières disparaissent ainsi, causant
un appauvrissement génétique remarqué par les contemporains, ainsi qu’un
progressif effacement des spécificités morphologiques locales sous l’effet des
déplacements de masse de chevaux destinés à la remonte. Malgré tout, plusieurs
Blandine HUSSER 5
officiers, contrariés par le décalage entre la vieille définition du Barbe et la réa-
lité qu’ils ont sous les yeux, vont tenter d’élaborer au cours de leurs missions une
nouvelle classification des équidés maghrébins dans le cadre algérien.
CHAPITRE III
LA DÉCOUVERTE :
NOUVEAU CHEVAL, NOUVEAU MONDE
La conquête de l’Algérie provoque inévitablement une confrontation violente
entre deux univers équestres que tout oppose. Lors de missions de recensement
des ressources chevalines région par région, des officiers de remonte se penchent,
dans des conditions difficiles, sur la diversité des morphologies – ou types –
qu’ils observent à l’échelon local. Le capitaine Morris (1803-1867) propose une
première ébauche de classification en 1834, suivi par le vétérinaire militaire
Mercier en 1847. Tous deux considèrent qu’il y a dans la Régence non pas une
mais plusieurs races de chevaux, et que le Barbe n’est que l’une d’entre elles.
Leurs conclusions sont néanmoins insuffisantes en raison de l’incessant brassage
des chevaux provoqué par la guerre et de leur tentative de combler leur manque
de communication avec les Algériens par leurs connaissances historiques. Ainsi,
les textes antiques retraduits au xixe siècle et de vagues connaissances sur l’his-
toire de l’islam médiéval sont pleinement mobilisés dans cette redéfinition et
permettent de mettre un nom sur ces races construites de manière très théorique
et artificielle, à l’image du « Numide » ou du « Maure ».
Ces travaux, bien que révolutionnaires par leurs enjeux, tombent très rapide-
ment dans l’oubli, malgré leur recherche d’une triple cohérence morphologique,
géographique et sociale. La raison de cet échec est double. Premièrement, les
impératifs de la remonte, qui demande d’élever rapidement des chevaux de cava-
lerie fiables, dans un contexte de guérilla épuisante pour les deux camps, ne sau-
raient s’embarrasser de ces distinctions trop abstraites. Et dans un second temps,
le principal vecteur de connaissance sur le cheval algérien, le général Eugène
Daumas (1803-1871), qui écrit en étroite collaboration avec l’émir Abd el-Kader
(1808-1883) à partir des années 1850, encourage une confusion aboutie entre
Barbe et Arabe, qu’il réunit sous le même vocable de « cheval d’Orient ». Cette
conception est entérinée par les peintures orientalistes – à l’exception d’Eugène
Fromentin (1820-1876), véritable « peintre du Barbe ». Les artistes représentent
de manière systématique le cheval algérien avec des traits fortement arabisés. Ils
entretiennent ainsi involontairement le courant de pensée qui finit par s’imposer
et qui fait du Barbe un Arabe dégénéré qu’il s’agit de ramener par croisement
à sa pureté originelle, à contre-courant de la majorité des autres races équines
françaises du xixe siècle. Les éleveurs de métropole maintiennent en effet leurs
races dans un état jugé déjà « pur » ou se projettent résolument vers l’avenir.
6 THÈSES 2017
DEUXIÈME PARTIE
LE BARBE A-T-IL DISPARU AU XIXe SIÈCLE ? (1847-1914)
CHAPITRE PREMIER
LE COMBAT :
LE BARBE MILITAIRE, PARADIGME DE LA RACE
À partir de 1847 et la prise en main de l’ensemble de l’élevage équin de l’Algérie
par l’armée, le Barbe militaire connaît un véritable âge d’or. Son corps déjà
très apprécié s’aligne de plus en plus sur le modèle de ce que la cavalerie légère
recherche. Le système repose sur l’élevage dans des haras et jumenteries d’un
nombre restreint d’individus d’élite, envoyés ensuite dans des dépôts d’étalons et
stations de monte répartis sur le territoire afin que les propriétaires – très majo-
ritairement algériens – viennent faire saillir leurs juments. Le but recherché est
une amélioration progressive de l’ensemble du cheptel sur des critères purement
militaires, malgré quelques engagements pris à demi-mot pour répondre éga-
lement aux besoins civils. Le bilan est néanmoins mitigé faute d’adhésion des
éleveurs des tribus et d’une politique d’élevage claire. Le croisement améliora-
teur de plus en plus répandu avec l’Arabe importé de Syrie rencontre quant à lui
une hésitation jamais résolue : l’Arabe-Barbe est-il vraiment un Barbe amélioré
ou une nouvelle race à part entière ?
Si le Barbe est peu apprécié dans les rangs de l’armée de métropole, dont
il est évincé après la défaite de 1870, il devient en revanche emblématique de la
cavalerie d’Afrique – chasseurs et spahis – envoyée partout dans le monde, de la
Chine au Mexique en passant par la Crimée. Dans ces biotopes difficiles auxquels
il est totalement étranger, il fait néanmoins preuve d’une résilience remarquable
qui entérine de plus en plus sa réputation de cheval de cavalerie légère idéal.
Calme et de petite taille, il voyage particulièrement bien en bateau, et les grands
progrès en matière de transport maritime équin sous le Second Empire se font
sur mesure par rapport à ses exigences. Il participe également au rayonnement
diplomatique de la France via l’envoi au Japon d’un nombre conséquent d’étalons
lorsque des officiers de l’armée d’Afrique sont chargés de recréer et de former
la cavalerie nippone. Le cadre militaire offre un observatoire idéal pour étudier
de plus près l’évolution des vies, des comportements et des morphologies des
individus barbes jusqu’à la veille du premier conflit mondial.
Blandine HUSSER 7
CHAPITRE II
LA COLONIE :
LE BARBE CIVIL, L’AUTRE VERSANT IGNORÉ ?
Le Barbe civil est le grand oublié des politiques d’élevage comme du modèle type
prôné par le standard du stud-book de la race barbe, ouvert en 1886. Cheval léger
de selle, il se retrouve en décalage perpétuel avec les nouvelles exigences des
activités coloniales agricoles, industrielles et de transport qui se sont presque
immédiatement alignées sur le fonctionnement de la métropole. Le cas des
diligences algériennes, les célèbres pataches, importées de France, permet de
réaliser une étude comparative très parlante des capacités des chevaux algériens
et français pour une même tâche et un matériel identique. Les chevaux de trait
français restent totalement incapables de s’acclimater en Algérie, de même que
les grands chevaux de chasse normands ou de course anglais ; par conséquent,
on modifie des Barbes avec des chevaux lourds pour créer des demi-sang à desti-
nation de l’attelage, on les croise avec des Arabes pour fournir un cheval de selle
plus élégant, ou avec des pur-sang pour obtenir des produits plus compétitifs
dans des courses pourtant réservées aux chevaux algériens de souche.
En parallèle de ces modifications débridées et de ces croisements souvent
synonymes d’échecs, d’autant plus difficiles à retracer que beaucoup sont clan-
destins pour des questions de papiers d’identification et de primes à l’élevage, le
cheval barbe « d’avant 1830 » est de plus en plus mis à l’honneur. Paradoxalement,
au moment où il est sans cesse transformé davantage, il fait l’objet de nom-
breuses recherches à visée scientifique et historique. De grands débats cherchent
à replacer le cheval contemporain dans la droite lignée des découvertes archéolo-
giques rupestres et romaines en Algérie et en Tunisie. La virulente controverse
qui entoure l’absence ou non chez le Barbe d’une sixième vertèbre lombaire est
d’une violence qui ne s’explique que par le fait que les savants d’alors pensent
détenir enfin la solution à l’épineuse question du cheval primitif en résolvant
ce problème. Enfin, les indéniables capacités cognitives du cheval algérien ainsi
que sa grande proximité avec l’homme amènent à des réflexions souvent solides
sur l’intelligence du cheval et ses facultés d’apprentissage, dont le Barbe est,
avec l’Arabe, le paradigme absolu.
CONCLUSION
Finalement, le triple paradoxe de départ – l’inadéquation totale entre le concept
européen de race, la vieille notion de Barbe telle que définie à l’époque moderne
et les conceptions équines nord-africaines – n’a toujours pas été résolu en 1914.
Il ne débouche pas sur un modèle nouveau et cohérent, ce qui aurait impliqué
8 THÈSES 2017
une profonde remise en cause des archétypes anciens. Bien au contraire, la défi-
nition du Barbe s’est encore appauvrie. Elle exclut désormais une grande partie
de la population chevaline de l’Algérie, qui ne correspond pas au standard d’un
stud-book bien trop restrictif par son fonctionnement et ses critères. De même,
le statut des individus obtenus par des croisements plus ou moins heureux avec
des équidés occidentaux reste flou.
Or au tournant du xxe siècle, à un moment où l’on hésite encore à considérer
ces chevaux comme des Barbes améliorés ou comme de nouvelles races à part
entière, se produit une véritable « fossilisation » de la situation, sous l’effet
conjugué de la volonté de protéger rétroactivement le « Barbe pur », menacé par
ces croisements, et de la mécanisation croissante, qui rend notamment inutiles
les réflexions sur un cheval barbe plus apte au trait. Les essais se ralentissent,
puis s’arrêtent : l’indépendance en 1962 fige dans l’ambre cette situation. En
l’absence de sélection générale en vue d’une pratique fonctionnelle ou sportive
donnée, cet état de fait s’est prolongé jusqu’à aujourd’hui, où il est sans conteste
possible de qualifier le Barbe d’anachronisme vivant.
En l’espace de quatre siècles, la notion de Barbe s’est donc de fait littérale-
ment fossilisée à mi-chemin entre deux conceptions de la race, figée dans une
apparente intemporalité, alors même que l’animal qui porte ce nom a évolué
sans discontinuer, que ce soit au niveau de son corps, de son mental ou de ses
usages. Ici réside la véritable beauté du paradoxe. Ce cas inédit permet d’étudier
en profondeur et avec un maximum de lisibilité la transformation des animaux
domestiques et de travail au xixe siècle. Mais il permet également d’aborder leurs
évolutions sur le temps long, sur le plan morphologique et – ce qui est inédit –
sur le plan du comportement à l’échelle des individus.
ANNEXES
Signalement du cheval algérien offert par la ville de Marseille à la Grande Écurie,
1764. — Liste et signalement de chevaux barbes importés de Tripoli, 1764. —
Extrait de l’arrêt du Conseil d’État du 17 octobre 1665 sur les haras. — Histoire
d’un cheval qui monta un escalier de marbre de trente-deux marches, par Gaspard
de Saunier, 1761. — Rapport sur l’organisation des dépôts de remonte et des
haras, 1850. — Poème arabe sur les chevaux du Sahara, par Abd el-Kader, 1851.
— Abd el-Kader à cheval, par le photographe hippique Delton, 1865. — Rapport
du secrétaire général Durieu au gouverneur général de l’Algérie sur l’institution
d’un stud-book de la race barbe, 1886. — Arrêté du 8 mars 1886 portant création
du stud-book de la race barbe. — Extraits de journaux populaires de l’Algérie
concernant le Barbe, 1889-1894.
Vous aimerez peut-être aussi
- Dossier 24 Le Barbe Cheval Berbère PDFDocument21 pagesDossier 24 Le Barbe Cheval Berbère PDFLinaZinebPas encore d'évaluation
- Brochure ChevalDocument9 pagesBrochure ChevalZakiBouzidEditions67% (3)
- C.analy EncgDocument46 pagesC.analy Encgabdelmajid en-namiPas encore d'évaluation
- Projet EcoDocument25 pagesProjet EcoWided TouhamiPas encore d'évaluation
- Marketing QCMDocument16 pagesMarketing QCMAchrafPas encore d'évaluation
- TD N1 M P: Atière: Rospection Commerciale Et Gestion de Porte FeuilleDocument2 pagesTD N1 M P: Atière: Rospection Commerciale Et Gestion de Porte FeuilleAHBIRPas encore d'évaluation
- Cours Marketing de Base 21-22Document57 pagesCours Marketing de Base 21-22Yass Tae's100% (1)
- Les Concepts Economique de Base: GeneraleDocument35 pagesLes Concepts Economique de Base: Generalemed bibPas encore d'évaluation
- Exercices Partie V 3 Les Options StratégiquesDocument9 pagesExercices Partie V 3 Les Options StratégiquesDoha Kninir100% (1)
- Resumé Marketing ApprofondieDocument21 pagesResumé Marketing ApprofondieSaadia ElfakirPas encore d'évaluation
- La Zone de ChalandiseDocument4 pagesLa Zone de ChalandiseSara Belayachi100% (2)
- Chapitre 2 - Présentation de L'activité Économique - Partie 4Document17 pagesChapitre 2 - Présentation de L'activité Économique - Partie 4Maroc24100% (1)
- Cours Microéconomie (S1)Document158 pagesCours Microéconomie (S1)Hojejah CeesayPas encore d'évaluation
- Diaporama 1 - CopieDocument10 pagesDiaporama 1 - CopieYousra ZrPas encore d'évaluation
- COURS DE MACROÉCONOMIE v1Document56 pagesCOURS DE MACROÉCONOMIE v1Altafallah MissaouiPas encore d'évaluation
- Cours Marketing Fondamental GEADocument138 pagesCours Marketing Fondamental GEASd IlyassePas encore d'évaluation
- Cours Introduction À L'économie 2019 - 2020Document103 pagesCours Introduction À L'économie 2019 - 2020Mamita k2100% (1)
- 050 Cout VariableDocument14 pages050 Cout Variabletouil_redouanePas encore d'évaluation
- Management Des Entreprises CorrigeDocument5 pagesManagement Des Entreprises CorrigeJad SenmarPas encore d'évaluation
- Eco Monétaire Et Financière 256623Document6 pagesEco Monétaire Et Financière 256623Ayoub Mezrouii100% (1)
- Identité Et Diversité.2019docxDocument17 pagesIdentité Et Diversité.2019docxslimani azizPas encore d'évaluation
- Elasticite de La DemandeDocument2 pagesElasticite de La DemandeAyo OubPas encore d'évaluation
- Frontière Des Possibilités de Production D'une ÉconomieDocument3 pagesFrontière Des Possibilités de Production D'une Économietati0123100% (2)
- Chapitre 1 Le Cadre ComptableDocument5 pagesChapitre 1 Le Cadre Comptableconstruction hssaisounePas encore d'évaluation
- Rapport Thematique de Diagnostic TerritoDocument38 pagesRapport Thematique de Diagnostic TerritomehdiPas encore d'évaluation
- Cours Économie IndustrielleDocument148 pagesCours Économie IndustrielleSi Hem50% (2)
- 02 TypologieDocument17 pages02 Typologiemezouki100% (6)
- Vieille Technologique Harina de XoconostleDocument7 pagesVieille Technologique Harina de XoconostlepanchitocartmanPas encore d'évaluation
- EXAMEN FINAL MKT Et COM - IIUMA 22-23Document2 pagesEXAMEN FINAL MKT Et COM - IIUMA 22-23ASSOGBADJO Septime OlympePas encore d'évaluation
- Chapitre1 Le MarchéDocument35 pagesChapitre1 Le MarchéKamil ChamPas encore d'évaluation
- 2017 Cnaem CorrigeDocument5 pages2017 Cnaem CorrigeRim ElouafiPas encore d'évaluation
- Economie Entreprise s1 ALCenterDocument178 pagesEconomie Entreprise s1 ALCenterAyman ZackPas encore d'évaluation
- Cas WhiskasDocument3 pagesCas WhiskasGuillaume BctPas encore d'évaluation
- Textile HabillementDocument109 pagesTextile HabillementHyacinthe DahoPas encore d'évaluation
- Ias41 2Document17 pagesIas41 2brahim intissarPas encore d'évaluation
- Iua Cours M2F 2016-2017Document63 pagesIua Cours M2F 2016-2017Sana MariamPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - Demande Individuel & Globale - Cours 2023Document21 pagesChapitre 1 - Demande Individuel & Globale - Cours 2023Mar IemPas encore d'évaluation
- Série de Prix ADocument2 pagesSérie de Prix AChahine Serghine100% (1)
- Partie3-La Production - Chapitre 1-La Diversité Des Organisations ProductivesDocument4 pagesPartie3-La Production - Chapitre 1-La Diversité Des Organisations ProductivesMme et Mr LafonPas encore d'évaluation
- Lexique D'économieDocument27 pagesLexique D'économieVa MpPas encore d'évaluation
- Uemoa FDocument43 pagesUemoa FJoséphine NancassePas encore d'évaluation
- 12 - Histoire de La Pensée Économique PDFDocument15 pages12 - Histoire de La Pensée Économique PDFالتهامي التهاميPas encore d'évaluation
- HPE Cours Complet CHACHADocument67 pagesHPE Cours Complet CHACHAJustine Gengembre100% (1)
- Exercices Sur Le Cycle de Vie Dun ProduitDocument4 pagesExercices Sur Le Cycle de Vie Dun ProduitkeadPas encore d'évaluation
- Etude de Cas Stratégie MarketingDocument8 pagesEtude de Cas Stratégie MarketingIMANE CHAFIPas encore d'évaluation
- TD N°2 Analyse Des Coûts PDFDocument4 pagesTD N°2 Analyse Des Coûts PDFbadrPas encore d'évaluation
- Filiere Viande RougeDocument1 pageFiliere Viande RougeIlyasse Ait HaddouPas encore d'évaluation
- Economie - Cours Des Fiches 1,2 Et 3Document9 pagesEconomie - Cours Des Fiches 1,2 Et 3ThiebautPas encore d'évaluation
- TD 6Document5 pagesTD 6Achraf El aouamePas encore d'évaluation
- TD MarcheDocument7 pagesTD MarcheSimon V.WPas encore d'évaluation
- Na9la Communication Français Ofppt 2022Document2 pagesNa9la Communication Français Ofppt 2022Azo DinPas encore d'évaluation
- Cours de TEEODocument11 pagesCours de TEEOAshley Wendy WilliamsPas encore d'évaluation
- Marketing Approfondi - La Démarche MarketingDocument19 pagesMarketing Approfondi - La Démarche MarketingImane ImanePas encore d'évaluation
- Ecodev Prof Nyembo 2009-1-1Document160 pagesEcodev Prof Nyembo 2009-1-1johnprince mukendiPas encore d'évaluation
- Pr. Nawal Bensaid - Introduction À L'économie S1 - Groupe E FDocument65 pagesPr. Nawal Bensaid - Introduction À L'économie S1 - Groupe E FEl Aziz El MehdiPas encore d'évaluation
- 6-Politique ProduitDocument11 pages6-Politique ProduitDjamel AzroutiPas encore d'évaluation
- 00 Chap 7 Monopole Et Oligopole SC PoDocument67 pages00 Chap 7 Monopole Et Oligopole SC Ponada333100% (1)
- PARTIE 4 Mercatique-1Document17 pagesPARTIE 4 Mercatique-1Fedwa SlaouiPas encore d'évaluation
- Cours Micro JekkiDocument72 pagesCours Micro Jekkiالابتسامة سرها الوسامة100% (1)
- AdminLB-carte Identite de La Vache PDFDocument1 pageAdminLB-carte Identite de La Vache PDFAngel KissPas encore d'évaluation
- Cours ACMDocument42 pagesCours ACMFAOUZI NizarPas encore d'évaluation
- Le Berger AllemandDocument12 pagesLe Berger Allemanddhoulhijja9960Pas encore d'évaluation
- La Famille Des AnimauxDocument10 pagesLa Famille Des AnimauxCiubuca GetaPas encore d'évaluation
- LOOF Catalogue NIMES 2022Document58 pagesLOOF Catalogue NIMES 2022linhPas encore d'évaluation
- Dressage Du Chiens Au PistageDocument10 pagesDressage Du Chiens Au PistagemiguelPas encore d'évaluation
- Conférence: Grand Angle ViandeDocument30 pagesConférence: Grand Angle ViandeISSAMPas encore d'évaluation
- 01269me010if LockedDocument1 page01269me010if LockedDéborah LodensPas encore d'évaluation
- Zombicide Compagnons ChiensDocument6 pagesZombicide Compagnons ChiensDavid BAUWENSPas encore d'évaluation
- Les Chiens Les Plus Dangereux Du MondeDocument14 pagesLes Chiens Les Plus Dangereux Du MondeRami ÉcologuePas encore d'évaluation
- ChevauxDocument9 pagesChevauxgattoxx44100% (1)
- Boeuf CoursDocument5 pagesBoeuf CoursAyatte SaidPas encore d'évaluation
- Palmarès Des Berrichons Du CherDocument3 pagesPalmarès Des Berrichons Du CherCentre FrancePas encore d'évaluation
- Jack Russel Terrier2Document13 pagesJack Russel Terrier2Ionel DiaconuPas encore d'évaluation
- 19.02.2016 / FR FCI-Standard #343: Federation Cynologique Internationale (Aisbl)Document7 pages19.02.2016 / FR FCI-Standard #343: Federation Cynologique Internationale (Aisbl)fthebault.fotPas encore d'évaluation
- FR 14-02-2023 Registre CPDX 0Document2 pagesFR 14-02-2023 Registre CPDX 0Jason KeithPas encore d'évaluation
- British LonghairDocument2 pagesBritish Longhairandreea uPas encore d'évaluation
- Cheval SauvageDocument5 pagesCheval Sauvagede merdPas encore d'évaluation
- Annuaire Boulonnais 2011 PDFDocument101 pagesAnnuaire Boulonnais 2011 PDFSkavenGirlPas encore d'évaluation
- Le ChevalDocument2 pagesLe Chevalعبدو احمد100% (1)
- A4 Génétiqu Anglo 2018.compressedDocument28 pagesA4 Génétiqu Anglo 2018.compressedAnonymous Crg4Jp5SyPas encore d'évaluation
- Nomenclature - PDF ChienDocument12 pagesNomenclature - PDF ChienAmos NIYOGUSERUKAPas encore d'évaluation
- Les Robes Du ChevalDocument40 pagesLes Robes Du ChevalAlina TeodorescuPas encore d'évaluation
- Les Marocains Et Le ChevalDocument20 pagesLes Marocains Et Le ChevalKHALID MAATOUBPas encore d'évaluation
- Liste de Prix Et Temps ToilettageDocument5 pagesListe de Prix Et Temps Toilettage44dzrhhfqkPas encore d'évaluation
- Dossier de Presse Grande Semaine de Pompadour 2013Document14 pagesDossier de Presse Grande Semaine de Pompadour 2013Pixizone_ComPas encore d'évaluation
- ExerciceDocument1 pageExerciceAAPas encore d'évaluation
- Shiba Inu - Pedigree - 257Document7 pagesShiba Inu - Pedigree - 257BarreaudPas encore d'évaluation
- Tableau Décrire Un AnimalDocument1 pageTableau Décrire Un AnimalHend Fhima67% (3)
- Pointage MontbeliardeDocument4 pagesPointage MontbeliardeGéraldine Jourdan100% (1)