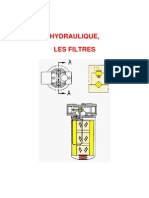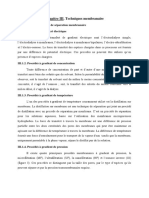Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Procedures Exploitation ST Akomnyada
Procedures Exploitation ST Akomnyada
Transféré par
Khalid ChoukarTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Procedures Exploitation ST Akomnyada
Procedures Exploitation ST Akomnyada
Transféré par
Khalid ChoukarDroits d'auteur :
Formats disponibles
CAMEROUNAISE DES EAUX
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (1 /138)
(Version Février 2010)
SOMMAIRE
OBJET ET DOMAINES D’APPLICATION DE LA PROCEDURE
PERSONNEL DE LA STATION D’AKOMNYADA
CHAPITRE 1 : FICHE TECHNIQUE DE LA STATION DE TRAITEMENT
D’AKOMNYADA
I. Généralités
II. Caractéristiques des eaux
III. Débit de l’installation
IV. Principe des traitements
V. Principe de fonctionnement des appareils de traitement
VI. Filtration : Le filtre AQUAZUR « V ».
CHAPITRE 2 : DIMENSIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
A. Dégrillage automatique
B. Pompage d’eau brute
C. Ouvrage d’arrivée d’eau brute et de répartition
D. Décanteur PULSATOR
E. Filtres
F. Réactifs
G. Pompage d’eau traitée
H. Mesures et instrumentation
I. Poste de production d’air comprime de service
CHAPITRE 3 : FONCTIONNEMENT DE LA STATION :
A. Fonctionnement Hydraulique
B. Fonctionnement électrique
CHAPITRE 4 : MISE EN SERVICE
I. Mise en service générale
II. Dosage des réactifs
III. Mise en service du PULSATOR
CHAPITRE 5 : EXPLOITATION DE LA STATION
A. Exploitation Générale
B. Exploitation du PULSATOR
C. Journal du fonctionnement
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (2 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 6 : ENTRETIEN DE LA STATION
D. Entretien Général
E. Entretien des boites de partialisation
F. Etalonnage de sonde Ph
G. Nettoyage
CHAPITRE 7 : INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
A. Principaux incidents, causes et remèdes sur un PULSATOR
B. Principaux incidents causes et remèdes sur un filtre AQUAZUR
CHAPITRE 8 : ARRET DE L’INSTALLATION
A. Arrêt de l’installation d’eau brute
B. Arrêt d’un PULSATOR
C. Arrêt d’un filtre
ANNEXES :
ANNEXE A : Méthodes d’Analyse
ANNEXE B : Détermination des taux de traitement
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (3 /138)
(Version Février 2010)
OBJET ET DOMAINES D’APPLICATION DE LA PROCEDURE
OBJET DES PROCÉDURES :
Les présentes procédures ont pour objet de fixer les procédures d’exploitation de la
station de traitement d’AKOMNYADA. Toutes viseront l’amélioration des conditions
d’exploitation et de standardisation des modes d’interventions.
DOMAINES D’EXPLOITATION
Les domaines d’application concernent l’exploitation des différents ouvrages et
équipements de la station de traitement d’AKOMNYADA.
PERSONNEL CONCERNÉ
L’application de ces procédures concerne le personnel suivant :
- le chef d’usine
- le chef service production
- le chef service maintenance
- le chef service contrôle de la qualité
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (4 /138)
(Version Février 2010)
PERSONNEL DE LA STATION D’AKOMNYADA
En vu d’assurer une conduite de l’exploitation et le maintien en bonne état des
équipements et ouvrages de la station de traitement, l’organisation ci-après a été
mise en place :
- 1 chef d’usine : coordonne les différentes activités de l’usine :
o Production ;
o Maintenance ;
o Contrôle de la qualité.
- 1 chef service production :
o contrôle les activités des exploitants ;
o établit les rapports mensuels ;
o veuille au fonctionnement continu de l’usine.
- 1 chef section production :
o établit les bons de sortie magasin pour les produits de traitement ;
o établit les tableaux de bord journaliers ;
o contrôle le traitement de l’eau ;
o entretient les ouvrages de traitement.
- 4 agents de quart par quart (4x4) :
1 chef de quart :
o relève les différents compteurs ;
o mets les équipements en service et les arrête ;
o signale les pannes par des ordres de travail ;
o rédige le journal de quart.
1 contremaître
o surveille la qualité de l’eau ;
o analyse de première urgence au cours du traitement.
1 traiteur d’eau
o procède au traitement de l’eau en y injectant les différents produits ;
o réceptionne les produits de traitement.
1 manutentionnaire
o procède à la manutention des différents produits.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (5 /138)
(Version Février 2010)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (6 /138)
(Version Février 2010)
1 chef service maintenance assisté d’un adjoint :
o entretien préventif et curatif des équipements électromécaniques ;
o réhabilitation des équipements électromécaniques ;
o établissement des rapports mensuels.
1 chef section entretien général
o effectue le nettoyage des différents équipements ;
o effectue le nettoyage des locaux.
1 chef section atelier
o coordonne les différents travaux à exécuter en atelier.
1 chef service contrôle de la qualité
o veuille aux normes de l’eau traitée (OMS) ;
o veuille aux respects des différents paramètres à respecter pour le
traitement ;
o établissement des rapports mensuels.
1 chef section qualité de l’eau
o fait les différentes analyses des eaux brutes et traitées ;
o estime les différentes quantités de produits de traitement à utiliser pour
la production.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (7 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 1
FICHE TECHNIQUE DE LA STATION DE
TRAITEMENT D’AKOMNYADA
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (8 /138)
(Version Février 2010)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (9 /138)
(Version Février 2010)
I. Généralités :
Cette station est située dans la région du Centre, département du Nyong et So’o. Elle
à 4 km de la ville de Mbalmayo et dessert les villes de YAOUNDE et de MBALMAYO
II. Caractéristiques des eaux :
a. EAU BRUTE
L’eau brute est prélevée dans la rivière NYONG. Ses principales caractéristiques
sont :
Analyse physico-chimique :
- couleur :……………………….100 à 320 degrés Hazen
- température…………………….24 à 30° C
- turbidité………………………..1,8 à 6 NTU
- matière en suspension …………faible
- matières organiques :
- en milieu acide………………….19 à 24 mg/l
- pH………………………………..5,2 à 6,2
- TAC……………………………..0,1 à 1°F
- CO2 libre……………………….> 5 mg/l
- Fer………………………………1,2 à 1,8 mg/l
- Manganèse………………………0,02 mg/l maximum
- Azote ammoniacal………………..< 0,3 mg/l
b. EAU TRAITEE
L’eau brute après traitement, permet d’obtenir une eau traitée ayant à la distribution
les qualités physico-chimiques et bactériologiques d’une eau potable.
Analyse physico-chimique :
- couleur :……………………….< 10 unités Pt/Co
- odeur, saveur…………………..absentes
- turbidité………………………..<1 NTU
- aluminium ……………………..< 0,3 mg/l
- fer (en fer)……………………...< 0,2 mg/l
- manganèse (en Mn)……………< 0,1 mg/l
- pH………………………………..8,3 environ
- oxygène dissous…………………minimum 75% de saturation
- ammonium………………………..< 0,5 mg/l
Analyse bactériologique :
- germes totaux concentration maximale admissible (CMA) :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (10 /138)
(Version Février 2010)
10 germes/ml à 37°C
100 germes/ml à 22°C
- absence de salmonelles, de staphylocoques pathogènes, de bactériophages
fécaux, d’entérovirus et d’organismes parasites.
coliformes totaux……………………..0/
coliformes fécaux……………………..0
streptocoques fécaux…………………..0
III. DEBIT DE L’INSTALLATION :
eau brute…………………………4375 m3/h, soit………….105000 m3/j
eau décantée………………………4250 m3/h, soit………….102000 m3/j
eau filtrée…………………………4250 m3/h, soit………….102000 m3/j
eau traitée produite……………….4170 m3/h, soit………….100000 m3/j
IV. PRINCIPE DES TRAITEMENTS :
Pour obtenir une eau distribuée répondant aux normes nécessaires (voir 2), les
différents traitements suivants sont appliqués à l’eau brute :
dégrillage
coagulation-floculation
décantation
filtration par sable
neutralisation au pH d’équilibre
désinfection
1. DEGRILLAGE :
Le dégrillage permet :
de procéder la station contre l’arrivée intempestive de gros objets
susceptibles de provoquer des bouchages et ses détériorations dans les
différentes unités de l’installation.
De séparer et d’évacuer facilement les matières volumineuses charriées
par l’eau brute qui pourraient nuire à l’efficacité des traitements suivants.
2. COAGULATION – FLOCULATION
Les eaux contiennent des particules en suspension colloïdales ou pseudo
colloïdales, très fines, qu’il est nécessaire d’agglutiner en un floc volumineux et lourd
afin d’assurer leur sédimentation.
Les colloïdes possèdent des charges électriques à l’interface qui empêchent les
particules voisines de se rapprocher.
L’action s’effectue en deux stades :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (11 /138)
(Version Février 2010)
la coagulation, qui permet de décharger les colloïdes afin de donner
naissance à un précipité,
la floculation, qui a pour but d’accroître le volume et la cohésion du floc
formé par la coagulation.
a. Coagulation :
Ont utilise un seul métallique tel que le sulfate d’alumine.
La dose à utiliser dépend de la nature de l’eau à traiter :
elle est établie à la mise en service de l’installation par essais « jartest ».
Plus une eau est chargée de matières colloïdales et surtout de matières
végétales, plus il faudra de réactifs pour la clarifier ;
la nature des matières organiques influe sur la coagulation ;
le pH du milieu est prépondérant sur la coagulation et sur la dose de
réactif ;
L’hydrolyse, donc l’efficacité, du sulfate d’alumine est maximale si le pH est
voisin de 6,1 et l’élimination des matières organiques est maximale entre
6,0 et 7,0 de Ph. Le Ph sera donc compris dans ces limites. Cependant, le
sulfate d’alumine est un sel d’acide fort et provoque un abaissement du
pH, ce qui peut amener une eau à devenir agressive.
Il est effectué une correction de pH (ou ajustement de pH) avant le traitement
de façon à ajuster le pH de floculation à sa valeur optimale et dans l’eau traitée pour
obtenir le pH d’équilibre.
L’ajustement du pH se fait :
* avec du lait de chaux
b. Floculation :
Elle est favorisée par la mise en contact de l’eau avec le maximum de flocs déjà
formés par le traitement antérieur. C’est la technique du lit de boues. Elle est de plus
améliorée par l’ajout de produit appelé adjuvant de floculation, tel que : les floculants
synthétiques ou poly électrolytes.
3. DECANTATION :
La décantation a pour but de transmettre le dépôt des particules en suspension dans
l’eau, sous l’influence de la pesanteur, afin d’améliorer la qualité de l’eau.
Pour que cette décantation ait lieu, il faut que la vitesse de chute des particules soit
supérieure à la vitesse ascensionnelle VA de l’eau dans l’appareil :
(VA = débit horaire m3/h )
Surface m2
Ces particules existent dans l’eau brute et sont rassemblées en flocons plus gros (et
donc plus lourds) par l’adjonction de réactifs chimiques lors de la floculation.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (12 /138)
(Version Février 2010)
4. FILTRATION PAR SABLE :
La filtration a pour but de retenir les particules en suspension dans l’eau brute, soit
que ces particules existent dans l’eau brute, soit qu’elles aient été formées par une
coagulation préalable.
La rétention des matières solides contenues dans l’eau provoque une obstruction
progressive des interstices existant entre les éléments constitutifs de la matière
filtrante. Ce phénomène est désigné sous le nom de « colmatage du filtre ».
A mesure que ce colmatage se produit, les pertes de charge subies par le courant
d’eau traversant les filtres s’accroissent.
La rapidité du colmatage dépend :
- de la nature des eaux traitées, elle est d’autant plus rapide que les eaux
sont plus chargées
- du débit par unité de surface filtrante ou vitesse de filtration, elle s’accroît
avec cette vitesse,
- de la granulométrie de la matière filtrante, elle est d’autant plus rapide que
la granulométrie est plus faible.
5. NEUTRALISATION AU pH D’EQUILIBRE :
A une concentration donnée de bicarbonate de calcium et de magnésium correspond
une concentration d’acide carbonique libre qui est la quantité nécessaire d’acide
carbonique pour que les bicarbonates ne se découpent pas en laissant précipiter les
carbonates correspondants.
Cette quantité nécessaire d’acide carbonique est désignée sous le nom « d’acide
carbonique équilibrant ».
Si l’eau contient une quantité d’acide carbonique supérieure à la dose d’acide
équilibrant, son excès par rapport à cette dose constitue « l’acide carbonique
agressif ».
La quantité de CO2 semi – combiné (HCO3 des bicarbonates) est égale à celle du
CO2lié.
Les eaux qui contiennent du CO 2 agressif attaquent le calcaire en solubilisant les
carbones sous forme de bicarbonates, elles sont donc, à fortiori incapables de
provoquer la formation d’une couche carbonatée protectrice sur les surfaces avec
lesquelles elles sont en contact.
Au contraire les eaux qui contiennent une quantité de CO 2 libre inférieure à la
quantité théorique de CO2 équilibrant, précipitent du calcaire. Elles sont incrustantes.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (13 /138)
(Version Février 2010)
Le pH dépend du rapport :
CO 2libres
CO 2 desbicarbonates
En conséquence, à chaque valeur de l’alcalinité correspond un pH dit « pH
d’équilibre ». Lorsque le pH d’une eau est inférieur au pH d’équilibre, elle doit être
considérée comme agressive.
La mesure de l’agressivité s’effectue par la mesure du pH et du TAC après un temps
de contact avec le marbre : test « au marbre ». Egalement exploitation du
diagramme d’H et D
La neutralisation peut s’effectuer par différents procédés, en particulier pour cette
installation : dosage d’eau de chaux saturée pour obtenir le Ph d’équilibre égal à
celui de l’essai au marbre.
6. DESINFECTION
La plupart des eaux, qu’elles aient subi ou non un traitement préalable et, même si
elles sont parfaitement limpides, se trouvent souvent contaminées par des microbes
dangereux pour l’organisme humain.
Le chlore, par sa grande efficacité à l’état de traces, et par sa facilité d’emploi, est le
réactif le plus utilisé pour assurer la désinfection de l’eau.
L’action microbicide, à faible dose, s’explique par la destruction des diastases
indispensables à la vie des germes microbiens.
En outre le chlore est doué d’un pouvoir oxydant important, favorable à la destruction
des matières organiques.
On introduit dans l’eau une dose de chlore légèrement supérieure au « test », si la
température est inférieure à 10° et, légèrement inférieure au « test » si la
température est supérieure à 15°.
Le chlore est pour cette installation, injecté sous forme d’hypochlorite de calcium.
Afin de limiter la formation de trihalométhanes, il est prévu l’injection de sulfate
d’ammonium (proportion d’environ 1 ppm de NM 4 pour 4 ppm de chlore libre) pour
former des chloramines et donner à l’eau un pouvoir de désinfection rémanent.
V. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS DE TRAITEMENT
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (14 /138)
(Version Février 2010)
L’application des principes des traitements nécessaires est réalisée pour cette
installation par les appareils de traitements suivants :
- dégrillage : automatique ;
- coagulation – floculation : le mélangeur rapide ;
- coagulation – floculation : le PULSATOR ;
- filtration : le filtre AQUAZUR V ;
- filtration : le régulateur hydraulique ;
- neutralisation au pH d’équilibre : le saturateur à turbine.
a. DEGRILLAGE – LE DEGRILLEUR AUTOMATIQUE
Le dégrilleur automatique mis en place dans la prise d’eau brute est constitué des
éléments suivants :
- une grille fixe verticale dont l’entrefer est de 20mm.
- Une poche râteau animée d’un mouvement alternatif.
à la descente, elle est maintenue écartée de la grille à une distance
de 800 mm.
Arrivée en position basse, la poche râteau bascule et remonte le
long des grilles
En fin de course haute, un éjecteur hydraulique provoque
l’évacuation des refus dans un caniveau.
- une chaîne d’entraînement de la poche râteau
- un dispositif hydraulique de commande d’ouverture et de fermeture de la
poche râteau.
- Un dispositif de détection des pertes de charges par bullage d’air.
Le dégrilleur automatique fonctionne lorsque l’on atteint une perte de charge
prédéterminée entre l’amont et l’aval de la grille ou par minuterie, si cette perte de
charge n’apparaît pas au bout d’un temps également prédéterminé.
b. COAGULATION – LE MELANGEUR RAPIDE
L’agitateur rapide à hélice mis en place dans une chambre de mélange spécialement
étudiée, crée un gradient de vitesse important qui permet la diffusion instantanée du
coagulant.
c. FLOCULATION – DECANTATION – « LE PULSATOR »
Le PULSATOR est un décanteur à lit de boues, composé d’une cuve à fond plat,
comportant un réseau de ramifications perforées avec des tranquilisateurs. La
hauteur du lit de boue est limitée par son déversement dans les concentrateurs, à
mi-hauteur de la cuve. L’eau est recueillie à la partie supérieure par les goulottes de
collecte d’eau décantée.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (15 /138)
(Version Février 2010)
L’eau brute additionnée du réactif de coagulation (réactif dont les doses ont été
déterminées au laboratoire par l’essai de floculation), arrive d’abord dans la partie
haute de la cloche à vide. Cette cloche située au-dessus du plan d’eau du décanteur,
est équipée d’un ventilateur fonctionnant en pompe à vide et d’une vanne à clapet de
mise à l’atmosphère, commandée par un contacteur à flotteur. Elle permet
d’introduire par pulsations, au travers des ramifications inférieures, l’eau brute
floculée.
Ce courant d’eau pulsée, traversant le lit de boues en bas en haut, le maintient en
expansion homogène.
Pendant le temps d’aspiration, la vanne type à clapet étant fermée, seule une
fraction du débit passe dans le décanteur, l’autre s’élevant (de 60 à 80 cm suivant le
réglage fait à la mise en route, et en 20 à 40 secondes) dans la partie supérieure de
la cloche : le lit de boues se tasse, les flocons se resserrent entre eux. Ce temps
d’aspiration est réglé par la vanne manuelle en amont du ventilateur.
Pendant le temps de chasse, la vanne à clapet est ouverte par le contacteur à
flotteur, et le débit d’eau brute floculée est augmenté du débit de vidange de la
tranche d’eau aspirée préalablement dans la cloche : le lit de boues s’expansé. Le
temps de chasse (5 à 15 secondes) est réglé par une vanne manuelle placée en aval
de la vanne automatique de mise à l’atmosphère.
L’action du lit de boues homogène sur l’eau brute chargée de flocs en formation a
deux effets :
- d’une part, formation complète et rapide du floc par le contact intime avec
les boues déjà formées,
- d’autre part, filtration de ce floc, l’eau décantée étant recueillie à la partie
supérieure du décanteur dans les goulottes.
L’apport de nouvelles boues floculées tend à augmenter le volume du lit de boues
qui se déverse dabs les concentrateurs.
C’est à partir de ces concentrateurs que l’on effectue les extractions de boues d’une
manière intermittente.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (16 /138)
(Version Février 2010)
VI. FILTRATION : LE FILTRE AQUAZUR « V »
1. Caractéristiques :
Le filtre AQUAZUR « V » est essentiellement caractérisé par :
- un lit filtrant de granulométrie homogène et qui reste homogène après
lavage ;
- un lavage par retour simultané d’air et d’eau accompagné d’un balayage
de surface, suivi d’un rinçage au même débit, sans mise en expansion du
lit filtrant, et toujours avec balayage de surface ;
- une grande hauteur d’eau au-dessus du lit filtrant (1,2m).
2. Description :
Le filtre AQUAZUR « V » est constitué :
- d’une cuve en béton séparée en deux parties par un plancher de dalles en
béton de faible épaisseur dans lequel sont vissées des buselures à longue
queue D 20 (50 au m2) ;
- d’une distribution d’air de lavage assurée par un canal en béton situé sous
la goulotte de lavage répartissant l’air sous le plancher ;
- des équipements suivants :
diaphragme et déversoir à partir de la goulotte d’eau à filtrer
permettant l’équirépartition du débit total d’eau à filtrer entre tous les
filtres ;
vannes de sortie d’eau filtrée, d’entrée d’air de lavage, d’entrée
d’eau de lavage, d’évacuation des eaux de lavage ;
d’une goulotte de récupération des eaux de lavage : déversoirs à
0,50 m au-dessus du lit filtrant ;
d’une goulotte en « V » percée de nombreux orifices permettant
d’obtenir le balayage de surface à partir de la goulotte d’arrivée
d’eau à filtrer, pendant le lavage du filtre.
- d’une régulation de niveau assurée par un siphon partialisé commandé par
une boîte de partialisation à flotteur maintenant un niveau constant au-
dessus du sable (1,20 m) ;
- d’un indicateur d’encrassement.
3. Fonctionnement :
L’eau à filtrer à la sortie du déversoir pénètre dans le filtre par l’orifice situé à
l’extrémité de la goulotte en « V ». Elle traverse le lit filtrant.
L’eau filtrée passe à travers les buselures du plancher pour être reprise sous le
plancher, par la tubulure de sortie d’eau filtrée et acheminée par le siphon vers la
citerne d’eau filtrée.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (17 /138)
(Version Février 2010)
4. Lavage :
A encrassement déterminé, il est nécessaire de procéder au lavage du filtre.
Les caractéristiques de lavage sont les suivants :
- débit d’air de lavage : 50Nm3/h par m2 ;
- débit d’eau de lavage : 13 à 15 m3/h/m2 ;
- débit d’eau de balayage : 7 m3/h/m2 ;
La durée de la séquence de soufflage par retour d’air et d’eau avec courant de
balayage est de 4 à 5 mo. La durée de la séquence de rinçage par retour d’eau avec
courant de balayage est 3 à 4 m, c’est-à-dire jusqu’au moment où l’eau évacuée est
propre.
5. FILTRATION : le régulateur hydraulique
Le niveau de l’eau sur les filtres est fixe ou varie peu : l’eau filtrée est restituée 2 à 3
mètres plus bas, à un débit constant et égal au débit total entrant, divisé par le
nombre de filtres.
Le maintien de ce débit constant, quelque soit le degré d’encrassement des filtres,
est assuré par un régulateur placé à la sortie de chacun d’eux.
Cet organe crée une perte de charge auxiliaire importante lorsque le filtre est propre
et qui s’annule quand le filtre est totalement colmaté : le régulateur compense le
colmatage du lit filtrant.
Le siphon concentre DEGREMONT et sa boîte de partialisation permettent de
réaliser une régulation de niveau dont la boîte de partialisation est l’organe de
détection et de commande et le siphon l’organe régleur.
6. Siphon :
Il est constitué de deux tubes concentriques, l’écoulement s’effectuant de la branche
intérieure vers la branche extérieure.
Si l’on introduit de l’air à la partie supérieure, cet air est entraîné par l’eau dans la
branche aval où la densité du mélange eau-air s’abaisse diminuant ainsi le vide au
col. Sans air de partialisation le vide au col est égal à la hauteur « H » de chute entre
le plan d’eau sur le filtre et la plan d’eau dans la vasque aval de restitution. Avec la
partialisation par de l’air, ce vide est réduit à la hauteur « hl » égal au produit de « h »
par la densité du mélange eau-air.
La différence « h » - hl – h2 représente la perte de charge ainsi créée par l’apport
d’air (cf. schéma).
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (18 /138)
(Version Février 2010)
Si « hl » représente la perte de charge, filtre propre, dû au passage du débit à filtrer à
travers le lit filtrant, le plancher est la tuyauterie d’évacuation d’eau filtrée jusqu'au col
du siphon, « h2 » représente la hauteur de colmatage disponible pour le lit filtrant.
Il suffit donc d’introduire, filtre propre, une quantité d’air suffisante pour créer cette
perte de charge « h2 » et, au fur et à mesure que le lit filtrant va s’encrasser, il suffira
de réduire le débit d’air jusqu’à l’annuler pour faire passer « hl » à « H ».
7. Boîte de partialisation :
C’est l’organe qui introduit l’air au sommet du siphon pour en régler le débit. Cette
boîte comporte un clapet (relié à un ressort « D »), lui-même relié (point « F ») à un
flotteur.
a. A débit constant :
Le flotteur est immobile cas le niveau est constant dans le filtre. Le point « F » est
donc fixe. Le filtre s’encrasse peu à peu : son débit décroît ce qui entraîne une
diminution de la densité du mélange eau-air donc du vide « hl » au col ainsi que dans
l’enceinte de la boîte de partialisation : la section et le débit d’air sont alors réduit
sous l’action du ressort : la densité du mélangeur eau-air augmente, fournissant une
hauteur « hl » supérieur à celle qui existait avant encrassement.
Quand le filtre est complètement encrassé, il ne pénètre plus du tout d’air : le filtre
débite sous sa chute géométrique maximale. Si on ne lave le filtre à ce moment sont
débit commence à diminuer. Cette boîte permet donc la compensation automatique
du colmatage.
b. A débit variable :
Elle permet d’adapter le débit du filtre au débit d’eau à filtrer. Une augmentation du
débit correspond à une élévation du point « F » et à la diminution de la quantité d’air
qui va vers le siphon. La perte de charge « hl » diminue, entraînant l’augmentation
du débit évacué par le siphon.
8. Vacuomètre – indicateur de perte de charge :
Si l’on place un vacuomètre au col du siphon, on mesure le vide « hl » qui représente
la perte de charge à travers le filtre et ses tuyauteries.
9. Neutralisation : le saturateur à turbine
L’eau de chaux saturée nécessaire pour la neutralisation au pH d’équilibre est
produite par un saturateur à turbine alimentée lait de chaux et eau de dilution.
Description du saturateur :
Il est composé de :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (19 /138)
(Version Février 2010)
- une cuve de saturation cylindro-conique ;
- une tuyère de recyclage de chaux et boues ;
- une turbine à vitesse réglable à la partie supérieurs de a tuyère ;
- une jupe entourant la tuyère, dans laquelle se termine la saturation de l’eau
de chaux ;
- une admission de lait de chaux au tiers supérieur de la tuyère ;
- une admission d’eau à saturer à mi-hauteur de la tuyère, réglable par
débimètre ;
- un concentrateur des boues provenant du lait de chaux ;
- une extraction automatique des boues ;
- une vidange générale ;
- une goulotte de reprise en surface de l’eau de chaux saturée ;
- une préparation de lait de chaux en continu ou en discontinu.
10. Fonctionnement :
Le lait de chaux est injecté dans la tuyère de recyclage et l’eau à saturer au tiers
supérieur de la tuyère.
La turbine aspirante effectue le mélange intime de l’eau, du lait de chaux et dans
boues de carbonate ré-aspirées à la base de la tuyère. La séparation de l’eau de
chaux saturée et des boues s’effectue par décantation à la base de la jupe entourant
la tuyère.
Le saturateur fonctionne avec un lit de chaux et de boues dont le niveau est réglé par
le seuil du concentrateur où se déversent les boues.
L’extraction de ces derniers s’effectue par les purges automatiques commandées par
la minuterie réglable.
Le débit d’eau de chaux est réglé par lecture du débitmètre d’eau à saturer.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (20 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 2
DIMENSIONNEMENT ET CARACTERISTIQUES
PRINCIPALES
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (21 /138)
(Version Février 2010)
A. DEGRILLAGE AUTOMATIQUE (Rep. S1/S2)
- nombre…………………………… 2
- type………………………………. Amc _àà m
- fournisseur……………………….. EGA
Dimensions
- longueur utile…………………….. 10 m
- largeur……………………………. 2m
- espacement entre barreaux………… 20 m
avec détection de niveau par bullage :
- nombre …………………………... 2
- fournisseur……………………….. EGA
- type………………………………. CE. 800 X (AL)
- pertes de charges admissibles……. 0 à 400 mm
avec moteur frein, tremillage :
- nombre…………………………… 2
- fournisseur……………………….. CEM
- puissance…………………………. 4 KW
- alimentation………………………. 380 V triphasé
Avec moteur centrale hydraulique poche râteau :
- nombre…………………………….. 2
- fournisseur…………………………. LEROY SOMER
- puissance…………………………… 2,2 kw
- alimentation………………………… 380 V triphasé
B. POMPAGE D’EAU BRUTE
- groupe électropompe (Rep. P1 a/b, P2 a/b)
nombre……………………….. 4
fournisseur…………………… BERGERON
type………………………….. FR. 78 800 83
débit nominal………………… 1 460 m3/h
hauteur manométrique totale…. 41,5 m
- avec moteur :
fournisseur……………………. JEUMONT SCHNIDER
type…………………………… PNCB 355 M6 VI
puissance……………………… 250 kw
alimentation……………………… 4 KV-50 Hz-triphasé
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (22 /138)
(Version Février 2010)
vitesse de rotation……………….. 980 rpm
- détecteur de niveau (Rep. CNB1,CNB2, ANBI a.b) :
nombre…………………………… 4
fournisseur……………………….. FLYGT
type……………………………….. ENH 10 ou équivalent
- dispositif antibelier (Rep. RI) :
réservoir vertical :
volume………………………… 12 000l
diamètre………………………. 2m
hauteur cylindrique…………… 4m
pression service………………. 6 bars
pression d’épreuve……………. 9 bars
compresseur d’air :
fournisseur……………………… CREYSSENSAC
type……………………………… CL 50 A
débit……………………………… 40 m3/h
pression………………………….. 7 à 9 bars
- équipement :
- vanne normale manuelle (Rep. V 15)
fournisseur…………………… RAMUS
type…………………………… VMR II
dimension……………………..1 500 x 500 mm
- groupe électropompe des séparateurs (Rep. P3 a/b) :
nombre……………………….. 2
fournisseur…………………… FLYGT
type…………………………… CNM 40 – 250
débit nominal…………………. 19 m3/h
hauteur manométrique totale….. 19 unités.
- avec moteur :
fournisseur…………………….. BBC
type…………………………….
puissance……………………… 2,2 kw
alimentation…………………… 380 V-50 Hz triphasé
vitesse de rotation……………… 1450 rpm
- séparateurs d’eau brute pour arrosage des paliers de pompe d’eau brute :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (23 /138)
(Version Février 2010)
fournisseur…………………………. LAKOS
type………………………………… Macromate mod M 2002 W
débit………………………………... 20 à 30 m3/h
pertes de charge……………………..3,5 m de CE
C. OUVRAGE D’ARRIVEE D’EAU BRUTE ET DE REPARATION
- Dimension unitaires :
longueur………………………….. 2,65 m
largeur…………………………….. 2,65 m
hauteur……………………………. 2,37 m
volume…………………………….. 20 m3
- Hélico-mélangeurs (Rép. A1 et A2) :
nombre…………………………….. 2
fournisseur………………………….. DOSAPRO
type…………………………………... ARO 920
diamètre hélice……………………….1000 mm
matériau……………………………… acier revêtu époxy
vitesse de rotation…………………… 28 à 109,4 rpm
débit de l’hélice……………………… 3100 m3/h
- avec moteur :
fournisseur…………………………… SEM
type…………………………………… DT 132 Ml 4
puissance……………………………… 9,2 KW
vitesse de rotation…………………….. 1500 rpm
alimentation……………………………Tri 220/3380 V – 50 Hz
variateur de vitesse……………………. SEW type VZ4
D. DECANTEUR PULSATOR
nombre………………………………… 4
- Dimension unitaires
longueur……………………………….. 25 m H : 4,55
largeur…………………………………. 23,4 m
superficie totale………………………… 585 m2
- Ventilateur (Rep. C2 a/b/c)
Nombre…………………………….. 1
fournisseur…………………………… SOLYVENT VENTEC
type……………………………………. HD 72 CRI
débit……………………………………. 1000 m3/h
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (24 /138)
(Version Février 2010)
- avec moteur :
fournisseur…………………………….. CEM
type……………………………………. MEPP 160 MS2
puissance……………………………… 11 KW
alimentation…………………………… 380 V – 50 Hz
vitesse de rotation……………………… 2900 RPM
- électrovanne de mise à l’atmosphère (Rep. EV5 a/b/c) :
nombre…………………………………. 2
fournisseur……………………………… JOUVENEL ET
CORDIER
type……………………………………... V 401 U4
- interrupteur à flotteur :
nombre …………………………………. 1
fournisseur………………………………. TELEMATIQUE
type…………………………………….. XLI AB 12
- dispositif d’extraction des boues :
- vanne automatique d’extraction (Rep. V 21 a/b/c) :
nombre………………………………. 1
fournisseur…………………………… MIROUX
type…………………………………… AA
diamètre de l’orifice………………….. 200 mm
fluide de commande…………………... air
- électrovanne de commande pour vanne d’extraction (Rep. EV6 a/b/c) :
nombre………………………………… 1
fournisseur…………………………….. JOUVENEL ET CORDIER
type…………………………………….. V 401 U4
- minuteries :
Nombre………………………………….. 1
Fournisseur……………………………… DEGREMONT
alimentation……………………………… 220 V – 50 Hz
et les tuyauteries nécessaires d’arrivée d’eau, de répartition, de
sortie d’eau clarifiée et de vidange.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (25 /138)
(Version Février 2010)
E. FILTRES
type……………………………………. AQUAZUR V
nombre………………………………… 6
- Dimension unitaires
longueur………………………………. 11 m
largeur…………………………………. 7m
surface …………………………………. 77 m2
- Equipements unitaires
- matière filtrantes :
Couche support :
type……………………………………. Gravier 4 à 8 mm
hauteur…………………………………. 0,05 m environ
volume………………………………….. 23 m3 (valeurs pour 6
filtres (et non unitaires)
Sable :
type……………………………………… sable TEN 0,95 mm
hauteur…………………………………... 1,15 m environ
volume……………………………………532 m3 (valeurs pour 6 filtres
( et non unitaires)
Plancher filtrant équipé de bosselures :
fournisseur…………………………….. DEGREMONT
type…………………………………….. D 20
nombre de buselures…………………… 4158 (valeurs pour 6
filtres (et non unitaires)
Siphon :
fournisseur………………………………NEYRPIC–DEGREMONT
type……………………………………… DE 40
Indicateur de colmatage :
fournisseur……………………………….. AIRINDEX
type………………………………………. A 54 VL 6
graduation………………………………… 0 à 2,5 Mce
Equipments communs:
- groupe électropompe de lavage (Rep. P4 a/b) :
nombre…………………………………….. 2
fournisseur………………………………… KSB
type………………………………………… ETA 300-35
débit………………………………………… 1080 m3/h
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (26 /138)
(Version Février 2010)
hauteur manométrique totale……………….. 8,5 Mce
- avec moteur :
fournisseur………………………………….. BBC
type………………………………………….. MEPP 225 MR 6
puissance…………………………………….. 37 KW
alimentation………………………………….. 380 V – 50 Hz
vitesse de rotation……………………………. 950 rpm
- détecteur de niveau (Rep. ANH 5 ANB 5) :
nombre………………………………………… 2
fournisseur…………………………………….. FLIGT
type…………………………………………….. ENH 10
- suppresseur d’air de lavage (Rep. C4 a/b) :
nombre………………………………………….. 2
fournisseur……………………………………… HIBON
type…………………………………………….. ROOTS
débit…………………………………………….. 4400 Nm3/h
pression………………………………………… 350 mbars
- avec moteur :
fournisseur……………………………………… CEM
type……………………………………………... MOPQ 250 S4
puissance……………………………………….. 75 KW
alimentation…………………………………….. 380/220 V – 50 Hz
vitesse de rotation………………………………. 1500 rpm
- avec silencieux :
fournisseur……………………………………… HIBON
type…………………………………………….. AE 250
- avec soupape de sûreté :
fournisseur…………………………….. HIBON
type……………………………………. AMP 200
pression de tarage……………………… 400 mbar
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (27 /138)
(Version Février 2010)
F. POSTES DES REACTIFS
1. Poste de dosage de sulfate d’alumine
- bac de préparation :
nombre…………………………………. 2
dimensions……………………………… 3,0 x 3,0 m
hauteur………………………………….. 4,0 m
matériau…………………………………. Béton
capacité………………………………….. 36 m3
- électro-agitateur (Rep. A3 a/b)
nombre………………………………….. 2
fournisseur……………………………… DOSAPRO
type……………………………………… HM 1200
matériau……………….. ………………. acier inoxydable
longueur………………………………… 1200 mm
puissance………………………………... 2,2 KW
alimentation…………………………….. 380/220 V –tri
- groupe électropompe (Rep. P. 13 a/b :C)
nombre………………………………….. 3
fournisseur……………………………… DOSAPRO
type…………………………………MMRC/1/9/E90/112/PA/5 (7) 5
débit.......................................................... 3000 l
doseur........................................................ PVC
puissance………………………………… 3 KW
alimentation………………………………380/220 V – 50 Hz
- Trémie vide sac :
nombre………………………………….. 2
fournisseur…………………………….. EDM
matériau grille…………………………. Acier inox
Equipé de :
- un filtre dépoussiéreur :
surface…………………………….. 4,5 m2
- un vibrateur :
puissance…………………………… 90 W
- une turbine d’aspiration :
puissance…………………………… 1,1 KW
2. POSTE DE DOSAGE D’HYPOCHLORITE DE CALCIUM
- bac de préparation :
nombre………………………………. 2
dimensions……………………………3,0 x 3,0 m
hauteur……………………………….. 4,0 m
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (28 /138)
(Version Février 2010)
matériau………………………………. Béton armé
capacité……………………………….. 36 m3
- électro-agitateur :
nombre………………………………… 2
fournisseur…………………………….. DOSAPRO
type……………………………………. HM 1200
arbre hélice :
o matériau……………………….acier recouvert ébonite
o longueur………………………… 1200 mm
puissance……………………………….. 1,5 KW
alimentation…………………………….. 380/220 V – 50 Hz
- groupe électropompe doseuse (Rep. P 18 a/b/c) :
nombre………………………………….. 2
fournisseur……………………………… DOSAPRO
type…………………………MMRC/1/9/E90/112/PA/5(7) 5
débit......................................................... 3144 1/h
doseur....................................................... PVC
puissance………………………………… 2,8 KW
alimentation…………………………….. 220/380 V –50 Hz
- trémie vide sacs :
nombre……………………………… 2
fournisseur………………………….. EDM
matériau grille…………………Acier revêtu époxy (pas fait)
3. Poste de dosage de polyélectrolyte
- bac de préparation :
nombre……………………………. 2
dimensions………………………… 2,60 x 2,60 m
hauteur…………………………….. 2,60 m
matériau……………………………. Béton armé
capacité…………………………….. 15 m3
- disperseur :
nombre……………………………… 2
fournisseur………………………….. STS
matériau…………………………….. acier inox
- électro-agitateur (Rep. A6 a/b)
nombre………………………………. 2
fournisseur…………………………… DOSAPRO
type…………………………………… HM 850
arbre hélice :
o matériau……….. Acier inox
o longueur……….. 850 mm
puissance……………………………… 1,5 KW
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (29 /138)
(Version Février 2010)
alimentation…………………………… 380/220 V – 59 Hz
- groupe électropompe doseuse (Rep. P 21 a/b/C)
nombre………………………………… 2
fournisseur…………………………….. DOSAPRO
type…………………… PMRB/1/7/E90/SM/5/N/7/V
débit......................................................... 1200 1/h
doseur..................................................... inox
puissance................................................ 1,1 KW
alimentation............................................ 380/220 V – 50 Hz
- bac de partage :
nombre…………………………………. 1
fournisseur……………………………… STRADA
matériau………………………………… PVC
- trémie vide sacs :
nombre………………………………… 1
fournisseur…………………………….. EDM
matériau………………………………… acier inox
Equipé de :
- un couloir vibrant :
puissance……………………………… 0,5 KW
- un volet de réglage du débit.
4. POSTE DE DOSAGE DE CHAUX
- Bac de préparation :
nombre………………………….. 2
dimension……………………….. 4,0 x 4,0 m
hauteur…………………………… 4m
matériau………………………….. béton armé
capacité…………………………... 64 m3
- électro-agitateur (Rep. A4 a/b) :
nombre……………………………. 2
fournisseur………………………… DOSAPRO
type………………………………... HM 1600
arbre hélice :
_ Matériau…………………… acier au carbone
_ Longueur………………………. 1600 mm
puissance…………………………… 5,5 KW
alimentation………………………… tri 380/220 V – 50 Hz
- groupe électropompe doseuse (Rep. P 14 a/b) :
nombre………………………………. 3
fournisseur…………………………… DOSAPRO
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (30 /138)
(Version Février 2010)
type……………………………… MMRC/1/9/112/SM/5 (7) 2
débit………………………………….. 3144
doseur…………………………… acier inox
puissance………………………… 3 KW
alimentation……………………… 380/220 V – 50 Hz tri
- groupe électropompe doseuse alimentation saturateur (Rep. P 15 a/b) :
nombre…………………………. 3
fournisseur……………………… DOSAPRO
type……………………………MMRB/1/6/E90/72/SM/5 (7) 2
débit............................................... 1000 1/h
doseur............................................. acier inox
puissance........................................ 1,1 KW
alimentation.................................... 380/220 V – 50 Hz tri
trémie vide sacs :
nombre…………………………… 2
fournisseur………………………… EDM
matériau grille……………………… acier revêtu
Comprenant :
- un filtre dépoussiéreur :
surface……………………………… 4,5 m2
- un vibrateur :
puissance……………………………. 90 W
- une turbine d’aspiration :
puissance……………………………..1,1 KW
- SATURATEUR DE CHAUX
nombre………………………………. 2
type………………………………….. DEGREMONT
Dimension unitaires
o diamètre……………………………… 4,50 m
o surface……………………………….. 16 m2
- Equipements unitaires
- vanne de régulation d’alimentation en eau du saturateur :
(Rep. EV 24 a/b ET (A : B)
fournisseur…………………………. DOSAPRO
type…………………………………. PIC
diamètre……………………………… 65 mm
construction…………………………. Fonte
- une turbine de recyclage des boues (Rep. A/b) :
fournisseur………………………….. DOSAPRO
type………………………………….. HM 300
débit à l’hélice………………………… 396 m3/h
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (31 /138)
(Version Février 2010)
vitesse de rotation…………………….. 68 à 286 rpm
- avec moteur :
fournisseur……………………………. SEM
type…………………………………… DT 80 M4
puissance ……………………………… 0,75 KW
alimentation…………………………… Tri 380/220 V –50 Hz
- un débitmètre pour eau de dilution :
fournisseur…………………………….. SART
type……………………………………. PK 13
graduation……………………………… 4 à 40 m3/h
- dispositif d’extraction des boues :
- vanne automatique d’extraction (Rep. V 93 a/b, V 98 a/b) :
nombre…………………………………. 3
fournisseur……………………………… DOSAPRO
type……………………………………… PIC
diamètre…………………………………. 65 mm
fluide moteur……………………………. Eau
pression de service………………………. 2,5 bars
- électro - vanne de commande pour vanne d’extraction :
nombre……………………………… 3
fournisseur………………………JOUVENEL ET CORDIER
type………………………………….. V 301 U 6
fluide de moteur……………………… eau
pression de service…………………… 2,5 bars
tension d’alimentation…………………. 220 V – 50 Hz
- Alimentation en eau des saturateurs :
- groupe électropompe d’alimentation (Rep. P5 a/b/c° /
nombre…………………………………. 3
fournisseur……………………………… KSB
type……………………………………… 65 –315
débit nominal……………………………. 40 m3/h
hauteur manométrique totale………. ….. 27,5 m
- bac de partage eau de chaux :
nombre……………………………. 1
fournisseur………………………… STRADA
matériau……………………………. PVC
5. POSTE DE DOSAGE DE SULFATE D’AMMONIUM
- Bac de préparation :
nombre……………………………. 2
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (32 /138)
(Version Février 2010)
dimensions………………………… 162
hauteur…………………………….. 1 ,0 m
matériau……………………………. PVC
capacité…………………………….. 2 000 1
- Electro-agitateur (Rep. A7 a/b) :
nombre……………………………. 2
fournisseur………………………… DOSAPRO
type………………………………... VDB 1322
arbre hélice :
− Matériau……………acier inoxydable
− Longueur……………1405 mm
puissance………………………….. 0,75 KW
alimentation…………………………tri 380/220 V – 50 Hz
- groupe électropompe doseuse (Rep. P 22 a/b/c) :
nombre…………………………….. 3
fournisseur…………………………. DOSAPRO
type…………………………………. Mroy B 56 FR 162
débit………………………………… 120 1/h
doseur………………………………. Polyéthylène
puissance……………………………..0,55 KW
alimentation………………………….. 380/220 V – 50 Hz
- Bac de partage :
nombre………………………………… 1
fournisseur…………………………….. STRADA
matériau……………………………….. PVC
6. POSTE DE DOSAGE DE SULFATE DE CUIVRE
- Bac de préparation :
nombre………………………………… 2
dimensions…………………………….. 1,0 m
hauteur…………………………………. 1m
matériau………………………………… PVC
capacité…………………………………. 1 000 l
- Electro-agitateur (Re ; A8 a/b) :
nombre…………………………………. 2
fournisseur……………………………… DOSAPRO
type……………………………………… VDB 1321
arbre hélice :
* matériau………………… acier inox
* longueur………………… 930 mm
puissance……………………………….. 0,37 KW
alimentation…………………………tri 380/220 V – 50 Hz
- Groupe électropompe doseuse (Rep. P 23 a/b/c) :
nombre………………………………….. 3
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (33 /138)
(Version Février 2010)
fournisseur………………………………. DOSAPRO
type……………………………………… mRoY A 112 FR 132
débit……………………………………. 66 l/h
doseur…………………………………… polyéthylène
puissance……………………………….. 0,25 KW
alimentation…………………………….. 380/220 V – 50 Hz
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (34 /138)
(Version Février 2010)
G. POMPAGE D’EAU TRAITEE
1. POMPAGE D’EAU TRAITEE VERS YAOUNDE
- Groupe électropompe (Rep. P8 a/b et P9 a/b) :
nombre……………………………… 4
fournisseur………………………….. BERGERON
type…………………………………. MR 58
débit nominal……………………….. 1390 m3/h
hauteur manométrique totale……….. 121 m
- avec moteur :
fournisseur………………………….JEUMONT-Schneider
type………………………………….. HNCB 400 L4-VI
puissance……………………………. 650 KW
alimentation…………………………. 6 KV – Hz triphasé
vitesse de rotation…………………… 1 500 rpm
- détecteur de niveau (Rep. ANB 7 a/b) :
nombre……………………………….. 2
fournisseur……………………………. FLYGT
type…………………………………… ENH 10
- dispositif anti bélier :
- réservoir (Rep. R3 a/b) :
nombre……………………………….. 2
diamètre………………………………. 2 500 mm
volume………………………………… 37 500 l
pression de service……………………. 25 bars
pression d’épreuve……………………. 37,5 bars
- compresseur d’air (Rep. C5 a/b) :
nombre……………………………….. 2
fournisseur…………………………… CREYSSENSAC
type…………………………………… CV 110 B
débit………………………………….. 100 m3/h
pression……………………………… 12 bars
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (35 /138)
(Version Février 2010)
2. POMPAGE D’EAU TRAITEE VERS MBALMAYO
- Groupe électropompe (Rep. P10 a/b) :
nombre………………………………… 2
fournisseur…………………………….. CREYSSENSAC
type……………………………………. CV 110 B
débit…………………………………… 100 m3/h
pression………………………………… 12 bars
3. POMPAGE D’EAU TRAITEE VERS LE RESERVOIR DE LA STATION
- Groupe électropompe (Rep. P11 a/b) :
nombre………………………………… 2
fournisseur…………………………….. KSB
type……………………………………. ETANORM 80-400
débit nominal………………………… 120 m3/h
hauteur manométrique totale………… 12 bars
- avec moteur :
fournisseur…………………………. BBC
type………………………………….. MEPP 180 LR 4
puissance……………………………. 30 KW
alimentation…………………………. 380 V – 50 triphasé
vitesse de rotation……………………1 500 rpm
- détecteur de niveau (Rep. CNH 11, ANH 11, CNB 11, ANB 11) :
nombre……………………………….. 4
fournisseur……………………………. FLYGT
type…………………………………… ENH 10
- dispositif anti bélier :
Réservoir (Rep. R5) :
fournisseur……………………………….. CHARLATTE
volume………………………………… 500 l
pression de service……………………. 10 bars
pression d’épreuve……………………. 15 bars
Compresseur d’air (Rep. C5 a/b) :
nombre……………………………….. 2
fournisseur…………………………… CREYSSENSAC
type…………………………………… CV 110 B
débit………………………………….. 100 m3/h
pression……………………………… 12 bars
Il s’agit des mêmes compresseurs que ceux de la page 48 (il y en a donc 2 au total
en non 6).
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (36 /138)
(Version Février 2010)
4. BASSIN D’ORNEMENT
- Groupe électropompe (Rep. P 7) :
nombre………………………………… 1
fournisseur…………………………….. FLYGT
type……………………………………. CP 3127 LT 411
débit nominal………………………… 180 m3/h
hauteur manométrique totale………… 5,3 m
- avec moteur :
fournisseur…………………………. FLYGT
type…………………………………..
puissance……………………………. 4 ,7 KW
alimentation………………………220/380 V – 50 Hz triphasé
vitesse de rotation…………………… 1 500 rpm
- Régulateur de niveau :
nombre……………………………….. 1
fournisseur…………………………….FLYGT
type…………………………………… ENH LG 6
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (37 /138)
(Version Février 2010)
H. MESURES ET INSTRUMENTATION
1. MESURE DE PH
- Ph mètre sur l’eau brute (Rep. PH1)
nombre……………………………….. 1
fournisseur……………………………. POLYMETRON
type cellule……………………………… 8301 corps inox
type transmetteur……………………… 8960 M
échelle…………………………………. 2 à 12Ph
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
Équipé de :
une électrode de verre, type 8404 US,
une électrode de référence, type 360 USK 7.
- Ph mètre sur l’eau brute (Rep. PH2)
nombre……………………………….. 1
fournisseur……………………………. POLYMETRON
type cellule……………………………… 8340
type transmetteur……………………… 8960 M
échelle…………………………………. 2 à 12Ph
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
Équipé de :
une électrode de verre, type 8404 S,
une électrode de référence, type 8444 S.
- Enregistreur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… EUROPONT 2200 -2
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 0 à 10 Ph
2. MESURE DE TURBIDITE (Rep. TU.1, TU 2) :
- turbine sur l’eau floculée :
nombre……………………………….. 1
fournisseur……………………………. LEUNE
type …………………………………HACH–surface Scotter 5
échelle………………………………….0-0,1 à 0-5 000 NTU
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
- Enregistreur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………EUROPONT 2200 -2 voies
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (38 /138)
(Version Février 2010)
graduation……… 0 – 5000 NTU, 0-3 0 NTU
3. MESURE DE CHLORE RESIDUEL ET TOTAL (Rep. Cl)
- un analyseur de chlore
fournisseur………………………XALLACE ET TIERNAN
type ….……………………………… DEPOLOX 3
échelle…………………………….. 0 à 5 mg Cl2/l
débit échantillon…………………….. 35 l/h
- un enregistreur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………EUROPONT 2200 -2 voies
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 0 – 5 mg Cl2/l
4. MESURE DE NIVEAU POMPAGE EAU BRUTE
- Indicateur de niveau :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… NGV 1200
étendue mesurée…………………….. 0 à 10 ml
- Convertisseur transmetteur d’intensité :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… CTI
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
- Indicateur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… NE 96
graduation……………………………… 0 – 10 m
5. MESURES DE NIVEAU CHATEAU D’EAU
- Capacité de pression :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… 4901 A
étendue mesurée…………………….. 0 – 7,5 m
signal de sortie……………………… 4-20 Ma
alimentation………………………… 220 V – 50 Hz
6. MESURES DE NIVEAU DANS RESERVOIRS EAU TRAITEE
- Capacité de pression :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… 4901 A
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (39 /138)
(Version Février 2010)
étendue mesurée…………………….. 0 – 5,5 m
signal de sortie……………………… 4-20 ma
alimentation………………………… 220 V – 50 Hz
- un enregistreur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… EUROPONT 2100
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 0 – 5,5 m
7. MESURES DE DEBIT D’EAU BRUTE (Rep. MQ 1)
- Sonde à insertion :
nombre………………………………… 2
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… SU 35
diamètre tuyauterie……………………… 1400 mm
- Diamètre électronique à ultra – sons :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… MDU
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
débit maxi……………………………… 5250 m3/h
- Capteur intégrateur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… MID1
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
debit maxi……………………………… 5250 m3/h
- Compteur d’impulsion :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… CIE 1000
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 1 imp/100 m3
8. MESURES DE DEBIT EAU TRAITEE (Rep. MQ2)
- Sonde à insertion :
nombre………………………………… 2
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… SU 35
diamètre tuyauterie……………………… 1400 mm
- coffret électronique à ultra-sons :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… MDU
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (40 /138)
(Version Février 2010)
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
débit maxi……………………………… 5000 m3/h
- Capteur intégrateur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… MID 1
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
débit maxi……………………………… 5000 m3/h
- Capteur d’impulsions :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… CIE 1000
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 1 imp. /100 m3
- un enregistreur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… EUROPONT 2200
signal d’entrée……………………… 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
graduation……………………………… 0 – 5250 m3/h
(Eau brute) 0-5000 m3/h (eau traitée)
9. MESURES DE DEBIT EAU DE LAVAGE
- Capteur de pression (Rep. MQ 3)
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… 3441
signal sortie..…………………………. 4 – 20 mA
alimentation…………………………… 220 V – 50 Hz
- Indicateur :
fournisseur……………………………. FLUTEC
type ….……………………………… NE 96 C 90°
graduation……………………………… 0 à 1200 m3/h
- diaphragme :
fournisseur……………………………. FLUTEC
diamètre nominal……………………… 400 mm
pression différentielle………………… 25 Mce
débit…………………………………… 1100 m3/h
10. MESURES DE DEBIT EAU FILTREE (pour turbidimètre)
- un indicateur de débit :
fournisseur……………………………. MCV
type……………………………………. 785 (à ludion)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (41 /138)
(Version Février 2010)
étendue mesurée……………………… 12,5 à 125 l.l
débit nominal………………………….. 90 l/h
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (42 /138)
(Version Février 2010)
I. POSTE DE PRODUCTION D’AIR COMPRIME DE SERVICE
- Groupe électro compresseur d’air comprimé (Rep.) :
nombre………………………………… 2
fournisseur……………………………. CREYSSENSAC
type ….……………………………… CL 50 A
débit……………………………………… 40 m3/h
pression de fonctionnement………………… 7 à 9 bars
- avec moteur :
fournisseur……………………………. BBC
type……………………………………. MEUC 132 SR2
puissance……………………………… 2,2 KW
alimentation…………………………… 380/220 V –50 Hz
vitesse de rotation…………………….. 1290 rpm
- Système de régulation électrique comprenant :
contacteur manométrique d’asservissement du groupe :
enclenchement……………………… 7 bars
déclenchement……………………… 9 bars
- réservoir d’air comprimé :
volume…………………………….. 500 l
pression de service………………… 10 bars
- Equipements :
robinet ave manomètre
soupape de sécurité
robinet de purge.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (43 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 3
FONCTIONNEMENT DE LA STATION
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (44 /138)
(Version Février 2010)
A. FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE
1. PRISE D’EAU BRUTE
La prise d’eau brute située sur la rive droite de la rivière NYONG est divisée en deux
canaux équipés chacun de la façon suivante :
- des batardeaux permettant l’isolement des canaux manœuvrables par un
palan manuel ;
- un dégrilleur à nettoyage automatique par détection de pertes de charge
(Rep. S1 et S2). Les déchets sont évacués automatiquement à l’aide d’un
dispositif de chasse à l’eau dans un caniveau en béton.
- une vanne murale à commande manuelle afin d’isoler un dégrilleur, si
nécessaire (Rep. V15 et V16) ;
- une fosse de pompage d’eau brute.
2. POMPAGE D’EAU BRUTE
Chaque fosse de pompage est équipée de deux pompes d’eau brute (P1 a/b et P2
a/b) d’un débit unitaire de 1460 m3/h. En fonctionnement normal, trois pompes sont
en service et la dernière en secours.
Les paliers de ces pompes sont refroidis à l’eau brute à partir d’une alimentation
située sur la conduite de refoulement principale. Un dispositif anti-bélier assure la
protection du pompage d’eau brute.
3. OUVRAGE DE REPARTITION
L’eau arrive à la station dans un ouvrage permettant l’injection et le mélange des
réactifs de traitement, puis la répartition de l’eau à traiter vers les décanteurs. Il est
divisé en plusieurs compartiments assurant le mélange court des réactifs avec l’eau
brute.
Le sulfate de cuivre est injecté dans l’eau brute à l’entrée de cet ouvrage afin de
limiter la prolifération d’algues dans les ouvrages de traitement.
Le lait de chaux est injecté en amont du premier des deux mélangeurs rapides (A1 et
A2) équipant cet ouvrage.
Puis les réactifs de floculation sont injectés au niveau du second mélangeur rapide
pour le sulfate d’alumine et à la sortie de l’ouvrage pour le polyélectrolite.
Les réactifs sont injectés par pompes doseuses, un canal recueille l’eau et assure sa
répartition par surverse au moyen de déversoirs réglables vers les décanteurs.
4. DECANTATION
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (45 /138)
(Version Février 2010)
L’eau brute additionnée des réactifs de floculation atteint gravitairement la partie
haute de la cloche à vide du décanteur, puis est introduire dans les ramifications
inférieurs du Pulsator.
Elle traverse alors le lit de boues d bas en haut. Ce qui assure une filtration et une
floculation accrue de l’eau à traiter (voir paragraphe 1.5.3. : Le Pulsator).
L’eau décantée est recueillie à la partie supérieure par des goulottes de collecte afin
d’être envoyée en filtration.
Les boues en excès sont extraites au niveau des « concentrateurs du Pulsator par
l’intermédiaire des vannes automatiques, dont les cadences et durées d’ouvertures
sont réglables. Ces boues sont envoyées à l’égout.
5. FILTRATION
L’eau décantée est donc admise sur une batterie de six filtres à double cellules de
type Aquazur V, (voir paragraphe 1.5.4.). Elle est répartie sur les filtres de façon
gravitaire à l’aide de déversoirs réglable et d’orifices noyés. En fonctionnement
normal, cinq filtres sont en service et les derniers à l’arrêt ou en lavage.
Le débit d’eau traversant chaque filtre est contrôlé par un régulateur hydraulique
placé en sortie de chaque filtre (voir paragraphe 1.5.5).
Lorsque l’un des filtres est encrassé, le lavage à l’air et à l’eau est effectué à l’aide
de deux pompes (P4 a/b, l’une en service, l’autre en stand by) alimentées en eau
filtrée et de deux suppresseurs (C3 a/b, l’un en service, l’autre en stand by).
L’eau filtrée est admise dans la bâche d’eau filtrée à la sortie de laquelle est injectée
de l’hypochlorite de calcium à l’aide d’une pompe doseuse.
Cette bâche alimente également les pompes du saturateur à chaux (P5 a/b/c), utilisé
pour la préparation de l’eau de chaux (voir fonctionnement du saturateur à chaux,
paragraphe 1.5.6).
6. RESERVOIR D’EAU TRAITEE –DISTRIBUTION
Un réservoir de stockage d’une capacité de 8 300 m3 reçoit l’eau traitée. Celui-ci est
divisé en deux e parties égales ayant chacune deux compartiments, le premier
servant de bâche de contact pour la désinfection et le second de stockage. Il est
également injecté dans ce compartiment, le sulfate d’ammonium et l’eau de chaux
pour la neutralisation de l’eau traitée, et la formation de manochloramine.
Ces réactifs sont injectés gravitairement à partir de bâches de partage alimentées
par des pompes doseuses.
La capacité des bâches de contact d’eau traitée permet d’assurer un temps de séjour
de 15 minutes environ au débit nominal de la station.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (46 /138)
(Version Février 2010)
L’eau traitée est ensuite envoyée par pompage vers les réservoirs de Yaoundé
(pompes Réf. P8 a/b et P9 a/b), de Mbalmayo (pompe réf. .P10 a/b/c) et de château
d’eau de la station (pompe réf. P11 a/b).
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (47 /138)
(Version Février 2010)
B. FONCTIONNEMENT ELECTRIQUE
1. DEGRILLAGE AUTOMATIQUE
Description :
- Poche râteau et relevage du dégrilleur (S1/S2)
un commutateur auto/O/manu, en local ;
boutons –poussoirs marche/arrêt pour la poche râteau et pour le
relevage en local.
- Vanne automatique de chasse d’eau (VA 1)
un commutateur auto/o/manu commun aux dégrilleurs, est local ;
boutons-poussoirs marche/arrêt en local.
Fonctionnement :
En automatique le dégrilleur est mis en service par le détecteur de pertes de charges
(I Pdc CNI/CN2) ou par une minuterie, après temporisation, lorsque les pertes de
charges sont insuffisantes.
Le détecteur de pertes de charge comporte les seuils de fonctionnement suivant :
- 1er seuil : déclenchement du dégrilleur ;
- 2ème seuil : alarme. Arrêt du pompage d’eau brute correspondant et du
dégrillage.
La fin de course située en haut des grilles, commande l’ouvrage de la vanne d’eau
d’évacuation des refus. Cette vanne est refermée par l’intermédiaire d’une minuterie
réglable.
Contrôle des alarmes :
- Alarme défaut général sur dégrilleur EGA (S1/S2) retransmis en salle de
contrôle.
- Défauts de fonctionnement indiqués en local :
limiteur de couple ;
manque d’huile centrale râteau ;
température d’huile centrale râteau ;
enroulement inverse.
2. POMPAGE D’EAU BRUTE
Description :
- pompes d’arrosage des paliers des pompes d’eau brutes (P3 a/b)
Commutateur de sélection P3a ou P3b local
Commutateur auto/o/manu local.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (48 /138)
(Version Février 2010)
- pompes d’eau brute (P1 a/b et P2 a/b)
Commutateur de sélection local / distance.
B.P marche / arrêt (en local et en salle de contrôle) et arrêt
d’urgence.
- vanne automatique d’arrosage paliers (VA2)
Commutateur auto/o/manu local
- compresseurs anti-béliers (CO a/b).
Commutateur de sélection et auto/o/manu local
Fonctionnement :
- Démarrage de la première pompe d’eau brute en automatique.
Démarrage pompe d’arrosage sélectionnée (P3 a ou b)
ouverture de la vanne automatique VA2
alimentation du coffret séparateur
contrôle du débit d’arrosage sur C01 a/b ou CO2 a/b
- Après temporisation, démarrage de la pompe d’eau brute et ouverture de
l’électrovanne d’arrosage EV1 a/b ou EV2 a/b.
- Démarrage de la 2ème et 3ème pompe d’eau brute.
contrôle du débit d’arrosage C01 a/b ou CO2 a/b
après temporisation, démarrage de la pompe d’eau brute et
ouverture de l’électrovanne d’arrosage EV1 a/b ou EV2 a/b.
- arrêt 1ère et 2ème pompes d’eau brute
arrêt de la pompe d’eau brute
fermeture de l’électrovanne d’arrosage EV1 a/b ou EV2 a/b.
- arrêt de la dernière pompe d’eau brute.
arrêt pompe d’eau brute
fermeture de l’électrovanne d’arrosage EV1 a/b ou EV2 a/b.
fermeture vanne automatique VA2
coupure de l’alimentation de séparateur
arrêt de la pompe d’arrosage (P3 a ou b).
Contrôle des alarmes :
- Arrêt des pompes d’eau brute par niveau bas (CNB1 ou CNB2) et alarmes
correspondantes (ANB1 ou ANB2)
- Arrêt des pompes d’eau brute par manque de débit d’arrosage des paliers
(CO1 a/b ou CO2 a/b) et alarmes correspondantes en salle de contrôle
- Alarme niveau haut du réservoir anti bélier R1 interdisant le démarrage
d’une pompe d’eau brute et fermeture de l’électrovanne haute
- Arrêt compresseur anti bélier C1 a/b par niveau haut (CNH3)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (49 /138)
(Version Février 2010)
- Démarrage du compresseur anti bélier C1 a/b par niveau bas (CNB3)
- Alarme niveau bas du réservoir anti bélier R1 interdisant le démarrage
d’une pompe d’eau brute et fermeture de l’électrovanne basse EV3 b
3. MELANGE RAPIDE
Description :
Flash mixers (A1 et A2)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
commutateur marche/arrêt en salle de contrôle et en salle
électrique
Fonctionnement :
en automatique, le fonctionnement des flashes mixers est asservi à
celui des pompes d’eau brute
en manuel, pas d’asservissement
Contrôle et alarmes
alarme défaut flash mixers en salle de contrôle
alarme niveau haut dans le mélangeur en salle de contrôle (ANH4)
4. DECANTATION
Description :
- Ventilateur du pulsator ( C2 a/b/c)
commutateur auto/o/manu local
- Electrovanne de mise à l’atmosphère (EV5 a1/a2, EV5 b1/b2 et EV5 c1/c2)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
électrovannes d’extraction des boues (EV6 a et EV7 a, EV6 b et
EV7 b, EV6 c et EV7 c)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
Fonctionnement :
Le démarrage du ventilateur du pulsator est asservi aux pompes d’eau brute et son
fonctionnement est contrôlé par deux minuteries de cadences – durées (M1, M2)
En automatique, les électrovannes de mise à l’atmosphère sont asservies à
l’interrupteur à flotteur de la cloche du pulsator (IF a/b/c)
Contrôle et alarmes :
signalisation défaut ventilateur en local et en salle de contrôle
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (50 /138)
(Version Février 2010)
alarme manque d’air de service décanteur en salle de contrôle
(ACP 2)
5. FILTRATION
Description :
- pompes d’eau de lavage filtres (P4 a/b)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
commutateur de sélection P4 a ou P4 b en local
boutons - poussoirs marche/ arrêt sur pupitre de lavage
- suppresseurs d’air de lavage (C3 a/b)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
commutateur de sélection C3 a ou C3 b en local
boutons - poussoirs marche/ arrêt sur pupitre de lavage
- vanne automatique de stérilisation de l’eau de lavage (EV 15)
commutateur en service /hors service en local
- matériel sur pupitres de lavage
commutateur marche /arrêt
- Lavage
commutateur motorisé
commutateur sélection
B.P semi – auto
B.P pas à pas
commutateur filtration / arrêt
Fonctionnement :
En semi automatique, l’indicateur de colmatage indiquera si le filtre en service
nécessite un lavage. Après déclenchement du bouton – poussoir semi – auto, le
lavage du filtre se déroulera de façon automatique par l’intermédiaire d’un
combinateur électro – mécanique, assurant la mise en service des pompes, des
suppresseurs et le positionnement des vannes selon les séquences de lavage (voir
paragraphe).
Le lavage des filtres peut être également réalisé pas à pas par l’intermédiaire du
bouton – poussoir correspondant.
La séquence rinçage stérilisation se déroulera lorsque le commutateur
correspondant sera en position « stérilisation ».
A la suite du lavage d’un filtre, celui-ci peut être mis à l’arrêt ou en filtration.
Contrôles et alarmes :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (51 /138)
(Version Février 2010)
niveau bas citerne eau filtrée (ANB 5) assurant la protection des
pompes d’eau de lavage P4 et des pompes des saturateurs P5
a/b/c.
niveau haut citerne eau filtrée (ANH 5) provoquant l’arrêt des
pompes d’eau brute et la mise à l’arrêt des filtres (fermeture des
vannes EV 10 sortie eau filtrée).
alarme globale « arrêt lavage » par défaut suppresseurs, pompes
ou air de service.
alarme manque d’air de service générale (ACP1)
alarme turbidité eau décantée (TU 1) et eau filtrée (TU 2)
6. REACTIFS
a. HYPOCHLORITE DE CALCIUM
Description :
- agitateur bac de préparation (A5 a/b)
commutateur marche /arrêt local
- pompes doseuse (P18 a/b/c)
commutateur de sélection P18 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
- ventilateur de neutralisation (C6) et vanne d’eau de service (EV 30)
commutateur marche /arrêt local
Fonctionnement :
Une pompe doseuse d’hypochlorite est asservie aux pompes d’eau brute pour la
stérilisation
L’autre pompe en service est asservie au rinçage des filtres en eau stérilisée (voir
paragraphe).
Contrôles et alarmes :
alarme niveau bas bac d’hypochlorite (ANB 14 a/b) provoquant
l’arrêt de l’agitateur et des pompes selon le bac sélectionné
retransmis en salle de contrôle.
alarme niveau haut bac d’hypochlorite (ANH 14 a/b) retransmise
en salle de contrôle.
b. SULFATE DE CUIVRE
Description :
- agitateur bac de préparation (A8 a/b)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (52 /138)
(Version Février 2010)
commutateur marche /arrêt local
- pompes doseuse (P23 a/b/c)
commutateur de sélection P23 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
Fonctionnement :
La pompe doseuse en service est asservie à la marche des pompes d’eau brute
Contrôles et alarmes :
alarme niveau bas bac de sulfate de cuivre (ANB 17 a/b)
provoquant l’arrêt de l’agitateur et des pompes selon le bac
sélectionné retransmise en salle de contrôle.
alarme niveau haut bac (ANH 17 a/b) retransmise en salle de
contrôle.
c. SULFATE D’ALUMINE
Description :
- agitateur bac de préparation (A3 a/b)
commutateur marche /arrêt local
- pompes doseuse (P13 a/b/c)
commutateur de sélection P13 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
Fonctionnement :
La pompe doseuse en service est asservie à la marche des pompes d’eau brute
Contrôles et alarmes :
alarme niveau bas bac de sulfate d’alumine (ANB 13 a/b)
provoquant l’arrêt de l’agitateur et des pompes selon le bac
sélectionné retransmise en salle de contrôle.
alarme niveau haut bac (ANH 13 a/b) retransmise en salle de
contrôle.
d. SULFATE D’AMMONIUM :
Description :
- agitateur bac de préparation (A7 a/b)
commutateur marche /arrêt local
- pompes doseuse (P22 a/b/c)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (53 /138)
(Version Février 2010)
commutateur de sélection P22 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (54 /138)
(Version Février 2010)
Fonctionnement :
La pompe doseuse en service est asservie à la marche des pompes d’eau brute
Contrôles et alarmes :
alarme niveau bas bac de sulfate d’ammonium (ANB 16 a/b)
provoquant l’arrêt de l’agitateur et des pompes selon le bac
sélectionné retransmise en salle de contrôle.
alarme niveau haut bac (ANH 16 a/b) retransmise en salle de
contrôle.
e. POLYELECTROLYTE
Description :
- agitateur bac de préparation (A6 a/b)
commutateur marche /arrêt local
- pompes doseuse (P21 a/b/c)
commutateur de sélection P21 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
Fonctionnement :
La pompe doseuse en service est asservie à la marche des pompes d’eau brute
Contrôles et alarmes :
alarme niveau bas bac de polyélectrolyte (ANB 15 a/b) provoquant
l’arrêt de l’agitateur et des pompes selon le bac sélectionné
retransmise en salle de contrôle.
alarme niveau haut bac (ANH 15 a/b) retransmise en salle de
contrôle.
f. CHAUX
Description :
- pompes saturateur de chaux (P15 a/b/c)
commutateur de sélection P15 a/b ou c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
- saturateur
commutateur marche /arrêt en salle électrique
- pompe hélice (A9 a/b)
commutateur marche /arrêt en salle électrique
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (55 /138)
(Version Février 2010)
- électrovannes d’extraction du saturateur (EV20a/b, EV21 et EV22a/b,
EV23)
commutateur auto/o/manu en salle électrique
- pompes doseuses chaux saturateurs et floculation (P15 a/b/c et P14 a/b/c)
commutateur de sélection P15 a/b/c et P14 a/b/ c
commutateur auto/o/manu en salle électrique
- agitateurs bac de préparation lait de chaux (A4 a/b)
B.P marche/arrêt en salle électrique
Fonctionnement :
Le saturateur en service est asservi au fonctionnement de la pompe d’alimentation
P5 a (ou P5c en secours).
Les électrovannes d’alimentation en eau sont asservies au nombre de pompes d’eau
brute en service :
1. pompe d’eau brute en service : EV24 a ou 25a en service
2. pompes d’eau brute en service : EV24 b ou 25b en service
3. pompes d’eau brute en service : EV24 a + b ou 25a +b en
service
Les électrovannes d’extraction (EV20 a/b, EV21 et EV22 a/b) sont asservies à la
marche du saturateur et au cadenceur eau brute. Deux minuteries assurent les
cadences – durées des extractions du concentrateur, ainsi que les extractions de
fond.
La pompe doseuse de lait de chaux (P15 a/b/c) alimentant le saturateur est asservie
à la marche de ce dernier
La pompe doseuse de lait de chaux pour floculation (P14 a/b/c) est asservie au
fonctionnement des pompes d’eau brute
Sur les deux circuits de lait de chaux, un rinçage en eau est réalisé par l’ouverture
des électrovannes EV26 a/b et EV27 correspondant aux circuits saturateur et
floculation.
La fermeture de ces électrovannes est temporisée de 0 à 3 min après arrêt de la
pompe correspondante.
Contrôles et alarmes :
alarme niveau haut bac de préparation de chaux, en local
alarme niveau bas bac de préparation chaux, en local et en salle
de contrôle, provoquant l’arrêt de l’agitateur A4 a/b du bac
sélectionné et des pompes doseuses lait de chaux en service
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (56 /138)
(Version Février 2010)
contrôleur de circulation d’eau d’alimentation du saturateur
entraînant l’arrêt de la pompe d’alimentation P5 a/b
correspondante. Alarme signalée en salle électrique.
7. POMPAGE EAU TRAITEE
Description :
- pompes eau traitée vers Yaoundé (P8 a/b et P9 a/b)
commutateur de sélection local/distance à clef
B.P Marche/arrêt en local et en salle de contrôle
B.P arrêt d’urgence en local.
- pompes eau traitée vers Mbalmayo (P10 a/b/c)
commutateur auto/o/manu en local
B.P Marche/arrêt en local
B.P arrêt d’urgence en local
- pompes eau traitée réservoir 300 m3 (P11 a/b)
commutateur auto/o/manu en local
B.P Marche/arrêt en local
commutateur de sélection P11 a/b en salle de contrôle (clavier à
touches)
- vannes automatiques de refoulement eau traitée vers Yaoundé (V3 a/b et
V4 a/b)
B.P Marche/arrêt en local
- compresseurs anti – bélier réservoirs R3 a/b, R4 et R5 (C5 a/b)
commutateur de sélection C5 a/b en local
B.P Marche en local
Fonctionnement :
Le démarrage d’une pompe d’eau traitée alimentant Yaoundé (P8 a/b ou P9 a/b)
entraîne l’ouverture de la vanne de refoulement correspondante (VA3 a/b ou VA4
a/b)
Les contrôleurs de débit d’eau d’arrosage des paliers (CQ3 a/b et CQ4 a/b) et
l’électrovanne EV33 sont alors en service.
Une temporisation empêche le démarrage simultané de deux pompes d’eau traitée
L’arrêt d’une de ces pompes entraîne la fermeture de la vanne de refoulement
correspondante puis l’arrêt du moteur.
La pompe de refoulement d’eau traitée vers Mbalmayo (P10 a/b/c), en service est
commandée soit par horloge avec arrêt par le pressostat CPH, soit par les niveaux
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (57 /138)
(Version Février 2010)
du réservoir 300 m3. CNB11 et CNH 11 lorsque le commutateur de fonctionnement
du réservoir est en position secours. L’électrovanne VA5 est alors en position
ouverture.
Il est possible d’avoir deux pompes P10 en fonctionnement à l’aide du clavier à
touches situé en salle de contrôle.
Les pompes d’alimentation du réservoir 300 m3 (P11 a/b) démarrent en automatique
par niveau bas CNB11 et s’arrêtent par niveau haut CNH11 lorsque le commutateur
de fonctionnement du réservoir est en position « marche normale »
En automatique :
Les compresseurs antis – béliers C5a et C5b sont asservis respectivement aux
contacts de niveaux CNB9, CNH9 et CNH9, CNH10. :
démarrage du compresseur par niveau bas
arrêt du compresseur par niveau haut
En manuel :
La commande s’effectue par bouton poussoir (marche si poussoir enfoncé).
Alarmes et contrôles :
alarmes niveau bas bâche d’alimentation en eau traitée ANB7 a/b
entraînant l’arrêt des pompes P8 a/b et P9 a/b ainsi que des
pompes P10 a/b/c et P11 a/b selon le réservoir sélectionné.
Alarmes retransmises en salle de contrôle.
pressostat sur conduite de refoulement vers Mbalmayo entraînant
l’arrêt des pompes P10 a/b/c
alarme niveaux bas et haut réservoir 300m3 (ANB11 et ANH11)
retransmises en salle de contrôle
alarmes discordantes vannes de refoulement eau traitée VA3 a/b
et VA4 a/b retransmises en salle de contrôle
alarmes vannes d’alimentation bâche fermées VA44 a/b entraînant
l’interdiction respective des pompes d’eau traitée P8 a/b et P9 a/b
alarmes défaut pompes d’eau traitée retransmises en salle e
contrôle
alarmes niveaux bas et haut réservoir R3 a anti – bélier (ANB9 et
ANH9) entraînant l’arrêt des pompes d’eau traitée P8 a /b et P9
a/b, retransmises en salle de contrôle
alarmes niveaux bas et haut réservoir R3 b anti – bélier (ANB10 et
ANH10) entraînant l’arrêt des pompes d’eau traitée P8 a /b et P9
a/b, retransmises en salle de contrôle
commande de la fermeture des électrovannes EV16a, 16b, 17a,
17b par les niveaux des réservoirs R3 a et b suivants : ANH9,
ANB9, ANH10, ANB10.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (58 /138)
(Version Février 2010)
commande de l’ouverture des électrovannes EV18 d’alimentation
en air comprimé après démarrage du compresseur C5 a/b
sélectionné.
commande de l’ouverture des électrovannes des mises à vide des
réservoirs R3 a et b après démarrage des compresseurs C5 a/b
avec une temporisation de 10 secondes à l’ouverture.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (59 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 4
MISE EN SERVICE
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (60 /138)
(Version Février 2010)
I. MISE EN SERVICE GENERALE
- faire effectuer le nettoyage complet manuel de tous les ouvrages de
traitement et du poste de dosage des réactifs ;
- effectuer les essais d’étanchéité s’ils n’ont été réalisés précédemment ;
- procéder au graissage de tous les appareils électromécaniques (suivant
notices spécifiques des différents constructeurs) ;
- effectuer tous les essais électriques, y compris le sens de rotation des
moteurs, et de l’automaticité de fonctionnement (paragraphe) ;
- effectuer les essais de plancher des filtres à l’eau et à l’air surpressé s’ils n’ont
pas été réalisés précédemment. Faire charger les filtres en gravier ;
- procéder à la préparation des solutions de réactifs ( paragraphe )
- mettre en service le pompage d’eau brute
- ajuster le débit d’eau brute à l’ide de l’indicateur de débit par réglage de la
vanne d’arrivée d’eau brute
- procéder au réglage des différents doseurs de réactifs
- remplir les différents doseurs de réactifs :
sulfate de cuivre
chaux pour pH de floculation
coagulant (sulfate d’alumine)
floculant (polymère)
- mettre en service les analyseurs de pH et de turbidité sur l’eau brute.
- procéder à la mise en service des décanteurs, « pulsator » en envoyant l’eau
à l’égout
- lorsque l’eau est normalement décantée, alimenter la filtration et laisser l’eau
couler à l’égout pendant plusieurs heures par la vidange de la filtration en la
réglant de manière à maintenir au minimum 20 cm au-dessus du sable de
filtration
- effectuer les analyseurs nécessaires, et mettre en service les analyseurs de
turbidité
- lorsque l’eau est correctement traitée et filtrée, alimenter la citerne d’eau filtrée
- procéder au réglage de la régulation des filtres par les boîtes de partialisation
- procéder au lavage des filtres (paragraphe)
- après lavage des filtres, mettre en service la désinfection et la neutralisation
au pH d’équilibre, ainsi que les analyseurs de chlore eau traitée
- mettre en service le pompage de reprise d’eau traitée pour l’alimentation du
château d’eau, et des réseaux de distribution
- mettre en service le mesureur de débit d’eau traitée
II. DOSAGE DES REACTIFS
a) Hypochlorite de calcium :
Détermination de la dose de chlore à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (annexe B) : en désinfection :
test « chlore »
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (61 /138)
(Version Février 2010)
L’injection de la quantité de chlore nécessaire est effectuée sous forme de solution
d’hypochlorite de calcium dilué.
L’hypochlorite de calcium du commerce contient environ 630 grammes de chlore
actif par kg de produit.
Désinfection :
Il est nécessaire qu’au point le plus éloigné du réseau de distribution, il reste une
quantité de chlore de 0,15 à 0,2 mg/l. Pour le mode de désinfection choisi, il s’agit de
chlore combiné (chloramines).
Il faut donc à la quantité de chlore du réseau, cette quantité peut être estimée à 0,6
mg/m3 et sera diminuée compte tenu des teneurs en chlore libre mesurées en
différents points du réseau.
La quantité d’hypochlorite de calcium du commerce sera donc :
P1 (g/m3) = (test »chlore »+0,6)x1,6.
Préparation de la solution d’hypochlorite :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit :
P1= quantité d’hypochlorite en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h ;
q = débit de la pompe doseuse en l/h ;
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord ;
V2 = volume du bac de 10 cm du bord à 10cm du fond.
La concentration de la solution en hypochlorite de calcium ne doit pas dépasser 60g/l
pour éviter dans le bac des dépôts trop importants d’où risque de bouchages
éventuels de la pompe doseuse et des tuyauteries. Il faut donc prendre une valeur
de ‘q’ égale ou supérieure à :
P1 Q
60
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe en tenant compte toutefois de la condition impérative ci-
dessus.
La quantité d’hypochlorite de calcium du commerce à dissoudre sera :
- pour un bac complètement vide
P1 Q V 1
x en kg
q 1000
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm du fond :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (62 /138)
(Version Février 2010)
P1 Q V 2
y en kg
q 1000
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (63 /138)
(Version Février 2010)
Exemple de calcul : Soit :
P1 = 14 g/m3
Q = 4250 m3/h
q = 1572 l/h
V1 = 13000 litres
V2 = litres
Les quantités d’hypochlorite de calcium seront :
X= 568 kg
Y = 492 kg
Ce réglage permet de faire varier la dose d’hypochlorite à injecter de 7 à 21 g/m 3 soit
en chlore actif de 4,3 à 13 g/m3
Réglage du débit de la pompe doseuse de désinfection :
Soit qd = débit de la pompe doseuse en l/h :
P 2 Q V 2
qd
Y 1000
Chargement du bac :
- emplir le bac aux ¾ d’eau,
- mettre en service l’électro-agitateur, et le ventilateur,
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y)
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord, continuer l’agitation pendant
15 minutes pour bien homogénéiser la solution
- arrêter l’électro-agitateur
- laisser au repos une heure avant utilisation
b) Chaux :
Détermination de la dose de chaux à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (ANNEXE B) :
- pour la floculation : pH de floculation
- pour la neutralisation : pH d’équilibre
L’injection de la quantité de chaux nécessaire est effectuée sous forme de lait de
chaux pour la floculation et sous forme de chaux pour la neutralisation.
La chaux éreinte du commerce a une teneur moyenne en Ca(OH) 2 de 80%.
Les quantités en g/m3 sont exprimées en produit pur (Ca(OH) 2) pour la floculation et
en produit pur Ca(OH)2 pour la neutralisation.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (64 /138)
(Version Février 2010)
Doses réelles de chaux à injecter :
Floculation :
P1 (g/m3)= taux de traitement (jar-test),
Neutralisation :
La quantité de chaux à injecter doit permettre d’obtenir un pH et un TAC identiques à
ceux résultant du test ‘au marbre’ sur l’eau filtrée.
La quantité de chaux en produit pur Ca(OH)2 est :
P2 (g/m3)= (TAC2-TAC1) X 7,4
Avec TAC1 = TAC de l’eau filtrée
TAC2 = TAC de l’eau filtrée après test ‘au marbre’
Préparation de la suspension de lait de chaux :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit
P1= quantité de chaux en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit de la pompe doseuse en l/h
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord
V2= volume du bac de 10 cm du bord à 10cm au-dessus de l’hélice de
l’agitateur
La concentration de la suspension en chaux ne doit pas dépasser 100g/l pour éviter
dans le bac des dépôts trop importants d’où risque de bouchages éventuels de la
pompe doseuse et des tuyauteries. Il faut donc prendre une valeur de ‘q’ égale ou
supérieure à :
P1 Q
100
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe en tenant compte toutefois de la condition impérative ci-
dessus.
La quantité de chaux du commerce à mettre en suspension sera :
- pour un bac complètement vide
P1 Q V 1
x en kg
q 1000
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (65 /138)
(Version Février 2010)
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm au dessus de l’hélice :
P1 Q V 2
y en kg
q 1000
Exemple de calcul : Soit
P1 = 60 g/m3
Q = 4375 m3/h
q = 3000 l/h
V1 = 64000 litres
V2 = 60000 litres
Les quantités d’hypochlorite de calcium seront :
X= 5600 kg
Y = 5250 kg
Réglage du débit de la pompe doseuse de floculation : Soit
qd = débit de la pompe doseuse en l/h :
P 2 Q V 2
qd
Y 1000
Chargement du bac :
- emplir le bac aux ¾ d’eau,
- mettre en service l’électro-agitateur, et le filtre à poussière,
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y)
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord,
- le bac est prêt pour l’utilisation
nota : ne jamais arrêter l’agitateur une fois la préparation effectuée, la suspension de
chaux risquant de déposer.
Préparation et dosage de la solution d’eau de chaux (par saturateur à turbine) :
Calcul du débit d’eau de chaux nécessaire à la neutralisation au pH d’équilibre : Soit
P2= quantité de chaux pure Ca(OH)2 en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit d’eau de chaux nécessaire à la neutralisation au pH d’équilibre
S = solubilité de la chaux pure Ca(OH) 2 en g/l (en fonction de la température
de l’eau)
S= TEMPERATURE EN ° CELSIUS
solubilité 0 10 20 30 40
Ca(OH)2 1,85 1,75 1,65 1,55 1,40
TAC en °F 250 235 220 210 190
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (66 /138)
(Version Février 2010)
Le débit d’eau de chaux saturée à injecter sera :
P2 Q
q en m3/h
S 1000
Nota : Pour éviter des variations de solubilité de la chaux dans l’eau de chaux en
fonction de la température la valeur de S est prise à 40°C soit 190° TAC ou 1,4 g/l en
Ca(OH)2
D’où :
P2 Q
q en m3/h
1400
Réglage des débits d’alimentation du saturateur :
Quantité de chaux commerciale nécessaire à la saturation de l’eau de chaux :
Cette quantité est celle consommée pour la décarbonatation de l’eau à saturer, plus
celle nécessaire à la saturation de l’eau en fonction de la température de l’eau
d’alimentation, soit :
P3 = quantité de chaux commerciale en kg/m3
TAC = TAC de l’eau d’alimentation en °F
TMg = TMg de l’eau d’alimentation en °F
CO2 = CO2 de l’eau d’alimentation en °F
S = solubilité de la chaux pure Ca(OH)2 en fonction de la température en g/l
K = pourcentage de chaux pure Ca(OH)2 dans la chaux commerciale en %
0, 0074(TAC TMg CO 2) 0, 2 S
P3 en kg/m3
K
La valeur 0,2S tient compte de rendement du saturateur (de l’ordre de 80%), c'est-à-
dire des possibilités de dissoudre la chaux pure contenue dans la chaux
commerciale. D’où :
0, 0074(TAC TMg CO 2) 1, 68
P3 en kg/m3
K
Débit de lait de chaux : soit
P3 = quantité de chaux commerciale nécessaire à la saturation de l’eau en
kg/m3
q1 = débit de lait de chaux en m3/h
q2 = débit d’eau d’alimentation en m3/h
C = concentration du lait de chaux en kg/m3, (soit X/V1)
P3 q 2
q1
C
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (67 /138)
(Version Février 2010)
Tracer la courbe du débit de q1 en fonction de q2 à partir d’un débit fixe de q2
(inférieur au débit maxi du saturateur)
Débit d’eau d’alimentation du saturateur :
Ce débit est supérieur au débit de sortie du saturateur car il est tenu compte du débit
d’extraction des boues du saturateur qui est 10% du débit total d’alimentation du
saturateur (lait de chaux + eau)
- débit total d’alimentation = q1 + q2
- débit d’extraction des boues = 0,1(q1 + q2)
- débit d’eau de chaux saturée : q = q1 + q2 - 0,1(q1 + q2)
= 0,9 q1 – 0,9 q2
= 0,9 q2 (P3/C + 1)
d’où : q = 0,9 x(P3/C + 1)x q2 ,
q
q2
0,9 ( P 3 / C 1)
Tracer la courbe de débit q2 en fonction du débit q nécessaire d’injection d’eau de
chaux pour la neutralisation au pH d’équilibre.
Exemple de calcul :
Calcul de q, soit :
P2 = 7,4 (TAC2 – TAC1) = 7,4x2=14,8 g/m3
Q = 845 m3/h ;
14,8 845
q
1400 = 8,9 m3/h
Quantité de chaux commerciale : soit :
TAC = 4,2 °F
TMg = 0,6 °F
CO2 = 2,2 °F
K = 75% = 0,75
0, 0074(4, 2 0, 6 2, 2) 1, 68
P3 = 2,30 kg/m3
0, 75
Débit de lait de chaux: Soit :
P3 =2,30 kg/m3
x 880
C= 84, 60 kg/m3
V 1 10, 4
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (68 /138)
(Version Février 2010)
q2 = 18 m3/h (débit maxi du saturateur 20 m3/h)
2,30
q1= 18 0, 490 m3/h
84, 60
Tracer la courbe 1 :
- en abscisse : q2 = débit d’eau d’alimentation du saturateur
- en ordonnée : q1= débit lait de chaux
Débit d’eau d’alimentation :
8,9
9, 6
q2 = 0,9( 2,30 1)
84, 60
Tracer la courbe 2 :
- en abscisse : q = débit d’injection d’eau de chaux
- en ordonnée : q2 = débit d’eau d’alimentation du saturateur
D’où
2,30
q1= 9, 6 0, 260 m3/h
84, 60
c) SULFATE D’ALUMINE
Détermination de la dose de sulfate d’alumine à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (ANNEXE B) : L’injection de la
quantité de sulfate d’alumine nécessaire est effectuée sous forme de solution diluée
de sulfate d’alumine.
Le sulfate du commerce a une teneur moyenne en AL 2O3 DE 17%.
Les quantités en g/m3 sont exprimées en produit commercial (AL2(SO4)318H2O).
Préparation de la solution de sulfate d’alumine :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit
P= quantité de sulfate d’alumine en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit de la pompe doseuse en l/h
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord
V2= volume du bac de 10 cm du bord à 10cm du fond.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (69 /138)
(Version Février 2010)
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe.
La quantité de sulfate d’alumine du commerce à dissoudre sera :
- pour un bac complètement vide
P1 Q V 1
x en kg
q 1000
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm au dessus du fond :
P Q V 2
y en kg
q 1000
Exemple de calcul : Soit
P = 80 g/m3
Q = 4375 m3/h
q = 1572 l/h
V1 = 35000 litres
V2 = 33000 litres
Les quantités d’hypochlorite de calcium seront :
X= 7792 kg
Y = 7347 kg
Ce réglage permet de faire varier la dose de sulfate d’alumine à injecter de 40 à 120
g/m3, soit 25 à 75 % du débit maxi de la pompe doseuse.
Chargement du bac :
- emplir le bac aux ¾ d’eau,
- mettre en service l’électro-agitateur, et le ventilateur,
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y)
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord, continuer l’agitation pendant
15 minutes pour bien homogénéiser la solution,
- arrêter l’électro-agitateur,
- le bac est prêt pour l’utilisation
d) POLYELECTROLYTE
Détermination de la dose de polyélectrolyte à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (ANNEXE B). L’injection de la
quantité de sulfate d’alumine nécessaire est effectuée sous forme de solution diluée
de polyélectrolyte. Le polyélectrolyte utilisé est le produit.
Les quantités en g/m3 sont exprimées en produit commercial
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (70 /138)
(Version Février 2010)
Préparation de la solution de polyélectrolyte :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit
P= quantité de polyélectrolyte en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit de la pompe doseuse en l/h
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord
V2= volume du bac de 10 cm du bord à 10cm du fond.
La concentration de la solution de polyélectrolyte ne doit pas dépasser 5g/l pour
limiter la viscosité de la solution Il faut donc prendre une valeur de ‘q’ égale ou
supérieure à :
P1 Q
5
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe en tenant compte toutefois de la condition impérative ci-
dessus.
La quantité de polyélectrolyte à dissoudre sera :
- pour un bac complètement vide
P Q V 1
x en kg
q1 1000
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm au dessus du fond :
P Q V 2
y en kg
q1 1000
Exemple de calcul : Soit
P = 0,4 g/m3
Q = 4375 m3/h
q = 631 l/h (50% du débit maxi)
V1 = 15000 litres
V2 = 13000 litres
Les quantités d’hypochlorite de calcium seront :
X= 41 kg
Y = 36 kg
Ce réglage permet de faire varier la dose de polyélectrolyte à injecter de 0,2 à 0,6
g/m3, soit 25 à 75% du débit maxi de la pompe doseuse.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (71 /138)
(Version Février 2010)
Chargement du bac
- emplir en eau jusqu’à noyer l’hélice ;
- mettre en service l’électro-agitateur ;
- admettre l’eau sous pression sur le disperseur ;
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y) grâce au disperseur en évitant la
formation de ‘grumeaux’ ;
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord, continuer l’agitation pendant
60 minutes pour bien homogénéiser la solution ;
- arrêter l’électro-agitateur ;
- le bac est prêt pour l’utilisation.
e) SULFATE DE CUIVRE
Détermination de la dose de sulfate de cuivre à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (ANNEXE B). L’injection de la
quantité de sulfate de cuivre nécessaire est effectuée sous forme de solution diluée
de sulfate de cuivre.
L’injection de la quantité de sulfate de cuivre nécessaire est effectuée sous forme de
solution diluée de sulfate de cuivre.
Les quantités en g/m3 sont exprimées en produit pur.
Préparation de la solution de sulfate de cuivre :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit
P= quantité de sulfate de cuivre en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit de la pompe doseuse en l/h
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord
V2= volume du bac de 10 cm du bord à 10cm du fond.
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe.
La quantité de sulfate de cuivre du commerce à dissoudre sera :
- pour un bac complètement vide
P Q V 1
x en kg
q 1000
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm au dessus du fond :
P Q V 2
y en kg
q 1000
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (72 /138)
(Version Février 2010)
Exemple de calcul : Soit
P = 0,7 g/m3
Q = 4375 m3/h
q = 33 l/h, (50% débit maxi)
V1 = 1000 litres
V2 = 800 litres
Les quantités de sulfate de cuivre seront :
X= 92 kg
Y = 74 kg
Ce réglage permet de faire varier la dose de permanganate de potassium à injecter
de 0,35 à 1 g/m3, soit 25 à 75 % du débit maxi de la pompe doseuse.
Chargement du bac :
- emplir le bac aux ¾ d’eau,
- mettre en service l’électro-agitateur,
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y)
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord, continuer l’agitation pendant
15 minutes pour bien homogénéiser la solution,
- arrêter l’électro-agitateur,
- le bac est prêt pour l’utilisation
f) SULFATE D’AMMONIUM
Détermination de la dose de sulfate d’ammonium à utiliser :
Cette dose est celle trouvée aux essais de laboratoire (ANNEXE B). Une dose est
généralement utilisée sur une eau brute ayant les caractéristiques de celle
alimentant cette installation (2a).
Les quantités en g/m3 sont exprimées en produit pur.
Préparation de la solution de sulfate d’ammonium :
Calcul de la quantité nécessaire : Soit
P= quantité de sulfate d’ammonium en g/m3
Q = débit d’eau à traiter en m3/h
q = débit de la pompe doseuse en l/h
V1 = volume du bac rempli à 10 cm du bord
V2= volume du bac de 10 cm du bord à 10cm du fond.
Pour le réglage initial de la pompe doseuse prendre une valeur de ‘q’ égale à la
moitié du débit de la pompe.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (73 /138)
(Version Février 2010)
La quantité de sulfate d’ammonium du commerce à dissoudre sera :
- pour un bac complètement vide
P Q V 1
x en kg
q 1000
- pour un bac utilisé jusqu’à 10 cm au dessus du fond :
P Q V 2
y en kg
q 1000
Exemple de calcul : Soit
P = 4 g/m3
Q = 4170 m3/h
q = 100 l/h,
V1 = 1500 litres
V2 = 1300 litres
Les quantités de sulfate d’ammonium seront :
X= 250 kg
Y = 216 kg
Chargement du bac :
- emplir le bac aux ¾ d’eau,
- mettre en service l’électro-agitateur,
- faire tomber en pluie le réactif (poids X ou Y)
- compléter le remplissage jusqu’à 10 cm du bord, continuer l’agitation pendant
15 minutes pour bien homogénéiser la solution,
- arrêter l’électro-agitateur,
- le bac est prêt pour l’utilisation
III. MISE EN SERVICE DU PULSATOR
A. Préliminaire à la mise en service
- s’assurer que le nettoyage a bien été effectué en particulier pour le fond des
concentreurs de boues, le fond du décanteur, la cloche à vide, les canaux
généraux de distribution, afin d’éviter les bouchages des ramifications, de
leurs orifices de distribution, des tuyauteries d’extraction des boues , des
tuyauteries de vidange,
- s’assurer du bon fonctionnement de l’interrupteur à flotteur de la cloche à vide,
en particulier qu’il ne se produise pas de coincement ou de frottement exagéré
du câble de commande de l’interrupteur à flotteur,
- mettre sous pression les vannes automatiques d’extraction des boues et
vérifier leur fonctionnement. Arrêter le dispositif de commande automatique de
ces vannes,
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (74 /138)
(Version Février 2010)
- ouvrir en grand toutes les vannes :
o vidange générale
o vannes manuelles des extractions de boues
o vidange des concentrateurs de boues
o vannes de prises d’échantillons,
o vanne d’aspiration du ventilateur
o vanne manuelle de mise à l’atmosphère.
B. Mise en eau :
- mettre en route les doseurs de réactifs préalablement réglés (paragraphe 4/2)
- alimenter le décanteur en eau brute par mise en route des pompes d’eau
brute en réglant le débit par lecture du débitmètre par ouverture et réglage des
vannes de sortie des pompes
- fermer la vidange générale après avoir constaté qu’elle débite normalement,
- laisser le niveau d’eau monter dans le décanteur en contrôlant l’étanchéité
des vannes de vidange et l’étanchéité des parois,
- fermer les vannes de vidange des concentrateurs lorsqu’elles débitent
normalement à l’égout.
- Fermer les vannes manuelles des extractions des boues des concentrateurs
lorsqu’elles débitent normalement à l’égout
Etalonnage du débit d’eau brute ;
Lorsque le niveau d’eau est situé à 20 cm au-dessus des déversoirs des
concentrateurs, contrôler le débit d’eau brute par le temps nécessaire pour remplir
les hauteurs d’eau de 20 cm en 20 cm. La dernière mesure doit être effectuée avant
que le niveau d’eau n’atteigne le niveau inférieur des goulottes de reprise.
Calcul du débit :
Si t = temps en secondes pour remplir une hauteur d’eau de 0,2 m
S1 = surface totale en m2 du pulsator
S2 = surface au sol en m2 des parois de la cloche à vide
S3 = surface au sol totale en m2 des piliers
Q = débit en m3 /h d’eau brute
Le débit mesuré est égal à :
( S 1 S 2 S 3) 0, 2 3600
Q(m3 /h) =
t
Ce résultat permet de vérifier le débit d’eau brute en fonction du pompage et de la
lecture sur le débitmètre.
Etalonnage du débit d’extraction des boues
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (75 /138)
(Version Février 2010)
- dès que l’étalonnage du débit d’eau brute a été effectué, régler le dispositif
d’automaticité des extractions des boues en chronométrant exactement un
temps d’ouverture de 45 secondes toutes les 5 minutes,
- ouvrir les vannes manuelles d’extraction des boues et régler l’évacuation du
fluide moteur pour obtenir une ouverture et une fermeture rapide des vannes
automatiques.
- arrêter le dispositif d’automaticité des extractions,
- lorsque le niveau d’eau arrive dans le pulsator, au-dessous des goulottes de
reprise, arrêter les doseurs de réactifs et d’alimentation générale en eau brute,
- mettre en route le dispositif d’automaticité des extractions en conservant le
réglage adopté (45 secondes toutes les 45 minutes),
- contrôler le temps nécessaire pour que le niveau s’abaisse de 0,05 m et
répéter ce contrôle au minimum 3 fois,
- noter le nombre d’ouverture de vannes automatiques.
Calcul du débit d’une vanne :
Si T = temps en minutes pour descendre le niveau de 0,05 m
S1 = surface totale en m2 du pulsator
S2 = surface au sol en m2 des parois de la cloche à vide
S3 = surface au sol totale en m2 des piliers
q = débit d’extraction par vanne en m3 /h
n = nombre de vannes s’ouvrant simultanément à chaque extraction
Le débit d’extraction par vanne est égal à :
( S 1 S 2 S 3) 0, 05 3600 5
Q (m3/h) =
T 45 n
- arrêter le dispositif d’automaticité des extractions des boues et fermer les
vannes manuelles des extractions
- remettre en route les doseurs de réactifs et l’alimentation en eau brute,
- mettre en route les pulsations dès que l’eau décantée se déverse dans les
goulottes de reprise.
Réglage de base du dispositif de commande des pulsations :
- vérifier qu’à débit minimum et à débit maximum les orifices de reprise d’eau
décantée sont toujours noyés dans la cuve du pulsator. Sinon rehausser le
niveau par :
o augmentation de la hauteur du niveau dans la goulotte d’eau
décantée (par les filtres)
o rehaussement du seuil à l’extrémité des goulottes collectrices
d’eau décantée
- régler les butées de l’interrupteur à flotteur de façon à ce que :
- le plan d’eau maximal en pulsation dans la cloche soit à 0,70 m au – dessus
du niveau maximal statique dans la cloche,
- le plan d’eau minimal en pulsation soit à 0,10 m du niveau maximal statique à
la mise en service, la hauteur de chasse sera de 0,60 m,
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (76 /138)
(Version Février 2010)
- mettre en route le ventilateur et fermer légèrement la vanne d’aspiration
dans la cloche (compter le nombre de tours). Contrôler le temps nécessaire
pour que le niveau atteigne son maximum. Ce temps doit être réglé à 45
secondes par réglage de la vanne d’aspiration,
- fermer légèrement la vanne manuelle placée sur le circuit de mise
automatique à l’atmosphère (compter le nombre de tours). Contrôler le temps
de chasse entre le niveau maximal et le niveau minimal. Ce temps doit être
réglé à 10 secondes par réglage de al vanne d’aspiration.
Formation du lit de boues :
Durée de formation du lit de boues :
La vitesse de formation du lit de boues est fonction de la nature de l’eau et des
doses de réactifs nécessaires à la clarification.
Le lit de boues peut être formé en trois heures avec une eau brute chargée et des
doses de réactifs élevées. Le lit de boues peut être formé en plus de 24 heures avec
une eau brute peu chargée et des doses de réactifs faibles. Pendant les trois
premières heures de fonctionnement, effectuer et noter toutes les 30 minutes les
contrôles suivants :
temps (min)…………………………… : 30
débit d’eau brute (m3 /h )……………... :
hauteur de chasse (m) ………………… : 0,60
durée de chasse (s)…………………….. : 10
durée d’aspiration (s) …………………. : 45
doses de réactifs (g/m3) :
sulfate de cuivre………………… :
sulfate d’alumine……………….. :
chaux……………………………. :
floculant…………………………. :
pH eau brute……………………………………… :
pH eau décantée………………………………… :
nota : le pH de l’eau décantée doit être sensiblement égal à celui trouvé, pour les
mêmes doses de réactifs, lors de l’essai ‘jar-test’
Après trois heures de fonctionnement, effectuer et noter toutes les heures, les
contrôles suivants :
date……………………………………
temps (h)……………………………… : 3
débit d’eau brute (m3 /h )……………... :
hauteur de chasse (m) …………………
durée de chasse (s)……………………..
durée d’aspiration (s) ………………….
Pourcentage de boues dans le lit de boues :
après 5 min, bas…………………
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (77 /138)
(Version Février 2010)
après 5 min, haut…………………
après 10 min, bas…………………
après 10 min, haut…………………
fréquence d’extraction…………………….
durée d’extraction………………………..
pourcentage d’extraction
pH eau brute……………………………………… :
pH eau décantée…………………………………
doses de réactifs (g/m3) :
sulfate de cuivre………………… :
sulfate d’alumine……………….. :
chaux……………………………. :
floculant………………………….
Nota : contrôle du pourcentage de boues du lit de boues :
- utiliser des éprouvettes de 250 ml
- ouvrir les deux prises d’échantillon hautes et basses et laisser couler environ
2 minutes,
- prélever 250 ml d’eau boueuse à chaque prise d’échantillon et fermer les
vannes de prise d’échantillon,
- fermer successivement chaque éprouvette avec la paume de main et
retourner 5 fois pour bien homogénéiser,
- placer les éprouvettes à température constante,
- lire le volume en ml de boues déposées après des temps de décantation de 5
minutes et 10 minutes
- le pourcentage de boues sera égal à : % = ml de boues déposées x 0,4
Réglage définitif de la cadence des pulsations et de la hauteur de chasse
Le contrôle du pourcentage de boues à la partie basse et à la partie haute du lit de
boues permet d’ajuster la cadence des pulsations et la hauteur de chasse.
Attendre 3 heures entre un réglage et un nouveau réglage éventuel. N’effectuant ce
réglage éventuel qu’après contrôle des pourcentages de boues.
a) pourcentage de boues plus élevé à la partie basse du lit de boues (supérieur de 7
% à celui de la partie haute)
La cadence de pulsation est trop lente ou la hauteur de chute trop faible.
Commencer par réduire le temps de chasse (on peut descendre jusqu’à 5 secondes)
Si la différence de pourcentage reste toujours supérieure à 7 entre la partie basse et
la partie haute, augmenter la hauteur de chasse, de 5 cm en maintenant la même
cadence (durée de chasse 5 secondes, durée d’aspiration : 45 secondes). On peut
augmenter la hauteur de chasse jusqu’à un maximum de hauteur totale de 0,80 m.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (78 /138)
(Version Février 2010)
si la différence de pourcentage reste toujours supérieure à 7, agir sur la durée de
l’aspiration en la réduisant de 5 secondes par 5 secondes (ne pas descendre en
durée d’aspiration en dessous de 20 secondes).
b) pourcentage de boues plus élevé à la partie haute du lit de boues : la cadence de
pulsation est trop rapide ou la hauteur de chute trop grande.
Commencer par réduire la hauteur de chute de 5 cm. Si cela est insuffisant,
augmenter le temps d’aspiration par une seconde (on peut augmenter la durée
d’aspiration jusqu’à 15 secondes)
Si cela est insuffisant vérifier le traitement (insuffisance de coagulant ou floculant)
Nota 1 : on peut tolérer un pourcentage de boues de 5 à 7, supérieur à la partie
basse par rapport à la partie haute. Par contre le pourcentage de boues à la partie
haute doit toujours être inférieur à celui de la partie basse.
Nota 2 : les réglages précédents sont valables pour un pulsator fonctionnant au débit
nominal d’eau brute. En cas de fonctionnement à débit inférieur, s’assurer que le
débit d’aspiration du ventilateur reste inférieur au débit d’eau brute.
A cet effet, mesurer le débit de remplissage de la cloche en arrêtant l’alimentation en
eau brute et les réactifs.
Mesurer le temps de remplissage sur une hauteur de 30 cm :
Si q = débit aspiré en m3 /h
S4 = surface intérieure de la cloche à vide en m2
t = temps de remplissage en secondes
S 4 0,30 3600
q=
t
Pour éviter d’aspirer pendant le remplissage de la cloche des boues dans les
ramifications inférieures du pulsator, il faudra régler la vanne à l’aspiration du
ventilateur pour que l’on obtienne toujours :
q inférieur au débit d’eau brute
Nota 3 : les réglages obtenus pour la cadence de pulsation sont en général :
- eaux faiblement chargées :
* temps de chasse………………………..7 à 10 s
* temps d’aspiration……………………20 à 24 s
* hauteur de chasse ( 0,05)..………… 0,60 m
- eaux moyennement chargées :
* temps de chasse………………………..5 à 7 s
* temps d’aspiration……………………20 à 25 s
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (79 /138)
(Version Février 2010)
* hauteur de chasse( 0,05)..………… 0,60 m
- eaux fortement chargées :
* temps de chasse………………………..7 à 9 s
* temps d’aspiration……………………25 à 30 s
* hauteur de chasse( 0,05)..………… 0,75 m
Réglage des extractions :
Lorsque le niveau du lit de boues atteint le déversoir des concentrateurs :
- mettre en route le dispositif d’automaticité des extractions de boues et
régler :
* durée d’extraction………………………….5 min
* fréquence d’extraction …………………….1 h
- prélever une éprouvette de 250 ml d’eau boueuse après 2 secondes
d’ouverture de la vanne d’extraction et une éprouvette de 250 ml d’eau
boueuse 3 secondes avant la fermeture de la vanne.
- homogénéiser en fermant successivement chaque éprouvette avec la paume
de la main et en retournant l’éprouvette 5 fois.
- placer les éprouvettes à température constante
- lire le volume en ml de boues déposées après des temps de décantation de 5,
10 et 30 minutes,
- le pourcentage de boues sera égal à : % = ml de boues déposées x 0,4
- on doit obtenir :
* après 5 minutes, environ ………………….99%
* après 10 minutes, environ ………………….99%
* après 30 minutes, environ ………………….90%
- si après 30 minutes la différence est supérieure à 10%, diminuer la durée
d’extraction, puis si cela ne suffit pas la fréquence d’extraction.
- le réglage optimum est atteint lorsque le lit de boues est situé à 0,10 m au-
dessus des déversoirs des concentrateurs et que le niveau de boues dans les
concentrateurs est entre 0,20 et 0,30 m, au-dessous des déversoirs des
concentrateurs.
C. FICHE TECHNIQUE APRÈS MISE EN ROUTE :
- date…………………………………………………….
- nombre de pulsators……………………………………
- dimensions :
* surfaces totales (S1)……………………………
* surface de décantation
(S1 + S2 + S3)…………………………………..
* surface de la cloche S4 ……………………..
- débits unitaires :
* maximum (m3 /h)…………………………….
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (80 /138)
(Version Février 2010)
* minimum (m3 /h)…………………………….
- hauteur de chasse………………………………………
- durée de chasse……………………………………….
- durée d’aspiration…………………………………….
- pourcentage de boues dans le lit de boues après 5 minutes :
* bas…………………………………………………..
* haut…………………………………………………..
- pourcentage de boues dans le lit de boues après 10 minutes
* bas…………………………………………………..
* haut…………………………………………………..
- doses de réactifs :
*sulfate de cuivre………………… :
*sulfate d’alumine……………….. :
*chaux……………………………. :
*floculant………………………….
- pH eau brute………………………………………….
- pH eau traitée………………………………………….
D. MISE EN SERVICE DE LA REGULATION DE LA FILTRATION
Réglage des boîtes de partialisation (montage amont) :
Précautions à prendre avant réglage :
- veiller à ce que la boîte soit montée dans une position telle que sa tige soit
parfaitement verticale, faute de quoi, les frottements anormaux qui en
résulteraient pourraient être cause de pompage dans la régulation ou, d’usure
prématurée des coussinets de guidage des tiges de la boîte.
- Si la tige n’est pas bien en position verticale, jouer sur la liaison entre la
boîte et la manchette pour obtenir une bonne verticalité, tout en conservant
une parfaite étanchéité
- vérifier que le joint, servant de siège au clapet, est bien appliqué dans son
logement ; s’il est décollé, utiliser, pour le mettre en place, une colle valable
pour le caoutchouc et l’aluminium,
- vérifier, par l’orifice de la boîte d’entrée, que la butée sur laquelle s’appuie le
ressort intérieur, est bien bloquée, par sa vis pointeau, sur la tige intérieure,
- vérifier que la tige coulisse bien sur ses coussinets inférieurs et supérieurs,
que le clapet coulisse bien sur la tige et, vient s’appliquer, de façon étanche,
sur le joint en caoutchouc du siège quand on lève la tige et, que l’on comprime
le ressort intérieur.
Réglage initial de la boîte :
- le réglage, pour être valable, nécessite qu’auparavant on ait bien pris soin de
vérifier que tous les seuils des siphons concentriques de régulation soient à la
même cote pour tous les filtres, sinon, reprendre le calage des siphons,
- réaliser sur le filtre la cote d’eau maximale en régulation (indiquée sur les
plans de l’installation) diminuée de 3 cm.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (81 /138)
(Version Février 2010)
- desserrer la vis qui fixe le flotteur sur la tige inférieure, ainsi que la vis fixant la
bague située au – dessous et, qui servira, plus tard, de repère de réglage,
laisser le flotteur flotter sur le plan d’eau matérialisé à l’opération précédente,
- lever doucement, à la main, la tige inférieure jusqu’à ce que le clapet vienne
juste au contact du joint caoutchouc du siège, sans compression du ressort
intérieur,
- la tige étant dans cette position, visser la vis de fixation du flotteur sur la tige,
de façon que le flotteur flottant sur le plan d’eau matérialisé au deuxième
paragraphe, le clapet de la boîte soit juste fermé.
Si le réglage est bien fait de façon semblable sur tous les filtres et, si les clapets
d’entrée d’eau ont leur axe bien libre, ne créant pas de frottements particuliers, on
doit constater, pour tous les filtres, la même différence de niveau entre la goulotte
générale d’eau décantée et le plan d’eau réglé sur tous les filtres (à condition, bien
sûr, que les filtres soient dans le même état d’encrassement). Autrement dit, cette
vérification est à faire quand les filtres sont propres.
Si l’on constatait des écarts entre les filtres, il faudrait alors ajuster légèrement le
réglage des flotteurs sur leur tige : si, sur un filtre, la différence de niveau est plus
grande que sur les autres, il faut desserrer la vis de fixation du flotteur et, abaisser
légèrement le flotteur par rapport à la tige.
- enfin, le réglage étant correct, serrer sur la tige, la vis de la bague folle située
au-dessus du flotteur, après avoir amenée au contact de celui-ci. Cette bague
permet de bien matérialiser le réglage réalisé, elle ne devra pas être
débloquée par la suite pour n’avoir plus à refaire le réglage initial,
- éventuellement, faire juste au-dessous de la bague une marque par un trait de
scie sur la tige pour bien matérialiser le réglage initial.
Vérification de l’équirépartition
Lorsque le réglage des boîtes de partialisation est terminé, vérifier que la répartition
du débit est bien réalisée en s’assurant que, les lames-déversoirs alimentant chaque
filtre sont bien horizontales et calées à la même hauteur. La hauteur de la lame d’eau
sur les déversoirs doit être identique pour tous les filtres.
E. MISE EN SERVICE DE LA FILTRATION
Préliminaires à la mise en service :
- s’assurer du chargement des filtres à sable avec les quantités correctes de
matériau. Répéter les niveaux de sable dans les filtres ainsi chargés
- mettre en service le poste de production d’air de service alimentant les vannes
automatiques des filtres.
- vérifier le fonctionnement correct de ces vannes automatiques, en effectuant à
blanc, les opérations de lavage pas à pas, par exemple.
- vérifier que la bâche d’eau de lavage soit suffisamment remplie et dans le cas
contraire, alimenter cette bâche par les filtres.
- s’assurer de la mise à disposition des pompes et suppresseurs de lavages
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (82 /138)
(Version Février 2010)
Lavage d’un filtre
Le lavage d’un filtre AQUAZUR V comporte les différentes phases suivantes :
- une vidange partielle pour mise à niveau de l’eau sur les filtres, afin de ne pas
entraîner de sable au cours du lavage
- un lavage à l’air surpressé avec un faible débit d’eau.
- Immédiatement après la séquence de vidange, le groupe électro-suppresseur
est mis en marche avant l’ouverture de la vanne d’entrée d’air de lavage.
- Puis la pompe d’eau de lavage est mise en service avant l’ouverture de la
vanne d’entrée d’eau de lavage.
o débit d’air de lavage…………………4400 Nm3 /h
o débit d’eau de lavage…………………550 m3 /h
o durée de la séquence………………….4 à 5 min
- un risque à grand débit.
La vanne d’entrée d’air de lavage se ferme, le suppresseur est mis à l’arrêt, et la
vanne de purge d’air est alors ouverte.
Simultanément un débit d’eau de rinçage plus important est envoyé sous le plancher
du filtre
Cette séquence permet également l’injection éventuelle d’hypochlorite dans l’eau de
rinçage afin de stabiliser le filtre.
o débit d’eau de rinçage…………………1100 m3 /h
o durée de la séquence………………….3 à 4 min environ
- le critère de fin de rinçage, l’eau s’évacuant au déversoir doit être parfaitement
claire
- un arrêt : cet arrêt est caractérisé par la fermeture des vannes d’entrée et de
sortie d’eau de lavage et l’arrêt de la pompe
- un démarrage : durant cette séquence, la vanne de purge d’air se ferme et la
vanne de sortie d’eau filtrée est ouverte
- remise en filtration : par ouverture de la vanne d’entrée d’eau à filtrer, le filtre
est remis en service. Ce cycle de lavage se déroule de façon automatique
après déclenchement des opérations par l’opérateur.
Il sera nécessaire à la mise en service de vérifier les divers paramètres des
séquences de lavage, (durée, débits, qualité d’eau), afin d’apporter éventuellement
les modifications nécessaires.
Lorsque les filtres seront lavés et mis en filtration, mettre en service les analyseurs
de turbidité.
MISE EN SERVICE DU SATURATEUR DE CHAUX A TURBINE
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (83 /138)
(Version Février 2010)
Préliminaires à la mise en service
- s’assurer que la nettoyage a bien été effectué en particulier pour le fond du
concentrateur de boues et le fond du saturateur
- s’assurer du bon fonctionnement de la turbine
- mettre sous pression la vanne automatique d’extraction des boues et vérifier
son fonctionnement en automatique. Arrêter ensuite le dispositif de
commande automatique.
- ouvrir en grand toutes les vannes
o vidange générale
o vanne manuelle et automatique des extraction de boues
Mise en eau :
- alimenter le saturateur en eau brute par ouverture et réglage de la vanne
V121 ou V124. Régler le débit à 30 m3 /h
- fermer la vidange générale et les vannes manuelles et automatiques
d’extraction après avoir constater qu’elles débitent normalement.
Etalonnage du débit d’eau :
Lorsque le niveau d’eau est situé à 20 cm au-dessus du déversoir du concentrateur,
contrôler le débit d’eau brute par le temps nécessaire pour remplir les hauteurs d’eau
de 20 cm en 20 cm.
Calcul du débit ; Soit :
t = temps en secondes pour remplir une hauteur de 0,2 m
S = surface du saturateur en m2
q2 = débit en m3 /h d’eau d’alimentation
Le débit mesuré est égal à :
S 0, 2 3600
q2 (m3 /h) =
t
Ce résultat permet de vérifier le débit d’eau brute en fonction de la lecture du
débitmètre.
Etalonnage du débit d’extraction des boues :
- dès que l’étalonnage du débit d’eau brute a été effectué, régler le dispositif
d’automaticité des extractions de boues en chronométrant exactement un
temps d’ouverture de 10 secondes toutes les 2 minutes,
- ouvrir la vanne manuelle d’extraction de boues,
- arrêter le dispositif d’automaticité des extractions
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (84 /138)
(Version Février 2010)
- lorsque le niveau arrive dans le saturateur au-dessous de la goulotte de
reprise, fermer l’arrivée d’eau d’alimentation,
- mettre en route le dispositif d’automaticité en conservant le réglage adopté (10
secondes toutes les 2 minutes),
- contrôler le temps nécessaire pour que le niveau s’abaisse de 0,05 m et
répéter ce contrôle au minimum trois fois,
- noter le nombre d’ouverture de la vanne automatique
Calcul du débit de la vanne : Soit :
t = temps en minutes pour remplir une hauteur de 0,05 m
S = surface du saturateur en m2
q3 = débit en m3 /h d’eau d’alimentation
Le débit d’extraction est égal à :
S 0, 05 3600 2
q3 (m3 /h) =
t
- arrêter le dispositif d’automaticité d’extraction des boues et fermer la vanne
manuelle
Mise en fonctionnement du saturateur :
- lorsque le saturateur est complètement rempli, mettre en route la turbine et
régler la vitesse à moitié de la vitesse maximum
- régler le débit d’eau d’alimentation q2 et le débit de lait de chaux q1 aux
valeurs théoriques fixées (paragraphe )
- régler toutes les 2 heures le débit de lait de chaux de manière à obtenir TAC =
190°
Si TAC < 190, augmenter le débit
Si TAC > 190, diminuer le débit
- le lit de boues se forme en 6 à 12 heures. Pendant cette période effectuer
toutes les heures les contrôles suivants :
temps (h)……………………………………………… :1
débit d’eau d’alimentation ……………………………..
débit lait de chaux……………………………………….
TAC eau de chaux………………………………………
Pourcentage de boues dans colonne centrale…………..
Vitesse de la turbine…………………………………….
Nota : Contrôle du pourcentage de boues en haut de la colonne centrale :
- utiliser une éprouvette de 250 ml,
- prélever 250 ml en haut de la colonne,
- fermer l’éprouvette avec la paume de main et retourner 3 fois pour bien
homogénéiser
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (85 /138)
(Version Février 2010)
- laisser décanter
- lire le volume en ml de boues après 5 minutes de décantation
- le pourcentage de sera égal à : % boues = ml de boues déposées x 0,4
Réglage des extractions :
- lorsque le pourcentage atteint 15 % mettre en service l’extraction automatique
des boues. Régler le dispositif d’automaticité de manière à obtenir un débit
d’extraction égal à 10 % du débit (q1 + q2) ;
- agir sur le réglage en secondes du temps d’ouverture de la vanne
automatique :
q1 q 2
nb secondes =
q3
- si le pourcentage dans la colonne diminue, diminuer les extractions,
- si le pourcentage augmente, augmenter les extractions.
Réglage de la vitesse de la turbine :
- eau de chaux trouble sans remontées de boues :
o augmenter la vitesse de la turbine
- remontées de boues en nuage
o diminuer la vitesse de la turbine
F. FICHE TECHNIQUE APRÈS MISE EN SERVICE :
- date…………………………………………………
- dimensions :
o surface………………………………………
o hauteur cylindrique…………………………
o hauteur conique……………………………..
o débit d’eau d’alimentation (m3 /h) ……………….
o débit de lait de chaux (m3 /h) ………………….
o débit d’eau de chaux (m3 /h) ………………..
o débit d’extraction……………………….
o TAC eau de chaux……………………….
o pourcentage de boues colonne centrale……
o réglage automaticité :
- fréquence (en min)…………………
- durée (en s)…………………………..
Réglage du débit d’eau de chaux :
Le débit nécessaire est celui qui permet d’obtenir dans l’eau traitée le pH d’équilibre
et le TAC nécessaire (test au marbre).
Pour obtenir ce résultat, agir sur le débit d’alimentation q 2 et parallèlement sur le
débit de lait de chaux q1.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (86 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 5
EXPLOITATION DE LA STATION
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (87 /138)
(Version Février 2010)
A. EXPLOITATION EN GENERAL
Dès la fin de la mise en service, l’exploitation nécessite une surveillance générale du
fonctionnement des différents appareils de traitements :
- nettoyage de la grille de la prise d’eau,
- vérification du niveau d’eau dans l’anti-bélier ave réalimentation éventuelle en
air par mise en service du compresseur et ouverture de la vanne,
- surveillance du décanteur (exploitation du PULSATOR : voir paragraphe 5.2)
- surveillance du fonctionnement des filtres en effectuant les lavages
nécessaires lorsque l’encrassement atteint 1,8 à 2 m (lavage d’un filtre : voir
paragraphe)
- surveillance des niveaux dans les bacs de réactifs avec nouveau chargement
dès qu’un bac est vide (rechargement des bacs : paragraphe)
- contrôle à effectuer 3 à 4 fois par jour pour la tenue du journal de
fonctionnement et permettre les rectifications nécessaires au point de vue du
dosage des réactifs
- détermination des taux de traitement journellement, si la qualité de l’eau brute
varie fréquemment. Ces essais peuvent être espacés dans le cas contraire, et
n’être effectué qu’une fois par mois ou à chaque variation de la qualité de
l’eau brute (taux de traitement ;
B. EXPLOITATION DU PULSATOR
En dehors de la question du réactif, l’exploitation d’un PULSATOR s’effectue en
examinant plusieurs fois par jour, et surtout à chaque changement de débit, le niveau
lit de boues et de sa concentration en 10 minutes.
Ceci permet de contrôler à la fois la modification de la nature de l’eau brute par la
floculation et les extractions de boues.
Si les boues deviennent lourdes, on complète ces mesures par un relevé de
concentration du lit à deux hauteurs différentes pour s’assurer de son homogénéité,
et éventuellement corriger les pulsations.
Adaptation du dosage des réactifs à la nature de l’eau brute :
Effectuer les essais de floculation pour déterminer les doses correctes de réactifs.
S’il est souhaitable de faire ces essais le plus souvent possible pour avoir une eau
de qualité constante, on peut se limiter à un essai à chaque variation de la nature de
l’eau brute.
Par contre, en période de crues, ces essais sont à répéter d’autant plus souvent que
celles-ci sont plus fortes et plus soudaines.
Vérification de l’exactitude et de la constance de dosage des doseurs :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (88 /138)
(Version Février 2010)
Si on relève sur l’eau décantée dans les PULSATOR un pH différent de celui obtenu
en laboratoire avec les mêmes doses de réactifs, c’est que la nature de l’eau brute a
varié : ajuster le dosage des réactifs – ou que le dosage des réactifs est déréglé :
vérifier alors le débit et la constance des doseurs.
Adaptation des temps et cadence d’extraction des concentrateurs au débit et à
la nature de l’eau brute :
Le réglage initial des extractions est à corriger sur la base des principes suivants :
- les concentrateurs doivent être suffisamment pleins (environ les ¾)
pour obtenir un tassement correct des boues,
- les temps d’ouverture doivent être tels que les boues évacuées aient
une concentration aussi élevée que possible. Il est inutile de prolonger une
extraction s’il sort de l’eau claire. Le temps d’extraction sera réglé entre 20 et
30 secondes.
Le temps séparant deux ouvertures consécutives d’une même vanne automatique
doit être aussi long que possible, et en tout état de cause, supérieur à 5 minutes.
Par contre, rien n’empêche des extractions plus rapprochées, et même presque
consécutives, sur deux vannes différentes.
Les réglages effectués à la mise en route sont éventuellement à ajuster selon le
débit traité, et à la nature de l’eau brute, en suivant le niveau du lit de boues.
Si le niveau monte lentement au-dessus des concentrateurs, augmenter d’abord la
cadence d’extraction, si nécessaire, les temps d’extraction.
Si cette élévation de niveau est rapide, augmenter simultanément les temps et
cadences, si nécessaire, effectuer à ce moment des purges journalières de fond.
D’une façon générale, le réglage des extractions est à modifier :
- quand la turbidité ou le taux des réactifs introduits varient notablement,
- quand le débit de l’eau brute varie et que l’on désire toujours se limiter à la
valeur minimale de perte d’eau. On peut, dans ce cas, régler les cadences
d’extraction d’une façon sensiblement proportionnelle au débit d’eau brute.
Pulsations :
Surveiller le bon fonctionnement des pulsations, ce qui nécessite :
- l’entretien du ventilateur conformément aux notices du constructeur
- l’entretien de l’interrupteur à flotteur,
- la vérification du bon fonctionnement des galets, des contrepoids,
- la vérification du bon fonctionnement de la vanne automatique de mise à
l’atmosphère
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (89 /138)
(Version Février 2010)
Influence des variations de débit :
Comme nous l’avons déjà vu, il faut adapter le débit des réactifs et des extractions
de boues aux variations de débit d’eau brute.
Quand on réduit le débit d’eau brute, le niveau du lit de boues s’abaisse et sa
concentration augmente. Peu à peu, ce lit de boues se nourrit pour atteindre à
nouveau le niveau des bords supérieurs des concentrateurs. Pendant cette période
transitoire, stopper les extractions automatiques pour les remettre en route au
déversement sur les concentrateurs.
Quand on augmente le débit d’eau brute, le niveau du lit de boues a tendance à
monter. Aussi est – il nécessaire de régler momentanément par excès les
extractions, de façon à absorber l’excès des boues déversées dans les
concentrateurs. Quand l’équilibre est rétabli, on peut revenir au réglage normal
correspondant au débit entrant.
Le niveau supérieur stable des boues doit se trouver entre 5 et 10 cm au-dessus des
bords du concentrateur.
Remontées de boues
Si en surface on observe des remontées boues en nuages, mesurer le pH en
différents points du décanteur et revoir le dosage des réactifs. Toutefois de légères
remontées peuvent se produire par élévation de la température de l’eau du soleil.
C. JOURNAL DE FONCTIONNEMENT
Le journal de fonctionnement comportera :
- la date, le jour et l’heure,
- le débit de la station
- les caractéristiques de l’eau brute :
o turbidité,
o température
o pH
o TAC
o Cl
o Mo
o Couleur
o Fer,
o Manganèse,
- les essais de floculation
- les doses de réactifs utilisées sur la station
- les heures de recharge des bacs, quantité de réactifs introduite, durée de
vidange du bac entre deux recharges,
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (90 /138)
(Version Février 2010)
- pulsation
o aspiration
o chasse
- purges de déconcentration :
o durée
o fréquence,
- caractéristiques de l’eau décantée :
o turbidité
o pH
- degré de colmatage des filtres
- lavage des filtres, heure, durée,
- caractéristiques de l’eau traitée
o turbidité
o température
o pH
o TH
o TAC
o Mo
o Chlore restant (libre et total)
o Couleur
o Fer
o Manganèse
o Analyse bactériologique,
Noter tous accidents et incidents survenus en cours d’exploitation.
Nous insistons sur la bonne tenue de ce journal puisqu’il nous aidera, le cas échéant,
à vous conseiller.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (91 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 6
ENTRETIEN DE LA STATION
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (92 /138)
(Version Février 2010)
A. ENTRETIEN GENERAL
1. Appareillage électromécanique :
Procéder régulièrement au graissage et à l’entretien du matériel suivant les notices
‘constructeur’. Tenir un journal consignant :
- les dates de graissage,
- les dates de remplacement des pièces d’usures
2. Dosage des réactifs :
Bacs de solutions diluées :
- une fois par mois vidanger complètement les bacs
- procéder à un nettoyage complet par jet d’eau,
- effectuer un nouveau chargement pour un bac complètement vide
Saturateur de chaux :
- une fois tous les trois mois, avant un rechargement, procéder à une vidange
complète du saturateur et à son nettoyage au jet de l’intérieur,
- effectuer un nouveau chargement pour un saturateur complètement vide
3. Décanteur PULSATOR :
- tous les six mois procéder à une vidange complète du décanteur,
- le nettoyer au jet et vérifier tous les organes intérieurs,
- toutes les semaines, vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur à flotteur
de commande des PULSATOR
4. Filtre :
- tous les mois mesurer le niveau du sable et après une diminution d’une
hauteur de 10 cm procéder à la recharge du sable manquant (au maximum
une fois par an)
- si la perte en sable est supérieure à cette valeur il faut examiner le
fonctionnement du filtre en marche normale et en lavage (buselures cassées,
encrassées, débit d’eau ou d’air de lavage trop important)
5. Appareillage de mesure et de contrôle :
- toutes les semaines procéder à la vérification et à l’étalonnage éventuel de
ces appareils suivant notices ‘constructeurs’,
- tenir un journal consignant :
o les dates d’intervention
o les incidents constatés
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (93 /138)
(Version Février 2010)
B. ENTRETIEN DES BOITES DE PARTIALISATION
Tous les 15 jours : entretien sur place :
- dévisser les chapeaux supérieurs et inférieurs protégeant la tige
- desserrer la vis fixant le flotteur sur la tige, mais, ne pas desserrer la vis de la
bague qui sert de repère de réglage,
- monter et descendre la tige de la boîte en la nettoyant parfaitement avec un
chiffon légèrement gras (imbibé d’huile de paraffine par exemple),
- faire coulisser le clapet sur la tige, en comprimant plus ou moins le ressort
intérieur ; pour que la boîte assure un bon fonctionnement, il est indispensable
qu’il n’y ait pas blocage du clapet par rapport à la tige que ce clapet se
déplace sur cette tige, sans aucune contrainte autre que l’action du ressort.
- nettoyer à nouveau la tige après avoir fait coulisser le clapet
- vérifier l’état du joint de caoutchouc,
- nettoyer de ses dépôts éventuels,
- refixer ce flotteur sur sa tige, en amenant sa bague de serrage au contact de
la bague repère de réglage qu’on ne doit pas toucher
- huiler légèrement le pas de vis des bouchons-chapeaux supérieurs et
inférieurs, et les remettre en place.
Tous les trois mois : entretien en atelier
- dévisser le flotteur et démonter la boîte de partialisation pour entretenir en
magasin
- démonter la partie supérieure du boîtier et nettoyer soigneusement
l’ensemble : tiges, clapets, corps intérieur et extérieur, ressort intérieur,
- vérifier l’état du joint caoutchouc placé sur le siège,
- si le ressort intérieur ou le joint caoutchouc sont hors d’état, les
changer,
- si la tige a un jeu normal par rapport à ses bagues autolubrifiantes de
guidage, changer ces bagues
- pour la remise en place des nouvelle bagues, ne pas utiliser le maillet
( qui risquerait de créer une contraction des coussinets neufs) mais les
engager par simple pression ; au besoin, passer un léger coup d’alésoir dans
le logement pour faciliter la mise en place des nouvelles bagues,
- graisser les ressorts intérieur et extérieur,
- nettoyer les tiges avec un chiffon légèrement gras
- remonter l’ensemble en s’assurant que le boîtier est parfaitement
étanche, que la tige coulisse bien sur ses coussinets de guidage, et que le
clapet coulisse bien sur la tige.
- prendre soin de remonter la boîte avec sa tige parfaitement verticale
Attention :
Ni les coussinets qui sont autolubrifiants, ni les tiges, ne doivent être graissés ou
huilés, faute de quoi les poussières viennent s’y coller et provoquent le blocage du
clapet par rapport à la tige et le pompage de la régulation.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (94 /138)
(Version Février 2010)
Incident possible :
Si la boîte pompe :
- vérifier s’il n’y a pas eu déréglage du calage ;
- vérifier que le clapet de la boîte coulisse bien sur la tige et nettoyer cette tige
avec un chiffon sec légèrement gras.
C. ETALONNAGE D’UNE SONDE DE pH (tous les 10-15 jours environ) :
La vérification de la partie électronique se fait à ‘aide d’un simulateur de pH.
Ensuite, contrôle de la réponse des électrodes avec des solutions étalons.
Composition des solutions étalons :
- pH = 6,88
o KH2 PO4 (phosphate diacide de potassium)……………….3,404 g
o Na2 HPO4, 2H2 O (phosphate mono acide de sodium)……3,549 g
o amener à 1000 ml avec de l’eau déminéralisée
- pH = 4
o (C6H4) (COOH) (COOK) (phtalate acide de potassium)….10,210 g
o amener à 1000 ml avec de l’eau déminéralisée
- pH = 10
o NH Cl (chlorure d’ammonium)………………………………54 g
o dans 350 ml d’ammoniaque à 25° Bé,
o amener à 1000 ml avec de l’eau déminéralisée
D. NETTOYAGE :
Les mauvaises odeurs et certaines corrosions proviennent principalement des
dépôts de boues stagnant sur les parois et platelages. Pour les éviter, il faut
maintenir en parfait état de propreté, en procédant à un nettoyage périodique
sérieux, si possible au jet d’eau sous pression, de toutes les surfaces pouvant être
salies.
Les canaux, goulottes et déversoirs doivent être au balai-brosse et au jet d’eau. Les
surfaces liquides des différents compartiments seront débarrassées, par écumage
des écumes, boues flottantes et algues pouvant s’y trouver.
Chaque intervention doit faire l’objet d’un ordre de travail dûment signé par le
demandeur.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (95 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 7
INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (96 /138)
(Version Février 2010)
A. PRINCIPAUX INCIDENTS, CAUSES ET REMEDES SUR UN PULSATOR
1. Mauvaises qualités de l’eau clarifiée :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Débit d’eau à traiter supérieur à ce qui prévu le rétablir
Lit de boues non formé Ne pas faire d’extraction de boues avant
la formation correcte du lit de boues
Mauvais réglage de réactifs Vérifier et rétablir le réglage correct
Mauvais réglage des pulsations Rétablir si nécessaire le réglage, voir
chapitre exploitation
2. Concentration du lit de boues non homogène :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Mauvais réglage des pulsations (pour les réglages, ne tenir compte de la
concentration en boues situées à plus de 15
cm en dessous du niveau supérieur du lit de
boues)
- diminuer le temps de chasse
- éventuellement augmenter la hauteur de
chasse
- voir aussi chapitre exploitation
3. Arrêt des pulsations :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Arrêt du ventilateur de mise sous vide Remettre en service
Mauvais réglage de la hauteur de chasse Procéder à un nouveau réglage suivant les
consignes d’exploitation
4. Remontée du lit de boues (remontées en nuages) :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Elévation de température de l’eau sous néant
l’action du soleil
Mauvais dosage des réactifs Les vérifier
pH déficient en différents points du - vérifier le dosage et la distribution des
décanteur réactifs
- vérifier s’il n’y a pas de zone préférentielle
par tassement de boues en certains points
du pulsator, dans ce cas, vidanger le
pulsator et le nettoyer
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (97 /138)
(Version Février 2010)
5. Remontée de tout le lit de boues :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Concentrateurs pleins Voir chapitre concentrateurs pleins
Extractions de boues à l’arrêt Les rétablir
Vannes d’isolement des vannes Les ouvrir
automatiques d’extraction de boues
Mauvais réglage des extractions des boues Rectifier le réglage
6. E/ Concentrateurs pleins
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Extraction des boues à l’arrêt Les remettre en service
Tuyauteries d’extraction des boues Vidanger le pulsator et les concentrateurs
bouchées par un pompage annexe si nécessaire et
déboucher les tuyauteries
B. PRINCIPAUX INCIDENTS CAUSES ET REMEDES SUR UN FILTRE
AQUAZUR
1. Cycle de filtration court :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Taux de matières en suspension plus élevé Vérifier la qualité de l’eau à filtrer et corriger
dans l’eau à filtrer éventuellement celle-ci
Procéder au lavage du filtre
Présence d’algues Voir la stérilisation et l’ajustement du taux de
traitement en sulfate de cuivre
Mauvais lavage du filtre Faire un à plusieurs lavages successifs
2. Perte de sable :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Débit d’eau de lavage trop important vierge Régler le débit d’eau de lavage suivant
chapitre 4.5
Horizontalité du déversoir Vérifier s’il n’ y a pas eu de tassement de
terrain et si c’est le cas il faut meuler ou
reprendre à l’enduit les déversoirs
Débit de balayages trop importants Vérifier et réduire éventuellement
3. Inégalité du soufflage :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Buselures bouchées Nettoyer ou changer les buselures
défectueuses t remettre un joint neuf
Buselures cassées Changer les buselures et remettre un joint
neuf
Joint d’étanchéité défectueux Enlever le sable sur le joint défectueux et le
reprendre suivant les plans d’exécution
Porosité des dalles Faire un enduit des porosités et bien laisser
sécher avant et après enduit
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (98 /138)
(Version Février 2010)
4. Variation de perte de charge au démarrage :
CAUSES PROBABLES INTERVENTIONS
Vitesse de filtration ayant changée Vérifier l’équirépartition de l’eau (brute ou
décantée) sur les filtres (par exemple
nombre de filtres en fonctionnement ayant
changé)
Horizontalité du déversoir Vérifier s’il n’ y a pas eu de tassement de
terrain et si c’est le cas il faut meuler ou
reprendre à l’enduit les déversoirs
Sable encrassé par algues ou matières Lavage énergique (périodes successives
organiques soufflage et rinçage) chloration importante
pour détruire les algues
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (99 /138)
(Version Février 2010)
CHAPITRE 8
ARRET DE L’INSTALLATION
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (100 /138)
(Version Février 2010)
D. ARRET DE L’INSTALLATION D’EAU BRUTE
Arrêt de courte durée :
- fermer les vannes murales d’alimentation de la fosse d’eau brute
- stopper la ou les pompes d’eau brute
- vérifier l’arrêt des pompes d’arrosage des paliers et la fermeture de la vanne
automatique de refoulement
Arrêt de longue durée :
- procéder à l’arrêt des pompes comme indiqué ci-dessus
- mettre hors – service les décanteurs pulsator, le dégrillage automatique et les
filtres AQUAZUR
E. ARRET D’UN PULSATOR
Arrêt de courte durée :
- procéder à la mise hors service du dispositif de pulsations (ventilateur), après
isolement du pulsator
Arrêt de longue durée :
- procéder à l’extraction complète des boues des concentrateurs, dans le cas
d’une vérification interne de l’appareil par exemple
- le redémarrage du pulsator s’effectue de façon identique à une première mise
en service
F. ARRET D’UN FILTRE
Arrêt de courte durée :
- après isolement du filtre par fermeture de la vanne d’entrée d’eau, laisser le
filtre en eau
Arrêt de longue durée :
- procéder à la vidange du filtre
- en cas d’appoint de sable dans le filtre, procéder à un lavage avant remise en
service
- si nécessaire, procéder au réglage du régulateur hydraulique
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (101 /138)
(Version Février 2010)
ANNEXES :
ANNEXE A : Méthodes d’Analyse
ANNEXE B : Détermination des taux de traitement
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (102 /138)
(Version Février 2010)
ANNEXE A : Méthodes d’Analyse
SOMMAIRE
Pages
TA A.2
TAC A.4
TH A.6
CI A.8
TAC A.10
MESURE COLORIMETRIQUE DU CHLORE A.12
MESURE COLORIMETRIQUE DU FER A.13
MESURE COLORIMETRIQUE DU PH A.15
MESURE DE LA TENEUR EN MATIERES ORGANIQUES A.17
CO2 LIBRE A.21
DOSAGE DE L’OXYDE DISSOUS A.24
MESURE DE LA COULEUR A.28
MESURE DE LA TURBIDINITE A.30
DETERMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION DANS LES EAUX A.32
DOSAGE COLORIMETRIQUE DES IONS AMMONIUM A.34
MESURE DU PH DES EAUX A.40
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (103 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DU TITRE ALCALIMETRIQUE (TA)
PRINCIPE
Dosage de l’alcalinité par un acide fort. La fin de la réaction est indiquée par la
phénolphtaléine.
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixième de milliers (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un compte-gouttes.
REACTIFS
- phénolphtaléine à 1 % ;
o dissoudre 10 g de de phénolphtaléine (FORMULE page A2) dans
990 g d’alcool absolu.
- liqueur alcalimétrique : solution d’acide N/25 /
o acide chlorhydrique : préparer une solution normale (N) contenant
36,465 g de HCl en produit pur par litre. On pourra obtenir 1 000 ml
d’une solution N/25 en prenant 40 ml de la solution (N) que l’on
complètera avec 960 ml d’eau distillée.
o acide sulfurique : préparer une solution normale (N) contenant
49,à’& g de H2SO en produit pur par litre. On pourra obtenir 1 000
ml d’une solution N/25 en prenant 40 ml de la solution (N) que l’on
complètera avec 960 ml d’eau distillée.
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution alcamétrique jusqu’au trait zéro ;
- introduire 100 ml d’eau sous analyse dans l’erlenmeyer ;
- ajouter 4 à 5 gouttes de phénolphtaléine : la solution vire au rouge ;
- verser la solution alcamétrique goutte à goutte jusqu’à disparition de la
coloration ;
- lire le TA directement sur la burette en degré français.
Nota : si l’analyse est effectuée à l’aide d’une burette graduée en ml et si Vml est le
volume d’acide utilisé, le TA s’exprime : en degré français :
REMARQUE :
Il est pratique de mesurer TA et TAC en une seule manipulation. Pour cela, appliquer
la méthode d’analyse du TA et noyer le résultat. Une fois l’échantillon sous analyse
décoloré, y ajouter quelques gouttes d’hélianthine et suivre la méthode ci-dessus
sans remettre de la liqueur dans la burette. Noter la lecture finale qui est le TAC.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (104 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DU TITRE ALCALIMETRIQUE COMPLET (TAC)
PRINCIPE
Dosage de l’alcalinité par un acide fort. La fin de la réaction est indiquée par le
méthylorange (ou hélianthine).
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixième de milliers (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un compte – goutte.
REACTIFS
- liqueur alcalimétrique : solution d’acide N/25 :
- acide chlorhydrique :
o préparer une solution normale (N) contenant 36,’-( g de HCl en
produit pur par litre. On pourra obtenir 1 000 ml d’une solution N/25
en prenant 40 ml de la solution (N) que l’on complètera avec 960 ml
d’eau distillée.
- hélianthine à 1 % :
o dissoudre 10 g d’hélianthine (FORMULE page A4) dans 1 000 ml
d’eau distillée.
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution alcalimétrique jusqu’au trait zéro ;
- introduire 100 ml d’eau sous analyse dans l’erlenmeyer ;
- ajouter quelques gouttes d’hélianthine : la solution vire au jaune ;
- verser la solution alcalimétrique jusqu’à virage à l’orange ;
- lire le TAC directement sur la burette en degré français ;
NOTA : si l’analyse est effectuée à l’aide d’une burette graduée en ml et si Vml est le
volume d’acide utilisé, le TAC s’exprime :
REMARQUE :
Il est pratique de mesurer TA et TAC en une seule manipulation. Pour cela, appliquer
la méthode d’analyse du TA et noter le résultat. Une fois l’échantillon sous analyse
décoloré, y ajouter quelques gouttes d’hélianthine et suivre la méthode ci-dessus
sans remettre de la liqueur dans la burette. Noter la lecture finale qui est le TAC.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (105 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DE LA DURETE TOTALE – TH (Ca et Mg)
(Méthode au complexon)
PRINCIPE
Formation des complexes des ions Ca++ et Mg++ avec une solution tirée de sel
dissodique de l’acide éthylène diamètre tétracétique (EDTA) en milieu tamponné à
Ph1à ; La fin de la réaction est indiquée par le noir érichrome T.
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixièmes de milliers (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un compte-gouttes.
REACTIFS
- noir érichrome T (NET) en poudre ou en solution :
o NET………………………………………….. 0,25 g
o alcool absolu………………………………….100 ml
Solution à garder à l’abri de la lumière.
- solution tampon K10 :
o NH4Cl………………………………………… 34 g
o ammoniaque concentré…………………… 285 ml
o tartrate double de K et na………………… 200 g
o eau distillée (q.s.p)…………………………1 000 ml
- solution d’EDTA (ou « complexon III ») N/25 :
o sel dissoute de l’acide éthylène diamètre tétracétique 7,44 g
o chlorure de magnésium (formule)……………… 0,2
o eau distillée…………………………………….. 1 000 ml
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution d’EDTA jusqu’au trait zéro ;
- introduire 100 ml d’eau sous analyse dans l’erlenmeyer ;
- ajouter 20 gouttes environ de K 10 et 5 gouttes environ de NET (ou une
pincée de NET en poudre) : la solution vire au rouge vineux en présence
de TH ;
- verser la solution d’EDTA jusqu’au virage au bleu franc (la réaction est
accélérer par chauffage à 45 °C) ;
- lire le TH directement en degré français sur la burette.
NOTA : si l’analyse est effectuée à l’aide d’une burette graduée en ml et si V ml est
le volume d’EDTA utilisé, la burette totale TH s’exprime :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (106 /138)
(Version Février 2010)
DOSAGE DES CHLORURES (C1)
PRINCIPE
Le dosage volumétrique se fait par argentimétrie.
Une solution de nitrate d’argent précipite les ions chlorures CI sous formule de
chlorure d’argent blanc Agc12.
La fin de la réaction est marquée par l’apparition d’ions Ag+ libres. Elle est repérée
par le chrome de potassium qui précipite les ions Ag+ sous formule de chromate
d’argent rouge.
Cette analyse se fait à Ph légèrement basique.
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixièmes de millilitres (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un compte-gouttes.
REACTIFS
- dichromate de potassium à 10 % :
o dissoudre 100 g de dichromate de potassium (FORMULE page A8)
sec dans 1 000 ml d’eau distillée.
- acide oxalique à 10 % :
o dissoudre 100 g d’acide oxalique (FORMULE) dans 1 000 ml d’eau
distillée.
- phénolphtaléine à 1 % :
o dissoudre 10 g de phénolphtaléine (FORMULE ) dans 1 000 ml
d’eau distillée.
- nitrate d’argent N/25 :
o dissoudre 6,7956 g de AgN03 pour analyses (préalablement séché
à 110 °C et refroidir au dessiccateur) dans 1 000 ml d’eau distillée ;
o conserver cette solution N/25 à l’abri de la lumière pour éviter sa
décomposition.
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution de nitrate d’argent jusqu’au trait zéro ;
- introduire 100 ml sous analyse dans un erlenmeyer ;
- ajouter3 à 4 gouttes de phénolphtaléine. Si l’eau devient rose, ajouter
goutte à goutte de l’acide oxalique jusqu’à décoloration. Introduire 4 à 5
gouttes de dichromate de potassium à 10 % : la solution vire au jaune ;
- verser le nitrate d’agent jusqu’à apparition d’une coloration rouge brique ;
- lire le volume A sur la burette ;
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (107 /138)
(Version Février 2010)
- effectuer un essai à blanc de l’eau distillée. Effectuer la même opération
que ci-dessus et lire le volume B sur la burette.
EXPRESION DES RESULTATS
Le titre en chlorure exprimé en degré français est A-B.
NOTE : si la burette est graduée en ml et si V en ml = (FORMULE page A9)
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (108 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DU TAC (eau de chaux)
PRINCIPE
Dosage de l’alcalinité en Ca (OH) par un acide fort. La fin de la réaction est indiquée
par le méthylorange (ou hélianthine).
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixième de millilitres (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un compte-gouttes.
REACTIFS
- liqueur alcalimétrique : solution d’acide N/25 :
o acide chloridrique : préparer une solution normale (N) contenant
36,465 g de HC1 en produit pur par litre. Un pourra obtenir 1 000 ml
d’une solution N/25 en prenant 40 ml de la solution (N) que l’on
complétera avec 960 ml d’eau distillée.
o acide sulfurique : préparer une solution normale (N) 49,041 g de
H2SO4 en produit pur par litre. On pourra obtenir 1 000 ml d’une
solution N/25 en prenant 40 ml de la solution (N) que l’on
complétera avec 960 ml d’eau distillée.
- hélianthine à 1 % :
o dissoudre 10 g d’hélianthine (FORMULE page A10) dans 1000 ml
d’eau distillée.
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution alcalimétrique jusqu’au trait zéro ;
- introduire 10 ml d’eau sous analyse dans l’erlenmeyer ;
- ajouter quelques gouttes d’hélianthine : la solution vire au jauge ;
- verser la solution alcalimétrique jusqu’au virage à l’orange ;
- lire sur la burette le nombre de degrés français, soit A. Le TAC de l’eau de
chaux sera : Ax10.
- NOTA : si l’analyse est effectuée à l’aide d’une burette graduée en ml et si
V ml est le volume d’acide utilisé, le TAC de l’eau de chaux s’exprime en
degré français :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (109 /138)
(Version Février 2010)
MESURE COLORIQUE DU CHLORE
PRINCIPE
L’orthotolidine, indicateur d’oxydoréduction, prend en présence de chlore en milieu
acide une coloration jaune d’intensité croissance avec la concentration en chlore.
MATERIEL
- un comparateur HYDROCURE ;
- deux cuvettes graduées A et B.
- une plaquette « Chlore 0,1 à 2 mg/1 »
REACTIFS
- orthotololidique à 1 000 l dans une solution à 10 % d’acide chlorhydrique
pur pour analyse.
MODE OPERATOIRE
- rincer les deux cuvettes avec de l’eau analyser et bien les égoutter ;
- remplir l’une des cuvettes jusqu’au trait B avec l’eau à analyser et la placer
du côté opposé au repère « réactifs » ;
- remplir l’autre cuvette d’eau à analyser, ajouter 10 gouttes d’orthotolidine,
mélanger et la placer du côté repère « réactifs » ;
- introduire immédiatement la plaquette « Chlore 0,1 à 2 mg/l » dans le
logement situé sous la face antérieure du comparateur et effectuer la
lecture immédiatement en faisant coulisser la plaquette jusqu’à apparition
de l’écran coloré de même teinte que l’échantillon additionné
d’orthotolidine ;
- la lecture donne la teneur en chlore libre ;
- attendre 10 minutes et effectuer la lecture comme précédemment ;
- la lecture donne la teneur en chlore total ;
- si la teinte de l’eau analysée est comprise entre celles de deux écrans
colorés, prendre la moyenne des valeurs correspondant à ces deux écrans
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (110 /138)
(Version Février 2010)
MESURE COLORIMETRIQUE DU FER
(Méthode hydrocure)
PRINCIPE
En milieu ammoniacal, la solution alcoolique de diméthyglyoxime donne avec le fer
amené à l’état ferreux, un complexe dont la coloration rose a une intensité
croissance avec la concentration en fer.
MATERIEL
- un comparateur HYDROCURE ;
- deux cuvettes graduées A et B ;
- un flacon gradué de 125 ml avec bouchon ;
- une plaquette « fer 0,3 à 5 mg/l ;
- une plaquette « fer 0,06 à 1 mg/l.
REACTIFS
- ammoniaque pur pour analyse ;
- diméthyglyoxime en solution saturée, dans l’alcool à 95 % ;
- hydrosulfite en poudre.
MODE OPERATOIRE
- mesurer 100 ml d’eau à analyser dans le flacon gradué. L’eau à analyser
doit avoir un Ph de 6 à 8 et une température de 15 à 20°C. Ajouter une
pincée d’hydrosulfite. Fermer le flacon et agiter jusqu’à dissolution
complète. Attendre 5 minutes ;
- ajouter 16 gouttes de diméthyglyoxime et 16 gouttes d’ammoniaque.
Agiter. Attendre 15 minutes ;
- rincer les deux cuvettes avec de l’eau à analyser et bien les égoutter ;
- remplir l’une des cuvettes jusqu’au trait B avec l’eau à analyser additionnée
de réactifs .
- placer cette cuvette dans le compartiment du côté repère « Réactifs » ;
- remplir l’autre cuvette avec de l’eau à analyser et la placer dans le
compartiment à côté de la précédente ;
- introduire la plaquette « Fer 0,06 à 1 mg/l dans le logement se trouvant à la
partie supérieure du comparateur et effectuer la lecture en faisant coulisser
la plaquette jusqu’à apparition de l’écran coloré de même teinte que
l’échantillon de réactifs ;
- si la teneur est supérieure à 1 ml/l prendre la plaque « Fer 0,3 à 5 mg/l et
introduire dans le logement situé sous la face antérieure du comparateur.
Effectuer la lecture comme précédemment ;
- si la teinte de l’eau est comprise entre celle de deux écrans colorés,
prendre la moyenne des valeurs correspondantes à ces deux écrans.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (111 /138)
(Version Février 2010)
MESURE COLORIMETRIQUE DU PH
(Méthode HYDROCURE)
PRINCIPE
En fonction du Ph présumé de l’eau à analyser le comparateur est utilisé avec l’une
des plaquettes à écrans colorés couvrant la gamme des PH à mesurer, l’eau étant
additionnée de l’indicateur coloré précisé sur le plaquette.
MATERIEL
- un comparateur HYDROCURE ;
- deux cuvettes graduées A et B ;
- plaquette «pH 5,2 à 6,8 » ;
- plaquette « pH 6,0 à 7,6 »;
- plaquette « Ph 7,0 à 8,6 »
REACTIFS (HYDROCURE)
- rouge de chlorophénol à 0,04 % dans alcool à 95 % ;
- bleu de bromothymol à 0,04 % dans alcool à 95 % ;
- rouge de phénol à 0,02 % dans eau distillée.
NOTA : durée de conservation des solutions : 6 à 12 mois à l’abri de la lumière.
MODE OPERATOIRE
- rincer les deux cuvettes avec de l’eau à analyser et bien les égoutter ;
- remplir l’une des cuvettes jusqu’au trait B avec de l’eau à analyser, ajouter
le nombre de gouttes indiqué sur le flacon d’indicateur coloré
correspondant à la plaquette choisie. Mélanger en traversant le tout dans
l’autre. Placer cette cuvette dans le compartiment du côté repère
« Réactifs ».
- rincer la cuvette vide, la remplir jusqu’au trait B avec l’eau à analyser et la
placer dans le comparateur à côté de la précédente ;
- introduire la plaquette Ph choisie dans le logement situé sous la face
antérieure du comparateur et effectuer la lecture en faisant coulisser la
plaquette jusqu’à apparition de l’écran coloré de même teinte que
l’échantillon additionné d’indicateur ;
- si la teinte de l’eau analysée est comprise entre celles de deux écrans
colorés, prendre la moyenne des valeurs correspondant à ces deux
écrans.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (112 /138)
(Version Février 2010)
MESURE COLORIMETRIQUE DU MANGANESE
(Méthode HYDROCURE)
PRINCIPE
En présence de periodate en milieu acétique, l’ion manganèse est oxydé et réagit
avec le tétraméthyl-diamino-diphénylméthane en développant pendant 15 à 30
secondes une coloration bleue d’intensité croissante avec la concentration en
manganèse.
MATERIEL
- un comparateur HYDROCURE ;
- deux cuvettes graduées A et B ;
- un flacon de 125 ml avec bouchon ;
- une plaquette « Manganèse 0,05 à 2 mg/l ».
REACTIFS
- acide acétique au ½ ;
- indicateur TDD à 0,1 % de tétraméthyl-diamino-diphélméthane dans
l’alcool à 95 °
- neutralisant : soude 0,5 N ;
- periodate de sodium en cristaux pur pour analyse.
MODE OPERATOIRE
- mesurer le Ph de l’eau à analyser. S’il est inférieur à 7, l’amener à cette
valeur à l’aide d’une ou plusieurs gouttes de neutralisant ;
- rincer les deux cuvettes avec l’eau neutralisée et bien les égoutter ;
- remplir l’une des cuvettes jusqu’au trait A avec l’eau neutralisée et la placer
dans le comparateur du côté opposé au repère « Réactifs » ;
- remplir l’autre cuvette jusqu’au trait A, ajouter 3 grains de periodate de
sodium et agiter jusqu’à dissolution ;
- ajouter 6 gouttes acétique, 12 gouttes d’indicateur TDD, agiter et placer la
cuvette dans le comparateur du côté repère « Réactifs » ;
- introduire immédiatement la plaquette « Manganèse 0,02 mg/l dans le
logement situé sous la face antérieurs du comparateur et effectuer la
lecture immédiatement en faisant coulisser la plaquette que l’échantillon
additionné de réactifs ;
- si la teinte de l’eau analysée est comprise entre celle de deux écrans
colorés, prendre la moyenne des valeurs correspondant à ces deux
écrans.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (113 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DE LA TENEUR EN MATIERE ORGANIQUE
(MO en milieu acide)
PRINCIPE
Le permanganate de potassium fournit, en milieu acide, la quantité d’oxygène
nécessaire à l’oxydation totale des matières organiques d’origines diverses
contenues dans l’eau.
MATERIEL
- une burette graduée en degré français, et son support, ou une burette
graduée en dixième de millilitres (voir nota) ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une éprouvette de 100 ml ;
- trois pipettes de 10 ml graduées en dixièmes de millilitres.
REACTIFS
- solution de permanganate de potassium N/80 :
o une solution normale (N) contient 31,6068 g de KMn04 en produit
pur par litre ;
o à partir d’une solution N/10 contenant 3,1607 g de KMn04 pur par
litre, on pourra obtenir 1 000 ml d’une solution N/80 en prenant 125
ml de la solution N/10 que l’on complète avec 875 ml d’eau distillée ;
- solution de sel de Mohr (sulfate de fer et d’ammonium) à 0,5 % :
o dissoudre 5 g de sel de Mohr en produit pur dans 500 ml d’eau
distillée additionnée de 5 ml d’acide en produit pur. Compléter à 1
000 ml. On obtient une solution à 0,5 %.
- solution d’acide sulfurique au ½ en volume :
o diluer 50 ml de H2SO4 en produit pur dans 50 ml d’eau distillée.
Verser toujours l’acide dans l’eau. Refroidir pendant la préparation
pour éviter l’ébullition par réaction exothermique.
MODE OPERATOIRE
- introduire 100 ml d’eau sous analyse dans l’erlenmeyer. Ajouter 2,5 ml
d’acide sulfurique au 1/2 , puis porter à ébullition. Introduire alors 10 ml de
permanganate de potassium N/80 et maintenir à ébullition 10 ml de
solution de sel de Mohr. ;
- remplir la burette avec la solution de permanganate N/80 jusqu’au trait
zéro ;
- verser goutte à goutte la burette jusqu’à une légère teinte rose. Soit le
nombre de degrés français versé ;
- effectuer un essai à blanc avec les mêmes quantités de réactifs, sans
utiliser d’eau. Soit B le nombre de degrés français versé.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (114 /138)
(Version Février 2010)
EXPRESSION DES RESULTATS
La teneur en matières organiques dans l’eau analysée, exprimée en mg/l d’oxygène
est :
FORMULE page A20)
Nota : si l’analyse est effectuée à l’aide d’une burette graduée en ml et si A et B sont
les volumes de permanganate de potassium utilisés :
FORMULE A20
Les résultats sont légèrement exprimés en mg/l d’O2 mais peuvent l’être parfois en
mg/l de KMn04
FORMULE
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (115 /138)
(Version Février 2010)
DOSAGE DE L’ANHYDRIQUE CARBONIQUE LIBRE
(C02 LIBRE)
PRINCIPE
Le dosage de l’ana hydrique carbonique (C02) se fait par retour.
L’eau sous analyse est recueillies sur une quantité de liqueur basique légèrement
supérieure à celle qui est nécessaire pour neutraliser le C02 . La liqueur basique en
excès est ensuite dosée, en présence de phénolphtaléine, par une solution titrée
d’acide fort.
MATERIEL
- une burette graduée en dixièmes de millilitres ;
- une fiole jaugée de 200 ml avec bouchon de caoutchouc ;
- un erlenmeyer ou un bécher de 500 ml ;
- des pipettes de précision de 5ml,, 10 ml, 20 ml ;
- un compte-gouttes.
REACTIFS
- phénolphtaléine à 1% :
o dissoudre 10 g de phénolphtaléine (FORMULE) dans 990 g d’alcool
absolu.
- liqueur basique : solution d’hydroxyde de sodium environ N/40 :
o dissoudre 66 g de tartrate double de sodium et de potassium ou sel
de seignette, dans 500 ml d’hydroxyde de sodium N/20 : compléter
à 1 000 ml avec de l’eau distillée ;
o solution d’hydroxyde de sodium N/20 : préparer une solution
normale (N) contenant 40 g de Na0H en produit pur par litre. On
pourra obtenir 1 000 ml d’une solution N/20 en prenant 50 ml de la
solution (N) que l’on complétera avec 950 ml d’eau distillée.
- solution d’acide chlorhydrique N/10 :
o préparer une solution normale (N) contenant 36,645 g de HCl en
produit pur par litre. On pourra obtenir 1 000 ml d’une solution N/10
en pranant 100 ml de la solution (N) que l’on complètera avec 900
ml d’eau distillée.
MODE OPERATOIRE
- remplir la burette avec la solution d’acide chlorhydrique n/10 jusqu’au trait
zéro ;
- introduire un volume V=10 ml de solution de sodium N/40 dans une fiole
jaugée de 200 ml ;
- ajouter 6 à 8 gouttes de phénolphtaléine ;
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (116 /138)
(Version Février 2010)
- ajuster au trait de jauge avec de l’eau sous analyse, recueillie sans
agitation ni carbonate d’air ;
- fermer la fiole avec un bouchon en caoutchouc. La retourner pour
homogénéiser. La solution doit devenir rose, sinon introduire une plus
grande quantité d’hydroxyde de sodium (les 10 ml de Na0H permettent de
doser jusqu’à 50 mg/l de C02) ;
- verser dans un erlenmeyer de 500 ml en ajoutant le produit du rinçage de
la fiole jaugée avec de l’eau distillée fraichement bouillie et refroidir (eau
exemple de C02) ;
- tirer à l’acide chlorhydrique N/20 jusqu’à décoration du rose au blanc. Soit
A ml, le volume d’acide versé ;
- effectuer un essai à blanc sur l’hydroxyde de sodium, soit B ml volume
d’acide versé.
EXPRESSION DES RESULTAT
Si V le volume, en millilitres, de la prise d’essai (V= 200 –v).
La quantité d’anhydride carbonique libre contenu dans l’eau est :
FORMULE page A22
INTERFERENCE
La dureté totale (TH) de la solution sous analyse influe sur la netteté du virage de la
phénolphtaléine et donc sur le dosage. Pour une grande précision, majorer le résultat
de 1 ml/l de C02 par 10,9°F de dureté totale.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (117 /138)
(Version Février 2010)
DOSAGE DE L’OXYGENE DISSOUS
(Méthode de WINKLER)
PRINCIPE
Dosage par iodimètrie.
L’oxygène de l’eau oxyde un iodure en iode. L’iode libéré est dosé par une solution
d’hyposulfite de sodium.
La fin de la réaction est indiquée par l’emploi d’amidon ou le thiodène.
MATERIEL
- une fiole jaugée de 100 ml ;
- un flacon de 125 ml à bouchon émeri ;
- un erlenmeyer de 250 ml ;
- une burette de 25 ml et son support ;
- un compte – gouttes ;
- trois pipettes bâtons de 1 ou 2 ml.
Si plusieurs dosages doivent être réalisés simultanément, il suffit de se munir du
nombre correspondant de flacons de 125 ml. Le reste du matériel est commun
(rincer toutefois la fiole jaugée et l’erlenmeyer à l’eau distillée après chaque dosage).
REACTIFS
- solution de sulfate de manganèse à 400 g/l :
o dissoudre 400 g de sulfate de manganèse (MnS04, 2H20) dans 1
000 ml d’eau distillée.
- solution d’iodure de potassium :
o dissoudre 700 g de potasse (KOH) et 150 g d’iodure de potassium
(KI) dans 960 ml d’eau distillée ;
o dissoudre 10 g d’azoture de sodium (NaN3) dans 40 ml d’eau
distillée ;
o mélanger les deux solutions.
- acide sulfurique au ½ :
o verser progressivement 500 ml d’acide sulfurique concentré
(H2S04) dans 500 ml d’eau distillée ;
o réaction dégage beaucoup de chaleur et le liquide s’échauffe assez
fortement. C’est pourquoi il faut verser progressivement l’acide et
refroidir sous un courant d’eau le récipient. Utiliser du verre PYREX
pour réaliser la dilution.
- solution d’hyposulfite de sodium N/80 :
o préparer une solution mère décinormale (N/10) contenant 24,82 g
d’hyposulfite de sodium (Na2S202. 5H20) en produit pur par litre ;
o prélever 125 ml de la solution obtenue et réajuster à 1 000 ml. La
solution est N/80.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (118 /138)
(Version Février 2010)
NOTA : la solution mère N/10 peut être conservée environ un mois au réfrigérateur.
- solution d’emplois d’amidon contenant 1,25 G :l d’acide salicylique :
o cette solution, dont la préparation est susceptible de poser un
problème dans certains stations, pourra être remplacée par du
THIODENE, qui se présente sous la forme d’un solide cristallisé
dont on assure la conservation en flacon à l’abri de l’air.
NOTA : tous ces réactifs sont stables, sauf l’hyposulfite qui ne doit pas être conservé
plus d’un mois au grand maximum.
La solution d’hyposulfite doit être vérifiée fréquemment à l’aide d’une solution titrée
d’iode N/80 de conservation plus stable. Un volume d’hyposulfite doit neutraliser un
volume égal d’iode N/80.
MODE OPERATOIRE
- remplir le flacon de 125 ml à couchon émeri avec de l’eau sous analyse,
sans entraîner ou provoquer de bulles d’air (pratiquer pour cela par
siphonage) ;
- avec une pipette bâton de 1 à 2 ml, introduire dans l’eau 1 ml de solution
de sulfate de manganèse ; pour cela cette opération, l’extrémité de la
pipette doit plonger dans l’eau ;
- de la même façon, avec une autre pipette, introduire 1 ml de solution
d’iodure de potassium ;
- boucher le flacon, en prenant bien soin de ne pas retenir de bulles d’air
dans le flacon ;
- agiter lentement ; il se forme un précipité dont la couleur varie du blanc au
brun-orange suivant le teneur en oxygène dissous ;
- laisser la réaction s’opérer 10 minutes ;
- après ces minutes, ouvrier le flacon et introduire à l’aide d’une pipette
bâton dont l’extrémité plonge dans l’eau, 1 ml d’acide sulfurique au ½ ;
- reboucher le flacon sans bulle d’air et agiter ; le précipité se dissout et le
liquide devient lipide et présente une couleur jaune plus ou moins foncée,
ou est incolore, suivant la teneur en oxygène dissous ;
- à partir de ce moment, il est possible de manipuler sans précautions
spéciales contre les bulles d’air ;
- à l’aide d’une fiole jaugée, prélever 100 ml du liquide et les verser dans un
erlenmeyer de 250 ; rincer la fiole avec un peu d’eau distillée et verser
cette eau de rinçage dans l’erlenmeyer ;
- remplir une burette de 25 ml ave l’hyposulfite de sodium N/80 ; amener le
niveau au zéro ;
- introduire l’hyposulfite (contenu dans la burette) dans l’erlenmeyer en
agitant légèrement ce dernier, jusqu’à décoloration presque complète du
liquide (jaune très pâle) ;
- ajouter alors dans le liquide quelques gouttes d’emplois d’amidon ; il se
développe une couleur bleue (si la couleur n’apparaît pas, c’est que la
quantité d’hyposulfite introduit dans l’erlenmeyer est trop grande ; il faut
recommencer alors toutes les opérations) ;
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (119 /138)
(Version Février 2010)
- continuer l’addition d’hyposulfite jusqu’à disparition de la couleur bleue.
Vers la fin du dosage, l’hyposulfite doit être introduit goutte à goutte ;
- une fois la décoloration complète obtenue, arrêter l’addition d’hyposulfite et
ne pas tenir compte d’une recoloration.
EXPRESSION DES RESULTATS
La teneur en oxygène en mg/l de l’eau analysée est égale au volume en ml
d’hyposulfite N/80 versé dans les 100 ml de liquide.
Exemple :
5 ml d’hyposulfite = 5 mg/l d’oxygène dissous.
INTERFERENCES
Cette méthode est à proscrire chaque fois que l’on sera en présence d’eau contenant
des réducteurs susceptibles de mobiliser l’iode formé lors de la mesure. Ce sera le
cas, exemple, des eaux chromatées, des eaux contenant des acides aminés purs,
etc.….
L’introduction d’azoture de sodium permet la mesure sur des eaux contenant moins
de 0,1 mg/l d’azote nitreux et moins de 0,5 mg/l de fer ferreux.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (120 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DE LA COULEUR
PRINCIPE
La coloration de l’eau est comparée à celle de solutions étalons de platine-cobalt.
MATERIEL
- un tube de NESSLER ;
- matériel nécessaire pour réaliser des dissolutions :
o fioles jaugées ;
o pipettes.
- étalons de couleur.
REACTIFS
- solution étalon de platine-cobalt, de couleur 500 : dissoudre 1,245 g de
chloroplatine de potassium (K2 Pt Cl6) et 1g de chlorure de cobalt
cristallisé (C0 Cl2, 6H20) dans 400 ml d’eau distillée et 100 ml d’acide
chlorhydrique pur pour analyses. Compléter à 1 000 ml avec de l’eau
distillée ; Cette solution a une couleur de 500 unités par définition.
- solution de comparaison : il est utilisé couramment des solutions de
couleurs 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 70. Elles s’obtiennent par
dissolution au 1/100,1/50 etc. de la solution ci-dessous dans de l’eau
distillée. Ces solutions sont gardées dans des tubes de NESSLER, à l’abri
de la poussière.
MODE OPERATOIRE
- remplir un tube de NESSLER avec l’eau sous analyses ;
- faire la comparaison avec les tubes étalons en regardant verticalement
vers le bas à travers les tubes, au-dessus d’une surface réfléchissant la
lumière à travers la colonne liquide ;
- si l’eau présente des matières en suspension, éliminer celles-ci par
centrifugation ;
- si l’eau présente une couleur supérieure à 70 unités, la diluer avec de
l’eau distillée.
EXPRESSIONS DES RESULTATS
L’unité de couleur correspond à 1 mg de platine au litre.
Les lectures sont exprimées directement en milligrammes de platine au litre, et sont
exprimées en nombre entier le plus proche.
METHODE DE TERRAIN
L’eau sous analyse est comparée avec des écrans colorés étalonnés et gradués en
mg/l de platine.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (121 /138)
(Version Février 2010)
MESURE DE LA TURBIDITE
PRINCIPE
Un échantillon est soumis à un faisceau optique déterminé et l’intensité de la lumière
diffusée, à 90° de l’axe du faisceau incident, est mesurée par une cellule photo-
électrique.
Cette intensité, relevée sur un écran gradué, est comparée à celles de solutions
étalons utilisées dans les mêmes conditions.
MATERIEL
- turbidimètre équipé de cuves de mesure ;
- étalon de turbidité.
REACTIFS
- suspension étalon de formazine, de turbidité 400 :
o solution 1 : dissoudre 1 g de sulfate d’hydrazine (N2H2. H2S04)
dans 100 ml exactement d’eau distillée.
o solution 2 : dissoudre 10 g d’hexaméthylène tétramine (dans 50 ml
d’eau distillée, en chauffant légèrement. Après refroidissement,
ajuster le volume à 100 ml exactement avec de l’eau distillée.
Introduire 5 ml de solution 1, et 5 ml de solution 2 dans une fiole
jaugée de 100 ml. Ajuster le volume à 100 ml avec de l’eau distillée.
Bien homogénéiser et laisser au repos durant 48 heures, à 20°C. Le
liquide devient opalescent. On obtient ainsi une suspension étalon à
400 unités de turbidité, à 20°C.
- solution de comparaison : elles s’obtiennent par dilution de la suspension
étalon à l’aide d’eau distillée et sont gardées à l’abri de la poussière.
MODE OPERATOIRE
- effectuer toutes les opérations suivantes à la même température ;
- tracer une courbe d’étalonnage avec la gamme étalon préparée comme ci-
dessus ;
- effectuer une mesure avec l’eau sous analyse ; relever l’indication du
cadran ;
- lire le résultat en reportant l’indication du cadran sur la courbe
d’étalonnage.
EXPRESSION DES RESULTATS
La turbine peut s’exprimer en trois unités parfaitement équivalentes :
- JTU : Jackson Turidity Units ;
- NTU : Nephelometric Tubitidy Units ;
- FTU: Formazin Turbidity Units.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (122 /138)
(Version Février 2010)
AUTRE S UNITES TURBIDITE
L’appareil peut être également étalonné avec d’autres suspensions. Il est encore
couramment employé come unité le mg/l de silice.
Toute correspondance entre les unités NTU et mg/l de silice ne peut être établie une
fois pour toutes, mais varie en fonction de la qualité de l’eau (salinité en particulier) et
de l’importance de la turbidité.
o pour des turbidités très faibles (inférieur à 0,2 NTU) les valeurs
seront plus faibles en NTU qu’en mg/l de silice ;
o pour des turbidités plus élevées, le phénomène est inversé et on
peut donner la relation approchée suivante :
o 1 mg/l de SiO2 équivalent environ à 1,4 NTU.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (123 /138)
(Version Février 2010)
DETERMINATION DES MATIERES EN SUSPENSION DANS LES
EAUX
PRINCIPE
Détermination par pesée, après filtration de l’eau sur disque en fibre de verre, puis
séchage du disque à 105°C.
MATERIEL
- disques en fibres de verre (membranes millipore 1,2 micron réf. AP 200 –
47.00 ;
- apparition de filtration sous vide (millipore réf. XX 150-4700 ;
- trompe à vide ;
- balance de précision à 0,1 mg près ;
- étuve à 105°C ;
- dessiccateur.
MODE OPERATOIRE
- laver un disque filtrant à l’eau distillée et le sécher à l’étuve à 105°C durant
au moins 2 heures ;
- après refroidissement dans un dessinateur, tarer exactement ce disque,
soit P1 en milligrammes ;
- placer le filtre sur son support et relier à la mise sous vide (trompe à vide) ;
- filtrer un volume V en ml, d’eau sous analyse. Le volume ne doit pas être
inférieur à 100 ml et est choisi selon la quantité de matière en suspension
et la précision voulue ;
- rincer le récipient ayant contenu l’eau sous analyse et filtrer les eaux de
rinçage sur le filtre ;
- sécher le filtre à l’étuve à 105°C jusqu’à poids constant ;
- après refroidissement du dessiccateur, peser le filtre, soit P2 en
milligrammes.
EXPRESSION DES RESULTATS
La teneur en matière en suspension dans l’eau s’exprime par :
FORMULE page A33
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (124 /138)
(Version Février 2010)
DOSAGE COLORIMETRIQUE DES IONS AMMONIUM
Application norme AFNOR NF T 90-015 adaptée aux eaux résiduaires
(Méthode application pour des teneurs en ions NH4+
Comprises entre 0,1 et 6 mg/l)
PRINCIPE
Méthode de dosage colorimétrique des ions ammonium NH4+ présente dans les
eaux au moyen du réactif de Nessler.
Le mercuri-iodure de potassium (HgI4) K2 donne soit une coloration rouge orangé,
soit un précipité rouge brun avec le cation NH4+ en présence de soude de potasse
en excès.
FORMULE page A34
Il est pratiquement toujours nécessaire de retarder la formation du précipité (qui est
d’autant plus rapide que la concentration en ions ammonium est plus grande), par
addition préalable de tartrate double de sodium et de potassium.
MATERIEL
Matériel courant de laboratoire
Spectrophotocolorimètre (longueur d’onde environ 420 mn) ou tube pour
colorimétrie, bouché émeri (caoutchouc et liège étant susceptibles de céder des
produits ammoniacaux).
REACTIFS
L’eau distillée utilisée pour la préparation des réactifs et au cours du mode
opératoire, ainsi que les réactifs doivent être exempt d’ion ammonium. Si celle dont
on dispose contient quelque peu d’ions ammonium, le procédé le plus simple est
alors de la faire percoler à travers une zéolite appropriée (permutite cation).
Tartrate double de potassium et de sodium (sel de Seignette ou sel de Rochelle)
solution concentrée (solution 1).
Pour obtenir environ 1l de réactif, agiter jusqu’à dissolution complète :
o tartrate double de potassium et de sodium ;
o eau………………... 748 ml.
Puis ajouter 5,5 ml de lessive de potasse (d+ 1,33) et 4,5 ml de lessive de soude
(d=1,33).
Homogénéiser et laisser reposer deux jours, car il y a toujours un trouble et un dépôt
que l’on doit éviter de prélever pour faire le dosage.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (125 /138)
(Version Février 2010)
REACTIF DE NESSLER : solution 2
Dans une fiole jaugée de 1 litre, agiter jusqu’à dissolution complète :
o iodure mercurique……………………………… 45,5 g
o iodure de potassium…………………………….. 35 g
o eau………………………………………………. 15 ml environ
D’autre part, mélanger :
o lessive de potasse d=1,33……………………… 333 ml
o eau……………………………………………… 500 ml environ
Verser la solution de potasse dans la solution de mercuri iodure et compléter à un
litre avec de l’eau distillée. Homogénéiser et laisser reposer deux jours avant
l’emploi.
Il y a toujours trouble et dépôt subséquent que l’on doit éviter de remettre en
suspension au moment de l’emploi. Ce réactif se conserve bien à l’obscurité (un an
et plus).
Solution type d’ions ammonium NH4+ (solution 3) :
o dissoudre 133 mg de chlorure d’ammonium et compléter à un litre.
MODE OPERATOIRE
Prise d’essai :
Prise à analyser doit être parfaitement limpide et incolore ; sinon, il est nécessaire
de la filtrer après coagulation au sulfate d’alumine. Si ce traitement n’est pas possible
ou inefficace, faire une correction en conséquence à la densité optique trouvée.
Dosage par le spectotocolorimètre
- tracé de la courbe d’étalonnage :
ml de la solution 0 1 2 3 4 5 6
meq d’ions NH4+ 0 0,0025 0,005 0,0075 0,01 0,0125 0,015
Compléter à 50 ml avec de l’eau distillée afin d’obtenir des solutions contenant
respectivement :
mé au litre d’ions
0 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30
NH4+
5,4 mg mé au
0 0,9 1,8 2, 7 3,6 4,5
litre
Traiter chacune de ces solutions comme indiqué ci-après pour la prise d’essai.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (126 /138)
(Version Février 2010)
Reporter les valeurs trouvées en fonction des concentrations et tracer la courbe
d’étalonnage.
- dosage :
A la prise d’essai, ajouter 2 ml de la solution (1) de tartrate et mélanger ; puis 2 ml de
réactif de Nessler (2) et mélanger.
Attendre 10 minutes et mesurer l’intensité de la teinte au Spectrophotocolomètrie
vers une longueur d’onde de 420 mn.
Reporter la valeur trouvée sur la courbe d’étalonnage.
Dosage par la colorimétrie visuelle
Pour les concentrations inférieure à 0,05 mé au litre (environ 1 mg au litre), il est
suffisamment précis et beaucoup plus rapide de comparer visuelle avec une gamme
artificielle établie comme indiqué ci-après.
Préparer une solution mère ayant une teinte identique à celle d’un échantillon
contenant 1 mg d’ion ammoniaque traité suivant le mode opératoire de la présente
norme :
- chrome de potassium Cr4K2…………………… 0,055 g
- nitrate de cobalt (N03)2 C0, 6H20 fraichement essoré au bûcher 0,800 G
- acide chlorhydrique=119………………………..………… 5 ml
- eau q s p…………………………………………………… 500 ml
Réaliser à partir de cette solution une gamme artificielle entre 0 et 1 mg au litre, par
dilutions. Cette conservée en tubes pour colorimétrie à l’obscurité.
Teinte correspondant à
Solution ml Eau ml une teneur en NH4 mg au
titre
3,0 51,0 0
8,1 45,9 0,1
13,2 40,8 0,2
23,4 30,6 0,4
33,6 20,4 0,6
43,8 10,2 0,8
54,0 0,0 1,0
L’essai est mené dans les mêmes conditions que pour Spectrophotocolomètrie, la
solution en essai étant comparé avec les termes de la gamme artificielle.
EXPRESSION DES RESULTATS :
Les résultats doivent être exprimés en milliéquivalent d’ions NH4+ au litre.
Il est rappelé que :
- 1 mé = 18 ………………………………………. Mg d’ions NH4+
- 1 mé = 0,0555…………………………………… me d’ions NH4+
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (127 /138)
(Version Février 2010)
Précisions :
En Spectrophotocolomètrie la précision de la méthode est de 2 % environ.
INTERFERENCES :
La méthode AFNOR NF T 90-015 s’applique avec les adaptations suivantes relatives
aux Eaux Résiduaires.
Interférence due aux matières en suspension :
- Principe : Clarification avec du sulfate de zinc et une base.
- Réactifs : Solution de sulfate de zinc :
- dissoudre 100 g de ZnSO4, 7H20 dans l’eau distillée sans ammoniaque et
compléter à 1 litre.
Solution sodique :
- dissoudre 250 g de Na0H dans de l’eau distillée sans ammoniaque et
compléter à 1 litre.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (128 /138)
(Version Février 2010)
ANNEXE B
DETERMINATION DES TAUX DE TRAITEMENT
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (129 /138)
(Version Février 2010)
SOMMAIRE
Pages
JAR TEST B.2
MESURE VOLUME DE BOUE B.18
TEST « CHLORE » B.20
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (130 /138)
(Version Février 2010)
JAR –TEST
(Coagulation – Flocculation)
OBJET
Déterminer en laboratoire les taux de traitement à appliquer à l’eau brute pour le
meilleur fonctionnement de la station.
MATERIEL NECESSAIRE
- un flocculateur de laboratoire permettant d’agiter simultanément, à la
même vitesse, six béchers de 1 000 ml d’eau ;
- trois pipettes de 10 ml, graduées en dixièmes de millimètres ;
- une pipette de 2 ml, graduée en dixièmes de millilitres ;
- une éprouvette de 250 ml ;
- une éprouvette de 1 000 ml ;
- plusieurs flacons de 1 000 ml ;
- béchers de 1 000 ml ;
- un turbidimètre.
PREPARATION DES SOLUTIONS
Au moment où l’on réalise les essais de floculation, on prépare, à partir des solutions
mères à 100 g/l, les solutions à 10 g/l et 20g/l.
Les solutions mères et fluides seront préparées avec de l’eau déminéralisée ou
distillée.
Les solutions mères seront préparées à partir des produits commerciaux utilisés pour
l’exploitation de la station.
CHAUX
Lait de chaux à 20 g/l :
- peser 5g de chaux introduire cette chaux dans une éprouvette de 250 ml,
ajouter de l’eau jusqu’à ce que le niveau du liquide atteigne la graduation
250.
- Fermer l’éprouvette avec la paume de la main, et agiter violemment pour
obtenir une bonne suspension, transvasée ensuite cette suspension dans
un flacon. S’il reste un dépôt dans l’éprouvette, on laisse décanter le flacon
et lorsque l’eau surnageant est assez claire, on verse un peu d’eau dans
l’éprouvette que l’on agite bien et on transvase à nouveau dans le flacon
(répéter plusieurs fois jusqu’à ce qu’il reste plus de dépôt dans
l’éprouvette).
Toutes les fois où l’on désire utiliser le lait de chaux, il faut agiter violemment le
flacon avant de prélever le lait de chaux avec la pipette.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (131 /138)
(Version Février 2010)
La suspension se conserve 2 à 3 semaines à l’abri de la lumière.
Taux de traitement : en fonction du volume de solution prélevé, introduire dans un
volume d’eau à traiter de 1 000 ml :
- lait de chaux à 20 g/l.
VOLUME DE SOLUTION PRELEVE (en
TAUX DE TRAITEMENT (en g/m3
ml)
1 20
1,5 30
2 40
2,5 50
3 60
3,5 70
4 80
4,5 90
5 100
5,5 110
6 120
7 140
8 160
10 200
12 240
Lait de chaux à 10 g/l :
Lorsque la dose de chaux est faible (inférieure à 20 mg), on utilisera une suspension
à 10 g/l ;
- peser 2,( g de chaux, introduire cette chaux dans une éprouvette de 250
ml, ajouter de l’eau distillée jusqu’à ce que le niveau du liquide atteigne la
graduation 250 .
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main, et agiter violemment pour
obtenir une bonne suspension, transvasée ensuite cette suspension dans
un flacon. S’il reste un dépôt dans l’éprouvette, on laisse décanter le flacon
et lorsque l’eau surnageant est assez claire, on verse un peu d’eau dans
l’éprouvette que l’on agite bien et on transvase à nouveau dans le flacon
(répéter plusieurs fois jusqu’à ce qu’il reste plus de dépôt dans
l’éprouvette).
Toutes les fois où l’on désire utiliser le lait de chaux, il faut agiter violemment le
flacon avant de prélever le lait de chaux avec la pipette.
Taux de traitement : en fonction du volume de solution prélevé, introduit dans un
volume d’eau à traiter de 1 000 ml :
- lait de chaux à 10 g/l.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (132 /138)
(Version Février 2010)
VOLUME DE SOLUTION TAUX DE TRAITEMENT
PRELEVE (en ml) (en g/m3)
0,5 5
1 10
1,5 15
2 20
2,5 25
3 30
3,5 35
4 40
4,5 45
5 50
6 60
7 70
8 80
10 100
12 120
Sulfate d’alumine :
Solution mère 100 g/l :
- peser 25 g de sulfate d’alumine et introduire les cristaux dans une
éprouvette de 250 ml ;
- verser de l’eau distillée jusqu’à ce que le niveau du liquide atteigne la
graduation 250 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main, et agiter soigneusement
jusqu’à dissolution complète des cristaux (si l’on dispose de suffisamment
de temps, on peut laisser les cristaux dissoudre, et, lorsqu’il reste très peu
de cristaux, on agite pour terminer la dissolution et le mélange.
On obtient ainsi une solution mère « A » à 100 g//l. Elle se conserve à l’abri de la
lumière (5 à 6 mois).
Pour effectuer les essais de floculation, il faut préparer une solution à 10 g/l.
Solution à 10g/l :
- prélever 25 ml de la solution mère « A », et verser ce volume dans une
éprouvette de 250 ml ;
- verser de l’eau distillée jusqu’à ce que le niveau du liquide atteigne la
graduation 250 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main, et agiter soigneusement, en
retournant plusieurs fois l’éprouvette pendant 4 à 5 minutes de façon à
bien mélanger.
Cette solution doit être préparée immédiatement avant les essais de floculation.
Taux de traitement : en fonction du volume de solution prélevé, introduit dans le
volume d’eau à traiter de 1 000 ml :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (133 /138)
(Version Février 2010)
- solution de sulfate d’alumine à 10 g/l
VOLUME DE SOLUTION TAUX DE TRAITEMENT (en g/m3)
PRELEVE (en ml)
0,5 5
1 10
1,5 15
2 20
2,5 25
3 30
3,5 35
4 40
4,5 45
5 50
6 60
7 70
8 80
10 100
12 120
Floculant : polyéthylectrolyte :
Solution mère à 5g/l :
Les adjuvants se retrouvent dans le commerce, sous forme de poudre, ou sous
forme de solution concentrée :
- mettre 150 ml d’eau distillée dans un bécher ;
- peser 1,25g de produit, et verser très lentement dans l’eau, en agitant
violemment (il faut que la solution soit complète entre chaque addition de
produit) ;
- transvaser la solution dans une éprouvette de 250 ml, rincer le bécher en
versant 50 ml d’eau distillée, et traversant dans l’éprouvette de 250 ml,
recommencer le rinçage pour que le niveau de liquide dans l’éprouvette
atteigne la graduation 250 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main, et agiter violemment en
retournant plusieurs fois l’éprouvette pendant 4 à 5 minutes, de façon à
bien mélanger.
On obtient ainsi une solution mère « A » à 5g/l. Cette solution peut se conserver
environ 8 jours.
Pour effectuer les essais de floculation, il faut faire une solution à 0,10g/l.
Solution à 0,10 g/l :
- prélever 5 ml de la solution mère « A », et verser ce volume dans une
éprouvette de 250 ml ;
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (134 /138)
(Version Février 2010)
- verser de l’eau distillée jusqu’à ce que le liquide atteigne la graduation
250 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main, agiter violemment en
retournant plusieurs fois l’éprouvette pendant 4 à 5 minutes, de façon à
bien mélanger.
Cette solution doit être préparée immédiatement avant les essais de floculations.
Taux de traitement : en fonction du volume prélevé, introduit dans un volume d’eau à
traiter de 1 000 ml :
- solution de floculation à 0,1g/l.
VOLUME DE SOLUTION TAUX DE TRAITEMENT
PRELEVE (en ml) (en g/m3
0,5 0,05
1 0,5
1,5 0,15
2 0,20
2,5 0,25
3 0,30
3,5 0,35
4 0,40
4,5 0,45
5 0,50
6 0,60
7 0,7
8 0,8
10 1
12 1,2
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (135 /138)
(Version Février 2010)
MODE OPERATOIREDE LA DETERMINATION DES TAUX DE TRAITEMENT
Détermination de la dose de coagulant :
- prélever de l’eau brute dans un seau ou dans une cuve ayant une capacité
de 15 à 20 litres ;
- bien agiter cette eau, et introduire dans chaque bécher 1 000 ml d’eau,
- placer les bécher sur le flocculateur, et descendre les hélices d’agitation au
fond des béchers ;
- mettre en route le moteur, et faire tourner à la vitesse la plus rapide ;
- prendre la solution de sulfate d’alumine à 10 g/l et, au moyen d’une pipette
de 10 ml graduée en dixièmes, introduire :
- ml dans le bécher n°1………………………. 10 mg/l
- 2 ml dans le bécher n° 2……………………. 20 mg/l
- 3 ml dans le bécher n° 3……………………. 30 mg/l
- 4 ml dans le bécher n° 4……………………. 40 mg/
- 5 ml dans le bécher n° 5……………………. 50 mg/l
- 6 ml dans le bécher n°6…………………….. 60 mg/l
- déclencher le chronomètre = temps zéro ;
- après 3 minutes, ralentir la vitesse d’agitation, de façon à ce que les
hélices tournent à une vitesse voisine de 40 tr/min ;
- après 20 minutes de temps total, ralentir la vitesse, puis arrêter le moteur
et sortie toutes les hélices d’agitation ;
- mettre une note de floculation, en prenant les bases suivantes :
o 0 pas de flocon ;
o 2 opalescent ;
o 4 petits points ;
o 6 moyens ;
o 8 bons ;
o 10 très bon.
- laisser déposer 10 minutes et, avec un siphon recourbé, siphonner la
moitié de la hauteur d’eau dans le bécher, indiquer sur la feuille « Essais
de floculation » le temps de décantation et la hauteur d’eau siphonnée.
Sur les eaux siphonnées, mesurer :
- le Ph ;
- la turbidité ;
- le TAC.
Et porter les résultats sur la feuilles « Essais de floculation ».
Interprétation des résultats :
Si les eaux siphonnées dans les béchers n° 5, 6 ont des turbidités meilleurs que
celles siphonnées dans les béchers n°1, 2, 3 , 4 et que les turbidités des n°5,6 sont
sensiblement les mêmes : on recommence un nouvel essai.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (136 /138)
(Version Février 2010)
- rincer soigneusement les béchers, et mettre un litre d’eau dans chaque
bécher, puis opérer comme précédemment, mais introduire les volumes de
solutions suivants :
o 5 ml dans le bécher n°1………………………. 50 mg/l
o 6 ml dans le bécher n°2………………………. 60 mg/l
o 7 ml dans le bécher n°3………………………. 70 mg/l
o 8 ml dans le bécher n° 4……………………… 80 mg/l
o 9 ml dans le bécher N°5……………………… 90 mg/l
o 10 ml dans le bécher n°6……………………… 100 mg/l
- puis suivre la même méthode que celle indiquée précédemment.
Si la turbidité des eaux siphonnée dans le bécher n°1 est meilleure que celle des
béchers n°2,3, 4, 5, et 6, c’est la dose de réactif de 50 mg/l qu’il faut adopter. Si, par
contre, la turbidité de l’eau siphonnée dans le bécher n°4 est meilleure que celle des
eaux siphonnée dans les béchers n°1,2 3 4 5 et 6, c’est la dose de 80 mg/l qui
correspond au bon traitement.
Si l’on obtient, sensiblement, la même turbidité pour les eaux siphonnées dans les
béchers n° 5 et 6, il faut recommencer un nouvel essai :
- la date, l’heure et l’analyse sommaire de l’eau brute (au minimum, la
température, le pH, le TAC) ;
- sur la feuille, s’il s’agit d’un essai au sulfate d’alumine, devant coagulant,
inscrire sulfate d’alumine, et, sur la même ligne dans les colonnes 1, 2,3
etc., inscrire la dose en g/m3, en se servant du tableau donné dans
« Préparation des solutions » (B.3) ;
- sur la ligne temps d’apparition du floc : dès que le réactif a été introduit, on
regorge l’eau dans les béchers, et on note le moment après lequel on voit
de petits points se former ;
- on note, dans chaque colonne, le temps d’agitation rapide, ainsi que le
temps d’agitation lente ; ils doivent être les mêmes dans tous les béchers,
car un essai est comparatif ;
- les notes de floculation correspondant à l’aspect et à la grosseur des
flocons ; la note est d’autant meilleure que l’eau, entre les flocons est plus
claire ;
- le temps de décantation doit être le même dans tous les béchers, ainsi que
la hauteur d’eau siphonnée ; de cette façon, les eaux siphonnées
correspondant toutes à la même vitesse de décantation.
Détermination du pH de floculation :
Lorsque la plus faible turbidité est obtenue sur une siphonnée dont la pH est inférieur
à 6,5, ou lorsque la dose de coagulation (sulfate d’alumine provoque une diminution
du TAC de plus de 5°F, ou bien encore lorsque le TAC de l’eau siphonnée est égal
ou inférieur à 7°F, il faut recommencer des essais, en adoptant la dose de coagulant
ayant donné la meilleure turbidité, mais en introduisant avant, des doses croissantes
de chaux.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (137 /138)
(Version Février 2010)
Par exemple, si la dose de sulfate d’alumine qui a donné la meilleure turbidité est
égale à 60 mg/l, on fera un essai de floculation, en suivant la méthode précédente,
de la façon suivante :
- introduire la solution de lait de chaux à 10 g/l :
o à ml dans le bécher n°………………………. 0 mg/l
o 0,5 ml dans le bécher n°2…………………… 5 mg/l
o 1 ml dans le bécher n° ……………………… 10 mg/l
o 1,5 ml dans le bécher n°4…………………… 15 mg/l
o 2 ml dans le bécher n°5……………………… 20 mg/l
o 2,5 ml dans le bécher n°6……………………. 25 mg/l
- introduire 6 ml de solution de sulfate d’alumine chlorure ferrique à 10 g/l,
dans chacun des béchers ;
- après 3 minutes d’agitation rapide, réduire la vitesse, et arrêter l’agitation
après 20 minutes de temps total ;
- faire les mêmes observations que précédemment.
Détermination de la dose de floculant :
Le but du floculant d’augmenter la grosseur du floc ainsi que sa vitesse de
décantation.
Avec les quantités de sulfate d’alumine et de chaux ayant permis dans les essais
précédents d’obtenir la meilleure turbidité, il faut recommencer une série d’essais en
ajoutant des doses croissantes de floculant.
Par exemple si la dose de sulfate d’alumine est de 60 mg/l, la dose de chaux de 20
mg/l on fera un essai de floculation, en suivant la méthode précédente de la façon :
- introduire 1 ml de lait de chaux à 20 g/l et 6 ml de solution de sulfate
d’alumine dans chaque bécher ;
- démarrer le floculateur en agitation rapide ;
- introduire la dilution de floculant à 0,10g/l :
o 0 ml dans le bécher n°1……………….. 0 mg/l
o 1 ml dans le bécher n°2……………….. 0,1 mg/l
o 2 ml dans le bécher n°3……………….. 0,2 mg /l
o 3 ml dans le bécher n°4.………………. 0,3 mg/l
o 4 ml dans le bécher n°5……………….. 0,4 mg/l
o 5 ml dans le bécher n°6……………….. 0,5 mg/l
- après 3 minutes d’agitation rapide, réduire la vitesse et arrêter l’agitation
après 20 minutes de temps total ;
- faire les mêmes observations que précédemment.
Essais complets :
Lorsque les choses :
- de sulfate d’alumine ;
- de chaux du pH de floculation.
- de floculant.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (138 /138)
(Version Février 2010)
Ont été déterminés par les essais de floculation, refaire des essais complet avec :
- la dose de sulfate de cuivre déterminée.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (139 /138)
(Version Février 2010)
ESSAIS DE FLOCULATION
(JAR TEST)
EAU BRUTE : turbidité : TAC
Couleur : matières organiques
Ph :
1 2 3 4 5 6
Chaux mg/l :
Coagulant mg/l :
Floculant mg/l :
Autre réactif mg/l :
Temps d’agitation lente
Temps d’agitation rapide
Temps d’apparition du floc
Note de floculation*
Temps de décantation
Volume de boues en %
En 5 minutes
En 10 minutes
En 15 minutes
En 20 minutes
En 30 minutes
En 60 minutes
Turbidité eau filtrée sur papier
Couleur eau filtrée sur papier
MO
TAC
K des boues
o Note de floculation : 0 – pas de flocon
o 2 – opalescent
o 4 – petits points
o 6- moyen
o 8- bon
o 9 – très bon
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (140 /138)
(Version Février 2010)
MESURE ET SOLUTIONS NECESSAIRES
On utilise le matériel et les solutions des essais de floculation.
MODE OPERATOIRE
L’eau brute peu trouble, et la dose de coagulation est inférieur ou, au plus, égale à
20 mg/l
Mettre un filtre d’eau dans chacun des six béchers, placer les bécher sur le
flocculateur de laboratoire et plonger les hélices au fond des béchers.
Procéder comme pour l’essai de floculation, mais introduire, dans chacun des
béchers, la même dose de réactif, qui est celle qui a donné le meilleur résultat dans
l’essai de floculation.
Après les 20 minutes d’agitation totale, sortir les hélices, et laisser les boues
décanter complètement – 15 à 45 minutes – si cela est nécessaire.
Lorsque l’eau surnageant est bien claire, verser cette eau surnageant, très
lentement, dans un autre bécher ou dans une éprouvette, sans entraîner la boue
déposées. Opérer de la même façon avec tous les béchers, puis transvaser les
boues de tous les béchers dans le béchers n°1.
Recommencer l’essai de floculation avec les cinq autres béchers, et après
décantation et élimination de l’eau surnageant toutes les boues dans le même
bécher n°1.
Avec le flocculateur, on agite les boues contenues dans le bécher n°1, de façon à les
rendre homogènes, puis on arrête l’agitation et on laisse les boues se déposer.
Lorsque les boues sont bien déposées, on verse l’eau surnageant claire dans un
bécher ou dans une éprouvette.
Introduire les boues restant dans le bécher, dans une éprouvette de 250 ml (le
volume doit être inférieur à 250 ml) : puis en se servant de l’eau surnageant
recueillie, on ajuste le niveau du liquide à la graduation 250.
Boucher l’éprouvette avec la paume de la main, et retourner dix fois l’éprouvette, en
10 secondes.
Saisir l’éprouvette par la partie supérieure, et faire décrire un cercle au fond de
l’éprouvette, un tour en une seconde pendant 10 secondes.
Placer ensuite l’éprouvette sur une table exemple de vibrations et dans un endroit
frais (il ne faut pas que la température de l’eau varie).
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (141 /138)
(Version Février 2010)
Noter l’heure à laquelle on place l’éprouvette au repos, et lire le volume de boues
après 5,10,15,20,30,20,30, et 60 minutes. Ramener ce volume en pourcentage et
l’inscrire sur la feuille « Essais de floculation ».
Il faut obtenir au moins 75 ml de volume après 10 minutes de repos. S’il y a moins de
75 ml, il faut floculer de nouveaux béchers jusqu’à obtenir ce volume de boues de 75
ml en 10 minutes. On appliquera la même méthode que précédemment.
L’eau brute exige un taux de traitement compris entre 80 et 200 mg/l de coagulant,
on floculera cinq béchers de 1 000 ml.
L’eau brute exige un taux de traitement compris entre 200 et 400 mg/l de coagulant,
il suffira de floculer deux béchers.
NOTA : Il faut, dans tous les cas, obtenir au moins 75 ml de boues après 10 minutes
de repos.
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (142 /138)
(Version Février 2010)
TEST « CHLORE »
(Préchloration et Désinfection)
OBJET
C’est la détermination de la dose de chlore qu’il est nécessaire d’introduire dans
l’eau pour qu’il reste une trace de chlore libre après 2 heures de contact.
MATERIEL NECESSAIRE
- six flacons de 1 000 ml avec bouchons ;
- une pipettes de 10 ml de graduée en dixièmes de millilitres ;
- une pipette de 25 ml graduée en dixièmes de millilitres ;
- une éprouvette de 1 000 ml ;
- deux flacons teintés de 200 ml avec bouchons.
PREPARATION DES SOLUTIONS
Au moment où l’on réalise les essais du test « chlore », on prépare à partir de la
solution mère à 20 g en chlore une solution diluée à 1 g/l en chlore.µµLes solutions
mères et diluées seront préparées avec de l’eau potable pratiquement exemple de
matières organiques où à partir d’eau minérale en bouteille (non gazeuse).
Les solutions mères peuvent être conservées un mois à l’abri de la lumière en flacon
teinté.
L’hypochlorite de calcium utilisé pour le test « chlore » sera le produit commercial
pour l’exploitation de la station.
L’hypochlorite de calcium se présente sous la forme d’une poudre blanche et
contenant de 620 à 640 g de chlore par kg de produit.
Solution mère à 20g/l en chlore :
- peser 6,5 f d’hypochlorite de calcium et introduire le produit dans une
éprouvette de 250 ml ;
- verser de l’eau potable jusqu’à ce que le niveau du liquide atteigne la
graduation 200 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main et agiter soigneusement
pendant 5 minutes ;*laisser décanter jusqu’à ce que le liquide soit clair et
que les impuretés insolubles soient déposées au fond de l’éprouvette ;
- transvaser le liquide surnageant dans un flacon teinté que l’on bouche
soigneusement.
On obtient une solution mère « A » à 20 g/l.
Pour effectuer le test « chlore », il faut préparer une solution à 1g/l.
Solution à 1 g/l en chlore :
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (143 /138)
(Version Février 2010)
- prélever 10 ml de la solution mère « A », et verser ce volume dans une
éprouvette de 250 ml ;
- verser de l’eau potable ou minérale jusqu’à ce que le niveau du liquide
atteigne la graduation 200 ;
- fermer l’éprouvette avec la paume de la main et agiter soigneusement en
retournant plusieurs fois l’éprouvette pendant 4 à 5 minutes, de façon à
bien mélanger.
Cette solution doit être préparée immédiatement avant d’effectuer le test « chlore ».
Taux de traitement : en fonction du volume de solution prélevé, introduit dans ce
volume d’eau à traiter de 1 000 ml :
Solution à 1 g/l en chlore.
VOLUME DE SOLUTION TAUX DE TRAITEMENT
PRELEVE (en ml) EN CHLORE (en g/m3)
0,5 0,5
1 1
1,5 1,5
2 2
2,5 2,52
3 3
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (144 /138)
(Version Février 2010)
MODE OPERATOIRE DE LA DETERMINATION DU TAUX DE TRAITEMENT EN
CHLORE
- prendre une série de six flacons de 1 000 ml. Les remplir avec l’eau à
traiter à l’aide de l’éprouvette de 1 000 ml ;
- prendre la solution d’hypochlorite à 1 g/l et, au moyen d’une pipette de 10
ml graduée en dixièmes, introduire :
* 0,5 ml dans le flacon n°1…………………… 0,5 mg/l
* 1 ml dans le flacon n°2…………………….. 1 mg/l
* 1,5 ml dans le flacon n°3……………………. 1,5 mg/l
* 2 ml dans le flacon n°4……………………… 2 mg/l
* 2,5 ml dans le flacon n°5……………………. 2,5 mg/l
* 3 ml dans le flacon n°6……………………… 3 mg/l
- boucher et agiter les six flacons, les placer à l’abri de la lumière et à
température constante ;
Après 2 heures, mesurer le chlore libre restant. Le test « chlore » est celui où la
teneur en chlore libre obtenue est de 0,1 0 à 0,3 » mg/l
PROCEDURES D’EXPLOITATION DE LA STATION DE TRAITEMENT D’AKOMNYADA (145 /138)
(Version Février 2010)
Vous aimerez peut-être aussi
- Rapport - (2) Al WatikDocument11 pagesRapport - (2) Al WatikFatima Ezzahraa El JebbariPas encore d'évaluation
- TP 1 Epuration Des Eaux PDocument7 pagesTP 1 Epuration Des Eaux Puserr0% (1)
- Rapport ONASDocument18 pagesRapport ONASAsma Spp88% (8)
- Pelle Hydraulique Liebherr 901Document8 pagesPelle Hydraulique Liebherr 901Liebherr0% (1)
- Reflex Nikkor 500mm F 8Document26 pagesReflex Nikkor 500mm F 8MihaiisvoranuPas encore d'évaluation
- TP1 Mesure de MESDocument7 pagesTP1 Mesure de MESIslem Taane80% (5)
- Traitement Des Eaux de ConsommationDocument15 pagesTraitement Des Eaux de ConsommationABUBAKAR MUHAMMAD ADAMPas encore d'évaluation
- Traitement de Production D'eau de Consommation PDFDocument98 pagesTraitement de Production D'eau de Consommation PDFjolegende0% (1)
- Analyse D'eau D'oued Sebou Par Jar Test - MAHMOUDI ImaneDocument35 pagesAnalyse D'eau D'oued Sebou Par Jar Test - MAHMOUDI Imaneoufir chaimaaPas encore d'évaluation
- Annexes TheoriquesDocument44 pagesAnnexes TheoriquesSALIM BOUGHRIRAPas encore d'évaluation
- TP 1 Epuration Des Eaux PDocument6 pagesTP 1 Epuration Des Eaux Psabrinel hambli0% (1)
- Surveillance de La Qualite Des - Barki Khaoula - 283Document33 pagesSurveillance de La Qualite Des - Barki Khaoula - 283jfffmlfd flkrPas encore d'évaluation
- Specification Technique Des Unités de Potabilisation TEBESSA REV 01Document21 pagesSpecification Technique Des Unités de Potabilisation TEBESSA REV 01kourzi kamelPas encore d'évaluation
- Boues ActiveesDocument20 pagesBoues ActiveesChokri Chakiir100% (1)
- Système de Traitement Des Eaux Usées (Vatek)Document10 pagesSystème de Traitement Des Eaux Usées (Vatek)Hyd FreelancerPas encore d'évaluation
- 143 QualiteEauLaboratoireDocument21 pages143 QualiteEauLaboratoirepeguy diffoPas encore d'évaluation
- Rapport de SynthèseDocument13 pagesRapport de Synthèsedelyonkamdem1999Pas encore d'évaluation
- Présentation Youness NASSIR - 1er Poste ApprenantDocument46 pagesPrésentation Youness NASSIR - 1er Poste ApprenantYoussef100% (1)
- Module - Technique Qualite de Leau v2023Document18 pagesModule - Technique Qualite de Leau v2023mifoumeleoncePas encore d'évaluation
- Rapport M'Rirt2005Document19 pagesRapport M'Rirt2005aabdouu1111Pas encore d'évaluation
- Epreuve 2 de Aep Hyt 2021 2Document4 pagesEpreuve 2 de Aep Hyt 2021 2brice mouadje100% (1)
- D-0422373 Memoire Technique STEP HOPITAL KATIOLA 90LITS PDFDocument8 pagesD-0422373 Memoire Technique STEP HOPITAL KATIOLA 90LITS PDFalbanPas encore d'évaluation
- Fiche Finale 3 Entretien Du Réseau D'irrigation - Gargouri K Et Larbi ADocument8 pagesFiche Finale 3 Entretien Du Réseau D'irrigation - Gargouri K Et Larbi Akhouloud92othmenPas encore d'évaluation
- Memoire TechniqueDocument22 pagesMemoire Techniquekadri daoudaPas encore d'évaluation
- Ecoflo Guide-Conception QC STPDocument18 pagesEcoflo Guide-Conception QC STPNoureddine MerahPas encore d'évaluation
- Les Termes de References La Maintenance Des OuvragesDocument4 pagesLes Termes de References La Maintenance Des OuvragesABDELGHANI JRHAIDER100% (1)
- Etude de La Qualité Des SequqstrantsDocument53 pagesEtude de La Qualité Des SequqstrantsZakia Zakia100% (2)
- Rapport Sur Le Stage Effectué Du 01/03/2023 Au 31/03/2023 Dans La Société: ONEE-Branche Eau A TiznitDocument19 pagesRapport Sur Le Stage Effectué Du 01/03/2023 Au 31/03/2023 Dans La Société: ONEE-Branche Eau A Tiznitمحمد ابوالقاسمPas encore d'évaluation
- Conception D'une Station D'epurationDocument61 pagesConception D'une Station D'epurationChanel89% (18)
- TECHNEAU - Separateur HydrocarburesDocument27 pagesTECHNEAU - Separateur HydrocarburesLilian Lg's100% (1)
- Rapport de La Sortie de l'ONEEDocument4 pagesRapport de La Sortie de l'ONEENadia Ait TalbPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage: Station D'épuration Step El-KermaDocument17 pagesRapport de Stage: Station D'épuration Step El-KermaGenie des procede Promotion 2022Pas encore d'évaluation
- Biogreen FRDocument7 pagesBiogreen FRSoSo CombescurePas encore d'évaluation
- Hasnfra 3 Rapp 217Document24 pagesHasnfra 3 Rapp 217assala wiamPas encore d'évaluation
- Correction Exam Master 2018Document6 pagesCorrection Exam Master 2018Elbacha100% (1)
- RAPPORT CornyDocument16 pagesRAPPORT CornyelopsPas encore d'évaluation
- Ngadena Desire FelixDocument80 pagesNgadena Desire Felixdalila AMMARPas encore d'évaluation
- Descriptif Technique de La STEP 1200 EH HASSNAOUI BOUSFER 15 07Document16 pagesDescriptif Technique de La STEP 1200 EH HASSNAOUI BOUSFER 15 07youcef tecPas encore d'évaluation
- CHAPITRE 2 EVALUATION DES DEBITS DES EAUX USEE CoriigeDocument21 pagesCHAPITRE 2 EVALUATION DES DEBITS DES EAUX USEE CoriigeHanane BenGamra50% (2)
- Scope Water TreatmentDocument7 pagesScope Water TreatmentJoseph OlingaPas encore d'évaluation
- Rapport Stage STEP Laverie YoussoufiaDocument83 pagesRapport Stage STEP Laverie YoussoufiaYasser Sammad60% (5)
- UntitledDocument28 pagesUntitledRaoufyyPas encore d'évaluation
- Pollution Industrielle de L'eau: Caractérisation, Classification, MesureDocument12 pagesPollution Industrielle de L'eau: Caractérisation, Classification, MesureHassan El BarakaPas encore d'évaluation
- Eau UseeDocument8 pagesEau UseemariemPas encore d'évaluation
- DUC RapportDocument84 pagesDUC RapportKadd YoussPas encore d'évaluation
- Analyse de Leau Et Carte de Contrôle Dun Spectrophotomètre UV-VisibleDocument34 pagesAnalyse de Leau Et Carte de Contrôle Dun Spectrophotomètre UV-VisibleAzizaa ElhPas encore d'évaluation
- Rapport 1Document29 pagesRapport 1mehdiPas encore d'évaluation
- Fabrice HarangDocument31 pagesFabrice Harangboladenieve63Pas encore d'évaluation
- Exploitation STEP BADocument18 pagesExploitation STEP BABfjdPas encore d'évaluation
- Exploitation STEP BA PDFDocument18 pagesExploitation STEP BA PDFYhfPas encore d'évaluation
- Exploitation STEP BADocument18 pagesExploitation STEP BAYhfPas encore d'évaluation
- Fiche Technique Ro 315Document19 pagesFiche Technique Ro 315Rochdi KherratPas encore d'évaluation
- Maintenance ReguliereDocument14 pagesMaintenance ReguliereEsperant KilondaPas encore d'évaluation
- Rapport Du StageDocument4 pagesRapport Du StageHaifaHaifaPas encore d'évaluation
- CCTG Traitementf OnepDocument52 pagesCCTG Traitementf OnepcheikhnaPas encore d'évaluation
- Specs 2Document3 pagesSpecs 2Elissa NaalabandPas encore d'évaluation
- Step Cambéréne (ENDSS)Document9 pagesStep Cambéréne (ENDSS)Khalil Diallo100% (1)
- Dysfonctionnement D'une Filière de Traitement Des Eaux UséesDocument36 pagesDysfonctionnement D'une Filière de Traitement Des Eaux UséesMeryemPas encore d'évaluation
- Cours Sur Dessalement de Fouka Rev2Document126 pagesCours Sur Dessalement de Fouka Rev2Kaim Missoum50% (2)
- Maintenance Des Installations HydrauliquesDocument36 pagesMaintenance Des Installations Hydrauliquesnajim68Pas encore d'évaluation
- Saerftyh 5478Document63 pagesSaerftyh 5478sgsoussePas encore d'évaluation
- Determination de La Concentrat - ABDOUS Sanae - 2214Document33 pagesDetermination de La Concentrat - ABDOUS Sanae - 2214wadiePas encore d'évaluation
- sortieSTEP 6Document15 pagessortieSTEP 6Chaimae MAPas encore d'évaluation
- Télédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauD'EverandTélédétection de l'eau: Progrès des techniques de vision par ordinateur pour la télédétection de l’eauPas encore d'évaluation
- 45 Marches 03Document3 pages45 Marches 03Khalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Outil de DimensionnementDocument33 pagesOutil de DimensionnementKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- CommentRemblayerUneTranchee ModeOperatoireDocument2 pagesCommentRemblayerUneTranchee ModeOperatoireKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Exemples de Clauses Marche TravauxDocument20 pagesExemples de Clauses Marche TravauxKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Classification Des Materiels de CompactageDocument2 pagesClassification Des Materiels de CompactageKhalid Choukar100% (1)
- 248616792-BLIN DAGE-BT P - WatermarkDocument19 pages248616792-BLIN DAGE-BT P - WatermarkKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Remblayer CompacterDocument2 pagesRemblayer CompacterKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Calcul Du Silo CimentDocument17 pagesCalcul Du Silo CimentKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- RealisationJonctionRubaneeDeTransitionEntreUnCableTripolaireSynthetiqueEtUnCableTripolaireEnPapierImpregne CableSynthetiqueDocument2 pagesRealisationJonctionRubaneeDeTransitionEntreUnCableTripolaireSynthetiqueEtUnCableTripolaireEnPapierImpregne CableSynthetiqueKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Manuel Calcul Beton ArmeDocument48 pagesManuel Calcul Beton ArmeKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Béton Précontraint. CoursDocument23 pagesBéton Précontraint. CoursKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- PRETRAITEMENTDocument3 pagesPRETRAITEMENTKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Ejjaouani-ONEP 1 10 09-2Document31 pagesEjjaouani-ONEP 1 10 09-2Khalid ChoukarPas encore d'évaluation
- Conception Que Des Batiments - H.bachmann-CETDocument12 pagesConception Que Des Batiments - H.bachmann-CETKhalid Choukar100% (1)
- APD DéfinitiveDocument49 pagesAPD DéfinitiveKhalid ChoukarPas encore d'évaluation
- 477 S - Filtres HydrauliquesDocument38 pages477 S - Filtres Hydrauliquesanadif18967100% (7)
- TCR Instructions D'utilisation Et de SécuritéDocument72 pagesTCR Instructions D'utilisation Et de SécuritéKito Canada100% (1)
- 01 - Série Dexercices Collège Pilote - Physique - 7ème (2012-2013) MR Bouzidi AbdessamadDocument2 pages01 - Série Dexercices Collège Pilote - Physique - 7ème (2012-2013) MR Bouzidi AbdessamadAnonymous EcizZ0KSa100% (1)
- Etude Propriétes de Charge Et de Transport de Membranes - IDIL - MOUHOUMED - Elmi-ConvertiDocument199 pagesEtude Propriétes de Charge Et de Transport de Membranes - IDIL - MOUHOUMED - Elmi-Convertichaimae kaddouriPas encore d'évaluation
- Cours DessalementDocument38 pagesCours DessalementMeryeme QaddarPas encore d'évaluation
- Chapitre 3Document12 pagesChapitre 3Fousseyni TRAOREPas encore d'évaluation
- Amzil JaridDocument76 pagesAmzil JaridMahaPas encore d'évaluation
- Serie - Melanges - Separation (WWW - Pc1.ma) PDFDocument2 pagesSerie - Melanges - Separation (WWW - Pc1.ma) PDFNki NonkiPas encore d'évaluation
- Coursde Diagraphie L3 M1 Geo 21Document51 pagesCoursde Diagraphie L3 M1 Geo 21Ali KaddouriPas encore d'évaluation
- Cour Metallurgie1Document200 pagesCour Metallurgie1borhan DdinePas encore d'évaluation
- 15-Mai-Melanges Et Corps PursDocument40 pages15-Mai-Melanges Et Corps PursamexalcontactPas encore d'évaluation
- Audit EmbouteillageDocument43 pagesAudit Embouteillageeco-tree tahitiPas encore d'évaluation
- Article Plocher Par JF-CoulangeDocument6 pagesArticle Plocher Par JF-CoulangehoussinguyPas encore d'évaluation
- 548 C 47 B 9719 Efq SQDocument45 pages548 C 47 B 9719 Efq SQMaryam AbPas encore d'évaluation
- Catalogue - Fonto de VivoDocument22 pagesCatalogue - Fonto de VivoFrançois PequerulPas encore d'évaluation
- Fascicule 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCEPTION POSTES GAZ GN - RH - GFDocument108 pagesFascicule 2 SPECIFICATIONS TECHNIQUES CONCEPTION POSTES GAZ GN - RH - GFBensmatPas encore d'évaluation
- FriteuseDocument16 pagesFriteusePascale BavouxPas encore d'évaluation
- Rachid Rapport PhoDocument22 pagesRachid Rapport PhoAbderrahim BelmJouJPas encore d'évaluation
- Perforation Avec La Méthode PURE Charge Model PresentationDocument103 pagesPerforation Avec La Méthode PURE Charge Model PresentationM BOUKHAMLAPas encore d'évaluation
- SSIGETraitement Ulterieur Chez Le ConsommateurDocument4 pagesSSIGETraitement Ulterieur Chez Le ConsommateurMaison Fritz-Courvoisier 11Pas encore d'évaluation
- Qualité Air Et Gaz en Industrie AgroalimentaireDocument9 pagesQualité Air Et Gaz en Industrie AgroalimentaireAnne Marie PEVROLPas encore d'évaluation
- TP Chimie Des EauxDocument13 pagesTP Chimie Des EauxkhaoudjPas encore d'évaluation
- DosageDocument6 pagesDosageDreamm AllPas encore d'évaluation
- WCO RLR 800-1900 Sales Leaflet FR 6999060034Document8 pagesWCO RLR 800-1900 Sales Leaflet FR 6999060034Abdoul-latif HammaPas encore d'évaluation
- 01 PRO EXP3 S1 G2 Cours 04 09 AvrilDocument114 pages01 PRO EXP3 S1 G2 Cours 04 09 Avrilmapi AyoubPas encore d'évaluation
- La Rugosite - MitutoyoDocument47 pagesLa Rugosite - Mitutoyoyannrouge0150% (2)