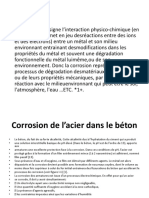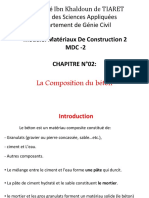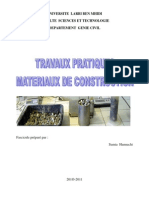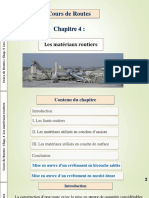Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Polycopie Benessalah Partie 2
Polycopie Benessalah Partie 2
Transféré par
Nourene AzarackCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Polycopie Benessalah Partie 2
Polycopie Benessalah Partie 2
Transféré par
Nourene AzarackDroits d'auteur :
Formats disponibles
TP 3 : Essai micro-Deval
TP 3 : Essai de Résistance à l’Usure (Micro-Deval)
(Selon la norme NF P 18-572)
1 Objectifs de TP
a) Connaitre l’appareil micro-Deval;
b) Déterminer la résistance à la usure du gravier suivant le coefficient MD ;
c) Classifier le type des graviers selon le coefficient MD.
2 Principe de l’essai
L’essai consiste à mesurer la quantité d’éléments inférieurs à 1.6 mm produits dans la
machine Deval par les frottements réciproques et les chocs modérés des granulats.
3 Équipements nécessaires
La machine micro-Deval (Fig. 3.1) comporte :
a- Un à quatre cylindres creux, fermés à une extrémité, ayant un diamètre
intérieur de 200 mm 1 mm et une longueur utile de 154 mm 1 mm pour les
gravillons compris entre 4 et 14 mm et de 400 mm 2 mm pour les 25-50 mm.
Chaque cylindre permet d’effectuer un essai ;
Fig. 3.1. Appareil
micro-Deval
Fig. 3.2. Cuve d’essai micro-
Deval et charge abrasive
b- La charge abrasive est constituée par des billes sphériques de 10 mm 0.5 mm
de diamètre en acier inox ;
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
38
TP 3 : Essai micro-Deval
c- Un moteur (environ 1 kW) doit assurer aux cylindres une vitesse de rotation
régulière de 100 tr/min 5 tr/min ;
d- Un dispositif doit permettre d’arrêter automatiquement le moteur à la fin de
l’essai ;
Une balance précise au gramme, de portée au moins égale à 10 kg.
Les tamis (Tamis de 1.6 mm et les tamis pour déterminer les classes granulaires).
4 Mode opératoire
La granularité du matériau soumis à l’essai est choisie parmi les six classes granulaires (4-
6.3 mm ; 6.3-10 mm ; 10-14 mm ; 10-25 mm ; 16-31.5 mm et 25-50 mm) de la granularité
du matériau, tel qu’il sera mis en œuvre. Pour les essais effectués sur les gravillons entre 4
et 14 mm une charge abrasive est utilisée ;
La masse de l’échantillon pour essai sera 500 g 2 g pour les gravillons de 4-14 mm et de
10 kg 20 g pour les granulats de 25-50 mm ;
Mise en place de l’échantillon dans la machine ainsi que la charge abrasive (Tableau 3.1)
qui est fixée suivant le tableau pour les gravillons de 4-14 mm et de 10 kg de matériau
pour les granulats compris entre 25 et 50 mm (sans la charge abrasive) ;
Tableau 3.1. Charge abrasive en fonction de la classe granulaire choisie
Classe granulaire (mm) Charge abrasive (g)
4 - 6.3 2000 5
6.3 - 10 4000 5
10 - 14 5000 5
Ajouter une quantité de 2.5 L d’eau pour les gravillons compris entre 4 et 14 mm et de 2.0
L d’eau pour les gravillons compris entre 25 et 50 mm ;
Mettre les cylindres en rotation à une vitesse de 100 tr/min 5 tr/min pendant :
-2 h ou 12000 tr pour les gravillons compris entre 4 et 14 mm ;
-2 h 20 min ou 14000 rotations pour les gravillons compris entre 25 et 50 mm.
Recueillir le granulat ainsi que la charge abrasive (pour les gravillons compris entre 4 et
14 mm) dans un bac en ayant soin d’éviter les pertes d’éléments ;
Tamiser le matériau contenu dans le bac sur le tamis de 1.6 mm ;
Laver l’ensemble sous un jet d’eau (retirer la charge abrasive à l’aide d’un aimant par
exemple pour les gravillons compris entre 4 et 14 mm) ;
Sécher le refus à 1.6 mm à l’étuve à 105 °C, jusqu’à masse constante ;
Peser ce refus, soit « m1 » le résultat de la pesée.
5 Calcul du coefficient micro-Deval
La résistance à l’usure du granulat est appelée, par définition, coefficient micro-Deval "MD"
qui s’exprime par le rapport de la masse des éléments inférieurs à 1.6 mm produits au cours
de l’essai "m", à la masse du matériau soumis à l’essai "M" multiplié par 100.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
39
TP 3 : Essai micro-Deval
m
MD = .100
M
Remarque : La masse de la fraction du matériau passant après l’essai au tamis de 1.6 mm
« m »:
m (g) = 500- m 1 pour les gravillons compris entre 4 et 14 mm ;
m (g) = 10000- m 1 pour les gravillons compris entre 25 et 50 mm.
6 Interprétation des résultats
Les valeurs de coefficient Micro-Deval indiquent la nature du gravier et permettre
d’apprécier leur qualité pour composer un béton comme présente le tableau suivant (Tableau
3.2).
Tableau 3.2 : type des graviers selon le coefficient MD
Valeurs de coefficient Micro Deval en présence de l’eau Appréciation
< 10 Très bon à bon
De 10 à 20 Bon à moyen
De 20 à 35 Moyen à faible
> 35 Médiocre
7 Travail demandé
Calculer le coefficient Micro-Deval « MD » du gravier ;
Commenter les résultats obtenus.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
40
TP 3 : Essai Micro Deval
TP 3 : Compte rendu exemplaire
Essai Micro Deval (Selon la norme NF P 18-572)
1 But de l’essai
L’essai Micro-Deval (MDE) permet de déterminer la résistance à l’usure d’un échantillon de
granulat.
Quatre échantillons identiques, de fraction 10/14 mm, sont soumis à un cycle d’usure, en
présence d’eau, par contact avec des billes d’acier à l’intérieur d’un cylindre en rotation.
Le coefficient Micro-Deval obtenu est le pourcentage de l’échantillon initial passant au tamis
de 1.6 mm après usure. Plus le pourcentage d’usure est bas, plus l’échantillon est résistant à
l’usure.
45% est la limite entre les sols durs et les sols friables.
2 Appareillage utilisés
a)- La machine Micro Deval comporte (Fig. 3.3):
- Un à quatre cylindres creux en acier inox ayant un diamètre intérieur de 200 ± 1mm et
une longueur utiles de 154 ± 1mm pour les gravillons compris entre 4 et 14 mm et de
400 ± 2 mm pour les 25 – 50 mm.
Les cylindres d’essai ont une épaisseur supérieure ou égale à 3 mm. Ils sont posés sur deux
arbres horizontaux soudés sur un châssis métallique tubulaire. Chaque cylindre est fermé à
une extrémité par un couvert plat d’environ 8 mm d’épaisseur. L’étanchéité est assurée par un
joint placé sur le couvercle. Chaque cylindre contient un échantillon.
La rotation des cylindres est obtenue grâce à deux arbres, recouverts en téflon, sur lesquels le
ou les cylindres appuient. La rotation arrive à travers un rapport de courroie. Le nombre de
rotations est comptabilisé à l’aide d’un compteur placé sur le panneau de commande.
- La charge est constituée par des boulets sphériques en acier inox de 10 ± 0.5 mm de
diamètre environ. Les diamètres doivent être contrôlés régulièrement ; il ne faut plus
utiliser celles qui passent à travers une passoire de 9.5 mm ou entre deux barres
parallèles de 9.5 mm.
- un moteur, d’environ 1kW, assurant au tambour de la machine une vitesse de rotation
régulière de 100 ± 5 mm tr/min.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
41
TP 3 : Essai Micro Deval
- un bac destiné à recueillir les matériaux après essai,
- un compte tours de type rotatif, arrêtant automatiquement le moteur au nombre de
tours voulu.
- un jeu de tamis de 1.6 - 4 – 6.3 – 8 - 10 – 14 – 25 – 40 - 50mm. Leur diamètre ne devra
pas être inférieur à 200 mm,
- une balance précise au gramme, de portée au moins égale à 10 kg,
- une étuve à 105 °c,
- des bacs et des truelles,
L’appareil Micro Deval Les boulets à mélanger avec l’échantillon
Etuve Balance de précision 1/100 g Tamis de 1.6 mm
Fig. 3.3. Matériaux utilisés
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
42
TP 3 : Essai Micro Deval
3 Préparation de l’échantillon
- Effectuer l’essai sur un granulat, ayant une granularité conforme à l’une des quatre
classes granulaires types 4-6.3 ; 6.3-10 ; 10-14 ; 25-50. Les 25-50 mm doivent contenir
60% de 25-40 mm. Laver l’échantillon et le sécher à l’étuve à 105 °c jusqu’à poids
constant (5 heures au minimum).
- Il n’est pas possible d’étendre ce processus d’usure aux sables, les classes granulaires
inférieures à 4 mm n’évoluent plus par usure, dans cet essai, mais par fragmentation.
- Tamiser l’échantillon à sec sur chacun des deux tamis de la classe granulaire choisie, en
commençant par le tamis le plus grand.
La prise d’essai sera de 500 ± 2 g pour les 4-14 mm et de 10kg ± 20 g pour les 25-50 mm.
4 Mode opératoire
L’essai se déroule en suivons les étapes suivantes :
- Essai sur les gravillons compris entre 4 et 14 mm. Mise en place de l’échantillon dans la
machine ainsi que la charge de boulets relatifs (Tableau 3.3) à la classe granulaire
choisie (voir tableau ci-dessous).
Tableau 3.3. Classe granulaires, poids d’échantillons et boulets équivalent
- Pour l’essai humide (en présence d’eau), ajouter 2.5 l d’eau.
- Replacer le couvercle et serrer les boulons de fixation. S’assurer que les cylindres sont
étanches pendant leur rotation.
- Mise en route de l’essai en faisant effectuer à la machine 12 000 rotations à une vitesse
régulière de (100 ± 5) tr/min pour toutes les classes, soit deux heures.
- Enlever le granulat après l’essai. Recueillir le granulat dans un bac placé sous
l’appareil, en ayant soin d’amener l’ouverture juste au-dessus de ce bac, afin d’éviter
les pertes de granulat.
- Tamiser le matériau contenu dans le bac sur le tamis de 1.6mm ; le matériau étant pris
en plusieurs fois afin de faciliter l’opération.
- Laver le refus à 1,6 mm dans un bac, bien remuer à l’aide d’une truelle. Puis verser
dans le bac perforé, égoutter et sécher à l’étuve jusqu’à poids constant.
- Peser ce refus une fois séché, soit m’ le résultat de la pesée (Fig. 3.4).
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
43
TP 3 : Essai Micro Deval
Peser 2000 gr de boulets Peser 500 gr des agrégats sous essai
Le mélange échantillon/boulets Forme des agrégats après 2 h d’essai
(tamisat et refus sur le tamis de 1.6 mm)
Fig. 3.4. Mode opératoire
5 Calcule du MDE
Calculer alors le coefficient MDE pour chaque cylindre de cette façon :
m 500 m
MDE 100. D’où MDE
M 5
Avec m ; masse du refus à 1.6 mm.
La valeur du MDE à utiliser, arrondi à l'entier le plus proche, est la moyenne des deux essais.
Donc on a ; M 500gr
m 14.4 gr
14.4
MDE 100. 2.88%
500
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
44
TP 3 : Essai Micro Deval
6 Conclusion et commentaire
Le tableau suivant (Tableau 3.4) est le tableau de classification de type de granulat selon le
coefficient Micro Deval MDE ;
Tableau 3.4. : Type des graviers selon le coefficient MDE
Valeurs de coefficient Micro Deval en présence de l’eau (%) Appréciation
< 10 Très bon à bon
De 10 à 20 Bon à moyen
De 20 à 35 Moyen à faible
> 35 Médiocre
Selon de tableau ci-dessus, on remarque que :
MDE 3% 10% Donc notre gravier est très bon à bon.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
45
TP 4 : Essai de fragmentabilité
TP 4 : Essai de fragmentabilité
(Selon la norme NF P 94-066)
1 Introduction
Bien qu’après son extraction, un déblai rocheux soit transformé en un matériau susceptible
d’être considéré, au moins partiellement, comme un sol meuble, il faut au préalable être en
mesure de prévoir, à partir de la roche en place, le comportement du matériau après abattage.
Ce besoin a conduit à établir un classement des matériaux rocheux sur la base de leur nature
géologique, de résultats d’essais (fragmentabilité, dégradabilité (TP prochain), masse
volumique... pratiqués sur des prélèvements représentatifs) et de l’expérience que l’on
possède de leur comportement au cours des différentes phases du terrassement.
2 Définition
Le coefficient de fragmentabilité (FR) est déterminé à partir d’un essai de fragmentation. Il
s’exprime par le rapport des D10 d’un échantillon de granularité initiale donnée, mesurés
avant et après lui avoir fait subir un pilonnage conventionnel avec la dame Proctor normal. Sa
détermination est en particulier nécessaire pour préciser le classement des roches argileuses
(marnes, argilites, schistes sédimentaires,...) et des roches siliceuses, magmatiques et
métamorphiques altérées ou peu résistantes.
3 Principe de l’essai
L'essai consiste à déterminer la réduction du D 10 d'un échantillon de granularité d/D donnée
soumis à un pilonnage conventionnel.
Avec : d/D, matériau constitue de grains qui sont en totalité retenus par le tamis de maille d et
passent en totalité au travers du tamis de maille D.
Cette réduction s'exprime par le rapport :
D10 ( Avant _ pilonnage)
FR
D10 ( Après _ pilonnage)
Avec : FR : Coefficient de fragmentabilité d'un matériau rocheux (en pourcentage) ; D 10 :
Dimension des grains en-dessous de laquelle se situe 10 % de la masse d'un matériau
granulaire (en millimètres).
Ce rapport est précisément le coefficient de fragmentabilité du matériau.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
46
TP 4 : Essai de fragmentabilité
4 Appareillage et matériel d'essai
Utiliser le matériel spécifique a l'essai Proctor (norme NF P 94-093) suivant :
— Lo moule CBR,
— La dame Proctor Normal,
— Le massif de réaction.
Une colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5. 10. 16, 20. 40, 50 ou 63, 80 mm.
Une balance : portée 3 000 g, précision ± 1 g.
5 Préparation des échantillons
Prélever un échantillon représentatif de la nature et de l'état hydrique du matériau rocheux
considéré par prélèvement soit carotté ; soit à la pelle hydraulique ; soit sur affleurements ;
soit directement sur le site en cours d'extraction puis préparer la fraction d/D qui sera
soumise à l’essai.
Cette fraction d/D est obtenue en fragmentant, si nécessaire, l'échantillon à l'aide d'un
marteau, puis en procédant a son tamisage au travers des tamis suivants :
10 et 20 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type marnes, argilites,
pelites...
40 et 80 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type schistes
sédimentaires et des roches magmatiques et métamorphiques altérées.
Les refus aux tamis de 20 et 80 mm peuvent être réintégrés dans la prise d'essai après
fragmentation au marteau et repassage aux travers des tamis respectifs 10/20 mm ou 40/80
mm.
La prise d'essai doit être de 2 kg (à un élément près). Elle doit être conserves à l’abri de
l’évaporation si l’essai de fragmentabilité n'est pas exécuté immédiatement après la
préparation de la fraction d/D.
6 Exécution de l’essai
Pour tracer la courbe granulométrique initiale avec trois points, tamiser la fraction 10/20 mm
ou 40/80 mm préalablement préparée respectivement au travers des tamis de 16 mm et 50
ou 63 mm, peser et noter les refus à ces tamis.
Reconstituer et rehomogénéiser la fraction d/D après ce tamisage et l’introduire dans le
moule CBR. Les éléments sont arrangés manuellement en imprimant quelques secousses au
moule par de légers coups de maillet sur les parois. La surface supérieure de l’échantillon doit
être aussi régulière que possible.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
47
TP 4 : Essai de fragmentabilité
L'ensemble moule et prise d'essai est ensuite place sur le massif de réaction utilisé pour
l'exécution des essais Proctor (voir norme NF P 94.093) et on applique à la surface de
l'échantillon 100 coups de dame Proctor Normal distribués conformément au mode de
compactage décrit pour le compactage d'une couche dans l'essai Proctor.
Après pilonnage, procéder au démoulage et à la désagrégation manuelle des éléments
éventuellement agglutinés, puis tamiser l’échantillon au travers des tamis suivants :
1, 2. 5, 10 mm lorsque la fraction soumise à l'essai est une fraction 10/20 mm ;
5, 10, 20, 40 mm lorsque la fraction soumise à l’essai est une fraction 40/80 mm ;
Procéder enfin à la pesée des refus sur chacun des tamis.
Si la désagrégation manuelle s'avère délicate du fait de la formation d'un « cake »
emprisonnant les granules dans une matrice plus ou moins argileuse et plastique, l'essai n’est
pas poursuivi et ce comportement est mentionné comme indique sur le modèle de feuille
d'essai figure 4.1.
7 Calculs et expression des résultats
A partir des résultats des pesées des refus aux différents tamis définis précédemment, établir
les courbes granulométriques de la fraction soumise à l’essai respectivement avant et après
pilonnage (norme NF P 94-056).
Déterminer sur ces courbes les valeurs respectives du D 10 du matériau respectivement avant
et après pilonnage.
Calculer le coefficient de fragmentabilité FR selon l'expression :
D10 ( Avant _ pilonnage)
FR
D10 ( Après _ pilonnage)
Etablir le procès-verbal de l’essai conformément au modèle de la feuille d’essai, Fig. 4.1.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
48
TP 4 : Essai de fragmentabilité
Fig. 4.1. Feuille d’un essai de fragmentabilité (NF P 94-066)
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
49
TP 4 : Essai de fragmentabilité
TP 4 : Compte rendu exemplaire
Essai de fragmentabilité (Selon la norme NF P 94-066)
1 Description
L’essai de fragmentabilité vise à déterminer la capacité des matériaux rocheux peu résistants
à être affectés par le trafic de chantier et à être compatibles avec un réemploi en remblai.
Deux fractions peuvent être testées : la fraction 10/20 (pour les marnes, argilites…) et la
fraction 40/80 (pour les schistes, roches magmatiques…). Une quantité de 2 kg de matériaux
est nécessaire pour l’essai, dont le principe général est présenté à la Fig. 4.2.
La courbe granulométrique de la fraction testée est mesurée sur trois points. Ensuite,
l’échantillon est introduit dans un moule CBR et soumis à 100 coups de dame Proctor Normal.
Après pilonnage, un nouveau tamisage est effectué (avec 4 tamis au minimum).
Sur les courbes granulométriques mesurées, on détermine les valeurs avant et après essai du
paramètre 𝐷10, la dimension des grains en dessous de laquelle se situe 10% de la masse du
matériau. Le coefficient de fragmentabilité 𝐹𝑅 se détermine alors selon l’expression :
D10 ( Avant _ pilonnage)
FR
D10 ( Après _ pilonnage)
2 Principe
L’essai consiste à déterminer la réduction de la dimension des grains en-dessous de laquelle
se situe 10% de la masse d’un matériau constitué de grains retenus en totalité entre deux
tamis de mailles de taille donnée soumis à un pilonnage conventionnel.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
50
TP 4 : Essai de fragmentabilité
Fig. 4.2. Fragmentabilité (Source : SETRA/GTR)
3 Appareillage utilisés
- Le moule CBR
- La dame Proctor normal
- Le massif de réaction
- Balance électronique précise à 1/1000.
- Pinceaux.
- Une colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5, 10, 16, 20, 40 et 80 mm (Fig. 4.3).
Moule CBR et dame Proctor Balance électrique Série de tamis
Fig. 4.3. Matériaux utilisés
4 Mode opératoire
- Le tamisage est effectué après la fragmentation de l’échantillon.
- Les tailles de tamis dépendront du type de matériau.
- A partir de cela, on procède à la reconstitution et à la réhomogénisation en
l’introduisant dans le moule CBR pour le compactage.
- Et enfin on effectue un tamisage après le démoulage et la désagrégation de
l’échantillon (Fig. 4.4).
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
51
TP 4 : Essai de fragmentabilité
Prélever un échantillon de fraction 8/20 Tamisat de l’échantillon avant pilonnage
Et le fragmenter à l’aide d’un marteau utilisons trois tamis
Rehomogénéiser l’échantillon et l’introduire Mesure des refus sur chaque tamis
au moule CBR, appliquant 100 coups
Fig. 4.4. Mode opératoire
5 Résultats
Les courbes granulométriques des deux échantillons sont représentées à la Fig. 4.5, avant et
après le pilonnage par la dame Proctor. Les valeurs à 10% ; 𝐷10, calculées pour les deux
échantillons, sont détaillées dans les ci-dessous.
Avant pilonnage :
méchantillon 2000gr
Les tamis (mm) Refus (gr) Tamisat cumulés (gr) Tamisat cumulés (%)
20 0 2000 100
16 505.588 1494.412 74.72
8 1494.411 0.001 0.000005
fond 0 / /
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
52
TP 4 : Essai de fragmentabilité
Après pilonnage :
méchantillon 2000gr
Les tamis (mm) Refus (gr) Tamisat cumulés (gr) Tamisat cumulés (%)
20 0 2000 100
16 304.031 1695.969 84.79
8 1148.692 547.277 27.36
4 235.382 311.895 15.59
2 89.527 222.368 11.12
1 59.666 162.702 8.13
fond 162.694 0.008 0.000004
100
Avant pilonnage
Après pilonnage
80
Tamisat cumulé (%)
60
40
20
0
0.1 1 10 100
Tamis (mm)
Fig. 4.5. Courbes granulométriques des échantillons testés avant et après pilonnage
6 Calcule du FR
Calculons alors le coefficient FR de cette façon :
D10 ( Avant _ pilonnage)
FR
D10 ( Après _ pilonnage)
Avec : D10 (Avant pilonnage) = 8.9 mm
Et : D10 (Avant pilonnage) = 1.6 mm
8.9
D’où : FR 5.56%
1.6
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
53
TP 4 : Essai de fragmentabilité
7 Conclusion et commentaire
Cette valeur de FR est largement inférieure à la valeur seuil de 7 proposée par la norme NF P
11-300 (qu’on a déjà vu en chapitre 0) pour une application en remblai. Le matériau peut
donc être considéré comme non fragmentable. On peut classer également l’échantillon dans la
classe R3 ! (mais pour trouver le chiffre à coté du 3 il est nécessaire de faire un essai de
dégradabilité qui le sujet de notre prochain TP).
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
54
TP 5 : Essai de dégradabilité
TP 5 : Essai de dégradabilité
(Selon la norme NF P 94-067)
1 Introduction
Parmi les paramètres d’identification les plus significatifs des problèmes posés par l’emploi
des matériaux dans la construction des remblais et des couches de forme, le coefficient de
dégradabilité (DG) est un représentant actif du comportement de certains matériaux rocheux
se traduisant par une évolution continue de leurs caractéristiques géotechniques (granularité,
argilosité, plasticité,...) par rapport à celles observées immédiatement après leur extraction.
Cette évolution est imputable à l'action combinée des agents climatiques ou hydrogéologiques
(gel, cycles imbibition-séchage) et des contraintes mécaniques subies. Elle conduit dans le cas
des matériaux rocheux considérés comme dégradables a une réduction plus ou moins
importante et ininterrompue des caractéristiques mécaniques et géométriques des ouvrages
dans lesquels ils sont utilisés.
2 Définition
Le coefficient de dégradabilité (DG) s’exprime par le rapport des D 10 d’un échantillon de
granularité initiale donnée, mesurés avant et après l’avoir soumis à des cycles de séchage –
immersion conventionnelle. Son interprétation vise essentiellement les possibilités d’emploi
en remblai des matériaux issus de roches argileuses (marnes, schistes sédimentaires...).
3 Principe de l'essai
L'essai consiste à déterminer la réduction du D10 d'un échantillon de granularité d/D donnée
(Matériau constitue de grains qui sont en totalité retenus par le tamis de maille d et passent
en totalité au travers du tamis de maille D) soumis à quatre cycles imbibition-séchage
conventionnels. Cette réduction s'exprime par :
D10 ( Du _ matériau _ avant _ 1er _ cycle _ imbibition/ séchage)
DG
D10 ( Du _ matériau _ après _ 4eme _ cycle _ imbibition/ séchage)
Avec : DG, Coefficient de dégradabilité d'un matériau rocheux (en pourcentage) ; D10
Dimension des grains en dessous de laquelle se situe 10 % de la masse d'un matériau
granulaire (en millimètres).
Ce rapport est précisément le coefficient de dégradabilité du matériau.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
55
TP 5 : Essai de dégradabilité
4 Appareillage et matériel d'essai
- Colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5, 10, 16, 20, 40, 50 ou 63, 80 mm.
- Etuve thermostatée réglable à 105 °C ± 2 °C. Bac métallique plat de dimensions
minimales (H x I x L): 0.1 m x 0.3 m x 0.5 m.
- Bac plat de dimensions minimales (H x I x L) : 0.25 m x 0.5 m x 0.75 m. Balance de
portée 3000 g, et de précision ± 1 g.
5 Préparation des échantillons
Prélever un échantillon représentatif de la nature du matériau rocheux considéré par
prélèvement soit carotté ; soit à la pelle hydraulique ; soit sur affleurements ; soit directement
sur le site en cours d'extraction puis préparer la fraction d/D qui sera soumise à l'essai. Cette
fraction d/D est obtenue en fragmentant si nécessaire l'échantillon avec un marteau, puis en
procédant a son tamisage au travers des tamis suivants :
10 et 20 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type marnes, argilites,
pelites... ;
40 et 80 mm pour les matériaux issus des roches argileuses du type schistes
sédimentaires.
Les refus aux tamis de 20 et 80 mm correspondant respectivement aux dimensions D des
deux fractions granulaires soumises à l’essai peuvent être réintégrés dans la prise d'essai
après fragmentation au marteau et repassage aux travers des tamis respectifs 10/20 mm ou
40/80 mm.
La prise d'essai doit être de 2 kg (A un élément près).
6 Exécution de l’essai
Pour tracer la courbe granulométrique initiale avec trois points, tamiser la fraction 10/20 mm
ou 40/80 mm préalablement préparée respectivement au travers des tamis de 16 mm et 50
ou 63 mm, peser et noter les refuse à ces tamis.
Reconstituer et rehomogénéiser la fraction d/D après ce tamisage et la repartir dans le bac
métallique. Celui-ci est alors place alternativement quatre fois successives en immersion dans
le grand bac, puis dans l'étuve réglée à 105 °C.
Le 1er cycle débute par une mise en immersion et le 4e cycle se termine par un séchage. La
durée d'un cycle est de :
• 8 h ± 1 h d'immersion,
• 16 h ± 1 h de séchage.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
56
TP 5 : Essai de dégradabilité
Apres cheque phase d'immersion et avant introduction de l’échantillon dans l'étuve, procéder
au siphonage de l'eau restant dans le bac métallique jusqu'à ce qu'il y ait risque
d'entrainement de particules solides dans l'écoulement.
A la fin du 4ème cycle, procéder au tamisage à sec de l’échantillon au travers des colonnes de
tamis suivantes :
1, 2, 5, 10 mm lorsque la fraction soumise à l’essai est une fraction 10/20 mm ;
5, 10, 20, 40 mm lorsque la fraction soumise à l’essai est une fraction 40/80 mm.
Procéder enfin à la pesée des refus sur chacun des tamis.
7 Calculs et expression des résultats
A partir des résultats des pesées des refus aux différents tamis définis précédemment, établir
les courbes granulométriques de la fraction soumise à l’essai respectivement avant et après
exposition aux quatre cycles d'imbibition-séchage (NF P 94-056). Déterminer sur ces courbes
les valeurs respectives du D10 du matériau respectivement avant et après exposition aux
cycles d'imbibition-séchage. Calculer le coefficient de dégradabilité DG d'après l'expression :
D10 ( Du _ matériau _ avant _ 1er _ cycle _ imbibition/ séchage)
DG
D10 ( Du _ matériau _ après _ 4eme _ cycle _ imbibition/ séchage)
Etablir le procès-verbal de l'essai conformément au modelé de feuille d'essai, Fig. 5.1.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
57
TP 5 : Essai de dégradabilité
Fig 5.1. Feuille d’un essai de dégradabilité (NF P 94-056)
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
58
TP 5 : Essai de dégradabilité
TP N° 5 : Compte rendu exemplaire
Essai de dégradabilité (Selon la norme NF P 94-067)
1 Description
L’essai de dégradabilité vise à évaluer la sensibilité du matériau rocheux aux sollicitations
hydriques, et donc le risque d’évolution à long terme sous l’action combinée de l’eau et des
sollicitations mécaniques.
L’échantillon testé est identique à celui préparé pour l’essai de fragmentabilité (qu’on a vu sur
le TP précédent), avec une fraction 10/20 ou 40/80 et une masse totale de 2 kg.
La granulométrie de l’échantillon est déterminée sur 3 points. L’essai consiste à soumettre
l’échantillon à quatre cycles alternant 8h d’imbibition et 16h de séchage en étuve à 105°.
Après l’essai, la granulométrie est à nouveau déterminée à l’aide de quatre tamis au minimum
(Fig. 5.2).
Sur les courbes granulométriques mesurées, on détermine les valeurs avant et après essai du
𝐷10, la dimension des grains en dessous de laquelle se situe 10% de la masse du matériau. Le
coefficient de dégradabilité 𝐷𝐺 se détermine alors selon l’expression :
D10 ( Du _ matériau _ avant _ 1er _ cycle _ imbibition/ séchage)
DG
D10 ( Du _ matériau _ après _ 4eme _ cycle _ imbibition/ séchage)
2 Principe
L’essai consiste à déterminer la réduction de la dimension des grains en-dessous de laquelle
se situe 10% de la masse d’un matériau constitué de grains retenus en totalité entre deux
tamis de mailles de taille donnée soumis à quatre cycles imbibition-séchage conventionnels.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
59
TP 5 : Essai de dégradabilité
Fig. 5.2. Dégradabilité (Source : SETRA)
3 Appareillage utilisés
- Colonne de tamis de mailles : 1, 2, 5, 10, 16 mm
- Etuve thermostatée réglable à 105°C ± 2°C
- Bac métallique plat de dimensions minimales {H x I x L} : 0.1 m x 0.3 m x 0.5 m.
- Bac plat de dimensions minimales {H x I x L} : 0.25 m x 0.5 m x 0.75 m.
- Balance portée 3000g, précision ± 1g (Fig. 5.3).
Bac métallique Balance électrique
Etuve à 105°C Série de tamis
Fig. 5.3. Matériaux utilisés
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
60
TP 5 : Essai de dégradabilité
4 Mode opératoire
- le tamisage est effectué après la fragmentation de l’échantillon. Les tailles de tamis
dépendront du type de matériau.
- A partir de cela, on procède à la reconstitution et à la réhomogénisation de la fraction
en la répartissant dans un bac métallique que l’on place alternativement quatre fois
successivement en immersion dans un grand bac, puis dans l’étuve a 105°C. Le 1er
cycle débute par une mise en immersion et le 4ème cycle se termine par un séchage.
- Après le 4ème cycle, on procède au tamisage.
Deux valeurs seuils sont retenues dans la classification française des roches NF P11-300 (Voir
chapitre 0) pour le coefficient de dégradabilité. Les matériaux pour lesquels 𝐷𝐺 < 5 sont
considérés comme peu dégradables, ceux pour lesquels 𝐷𝐺 > 20 sont considérés comme très
dégradables, tandis que les matériaux présentant une valeur intermédiaire de 𝐷𝐺 sont
moyennement dégradables.
5 Résultats
Les résultats de l’essai de dégradabilité sont présentés dans les Tableaux ci-dessous et à la Fig.
5.4.
Avant 1 er cycle Imbibition/Séchage :
méchantillon 2000gr
Les tamis (mm) Refus (gr) Tamisat cumulés (gr) Tamisat cumulés (%)
20 0 2000 100
16 325.465 1674.535 83.72
8 1674.507 0.028 0.000014
fond 0 / /
Après pilonnage :
méchantillon 2000gr
Les tamis (mm) Refus (gr) Tamisat cumulés (gr) Tamisat cumulés (%)
20 0 2000 100
16 311.751 1688.249 84.41
8 1669.967 18.282 0.91
4 12.551 5.731 0.28
2 0.333 5.398 0.26
1 0.388 5.01 0.25
fond 4.998 0.012 0.0006
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
61
TP 5 : Essai de dégradabilité
100
Avant 1er cycle
imbibition/séchage
80
Après 4ème cycle
imbibition/séchage
Tamisat cumulé (%)
60
40
20
0
0.1 1 10 100
Tamis (mm)
Fig. 5.4. Courbes granulométriques des échantillons testés avant 1er cycle et après
4ème cycle imbibition/séchage
6 Calcule du DG
Calculons alors le coefficient DG de cette façon :
D10 ( Du _ matériau _ avant _ 1er _ cycle _ d ' imbibition/ séchage)
DG
D10 ( Du _ matériau _ après _ 4eme _ cycle _ d ' imbibition/ séchage)
Avec : D10 (Avant 1er cycle imbibition/séchage) = 8.96 mm
Et : D10 (Après 4ème cycle imbibition/séchage) = 8.87 mm
8.96
D’où : DG 1.01%
8.87
7 Conclusion et commentaire
La valeur du coefficient de dégradabilité est quasiment égale à 1, ce qui signifie que le
matériau testé n’est pas dégradables sous l’action de sollicitations hydriques.
Le matériau testé présente de bon résultats aux essais de dégradabilité et fragmentabilité, ce
qui n’est pas surprenant puisque ces essais sont initialement prévus pour une utilisation en
remblais (et non en sous-fondation) et sont donc moins stricts que les essais Los Angeles et
Micro-Deval. On retiendra néanmoins que l’échantillon testé présente des résultats similaire,
et ce malgré leur performance très différente aux essais classiques de durabilité. On peut
classer également l’échantillon dans la classe R34 selon la norme NF P 11-300 (voir chapitre
6).
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
62
TP 5 : Essai de dégradabilité
CONDITIONS D'UTILISATION DES MATERIAUX EN REMBLAI (SETRA/LCPC)
R34 (états th, h et m)
Sol Observations Situation Conditions d'utilisation en remblai
générales météorologique
R34th Marnes rocheuses ou roches argileuses, Matériaux normalement inutilisables en l'état
évolutives, dont la mise en remblai comporte
R34h
un risque qu'il convient d'apprécier avant + pluie
faible
Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des
garanties de qualité suffisantes
chaque chantier.
= ni pluie,
ni évaporation
Solution 1 : traitement
T : traitement à la chaux seule
Les conditions d'utilisation proposées importante C : compactage moyen
doivent être accompagnées d'une réflexion Solution 2 : fragmentation
approfondie sur les méthodes d'extraction les G : fragmentation complémentaire après extraction
plus appropriées en particulier en vue de la R : couches moyennes
fragmentation, et sur la conception globale C : compactage moyen
des remblais (couches drainantes, H : remblai de hauteur faible (5 m)
stabilisation des talus,
"imperméabilisation"...). - évaporation
importante
Solution 1 : extraction en couches, fragmentation et aération
E : extraction en couches
G : fragmentation complémentaire après extraction
Ces matériaux présentent d'autant moins de W : aération
risque d'évolution qu'ils sont mieux R : couches minces
fractionnés (viser un matériau de granularité C : compactage moyen
continue ou riche en fines), bien compactés H : remblai de hauteur moyenne (10 m)
et humides à la mise en œuvre. Solution 2 : traitement
T : traitement à la chaux seule
Une étude spécifique préalable de ces C : compactage moyen
roches est souvent nécessaire pour définir la
R34m conception du remblai, la granularité à ++ Pluie forte
Ou moyenne
situation ne permettant pas la mise en remblai avec des
garanties de qualité suffisantes
obtenir et les moyens nécessaires
correspondants, et le mode de compactage.
+ Pluie faible G : fragmentation complémentaire après extraction
R : couches moyennes
C : compactage moyen
H : remblai de hauteur moyenne (10 m)
= ni pluie,
ni évaporation
G : fragmentation complémentaire après extraction
R : couches moyennes
importante C : compactage intense
H : remblai de hauteur moyenne (10 m)
- évaporation
importante
Solution 1 : arrosage et fragmentation
G : fragmentation complémentaire après extraction
W : arrosage pour maintien de l'état
R : couches minces
C : compactage intense
H : hauteur des remblais moyenne
Solution 2 : fragmentation
G : fragmentation complémentaire après extraction
R : couches moyennes
C : compactage intense
H : remblai de hauteur moyenne (10 m)
R34s ++ Pluie moyenne
Ou forte
Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des
garanties de qualité suffisantes
+ pluie
faible
E : extraction en couches
G : fragmentation complémentaire après extraction
R : couches minces
C : compactage intense
H : remblai de hauteur faible (5 m)
= ni pluie,
ni évaporation
Solution 1 : humidification et fragmentation
G : fragmentation complémentaire après extraction
importante W : humidification pour changer d'état
R : couches minces
C : compactage intense
H : remblai de hauteur moyenne (10 m)
Solution 2 : arrosage et fragmentation
G : fragmentation complémentaire après extraction
W : arrosage pour maintien de l'état
R : couches minces
C : compactage intense
H : remblai de hauteur faible (5 m)
- évaporation
importante
Situation ne permettant pas la mise en remblai avec des
garanties de qualité suffisantes
R34ts Matériaux inutilisables dans l'état
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
63
TP 6 : Classification des matériaux
TP 6 : Classification des matériaux utilisables dans les couches de forme
d'infrastructures routières
(Selon la norme NF P 11-300 et GTR 2000)
1 Introduction
Le présent cours définit également une classification des matériaux utilisables dans la
construction des remblais et des couches de forme d'infrastructures routières ; cette
classification s'appuie sur des critères représentatifs des problèmes posés par la construction
et le comportement de ces deux natures d'ouvrages. La classification définie ici constitue la
base de la démarche suivie depuis la conception jusqu'à la réalisation de tout projet de
remblai ou de couche de forme d'infrastructures routières
On va déjà vu dans la premier cours une classification des sols, plus particulièrement les
classe A, B, C et D.
Dans cette partie, on va plus détailler la classification des matériaux rocheux (Classe R) et les
sous-produits industriels (Classe F).
2 Classification des matériaux rocheux — Classe R selon (GTR2000)
Bien qu'après son extraction un déblai rocheux soit transformé en un matériau susceptible
d'être considéré, au moins partiellement, comme un sol, la roche en place ne peut être classée
en tant que sol qu'à titre prévisionnel sur la base de sa nature géologique, de résultats d'essais
(tels que fragmentabilité, dégradabilité, masse volumique) et de l'expérience que l'on possède
de son comportement au cours des différentes phases du terrassement.
Pour caractériser un massif rocheux en vue de son emploi en remblai ou en couche de forme,
on procède successivement en deux étapes :
1) identification de la nature pétrographique de la roche ;
2) détermination des paramètres d'état et des caractéristiques mécaniques du
matériau.
2.1. Classification des matériaux rocheux d'après la nature pétrographique de la roche
Deux classes principales de matériaux rocheux sont distinguées à partir des grandes familles
de roches habituellement considérées : les matériaux rocheux issus des roches sédimentaires,
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
64
TP 6 : Classification des matériaux
d'une part, et les matériaux rocheux issus des roches magmatiques et métamorphiques,
d'autre part.
Dans le cas des roches sédimentaires, la classification est subdivisée suivant les principales
natures de roches rencontrées dans cette catégorie : roches carbonatées (craies, calcaires),
roches argileuses, roches siliceuses, roches salines.
Dans le cas des matériaux provenant de roches magmatiques et métamorphiques, aucune
subdivision complémentaire n'est nécessaire, ces matériaux pouvant être considérés comme
ayant des comportements voisins pour une utilisation limitée à la réalisation de remblais et de
couches de forme.
2.2 Classification des matériaux rocheux d'après leur état et leurs caractéristiques
mécaniques
Comme cela a été indiqué, la connaissance de la seule nature pétrographique de la roche dont
est issu un matériau rocheux, n'est généralement pas suffisant pour prévoir tous les
problèmes que peut poser son utilisation en remblai ou en couche de forme. Outre la question
du choix de la méthode d'extraction, qui n'est pas traitée ici, les aspects à considérer sont :
— l'aptitude du matériau à se fragmenter sous les sollicitations appliquées au cours des
différentes phases de la mise en œuvre, et plus précisément la possibilité de produire une
proportion d'éléments fins suffisante pour lui communiquer un comportement de sol
sensible à l'eau ;
— la potentialité d'une évolution postérieurement à la mise en œuvre sous l'action des
contraintes mécaniques seules ou conjuguées avec celles de l'eau et du gel ;
— la teneur en eau dans le cas de matériaux très fragmentables tels que certaines craies,
marnes, schistes sédimentaires, etc. qui peuvent renfermer dans leur structure une
importante quantité d'eau qui se communiquera inévitablement aux éléments fins
produits au cours du terrassement ;
— la teneur en éléments solubles dans le cas de roches salines.
Il est donc nécessaire de caractériser les matériaux rocheux vis-à-vis de chacun de ces aspects
à partir de différents paramètres dont les suivants sont considérés actuellement comme les
plus représentatifs.
Paramètres d'état et de comportement mécaniques retenus dans la classification des
matériaux rocheux :
— Le coefficient Los Angeles (LA) (norme P 18-573).
— Le coefficient micro-Deval en présence d'eau (MDE) (P 18-572).
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
65
TP 6 : Classification des matériaux
Ces deux paramètres caractérisent plus particulièrement les roches relativement dures :
granites, gneiss, calcaires durs..., leur interprétation vise essentiellement les possibilités
d'emploi de ces matériaux en couches de forme voire en couches de chaussées, comme cela a
déjà été considéré dans le cas des sols (voir le Chapitre 0).
La masse volumique (pd) d'un échantillon de roche déshydraté (norme P 94-064). Ce
paramètre qui présente l'avantage d'être aisément mesurable est en corrélation étroite avec
la fragmentabilité des matériaux tels que les craies et les calcaires tendres. Son interprétation
vise essentiellement à distinguer l'emploi de ces matériaux en remblai.
Le coefficient de fragmentabilité (FR) (norme P 94-066). Ce coefficient est déterminé à
partir d'un essai de fragmentation réalisé dans un moule CBR. Il s'exprime par le rapport des
D10 d'un échantillon de granularité initiale donnée mesurés avant et après lui avoir fait subir
un pilonnage conventionnel avec la dame Proctor Normal. L'interprétation de ce paramètre
vise les possibilités d'emploi en remblai et éventuellement en couche de forme des matériaux
rocheux relativement friables pour lesquels les paramètres précédents manquent de
signification (roches siliceuses et argileuses principalement).
Le coefficient de dégradabilité (DG) (norme P 94-067). Ce coefficient s'exprime par le
rapport des D10 d'un échantillon de granularité initiale donnée mesurés avant et après l'avoir
soumis à ces cycles de séchage-immersion conventionnels. Son interprétation vise
essentiellement les possibilités d'emploi en remblai des matériaux issus de roches argileuses
(marnes, schistes sédimentaires...).
La teneur en eau naturelle (Wn) (norme NF P 94-050). L'influence de ce paramètre n'est prise
en compte dans la classification que pour certaines craies et roches argileuses comme cela a
déjà été indiqué.
La teneur en éléments solubles (% NaCI, gypse...). L'interprétation de ce paramètre est
limitée au cas des roches salines. Valeurs-seuils retenues pour les paramètres d'état et de
comportement des matériaux rocheux : elles figurent dans le tableau général paragraphe 2.3.
2.3 Tableau général de la classification des matériaux rocheux (tableau 5 de la norme NF P
11-300)
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
66
TP 6 : Classification des matériaux
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
67
TP 6 : Classification des matériaux
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
68
TP 6 : Classification des matériaux
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
69
TP 6 : Classification des matériaux
3 Classification des sols organiques, sous-produits industriels — Classe F
Cette catégorie concerne des matériaux particuliers dont l'emploi en remblai et en couche de
forme peut dans certains cas se révéler intéressant du point de vue technique et économique
sous réserve d'être acceptable vis-à-vis de l'environnement. Toutefois, les critères au travers
desquels il convient d'examiner chaque famille de matériaux entrant dans cette catégorie
pour en déduire ses possibilités d'emploi sont à la fois très divers et spécifiques à la famille de
matériaux considérée.
Certains d'entre eux ne sont d'ailleurs pas encore complètement définis faute d'expérience et
d'études suffisantes. La classification proposée a été établie à partir du recensement des
principales familles de matériaux de cette catégorie, susceptibles d'être concernées en France
par une utilisation en remblai ou en couche de forme. Neuf familles sont ainsi dénombrées
(sous-classes F1 à F9) chacune d'elles étant caractérisée par le ou les paramètres desquels
dépendent les possibilités d'emploi. Les valeurs seuils proposées de ces paramètres
permettent d'établir des distinctions à l'intérieur d'une même famille. Le tableau 6 ci-après
présente cette classification en se limitant toutefois à une définition générale des matériaux
entrant dans chacune des neuf familles ainsi qu'à celle du ou des paramètres considérés
comme significatifs vis-à-vis de leurs possibilités d'emploi.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
70
TP 6 : Classification des matériaux
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
71
TP 6 : Classification des matériaux
4 Tableau synoptique de classification des matériaux selon leur nature
(tableau 7)
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
72
Références bibliographiques
Références bibliographiques
LCPC-SETRA. « Guide des terrassements routiers : Réalisation des remblais et des couches de
forme ». Guide technique, France, 2000.
LCPC-SETRA. « Traitement des sols à la chaux et / ou aux liants hydrauliques ». Guide
technique, France, 2000.
J. Costet, G.Sanglerat. « Cours pratique de mécanique des sols ». Dunod, 1981.
S. Amar, J.-P. Magnan. « Essais de mécanique des sols en laboratoire et en place : Aide-mémoire
». Rapport des LPC, France, 1980.
F. Schlosser. « Eléments de mécanique des sols ». Presses des Ponts, France, 1988.
P 18-101:1990 Granulats — Vocabulaire — Définitions et classifications.
P 18-572:1990 Granulats — Essai d'usure micro-Deval.
P 18-573:1990 Granulats — Essai Los Angeles.
P 18-574:1990 Granulats — Essai de fragmentation dynamique.
P 18-576:1990 Granulats — Mesure du coefficient de friabilité des sables.
NF P 94-050:1991 Sols : reconnaissance et essais — Détermination de la teneur en eau
pondérale des sols — Méthode par étuvage.
P 94-051 Sols : reconnaissance et essais — Détermination des limites d´Atterberg — Limite de
liquidité à la coupelle — Limite de plasticité au rouleau.
NF P 94-055:1991 Sols : reconnaissance et essais — Détermination de la teneur pondérale en
matières organiques d´un sol — Méthode chimique.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
73
Références bibliographiques
P 94-056 Sols : reconnaissance et essais — Détermination de la granulométrie des sols par
tamisage.
P 94-057:1992 Sols : reconnaissance et essais — Détermination de la granulométrie des sols
fins par sédimentation.
P 94-064 Sols : reconnaissance et essais — Masse volumique d´un élément de roche
déshydraté — Méthode par immersion dans l´eau.
P 94-066 Sols : reconnaissance et essais — Coefficient de fragmentabilité des matériaux
rocheux.
P 94-067 Sols : reconnaissance et essais — Coefficient de dégradabilité des matériaux rocheux.
P 94-068 Sols: reconnaissance et essais — Valeur au bleu de méthylène d'un sol — Méthode à
la tâche.
P 94-078 Sols : reconnaissance et essais — Indice CBR après immersion — Indice CBR
immédiat — Indice portant immédiat — Mesure sur échantillon compacté dans le moule CBR.
P 94-093 Sols : reconnaissance et essais — Détermination des caractéristiques de compactage
d´un sol par l´essai Proctor normal et Proctor modifié.
Dr. Benessalah I. Licence 3 : Travaux publics
74
Vous aimerez peut-être aussi
- Corrosion Genie CivilDocument25 pagesCorrosion Genie CivilAziz Ch100% (1)
- Geo TechniqueDocument61 pagesGeo TechniquemedPas encore d'évaluation
- Cours Géotechnique CH IVDocument24 pagesCours Géotechnique CH IVel mlili YoussefPas encore d'évaluation
- Los AnglosDocument4 pagesLos Anglosamroune ademPas encore d'évaluation
- Methode de Dreux GorisseDocument27 pagesMethode de Dreux GorisseOumayma RkiouakPas encore d'évaluation
- Geotech Routière M1Document75 pagesGeotech Routière M1Hawa TembelyPas encore d'évaluation
- Caractéristiques Et Propriétés Des Bétons AutoplaçantsDocument10 pagesCaractéristiques Et Propriétés Des Bétons AutoplaçantsaissaPas encore d'évaluation
- FR Brochure Plastifiants Superplastifiant Beton Pret EmploiDocument8 pagesFR Brochure Plastifiants Superplastifiant Beton Pret EmploiDavid HoffmanPas encore d'évaluation
- Chaussées en Béton de Ciment - Exécution Et Contrôle: Norme FrançaiseDocument39 pagesChaussées en Béton de Ciment - Exécution Et Contrôle: Norme Françaiserachid zoubiriPas encore d'évaluation
- 2 Essais Laboratoir Materiaux Routier PDFDocument84 pages2 Essais Laboratoir Materiaux Routier PDFZakaria AmraniPas encore d'évaluation
- Formulation Des Betons Methode de DreuxDocument8 pagesFormulation Des Betons Methode de DreuxAnouarChaabanePas encore d'évaluation
- NA5282 Sols - Reconnaissance Et Essais - Coefficient de Fragmentabilité Des Matériaux RocheuxDocument5 pagesNA5282 Sols - Reconnaissance Et Essais - Coefficient de Fragmentabilité Des Matériaux RocheuxsamiPas encore d'évaluation
- Essai D Ecrasement Du BetonDocument8 pagesEssai D Ecrasement Du BetonSamsouma Bk100% (1)
- Coef Aplatissement PDFDocument2 pagesCoef Aplatissement PDFromaissa100% (1)
- La Composition Du Beton Module MateriauxDocument32 pagesLa Composition Du Beton Module MateriauxSerge KouadioPas encore d'évaluation
- Rideau Palplanche PDFDocument12 pagesRideau Palplanche PDFharikotoPas encore d'évaluation
- Enrobé Coulé À Froid PDFDocument4 pagesEnrobé Coulé À Froid PDFkhalidboutahriPas encore d'évaluation
- Théorie Et Physique de BétonDocument58 pagesThéorie Et Physique de Bétonmichael2Pas encore d'évaluation
- 6-Soutenement Des OsDocument15 pages6-Soutenement Des OssoltanePas encore d'évaluation
- TP RouteDocument8 pagesTP RouteSaidPas encore d'évaluation
- Al Omrane Fes Etude Geotechnique Marche N°34-2017Document10 pagesAl Omrane Fes Etude Geotechnique Marche N°34-2017Abdelilah ElmahsaniPas encore d'évaluation
- Formulation Et Proprietes Des Betons de Sable Renforce de Fibres de PolypropyleneDocument11 pagesFormulation Et Proprietes Des Betons de Sable Renforce de Fibres de PolypropyleneMissoum KaboPas encore d'évaluation
- Essai Marshall Et DuriezDocument15 pagesEssai Marshall Et DuriezJoPas encore d'évaluation
- CCTP GabionDocument2 pagesCCTP GabionsaamehbenhelelPas encore d'évaluation
- Généralités Sur Les GéosynthétiquesDocument52 pagesGénéralités Sur Les GéosynthétiquesLyes BELKACEMIPas encore d'évaluation
- Methode de Dreux GorisseDocument13 pagesMethode de Dreux Gorisseali bin sefu0% (1)
- L'influence de L'affaissement Et deDocument20 pagesL'influence de L'affaissement Et deMohsen TennichPas encore d'évaluation
- Les Fissures-Entretien Routier CoursDocument4 pagesLes Fissures-Entretien Routier CoursbertinPas encore d'évaluation
- Chapitre VI - PARTIE 2 LES BETONS HYDRAULIQUESDocument61 pagesChapitre VI - PARTIE 2 LES BETONS HYDRAULIQUESdouo100% (1)
- Rapport General de TP Specialise Vrai PDFDocument82 pagesRapport General de TP Specialise Vrai PDFEzechias SteelPas encore d'évaluation
- Dynamique Des Sols Master de Recherche CHAPITRES 0 ET 1Document56 pagesDynamique Des Sols Master de Recherche CHAPITRES 0 ET 1jijiPas encore d'évaluation
- Réalisé Par:: BANNOUR AbdelilahDocument13 pagesRéalisé Par:: BANNOUR AbdelilahRKIBI TAOUFIKPas encore d'évaluation
- TP RouteDocument37 pagesTP RouteHamza AbidiPas encore d'évaluation
- 5-Etude Du Tassement PDFDocument7 pages5-Etude Du Tassement PDFSerigne Abdoul Aziz MbodjPas encore d'évaluation
- Le Revêtement Routier - Les Enrobés BitumineuxDocument27 pagesLe Revêtement Routier - Les Enrobés BitumineuxAhmed RekikPas encore d'évaluation
- Corps Du Documnt CBRDocument9 pagesCorps Du Documnt CBRIbrahim Ouattara100% (1)
- NA427Document5 pagesNA427Lsp Ergosot Khemis-khechnaPas encore d'évaluation
- Essai de Portance A La Plaque Poutre de Benkelman 165Document1 pageEssai de Portance A La Plaque Poutre de Benkelman 165Seif Eddine100% (1)
- 54Document57 pages54Mohamed MehdiPas encore d'évaluation
- Chap 11 Bap BHP BFDocument7 pagesChap 11 Bap BHP BFStan FordPas encore d'évaluation
- Analyse Béton FraisDocument2 pagesAnalyse Béton FraisHassan Amerzag100% (1)
- Mini Projet RouteDocument37 pagesMini Projet RouteGhassen MradPas encore d'évaluation
- Classification Des Missions Géotechniques PDFDocument4 pagesClassification Des Missions Géotechniques PDFAlix Sossou100% (1)
- TP de CBR MdsDocument9 pagesTP de CBR Mdsmademoiselle FPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 - La Geotechnique RoutiereDocument182 pagesChapitre 1 - La Geotechnique RoutiereFadwa El KhouPas encore d'évaluation
- Essais Sur Les BitumesDocument6 pagesEssais Sur Les BitumesZoomaa Hazem Aloui100% (2)
- Dimensionnement ChausséeDocument19 pagesDimensionnement Chausséeesdras ABLY100% (1)
- Cours MDS 1 L2 2020-2021Document39 pagesCours MDS 1 L2 2020-2021Tasleem MuhammadPas encore d'évaluation
- California Bearing RatiotestDocument4 pagesCalifornia Bearing Ratiotestmademoiselle FPas encore d'évaluation
- Rapport Geotechnique - Stations de PompageDocument14 pagesRapport Geotechnique - Stations de Pompagefouad.zehouani1987Pas encore d'évaluation
- ProctorDocument19 pagesProctorAbdoul Fatré KienouPas encore d'évaluation
- Essais Des EnrobesDocument6 pagesEssais Des EnrobesAbir JamaliPas encore d'évaluation
- Essais Labo PDFDocument153 pagesEssais Labo PDFsabrina souPas encore d'évaluation
- Utilisation Des Tufs Calcaires - Sable de Dune PDFDocument99 pagesUtilisation Des Tufs Calcaires - Sable de Dune PDFAbdelghani BouhouchePas encore d'évaluation
- P98-131 BB AéronautiqueDocument16 pagesP98-131 BB AéronautiqueMohamed Redha Bekhouche100% (1)
- TP5. Micro DevalDocument3 pagesTP5. Micro DevalHakim DZPas encore d'évaluation
- TP-03 Essai Micro-DevalDocument3 pagesTP-03 Essai Micro-DevalKhalil KhalilPas encore d'évaluation
- TP 3Document6 pagesTP 3Mohammed MadaniPas encore d'évaluation
- Compte Rendue Essai Micro DévalDocument6 pagesCompte Rendue Essai Micro DévalMohamed Elmokhtar TiyebPas encore d'évaluation
- Essai de TriaxialDocument12 pagesEssai de TriaxialÄß ŁäPas encore d'évaluation
- Tomographie ÉlectriqueDocument4 pagesTomographie ÉlectriqueÄß ŁäPas encore d'évaluation
- Matrice de RigiditeDocument4 pagesMatrice de RigiditeÄß ŁäPas encore d'évaluation
- Exercices VL - DynaSOLDocument31 pagesExercices VL - DynaSOLÄß ŁäPas encore d'évaluation
- Pathologie Des ChausseesDocument37 pagesPathologie Des ChausseesAbderrahman LahkaimiPas encore d'évaluation
- Travaux Pratiques de Materiaux de ConstructionsDocument40 pagesTravaux Pratiques de Materiaux de Constructionssamiahannachi100% (5)
- 1177,1041, Graves de Recyclage Issues deDocument23 pages1177,1041, Graves de Recyclage Issues deTaibiBoukalmounePas encore d'évaluation
- J.C Et Pikan Los Angeles Et Fragmentation DynamiqueDocument7 pagesJ.C Et Pikan Los Angeles Et Fragmentation DynamiqueBarryPas encore d'évaluation
- Analyse Granulometrique TP N 2 NOM Preno PDFDocument12 pagesAnalyse Granulometrique TP N 2 NOM Preno PDFSalima MimaPas encore d'évaluation
- Fascicule 6 - Office Des AsphalteDocument27 pagesFascicule 6 - Office Des AsphalteMohamedAhfourPas encore d'évaluation
- Blanche Devis DescriptifDocument17 pagesBlanche Devis Descriptifpascal kenPas encore d'évaluation
- République Algérienne Démocratique Et PopulaireDocument7 pagesRépublique Algérienne Démocratique Et PopulaireYassine BelkadaPas encore d'évaluation
- Test Chef de Projet Wash-AtpcDocument5 pagesTest Chef de Projet Wash-AtpcGuillaume Djerabe100% (2)
- Examen Final TodayDocument2 pagesExamen Final Todayd61516117Pas encore d'évaluation
- Ciments - Liants Hydrauliques Routiers - Bétons: Documentation Technique Le Point Sur ChantierDocument20 pagesCiments - Liants Hydrauliques Routiers - Bétons: Documentation Technique Le Point Sur Chantierseneadame48Pas encore d'évaluation
- Methode de DreuxDocument31 pagesMethode de Dreuxhadji100% (1)
- Matériaux de Construction - TD 2009-2010Document3 pagesMatériaux de Construction - TD 2009-2010hamzadutsherPas encore d'évaluation
- La Formulation Du BétonDocument5 pagesLa Formulation Du Bétonحمزة متسو75% (4)
- DEVOIR N°2 de Matériaux de ConstructionDocument6 pagesDEVOIR N°2 de Matériaux de ConstructionOthniel MeignanPas encore d'évaluation
- TP-03 Essai Micro-DevalDocument3 pagesTP-03 Essai Micro-DevalKhalil KhalilPas encore d'évaluation
- Mémoire ValidéDocument88 pagesMémoire ValidéAliAnis0% (1)
- Essai Granulométrique+sédimentométrie PDFDocument19 pagesEssai Granulométrique+sédimentométrie PDFAdem Phy100% (2)
- Methode Dreux Goriss SNC MezoughiDocument7 pagesMethode Dreux Goriss SNC MezoughizakariaPas encore d'évaluation
- MEMOIRE FINAL DJADJOUKOA JacquesDocument110 pagesMEMOIRE FINAL DJADJOUKOA JacquesCabrel FankamPas encore d'évaluation
- Rapport Financier Annuel 2023 0CIMENT MAROCDocument196 pagesRapport Financier Annuel 2023 0CIMENT MAROCwijdane.missor1Pas encore d'évaluation
- Mémoire BoughezoulDocument114 pagesMémoire BoughezoulHoho MansourbenPas encore d'évaluation
- CCTP Materiaux Blancs Cle6cc323Document40 pagesCCTP Materiaux Blancs Cle6cc323Abdelghani BouhouchePas encore d'évaluation
- 1 LEs GranulatsDocument47 pages1 LEs GranulatsSalhi ImanePas encore d'évaluation
- GBB Eb GNF GNNB GnaDocument9 pagesGBB Eb GNF GNNB GnaelflouliPas encore d'évaluation
- Chapitre 4 Les Matériaux Routiers PDFDocument49 pagesChapitre 4 Les Matériaux Routiers PDFOusmane Dieng100% (6)
- 8compactage Bomag Internet Procedes Generaux de ConstructionDocument39 pages8compactage Bomag Internet Procedes Generaux de ConstructionYaya Issouf Ouattara100% (1)
- La Formulation Du BétonDocument5 pagesLa Formulation Du BétonKandousi Yassine100% (2)
- Méthodes de Formulation Des BétonsDocument31 pagesMéthodes de Formulation Des BétonsjfejfePas encore d'évaluation
- Chapitre V Dimensionnement Des Corps Des Chaussées +Document10 pagesChapitre V Dimensionnement Des Corps Des Chaussées +RamziElMaistroPas encore d'évaluation