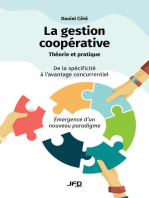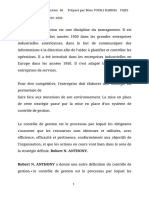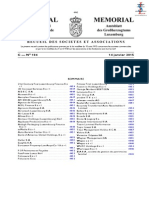Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Analyse de CPC Esg Caf 4
Analyse de CPC Esg Caf 4
Transféré par
Nouhaila NousairTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Analyse de CPC Esg Caf 4
Analyse de CPC Esg Caf 4
Transféré par
Nouhaila NousairDroits d'auteur :
Formats disponibles
L’Analyse de l’Activité et
des performances
Le compte de produits et de charges (CPC)
Le compte de CPC enregistre certaines opérations de l’entreprise pendant un
exercice, en charges ou en produits. Il explique la formation du résultat comptable
à partir de la nature des opérations retenues : exploitation, financières,
exceptionnelles.
1. Charges et produits
Le résultat est la différence entre les produits obtenus et les charges
supportées durant un exercice.
Un produit est une source potentielle de liquidités ou la disparition d’une
charge.
Une charge est un achat de bien, la rémunération d’un service ou
l’enregistrement d’une perte de valeur.
Le compte de CPC enregistre des flux représentatifs d’une
création définitive de richesse (exemple production d’un bien) ou
une destruction définitive de richesse (exemple paiement de charges
d’intérêt).Par contre on n’y trouvera pas les opérations relatives à
l’obtention d’une ressource nouvelle réversible (exemple : souscription
d’une dette) ou les opérations relatives à des acquisitions réversibles
(exemple : achat d’un outillage). Compte tenu de cette particularité, le
compte de résultat explique la création de richesse au cours de la période.
2. Présentation des opérations
Les flux relatifs aux opérations retenues sont regroupés par nature : résultat
d’exploitation, financier, non courant.
NB. Les flux regroupés dans le compte de CPC sont des flux de fonds et
non des flux de liquidités. Le résultat n’est donc pas équivalent à une
recette.
Les soldes intermédiaires de gestion.
Cet outil sert à l’analyse de l’activité et de la rentabilité d’une entreprise, cette
analyse a pour objectif de se prononcer sur la structure de produits et des
charges et sur leur évolution et d’apprécier les différents niveaux de marge et de
rentabilité caractérisant le déroulement de cette activité. Ces marges s’analysent
de l’amont vers l’aval, en particulier de la valeur ajoutée jusqu’au résultat net
comptable.
Chiffre d’affaires
CA = Vente de marchandise en l’état +Vente de biens et services produits
Marge brut ou commerciale :
Marge = vente de marchandises en l’état – achats revendus de marchandises
Il s’agit d’une ressource pour les entreprises commerciales ou un complément de
ressources dans les activités à activité mixte. C’est le premier indicateur pour
apprécier les performances d’une activité de négoce.
Il faut toujours veiller à comparer les résultats obtenus avec d’autres entreprises
du même secteur d’activité.
Par exemple : Le commerce de luxe où la marge commerciale est forte alors que
dans la grande distribution, la marge est généralement faible.
L’analyse de la marge commerciale permet de cerner les grandes lignes de la
politique commerciale : volumes, prix de vente.
Limites de ce solde : les achats sont évalués à leur coût externe d’achat alors que
les stocks le sont au coût complet. Par ailleurs, certaines subventions
d’exploitation qui représentent un complément au prix de vente pourraient être
pris en compte comme faisant partie du prix de vente.
Il faut prendre en considération que
- d’une part, les ventes de marchandises, sont nettes des RRRA
(rabais, remise, ristourne accordée par l’entreprise) ;
- et, d’autre part, les achats revendus de marchandise sont net des
RRRO (rabais, remise, ristourne obtenus) sur achats.
Dans l’effet, la marge commerciale constitue un indicateur fondamental de la
performance d’une entreprise commerciale.
Dans cette perspective il faut suivre attentivement quelques indicateurs tels :
Evolution des ventes de marchandises :
vente de Mise année N- vente de Mise année N-1>0
Vente de Mise année N-1
Marge commerciale : Mesure la
performance de l’activité commerciale de l’entreprise ; elle peut
être suffisantes pour couvrir toutes les charges en dehors du coût
d’achat de marchandises vendues
Le calcul des ratios sur plusieurs années permet de mettre en
évidence l’évolution de la marge réalisée par l’entreprise ; une
diminution est plutôt appréhendée comme négative et il faut en
identifier la cause :
1. Problème commercial, l’entreprise n’arrive pas à vendre ses
marchandises à un prix suffisant
2. Un problème d’approvisionnement, l’entreprise n’arrive pas à
maitriser l’évolution des prix d’achat
La comparaison des ratios avec ceux des concurrents. Si le ratio est
supérieur à celui des concurrents c’est le signe d’une efficacité
commerciale, mais si ce dernier est inférieur c’est le signe d’une
vulnérabilité (tout problème conjoncturel sur le marché peut avoir
des effets néfastes sur l’entreprise et moins de possibilités
d’absorption des chocs et de réactions que ses concurrents)
La production :
Production de l’exercice = ventes de biens et de services produits (+ ou -)
variation de stocks + immobilisations produites par l’entreprise pour elle-même.
La production de l’exercice résulte de trois composantes principales : les ventes
(la production vendue), la variation de stocks de produits en cours et de produits
finis (production stockée) et la production réalisée par l’entreprise pour elle
même en vue d’être immobilisée.
L’évolution de la production vendue en valeur et en volume est attentivement
suivie par l’analyste; elle peut indiquer une progression une stagnation ou une
régression de l’activité. La production de l’exercice constitue un indicateur de
gestion qui n’est pas homogène, car la production
vendue est exprimée en prix de vente alors que la production stockée et la
production immobilisée sont évaluées au coût de production.
C’est un solde qui ne concerne que les entreprises industrielles de
transformation de biens et services. Elle ne comprend pas les subventions qui
pourraient être considérées comme un complément de prix.
Certains indicateurs doivent être appréhendés tels :
Evolution de la production :
Si les évolutions du CA et de la VA sont divergentes alors il faut se
pencher sur l’évolution de la production stockée
La production stockée faisant apparaître un déstockage peut signifier
une reprise de la demande pour une production constante ; et
inversement
La valeur ajoutée :
Valeur ajoutée = la marge brute + production de l’exercice – consommations de
l’exercice.
La valeur ajoutée exprime la richesse crée par l’entreprise. Elle représente
l’apport de l’entreprise à l’économie c’est à dire la contribution de cette dernière
à la formation du produit intérieur brut (principal richesse du pays).
La V.A sert à rémunérer :
- le personnel : salaire et charge.
- L’état : impôts et taxe (sauf TVA).
- Les bailleurs de fonds : frais financier.
- Le capital : bénéfices.
- Renouveler les investissements : amortissements.
La V.A peut être obtenue par la différence entre la production totale de
l’exercice et la totalité des consommations externes absorbées par l’entreprise
pour réaliser cette production.
La valeur ajoutée est un bon indicateur du poids économique de l’entreprise.
Elle permet d’apprécier le développement et la régression de l’activité de
l’entreprise. Comparée au moyen mis en œuvre (personnel, équipements), la
valeur ajoutée rend compte de l’efficacité de ces moyens d’exploitation.
une démarche générique d’analyse de la Valeur ajoutée est généralement
souhaitable :
1) Calcul de la valeur ajoutée sur plusieurs années successives. Evolution
de la VA : permet d’apprécier la croissance ou
la régression de l’activité de l’entreprise
2) Comparaison des évolutions respectives du CA et de VA
3) Calcul du taux de valeur ajoutée ou taux d’intégration
Mesure le degré d’intégration de l’entreprise dans le processus de
production
4) Il faut aussi compléter l’analyse par l’étude de la consommation de
l’entreprise
5) Comparaison sectorielle de la performance en matière de valeur
ajoutée
6) Analyser l’efficacité de la combinaison productive à travers les ratios
suivants
La répartition de la valeur ajoutée
Bénéficiaire Nature et composition ratio N N+1
Salariés Charges de personnel :
Salaires
Charges sociales Charges de personnel
Intérimaires si retraitement VA
% %
Etat Impôt et taxes : I&T + IS % %
I&T VA
IS
Bailleurs de Charges financières : Charges financières % %
fonds Intérêts versés VA
Actionnaires dividendes Dividendes % %
VA
Entreprise Autofinancement ou CAF à Autofinancement % %
défaut VA
TOTAL Valeur ajoutée 100 100
Le Total n'est PAS TOUJOURS EGAL à la VA calculée dans les SIG : il manque
d’autres éléments comme les éléments exceptionnels ….
Excédent brut d’exploitation :
EBE = VA + subventions d’exploitation – impôts et taxes – charges de
personnels
Représente la performance économique de l’entreprise. Ce solde important pour
les entreprises du fait qu’il indique la ressource générée par l’exploitation
indépendamment de la politique d’investissement (dotations d’amortissement) ,
du mode de financement (politique financière) ou de la politique fiscale
puisqu’il est calculé avant la prise en compte des amortissements , des charges
financières et des impôts. Il constitue donc un surplus qui va servir à payer les
autres partenaires de l’entreprise (bailleurs de fonds, actionnaires,..).
Cet indicateur est d’une grande importance dans l’approche comparative car il
permet :
- des comparaisons inter entreprises.
- des comparaisons plus « fiables » que le résultat
d’exploitation.
Certains ratios peuvent êtres utilisés pour compléter l’analyse de ce solde
tels :
Résultat d’exploitation :
Résultat d’exploitation = EBE + autres produits d’exploitations – autres charges
d’exploitations - dotations d’exploitation + reprises
d’exploitation
Il mesure l’enrichissement de l’entreprise en tenant compte de l’usure et de la
dépréciation du capital économique. Ce solde est donc marqué par les choix
effectués et les contraintes liées à l’amortissement comptable.
C’est le premier et principal solde calculé par le CPC. Permet d’apprécier la
performance industrielle et commerciale de l’entreprise et comparer les
performances d’entreprises dont les politiques de financement sont différents.
Résultat financier :
Résultat financier = produits financiers – charges financièr
Le résultat financier prend en compte les aspects financiers et tout
particulièrement la structure de financement de l’entreprise.
Les charges se composent des intérêts des emprunts, des comptes courants
d’associés, agios.
Les produits financiers ont trois grandes sources :
. les placements de trésorerie (VMP …)
. les revenus du portefeuille financier à MT LT
. les dividendes venant des participations dans d’autres sociétés.
C’est le solde découlant des produits et charges relatifs aux décisions financières
de l’entreprise. C’est un résultat qui permet d’apprécier la performance de
l’entreprise quant à sa politique de financement liée à l’activité courante.
Résultat courant :
Résultat courant = résultat d’exploitation (+ ou –) résultat financier
Le résultat courant permet de calculer la performance globale de l’entreprise
censée correspondre à son activité normale. Il sera réparti entre l’Etat (impôt sur
les bénéfices), les actionnaires (sous forme de dividendes), l’entreprise elle-
même (sous forme des réserves).
Dernier solde avant la prise en compte des charges et produits non courant et de
l’impôt sur les résultats.
Résultat non courant :
Résultat non courant = produits non- courants – charges non courantes
Il figure dans le TFR comme un solde à part. Il existe deux types d’opérations
non courantes, tant en charges qu’en produits.
-les charges et les Produits qui sont inhabituels (pénalités supportées ou
perçues) mais liées à l’activité courante de l’entreprise,
-Les opérations en capital. Il s’agit surtout de cessions d’immobilisations
(physiques et financières)
Il est donc indépendant des soldes précédents et résulte des opérations réalisées
à titre exceptionnel pour l’entreprise, qu’il s'agisse d’opérations rattachées à
l’exercice ou à rattacher à des exercices antérieurs. Son intérêt est qu’il donne
une mesure des opérations non répétitives dans le résultat net de l’exercice.
Résultat net :
Résultat net = résultat courant (+) ou (-) résultat non courant– impôt sur les
résultats
Le résultat de l’exercice mesure l’augmentation du patrimoine de l’entreprise du
fait des opérations industrielles, commerciales et financières de l’exercice.
Il donne la mesure de la part des capitaux propres dans le revenu de l’exercice.
En effet ce résultat constitue une rubrique qui figure parmi les éléments des
capitaux propres au passif du bilan.
Pour une meilleure analyse le raisonnement en % du CA (activité de négoce ou
mixte) ou de la valeur de production (activité industrielle) est indispensable.
⇒ si RN> 5% ; résultat moyen
⇒ si 5%<RN<10 % ; résultat convenable
⇒ si RN > 10% ; bon résultat
Il faut aussi regarder si le poids des résultats exceptionnels ne gonfle pas ou
« plombe » artificiellement le résultat.
Notion de la Capacité d’autofinancement : CAF
En général c’est l’ensemble des produits encaissables moins l’ensemble des
charges décaissables.
Elle est constituée par l’ensemble des ressources générées par l’entreprise au
cours d’un exercice. Elle mesure l’épargne brute réalisée par l’entreprise au
cours de l’exercice. La CAF représente un indicateur de sécurité sur le plan
financier surtout pour un dossier de crédit présenté auprès d’une banque.
La CAF ne représente qu’un potentiel de financement. Comme le résultat, elle
n’est liquide que si elle s’extériorise en trésorerie et pour la seule partie non
utilisée dans le financement des emplois financiers de l’exercice.
La notion a perdu une partie de sa puissance ces dernières années au profit de
grandeurs reconstituant les flux de trésorerie produits par les opérations de
l’entreprise.
Mode de calcul de la CAF
La CAF peut être calculée à partir de l’EBE ou à partir du résultat net
comptable.
Le plan comptable marocain a préconisé la deuxième méthode.
Signe Mode de calcul
Résultat net de l’exercice
+ Dotations d’exploitation
+ Dotations financières
+ Dotations non courantes
- reprises d’exploitation
- reprises financières
- reprises non courantes
- produits des cessions d’immobilisations
+ valeurs nettes d’amortissements des immobilisations cédées
Capacité d’autofinancement CAF
+ Dividende
Autofinancement
Méthode soustractive
Cette formulation est dite explicative car chacun des postes
apparaissant dans la définition est théoriquement générateur de
trésorerie. Cette méthode doit toujours être préférée à l'approche
vérificative.
Le calcul de la CAF est plus ou moins long selon que l'on connaît
ou non l'excédent brut d'exploitation (EBE).
Excédent brut d’exploitation (EBE)
+ Transferts de charges d’exploitation
+ Autres produits d’exploitation
- Autres charges d’exploitation
+ Produits financiers
- Charges financières
+ Produits non courants
- Charges non courantes
- impôts sur les bénéfices
= CAF
L’autofinancement
L'autofinancement est la part de la CAF consacrée au
financement de l'entreprise. C'est la ressource interne
disponible après rémunération des associés.
Autofinancement de l'exercice (n)
=
CAF (n)
-
Dividendes versés durant l'exercice (n) et relatifs aux résultats de l'exercice
n-1
Vous aimerez peut-être aussi
- Résumé Droit Commercial s4Document5 pagesRésumé Droit Commercial s4Asmaa Lahouaoui100% (8)
- Compte-Rendu D'infraction Initi FDocument2 pagesCompte-Rendu D'infraction Initi Ffrancoisferrarini27Pas encore d'évaluation
- L'analyse de L'activité Et Résultat de L'entrepriseDocument13 pagesL'analyse de L'activité Et Résultat de L'entrepriseAdil LahlaliPas encore d'évaluation
- La LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmeD'EverandLa LA GESTION COOPERATIVE - THEORIE ET PRATIQUE: De la spécificité à l’avantage concurrentiel - Émergence d’un nouveau paradigmePas encore d'évaluation
- Pratiques managériales républicaines: À l'action, cadres de l'état !D'EverandPratiques managériales républicaines: À l'action, cadres de l'état !Pas encore d'évaluation
- Anesthesie PediatriqueDocument38 pagesAnesthesie PediatriqueSilvie DinPas encore d'évaluation
- Pr. KHALID BELKHOUTOUT Droit Commercial & Droit Des Sociétés PA2Document82 pagesPr. KHALID BELKHOUTOUT Droit Commercial & Droit Des Sociétés PA2Sanae GhanmiPas encore d'évaluation
- Les Titres Financiers (Réparé)Document51 pagesLes Titres Financiers (Réparé)Salma BriaPas encore d'évaluation
- La GrandeurDocument53 pagesLa GrandeurYaya OusmanPas encore d'évaluation
- QCM Diagnostic MarketingDocument3 pagesQCM Diagnostic MarketingAsmaa Lahouaoui0% (1)
- Chapitre 3 Analyse Par L - ESGDocument8 pagesChapitre 3 Analyse Par L - ESGRachid TahiriPas encore d'évaluation
- V D IAS 16 LOTFI CorporelleDocument98 pagesV D IAS 16 LOTFI CorporelleNajlae MaaounePas encore d'évaluation
- La Norme Comptable Internationale IAS 38Document18 pagesLa Norme Comptable Internationale IAS 38SalmaPas encore d'évaluation
- Cycle D'expertise Comptable 2005Document5 pagesCycle D'expertise Comptable 2005Hanane LouarratPas encore d'évaluation
- Module 2 Gestion Budgetaire PDFDocument135 pagesModule 2 Gestion Budgetaire PDFMamadou DiaPas encore d'évaluation
- Essentiel de La Comptabilite Approfondie Mechatt INTERESSANTDocument57 pagesEssentiel de La Comptabilite Approfondie Mechatt INTERESSANTali100% (2)
- Cour s6 Contrôle de Gestion Prof TouiliDocument71 pagesCour s6 Contrôle de Gestion Prof TouiliRachid Ablouh100% (1)
- S Jamal Semestre 4 Cours Analyse Financéire Yjamal PPPDocument15 pagesS Jamal Semestre 4 Cours Analyse Financéire Yjamal PPPKhadija LazrakPas encore d'évaluation
- Controle de Gestion - AGRADDocument25 pagesControle de Gestion - AGRADAsmaa ArifiPas encore d'évaluation
- Correction ENCG SettatDocument3 pagesCorrection ENCG SettatSimo YahiouPas encore d'évaluation
- Cours Contrôle BudgétaireDocument81 pagesCours Contrôle BudgétaireIMANE ENNAJYPas encore d'évaluation
- Bale 2Document28 pagesBale 2Bachir ElPas encore d'évaluation
- Chapitre IV Avec Correction Contrc3b4le de Gestion Et Modifications Organisationnelles PDFDocument53 pagesChapitre IV Avec Correction Contrc3b4le de Gestion Et Modifications Organisationnelles PDFMed Khalil FarhatPas encore d'évaluation
- Gestion de La TresorerieDocument57 pagesGestion de La TresorerieLatifa KadmiriPas encore d'évaluation
- 117 Exam Essai 2017 CorrigeDocument14 pages117 Exam Essai 2017 CorrigeMarc Justin NgassamPas encore d'évaluation
- Calcul Des Soldes Intermédiaires de GestionDocument7 pagesCalcul Des Soldes Intermédiaires de GestionElhachemi AlouachePas encore d'évaluation
- Chapitre 2 Le Budget Des VentesDocument5 pagesChapitre 2 Le Budget Des VentesGaetan MAKAKOUPas encore d'évaluation
- Vesport 2Document5 pagesVesport 2Khaoula El Boukhari100% (1)
- La Comptabilité Approfondie. Plan de La MatièreDocument23 pagesLa Comptabilité Approfondie. Plan de La MatièreAnas BouchikhiPas encore d'évaluation
- Cours de Fiscalité 22-23 Version 2 Du 22-01-2023Document77 pagesCours de Fiscalité 22-23 Version 2 Du 22-01-2023im zPas encore d'évaluation
- Cours SocialDocument17 pagesCours SocialMonir AmariPas encore d'évaluation
- Cas Pratique CPC Et EsgDocument2 pagesCas Pratique CPC Et EsgMohamed RafikyPas encore d'évaluation
- Ouisski Abdessamad PFE - CopieDocument51 pagesOuisski Abdessamad PFE - CopiealiPas encore d'évaluation
- État de RésultatDocument26 pagesÉtat de RésultatSyrine Mohamed100% (1)
- Comptabilité Des SociétésDocument12 pagesComptabilité Des SociétésKawtar Haddani0% (1)
- L'analyse Du Bilan Selon L'approche Fonctionnelle-ConvertiDocument5 pagesL'analyse Du Bilan Selon L'approche Fonctionnelle-ConvertiSALMA BENABDILLAH100% (1)
- Les Fusions Cours CompletDocument125 pagesLes Fusions Cours Complettaha elabbassiPas encore d'évaluation
- Controle de Gestion s6Document46 pagesControle de Gestion s6lamyaa errPas encore d'évaluation
- Série 2 Ias 38Document9 pagesSérie 2 Ias 38bilelPas encore d'évaluation
- Examens Finance 2015-2022Document162 pagesExamens Finance 2015-2022Kcharem Nidhal100% (1)
- Exercice ConcordanceDocument6 pagesExercice ConcordanceAyoub100% (1)
- Rapport de Stage Cac-La Tenue Comptable3Document42 pagesRapport de Stage Cac-La Tenue Comptable3Hellela BelmesPas encore d'évaluation
- Rapport PFE Version FinaleDocument113 pagesRapport PFE Version FinaleChaimae BelkhouPas encore d'évaluation
- Budget Des Ventes 2 Master CCADocument27 pagesBudget Des Ventes 2 Master CCANou haila100% (2)
- Rapport de Stage LP GCFDocument30 pagesRapport de Stage LP GCFChaimaa ElfaqihPas encore d'évaluation
- Contrats Long TermeDocument5 pagesContrats Long Termenishanth abirPas encore d'évaluation
- Exercice 3Document2 pagesExercice 3Thomas HenryPas encore d'évaluation
- Recap de Tous Les Cas ADFDocument205 pagesRecap de Tous Les Cas ADFizmPas encore d'évaluation
- Particularités Du Secteur Bancaire (IAS 30)Document23 pagesParticularités Du Secteur Bancaire (IAS 30)Saad ZanifiPas encore d'évaluation
- Cours ESG + CAFDocument24 pagesCours ESG + CAFMystéér DarifPas encore d'évaluation
- Chapitre 3 Gestion Budgétaire de La ProductionDocument9 pagesChapitre 3 Gestion Budgétaire de La ProductionnassimaPas encore d'évaluation
- Résumé Comptabilité Complet 1Document7 pagesRésumé Comptabilité Complet 1aminePas encore d'évaluation
- TD N°4: Les Modèles D'équilibre: Exercice 1Document3 pagesTD N°4: Les Modèles D'équilibre: Exercice 1Imane El hassouni50% (2)
- 113478606Document2 pages113478606Nabil EssitriPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Controle de GestionDocument21 pagesFiche de Lecture Controle de GestionTaha HMPas encore d'évaluation
- Corrigé W1 Q4 Méthode Additive TD 2ème Année S3 Tronc Commun ADF ENCG El Jadida 2020 2021 N 3Document1 pageCorrigé W1 Q4 Méthode Additive TD 2ème Année S3 Tronc Commun ADF ENCG El Jadida 2020 2021 N 3Abdelkhalek OuassiriPas encore d'évaluation
- Correction Série 3 PPTDocument13 pagesCorrection Série 3 PPTmessidkawtarPas encore d'évaluation
- La Comptabilite ApprofondieDocument32 pagesLa Comptabilite ApprofondieramiPas encore d'évaluation
- EXercice 5 de DossierDocument8 pagesEXercice 5 de DossierKamal SiidoxPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage WijdaneDocument38 pagesRapport de Stage WijdaneSaad HarounPas encore d'évaluation
- Le Passage Du Bilan Comptable Au Bilan FinancierDocument5 pagesLe Passage Du Bilan Comptable Au Bilan FinancierCoco Channel100% (1)
- Chapitre 01 - Généralité Sur La ComptabilitéDocument2 pagesChapitre 01 - Généralité Sur La ComptabilitésouraPas encore d'évaluation
- Rapport de Stage DDocument21 pagesRapport de Stage DWessalPas encore d'évaluation
- Bilan Fonctionnel ALSADocument6 pagesBilan Fonctionnel ALSAOuissam BenidarPas encore d'évaluation
- MS CcaDocument2 pagesMS CcaAsmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- Contrôle de Gestion FSJES S6Document22 pagesContrôle de Gestion FSJES S6Asmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- Monétair PDFDocument4 pagesMonétair PDFAsmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- Amendes Transactionnelles Et Forfaitaires ATF 1Document5 pagesAmendes Transactionnelles Et Forfaitaires ATF 1Asmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- Fonds de Commerce Ensemble 1&5-1Document13 pagesFonds de Commerce Ensemble 1&5-1Asmaa LahouaouiPas encore d'évaluation
- QCM Temnati CasaécoDocument9 pagesQCM Temnati CasaécoAsmaa Lahouaoui100% (1)
- Comportement Du Consommateur-lG1et2-ZinebDocument21 pagesComportement Du Consommateur-lG1et2-ZinebAsmaa Lahouaoui100% (1)
- Systeme Photovoltaique Alimentant Un FilDocument86 pagesSysteme Photovoltaique Alimentant Un Filsouad laribiPas encore d'évaluation
- Rapport de Projet de Fin D'étude: Création D'entreprise de Transformation Des AnchoisDocument124 pagesRapport de Projet de Fin D'étude: Création D'entreprise de Transformation Des AnchoisYamete KudasaiPas encore d'évaluation
- Format de Plan Pour Prêcher Un SermonDocument2 pagesFormat de Plan Pour Prêcher Un SermonScribdTranslationsPas encore d'évaluation
- Rapport de Vérification: Perceuse RadialeDocument14 pagesRapport de Vérification: Perceuse RadialeJoël LuntezilaPas encore d'évaluation
- Bientôt Des Cantines Bio Dans Les ÉcolesDocument3 pagesBientôt Des Cantines Bio Dans Les ÉcolesAlex Pop100% (1)
- SVN 2024-05-RDC Project Assistant (ShelterWASH) G4 - GomaDocument4 pagesSVN 2024-05-RDC Project Assistant (ShelterWASH) G4 - GomamushamukacardonPas encore d'évaluation
- Autorité IntroductionDocument13 pagesAutorité IntroductionDieudonné Badawe100% (1)
- Assurance VieDocument2 pagesAssurance ViehonogeraPas encore d'évaluation
- Vacances Scolaires 2023 2024 CalendrierDocument1 pageVacances Scolaires 2023 2024 CalendrierÉlise LeleuPas encore d'évaluation
- Administration DatabaseDocument22 pagesAdministration Databasebadrirania35Pas encore d'évaluation
- Devoir Acteur International de DéveloppementDocument3 pagesDevoir Acteur International de DéveloppementTantely Tolojanahary AndrianalimananaPas encore d'évaluation
- 42417Document93 pages42417AiméOuedraogoPas encore d'évaluation
- CCTP PS-SS L1 Avr-2022Document225 pagesCCTP PS-SS L1 Avr-2022sellami walidPas encore d'évaluation
- Portfolio: DossierDocument1 pagePortfolio: Dossierrickymoya19797Pas encore d'évaluation
- Note YssinDocument41 pagesNote Yssinadmin rebeiPas encore d'évaluation
- Analyse Fonctionnelle 4 MaiDocument3 pagesAnalyse Fonctionnelle 4 Maile petit ulysse KestPas encore d'évaluation
- أحسن الأخلاق Le Poème (Les meilleurs comportements) FINALDocument30 pagesأحسن الأخلاق Le Poème (Les meilleurs comportements) FINALBen Awal MouhammedPas encore d'évaluation
- Memorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums LuxemburgDocument48 pagesMemorial Memorial: Journal Officiel Du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt Des Großherzogtums Luxemburgprojectdoublexplus2Pas encore d'évaluation
- ACOCG M206 Plats À Base de Produits RégionauxDocument64 pagesACOCG M206 Plats À Base de Produits Régionauxsamielkhetmaoui170% (1)
- Bac PDFDocument4 pagesBac PDFFarel ParicePas encore d'évaluation
- Chapitre 2Document45 pagesChapitre 2nzhiti20100% (1)
- Architecture Institutionnelle Hopital Cours HolcmanDocument26 pagesArchitecture Institutionnelle Hopital Cours HolcmanMartin MartinPas encore d'évaluation
- Régime Des Évaluations Licence ISPITS VFDocument11 pagesRégime Des Évaluations Licence ISPITS VFAllioui WalidPas encore d'évaluation
- 1461 PDFDocument24 pages1461 PDFdknewsPas encore d'évaluation
- Fabrication Des Medicaments RadiopharmaceutiquesDocument7 pagesFabrication Des Medicaments RadiopharmaceutiquesInes SahraouiPas encore d'évaluation
- LastrologieDocument122 pagesLastrologieMarc-Evens PrudentPas encore d'évaluation
- Le Circuit Économique Macro-ÉconomieDocument3 pagesLe Circuit Économique Macro-Économiesalma hilaliPas encore d'évaluation