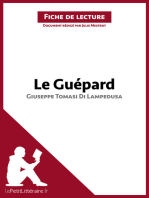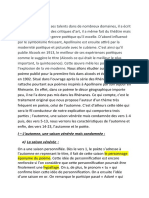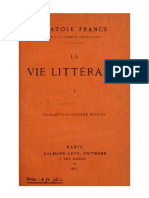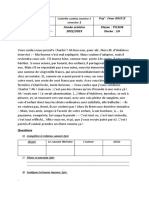Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Langage Et Littérature - Michel Foucault
Transféré par
Timothée Banel0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
104 vues66 pagesTitre original
Langage et Littérature - Michel Foucault
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
0 évaluation0% ont trouvé ce document utile (0 vote)
104 vues66 pagesLangage Et Littérature - Michel Foucault
Transféré par
Timothée BanelDroits d'auteur :
© All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1sur 66
Michel Foucault
Langage et Littérature
Conférence à l’Université Saint-Louis
Bruxelles
18/19 mars 1964
[1]
La question, qui est désormais célèbre, “Qu’est-ce que la
litt
littér
érat
atur
ure?
e?”,
”, vous
vous save
savezz qu’e
qu’ell
llee est
est asso
associ
ciée
ée pour
pour nous
nous à
l’exercice même de la littérature, comme si cette question n’était
pas posée
posée après
après coup
coup par une
une tierce person
personne
ne s’interrogean
s’interrogeantt sur un
objet étrange et qui lui serait extérieur, mais comme si elle avait
son lieu d’origine exactement dans la littérature, comme si poser
la question “Qu’est-ce que la littérature?” ne faisait qu’une seule
et même chose avec l’acte même d’écrire.
“Qu’est-ce que la littérature?”, ce n’est pas du tout une
question de critique, ce n’est pas du tout une question d’historien,
de sociologue, s’interrogeant devant un certain fait de langage.
C’est en quelque sorte un creux qui est ouvert dans la littérature,
un creux où elle aurait à se loger et probablement
probablement à recueillir tout
son être.
Il y a cependant un paradoxe, en tout cas une difficulté. Je
viens de dire que la littérature se loge dans la question “Qu’est-ce
que
que la litté
littérat
rature
ure?”.
?”. Mais,
Mais, aprè
aprèss tout
tout,, cette
cette ques
questio
tion
n est
est fort
fort
récente; elle
elle est à peine
peine plus
plus ancienne
ancienne que nous. En somme,
somme, la
question
question “Qu’est-ce
“Qu’est-ce que la littérature?”, on peut
peut dire en gros que
c’est
c’est depuis
depuis cet événem
événement
ent qu’a été l’œuvre
l’œuvre de Mallarm
Mallarméé
qu’elle est venue jusqu’à nous et qu’elle a pu se formuler. Alors
que
que la litt
littér
érat
atur
ure,
e, elle
elle,, n’a
n’a pas
pas d’âg
d’âge,
e, elle
elle n’a
n’a pas
pas plus
plus de
chronologie ou d’état civil que le langage humain lui-même.
[1]
La question, qui est désormais célèbre, “Qu’est-ce que la
litt
littér
érat
atur
ure?
e?”,
”, vous
vous save
savezz qu’e
qu’ell
llee est
est asso
associ
ciée
ée pour
pour nous
nous à
l’exercice même de la littérature, comme si cette question n’était
pas posée
posée après
après coup
coup par une
une tierce person
personne
ne s’interrogean
s’interrogeantt sur un
objet étrange et qui lui serait extérieur, mais comme si elle avait
son lieu d’origine exactement dans la littérature, comme si poser
la question “Qu’est-ce que la littérature?” ne faisait qu’une seule
et même chose avec l’acte même d’écrire.
“Qu’est-ce que la littérature?”, ce n’est pas du tout une
question de critique, ce n’est pas du tout une question d’historien,
de sociologue, s’interrogeant devant un certain fait de langage.
C’est en quelque sorte un creux qui est ouvert dans la littérature,
un creux où elle aurait à se loger et probablement
probablement à recueillir tout
son être.
Il y a cependant un paradoxe, en tout cas une difficulté. Je
viens de dire que la littérature se loge dans la question “Qu’est-ce
que
que la litté
littérat
rature
ure?”.
?”. Mais,
Mais, aprè
aprèss tout
tout,, cette
cette ques
questio
tion
n est
est fort
fort
récente; elle
elle est à peine
peine plus
plus ancienne
ancienne que nous. En somme,
somme, la
question
question “Qu’est-ce
“Qu’est-ce que la littérature?”, on peut
peut dire en gros que
c’est
c’est depuis
depuis cet événem
événement
ent qu’a été l’œuvre
l’œuvre de Mallarm
Mallarméé
qu’elle est venue jusqu’à nous et qu’elle a pu se formuler. Alors
que
que la litt
littér
érat
atur
ure,
e, elle
elle,, n’a
n’a pas
pas d’âg
d’âge,
e, elle
elle n’a
n’a pas
pas plus
plus de
chronologie ou d’état civil que le langage humain lui-même.
Cependant je ne suis pas sûr que la littérature elle-même
soit aussi ancienne qu’on a l’habitude de le dire. Bien sûr il y a
des millénaires que quelque chose existe, que rétrospectivement
nous avons l’habitude d’appeler «la littérature».
Je crois que c’est cela justement qu’il faudrait questionner.
Il n’est pas si sûr que Dante ou Cervantès ou Euripide, ça soit de
la littérature. Ils appartiennent bien sûr à la littérature, cela vaut
dire qu’ils font partie actuellement
actuellement de notre littérature actuelle, et
ils font partie de la littérature grâce à un certain rapport qui ne
concerne en fait que nous. Ils font partie de notre littérature, ils ne
font pas partie de la leur, pour l’excellente raison que la littérature
grecq
grecque
ue,, ça n’exis
n’existe
te pas,
pas, la littér
littératu
ature
re latine
latine ça n’exis
n’existe
te pas.
pas.
Autrement dit, si le rapport de l’œuvre d’Euripide à notre langage
est bien littérature, le rapport de cette même œuvre au langage
grec n’était certainement pas de la littérature.
C’est pourquoi je voudrais distinguer bien clairement trois
choses.
D’abord il y a le langage. Le langage c’est, vous le savez,
le murmure de tout ce qui est prononcé, et puis c’est en même
temps ce système transparent qui fait que, quand nous parlons,
nous sommes compris, bref, le langage c’est à la fois tout le fait
des paroles accumulées dans l’histoire, et puis le système même
de la langue.
Voilà donc d’un côté le langage.
langage. D’un autre côté il y a
les œuvres, disons qu’il y a cette chose étrange à l’intérieur du
langage, cette configuration de langage qui s’arrête sur soi, qui
s’immobilise, qui constitue un espace qui lui est propre, et qui
retient dans cet espace l’écoulement du murmure, qui épaissit la
transparence des signes et des mots, et qui dresse ainsi un certain
volume opaque, probablement énigmatique, et c’est cela en
somme qui constitue une œuvre.
Et puis il y a un troisième terme, qui n’est exactement ni
l’œuvre ni le langage, ce troisième terme c’est la littérature. La
littérature ce n’est pas la forme générale de toute œuvre de
langage, ce n’est pas non plus le lieu universel où se situe l’œuvre
de langage. C’est en quelque sorte un troisième terme, le sommet
d’un triangle, par lequel passe le rapport du langage à l’œuvre et
de l’œuvre au langage.
Je crois que c’est un rapport de ce genre qui est désigné par
le mot «littérature» dans son acception classique, littérature au
XVIIe siècle qui voulait tout simplement désigner la familiarité de
quelqu’un au moment même où il utilisait le langage courant, la
familiarité qu’il pouvait avoir avec les œuvres de langage,
l’usage, la fréquentation par laquelle il récupérait au niveau de
son langage quotidien ce qui était en soi et pour soi une œuvre.
Ce rapport qui constituait la littérature à l’époque classique n’était
à cette époque-là qu’une affaire de mémoire, de familiarité, de
savoir, c’était une affaire d’accueil.
Or ce rapport entre le langage et l’œuvre, ce rapport
qui passe par la littérature a cessé à partir d’un certain moment
d’être un rapport purement passif de savoir et de mémoire, il est
devenu un rapport actif, pratique, par là même un rapport obscur
et profond entre l’œuvre [2] au moment où elle se fait et le
langage lui-même. Dans l’ordre de la chronologie, le moment où
la littérature est devenue le troisième terme actif dans le triangle
qui se constitue ainsi, ce moment c’est évidemment au début du
XIXe siècle, ou à la fin du XVIII e, au voisinage de Chateaubriand,
de Mme Staël, de Laharpe, au détour du XVIII e siècle, au moment
où le XVIIIe siècle se détourne de nous, referme sur soi et
emporte avec soi quelque chose qui nous est dérobé maintenant,
mais qui demeure à penser sans doute si nous voulons penser ce
que c’est que la littérature.
On a l’habitude de dire que la conscience critique,
l’inquiétude réfléchissante sur ce que c’est que la littérature s’est
introduite très tard, en quelque sorte dans la raréfaction, dans le
tarissement de l’œuvre au moment où, pour des raisons purement
historiques, la littérature n’a plus été capable de se donner d’autre
objet qu’elle-même.
A vrai dire il me semble que le rapport de la littérature à
soi, la question sur ce qu’elle est faisait dès l’origine partie de sa
triangulation de naissance. La littérature n’est pas le fait pour un
langage de se transformer en œuvre, ce n’est pas non plus le fait
pour une œuvre d’être fabriquée avec du langage, la littérature,
c’est un troisième point, différent du langage et différent de
l’œuvre, un troisième point qui est extérieur à leur ligne droite et
qui par là même dessine un espace vide, une blancheur essentielle
où naît la question “Qu’est-ce que la littérature?”, une blancheur
essentielle qui à vrai dire est cette question même. Celle-ci par
conséquent, cette question ne se superpose pas à la littérature, elle
ne s’ajoute pas par une conscience critique supplémentaire à la
littérature, elle est l’être même de la littérature, originairement
écartelé et fracturé.
A vrai dire je n’ai pas le projet de vous parler de quoi que
ce soit, ni de l’œuvre, ni de la littérature, ni du langage. Mais je
voudrais placer en quelque sorte mon langage, qui
malheureusement n’est ni œuvre ni littérature, je voudrais le
placer dans cette distance, dans cet écart, dans ce triangle, dans
cette dispersion d’origine où l’œuvre, la littérature et le langage
s’éblouissent les uns les autres, je veux dire s’illuminent et
s’aveuglent les uns les autres, pour que peut-être, grâce à cela,
quelque chose de leur être sournoisement vienne jusqu’à nous.
Peut-être serez-vous un peu choqués et déçus du peu que
j’ai à vous dire.
Mais ce peu j’aimerais beaucoup que vous y prêtiez
attention, car je voudrais que parvienne jusqu’à vous ce creux du
langage qui ne cesse de creuser la littérature depuis qu’il existe,
c’est-à-dire depuis le XIXe siècle. Je voudrais que vous apparaisse
au moins la nécessité de vous débarrasser d’une idée toute faite,
d’une idée que cette littérature précisément s’est faite d’elle-
même, et cette idée c’est celle-ci, que la littérature est un langage,
un texte fait des mots, de mots comme les autres, mais des mots
qui sont suffisamment et tellement choisis et arrangés que, à
travers ces mots passe quelque chose qui est un ineffable.
Il me semble que c’est tout le contraire, que la littérature
n’est pas faite du tout d’un ineffable, elle est faite d’un non-
ineffable, de quelque chose que l’on pourrait par conséquent
appeler, au sens strict et originaire du terme, fable. Elle est donc
faite d’une fable, de quelque chose qui est à dire et qui peut être
dit, mais cette fable est dite dans un langage qui est absence, qui
est meurtre, qui est dédoublement, qui est simulacre, grâce à quoi
il me semble qu’un discours sur la littérature est possible, un
discours qui serait autre chose que ces allusions dont on nous a
rebattu les oreilles depuis maintenant des centaines d’années, ces
allusions au silence, au secret, à l’indicible, aux modulations du
cœur, finalement à tous ces prestiges de l’individualité où la
critique, jusqu’à ces derniers temps, avait abrité son
inconsistance.
La première constatation est que la littérature ce n’est pas
ce fait brut de langage, qui se laisse peu à peu pénétrer par la
question subtile, secondaire, de son essence et de son droit à
l’existence. La littérature en elle-même c’est une distance creusée
à l’intérieur du langage, une distance qui est sans cesse parcourue
et qui n’est jamais réellement franchie, enfin la littérature c’est
une sorte de langage qui oscille sur lui-même, une sorte de
vibration sur place. Encore ces mots d’oscillation et de vibration
sont insuffisants et assez mal ajustés, parce qu’ils laissent
supposer qu’il y a deux pôles, que la littérature, elle est à la fois
de la littérature et puis tout de même du langage, et qu’il y aurait
entre la littérature et le langage comme une hésitation. En fait, le
rapport à la littérature est pris tout entier dans l’épaisseur
absolument immobile, sans mouvement, de l’œuvre, et en même
temps ce rapport est ce par quoi l’œuvre et la littérature
s’esquivent l’une dans l’autre.
Car l’œuvre, en un sens, quand est-ce qu’elle est littérature?
Le paradoxe de l’œuvre, c’est précisément cela, qu’elle n’est
littérature qu’à l’instant même de son commencement, [3] dès sa
première phrase, dès la page blanche, et, à vrai dire, elle n’est
réellement littérature que tant que la page reste blanche, tant que
sur cette surface rien encore n’a été écrit, ce qui fait que la
littérature, que ce langage qui est là écrit sur un livre, ce qui fait
qu’il est de la littérature, qu’est-ce que c’est? C’est cette espèce
de rituel préalable qui trace aux mots leur espace de consécration.
Et par conséquent, dès que cette page blanche commence à
être emplie, dès que les mots commencent à se transcrire sur cette
surface qui est encore vierge, à ce moment là, chaque mot est en
quelque sorte absolument décevant par rapport à la littérature. En
fait, dès qu’un mot est écrit sur la page blanche, qui doit être la
page de littérature, à partir de ce moment là ce n’est déjà plus de
la littérature, c’est-à-dire que chaque mot réel est en quelque sorte
une transgression, qui fait par rapport à l’essence pure, blanche,
vide, sacrée de la littérature une transgression, qui fait de toute
[l’] œuvre non pas du tout l’accomplissement de la littérature,
mais sa rupture, sa chute, son effraction.
C’est une effraction que tout mot, sans statut ni prestige
littéraire, c’est une effraction que tout mot prosaïque ou
quotidien, mais c’est une effraction également que tout mot dès
qu’il est écrit.
“Longtemps je me suis couché tôt”. C’est la première
phrase de La Recherche du Temps Perdu. C’est bien en un
sens une entrée dans la littérature, mais il est évident qu’il n’y a
pas un seul de ces mots qui appartienne à la littérature; c’est une
entrée dans la littérature non pas parce que cette phrase serait
l’entrée en scène d’un langage tout armé des signes, du blason et
des marques de la littérature, mais tout simplement parce que
c’est l’irruption d’un langage tout court sur une page blanche,
c’est l’irruption du langage sans signe ni armes, au seuil même de
quelque chose que l’on ne verra jamais en chair, ces mots qui
nous conduisent jusqu’au seuil d’une perpétuelle absence, qui
sera la littérature.
Il est d’ailleurs caractéristique que la littérature depuis
qu’elle existe, la littérature depuis le XIXe siècle, depuis qu’elle a
offert à la culture occidentale cette figure étrange sur laquelle
nous nous interrogeons, il est caractéristique que la littérature se
soit toujours donnée une certaine tâche, et que cette tâche, ce soit
précisément l’assassinat de la littérature. A partir du XIXe siècle,
il ne s’agit plus du tout, entre les œuvres qui se succèdent, de ce
rapport contesté, réversible, lui-même d’ailleurs fort intriguant,
qui est le rapport de l’ancien au nouveau, et sur lequel toute la
littérature classique s’est interrogé. Le rapport de succession qui
apparaît à partir du XIXe siècle, c’est un rapport en quelque sorte
beaucoup plus matinal, qui serait à la fois rapport d’achèvement
de la littérature et de meurtre initial de la littérature. Baudelaire
n’est pas au romantisme, Mallarmé n’est pas à Baudelaire, le
surréalisme n’est pas à Mallarmé ce que Racine fut à Corneille,
ou ce que Beaumarchais fut à Marivaux.
En réalité, l’historicité qui apparaît au XIX e siècle dans le
domaine de la littérature est une historicité d’un type tout à fait
spécial et qu’on ne peut en aucun sens assimiler à celle qui a
assuré la continuité ou la discontinuité de la littérature jusqu’au
XVIIIe siècle.
L’historicité de la littérature au XIXe siècle ne passe pas par
le refus des autres œuvres, ou le recul, ou leur accueil,
l’historicité de la littérature au XIXe siècle passe obligatoirement
par le refus de la littérature elle-même, et ce refus de la littérature,
il faut le prendre dans tout l’écheveau très complexe de ses
négations, chaque acte littéraire nouveau, que ce soit celui de
Baudelaire, de Mallarmé, des surréalistes, peu importe, implique
au moins je crois quatre négations, quatre refus, quatre tentatives
d’assassinat, refuser d’abord la littérature des autres,
deuxièmement refuser aux autres le droit même à faire de la
littérature, contester que les œuvres des autres soient de la
littérature, troisièmement se refuser à soi-même, se contester à
soi-même le droit de faire de la littérature, et enfin,
quatrièmement, refuser de faire ou de dire autre chose dans
l’usage du langage littéraire que le meurtre systématique,
accompli, de la littérature.
Donc on peut dire, je crois, qu’à partir du XIX e siècle tout
acte littéraire se donne et prend conscience de lui-même comme
une transgression de cette essence pure et inaccessible que serait
la littérature. Et pourtant, en un autre sens, chaque mot, à partir
du moment où il est écrit sur cette fameuse page blanche à propos
de laquelle nous nous interrogeons, chaque mot pourtant fait
signe. Il fait signe à quelque chose car il n’est pas comme un mot
normal, comme un mot ordinaire. Il fait signe à quelque chose qui
est la littérature, chaque mot, à partir du moment où il est écrit sur
cette page blanche de l’œuvre, est une sorte de clignotant [4] qui
cligne vers quelque chose que nous appelons la littérature. Car, à
dire vrai, rien, dans une œuvre de langage, n’est semblable à ce
qui se dit quotidiennement. Rien n’est du vrai langage, je vous
mets au défi de trouver un seul passage d’une œuvre quelconque
que l’on puisse dire emprunté réellement à la réalité du langage
quotidien.
Et quelque fois je sais bien que cela se produit, je sais bien
qu’un certain nombre de gens ont prélevé précisément des
dialogues réels, quelque fois même enregistrés au magnétophone,
comme Butor vient de faire pour sa description de San Marco, où
il a collé sur la description même de la cathédrale en quelque
sorte les bandes magnétiques qui ont été effectivement prélevées
sur le dialogue des gens qui visitaient la cathédrale et faisaient les
commentaires dont les uns concernaient la cathédrale elle-même,
et dont les autres concernaient la qualité des ice-creams que l’on
peut manger sur la place.
Mais l’existence d’un langage réel ainsi prélevé et introduit
dans l’œuvre littéraire, quand cela se produit, ce n’est pas plus
qu’un papier collé dans un tableau cubiste. Le papier collé, dans
un tableau cubiste, il n’est pas là pour faire «vrai», il est là au
contraire pour trouer en quelque sorte l’espace du tableau, et c’est
de la même façon que le langage vrai, quand il est introduit
réellement dans une œuvre littéraire, est placé là pour trouer
l’espace du langage, pour lui donner en quelque sorte une
dimension sagittale qui, en fait, ne lui appartiendrait pas
naturellement. Si bien que l’œuvre n’existe que parce que cette
littérature est en même temps conjurée et profanée, cette
littérature qui pourtant soutient chacun de ces mots et dès le
premier.
On peut donc dire, si vous voulez, qu’au total, l’œuvre
comme irruption disparaît et se dissout dans le murmure qu’est le
ressassement de la littérature, il n’y a pas d’œuvre qui ne
devienne par là un fragment de littérature, un morceau qui
n’existe que parce qu’il existe autour d’elle, en avant et en arrière,
quelque chose comme la continuité de la littérature.
Il me semble que ces deux aspects, de la profanation et puis
de ce signe perpétuellement renouvelé de chaque mot vers la
littérature, il me semble que ceci permettrait d’esquisser en
quelque sorte deux figures exemplaires et paradigmatiques de ce
qu’est la littérature, deux figures étrangères et qui peut-être
pourtant s’appartiennent.
L’une, ça serait la figure de la transgression, ça serait la
figure de la parole transgressive, et l’autre au contraire serait la
figure de tous ces mots qui pointent et font signe vers la
littérature, d’un côté donc la parole de transgression, et d’un autre
côté ce que j’appellerais le ressassement de la bibliothèque.
L’une, c’est la figure de l’interdit, du langage à la limite,
c’est la figure de l’écrivain enfermé, l’autre au contraire, c’est
l’espace des livres qui s’accumulent, qui s’adossent les uns aux
autres, et dont chacun n’a que l’existence crénelée qui le découpe
et le répète à l’infini sur le ciel de tous les livres possibles.
Il est évident que Sade a articulé le premier, à la fin du
XVIIIe siècle, la parole de transgression; on peut même dire que
son œuvre, c’est le point qui à la fois recueille et rend possible
toute parole de transgression. L’œuvre de Sade, il n’y a aucun
doute, c’est le seuil historique de la littérature. En un sens, vous
savez que l’œuvre de Sade c’est un gigantesque pastiche. Il n’y a
pas une seule phrase de Sade qui ne soit entièrement tournée vers
quelque chose qui a été dit avant lui, par les philosophes du
XVIIIe siècle, par Rousseau, il n’y a pas un seul épisode, pas une
de ses seules scènes, insupportables, que Sade raconte qui ne soit
en réalité le pastiche dérisoire, complètement profanateur, d’une
scène d’un roman du XVIII e siècle – il suffit d’ailleurs de suivre
le nom des personnages, et on retrouve exactement de qui Sade a
voulu faire le pastiche profanateur.
C’est-à-dire que l’œuvre de Sade a la prétention, elle a eu la
prétention d’être l’effacement de toute la philosophie, de toute la
littérature, de tout le langage qui a pu lui être antérieur, et
l’effacement de toute cette littérature dans la transgression d’une
parole qui profanerait la page redevenue ainsi blanche.
Quant à la nomination sans réticence, quant aux
mouvements qui parcouront méticuleusement tous les possibles
dans les fameuses scènes érotiques de Sade, ce n’est pas autre
chose qu’une œuvre réduit à la seule parole de transgression, une
œuvre qui en un sens efface toute parole jamais écrite, et par là
même ouvre un espace vide, où la littérature moderne va avoir
son lieu; je crois que Sade, c’est le paradigme même de la
littérature. [5]
Et cette figure de Sade, qui est celle de la parole de
transgression, elle a son double dans la figure du livre qui se
maintient dans son éternité, elle a son double, son opposé dans la
bibliothèque, c’est-à-dire dans l’existence horizontale de la
littérature, cette existence qui n’est, à vrai dire, pas simple, qui
n’est pas univoque, mais dont, je crois, le paradigme jumeau
serait Chateaubriand.
Il n’y a absolument aucun doute que la contemporanéité de
Sade et de Chateaubriand n’est pas un hasard dans la littérature.
D’entrée de jeu, l’œuvre de Chateaubriand, dès sa première
ligne, veut être un livre, elle veut se maintenir à ce niveau d’un
murmure continu de la littérature, elle veut se transposer aussitôt
dans cette espèce d’éternité poussiéreuse qu’est celle de la
bibliothèque absolue. Tout de suite elle vise à rejoindre l’être
solide de la littérature, faisant ainsi reculer dans une sorte de
préhistoire tout ce qui a pu être dit ou écrit avant lui,
Chateaubriand. Si bien que, à quelques années près, on peut dire,
je crois, que Chateaubriand et Sade constituent les deux seuils de
la littérature contemporaine. Attala et La Nouvelle Justine ont vu
le jour à peu près en même temps, bien sûr ce serait un jeu facile
de les rapprocher ou de les opposer, mais ce qu’il faut tenter de
comprendre, c’est le système même de leur appartenance, c’est le
pli en quoi naît en ce moment, à la fin du XVIIIe siècle, au début
du XIXe siècle, dans de telles œuvres, dans de telles existences,
l’expérience moderne de la littérature. Cette expérience, je crois
qu’elle n’est pas dissociable de la transgression et de la mort, elle
n’est pas dissociable de cette transgression dont Sade a fait toute
sa vie et dont il a payé d’ailleurs ce prix de liberté que vous
savez. Quant à la mort, vous savez également qu’elle a hanté
Chateaubriand dès le moment où il a commencé à écrire, il était
évident pour lui que la parole qu’il écrivait n’avait de sens que
dans la mesure où il était en quelque sorte déjà mort, dans la
mesure où cette parole flottait au-delà de sa vie et au-delà de son
existence.
Il me semble que cette transgression et ce passage par delà
la mort représentent deux grandes catégories de la littérature
contemporaine, on pourrait dire si vous voulez que dans la
littérature, dans cette forme de langage qui existe depuis le XIX e
siècle, il n’y a que deux sujets réels, deux sujets parlant dans la
littérature, c’est Œdipe pour la transgression, c’est Orphée pour la
mort, et il n’y a que deux figures dont on parle, et auxquelles en
même temps, à mi-voix, et comme de biais, on s’adresse, ces
deux figures, c’est la figure de Jocaste profané, c’est la figure
d’Eurydice perdue et retrouvée.
Il me semble que ces deux catégories, donc, de la
transgression et de la mort, si vous voulez, de l’interdit et de la
bibliothèque, distribuent à peu près ce qu’on pourrait appeler
l’espace propre de la littérature. C’est en tout cas en ce lieu que
quelque chose comme la littérature nous vient.
Il est important de se rendre compte que la littérature,
l’œuvre littéraire, ne vient pas d’une sorte de blancheur d’avant le
langage, mais justement du ressassement de la bibliothèque, de
l’impureté déjà meurtrière du mot, et c’est à partir de ce moment
là que le langage réellement nous fait signe et fait signe en même
temps vers la littérature.
L’œuvre fait signe à la littérature, cela veut dire quoi?
Cela veut dire que l’œuvre appelle la littérature, qu’elle lui
donne des gages, qu’elle s’impose à elle-même un certain nombre
de marques qui prouvent à elle-même et aux autres qu’elle est
bien de la littérature. Ces signes, réels, par lesquels chaque mot,
chaque phrase indiquent qu’ils appartiennent à la littérature, c’est
ce que la critique récente, depuis Roland Barthes, appelle
l’écriture.
Cette écriture fait de toute œuvre, en quelque sorte, une
petite représentation, comme un modèle concret de la littérature.
Elle détient l’essence de la littérature, mais elle en donne en
même temps l’image visible, réelle. En ce sens on peut dire que
toute œuvre dit non seulement ce qu’elle dit, ce qu’elle raconte,
son histoire, sa fable, mais, de plus, elle dit ce qu’est la littérature.
Seulement elle ne le dit pas en deux temps, un temps pour le
contenu et un temps pour la rhétorique; elle le dit dans une unité.
Cette unité, elle est signalée précisément par le fait que la
rhétorique, à la fin du XVIII e siècle, a disparu.
La rhétorique a disparu, ça veut dire que la littérature est
chargée, à partir de cette disparition, de définir elle-même les
signes et les jeux par lesquels elle va être, précisément, littérature.
On peut donc dire, si vous voulez, que la littérature, telle
qu’elle existe depuis la disparition de la rhétorique, n’aura pas
pour tâche de raconter quelque chose, puis d’ajouter les signes
manifestes et visibles que c’est de la littérature, les signes de la
rhétorique, [6] elle va être obligée d’avoir un langage unique, et
pourtant un langage fourchu, un langage dédoublé, puisque, tout
en disant une histoire, tout en racontant quelque chose, elle devra
à chaque instant montrer et rendre visible ce qu’est la littérature,
ce qu’est le langage de la littérature, puisque la rhétorique a
disparu, qui était autrefois chargée de dire ce que devait être un
beau langage.
On peut donc dire que la littérature, c’est un langage qui est
à la fois unique et soumis à la loi du double; il se passe pour la
littérature ce qui se passait pour Le Double, chez Dostoïevski,
cette distance déjà donnée dans la brume et dans le soir, cette
autre figure par laquelle on ne cesse, au détour des rues, d’être
doublé et qui pourtant vient aussi bien à la rencontre du
promeneur, et ceci jusqu’à la panique, qui fait reconnaître au
moment où on se trouve juste en face de lui, le double.
C’est un jeu semblable qui se produit entre l’œuvre et la
littérature, l’œuvre va sans cesse au devant de la littérature, la
littérature est cette espèce de double qui se promène devant
l’œuvre, l’œuvre ne la reconnaît jamais, la croise pourtant sans
arrêt, mais, justement, il manque toujours ce moment de panique
que l’on trouve chez Dostoïevski.
Dans la littérature, il n’y a jamais rencontre absolue entre
l’œuvre réelle et la littérature en chair et en os. L’œuvre ne
rencontre jamais son double enfin donné, et, dans cette mesure,
l’œuvre est cette distance, cette distance qu’il y a entre le langage
et la littérature, c’est cette espèce d’espace de dédoublement, cet
espace du miroir, ce qu’on pourrait appeler le simulacre.
Il me semble que la littérature, l’être même de la littérature,
si on l’interroge sur ce qu’il est, sur son être même, ne pourrait
répondre qu’une chose, c’est qu’il n’y a pas d’être de la
littérature, il y a simplement un simulacre, un simulacre qui est
tout l’être de la littérature.
Il me semble que l’œuvre de Proust nous montrerait très
bien en quoi et comment la littérature est simulacre.
La Recherche du Temps Perdu, on le sait, c’est le récit d’un
cheminement qui ne va pas de la vie de Proust jusqu’à l’œuvre de
Proust, mais qui va du moment où la vie de Proust, la vie réelle,
sa vie mondaine, etc., se suspend, s’interrompt, se ferme sur elle-
même, et où dans la mesure même où la vie se replie sur soi,
l’œuvre va pouvoir s’inaugurer et ouvrir son propre espace.
Mais cette vie de Proust, cette vie réelle, elle n’est jamais
racontée dans l’œuvre. Et, d’un autre côté, cette œuvre pour
laquelle il a suspendu sa vie et décidé d’interrompre sa vie
mondaine, cette œuvre, elle n’est jamais donné non plus, puisque
Proust raconte comment, précisément, il va arriver à cette œuvre
qui devrait commencer à la dernière ligne du livre, mais qui n’est,
en réalité, jamais donnée dans son corps propre.
Si bien que, dans La Recherche du Temps Perdu, le
mot «perdu» a au moins trois significations. D’une part, cela veut
dire que le temps de la vie apparaît maintenant comme refermé,
lointain, irrécupérable, perdu. En revanche, deuxièmement, le
temps de l’œuvre, qui précisément n’a plus le temps d’être faite,
puisque quand le texte réellement écrit s’achève, l’œuvre n’est
pas encore là, le temps de l’œuvre qui n’a pas pu arriver à se faire
place dans ce récit qui devait raconter la genèse de l’œuvre, ce
temps de l’œuvre a été en quelque sorte gaspillé à l’avance, non
seulement par la vie, mais par le récit que Proust fait de la
manière dont il va écrire son œuvre. Et puis, finalement, ce temps
sans feu ni lieu, ce temps sans date ni chronologie, qui flotte en
pleine dérive, comme perdu entre le langage étouffé de tous les
jours, et celui, scintillant, de l’œuvre enfin illuminée, ce temps,
c’est celui que nous voyons dans l’œuvre même de Proust, que
nous voyons apparaître par fragments, que nous voyons
apparaître à la dérive, sans chronologie réelle, c’est un temps qui
est perdu et qui ne peut être retrouvé que comme des morceaux
d’or, par fragments. Si bien que l’œuvre, chez Proust, l’œuvre
n’est jamais elle-même donnée dans la littérature, elle n’est rien
d’autre, l’œuvre réelle de Proust, que le projet de faire une œuvre,
le projet de faire de la littérature, mais, sans cesse, l’œuvre réelle
est retenue au seuil de la littérature.
Au moment où le langage réel, qui raconte cette venue de
la littérature, va se taire, pour que, enfin, l’œuvre puisse
apparaître, dans sa parole souveraine, inévitable, à ce moment là,
l’œuvre s’achève, le temps est terminé, si bien qu’on peut dire
qu’en un quatrième [7] sens, le temps a été perdu au moment
même où il est retrouvé.
Vous voyez que dans une œuvre comme celle de Proust, on
ne peut pas dire qu’il y a un seul moment qui soit réellement
l’œuvre, on ne peut pas dire qu’il y a un seul moment qui soit
réellement la littérature. En fait, tout le langage réel de Proust,
tout ce langage que nous lisons maintenant, et que nous, nous
appelons son œuvre, et dont nous disons que c’est la littérature,
en fait, si on se demande ce que c’est, non pas pour nous, mais en
soi, on s’aperçoit que ce n’est ni une œuvre ni de la littérature,
mais cette espèce d’espace intermédiaire, d’espace virtuel comme
celui que l’on peut voir, mais jamais toucher, dans les miroirs, et
c’est cet espace de simulacre, qui donne à l’œuvre de Proust son
véritable volume.
Dans cette mesure là il faut bien convenir que le projet
même de Proust, l’acte littéraire qu’il a accompli lorsqu’il a écrit
son œuvre, n’a réellement aucun être assignable, ne peut jamais
être situé en un point quelconque ou du langage ou de la
littérature, en fait, on ne peut trouver que le simulacre, que le
simulacre de la littérature; et l’importance apparente du temps
chez Proust vient tout simplement du fait que le temps proustien,
qui est dispersion et flétrissure d’un côté, retour et identité des
moments bienheureux de l’autre, ce temps proustien n’est que la
projection interne, thématique, dramatisée, racontée, récitée, de
cette distance essentielle entre l’œuvre et la littérature, qui
constitue, je crois, l’être profond du langage littéraire.
Donc, si nous avions à caractériser ce que c’est que la
littérature, on trouverait cette figure négative de la transgression
et de l’interdit, symbolisée par Sade, cette figure du ressassement,
cette image de l’homme qui descend à la tombe un crucifix à la
main, de cet homme qui n’a jamais écrit qu’«outre-tombe»,
finalement, donc nous trouvons cette figure de la mort,
symbolisée par Chateaubriand, et puis nous trouvons cette figure
du simulacre. Autant de figures, je ne dirais pas négatives, mais
sans positivité aucune, et entre lesquelles l’être de la littérature
me paraît fondamentalement dispersé et écartelé.
Mais peut-être nous manque-t-il encore, pour définir ce
que c’est que la littérature, quelque chose d’essentiel. En tout cas,
il y a quelque chose que nous n’avons pas encore dit, et qui est
pourtant, historiquement, très important pour savoir ce que c’est
que cette forme de langage qui est apparu à partir du XIXe siècle.
Il est évident, en effet, que la transgression ne suffit pas à
définir totalement la littérature, puisqu’il y avait bien des
littératures transgressives avant le XIXe siècle. Il est évident que
ce n’est pas non plus le simulacre qui suffit à définir la littérature,
puisque avant Proust, il y avait quelque chose comme le
simulacre, regardez Cervantès, qui écrit le simulacre d’un roman,
regardez également Diderot, avec Jacques le Fataliste. Dans tous
ces textes, on trouve cet espace virtuel dans lequel il n’y a ni
littérature ni œuvre, et où pourtant il y a perpétuellement échange
entre l’œuvre et la littérature.
“Ah, si j’étais romancier, dit Jacques le fataliste à son
maître, ce que je vous raconte serait beaucoup plus beau que la
réalité que je vous narre; si je voulais embellir tout ce que je vous
raconte, vous verriez comme, à ce moment là, ce serait de la belle
littérature, mais je ne peux pas, je ne fais pas de la littérature, je
suis obligé de vous raconter ce qui est...” Et c’est dans ce
simulacre de littérature, dans ce simulacre de refus de littérature
que Diderot écrit un roman qui est, au fond, le simulacre du
roman.
En fait, ce problème du simulacre, par exemple chez
Diderot, et du simulacre dans la littérature à partir du XIX e siècle,
ce simulacre est important pour nous introduire à ce qui me paraît
central dans le fait de la littérature.
Dans Jacques le Fataliste, en effet, vous savez que
l’histoire se déploie à plusieurs niveaux. D’une part, le niveau
numéro un, c’est le récit, par Diderot, du voyage et des dialogues
entre Jacques, dit le fataliste, et son maître. Puis ce récit de
Diderot est interrompu par le fait que Jacques, en quelque sorte,
prend la parole à la place de Diderot, et se met à raconter ses
amours. Et puis, le récit des amours de Jacques est à nouveau
interrompu, il est interrompu par un récit de troisième niveau, par
une série de récits de troisième niveau, où on voit, par exemple,
les hôtesses, ou le Capitaine, etc., raconter leurs propres histoires.
Et ainsi, nous avons à l’intérieur du récit toute une
épaisseur de récits qui s’emboîtent comme des poupées
japonaises, et c’est cela qui constitue le pastiche du roman
d’aventures de Jacques le Fataliste. [8]
Mais ce qui est important, ce qui me paraît tout à fait
caractéristique, ce n’est pas tellement cet emboîtement des récits
les uns dans les autres, que le fait qu’à chaque instant Diderot, en
quelque sorte, fait sauter le récit en arrière, et impose, en tout cas,
à ces récits qui s’emboîtent, des sortes de figures rétrogrades qui
amènent sans cesse vers une espèce de réalité, de réalité du
langage neutre, du langage premier, qui serait le langage de tous
les jours, le langage de Diderot lui-même, le langage des lecteurs.
Et ces figures rétrogrades sont de trois sortes. Il y a d’abord
les réactions des personnages du récit emboîtant, qui, à chaque
instant interrompent le récit qu’ils entendent; puis,
deuxièmement, vous avez les personnages qui l’on voit apparaître
dans un récit emboîté – à un moment donné, l’hôtesse raconte
l’histoire de quelqu’un qu’on ne voit pas, il est simplement logé
là, virtuellement dans ce récit, et puis, voilà que brusquement,
dans le récit de Diderot même, on voit surgir ce personnage réel,
alors qu’en réalité, il n’avait de statut qu’emboîté à l’intérieur du
récit fait par l’hôtesse.
Puis, troisième figure, à chaque instant, Diderot se tourne
vers son lecteur, pour lui dire “ce que je vous raconte, vous devez
trouver cela extraordinaire, mais c’est comme ça que ça s’est
passé; bien sûr, cette aventure, elle n’est pas conforme aux règles
de la littérature, elle n’est pas conforme aux règles des récits bien
faits, mais je ne suis pas le maître de mes personnages, ils me
débordent, ils sont arrivés dans mon horizon avec leur passé, avec
leurs aventures, avec leurs énigmes, je ne fais que vous raconter
les choses telles qu’elles se sont effectivement passées...”
Ainsi, du cœur le plus enveloppé, le plus indirect du récit,
jusqu’à une réalité qui est contemporaine, antérieure même à
l’écriture, Diderot ne fait pas autre chose que de se décrocher, en
quelque sorte, lui-même, à l’égard de sa propre littérature.
Il s’agit à chaque instant de montrer que, en fait, tout cela,
ce n’est pas de la littérature, et qu’en fait il y a un langage
immédiat et premier, le seul qui soit solide, et sur lequel se trouve
bâtis, arbitrairement et pour le plaisir, les récits eux-mêmes.
Cette structure, c’est une structure qui est caractéristique de
Diderot, mais qu’on trouve également chez Cervantès, et dans
infiniment de récits allant du XVI e au XVIIIe siècle.
Pour la littérature, c’est-à-dire pour cette forme de langage
qui s’inaugure au XIX e siècle, des jeux comme ceux de Jacques
le Fataliste
Fataliste,, dont je viens de vous parler, ne sont, en réalité, que
des plaisanteries.
Quand Joyce, par exemple, s’amuse à faire un roman qui
est, si vous voulez, entièrement bâti sur l’Odyssée
l’ Odyssée,, il ne fait pas
du tout comme Diderot, lorsqu’il bâtit un roman sur le modèle du
roman picaresque; en fait, quand Joyce répète Ulysse, il répète
pour qu’en ce pli du langage,
langage, répété sur lui-même,
lui-même, quelque chose
chose
apparaisse, qui ne soit pas comme chez Diderot le langage de tous
les jours, mais quelque chose qui soit comme la naissance même
de la littérature.
C’est-à-dire
C’est-à-dire que Joyce fait en sorte que, à l’intérieur de son
récit, à l’intérieur de ses phrases, des mots qu’il emploie, de ce
récit infini de la journée d’un homme comme tout le monde dans
une ville comme tout le monde,
monde, quelque chose se creuse, qui soit
à la fois l’absence de la littérature, et son imminence, qui soit le
fait
fait qu’e
qu’ell
llee est
est là,
là, la litt
littér
érat
atur
ure,
e, abso
absolu
lume
ment
nt,, et tell
tellee est
est là
absolument parce qu’il s’agit d’Ulysse, mais en même temps dans
la distance, en quelque sorte, si vous voulez, au plus proche de
son éloignement. De là, sans doute, cette configuration qui est
essentielle à l’Ulysse
l’Ulysse de Joyce, d’une part les figures circulaires,
le cercle du temps, qui va du matin jusqu’au soir de la journée,
puis le cercle de l’espace,
l’espace, qui fait le tour de la ville, avec la
promenade
promenade du personnage.
personnage. Puis, en dehors de ces figures
circulaire
circulaires,
s, vous
vous avez
avez une sorte
sorte de rappor
rapportt perpen
perpendicu
diculair
lairee et
virtuel, un rapport point par point, un rapport biunivoque entre
chaqu
chaquee épiso
épisode
de de l’Ulysse
l’Ulysse de Joyc
Joycee et chaq
chaque
ue aven
aventur
turee de
l’Odyssée
l’Odyssée.. Et par cette référence, à chaque instant, les aventures
du personnage de Joyce ne sont pas doublées et
surimp
surimpres
ressio
sionnée
nnées,
s, elles
elles sont
sont au contraire
contraire creusé
creusées
es par cette
cette
présence
présence absente du personnage
personnage de l’Odyssée
l’Odyssée,, qui est, lui, le
déte
détent
nteu
eur,
r, mais
mais le déte
détent
nteu
eurr abso
absolu
lume
ment
nt loin
lointa
tain
in,, jama
jamais
is
accessible, de la littérature. [9]
Peut-
Peut-êt
être
re pour
pourrai
rait-o
t-on
n dire,
dire, pour
pour résu
résume
merr tout
tout ceci,
ceci, que
que
l’œuvre de langage, à l’époque classique, n’était pas vraiment de
la littérature.
littérature.
Pour
Pourqu
quoi
oi est-c
est-cee qu’o
qu’on
n ne peut
peut pas dire
dire que
que Jacques
Jacques le
Fataliste
Fataliste,, ou Cervantès, pourquoi est-ce qu’on ne peut pas dire
que Racine c’est de la littérature, ou Corneille, ou Euripide, sauf
pour nous bien sûr, dans la mesure où nous l’intégrons
l’intégrons à notre
lang
langag
age?
e? Pour
Pourqu
quoi
oi est-c
est-cee que,
que, à ce mome
moment
nt là, le rappo
rapport
rt de
Diderot à son propre langage n’était pas ce rapport littéraire dont
je vous
vous ai parlé
parlé à l’instant?
l’instant?
Il me semble qu’on pourrait dire ceci: c’est que, à l’époque
classique, en tout cas, avant la fin du XVIII e siècle, toute œuvre
de lang
langage
age exis
existai
taitt en fonct
fonctio
ion
n d’un
d’un certa
certain
in lang
langag
agee muet
muet et
primitif, que l’œuvre
l’œuvre serait
serait chargée de restituer.
restituer.
Ce langage
langage muet était en quelque
quelque sorte le fond initial, le
fond absolu sur lequel toute œuvre venait ensuite se détacher, et à
l’inté
l’intérie
rieur
ur duqu
duquel
el elle
elle vena
venait
it se loge
loger.
r. Ce langa
langage
ge muet
muet,, ce
langage d’avant les langages, c’était la parole de Dieu, c’était la
Vérité, c’était le modèle, c’était les anciens, c’était la bible, en
donnant au mot même de bible son sens absolu, c’est-à-dire son
sens commun. Il y avait une sorte de livre préalable, qui était la
Vérité, qui était la nature, qui était la parole de Dieu, et qui
cachait, en quelque sorte, en lui, et qui prononçait, en même
temps, toute la vérité.
Et ce langage souverain, et retenu, était tel que, d’une part,
tout autre langage, tout langage humain,
humain, quand il voulait être une
œuvre,
œuvre, devait
devait tout
tout simple
simplemen
mentt le retradu
retraduire,
ire, le retrans
retranscrire
crire,, le
répéter, le restituer. Mais d’un autre côté, ce langage de Dieu, ou
ce langage de la nature, ou ce langage de la vérité, était, pourtant,
caché. Il était le fondement de tout dévoilement, et pourtant, il
était lui-même caché, il ne pouvait pas être transcrit directement.
De là la nécessité de ces glissements, de ces torsions de mots, de
tout ce système que l’on appelle précisément la rhétorique. Après
tout,
tout, les métaph
métaphore
ores,
s, les métony
métonymie
mies,
s, les synecd
synecdoq
oques
ues,, etc.,
etc.,
qu’est-ce que c’était, sinon pour, avec des mots humains, qui sont
obscurs et cachés à eux-mêmes, retrouver, par un jeu d’ouvertures
et comm
commee par des
des chica
chicane
nes,
s, retrou
retrouver
ver ce lang
langage
age muet
muet que
que
l’œuvre avait pour sens et pour tâche de restituer et de restaurer.
Autrement dit, entre un langage bavard, qui ne disait rien, et
un langage absolu, qui disait tout, mais ne montrait rien, il fallait
bien qu’il y eut un langage
langage intermédiaire,
intermédiaire, ce langage
langage
intermédiaire qui ramenait du langage bavard au langage muet de
la nature et de Dieu, c’était précisément le langage littéraire. Si
nous
nous appelo
appelons
ns signes
signes,, avec
avec Berkel
Berkeley,
ey, avec
avec les philoso
philosophe
phess du
XVIIIe siècle, cela même qui était dit par la nature ou par Dieu,
on peut dire ceci, tout simplement, que l’œuvre classique, elle se
caractérise par le fait qu’il s’agissait, par un jeu de figures, qui
étaient les figures de la rhétorique, de ramener l’épaisseur,
l’opacité, l’obscurité du langage à la transparence, à la luminosité
même des signes.
Au contraire, la littérature, elle a commencé lorsque s’est
tu, pour le monde occidental, ou pour une partie du monde
occidental, ce langage qui n’avait cessé d’être entendu, d’être
perçu, d’être supposé pendant des millénaires. A partir du XIXe
siècle, on cesse d’être à l’écoute de cette première parole, et, à sa
place, se fait entendre l’infini du murmure, l’amoncellement des
paroles déjà dites; dans ces conditions là, l’œuvre n’a plus à
prendre corps dans ces figures de la rhétorique, qui vaudraient
comme signes d’un langage muet et absolu, l’œuvre, elle n’a plus
à parler que comme un langage qui répète ce qui a été dit, et qui,
par la force de sa répétition, à la fois efface tout ce qui a été dit, et
l’approche au plus près de soi, pour ressaisir l’essence de la
littérature.
On peut dire, si vous voulez, que la littérature, elle a
commencé le jour où s’est substitué à l’espace de la rhétorique
quelque chose que l’on pourrait appeler le volume du livre. Il est
d’ailleurs très curieux de constater que le livre n’est devenu un
événement dans l’être de la littérature que fort tard. C’est quatre
siècles après le moment où il a été réellement, techniquement,
matériellement inventé, que le livre a pris statut dans la
littérature; et le livre de Mallarmé, c’est le premier livre de la
littérature, le livre de Mallarmé, ce projet fondamentalement
échoué, ce projet qui ne pouvait pas ne pas échouer, il est [10] si
vous voulez, l’incidence de la réussite de Gutenberg sur la
littérature. Le livre de Mallarmé, qui veut répéter et anéantir en
même temps tous les autres livres, ce livre qui, dans sa blancheur,
frôle l’être définitivement échappé de la littérature, répond à ce
grand livre muet, mais plein de signes, que l’œuvre classique
essayait de recopier, essayait de représenter. Le livre de Mallarmé
répond à ce grand livre, mais, en même temps, il se substitue à
lui, il est le constat de sa disparition.
On comprend pourquoi, maintenant, dans ses prestiges, et
non seulement dans ses prestiges, mais dans son essence, d’une
part, l’œuvre classique n’était pas autre chose qu’une re-
présentation, car elle avait à re-présenter un langage qui était déjà
fait, et c’est pourquoi, au fond, l’essence même de l’œuvre
classique, on la trouve toujours, que ce soit chez Shakespeare ou
chez Racine, au théâtre, car on est dans le monde de la
représentation; et, inversement, l’essence de la littérature, au sens
strict du terme, à partir du XIXe siècle, ce n’est pas dans le théâtre
qu’on va la trouver, c’est précisément dans le livre.
Et c’est finalement dans ce livre, ce livre meurtrier de tous
les autres, et en même temps assumant en lui le projet, toujours
déçu, de faire de la littérature, c’est finalement dans ce livre que
la littérature trouve et fonde son être. Si le livre existait, et avec
une réalité très dense, depuis des siècles, avant cette invention de
la littérature, il n’était pas, en réalité, le lieu de la littérature, il
n’était qu’une occasion matérielle de faire passer du langage. La
meilleure preuve c’est que Jacques le Fataliste échappait ou
cherchait à échapper, sans cesse, à la sorcellerie des livres
d’aventures, par ces sauts en arrière dont nous avons parlé; de
même Don Quichotte et Cervantès.
Mais, en fait, si la littérature accomplit son être dans le
livre, elle n’accueille pas placidement l’essence du livre –
d’ailleurs le livre, en réalité, n’a pas d’essence, il n’a pas
d’essence hors de ce qu’il contient –, c’est pourquoi la littérature
sera toujours le simulacre du livre; elle fait comme si elle était un
livre, elle fait semblant d’être une série de livres. C’est pourquoi,
également, elle ne peut s’accomplir que par l’agression et la
violence contre tous les autres livres, bien plus, par l’agression et
la violence contre l’essence plastique, dérisoire, féminine du
livre. La littérature est transgression, la littérature, c’est la virilité
du langage contre la féminité du livre, mais que peut-elle être
finalement, sinon un livre parmi tous les autres, un livre avec tous
les autres, dans l’espace linéaire de la bibliothèque? Que peut être
la littérature sinon, précisément, une frêle existence posthume du
langage, c’est pourquoi il ne lui est pas possible, à cette
littérature, maintenant que tout son être est dans le livre, il ne lui
est pas possible de ne pas être, fatalement, d’outre-tombe.
Ainsi, dans cette seule épaisseur, ouverte et fermée du livre,
en ces feuillets qui sont à la fois blancs et couverts de signes, en
ce volume unique, car chaque livre est unique, mais semblable à
tous car tous les livres se ressemblent, ce qui se recueille, c’est
quelque chose comme l’être même de la littérature; la littérature
qu’il ne faut comprendre ni comme le langage de l’homme, ni
comme la parole de Dieu, ni comme le langage de la nature, ni
comme le langage du cœur ou du silence, la littérature, c’est un
langage transgressif, c’est un langage mortel, répétitif, redoublé,
le langage du livre même. Dans la littérature, il n’y a qu’un sujet
qui parle, un seul parle, et c’est le livre, cette chose que
Cervantès, vous vous souvenez, avait tellement voulu brûler, le
livre, cette chose dont Diderot avait voulu, dans Jacques le
Fataliste, si souvent s’échapper, le livre, cette chose dans laquelle
Sade a été, vous le savez, enfermé, et dans laquelle nous autres,
nous sommes, nous aussi, enfermés.
[11]
II
Hier, je vous ai tenu, ou j’ai essayé de vous tenir quelques
propos sur la littérature, sur cet être de négation et de simulacre,
qui prend corps dans le livre.
Ce soir, je voudrais faire un mouvement de recul et essayer
de contourner un peu ces propos que j’ai moi-même tenus sur la
littérature. Car, après tout, est-ce que, réellement, il est si clair, si
évident, si immédiat, qu’on puisse parler de la littérature?
Car, après tout, quand on parle de la littérature, qu’est-ce
qu’on a comme sol, comme horizon; rien de plus, sans doute, que
ce vide qui est laissé par la littérature autour d’elle, et qui autorise
une chose tout de même étrange, peut-être unique, c’est que la
littérature, c’est un langage à l’infini, qui permet de parler d’elle-
même à l’infini.
Qu’est-ce que c’est que cette réduplication perpétuelle de la
littérature par du langage sur la littérature, qu’est-ce que c’est que
ce langage qui est la littérature, et qui autorise, à l’infini, ces
exégèses, ces commentaires, ces redoublements?
Ce problème, je crois, n’est pas clair. Il n’est pas clair en
lui-même, et il me semble qu’il est moins clair que jamais
aujourd’hui.
Il n’est pas clair aujourd’hui, et moins que jamais, pour un
certain nombre de raisons. La première serait celle-ci, qu’un
changement s’est produit tout récemment dans ce qu’on pourrait
appeler la critique. On pourrait dire ceci, c’est que jamais la
couche du langage critique ne fut plus épaisse qu’aujourd’hui.
Jamais on n’a, si souvent, utilisé ce langage second, qui s’appelle
la critique, et jamais, réciproquement, le langage absolument
premier, le langage qui ne parle que de lui-même, et en son
propre nom, ne fut proportionnellement plus mince qu’il ne l’est
aujourd’hui.
Or, cet épaississement, cette multiplication des actes
critiques s’est accompagné d’un phénomène qui est un
phénomène presque contraire. Ce phénomène c’est, je crois,
celui-ci: le personnage du critique, de «l’homo criticus», qui a été
inventé à peu près au XIX e siècle, entre Laharpe et Sainte-Beuve,
est en train de s’effacer au moment même où se multiplient les
actes de critique. C’est-à-dire que les actes de critique, en
proliférant, en se dispersant, s’égaillent en quelque sorte, et vont
se loger, non plus dans des textes qui sont préposés à la critique,
mais dans des romans, dans des poèmes, dans des réflexions,
éventuellement dans des philosophies. Les vrais actes de la
critique, il faut les trouver de nos jours dans des poèmes de Char,
ou dans des fragments de Blanchot, dans des textes de Ponge,
beaucoup plus que dans telle ou telle parcelle de langage qui
aurait été, explicitement, et par le nom de leur auteur, destinés à
être des actes critiques.
On pourrait dire que la critique devient une fonction
générale du langage en général, mais sans organisme, ni sujet
propre.
Or, et ce serait le troisième phénomène qui rendrait difficile
de comprendre ce que c’est, actuellement, que la critique
littéraire, or, actuellement, un nouveau phénomène apparaît, et
qui est celui-ci: on voit s’établir, de langage à langage, un rapport
qui n’est pas exactement un rapport critique, en tout cas qui n’est
pas conforme à l’idée qu’on se faisait, traditionnellement, de la
critique, cette institution jugeante, hiérarchisante, cette institution
médiatrice entre un langage créateur, un auteur créateur, et un
public qui serait simplement le consommateur. Il se forme, de nos
jours, un rapport très différent, entre le langage que l’on peut
appeler premier, et que nous appellerons plus simplement la
littérature, et ce langage second, qui parle de la littérature, et
qu’on appelle d’ordinaire critique.
En effet, la critique se trouve actuellement sollicitée par
deux nouvelles formes de rapport à établir entre elle et la
littérature.
Il me semble qu’actuellement la critique vise à établir, par
rapport à la littérature, par rapport au langage premier, une sorte
de réseau objectif, discursif, justifiable en chacun de ses points,
démontrable, un rapport où ce qui est premier, ce qui est
constitutif, ce n’est pas le goût du critique, un goût plus ou moins
secret, ou plus ou moins manifeste, mais ce qui est essentiel, dans
ce rapport, ce serait une méthode, nécessairement explicite, une
méthode d’analyse, qui peut être une méthode psychanalytique,
linguistique, thématique, formelle, comme vous voudrez.
[12] Donc, si vous voulez, la critique est en train de se
poser le problème de son fondement, dans l’ordre de la positivité,
ou de la science. Et, d’un autre côté, la critique joue un rôle tout à
fait nouveau, qui n’est plus du tout le rôle qu’elle avait autrefois,
et qui était le rôle d’intermédiaire entre l’écriture et la lecture – à
l’époque de Sainte-Beuve, jusqu’à maintenant encore, après tout,
qu’est-ce que c’était que faire de la critique?, c’était faire une
sorte de lecture privilégiée, première, une lecture plus matinale
que toutes les autres, et qui permettait ainsi de rendre l’écriture,
nécessairement un peu opaque, obscure, ou ésotérique, de
l’auteur, accessible à ces lecteurs de seconde zone que nous
serions tous, les lecteurs qui ont besoin de passer par la critique
pour comprendre ce qu’ils lisent. Autrement dit, la critique était la
forme privilégiée, absolue, et première de la lecture.
Or, il me semble que maintenant, ce qu’il y a d’important
dans la critique, c’est qu’elle est en train de passer du côté de
l’écriture. Et ceci de deux façons. D’abord, parce que, de plus en
plus, la critique s’intéresse non plus du tout au moment
psychologique de la création de l’œuvre, mais à ce qu’est
l’écriture, à l’épaisseur même de l’écriture des écrivains, cette
écriture qui a ses formes, ses configurations. Et puis également,
parce que la critique cesse de vouloir être une lecture meilleure ou
plus matinale, ou mieux armée, la critique est en train de devenir
elle-même un acte d’écriture. Une écriture sans doute seconde par
rapport à une autre, mais une écriture, tout de même, qui forme
avec toutes les autres un lacis, un réseau, un enchevêtrement de
points et de lignes. Ces points et ces lignes de l’écriture en
général se croisent, se répètent, se recouvrent, se décalent, pour
former finalement dans une neutralité totale, ce qu’on pourrait
appeler le total de la critique et de la littérature, c’est-à-dire
l’actuel hiéroglyphe flottant de l’écriture en général.
Vous voyez à quelle ambiguïté nous nous trouvons
confrontés lorsqu’il s’agit d’essayer de penser ce qu’est ce
langage second, qui vient s’ajouter au langage premier de la
littérature, et qui prétend, à la fois, tenir sur ce premier langage un
discours absolument positif, explicite, entièrement discursif et
démontrable, et puis qui essaie en même temps d’être un acte
d’écriture, comme la littérature.
Comment arriver à penser ce paradoxe, comment la critique
peut-elle arriver à être à la fois ce langage second, et en même
temps comme un langage premier, c’est cela que je voudrais
essayer d’élucider avec vous, pour savoir ce que c’est, en somme,
que la critique.
Vous savez que, assez récemment, il y a peut-être une
dizaine d’années, et pas plus, pour essayer d’expliquer ce que
c’était que la critique, un linguiste, Jakobson, a introduit une
notion qu’il avait empruntée aux logiciens, la notion de
métalangage. Et il a suggéré que, après tout, la critique était,
comme la grammaire, comme la stylistique, comme la
linguistique en général, un métalangage.
C’est évidemment une notion très séduisante, et qui a l’air,
au premier abord en tout cas, de s’ajuster parfaitement, puisque la
notion de métalangage nous met en présence de deux propriétés
qui sont, au fond, essentielles, pour définir la critique. La
première, c’est la possibilité de définir les propriétés d’un langage
donné, les formes d’un langage, les codes, les lois d’un langage,
dans un autre langage. Et la seconde propriété du métalangage,
c’est que ce second langage, dans lequel on peut définir les
formes, les lois, et les codes du premier langage, ce second
langage n’est pas nécessairement différent, en substance, du
langage premier. Puisque, après tout, on peut faire le métalangage
du français en français; on peut le faire, bien sûr, en allemand, en
anglais, dans n’importe quelle langue, on peut le faire également
dans un langage symbolique inventé à cet effet, mais on peut
aussi bien faire le métalangage du français en français, ou le
métalangage de l’anglais en anglais; par conséquent, on a là, dans
cette possibilité de recul absolu par rapport au langage premier,
une possibilité, à la fois, de tenir sur lui un discours entièrement
discursif, et d’être pourtant entièrement sur le même plan que lui.
Je ne suis pas sûr, pourtant, que cette notion de
métalangage, qui a l’air de définir, au moins abstraitement, le lieu
logique où la critique pourrait se loger, il ne me semble pas que
cette notion de métalangage doive être retenue pour définir ce que
c’est que la critique. [13]
En effet, il faudrait peut-être, pour expliquer cette réticence
à l’égard de la notion de métalangage, revenir un petit peu sur ce
[que] nous disions hier, à propos de la littérature.
Vous vous souvenez que le livre nous était apparu comme
le lieu de la littérature, c’est-à-dire comme l’espace où l’œuvre se
donne le simulacre de la littérature, dans un certain jeu de miroir
et d’irréalité, où il était question à la fois de la transgression et de
la mort. Si nous essayons d’exprimer la même chose, mais dans le
vocabulaire des spécialistes du langage, peut-être pourrait-on dire
quelque chose comme ceci: la littérature, bien sûr, elle est un des
innombrables phénomènes de parole qui sont effectivement
prononcés par les hommes. Comme tous les phénomènes de
parole, la littérature n’est possible que dans la mesure où ces
paroles sont conformes à la langue, à cet horizon général qui
constitue le code d’une langue donnée. Donc, toute littérature,
comme acte de parole, n’est possible que par rapport à cette
langue, que par rapport à ces structures de codes, qui rendent
chaque mot de la langue effectivement prononcé, qui le rend
transparent, qui lui permet d’être compris. Si les phrases ont un
sens, c’est que chaque phénomène de parole se trouve logé dans
l’horizon virtuel, mais absolument contraignant, de la langue.
Tout ceci, ce sont des notions qui sont, bien entendu, très
connues.
Mais est-ce qu’on ne pourrait pas dire ceci, que la littérature
est un phénomène de parole extrêmement singulier, et qui se
distingue probablement de tous les autres phénomènes de parole.
En effet, la littérature, au fond, c’est une parole qui obéit peut-être
au code dans lequel elle est placée, mais qui, au moment même
où elle commence, et dans chacun des mots qu’elle prononce,
compromet le code dans lequel elle se trouve placée et comprise.
C’est-à-dire que, chaque fois que quelqu’un prend la plume pour
écrire quelque chose, c’est de la littérature dans la mesure où, si
vous voulez, la contrainte du code se trouve suspendu dans l’acte
même qui consiste à écrire le mot, et fait que, à la limite, ce mot
pourrait très bien ne pas obéir au code de la langue. Si,
effectivement, chaque mot écrit par un littérateur n’obéissait pas
au code de la langue, il ne pourrait absolument pas être compris,
ce serait absolument une parole de folie – et on a peut-être là la
raison de l’appartenance essentielle de la littérature et de la folie,
de nos jours.
Mais ceci est une autre question; nous pouvons dire
simplement ceci, c’est que la littérature c’est le risque toujours
pris et toujours assumé par chaque mot d’une phrase de
littérature, le risque, qu’après tout, ce mot, cette phrase, et puis
tout le reste, n’obéisse pas au code. La différence qu’il y a entre
les deux phrases suivantes, “Longtemps je me suis couché tôt”, et
cette autre “Longtemps je me suis couché tôt”, la première étant
celle que je dis, la seconde étant celle que je lis chez Proust, ces
deux phrases, elles sont, verbalement, exactement identiques;
elles sont, en réalité, profondément différentes; à partir du
moment où elle est écrite par Proust au seuil de La Recherche du
Temps Perdu, il se peut, à la limite, qu’aucun de ces mots n’ait
exactement le sens que nous prêtons, nous, à ces mêmes mots
lorsque nous les prononçons quotidiennement, il se peut très bien
que la parole ait suspendu le code auquel elle a été empruntée. Il
y a, si vous voulez, un risque toujours essentiel, fondamental,
toujours ineffaçable dans toute littérature, ce risque, c’est celui de
l’ésotérisme structural. Il se pourrait très bien que le code ne soit
pas respecté; en tout cas, la parole littéraire a toujours le droit
souverain de suspendre ce code, et c’est la présence de cette
souveraineté, même si elle n’est pas, en fait, exercée, qui
constitue probablement le péril et la grandeur de toute œuvre
littéraire.
Dans cette mesure là, il ne me semble pas que le
métalangage puisse être réellement appliqué comme méthode
pour la critique littéraire, puisse se proposer comme horizon
logique sur lequel nous pourrions placer ce que c’est que la
critique. Parce que le métalangage implique précisément que l’on
fasse la théorie de toute parole effectivement prononcée, à partir
du code qui a été établi pour la langue.
Si le code se trouve compromis dans la parole, si, à la
limite, le code peut ne pas valoir absolument, à ce moment là, il
n’est pas possible de faire le métalangage d’une pareille parole,
on est obligé de recourir à autre chose.
A quoi recourir, par conséquent, pour définir la littérature,
si on ne recourt pas à la notion [14] de métalangage? Peut-être
faut-il être plus modeste, et, au lieu d’avancer hors de toute
prudence ce mot tout ébouriffé de logique, qui est celui de
métalangage, est-ce qu’on ne pourrait tout simplement constater
cette évidence quasi imperceptible, mais qui me paraît décisive,
c’est que le langage, c’est peut-être le seul être qui existe au
monde, et qui soit absolument répétable.
Bien sûr, il y a d’autres êtres au monde qui sont répétables:
on trouve deux fois le même animal, on trouve deux fois la même
plante. Mais, dans l’ordre de la nature, la répétition n’est, en
réalité, qu’une identité partielle, et d’ailleurs parfaitement
analysable d’une façon discursive.
Il n’y a des répétitions, au sens strict, je crois, que dans
l’ordre du langage. Et, sans doute, il faudra faire un jour l’analyse
de toutes les formes de répétition possibles, qu’il y a dans le
langage, et c’est peut-être dans l’analyse de ces formes de
répétitions qu’on pourra esquisser quelque chose qui serait
comme une ontologie du langage. Disons simplement maintenant,
d’une façon très simple, que le langage ne cesse de se répéter.
Les linguistes le savent bien, qui ont montré combien peu il
fallait de phonèmes pour constituer le vocabulaire total d’une
langue. Ces mêmes linguistes, et de même les auteurs de
dictionnaires, savent combien peu il faut de mots, finalement,
pour arriver à constituer tous les énoncés possibles, infinis,
quantité nécessairement ouverte, qui sont ces énoncés que nous
prononçons tous les jours. Nous ne cessons d’utiliser une certaine
structure de répétition, répétition phonématique, répétition
sémantique des mots, et puis, on sait bien que le langage peut se
répéter, il peut se répéter à la voix près et au moment près de
l’élocution; on peut dire la même phrase, on peut dire la même
chose avec d’autres mots, et c’est, précisément, cela en quoi
consiste l’exégèse, le commentaire, etc.; on peut même répéter un
langage dans sa forme, en suspendant entièrement son sens, et
c’est ce que font les théoriciens du langage, lorsqu’ils répètent,
finalement, une langue, dans sa structure grammaticale, ou dans
sa structure morphologique.
Vous voyez que, de toute façon, le langage est en quelque
sorte le seul lieu, probablement, de l’être, dans lequel quelque
chose comme la répétition soit absolument possible. Or, ce
phénomène de la répétition dans le langage, est une propriété
constitutive, bien sûr, du langage, mais cette propriété ne reste
pas neutre et inerte par rapport à l’acte d’écrire. Ecrire, ce n’est
pas contourner la répétition nécessaire du langage, écrire, au sens
littéraire, c’est, je crois, mettre la répétition au cœur même de
l’œuvre, et il faudrait peut-être se dire que la littérature,
occidentale bien sûr – car je ne connais pas les autres et je ne sais
pas ce qu’on pourrait en dire –, la littérature occidentale a bien dû
commencer du côté d’Homère, Homère qui, justement, a utilisé
une bien étonnante structure de répétition, dans l’Odyssée.
Souvenez-vous du chant huit de l’ Odyssée, où on voit Ulysse, qui
est arrivé chez les Phéaciens, et qui ne s’est pas encore fait
reconnaître d’eux, Ulysse est invité au banquet des Phéaciens, nul
ne l’a reconnu, simplement il y a eu sa force dans les jeux, son
triomphe sur ses adversaires, qui ont montré qu’il était un héros,
mais qui n’ont pas trahi sa véritable identité. Il est donc là et
caché. Et, au milieu de ce banquet, un aède arrive et il vient
chanter, il vient chanter les aventures d’Ulysse, il vient chanter
les exploits d’Ulysse, les aventures et les exploits qui sont
précisément en train de se poursuivre sous les yeux de l’aède,
puisque Ulysse est là, ces exploits qui sont loin d’être achevés, et
qui contiennent donc leur propre récit, comme un de leurs
épisodes, puisqu’il appartient aux aventures d’Ulysse qu’à un
moment donné, il entende un aède chanter les aventures d’Ulysse.
Et ainsi, l’Odyssée se répète à l’intérieur d’elle-même,
l’Odyssée a cette espèce de miroir central, au cœur de son propre
langage, si bien que le texte d’Homère s’enroule sur lui-même,
s’enveloppe ou se développe autour de son centre, et se redouble,
dans un mouvement qui lui est essentiel.
Il me semble que cette structure, qu’on retrouve d’ailleurs
très souvent – on la retrouve dans Les Mille et une Nuits; vous
savez qu’il y a une des mille et une nuits qui est consacrée à
l’histoire de Shéhérazade, racontant les mille et une nuits à un
sultan, pour échapper [15] à la mort.
Et ainsi on a cette structure de répétition qui me paraît
constitutive probablement de l’être même de la littérature, sinon
en général, du moins de la littérature occidentale.
Il y a sans doute, même certainement, une distinction fort
importante entre cette structure de répétition et la structure de
répétition interne que nous trouvons dans la littérature moderne.
Dans l’Odyssée, en effet, on voyait le chant infini de l’aède qui
poursuivait, en quelque sorte, Ulysse et essayait de le rattraper, et
puis, en même temps, on voyait ce chant de l’aède, qui était
toujours déjà commencé, et qui venait à la rencontre d’Ulysse, qui
l’accueillait dans sa propre légende, et le faisait parler au moment
même où il se taisait, le dévoilait quand il se cachait.
Dans la littérature moderne, l’autoréférence est
probablement beaucoup plus silencieuse que ce long déboîtement
raconté par Homère. Il est probable que c’est dans l’épaisseur de
son langage que la littérature se répète elle-même, et,
probablement, par ce jeu de la parole et du code, dont je vous
parlais à l’instant.
En tout cas, je voudrais terminer ces considérations sur le
métalangage et les structures de répétition en vous disant ceci, en
vous suggérant ceci: est-ce que vous ne pensez pas qu’on
pourrait, à ce moment là, définir la critique, d’une façon très
naïve, non pas comme métalangage, mais comme la répétition de
ce qu’il y a de répétable dans le langage. Et dans cette mesure là
la critique littéraire ne ferait probablement que s’inscrire dans une
grande tradition exégétique, qui a commencé, au moins pour le
monde grec, dès les premiers grammairiens qui ont commenté
Homère. Est-ce qu’on ne pourrait pas dire, en première
approximation, que la critique est purement et simplement le
discours des doubles, c’est-à-dire l’analyse des distances et des
différences dans lesquelles se répartissent les identités du
langage. Et à ce moment là, on verrait d’ailleurs trois formes de
critique tout à fait possibles, l’une, la première, ce serait, si vous
voulez, la science, ou la connaissance, ou le répertoire des figures
par lesquelles les éléments identiques du langage sont répétés,
variés, combinés – comment est-ce qu’on varie, ou combine, ou
répète, les éléments phonétiques, les éléments sémantiques, les
éléments syntactiques, bref, la critique entendue en ce sens là,
comme science des répétitions formelles du langage, cela a un
nom, elle a existé pendant longtemps, c’est la rhétorique.
Et puis, il y a une seconde forme de science des doubles, ce
serait l’analyse des identités, ou des modifications, ou des
mutations, du sens, à travers la diversité des langages – comment
est-ce qu’on peut répéter un sens, avec des mots différents, et
vous savez que c’est à peu près cela qu’a fait la critique au sens
classique du terme, depuis Sainte-Beuve jusqu’à nos jours à peu
près, où on essayait de retrouver l’identité d’une signification
psychologique, ou historique, enfin l’identité d’un thématisme
quelconque, à travers la pluralité d’une œuvre. C’est cela qu’on
appelle traditionnellement la critique.
Alors je me demande s’il ne pourrait pas y avoir place, et
s’il n’y a pas place déjà maintenant, pour une troisième forme de
critique, qui serait le déchiffrement de cette autoréférence, de
cette implication que fait l’œuvre à elle-même, dans cette
structure épaisse de répétition, dont je vous parlais tout à l’heure à
propos d’Homère; est-ce qu’il n’y aurait pas place pour l’analyse
de cette courbe par quoi l’œuvre se désigne toujours à l’intérieur
d’elle-même, et se donne comme répétition du langage par le
langage.
Il me semble que c’est à peu près cela, c’est l’analyse de
cette implication de l’œuvre sur elle-même, l’analyse de ces
signes par quoi l’œuvre ne cesse de se désigner à l’intérieur
d’elle-même, je crois que c’est cela, en somme, qui donne leur
signification à ces entreprises diverses et polymorphes qu’on
appelle aujourd’hui l’analyse littéraire.
Et je voudrais vous montrer en quoi cette notion d’analyse
littéraire, qui est utilisée et appliquée par des gens différents, que
ce soit Barthes, Starobinsky, etc., comment cette analyse littéraire
peut, je crois, fonder une réflexion, enfin, ouvrir et déboucher sur
une réflexion quasi-philosophique, car je ne me targue pas plus de
faire de la vraie philosophie que je ne me permettais hier aux
littéraires de faire de la vraie littérature – je serai dans le
simulacre de la philosophie comme hier la littérature était dans le
simulacre de la littérature. [16]
Donc, je voudrais savoir si ce n’est pas vers un simulacre
de philosophie que ces analyses littéraires pourraient nous
conduire.
Il me semble que les esquisses d’analyse littéraire qui ont
été faites jusqu’à présent, on pourrait les regrouper, en tout cas on
pourrait leur donner, si vous voulez, deux grandes directions
différentes.
Les unes concernent les signes par lesquels les œuvres se
désignent à l’intérieur d’elles-mêmes. Et les autres concerneraient
la manière dont se spatialise la distance que les œuvres prennent à
l’intérieur d’elles-mêmes.
Je vous parlerais d’abord, à titre purement
programmatique, des analyses qui ont été faites, et qu’on pourrait
faire, probablement, pour montrer comment les œuvres littéraires
ne cessent de se désigner à l’intérieur d’elles-mêmes.
Vous savez que c’est une découverte paradoxalement
récente, que celle-ci, à savoir que l’œuvre littéraire est faite, après
tout, non pas avec des idées, non pas avec de la beauté, non pas
avec des sentiments, surtout, mais que l’œuvre littéraire, elle est
faite tout simplement avec du langage. Donc, à partir d’un
système de signes. Mais ce système de signes, il n’est pas isolé, il
fait partie de tout un réseau d’autres signes, qui sont les signes qui
circulent dans une société donnée, des signes qui ne sont pas
linguistiques, mais des signes qui peuvent être économiques,
monétaires, religieux, sociaux, etc. A chaque instant qu’on choisit
d’étudier dans l’histoire d’une culture, il y a donc un certain état
des signes, un état général des signes en général, c’est-à-dire qu’il
faudrait établir quels sont les éléments qui sont supports de
valeurs signifiantes, et à quelles règles obéissent ces éléments
signifiants dans leur circulation.
En tant qu’elle est une manifestation concertée des signes
verbaux, on peut être sûr que l’œuvre littéraire fait partie, à titre
de région, d’un réseau horizontal, muet ou bavard, peu importe,
mais toujours scintillant, qui forme, à chaque moment, dans
l’histoire d’une culture, ce qu’on peut appeler l’état des signes.
Et, par conséquent, pour savoir comment la littérature se signifie,
il faudrait savoir comment elle est signifiée, où elle se situe dans
le monde des signes d’une société, chose qui pratiquement n’a
jamais été faite pour les sociétés contemporaines, chose qu’il
faudra faire, en prenant peut-être pour modèle un travail qui porte
sur des cultures beaucoup plus archaïques que les nôtres, – je
pense aux études qui ont été faites par Georges Dumézil sur les
sociétés indo-européennes. Et vous savez qu’il a montré comment
les légendes irlandaises, ou les sagas scandinaves, ou les récits
historiques des romains, tels qu’ils sont reflétés par Tite-Live, ou
les légendes arméniennes, comment tout cet ensemble, que l’on
peut appeler [l’] œuvres de langage, si on veut éviter le mot
littérature, comment toutes ces œuvres du langage font partie, en
réalité, d’une structure de signes beaucoup plus générale, et qu’on
ne peut comprendre ce que sont réellement ces légendes qu’à la
condition de rétablir l’homogénéité de structure qu’il y a entre ces
légendes, et, par exemple, tel ou tel rituel religieux ou social que
l’on trouve dans une société iranienne, bref, dans une autre
société indo-européenne. A ce moment là, on s’aperçoit que la
littérature dans ces sociétés là, fonctionnait comme un signe
essentiellement social ou religieux, et que c’est dans la mesure
même où elle reprenait à son compte la fonction signifiante d’un
rituel religieux, d’un rituel social, que la littérature existait,
qu’elle était à la fois crée et consommée.
De nos jours, il est bien probable – il faudrait le voir, il
faudrait établir l’état des signes actuellement dans notre société –,
il est bien probable que la littérature ne se situerait pas du côté
des signes religieux, mais probablement beaucoup plus du côté
des signes, disons, de la consommation ou de l’économie. Mais,
après tout, on n’en sait rien, c’est cette première couche
sémiologique, fixant la région signifiante qu’occupe la littérature,
qu’il faudrait faire.
Mais par rapport à cette première couche sémiologique, on
peut dire que la littérature est inerte, elle fonctionne, certes, mais
ce réseau dans lequel elle fonctionne ne lui appartient pas, elle ne
le domine pas. Il faudrait, par conséquent, pousser cette analyse
sémiologique, ou plutôt la développer vers une autre couche qui
serait, elle, interne à l’œuvre, c’est-à-dire, il faudrait établir quel
est le système de signes qui fonctionne, non pas dans une culture,
mais à l’intérieur d’une œuvre elle-même? Là encore, on n’en est
qu’aux rudiments, en quelque sorte aux exceptions. Saussure a
laissé un certain nombre de cahiers dans lesquels il a essayé de
définir, justement, l’usage et la structure des signes phonétiques
[17] ou sémantiques dans la littérature latine. (Et ces textes sont
actuellement publiés par Starobinsky dans Le Mercure de France,
je vous y renvoie.) On a là l’esquisse d’une analyse où la
littérature apparaîtrait essentiellement comme une combinaison
de signes verbaux. Il y a un certain nombre d’auteurs pour
lesquels de pareilles analyses sont faciles, je pense à Péguy, à
Raymond Roussel, bien sûr, aux surréalistes également, et il y
aurait là, dans cette analyse du signe verbal en tant que tel, il y
aurait là, si vous voulez, une seconde couche d’analyse
sémiologique possible, couche qui serait celle, non plus de la
sémiologie culturelle, mais de la sémiologie linguistique,
définissant les choix qui peuvent être faits, les structures
auxquelles ces choix sont soumis, pourquoi ils ont été faits, le
degré de latitude qui est donné en chaque point du système, et qui
justifie la structure interne de l’œuvre.
Il y a également, probablement, une troisième couche de
signes, un troisième réseau de signes, qui sont utilisés par la
littérature pour se signifier elle-même, ce serait, si vous voulez,
les signes que Barthes appelle de l’écriture. C’est-à-dire les signes
par lesquels l’acte d’écrire se ritualise hors du domaine de la
communication immédiate.
Ecrire, on le sait maintenant, ce n’est pas simplement
utiliser les formules d’une époque, en y mélangeant quelques
formules individuelles, écrire, ce n’est pas mélanger une certaine
dose de talent, de médiocrité, et de génie, écrire, cela implique
surtout l’utilisation de ces signes qui ne sont rien d’autres que des
signes d’écriture. Ces signes d’écriture, ce sont peut-être certains
mots, certains mots dits nobles, mais ce sont surtout certaines
structures linguistiques profondes, comme, en français par
exemple, les temps du verbe – vous savez que l’écriture de
Flaubert, elle consiste essentiellement, et on peut le dire d’ailleurs
de tous les récits classiques français depuis Balzac jusqu’à Proust,
dans une certaine configuration, dans un certain rapport de
l’imparfait, du passé simple, du passé composé, et du plus-que-
parfait, constellation qui ne se retrouve jamais avec les mêmes
valeurs dans le langage réellement utilisé par vous et moi, ou dans
les journaux; cette configuration de ces quatre temps, elle est dans
le récit français classique, constitutive du fait qu’il s’agit
précisément d’un récit littéraire.
Enfin, il faudrait faire place à une quatrième couche
sémiologique, beaucoup plus restreinte et discrète, ce serait
l’étude des signes qu’on pourrait appeler d’implication, ou
d’auto-implication; ce sont les signes par lesquels une œuvre se
désigne à l’intérieur d’elle-même, se re-présente sous une certaine
forme, avec un certain visage, à l’intérieur de soi-même.
Je parlais tout à l’heure du chant huit de l’ Odyssée, où
Ulysse écoute l’aède chanter les aventures d’Ulysse. Or il y a
quelque chose de très caractéristique, c’est que, au moment où
Ulysse, entendant l’aède chanter ses propres aventures, Ulysse,
qui n’est toujours pas reconnu par les Phéaciens, baisse la tête, se
voile la figure, et se met à pleurer, dit le texte d’Homère, dans un
geste qui est celui des femmes, quand elles reçoivent, après la
bataille, le cadavre de leur époux.
Le signe de l’auto-implication de la littérature par elle-
même, vous le voyez, il est ici hautement significatif, c’est un
rituel, c’est exactement un rituel de deuil. C’est-à-dire que
l’œuvre ne se désigne elle-même que dans la mort, et que dans la
mort du héros. Il n’y a œuvre que dans la mesure où le héros, qui
est vivant dans l’œuvre, est pourtant déjà mort par rapport à ce
récit qui s’est fait.
Si l’on compare ce signe d’auto-implication au signe
d’auto-implication qu’il y a dans l’œuvre de Proust, on voit des
différences qui sont tout à fait intéressantes et caractéristiques.
L’auto-implication de La Recherche du Temps Perdu par
elle-même, quand est-ce qu’elle est donnée? Elle est donnée, au
contraire, sous la forme de l’illumination, de l’illumination
intemporelle, lorsque, brusquement, à propos d’une serviette
damassée, ou à propos d’une madeleine, ou à propos de
l’inégalité des pavés de la cour de Guermantes, qui rappelle
l’inégalité des pavés de Venise, quelque chose comme la présence
intemporelle, illuminée, absolument heureuse, de l’œuvre, se
donne à celui qui est en train, précisément, de l’écrire.
Entre cette illumination intemporelle et le geste d’Ulysse
qui se voile la face et qui pleure comme une épouse recevant le
cadavre de son mari tué à la guerre, vous voyez qu’il y a une
différence absolue, et qu’une sémiologie de ces signes de l’auto-
implication des œuvres en elles-mêmes nous apprendrait
certainement beaucoup de choses sur ce que c’est que la
littérature.
Mais tout cela, ce sont des programmes qui pratiquement
n’ont encore jamais été remplis. Si j’ai insisté sur ces différentes
couches sémiologiques, c’est que, actuellement, il y a [18] un
certain confusionnisme qui règne à propos de l’utilisation des
méthodes linguistiques ou sémiologiques à la littérature. Vous
savez qu’un certain nombre de gens, actuellement, mettent,
comme on dit à toutes les sauces les méthodes de la linguistique,
et traitent la littérature comme un fait brut de langage.
Il est vrai que la littérature est faite avec du langage.
Comme, après tout, l’architecture est faite avec de la pierre. Mais
il ne faut pas en tirer cette conséquence, qu’il est possible de lui
appliquer indifféremment les structures, les concepts et les lois
qui valent pour le langage en général.
En fait, quand on applique, à l’état brut, les méthodes
sémiologiques à la littérature, on est victime d’une double
confusion. D’une part, on fait un usage récurrent d’une structure
signifiante particulière dans le domaine des signes en général;
c’est-à-dire qu’on oublie que le langage n’est, au fond, qu’un
système de signes parmi un système beaucoup plus général de ces
signes, qui sont les signes religieux, sociaux, économiques, dont
je vous parlais tout à l’heure. Et puis, d’autre part, en appliquant à
l’état brut les analyses linguistiques à la littérature, on oublie,
justement, que la littérature fait usage de structures signifiantes
très particulières, beaucoup plus fines que les structures propres
au langage, et en particulier, ces signes d’auto-implication, dont
je vous parlais tout à l’heure, ils n’existent en fait que dans la
littérature, et il serait impossible d’en retrouver des exemples
dans le langage en général.
Autrement dit, l’analyse de la littérature, comme signifiante
et se signifiant soi-même, ne s’étale pas dans la seule dimension
du langage. Elle s’enfonce dans un monde de signes, qui ne sont
pas encore des signes verbaux, et, d’un autre côté, elle s’étire, elle
s’élève, elle s’allonge vers d’autres signes, qui sont beaucoup
plus complexes que les signes verbaux.
Ce qui fait que la littérature n’est ce qu’elle est que dans la
mesure où elle n’est pas simplement limitée à l’usage d’une seule
surface sémantique, de la seule surface des signes verbaux. En
réalité, la littérature se tient debout à travers plusieurs épaisseurs
de signes, elle est, si vous voulez, profondément poly-sémantique,
mais sur un mode singulier, non pas comme on dit qu’un message
peut avoir plusieurs significations et qu’il est ambigu, mais, en
réalité, la littérature est poly-sémantique, cela veut dire que, pour
dire une seule chose, ou peut-être pour ne rien dire du tout, car
rien ne prouve que la littérature doit dire quelque chose, en tout
cas, pour dire quelque chose ou pour ne rien dire, la littérature est
toujours obligée de parcourir un certain nombre de couches
sémiologiques – je crois, au minimum, les quatre couches dont je
vous ai parlé –, et, dans ces quatre couches, elle prélève de quoi
constituer une figure, une figure qui a pour propriété de se
signifier elle-même. C’est-à-dire que la littérature n’est pas autre
chose que la re-configuration, sous une forme verticale, de signes
qui sont donnés dans la société, dans la culture, en couches
séparées, c’est-à-dire que la littérature ne se constitue pas à partir
du silence, la littérature, ce n’est pas l’ineffable d’un silence, la
littérature, ce n’est pas l’effusion de ce qui ne peut pas se dire et
qui ne se dira jamais.
La littérature, en réalité, n’existe que dans la mesure où
on n’a pas cessé de parler, que dans la mesure où on ne cesse pas
de faire circuler des signes. C’est parce qu’il y a tout autour d’elle
des signes, c’est parce que ça parle que quelque chose comme un
littérateur peut parler.
Voilà, si vous voulez, très grossièrement schématisée, dans
quelle orientation on pourrait voir se développer une analyse
littéraire, qui serait, au sens strict du terme, sémiologique.
Il me semble que l’autre voie serait la voie, peut-être à la
fois plus et moins donnée, qui concernerait, non plus les
structures significatives et signifiantes de l’œuvre, mais sa
spatialité.
Vous savez que, pendant longtemps, on a considéré que le
langage avait une profonde parenté avec le temps. On l’a cru,
sans doute, pour plusieurs raisons. Parce que le langage, c’est
essentiellement ce qui permet de faire un récit, et en même temps
ce qui permet de faire une promesse. Le langage, c’est
essentiellement, ce qui «lit» le temps. Et puis, le langage dépose
le temps en lui-même, puisqu’il est écriture, et que, comme
écriture, il va se maintenir dans le temps, et maintenir ce qu’il dit
dans le temps. La surface couverte de signes n’est, au fond, que la
ruse spatiale de la durée.
C’est donc dans le langage que le temps se manifeste à lui-
même, et c’est dans le langage, d’ailleurs, qu’il va devenir
conscient de lui-même comme histoire. Et on peut dire, si vous
[19] voulez, que de Herder à Heidegger, le langage comme
logos a toujours eu pour haute fonction de garder le temps, de
veiller sur le temps, de se maintenir dans le temps, et de maintenir
le temps sous sa veille immobile.
Et je crois que nul n’avait songé que le langage, après
tout, ce n’était pas du temps, mais de l’espace. Nul n’y a songé,
sauf quelqu’un que, pourtant, je n’aime pas beaucoup, mais je
suis obligé de le constater, c’est Bergson. Bergson qui a eu l’idée
qu’après tout le langage ce n’était pas du temps mais c’était de
l’espace. Il n’y a eu qu’un ennui, c’est qu’il en a tiré une
conséquence négative. Et qu’il s’est dit que si le langage c’était
de l’espace, et pas du temps, c’était tant pis pour le langage. Et
comme l’essentiel de la philosophie, qui, justement, est langage,
était de penser le temps, il en a tiré ces deux conclusions
négatives: premièrement, que la philosophie devait se détourner
de l’espace et du langage pour pouvoir mieux penser le temps, et,
deuxièmement, que pour pouvoir penser et exprimer le temps, il
fallait, en quelque sorte, court-circuiter le langage, enfin, il fallait
se débarrasser de ce qu’il pouvait y avoir de pesamment spatial
dans le langage. Et, pour neutraliser ces pouvoirs, ou cette nature,
ou ce destin spatial du langage, il fallait faire jouer le langage sur
lui-même, utiliser en face des mots d’autres mots, des contre-
mots, en quelque sort; et, dans ce plissement, dans ce choc, dans
cet entrelacs des mots les uns sur les autres, où la spatialité de
chacun des mots aurait été tuée, en tout cas épongée, anéantie, en
tout cas limitée par la spatialité des autres, dans ce jeu qui est, au
sens strict du terme, la métaphore, – de là l’importance des
métaphores chez Bergson – , il pensait que, grâce à tout ce jeu du
langage contre lui-même, grâce à tout ce jeu de la métaphore
neutralisant la spatialité, quelque chose parviendrait à naître, ou
du moins, à passer, et qui serait l’écoulement même du temps.
En fait, ce qu’on est en train de découvrir maintenant, et
par mille chemins, qui, d’ailleurs, sont presque tous empiriques,
c’est que le langage est espace.
Le langage est espace, et on l’avait oublié, tout simplement
parce que le langage fonctionne dans le temps, c’est la chaîne
parlée, et qu’il fonctionne pour dire le temps. Mais la fonction du
langage n’est pas son être, et l’être du langage, justement, si sa
fonction est d’être temps, l’être du langage est d’être espace.
Espace, puisque chaque élément du langage n’a de sens que
dans le réseau d’une synchronie. Espace, puisque la valeur
sémantique de chaque mot ou de chaque expression est définie
par le découpage d’un tableau, d’un paradigme. Espace, puisque
la succession même des éléments, l’ordre des mots, les flexions,
les accords entre les différents mots, le long de la chaîne parlée,
obéit, avec plus ou moins de latitude, aux exigences simultanées,
architectoniques, par conséquent spatiales, avec un signifié, que
par des lois de substitution, de combinaison d’éléments, donc par
une série d’opérations définies sur un ensemble, par conséquent,
dans un espace.
Et longtemps, je crois, jusqu’à pratiquement maintenant, on
a confondu les fonctions annonciatrices et récapitulatrices du
signe, qui sont bien des fonctions temporelles, à ce qui lui
permettait d’être signe, et ce qui permet à un signe d’être signe,
ce n’est pas le temps, c’est l’espace.
La parole de Dieu, qui fait que les signes de la fin du
monde sont bien les signes de la fin du monde, cette parole, elle
n’a pas lieu dans le temps, elle peut bien se manifester dans le
temps, elle est éternelle, elle est synchronique par rapport à
chacun des signes qui signifient quelque chose.
L’analyse littéraire n’aura, je crois, de sens propre qu’à la
condition d’oublier tous ces schèmes temporels, dans lesquels elle
a été prise, tant qu’on a confondu le langage et le temps. Et, en
particulier, le mythe de la création. Si la critique, pendant si
longtemps, s’est donné pour fonction et pour rôle de restituer ce
moment de la création première, qui serait le moment où l’œuvre
est en train de naître et de germer, c’est tout simplement qu’elle
obéissait à la mythologie temporelle du langage. Il y avait
toujours cette nécessité, cette nostalgie de la critique, retrouver
les chemins de la création, reconstituer dans son propre discours
de critique le temps de la naissance et de l’achèvement, qui,
pensait-on, devait bien détenir les secrets de l’œuvre. La critique
a été, si vous voulez, autant que les conceptions du langage ont
été liées au temps, la critique a été créationniste dans la mesure
même où le langage a été reçu comme du temps, elle croyait à la
création, comme elle croyait au silence. [20]
Il me semble que cette analyse du langage de l’œuvre
comme espace mériterait d’être tentée. A vrai dire, elle l’a été, par
un certain nombre de gens, et dans un certain nombre de
directions.
Je vais encore être un peu dogmatique, schématiser des
choses qui ne sont encore que des programmes et des esquisses,
mais je me demande si on ne pourrait pas, très grossièrement, dire
quelque chose comme ceci.
D’abord, il est certain qu’il y a des valeurs spatiales qui
sont engagées dans des configurations culturelles complexes, et
qui spatialisent tout langage et toute œuvre qui apparaissent dans
cette culture. Je pense par exemple à l’espace de la sphère depuis
la fin du XV e siècle jusqu’au début, à peu près, du XVII e siècle.
Pendant toute la période qui couvre, disons l’extrême fin du
Moyen Age, la Renaissance, jusqu’au tout début de l’âge
classique.
La sphère, à cette époque là, n’a pas simplement été une
figure privilégiée, dans l’iconographie ou dans la littérature,
parmi d’autres figures, elle a été, en réalité, cette sphère, la figure
réellement spatialisante, le lieu absolu et originaire où prenaient
place toutes les autres figures de la culture renaissante, et de la
culture, disons, baroque.
La courbe fermée, le centre, la coupole, le globe qui
rayonne ne sont pas des formes simplement choisies par les gens
de cette époque là, ce sont les mouvements par lesquels sont
donnés silencieusement tous les espaces possibles de cette
culture, et l’espace du langage.
Empiriquement, bien sûr, il y a eu la découverte que la terre
était ronde, ce qui a privilégié, en fait, la sphère; ça a été la
découverte que la terre était l’image, par conséquent, solide,
sombre, ramassée sur elle-même, de la sphère céleste, et de sa
voûte, et par conséquent aussi l’idée que l’homme, à son tour,
n’est qu’une petite sphère microcosmique, placée sur le cosmos
de la terre, et à l’intérieur du macrocosme de l’éther.
Est-ce que ce sont ces découvertes, ces idées, qui ont donné
à la sphère son importance, il n’y a peut-être pas beaucoup de
signification à poser ce problème. Ce qui est certain, ce qu’on
devrait pouvoir analyser, c’est ceci, que la représentation, au sens
le plus général, l’image, l’apparence, la vérité, l’analogie, depuis
la fin du XV e siècle jusqu’au début du XVIIe siècle, se sont
donnés dans l’espace fondamental de la sphère. Ce qui est certain,
c’est que le cube pictural de la peinture de Quattrocento, par
exemple, a été remplacé par la demi-sphère creuse où se sont
placés et déplacés les personnages de la peinture à partir de la fin
du XVe siècle et surtout du XVI e siècle. Ce qui est certain, c’est
que le langage a commencé de se recourber sur lui-même, pour
inventer des formes circulaires, pour revenir à son point de
départ, – prenez par exemple le voyage fantastique de Pantagruel,
tel qu’il s’achève au point ambigu du départ, par une marche à
travers un pays délicieux qui évoque l’Olympe, la Thessalie,
l’Egypte, la Libye, et, ajoute Rabelais, l’île Hyperborée (?) sur la
mer Judaïque, mais voilà que cette terre qu’on traverse, au bout
des îles, quand on est arrivé au plus loin du voyage, quand on est
absolument perdu, voilà que ce pays, dit toujours Rabelais, est
gracieux autant qu’est le pays de Touraine, qui est précisément ce
pays même, sans aucun doute, d’où les compagnons trouvèrent
leur point de départ, d’où ils sont partis pour aller rejoindre ces
îles, de telle sorte que, pour rentrer en leur pays, il n’était pas
besoin de faire tout ce voyage, puisqu’ils n’ont pas cessé d’y être,
ou afin de le quitter à nouveau peut-être, parce que, si maintenant,
au moment où ils vont se réembarquer, ils sont déjà au pays de
Touraine, c’est peut-être parce qu’ils vont partir pour un nouveau
voyage. Et, en tout cas, le cercle recommence indéfiniment.
En tout cas, c’est probablement cette sphère de la
représentation renaissante, qui en se dissociant, en explosant
littéralement, ou en se tordant sur elle-même, a donné, au milieu
du XVIIe siècle, les grandes figures baroques du miroir, de la
bulle irisée, de la sphère, de la torsade, de ces grands vêtements
qui s’enveloppent comme des hélices autour des corps et qui
montent dans la direction verticale.
Il me semble que l’on pourrait faire, de la spatialité des
œuvres en général, une analyse de ce type; et on en a d’ailleurs
bien des esquisses, plus que des linéaments, dans des analyses
comme celles qu’a fait Poulet par exemple.
Il est probable aussi que cette spatialité culturelle du
langage ne peut, à l’extrême rigueur, que saisir l’œuvre de
l’extérieur. En fait, il y a aussi une spatialité intérieure à l’œuvre
même. Cette spatialité intérieure, ce n’est pas sa composition,
exactement, ce n’est pas ce qu’on appelle traditionnellement son
rythme ou son mouvement.
C’est, en quelque sorte, l’espace profond d’où viennent et
où circulent les figures de l’œuvre. [21] Et, à vrai dire, de
pareilles analyses ont été faites, elles ont été faites en grande
partie par Starobinsky dans son Rousseau, ou par Rousset dans
Formes et significations – et je pense alors très précisément, et je
ne fais que citer le texte et vous y renvoyer explicitement, je
pense à la très belle analyse que Rousset a faite de la boucle et de
la vrille chez Corneille. Il a montré comment le théâtre de
Corneille au début, depuis La Galerie du Palais jusqu’au Cid ,
obéit à une spatialité de boucle; c’est-à-dire que deux
personnages sont donnés, qui sont réunis avant le début de la
pièce. La pièce ne commence que dans la mesure où ces
personnages sont séparés, et puis, au milieu de la pièce, ils se
rejoignent, ils se rejoignent mais ils se croisent, la réconciliation
n’est pas possible ou n’est pas parfaite; c’est l’histoire de
Rodrigue et de Chimène, qui ne peuvent pas arriver à se rejoindre
absolument, à cause de ce qui s’est passé; qui se trouvent donc
séparés à nouveau, et réunis simplement à la fin de la pièce. D’où
une forme de boucle, une forme de huit, si vous voulez, de signe
d’infini, qui caractérise la spatialité des premières œuvres de
Corneille. Et puis Polyeucte, représente en quelque sorte
l’irruption d’un mouvement ascensionnel qui n’existait pas, parce
que chez Polyeucte, on a bien cette figure en huit, deux
personnages qui sont réunis avant le début de la pièce, Polyeucte
et pauline, puis qui sont séparés, qui se rejoignent, puis qui sont
séparés pour se retrouver finalement. Mais le jeu de la séparation
n’est pas dû à des événements qui sont sur le même plan que les
personnages eux-mêmes, ils sont dus essentiellement à ce
mouvement ascendant provoqué par la conversion de Polyeucte.
Si vous voulez, le facteur de séparation et de réunion, c’est une
structure verticale, qui culmine en Dieu. A partir de ce moment
là, Polyeucte se sépare de Pauline pour rejoindre Dieu, Pauline,
pour rejoindre Polyeucte, va le suivre; et c’est le jeu de cette
boucle et de cette spire qui va donner à la pièce de Polyeucte et
aux œuvres de Corneille qui vont suivre, ce mouvement d’hélice,
cette espèce de drapé ascendant, qui est peut-être le même que
celui qu’on retrouve, à la même époque, dans la sculpture
baroque.
Enfin, et ceci étant la spatialité de l’œuvre même, peut-être
pourrait-on trouver une troisième possibilité d’analyser la
spatialité de l’œuvre, en étudiant non plus la spatialité de l’œuvre
en général, mais la spatialité du langage lui-même dans l’œuvre.
C’est-à-dire mettre au jour un espace qui ne serait pas celui de la
culture, qui ne serait pas celui de l’œuvre, mais celui du langage
lui-même, posé là sur la feuille blanche du papier, le langage qui,
par sa nature propre, constitue et ouvre un certain espace, un
espace souvent fort compliqué, et qui a peut-être été, au fond,
rendu sensible, dans l’œuvre même de Mallarmé – cet espace de
l’innocence, de la virginité, de la blancheur, cet espace de la vitre
aussi, qui est celui du froid, de la neige, du gel où l’oiseau est
retenu, c’est un espace qui est à la fois tendu et lisse, qui est, aussi
bien, fermé et replié sur lui-même, il s’ouvre dans toutes ses
qualités de licitude, il s’ouvre à la pénétration absolue du regard
qui peut le parcourir, mais le regard, au fond, ne peut que glisser
sur lui, cet espace ouvert est en même temps un espace
complètement fermé. Et c’est probablement cela, l’espace des
mots de Mallarmé. Cet espace des objets mallarméens, cet espace
du lac mallarméen, c’est également l’espace de ses mots. Prenez,
par exemple, les valeurs, fort bien analysées par J.-P. Richard, les
valeurs de l’éventail et de l’aile chez Mallarmé. L’éventail et
l’aile, quand ils sont ouverts, ont cette propriété de dérober à la
vue: l’aile dérobe l’oiseau à la vue, tant elle est ample, l’éventail
masque le visage, donc, l’aile et l’éventail dérobent à la vue, ils
cachent, ils mettent hors d’atteinte et à distance, mais ils ne
cachent que dans la mesure où ils déploient, c’est-à-dire dans la
mesure où se trouve déployée la richesse diaprée de l’aile, ou
encore le dessin même de l’éventail. Et quand ils sont fermés, au
contraire, l’aile laisse voir l’oiseau, l’éventail laisse voir le
visage, ils laissent donc approcher, ils offrent à la saisie du regard
ou de la main ce qu’ils cachaient tout à l’heure quand ils étaient
ouverts, mais, au moment même où ils se replient, ils deviennent
cachants, ils recèlent précisément tout ce qui était étalé au
moment où ils s’ouvraient. Donc l’aile et l’éventail forment le
moment ambigu du dévoilement, et pourtant de l’énigme; ils
forment le moment du voile tendu sur ce qui est à voir, et
également le moment de la parade absolue.
Cet espace ambigu des objets mallarméens, qui dévoilent et
cachent à la fois, c’est probablement l’espace même des mots de
Mallarmé, l’espace du mot lui-même, le mot, chez Mallarmé,
déploie sa parade, en enveloppant, en enfonçant sous cette parade
ce qu’il est en train de dire. Il est à la fois replié sur la page
blanche, cachant ce qu’il a à dire, et il fait surgir, [22] dans ce
mouvement même de repli sur soi, il fait surgir, dans la distance,
ce qui demeure irrémédiablement absent. Et c’est le mouvement
probablement de tout le langage de Mallarmé, c’est le
mouvement, en tout cas, du livre de Mallarmé, du livre qu’il faut
prendre à la fois au sens le plus symbolique, du lieu du langage,
et au sens le plus précis de cette entreprise de Mallarmé, dans
laquelle il s’est littéralement perdu, à la fin de son existence, c’est
le mouvement, donc, de ce livre qui, ouvert comme un éventail,
doit cacher tout en montrant, et qui, fermé, doit laisser voir le
vide qu’il n’a pas cessé, en son langage de nommer. C’est
pourquoi le livre c’est l’impossibilité même du livre, c’est sa
blancheur scellante, quand il se déploie, c’est sa blancheur
dévoilante quand il se replie. Le livre de Mallarmé, dans son
impossibilité obstinée, rend quasi-visible l’invisible espace du
langage, cet invisible espace du langage dont il faudrait faire
l’analyse, non seulement chez Mallarmé, mais pour tout auteur
que l’on voudrait aborder.
Ces analyses possibles, déjà esquissées en partie ici et là,
vous me direz qu’elles ont l’air d’aborder l’œuvre en ordre
dispersée; il y a d’un côté le déchiffrement des couches
sémiologiques, et puis de l’autre, l’analyse des formes de
spatialisation. Est-ce que ces deux mouvements, l’analyse des
couches sémiologiques, l’analyse des formes de spatialisation
doivent demeurer parallèles, ou est-ce qu’elles vont être
convergentes, ou est-ce qu’elles ne vont converger qu’à l’infini,
du côté où l’œuvre est à peine visible dans son lointain; peut-on
espérer un jour un langage unique qui ferait apparaître à la fois les
valeurs sémiologiques neuves, et l’espace où elles se spatialisent?
Il n’y a absolument aucun doute; nous sommes loin de
pouvoir tenir encore un tel discours, et la dispersion des propos
que je viens de vous tenir en témoigne.
Et pourtant, et plutôt, c’est cela, sans doute, qui est notre
tâche. La tâche de l’analyse littéraire, maintenant, la tâche, peut-
être, de la philosophie, la tâche, peut-être, de toute la pensée et de
tout le langage actuellement, ce serait de laisser venir au langage
l’espace de tout langage, l’espace dans lequel les mots, les
phonèmes, les sons, les sigles écrits peuvent être, en général, des
signes; il faudra bien un jour qu’apparaisse cette grille qui libère
le sens en retenant le langage. Mais quel langage aura la force ou
la réserve, quel langage aura assez de violence ou de neutralité
pour laisser apparaître et pour nommer lui-même l’espace qui le
constitue comme langage, cela, nous ne le savons pas. Est-ce que
ce sera un langage beaucoup plus resserré que le nôtre, un
langage qui ne connaîtra plus la séparation actuelle de la
littérature, de la critique, de la philosophie; un langage en quelque
sorte absolument matinal, et qui rappellera, au sens fort du mot
rappel, ce qu’a pu être le premier langage de la pensée grecque.
Ou est-ce qu’on ne pourrait pas dire, peut-être, encore autre
chose, c’est que, si la littérature a actuellement un sens, et si
l’analyse littéraire au sens où je viens d’en parler a actuellement
un sens, c’est peut-être parce qu’elles présagent ce que sera ce
langage, c’est peut-être qu’elles sont signes que ce langage est en
train de naître. Qu’est-ce que c’est, après tout, que la littérature,
pourquoi est-ce qu’elle est apparue au XIXe siècle, comme nous
le disions hier, et liée au curieux espace du livre?
C’est peut-être précisément cela, la littérature, c’est cette
invention récente, qui date de moins de deux siècles, c’est,
fondamentalement, le rapport en train de se constituer, le rapport
en train de devenir obscurément visible, mais non encore
pensable, du langage et de l’espace.
Au moment où le langage renonce à ce qui a été sa vieille
tâche depuis des millénaires, et qui était de recueillir ce qui ne
doit pas être oublié, lorsque le langage découvre qu’il est lié par
la transgression et la mort à ce fragment d’espace, si facile à
manipuler, mais si ardu à penser, et qui est le livre, alors, quelque
chose comme la littérature est en train de naître. La naissance de
la littérature, elle est encore toute proche de nous, et pourtant,
déjà, aux creux d’elle-même, elle pose la question de ce qu’elle
est. C’est qu’elle est extrêmement jeune encore dans un langage
qui était très vieux. Elle est apparue dans un langage qui depuis
des millénaires, depuis, en tout cas l’aurore de la pensée grecque
était voué au temps.
Elle est apparue donc dans un langage voué au temps,
comme le balbutiement, ou le premier balbutiement d’un langage
très long probablement encore, et au bout duquel nous sommes
loin d’être arrivés, ce langage sera voué á l’espace. Le livre a été
jusqu’au XIXe siècle le support accessoire, le livre, dans sa
matérialité spatiale, a été le support accessoire d’une parole qui
avait pour souci la mémoire et le retour. Et voilà qu’il est devenu,
et c’est cela la [23] littérature, voilà que le livre est devenu, à peu
près à l’époque de Sade, le lieu essentiel du langage, son origine
toujours répétable, mais définitivement sans mémoire.
Quant à la critique, que fut-elle depuis Sainte-Beuve
jusqu’aux autres..., que fut-elle, sinon précisément l’effort pour
penser, l’effort désespéré, l’effort voué à l’échec, pour penser en
termes de temps, de succession, de création, de filiation,
d’influence, ce qui était entièrement étranger au temps, ce qui
était voué à l’espace, c’est-à-dire la littérature.
Et cette analyse littéraire, à laquelle tant de gens
aujourd’hui s’exercent, elle n’est pas la promotion de la critique
dans un métalangage, elle n’est pas la critique devenue enfin
positive, avec tous ses gestes menus, patients, avec toutes ses
accumulations un peu laborieuses; l’analyse littéraire, si elle a un
sens, elle ne fait autre chose qu’effacer la possibilité même de la
critique, elle rend peu à peu visible, mais dans un brouillard
encore, que le langage devient de moins en moins historique et
Vous aimerez peut-être aussi
- Le Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvreD'EverandLe Guépard de Giuseppe Tomasi di Lampedusa (Fiche de lecture): Résumé complet et analyse détaillée de l'oeuvrePas encore d'évaluation
- Les Temps Verbaux Dans Un Récit1Document2 pagesLes Temps Verbaux Dans Un Récit1chabaudPas encore d'évaluation
- Émile ZOLA Sur Flaubert, La Tribune, 28 Novembre 1869Document3 pagesÉmile ZOLA Sur Flaubert, La Tribune, 28 Novembre 1869DariaBKPas encore d'évaluation
- Poétique de L'espaceDocument19 pagesPoétique de L'espaceSarah Al TayehPas encore d'évaluation
- La Critique HistoriqueDocument3 pagesLa Critique HistoriqueHassan ElhassanPas encore d'évaluation
- Michel BUTOR Sur La Princesse de Clèves, in "Répertoire Vol.1 " (1960)Document1 pageMichel BUTOR Sur La Princesse de Clèves, in "Répertoire Vol.1 " (1960)Lydia P.Blanc0% (1)
- Dear Ed ActionDocument110 pagesDear Ed ActionGabriela DincaPas encore d'évaluation
- La Ville en Tant Qu'espace Scénique (Une Étude Anthropologique)Document82 pagesLa Ville en Tant Qu'espace Scénique (Une Étude Anthropologique)Mélissa MeilhacPas encore d'évaluation
- Picabia, Francis - CaravansérailDocument162 pagesPicabia, Francis - CaravansérailHermesPas encore d'évaluation
- La Psychanalyse Dans Le Surréalisme - Jean Schuster LANE17Document7 pagesLa Psychanalyse Dans Le Surréalisme - Jean Schuster LANE17Rafael Eduardo FrancoPas encore d'évaluation
- 457 Baudelaire Sa Vie Et Ses OeuvresDocument76 pages457 Baudelaire Sa Vie Et Ses Oeuvreszeineb jemliPas encore d'évaluation
- Andre Gide Et L Aphorisme Du Style Des Idees BibliographieDocument39 pagesAndre Gide Et L Aphorisme Du Style Des Idees BibliographieZoraRosaPas encore d'évaluation
- Georges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereDocument4 pagesGeorges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereTimothée BanelPas encore d'évaluation
- La Pensée Anarchiste Victor Serge (Le Crapouillot 1938) PDFDocument11 pagesLa Pensée Anarchiste Victor Serge (Le Crapouillot 1938) PDFJefersonPas encore d'évaluation
- Maurice NADEAU Histoire Du SurréalismeDocument21 pagesMaurice NADEAU Histoire Du SurréalismeAgustina Fernández AgosteguiPas encore d'évaluation
- Littérature Et MytheDocument90 pagesLittérature Et Mytheloubna bleuPas encore d'évaluation
- Hegel Et Marx Face Au Sens de L'histoireDocument137 pagesHegel Et Marx Face Au Sens de L'histoireabderrrassoulPas encore d'évaluation
- Contes Licencieux - J de La Fontaine PDFDocument10 pagesContes Licencieux - J de La Fontaine PDFKiffer Jean NicolasPas encore d'évaluation
- BRUNEL, Pierre - Thématologie Et Littérature ComparéeDocument10 pagesBRUNEL, Pierre - Thématologie Et Littérature ComparéeBiagio D'AngeloPas encore d'évaluation
- Le Sel de La Mer PDFDocument32 pagesLe Sel de La Mer PDFsamir hamadPas encore d'évaluation
- Étude Psychocritique, Jungienne, de French TownDocument14 pagesÉtude Psychocritique, Jungienne, de French Townzeugma2010Pas encore d'évaluation
- LAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoDocument177 pagesLAPPRAND M (2020) Pourquoi L'oulipoAlexandre GuimarãesPas encore d'évaluation
- Racine Et Shakspeare (Sic) (... ) Stendhal (1783-1842) bpt6k6931h PDFDocument423 pagesRacine Et Shakspeare (Sic) (... ) Stendhal (1783-1842) bpt6k6931h PDFJulianPas encore d'évaluation
- L École Du Désenchantement Sainte Beuve Nodier Annas Archive Zlib 5513655Document628 pagesL École Du Désenchantement Sainte Beuve Nodier Annas Archive Zlib 5513655Augusto DardePas encore d'évaluation
- Au Croisement de Maurice Blanchot Et de Francis PongeDocument12 pagesAu Croisement de Maurice Blanchot Et de Francis PongeCrisisDeLaPresenciaPas encore d'évaluation
- Reel Irreel Chez PerecDocument51 pagesReel Irreel Chez PerecAnonymous saZrl4OBl4Pas encore d'évaluation
- Le Realisme Travesti Ou L'illusion de La Realite Dans Le Roman Sphinx D'anne Garreta - Julie Lachapelle PDFDocument125 pagesLe Realisme Travesti Ou L'illusion de La Realite Dans Le Roman Sphinx D'anne Garreta - Julie Lachapelle PDFAnonymous IC3j0ZSPas encore d'évaluation
- Pierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesDocument32 pagesPierre Pachet /// Habilitation À Diriger Des RecherchesPierrePachetPas encore d'évaluation
- Litterature RanciereDocument3 pagesLitterature RanciereNoël Pécout100% (1)
- Francois de MalherbeDocument4 pagesFrancois de Malherbemaki9550% (2)
- Revue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresDocument304 pagesRevue Formules, Revue Des Littératures À Contraintes #5 Pastiches Collages Et Autres ReecrituresSCHIAVETTA Angel BernardoPas encore d'évaluation
- Bessiere J. - Litterature Comparee Et Critique Litteraire ContemporaineDocument9 pagesBessiere J. - Litterature Comparee Et Critique Litteraire ContemporaineJames CarroPas encore d'évaluation
- (Faux Titre No. 310) Yourcenar, Marguerite - Blanchet-Douspis, Mireille-L'Influence de L'histoire Contemporaine Dans L'œuvre de Marguerite Yourcenar-Rodopi (2008)Document514 pages(Faux Titre No. 310) Yourcenar, Marguerite - Blanchet-Douspis, Mireille-L'Influence de L'histoire Contemporaine Dans L'œuvre de Marguerite Yourcenar-Rodopi (2008)Anna BenchimolPas encore d'évaluation
- Octave Mirbeau, Un FouDocument5 pagesOctave Mirbeau, Un FouAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- La Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)Document6 pagesLa Géocritique Selon Westphal (Note de Lecture)houcine720% (1)
- Pierre Michel, Octave Mirbeau Et Oscar WildeDocument6 pagesPierre Michel, Octave Mirbeau Et Oscar WildeAnonymous 5r2Qv8aonf100% (1)
- Tzvetan Todorov Poetique de La Prose PDFDocument186 pagesTzvetan Todorov Poetique de La Prose PDFCojdepHaiti67% (3)
- A Bossert Histoire de La Littérature AllemandeDocument816 pagesA Bossert Histoire de La Littérature AllemandeAndré BlittePas encore d'évaluation
- Variations Du FRDocument3 pagesVariations Du FRCamilla PorcellaPas encore d'évaluation
- Riquet A La HouppeDocument8 pagesRiquet A La Houppeapi-349870807Pas encore d'évaluation
- AllitérationDocument9 pagesAllitérationyan.nickPas encore d'évaluation
- Anthropo Et Lumières PDFDocument232 pagesAnthropo Et Lumières PDFduel9Pas encore d'évaluation
- Sec XVII Istoria Literaturii FrancezeDocument60 pagesSec XVII Istoria Literaturii FrancezeGabriela Floare100% (1)
- Analyse Automne MaladeDocument6 pagesAnalyse Automne Maladeem adPas encore d'évaluation
- Istoria Literaturii Franceze - IluminismulDocument69 pagesIstoria Literaturii Franceze - IluminismulNicoleta Dragoman100% (1)
- La Vie LittéraireDocument721 pagesLa Vie LittérairebleitesPas encore d'évaluation
- Lucía Campanella, "Le Journal D'une Femme de Chambre" Et "Puertas Adentro" de Florencio Sánchez: Rencontre Interocéanique de Deux Écrivains AnarchisantsDocument19 pagesLucía Campanella, "Le Journal D'une Femme de Chambre" Et "Puertas Adentro" de Florencio Sánchez: Rencontre Interocéanique de Deux Écrivains AnarchisantsAnonymous 5r2Qv8aonfPas encore d'évaluation
- Léry Ou Le Rire de L'indienDocument20 pagesLéry Ou Le Rire de L'indienMark CohenPas encore d'évaluation
- Milner - Les Paradoxes Du SolitaireDocument10 pagesMilner - Les Paradoxes Du Solitaireoutof_spacePas encore d'évaluation
- Dracula B1 - Bram Stoker PDFDocument51 pagesDracula B1 - Bram Stoker PDFRicardoPas encore d'évaluation
- George Blin, Stendhal Et Les Problèmes Du RomanDocument354 pagesGeorge Blin, Stendhal Et Les Problèmes Du RomanLarisa Elena TimoftePas encore d'évaluation
- Clement Rosset Le Reel Traite de LidiotieDocument138 pagesClement Rosset Le Reel Traite de LidiotiesocphilPas encore d'évaluation
- Salvador DalíDocument29 pagesSalvador DalífranckPas encore d'évaluation
- Jarry, Alfred - Gestes - Et - Opinions - Du - Docteur - (... ) PDFDocument333 pagesJarry, Alfred - Gestes - Et - Opinions - Du - Docteur - (... ) PDFAntonio Jose Mendez BurguillosPas encore d'évaluation
- Cours MontaigneDocument9 pagesCours MontaigneCharlotte ORSATIPas encore d'évaluation
- Commentaire Lettres PersannesDocument2 pagesCommentaire Lettres Persannessarah0405Pas encore d'évaluation
- Tzvetan Todorov Les Categories Du Recit LitteraireDocument27 pagesTzvetan Todorov Les Categories Du Recit LitteraireHossam EddinPas encore d'évaluation
- Lettres Persanes Notes de LectureDocument6 pagesLettres Persanes Notes de LectureAnnelise NdourPas encore d'évaluation
- Aline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDocument328 pagesAline Mura-Brunel - Silences Du Roman - Balzac Et Le Romanesque Contemporain (Faux Titre 252) (2004) PDFDhafer OuazPas encore d'évaluation
- Jeanluc Nancy Hegel Linquietude Du Negatif 1Document157 pagesJeanluc Nancy Hegel Linquietude Du Negatif 1Timothée BanelPas encore d'évaluation
- Communaute, Immunite, Biopoutique: Repenser Les Termes de La PolitiqueDocument252 pagesCommunaute, Immunite, Biopoutique: Repenser Les Termes de La PolitiqueTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Jeanluc Nancy Le Sens Du MondeDocument254 pagesJeanluc Nancy Le Sens Du MondeTimothée Banel100% (1)
- MIA (Français) - Engels - Principes Du CommunismeDocument14 pagesMIA (Français) - Engels - Principes Du CommunismeTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de FranceDocument20 pagesPresses Universitaires de FranceTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Georges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereDocument4 pagesGeorges Didihuberman Minima Lumina Phenomenologie Et Politique de La LumiereTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Maurice Maueu Jean Borreil La Raison de LautreDocument208 pagesMaurice Maueu Jean Borreil La Raison de LautreTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Karl Marx Manuscrits de 1844 1Document253 pagesKarl Marx Manuscrits de 1844 1Timothée BanelPas encore d'évaluation
- AGAMBEN Studenti 2017Document5 pagesAGAMBEN Studenti 2017Timothée BanelPas encore d'évaluation
- Realisme CapitalisteDocument96 pagesRealisme CapitalisteTimothée BanelPas encore d'évaluation
- Walter Benjamin Uvres I 2Document402 pagesWalter Benjamin Uvres I 2Timothée Banel100% (1)
- MythologiesDocument239 pagesMythologiesyeteneklibayripley90% (10)
- Nous Opéraïstes Le Roman de Formation Des Années Soixante en Italie (Tronti, Mario Valensi, Michel)Document208 pagesNous Opéraïstes Le Roman de Formation Des Années Soixante en Italie (Tronti, Mario Valensi, Michel)Timothée BanelPas encore d'évaluation
- Dossier Pedagogique MedeeDocument47 pagesDossier Pedagogique Medeeg.valat.rodriguesPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Les Fleurs Du Mal PDFDocument12 pagesFiche de Lecture Les Fleurs Du Mal PDFaneffeg zakaria50% (2)
- 6-Trois Expressions+francaises+pour+dire+que+vous+aimez+quelque+chose PDFDocument2 pages6-Trois Expressions+francaises+pour+dire+que+vous+aimez+quelque+chose PDFJaoud RaissPas encore d'évaluation
- La Princesse de Clèves de Mme de La: Fayette Le Renoncement Au DucDocument4 pagesLa Princesse de Clèves de Mme de La: Fayette Le Renoncement Au DucSanaa MarinaPas encore d'évaluation
- A Poison Tree... (Cité Dans The Originals) - SolitudesDocument1 pageA Poison Tree... (Cité Dans The Originals) - Solitudesparoliers prim's100% (1)
- D&D 5 - Demi-OrcDocument2 pagesD&D 5 - Demi-OrcSisy CheroPas encore d'évaluation
- Celui Qui N'en Faisait Qu'à Sa Tête @lecturefrDocument3 pagesCelui Qui N'en Faisait Qu'à Sa Tête @lecturefrlila bPas encore d'évaluation
- Le Registres LittérairesDocument20 pagesLe Registres LittérairesRita Abou Tayeh100% (1)
- Pourquoi Le Discours Amoureux Est-Il Aussi Triste ?Document2 pagesPourquoi Le Discours Amoureux Est-Il Aussi Triste ?Aya BellaPas encore d'évaluation
- NOUVELLE de Annie LukandoDocument5 pagesNOUVELLE de Annie LukandoPlume vivantePas encore d'évaluation
- fiches le chevalier doubleDocument22 pagesfiches le chevalier doubleahmed taffachPas encore d'évaluation
- Francois Decouvre Le Village de Son AmiDocument5 pagesFrancois Decouvre Le Village de Son AmimostafaPas encore d'évaluation
- Idees Activités PHONOLOGIE GSDocument8 pagesIdees Activités PHONOLOGIE GSLeón JeanPas encore d'évaluation
- Kateb Yacine 0Document128 pagesKateb Yacine 0mouradPas encore d'évaluation
- الإمتحان المحلي للفرنسية 2018 للثالثة إعدادي أحرار-جهة سوس ماسة درعةDocument2 pagesالإمتحان المحلي للفرنسية 2018 للثالثة إعدادي أحرار-جهة سوس ماسة درعةMoha ElcasawiPas encore d'évaluation
- 1 A. BAC. Evaluation Diagnostique - 1Document4 pages1 A. BAC. Evaluation Diagnostique - 1Walid Rhabouqi100% (1)
- PG, Sqce 2, Texte 8 (LL)Document4 pagesPG, Sqce 2, Texte 8 (LL)Hadrien CostaPas encore d'évaluation
- Ce 8 Fra 1 Sem 0809Document2 pagesCe 8 Fra 1 Sem 0809Fatima Zahra BahidaPas encore d'évaluation
- Latin 3eme Sequence Empereurs RomainsDocument4 pagesLatin 3eme Sequence Empereurs RomainsmiailliePas encore d'évaluation
- Commentaire Composé de "Famille", Jacques Prévert: PlanDocument3 pagesCommentaire Composé de "Famille", Jacques Prévert: PlanleMoutonPas encore d'évaluation
- TnbreuseDocument122 pagesTnbreusefollowingnoctiusPas encore d'évaluation
- Cours Et Exercices 2011 2012Document52 pagesCours Et Exercices 2011 2012Léon NGOMSU ITEMBEPas encore d'évaluation
- 2AS-Compo2-Devenir Citadin - 2021Document2 pages2AS-Compo2-Devenir Citadin - 2021Sï HēmPas encore d'évaluation
- Robiou (Félix), Questions Homériques, Avec 3 Cartes, 1876.Document128 pagesRobiou (Félix), Questions Homériques, Avec 3 Cartes, 1876.Francophilus VerusPas encore d'évaluation
- Voyez Le Seigneur Est Bon (Berthier)Document2 pagesVoyez Le Seigneur Est Bon (Berthier)henricus1712Pas encore d'évaluation
- La Peau de Chagrin, L'agonie de RaphaelDocument8 pagesLa Peau de Chagrin, L'agonie de RaphaelHind SouiriPas encore d'évaluation
- BenhaimiDocument11 pagesBenhaimiChaima YalaouiPas encore d'évaluation
- Albert COHEN, Belle Du Seigneur, 1968Document1 pageAlbert COHEN, Belle Du Seigneur, 1968lesliebejaouiPas encore d'évaluation
- TCLSH4 ControleDocument3 pagesTCLSH4 ControleOmar BroukPas encore d'évaluation
- Composition 2 3am 2020Document2 pagesComposition 2 3am 2020Leslous Fella100% (1)