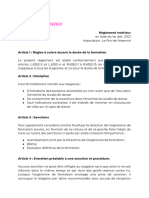Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Articles Bonne Pratique Antibiotiques
Transféré par
Jacques AlbertiniTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Articles Bonne Pratique Antibiotiques
Transféré par
Jacques AlbertiniDroits d'auteur :
Formats disponibles
Recommandations
de bonne pratique
Prescription des antibiotiques
en pratique bucco-dentaire
’AFSSAPS a élaboré ces recom- stomatologue, chirurgien maxillo-fa- ma, chirurgien-dentiste (Paris), Fran-
L mandations de bonne pratique à
partir des évaluations d’un groupe
cial (Villeneuve-Saint-Georges), Vian-
ney Descroix, chirurgien-dentiste (Pa-
çoise Goebel, AFSSAPS, Laurent
Nawroki, chirurgien-dentiste (Lille),
multidisciplinaire d’experts présidé ris), Luc Dubreuil, microbiologiste Anna Pelibossian, AFSSAPS, Isabel-
par Monsieur Philippe Lesclous, chi- (Lille), Nathalie Dumarcet, AFSSAPS, le Pellanne, AFSSAPS, Wilhelm Per-
rurgien-dentiste (Montrouge) et com- Xavier Duval, infectiologue (Paris), tot, chirurgien-dentiste (Paris), Éric
posé de : Frédéric Duffau, chargé de Nadine Forest, chirurgien-dentiste Senneville, infectiologue (Tourcoing),
projet, chirurgien-dentiste (Paris), (Neuvy-le-Roi), Pierre Gangloff, chi- Michel Sixou, chirurgien-dentiste
Jean-Jacques Bensahel, chirurgien- rurgien-dentiste (Nancy), Michel Gar- (Toulouse), Henri Tenenbaum, chi-
dentiste (Nice), Patrick Blanchard, re, infectiologue (Brest), Alice Ger- rurgien-dentiste (Strasbourg).
Principaux messages
Il convient de réserver la prescription des antibiotiques aux situations pour lesquelles ils sont nécessaires.
En médecine bucco-dentaire, les antibiotiques sont réservés à des situations peu fréquentes.
L’utilisation d’antibiotiques ne peut ni pallier l’insuffisance d’hygiène orale, ni se substituer aux règles universelles d’hygiène
et d’asepsie inhérentes à toute pratique de soins.
L’hygiène orale revêt un caractère fondamental dans la prévention des infections en médecine bucco-dentaire. Les patients
doivent recevoir une information adaptée en ce sens.
Il convient de distinguer les patients :
– de la population générale, de loin les plus nombreux (absence d’immunodépression ou de cardiopathie à haut risque
d’endocardite infectieuse) ;
– immunodéprimés (après évaluation soigneuse avec les médecins concernés) ;
– à haut risque d’endocardite infectieuse (prothèse valvulaire, antécédent d’endocardite infectieuse, cardiopathie
congénitale cyanogène). Dorénavant, chez les patients présentant une cardiopathie à risque modéré (autres
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
278
valvulopathies, autres cardiopathies congénitales, prolapsus de la valve mitrale…) et les patients porteurs d’une prothèse
articulaire, l’antibiothérapie prophylactique n’est plus indiquée lorsqu’un geste bucco-dentaire est réalisé.
L’antibiothérapie prophylactique :
– est recommandée selon le risque infectieux du patient et l’acte invasif pratiqué ;
– est instaurée pour limiter un risque d’endocardite infectieuse ou pour limiter un risque d’infection locale et son extension
éventuelle ;
– son champ d’indication et sa durée de prescription ont été fortement réduits depuis les précédentes recommandations ;
– est recommandée chez le patient à haut risque d’endocardite infectieuse, pour tout acte dentaire impliquant une
manipulation de la gencive (par exemple le détartrage) ou de la région péri-apicale de la dent et en cas d’effraction de la
muqueuse orale (excepté l’anesthésie locale ou locorégionale) ;
– consiste en une prise unique dans l’heure qui précède l’acte :
- amoxicilline : 2 g chez l’adulte, 50 mg/kg chez l’enfant (sans dépasser la dose adulte) ;
- en cas d’allergie ou d’intolérance aux b-lactamines, clindamycine : 600 mg chez l’adulte, 20 mg/kg chez l’enfant à partir
de 6 ans (sans dépasser la dose adulte).
L’antibiothérapie curative :
– est subordonnée à la mise en évidence d’un foyer infectieux ;
– ne doit ni différer, ni se substituer au traitement étiologique non médicamenteux, en particulier chirurgical, du foyer
infectieux ;
– en présence d’une infection accompagnée de fièvre, trismus, adénopathie ou œdème persistant ou progressif, sera
toujours indiquée en complément du traitement local adéquat.
Introduction biotiques dans un domaine spéci- ni pallier l’insuffisance d’hygiène ora-
fique, la médecine bucco-dentaire, le du patient, ni se substituer aux
L’AFSSAPS actualise ses recom- s’adressent à tous les profession- règles universelles d’hygiène et
mandations sur la prescription des nels de santé (un glossaire est an- d’asepsie inhérentes à toute pra-
antibiotiques en odontologie et en nexé à l’argumentaire pour éclairer tique de soins.
stomatologie initialement élaborées le sens de certains termes spéci- L’utilisation des antibiotiques com-
en 2001 en raison, d’une part, de fiques). La chirurgie maxillo-faciale porte des risques individuels et col-
l’évolution préoccupante de la ré- et la chirurgie ORL ont été exclues lectifs ; il convient de les prescrire
sistance aux antibiotiques qui doit de ce document. de manière parcimonieuse et ration-
conduire à réserver la prescription L’antibiotique peut être prescrit à nelle, donc dans des situations cli-
d’antibiotiques aux situations pour des fins curatives (antibiothérapie niques pour lesquelles l’étiologie
lesquelles ils sont nécessaires et, curative) ou à des fins préventives bactérienne est fortement suspec-
d’autre part, de nouveaux arguments (antibiothérapie prophylactique). tée et l’efficacité des antibiotiques
scientifiques, en particulier dans les En médecine bucco-dentaire, les démontrée ou fortement présumée.
domaines de la prophylaxie des en- antibiotiques sont réservés à des La notion de balance bénéfice/risque
docardites infectieuses et de l’anti- situations peu fréquentes. Le trai- a été retenue, en considérant que le
biothérapie prophylactique des por- tement étiologique d’un foyer in- bénéfice se situe à l’échelon indivi-
teurs de prothèse articulaire. De plus, fectieux est le plus souvent non duel (prévenir ou traiter une infec-
l’apport des antibiotiques dans cer- médicamenteux. tion), tandis que le risque se situe à
taines situations aujourd’hui parfai- L’hygiène orale revêt un caractère l’échelon individuel et collectif (pré-
tement identifiées (traitement des fondamental dans la prévention des venir ou minimiser le développement
parodontites, avulsion des dents de infections en médecine bucco- de souches bactériennes résistantes
sagesse mandibulaires incluses) est dentaire. Dès lors, une éducation aux antibiotiques).
désormais mieux documenté. systématique et répétée doit être Ces recommandations ont été ma-
Ces recommandations, bien que délivrée au patient. En aucun cas, joritairement établies sur la base
portant sur la prescription des anti- l’utilisation d’antibiotiques ne peut d’avis d’experts, compte tenu de la
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
279
Recommandations de bonne pratique
faiblesse du nombre d’études ayant pliquées au cours d’une pathologie Population générale
un niveau de preuve suffisant selon donnée, du spectre d’activité anti-
les standards actuels de l’évalua- bactérienne et des paramètres phar- Ce groupe comprend tous les pa-
tion scientifique, soulignant ainsi la macocinétiques et pharmacodyna- tients qui ne présentent aucun des
nécessité de développer la recherche miques des molécules. Il doit aussi facteurs de risque décrits dans les
clinique dans le domaine de la pres- tenir compte du critère de gravité de deux catégories suivantes, en te-
cription des antibiotiques en méde- la pathologie et des antécédents du nant compte du fait qu’aucun pa-
cine bucco-dentaire. Elles sont prin- patient, en particulier de nature al- tient n’est totalement exempt du
cipalement fondées sur la flore lergique. Les prélèvements micro- risque de développer une infection.
bactérienne des sites infectés, sur biologiques ne sont pas justifiés Dorénavant, chez les patients pré-
des paramètres pharmacocinétiques en pratique courante, en raison du sentant une cardiopathie à risque
et pharmacodynamiques des anti- peu d’intérêt qu’ils présentent. modérée (autres valvulopathies,
biotiques ainsi que sur l’expérience Dans tous les cas, ces recomman- autres cardiopathies congénitales,
clinique. dations sont générales et ne pour- prolapsus de la valve mitrale…), l’an-
Ainsi, il est possible que certains an- raient se substituer au jugement cli- tibiothérapie prophylactique n’est
tibiotiques ayant une autorisation de nique du praticien face aux situations plus indiquée lorsqu’un geste buc-
mise sur le marché (AMM) dans le individuelles. co-dentaire est réalisé.
traitement des infections envisagées Les données issues de la littérature
ici ne soient pas recommandés dans scientifique ne permettent plus de
ce texte et inversement, et/ou que Notion de patient retenir les patients porteurs d’une
des schémas d’administration dif- à risque d’infection prothèse articulaire dans un groupe
fèrent des mentions légales actuel- susceptible de développer une in-
lement en vigueur. La prescription antibiotique doit être fection au niveau de la prothèse lors-
Dans la mesure où l’information décidée en fonction du risque pré- qu’un geste bucco-dentaire est réa-
contenue dans les AMM des spé- sumé du patient de développer une lisé. En conséquence, pour les
cialités recommandées est suscep- infection. Chaque patient présente patients porteurs d’une prothèse or-
tible d’évoluer, il convient de s’as- un niveau de risque infectieux qui thopédique, aucune indication à l’an-
surer, au moment de la prescription lui est propre. Selon la littérature tibiothérapie prophylactique des
de l’antibiotique, notamment du res- scientifique et les avis d’experts, des actes bucco-dentaires n’a été rete-
pect des contre-indications, mises groupes à risque ont été détermi- nue (grade C). Pour autant, cela ne
en garde et précautions d’emploi, nés en fonction du patient, des actes remet pas en question la nécessité
en ayant un regard sur les interac- bucco-dentaires et du risque de sur- de réaliser un examen bucco-den-
tions médicamenteuses. Les recom- venue de bactériémies. taire complet chez les patients can-
mandations et l’information en vi- Compte tenu de ces éléments, il a didats à la pose d’une prothèse ar-
gueur relatives à la sécurité d’emploi été décidé de distinguer trois types ticulaire afin d’éliminer les foyers
de ces spécialités sont disponibles de patients : infectieux locaux.
sur les sites Internet de : – la population générale, de loin la
– l’Agence française de sécurité catégorie englobant le plus grand Patients immunodéprimés
sanitaire des produits de santé nombre de patients ;
(AFSSAPS) : www.afssaps.fr ; – les patients immunodéprimés, à Dans ce groupe, le risque infectieux
– l’Agence européenne des médi- risque d’infection locale et de son est considéré comme lié à tout fac-
caments (EMA) : www.ema.euro- extension éventuelle, après éva- teur responsable d’une immunodé-
pa.eu. luation soigneuse avec les méde- pression, qu’elle soit congénitale ou
Le choix des antibiotiques pour le cins concernés ; acquise. En l’absence de critères
traitement des infections bucco-den- – les patients à haut risque d’endo- objectifs, biologiques ou cliniques,
taires doit être fait en tenant comp- cardite infectieuse. permettant de l’évaluer, la décision
te des bactéries habituellement im- d’inclure un patient dans cette
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
280
catégorie de risque doit être prise de la dent par les tests adéquats, Antibiothérapie
en bonne intelligence entre, d’une sous digue, en une seule séance, en prophylactique
part, le chirurgien-dentiste ou le sto- étant sûr que la totalité de la lumiè-
matologue et, d’autre part, les mé- re canalaire est accessible. Ce trai- L’antibiothérapie prophylactique (an-
decins concernés. tement doit donc être réservé aux tibioprophylaxie) consiste en l’ad-
dents monoradiculées et, à la rigueur, ministration d’un antibiotique dans
Patients à haut risque à la première prémolaire si les deux l’objectif de prévenir le développe-
d’endocardite infectieuse canaux sont accessibles. La sépara- ment d’une infection locale, géné-
tion des racines est un acte à éviter rale ou à distance. Elle s’utilise donc
Ce groupe réunit uniquement les pa- autant que possible et n’est autori- en l’absence de tout foyer infectieux
tients présentant une cardiopathie sée qu’en l’absence de toute attein- et consiste en l’administration par
définie comme étant à haut risque te parodontale. Les pulpopathies, les voie systémique d’une dose unique
d’endocardite infectieuse (enca- parodontopathies et les traumatismes d’antibiotique dans l’heure qui pré-
dré 1). Par conséquent, ce risque nécessitent l’extraction. cède l’acte invasif. Il importe de ré-
d’infection exclut les patients pré- server une telle prescription aux si-
sentant une cardiopathie définie tuations pour lesquelles elle est
comme étant à risque faible ou mo- Information et recommandée (tableaux 1 à 7).
déré d’endocardite infectieuse (par éducation du patient
exemple l’insuffisance mitrale). Actes non invasifs
Rappel des actes contre-indiqués Le patient doit systématiquement être
chez les patients à haut risque d’en- informé qu’une consultation chez son Quel que soit le niveau de risque in-
docardite infectieuse : médecin est nécessaire en cas d’ap- fectieux du patient, l’antibiothérapie
– anesthésie intraligamentaire ; parition de symptômes infectieux gé- prophylactique n’est pas indiquée
– traitement endodontique des néraux à la suite d’un acte invasif, pour la réalisation d’actes non in-
dents à pulpe non vivante, y com- que celui-ci ait fait l’objet ou non d’une vasifs, en particulier pour les actes
pris la reprise de traitement ca- antibiothérapie prophylactique. listés ci-dessous (grade C pour le
nalaire ; Par ailleurs, toute prescription anti- patient à haut risque d’endocardite
– traitement endodontique des biotique doit être clairement expli- infectieuse, sinon accord profession-
dents à pulpe vivante en plusieurs quée au patient (posologie et durée nel) :
séances ou sans champ opéra- du traitement). En effet, la stratégie – actes de prévention non san-
toire (digue) ; de prescription repose sur la com- glants ;
– amputation radiculaire ; plète compréhension du patient. – soins conservateurs ;
– transplantation ; – soins prothétiques non sanglants ;
– réimplantation ; – dépose postopératoire de su-
– chirurgie péri-apicale ; Antibiothérapie tures ;
– chirurgie parodontale ; par voie locale – pose de prothèses amovibles ;
– chirurgie implantaire et des péri- – pose ou ajustement d’appareils
implantites ; L’antibiothérapie par voie locale, à orthodontiques ;
– mise en place de matériaux de libération immédiate ou contrôlée, – prise de radiographies dentaires.
comblement ; n’est pas indiquée en odontologie
– chirurgie pré-orthodontique des et en stomatologie en raison de la Actes invasifs
dents incluses ou enclavées. faiblesse du niveau de preuve en
Les soins endodontiques chez les termes de bénéfice thérapeutique Est considéré comme invasif un acte
patients du groupe à haut risque d’en- et d’une sécurité d’emploi problé- susceptible d’induire une infection
docardite infectieuse doivent être ex- matique par risque de sélection de locale, à distance ou générale.
ceptionnels. Ils ne peuvent être réa- mutants résistants (accord profes- Pour la population générale, la plu-
lisés qu’après vérification de la vitalité sionnel). part des actes invasifs ne nécessi-
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
281
Recommandations de bonne pratique
te pas d’antibiothérapie prophylac- Chez le patient à haut risque d’en- (par exemple le détartrage) ou de
tique (accord professionnel). docardite infectieuse, l’antibiothé- la région péri-apicale de la dent ;
Chez le patient immunodéprimé, rapie prophylactique est recomman- – en cas d’effraction de la muqueu-
l’antibiothérapie prophylactique dé- dée (grade B) : se orale (exceptée l’anesthésie lo-
pendra des situations cliniques (ac- – pour tout acte dentaire impliquant cale ou locorégionale).
cord professionnel). une manipulation de la gencive
Encadré 1. Cardiopathies à haut risque d’endocardite infectieuse
• Prothèse valvulaire (mécanique ou bioprothèse) ou matériel étranger pour une chirurgie valvulaire conservatrice (anneau
prothétique…).
• Antécédent d’endocardite infectieuse.
• Cardiopathie congénitale cyanogène :
– non opérée ou dérivation chirurgicale pulmonaire/systémique ;
– opérée, mais présentant un shunt résiduel ;
– opérée avec mise en place d’un matériel prothétique par voie chirurgicale ou transcutanée, sans fuite résiduelle,
seulement dans les 6 mois suivant la mise en place ;
– opérée avec mise en place d’un matériel prothétique par voie chirurgicale ou transcutanée avec shunt résiduel.
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Mise en place d’une digue – – RB
Soins endodontiques :
• traitement des dents à pulpe vitale – R RB
• traitement des dents à pulpe nécrosée – R Acte
contre-indiqué
• reprise de traitement* – R Acte
contre-indiqué
Chirurgie péri-apicale :
• sans comblement à l’aide d’un substitut osseux –A R Acte
contre-indiqué
• avec comblement à l’aide d’un substitut osseux – R Acte
contre-indiqué
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Avec ou sans lésion inflammatoire périradiculaire d’origine endodontique (LIPOE).
Tableau 1. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique en endodontie.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
282
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Actes et soins parodontaux :
• détartrage avec et sans surfaçage radiculaire – R RB
• sondage parodontal – R RB
Chirurgie parodontale :
• allongement de couronne clinique – R* Acte
contre-indiqué
• chirurgie de la poche :
– lambeau d’accès –C R* Acte
contre-indiqué
– comblement et greffes osseuses – R* Acte
contre-indiqué
– membrane de régénération parodontale –B R* Acte
contre-indiqué
– protéines dérivées de la matrice amélaire –B R* Acte
contre-indiqué
• chirurgie plastique parodontale :
– lambeau déplacé – R* Acte
contre-indiqué
– greffe gingivale – R* Acte
contre-indiqué
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, le rapport entre bénéfice de l’intervention et risque infectieux devra être pris en compte.
Tableau 2. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique en parodontologie.
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Avulsion dentaire :
• dent sur arcade, alvéolectomie, séparation de racines – R RB
• amputation radiculaire – R Acte
contre-indiqué
• dent de sagesse mandibulaire incluse RA R RB
• dent incluse (hors dent de sagesse mandibulaire), dent en
désinclusion, germectomie R R RB
• chirurgie pré-orthodontique des dents incluses ou enclavées R R Acte
contre-indiqué
Autotransplantation R R* Acte
contre-indiqué
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, le rapport entre bénéfice de l’intervention et risque infectieux devra être pris en compte.
Tableau 3. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique pour les avulsions dentaires et transplantations.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
283
Recommandations de bonne pratique
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Chirurgie osseuse
(hors actes de chirurgie maxillo-faciale et ORL) R R* RB
Exérèse des tumeurs et pseudo-tumeurs bénignes de la
muqueuse buccale – R* RB
Frénectomie – R* RB
Biopsie des glandes salivaires accessoires – R* RB
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, l’intérêt de l’antibiothérapie prophylactique doit être déterminé en fonction du risque infectieux.
Tableau 4. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique pour les chirurgies des tissus durs et des tissus mous.
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Chirurgie pré-implantaire :
• élévation du plancher sinusien avec ou sans matériau de R R* Acte
comblement contre-indiqué
• greffe osseuse en onlay RC R* Acte
contre-indiqué
• membrane de régénération osseuse ou matériau de R R* Acte
comblement contre-indiqué
Chirurgie implantaire :
• pose de l’implant – R* Acte
contre-indiqué
• dégagement de l’implant – R* Acte
contre-indiqué
Chirurgie des péri-implantites :
• lambeau d’accès, comblement, greffe osseuse, membrane – R* Acte
contre-indiqué
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, le rapport entre bénéfice de l’intervention et risque infectieux devra être pris en compte.
Tableau 5. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique pour les actes chirurgicaux en implantologie.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
284
Patient
Actes bucco-dentaires invasifs À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Anesthésie locale ou locorégionale dans un tissu non infecté – – –
Anesthésie locale intraligamentaire – R* Acte
contre-indiqué
Soins prothétiques à risque de saignement – R RB
Soins orthodontiques à risque de saignement – R RB
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, une anesthésie locale ou locorégionale devra être préférée à l’anesthésie intraligamentaire.
Tableau 6. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique pour les autres actes bucco-dentaires invasifs.
Prise unique dans l’heure qui précède l’intervention
Situation Antibiotique
Adulte Enfant
Posologies quotidiennes Posologies quotidiennes
établies pour un adulte à la établies pour un enfant à la
fonction rénale normale fonction rénale normale,
sans dépasser la dose
adulte
Sans allergie aux Amoxicilline 2g 50 mg/kg
pénicillines VO ou IV VO ou IV
En cas d’allergie aux Clindamycine 600 mg 20 mg/kg
pénicillines VO ou IV VO* ou IV
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Chez le patient immunodéprimé, une anesthésie locale ou locorégionale devra être préférée à l’anesthésie intraligamentaire.
Tableau 7. Recommandations de prescription d’une antibiothérapie prophylactique pour les autres actes bucco-dentaires invasifs.
Antibiothérapie Le recours à une antibiothérapie cu- fièvre, trismus, adénopathie ou œdè-
curative rative se fera toujours en complé- me persistant ou progressif, l’anti-
ment du traitement local adéquat biothérapie curative sera toujours
L’antibiothérapie curative consiste en (débridement, drainage, chirurgie), indiquée en complément du traite-
l’administration d’antibiotique(s) par en particulier dans le traitement des ment local adéquat. Elle ne devra ni
voie systémique avec pour objectif maladies parodontales et des péri- différer, ni se substituer au traite-
de traiter une infection (tableaux 8 implantites. ment étiologique non médicamen-
à 11). Il importe de réserver une tel- Quel que soit le niveau de risque in- teux, en particulier chirurgical, du
le prescription aux situations pour fectieux du patient, en présence foyer infectieux (accord profes -
lesquelles elle est recommandée. d’une infection accompagnée de sionnel).
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
285
Recommandations de bonne pratique
Patient
Modalités de
Pathologies d’origine infectieuse À haut risque prescription
Population
Immunodéprimé d’endocardite (voir tableaux
générale
infectieuse 12 et 13)
Caries – – –
Pulpopathies et complications
périradiculaires :
• pulpopathies (pulpites réversibles ou
irréversibles) – – –*
• complications de la pathologie pulpaire † – – SO*
– : prescription non recommandée (accord professionnel).
SO : sans objet, car l’acte local adapté est contre-indiqué.
* Chez le patient à haut risque d’endocardite infectieuse, le traitement endodontique des dents à pulpe non vivante, y compris la reprise de traitement
endodontique, et celui des dents à pulpe vivante en plusieurs séances ou sans champ opératoire (digue) sont contre-indiqués (accord pro fessionnel).
Tableau 8. Antibiothérapie curative dans le traitement des caries, pulpopathies et complications péri-apicales.
Patient
Modalités de
Pathologies d’origine infectieuse À haut risque prescription
Population
Immunodéprimé d’endocardite (voir tableaux
générale
infectieuse 12 et 13)
Gingivite induite par la plaque dentaire
Parodontites (débridement mécanique) :
• chronique – – –
• agressive localisée R R R III ou IV
• agressive généralisée RA R R IV
• « réfractaire au traitement » R R R *
Maladies parodontales nécrosantes R R R II
Parodontites (traitement chirurgical) – – SO
Abcès parodontal – R R I
Lésion combinée endo-parodontale – – SO**
Infection locale relative aux protocoles de
régénération parodontale –*** R**** SO I
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* Parodontite réfractaire au traitement parodontal correctement conduit (débridement mécanique avec ou sans antibiothérapie curative par voie systé-
mique, puis traitement chirurgical si les résultats du débridement mécanique sont jugés insuffisants lors de la séance de réévaluation). Choix de la molécule
antibiotique sur argument bactériologique.
SO : sans objet, car l’acte local adapté est contre-indiqué.
** Chez le patient à haut risque d’endocardite infectieuse, en présence d’une lésion endo-parodontale responsable d’une nécrose pulpaire, le traitement
consistera en l’avulsion de la dent.
*** En l’absence d’argument scientifique, l ’utilité de l’antibiothérapie curative n’est pas établie.
**** Tenir compte du rapport entre bénéfice de l’intervention et risque infectieux.
Tableau 9. Antibiothérapie curative dans le traitement des maladies parodontales.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
286
Patient
Modalités de
Pathologies d’origine infectieuse À haut risque prescription
Population
Immunodéprimé d’endocardite (voir tableaux
générale
infectieuse 12 et 13)
Mucosite péri-implantaire – – –
Péri-implantite –* R R I
– : prescription non recommandée (accord professionnel).
R : prescription recommandée (accord professionnel).
* En l’absence d’argument scientifique, l’utilité de l’antibiothérapie curative n’est pas établie.
Tableau 10. Antibiothérapie curative dans le traitement des pathologies péri-implantaires.
Patient
Modalités de
Pathologies d’origine infectieuse À haut risque prescription
Population
Immunodéprimé d’endocardite (voir tableaux
générale
infectieuse 12 et 13)
Accidents d’éruption dentaire :
• dent temporaire – –* R I
• dent permanente (péricoronarite) R R R I
Cellulite :
• aiguë (circonscrite, diffusée, diffuse) R R R I
• chronique – R R **
• actinomycose cervico-faciale R R R ***
Ostéite :
• alvéolite suppurée R R R I****
• ostéite (maxillo-mandibulaire) R R R I****
Infections bactériennes des glandes salivaires R R R I
Stomatites bactériennes R R R I
Sinusite maxillaire aiguë d’origine dentaire R R R V
– : prescription non recommandée.
R : prescription recommandée.
En indice : grade de la recommandation. Si celui-ci n’est pas indiqué, comprendre « accord professionnel ».
* En l’absence d’argument scientifique, l’utilité de l’antibiothérapie curative n’est pas établie.
** Sur argument bactériologique.
** Sur arguments bactériologique et anatomopathologique.
**** Jusqu’à amendement des signes infectieux loca ux.
Tableau 11. Antibiothérapie curative dans le traitement des autres infections bucco-dentaires.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
287
Recommandations de bonne pratique
Modalités de prescription Prise en charge hospitalière le validé de prescription antibiotique.
en ambulatoire Par conséquent, chez l’adulte, l’as-
Les patients présentant des signes sociation amoxicilline et métronida-
Le respect des schémas posolo- infectieux locaux associés à un re- zole est recommandée pour traiter
giques (doses et durées de traite- tentissement général, en particulier une ostéonécrose d’origine médi-
ment) est primordial (tableaux 12 sur un terrain à risque d’infection gé- camenteuse surinfectée, à raison
et 13). nérale, ou chez qui l’administration de 2 g d’amoxicilline par jour, en
Les schémas d’administration de par voie orale est rendue impossible, 2 prises, et de 1 500 mg de métro-
certains antibiotiques peuvent dif- devront être hospitalisés. Il en est nidazole par jour, en 2 ou 3 prises,
férer selon qu’ils sont administrés de même des patients présentant jusqu’à amendement des signes
seuls ou associés à d’autres anti- une ostéoradionécrose surinfectée. infectieux locaux. En cas d’allergie
biotiques. Le choix du traitement antibiotique aux β-lactamines chez l’adulte, la
En première intention, la monothé- relève d’un avis spécialisé. clindamycine sera prescrite à raison
rapie est généralement la règle. Pour le traitement de l’ostéonécro- de 1 200 mg/j, en 2 prises, jusqu’à
Le traitement de seconde intention se d’origine médicamenteuse sur- amendement des signes infectieux
est envisagé en cas d’échec du trai- infectée, la littérature scientifique ne locaux.
tement de première intention. permet pas de dégager un protoco-
Renvoi vers Traitement Traitement
tableaux 8 à 11 de première intention de seconde intention
I – Cas général • Amoxicilline : 2 g/j en 2 prises • Amoxicilline-acide clavulanique (rapport
• Azithromycine : 500 mg/j en 1 prise* 8/1) : de 2 g/j en 2 prises à 3 g/j en 3 prises
• Clarithromycine : 1 000 mg/j en 2 prises (dose exprimée en amoxicilline)
• Spiramycine : 9 MUI/j en 3 prises • Amoxicilline : 2 g/j en 2 prises
• Clindamycine : 1 200 mg/j en 2 prises et métronidazole : 1 500 mg/j en 2 ou 3 prises
• Métronidazole : 1 5 00 mg/j en 2 ou 3 prises
et azithromycine : 500 mg/j en 1 prise*
ou clarithromycine : 1 000 mg/j en 2 prises
ou spiramycine : 9 MUI/j en 3 prises
II – Maladies • Métronidazole : 1 500 mg/j en 2 ou 3 prises
parodontales
nécrosantes
III – Parodontite • Doxycycline : 200 mg/j en 1 prise**
agressive localisée
IV – Parodontite • Amoxicilline : 1,5 g/j en 3 prises ou 2 g/j
agressive localisée en 2 prises
ou généralisée et métronidazole : 1 500 mg/j en 2 ou 3 prises
• En cas d’allergie aux pénicillines :
métronidazole : 1 500 mg/j en 2 ou 3 prises
V – Sinusite • Amoxicilline-acide clavulanique • Pristinamycine : 2 g/j en 2 prises
maxillaire aiguë (rapport 8/1) : de 2 g/j en 2 prises à 3 g/j en
d’origine dentaire 3 prises (dose exprimée en amoxicilline)
Durée des traitements : 7 jours, sauf * et **.
* Durée du traitement : 3 jours.
** En 1 prise, à midi ou le soir, pendant le repas, au plus tard 1 heure avant le coucher ; en dessous de 60 kg, 200 g le premier jour puis 100 mg les jours sui-
vants. Durée du traitement : 14 jours.
Tableau 12. Schémas d’administration préconisés chez l’adulte (posologies quotidiennes établies pour un adulte à la fonction rénale normale).
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
288
Renvoi vers Traitement Traitement
tableaux 8 à 11 de première intention de deuxième intention
I – Cas général • Amoxicilline : 50-100 mg/kg/j en 2 prises • Amoxicilline-acide clavulanique (rapport
• Azithromycine (hors AMM) : 20 mg/kg/j en 8/1) : 80 mg/kg/j en 3 prises (dose exprimée
1 prise pendant 3 jours* en amoxicilline)
• Clarithromycine (hors AMM) : 15 mg/kg/j • Amoxicilline : 50-100 mg/kg/j en 2 prises
en 2 prises et métronidazole : 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises
• Spiramycine : 300 000 UI/kg/j en 3 prises • Mé tronidazole 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises
• Clindamycine** : 25 mg/kg/j en 3 ou 4 prises et azithromycine (hors AMM) : 20 mg/kg/j en
1 prise*
ou clarithromycine (hors AMM) : 15 mg/kg/j
en 2 prises
ou spiramycine : 300 000 UI/kg/j en 3 prises
II – Maladies • Métronidazole : 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises
parodontales
nécrosantes
III – Parodontite • Doxycycline : 4 mg/kg/j en 1 prise
agressive localisée
IV – Parodontite • Amoxicill ine : 50 à 100 mg/kg/j en 2 ou
agressive localisée 3 prises
ou généralisée et métronidazole : 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises
• En cas d’allergie aux pénicillines :
métronidazole : 30 mg/kg/j en 2 ou 3 prises
V – Sinusite • Amoxicilline-acide clavulanique • Pristinamycine** : 50 mg/kg/j en 2 prises
maxillaire aiguë (rapport 8/1) : 80 mg/kg/j en 3 prises (dose
d’origine dentaire exprimée en amoxicilline)
Durée des traitements : 7 jours, sauf * et **.
* Durée du traitement : 3 jours.
** Du fait des présentations pharmaceutiques de la clindamycine et de la pristinamycine disponibles pour la voie orale, ces antibiotiques sont recomman-
dés chez l’enfant à partir de 6 ans (prise de gélules ou de comprimés contre-indiquée chez l’enfant de moins de 6 ans, par risque de fausse route). La clinda-
mycine peut être u tilisée par voie intraveineuse chez l’enfant à partir de 3 ans.
Tableau 13. Schémas d’administration préconisés chez l’enfant (posologies quotidiennes établies pour un enfant à la fonction rénale normale, sans
dépasser la dose adulte).
Cas particuliers re (traumatismes alvéolo-dentaires, ostéonécrose d’origine médicamen-
réimplantation d’une dent luxée) ou teuse sans symptomatologie infec-
Quelques situations, traitements ou qui sont, selon le niveau de risque tieuse). Ces situations peuvent né-
pathologies offrent un terrain propi- du patient, difficiles à traiter (traite- cessiter un traitement antibiotique
ce à des infections potentielles qui ment chirurgical d’une sinusite, al- probabiliste par voie systémique (ta-
peuvent altérer le pronostic dentai- véolite sèche, ostéoradionécrose ou bleau 14 et 15).
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
289
Recommandations de bonne pratique
Patient
Cas particuliers À haut risque
Population
Immunodéprimé d’endocardite
générale
infectieuse
Traumatisme alvéolo-dentaire avec ou sans effraction
muqueuse ou osseuse – R R
Réimplantation d’une dent luxée lors d’un traumatisme –* R Acte
contre-indiqué
Communication bucco-sinusienne postopératoire récente R R R
Alvéolite sèche – – R
Prévention de l’ostéoradionécrose (en cas d’acte chirurgical
sur secteur irradié) SO R** SO
Prévention de l’ostéonécrose d’origine médicamenteuse
(en cas d’acte chirurgical) :
• bisphospho nates par voie orale – – R**
• bisphosphonates par voie intraveineuse (BPIV) R** R** R**
Ostéoradionécrose sans symptomatologie infectieuse SO – SO
Ostéonécrose d’origine médicamenteuse sans
symptomatologie infectieuse SO – SO
– : prescription non recommandée (accord professionnel).
R : prescription recommandée (accord professionnel).
* En l’absence d’argument scientifique, l’utilité de l’antibiothérapie curative n’est pas établie.
** Première prise dans l’heure qui précède l’acte chirurgical.
SO : sans objet (car le patient doit être traité comme un patient immunodéprimé).
Tableau 14. Antibiothérapie pour les cas particuliers.
Adulte Enfant
(posologies quotidiennes établies (posologies quotidiennes établies
Antibiotique
pour un adulte à la fonction rénale normale) pour un enfant à la fonction rénale normale,
sans dépasser la dose adulte)
Amoxicilline 2 g/j en 2 prises 50-100 mg/kg/j en 2 prises
VO ou IV** VO ou IV**
Clindamycine 1 200 mg/j en 2 prises 25 mg/kg/j en 3 ou 3 prises
VO ou IV** VO* ou IV**
Durée des traitements : jusqu’à cicatrisation muqueuse pour la prévention de l’ostéoradionécrose et la prévention de l’ostéonécrose d’origine médicamen-
teuse (BPIV). Sept jours pour les autres situations.
VO : voie orale.
IV : voie intraveineuse.
* Du fait de sa présentation pharmaceutique disponible pour la voie orale, la clindamycine est recommandée chez l’enfant à partir de 6 ans (prise de
gélules ou c omprimés contre-indiquée chez l’enfant de moins de 6 ans, par risque de fausse route). La clindamycine peut être utilisée par voie intravei-
neuse chez l’enfant à partir de 3 ans.
** Relais oral le plus précoce possible avec amoxicilline, ou clindamycine.
Tableau 15. Schémas d’administration préconisés pour l’antibiothérapie des cas particuliers.
Journal de Parodontologie & d’Implantologie Orale - Vol. 30 N°4
290
Vous aimerez peut-être aussi
- Prothese Fixe UnitaireDocument33 pagesProthese Fixe UnitaireJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Amputation CoronoradiculaireDocument148 pagesAmputation CoronoradiculaireCicek TibbilPas encore d'évaluation
- Prothese AdjointeDocument8 pagesProthese AdjointeJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Aspect Biomecanique de La Prothèse Implantaire FixéeDocument151 pagesAspect Biomecanique de La Prothèse Implantaire FixéeSebastian ScanlonPas encore d'évaluation
- Préscription MédicamenteuseDocument14 pagesPréscription MédicamenteuseMed Rida SalmiPas encore d'évaluation
- Position Du PraticienDocument68 pagesPosition Du Praticienkhoualdia marwaPas encore d'évaluation
- Mobilité Dentaire Stratégies Thérapeutiques DR I.BOUGHEDDA PDFDocument14 pagesMobilité Dentaire Stratégies Thérapeutiques DR I.BOUGHEDDA PDFMeriem AbadliaPas encore d'évaluation
- Cours Lésions Inter RadiculairesDocument12 pagesCours Lésions Inter RadiculairesDjaa MilaaPas encore d'évaluation
- Pathologie DentaireDocument179 pagesPathologie DentaireMarjorie SylvainPas encore d'évaluation
- Conduite À Tenir Chez Le Sujet À Risque HémorragiqueDocument4 pagesConduite À Tenir Chez Le Sujet À Risque HémorragiqueIbrahim BibPas encore d'évaluation
- La vérité cachée sous vos couronnes dentaires: Les Dents dévitaliséesD'EverandLa vérité cachée sous vos couronnes dentaires: Les Dents dévitaliséesPas encore d'évaluation
- Les Systèmes Adhésifs IDocument166 pagesLes Systèmes Adhésifs IDjaa Milaa100% (1)
- Analyse Esthetique Photos PDFDocument117 pagesAnalyse Esthetique Photos PDFikram riahiPas encore d'évaluation
- LOdontologiste Face ADocument165 pagesLOdontologiste Face Aikram100% (1)
- Chirurgie Maxillo-Faciale Et Stomatologie - Pour Le 2e Cycle Des Études Médicales, 2ème ÉditionDocument158 pagesChirurgie Maxillo-Faciale Et Stomatologie - Pour Le 2e Cycle Des Études Médicales, 2ème ÉditionJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Chirurgie Maxillo-Faciale Et Stomatologie - Pour Le 2e Cycle Des Études Médicales, 2ème ÉditionDocument158 pagesChirurgie Maxillo-Faciale Et Stomatologie - Pour Le 2e Cycle Des Études Médicales, 2ème ÉditionJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- ONCD - Volume 2Document164 pagesONCD - Volume 2Silviu ConstantinescuPas encore d'évaluation
- 35 Orthodontie Baidouri RedaDocument19 pages35 Orthodontie Baidouri RedaJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Les Urgences Dentaires AVEC GLOSSAIRE EN ANGLAISDocument57 pagesLes Urgences Dentaires AVEC GLOSSAIRE EN ANGLAISangaPas encore d'évaluation
- La Chirurgie Endodontique - Google DocsDocument2 pagesLa Chirurgie Endodontique - Google DocscyrcyrcyrPas encore d'évaluation
- EndoDocument14 pagesEndoZakariae Ibn AttyaPas encore d'évaluation
- Cancers de La Muqueuse BuccaleDocument9 pagesCancers de La Muqueuse BuccaleNia AdibPas encore d'évaluation
- ATB Bucco Dentaire Argumentaire V3Document75 pagesATB Bucco Dentaire Argumentaire V3Jean Philippe TranPas encore d'évaluation
- Les Résorptions RadiculairesDocument11 pagesLes Résorptions RadiculairesMayasa IskPas encore d'évaluation
- Chapitre 1 Consultation 2011 Guide Clinique D OdontologieDocument3 pagesChapitre 1 Consultation 2011 Guide Clinique D OdontologieaqwxszPas encore d'évaluation
- Plan de Traitement ParodontalDocument2 pagesPlan de Traitement ParodontalAlexPas encore d'évaluation
- Patients à RisqueDocument8 pagesPatients à RisqueHanane BalPas encore d'évaluation
- EMC Antibiotiques en Médecine BuccaleDocument9 pagesEMC Antibiotiques en Médecine Buccaletahari nabilaPas encore d'évaluation
- Le Systeme Nerveux Cours PDF 2Document25 pagesLe Systeme Nerveux Cours PDF 2HamidBenmansour50% (2)
- Cardiopathie Et StomatologieDocument7 pagesCardiopathie Et StomatologieMayssa BourenanePas encore d'évaluation
- Urgences ParoDocument3 pagesUrgences ParoTania RomanPas encore d'évaluation
- Laurent Et Al. - Groupe de Travail ScientifiqueDocument31 pagesLaurent Et Al. - Groupe de Travail Scientifiqueyoussef lachhabPas encore d'évaluation
- Remplir La Fiche Clinique.Document18 pagesRemplir La Fiche Clinique.OkPas encore d'évaluation
- 2015tou33042 PDFDocument114 pages2015tou33042 PDFchokriPas encore d'évaluation
- Tumeurs Bénignes Des Maxillaires A) Odontogènes Et B) Non Odontogènes. PR AyatDocument14 pagesTumeurs Bénignes Des Maxillaires A) Odontogènes Et B) Non Odontogènes. PR AyatAmirouche MezhoudPas encore d'évaluation
- Introduction À L'odontologie GériatriqueDocument4 pagesIntroduction À L'odontologie GériatriqueMariana BurlacuPas encore d'évaluation
- PROGRAMME DU CONCOURS D INTERNAT MD Statut de Linterne 1Document19 pagesPROGRAMME DU CONCOURS D INTERNAT MD Statut de Linterne 1Achraf AcherPas encore d'évaluation
- Odontologie Pédiatrique Évaluation Du Risque Carieux Chez L'enfant Et L'adolescent Et Conduites À TenirDocument22 pagesOdontologie Pédiatrique Évaluation Du Risque Carieux Chez L'enfant Et L'adolescent Et Conduites À TenirSmain Boutaga100% (1)
- Prise en Charge Bucco Dentaire de La Personne ÂgéeDocument14 pagesPrise en Charge Bucco Dentaire de La Personne ÂgéeHassan MoussaouiPas encore d'évaluation
- Urgences Dentaires Dans La Pratique QuotidienneDocument8 pagesUrgences Dentaires Dans La Pratique QuotidienneMayssa BourenanePas encore d'évaluation
- EMC-Résorptions Pathologiques Des Dents Permanentes ÉvoluéesDocument16 pagesEMC-Résorptions Pathologiques Des Dents Permanentes ÉvoluéesAli mahieddine BoudiaPas encore d'évaluation
- Guide Pour Le Diagnostic Clinique Différentiel Des Lésions de La Muqueuse BuccalDocument46 pagesGuide Pour Le Diagnostic Clinique Différentiel Des Lésions de La Muqueuse BuccalCHOUCHOU12485100% (1)
- Prothetique Sur L'integration Biologique, Consequenc (PDFDrive)Document256 pagesProthetique Sur L'integration Biologique, Consequenc (PDFDrive)tamouza chaouiPas encore d'évaluation
- 1.1c Le Fluor Sous Toutes Ses FormesDocument11 pages1.1c Le Fluor Sous Toutes Ses FormesAli mahieddine BoudiaPas encore d'évaluation
- Examen Clinique en Stomatologie: E. Maladière, C. VacherDocument11 pagesExamen Clinique en Stomatologie: E. Maladière, C. VacherMoncef PechaPas encore d'évaluation
- Prothèse Complète Immédiate: M.-V. Berteretche, O. HüeDocument11 pagesProthèse Complète Immédiate: M.-V. Berteretche, O. HüeAbdelkhalek BouararaPas encore d'évaluation
- 2 Diagnostics Pronostic GingivitesDocument7 pages2 Diagnostics Pronostic GingivitesMounir ZaghezPas encore d'évaluation
- Paro Prothese 150925134319 Lva1 App6891Document8 pagesParo Prothese 150925134319 Lva1 App6891Mayssa Bourenane100% (1)
- Analyse Esthétique Du Patient2 1Document14 pagesAnalyse Esthétique Du Patient2 1Halime NadirPas encore d'évaluation
- 7.restauration DefinitiveDocument44 pages7.restauration DefinitiveFerhani OuaPas encore d'évaluation
- Laser en OdontoDocument8 pagesLaser en OdontoAmine Azzaz100% (1)
- Les Moyens de DétectionDocument47 pagesLes Moyens de DétectionNajib JebjoubaPas encore d'évaluation
- 5 Le Trauma Occlusal - Thérapeutique 3A S6 FMD 2021 PR A CherkaouiDocument30 pages5 Le Trauma Occlusal - Thérapeutique 3A S6 FMD 2021 PR A Cherkaouihadil chebliPas encore d'évaluation
- 2017 03-Pulpite-Irreversible SimonDocument10 pages2017 03-Pulpite-Irreversible SimonIness Bgh0% (1)
- TheseDocument2 pagesThesejaboubadrPas encore d'évaluation
- Rev Odont Stomat 2010 39 p112-133Document22 pagesRev Odont Stomat 2010 39 p112-133Iness BghPas encore d'évaluation
- Jsop 06Document36 pagesJsop 06kamil09Pas encore d'évaluation
- Dentisterie A Minima Notes de CoursDocument16 pagesDentisterie A Minima Notes de CoursHana Ditta TanemPas encore d'évaluation
- Dentsiterie CosmetiqueDocument14 pagesDentsiterie CosmetiqueNador Abdennour100% (2)
- Diagnostic Clinique Des Parodontites Apicales PDFDocument14 pagesDiagnostic Clinique Des Parodontites Apicales PDFÝøů Çěf GherrasPas encore d'évaluation
- Les Céramiques DentairesDocument3 pagesLes Céramiques DentairessafaePas encore d'évaluation
- Crête FlottanteDocument13 pagesCrête FlottanteAlia FerchichiPas encore d'évaluation
- Reprise de TraitementDocument9 pagesReprise de TraitementNador Abdennour100% (1)
- Incidence de La Prothese Fixee Sur Le Parodonte 3Document126 pagesIncidence de La Prothese Fixee Sur Le Parodonte 3hind bendahhanePas encore d'évaluation
- Les Inter Relations Parodontie - OrthodontieDocument12 pagesLes Inter Relations Parodontie - OrthodontieChichi ChahrouzPas encore d'évaluation
- Histoire de La Medecine Dentaire en FranceDocument5 pagesHistoire de La Medecine Dentaire en FranceJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Hygiene Cours 5Document3 pagesHygiene Cours 5Jacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Perte Prématurée DDocument2 pagesPerte Prématurée DJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Evaluation Convergence CouronneDocument8 pagesEvaluation Convergence CouronneJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- AntalgiquesDocument45 pagesAntalgiquesJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Remontée de Marge Avant Prothese Par CfaoDocument10 pagesRemontée de Marge Avant Prothese Par CfaoJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Comment Faire Uninlay-Onlay EsthetiqueDocument10 pagesComment Faire Uninlay-Onlay EsthetiqueJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Gnatho 35 BAIDOURI REDADocument26 pagesGnatho 35 BAIDOURI REDAJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- Epr 50 Cours Fiche Incomplet Baidouri RedaDocument15 pagesEpr 50 Cours Fiche Incomplet Baidouri RedaJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- BIOMATERIAUXDocument7 pagesBIOMATERIAUXJacques AlbertiniPas encore d'évaluation
- 9oQrQUST6uaEK0FEj RZG - 1.9 Entretien Avec Le DR Terrence Sejnowski v3Document5 pages9oQrQUST6uaEK0FEj RZG - 1.9 Entretien Avec Le DR Terrence Sejnowski v3AkimPas encore d'évaluation
- These29 13Document143 pagesThese29 13benhammadi najibPas encore d'évaluation
- DC 223 En-FrDocument2 pagesDC 223 En-FrRizk ElkhoolyPas encore d'évaluation
- RCT MarketSnapshot Cosmetic FR 07-07-20Document15 pagesRCT MarketSnapshot Cosmetic FR 07-07-20nerac34Pas encore d'évaluation
- Reglement Intérieur PDE - AMOROSDocument3 pagesReglement Intérieur PDE - AMOROSlaferaleprodPas encore d'évaluation
- Phase 1 ValentinDocument17 pagesPhase 1 Valentinvalentin DapraPas encore d'évaluation
- 01b PNLATDocument6 pages01b PNLATYanisPas encore d'évaluation
- Rapport de Mari ClaireDocument17 pagesRapport de Mari ClaireBidossessi Boris GanhitoPas encore d'évaluation
- Les Nouvelles Technologies de Santé SynthèseDocument41 pagesLes Nouvelles Technologies de Santé SynthèseFeriel FerielPas encore d'évaluation
- Pharmacologie (11e Édition) 2007, Yvan TouitouDocument6 pagesPharmacologie (11e Édition) 2007, Yvan TouitouHouda BentouraPas encore d'évaluation
- Traumatisme Cranio-EncephaliqueDocument32 pagesTraumatisme Cranio-EncephaliqueEbePas encore d'évaluation
- 10 - La Réglementation en Matière de Radioprotection en Algérie (Présenté Par MR Chelbani)Document27 pages10 - La Réglementation en Matière de Radioprotection en Algérie (Présenté Par MR Chelbani)walid walidPas encore d'évaluation
- TerminologieDocument79 pagesTerminologieJude EmmanuelPas encore d'évaluation
- 01 1-1 La Com Soignant SoigneDocument4 pages01 1-1 La Com Soignant SoigneLiliaPas encore d'évaluation
- L'apport Freudien Sur Les Névroses de GuerreDocument11 pagesL'apport Freudien Sur Les Névroses de GuerreMaya BkPas encore d'évaluation
- These Professionnelle 051213Document116 pagesThese Professionnelle 051213Eugene LiangPas encore d'évaluation
- LYCEE PILOTE DE SFAX DEVOIR DE CONTROLE N 1 Prof - M. Kharrat SVT. 4 SC. EXP 3 Octobre 2010 Durée - 2HDocument5 pagesLYCEE PILOTE DE SFAX DEVOIR DE CONTROLE N 1 Prof - M. Kharrat SVT. 4 SC. EXP 3 Octobre 2010 Durée - 2HSana GhribiPas encore d'évaluation
- GoutteDocument5 pagesGoutteMahefa Serge RakotozafyPas encore d'évaluation
- Remplir La Fiche Clinique.Document18 pagesRemplir La Fiche Clinique.OkPas encore d'évaluation
- Complications Aigues Du DiabèteDocument54 pagesComplications Aigues Du DiabèteMohamed Ikbal100% (1)
- Psychiatrie 1Document94 pagesPsychiatrie 1Luc MudePas encore d'évaluation
- SinusDocument15 pagesSinusMua korinePas encore d'évaluation
- Fazzini Section7 EmergencyDocument26 pagesFazzini Section7 EmergencyMourtala KabirouPas encore d'évaluation
- ANCPNC Manuel Du FaciliteurDocument204 pagesANCPNC Manuel Du FaciliteurGasnicka BeltinordPas encore d'évaluation
- 025mjk Lisette BenoitDocument2 pages025mjk Lisette BenoitChristian Lauric N'guessanPas encore d'évaluation