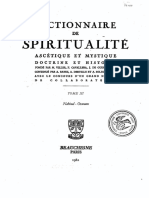Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Descartes Les Annees de Formation
Transféré par
Domenico CollaccianiTitre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Descartes Les Annees de Formation
Transféré par
Domenico CollaccianiDroits d'auteur :
Formats disponibles
2
Les années de formation
Édouard Mehl
« La vérité se découvre toujours bien1 »
Sensible aux vices cachés de l’esprit comme la graphomanie et la vaine gloire,
Descartes n’a jamais voulu beaucoup écrire. Aussi n’est-il pas, comparativement
à d’autres, un auteur très prolixe, ce qui ne fait pas moins de lui un caractère
très studieux. Toute la première partie de son œuvre, et sa récapitulation dans
le Discours de la Méthode (1637), placent l’entreprise philosophique sous le signe
des « études » menant à la sagesse : au lieu de lire des livres et d’accumuler des
doutes, dit l’auteur de ce Discours, qui parle beaucoup de lui-même sans jamais
dire son nom, « je pris un jour résolution d’étudier aussi en moi-même ».
Cette résolution, aussi solennelle que celle qui ouvrira plus tard le Traité
de la Réforme de l’Entendement de Spinoza 2, institue la rupture avec une vie
antérieure, non moins studieuse, mais trop exclusivement tournée, quant à
son objet, vers « le grand livre du monde3 ». Quelques années avant le récit du
1. À Ferrier, 8 octobre 1629, AT I, 37, 22.
2. Spinoza, Œuvres I, sous la dir. de P.-F. Moreau, PUF, 2009, p. 64 sq. Sur l’intertexte carté-
sien du Prologue de Spinoza (et les limites de la comparaison), voir P.-F. Moreau, Spinoza.
L’expérience et l’ éternité, PUF, 1994, p. 47 sq.
3. DM I, AT VI, 10, 28-29. Voir la nouvelle édition du Discours de la Méthode, annotée
par G. Rodis-Lewis † dans R. Descartes, Œuvres Complètes, III, sous la direction de
J.-M. Beyssade et D. Kambouchner, Paris, Gallimard, 2009, p. 622-623, signalant à juste
titre l’intertexte de Montaigne (Les Essais, I, 26, 157-158a : « Ce grand monde […] je veux
que ce soit le livre de mon écolier »). La décision philosophique cartésienne (« étudier aussi
en moi-même… » pour « … choisir les chemins que je devais suivre [la version latine AT VI,
545, évoque rigoureusement les formules de Spinoza : quidnam a me optimum fieri posset
inquirere] »), se veut donc en rupture avec le projet philosophique de Montaigne, fondé
seulement sur « l’expérience » et ne visant qu’une sagesse « mondaine » – entendons par là
que l’« écolier » apprend dans le monde, et de lui, comment il faut y vivre. Préoccupation
légitime mais insuffisante, et dont la philosophie authentique doit, à un moment donné
(semel), se détourner.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 41 08/01/15 12:07
42 Descartes
Discours, Descartes évoquait déjà le commencement de ses études1, en faisant
un usage remarquable du pronom possessif : ces études ne désignent nullement
la formation scolaire initiale, mais un recommencement ultérieur, destiné à
rétablir en l’esprit la pleine jouissance de cette puissance native qu’on appelle
le « bon sens ou la raison2 ». La forme maîtresse de ce commencement philo-
sophique n’est donc pas l’envol et l’extase enthousiaste mais le repli, la retraite
et un studium d’un genre nouveau, dont le commun des mortels n’a pas même
idée3.
La première des Règles pour la direction de l’esprit, détermine d’emblée la
finalité de cet apprentissage : rendre l’esprit capable de juger universellement de
« tout ce qui se présente4 », non pour le plaisir futile d’arbitrer les disputes des
« philosophes », mais parce qu’il faut savoir « distinguer le vrai d’avec le faux
[…] pour marcher avec assurance en cette vie5 ». Si l’institution de règles et
l’exercice sont pour cela nécessaires, c’est que cette « puissance de bien juger […]
qu’on nomme le bon sens ou la raison6 », quoique vraisemblablement identique
et tout entière en tout homme, est presque toujours empêchée par de mauvaises
habitudes contractées dès l’enfance : la précipitation des esprits téméraires, ou
bien au contraire la défiance des esprits timides7, tendances souvent aggravées
par une éducation inapte à redresser cette nature. Car les maîtres, comme
1. À Mersenne, 15 avril 1630, AT I, 144, 5-9 : « Or j’estime que tous ceux à qui Dieu a donné
l’usage de cette raison, sont obligé de l’employer principalement pour tâcher à le connaître,
et à se connaître eux-mêmes. C’est par là que j’ai tâché de commencer mes études… »
2. DM I, AT VI, 2, 6-7.
3. Descartes avait entrepris dès les années 1620 la rédaction d’un Studium bonæ mentis, que
l’on traduit, à la suite de son premier biographe, Adrien Baillet, par l’Étude du bon sens.
Cette traduction se justifie par le fait que la version latine de l’incipit du Discours de la
Méthode donne bona mens pour « bon sens ». Si toutefois l’on se réfère à l’énoncé de la
première des Règles pour la direction de l’esprit (« Studiorum finis esse debet ingenii directio
ad solida & vera, de iis omnibus quæ occurunt, proferenda judicia », AT X, 359, 5-7), et si
l’on constate que cette puissance de bien juger est l’essence même de la bona mens (DM I,
AT VI, 2, 5-7 : « la puissance de bien juger… qui est proprement ce qu’on nomme le bon
sens ou la raison [rectam rationem] »), on pourra penser que le Studium bonæ mentis n’est
rien d’autre qu’un Art du jugement. Sur l’édition de ces textes de jeunesse, voir désormais :
Étude du bon sens, La Recherche de la vérité et autres écrits de jeunesse (1616-1631), éd. par
V. Carraud et G. Olivo, Paris, PUF, 2013. Voir également Descartes, Œuvres complètes
(Premiers écrits ; Règles pour la direction de l’esprit), Tel-Gallimard, 2015.
4. Règle I, AT X, 359, 5-7 (tr.) : « Le but des études doit être de diriger les esprits en sorte
qu’ils portent des jugements solides et vrais sur tout ce qui se présente ». Cette autonomie
et cette universalité du jugement renvoient à ce que, dans la Sagesse (1601, 1604²), Pierre
Charron (1541-1603) donnait pour l’office même du sage : « Juger de tout ». P. Charron,
La Sagesse, II, 2, Paris, Fayard, 1986, p. 389 : « le vrai office de l’homme, son plus propre
et plus naturel exercice, sa plus digne occupation est de juger ». La seconde édition précise
que cette soumission de toutes choses à l’examen du jugement s’entend de tout sauf des
vérités de la foi, « lesquelles il faut recevoir simplement avec toute humilité et soumission »
(ibid., p. 388). Cf., dans le même sens, DM III, AT VI, 28, 15-19 et Reg. III, AT X, 370,
16-25.
5. DM I, AT VI, 10, 10-11.
6. DM I, AT VI, 2, 5.
7. DM II, AT VI, 15, 17-31.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 42 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 43
tous, ont eux-mêmes été « enfants avant que d’être hommes », et certains, sans
doute, n’ont pas cessé de l’être. Aussi est-il « presque impossible » de toujours
bien juger (quoi qu’il soit théoriquement en la puissance de chacun de le faire),
troublés que nous sommes tous par des « appétits » et des « précepteurs » qui
ne conseillent « peut-être pas toujours le meilleur1 ».
Le meilleur, c’est assurément de cultiver le bon sens comme tel, c’est-à-dire
qu’au lieu de travailler à augmenter ses connaissances, il faut tâcher d’augmenter
en l’esprit cette lumière « pure2 » dont dépend le jugement, et, partant, toute
la sagesse, puisqu’« il suffit de bien juger pour bien faire […], c’est-à-dire pour
acquérir toutes les vertus3 ». Les objets du savoir auxquels les ignorants vouent
une admiration fétichiste n’ont d’intérêt qu’en tant qu’ils offrent à l’esprit la
matière et l’occasion d’exercer son jugement. C’est presque une évidence. Mais,
bien que tout homme désire naturellement savoir, c’est un fait, suffisant à lui
seul à susciter l’étonnement (et la philosophie dont il est le point de départ),
que la quasi-totalité d’entre eux, aveuglés par ce désir, sombrent dans la vaine
curiosité et pensent voir plus clair dans leurs ténèbres que dans la lumière
même ; à tel point que certains finissent même par n’en plus pouvoir supporter
la clarté4. Compliquant l’incipit de la Métaphysique aristotélicienne, les textes
de jeunesse de Descartes développent ce paradoxe anthropologique : la plupart
des hommes ne désirent savoir que ce qu’ils ne peuvent pas savoir, et ils ignorent
ce qui est à leur portée, car cela ne les intéresse pas.
Du Collège au Studium
Si bonne soit-elle, une éducation qui excite donc la curiosité sans donner
les moyens de la satisfaire, et qui nous transmet les tares de nos aïeux en même
temps que leur savoir, est toujours à refaire. Les formules du Discours sont
1. DM II, AT VI, 13, 1-12.
2. Sur cette « pureté » de la lumière naturelle ou raison, cf. Règle IV, AT X, 373, 1-2 ; La
Recherche de la Vérité, AT X, 498, 20-24 : « un homme de médiocre esprit, mais […] qui
possède toute la raison selon la pureté de sa nature ». Remarquons que l’universel partage
de la raison n’est jamais tenu pour un principe, mais pour une opinion commune que la
philosophie partage avec le sens commun. La chose est bien rendue et soulignée dans la
version latine du Discours de la Méthode (AT VI, 540) : Nam rationem… æqualem in omnibus
esse facile credo ; il s’agit de fait d’une communis sententia philosophorum (nous soulignons).
Voir, en ce sens, la prudence d’une déclaration à Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 598,
1-9 : « Tous les hommes ayant une même lumière naturelle, ils semblent devoir avoir tous
les mêmes notions… mais il n’y a presque personne qui se serve bien de cette lumière » (nos
italiques).
3. DM III, AT VI, 28, 9-14.
4. Reg. I, AT X, 360, 19-20 ; Reg. IV, p. 371, l. 19-21 ; Reg. IX, p. 411, l. 11-18. On peut y voir
une réminiscence de l’allégorie platonicienne de la caverne (comme en DM VI, AT VI, 70,
26 – 71, 11), mais il faut surtout songer à Aristote, Métaphysique, a, 993 b 9, où l’entende-
ment humain est dit aveuglé par l’évidence de la vérité, comme une chauve-souris par la
lumière du jour.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 43 08/01/15 12:07
44 Descartes
choisies, mais le fond reste ce qu’il est, irrévérencieux, voire assassin à l’égard
de ses maîtres1. Descartes a pourtant reçu une éducation exemplaire dans « une
des plus célèbres écoles de l’Europe2 », le Collège Royal de La Flèche, créé par
les Jésuites en 1604, dont il a brillamment et intégralement suivi le curriculum,
avant d’accomplir des études de droit, et de se voir décerner le grade de licencié,
le 10 novembre 1616. Longtemps débattue, la question des dates précises de
la scolarité – vraisemblablement 1607-1615 et non 1606-1614 – n’a pas d’inci-
dence majeure sur la formation elle-même, mais importe en revanche pour
l’identification des futurs destinataires du Discours de la Méthode, notamment
le Père Étienne Noël, principal de la Flèche selon les dates corrigées3. Même
si le Discours ne manifeste aucun désir de rectifier les insuffisances de cette
formation scolaire, et se défend de toute intention réformatrice en matière
pédagogique, la dignité et la crédibilité du Ratio et Institutio Studiorum défini
par Ignace de Loyola, et scrupuleusement observé à La Flèche, ne ressortent pas
indemnes de l’examen auquel le soumet toute la première partie de l’ouvrage,
fait de « diverses considérations touchant les sciences4 ».
Mais pourquoi tant de soin à déceler les déficiences de cette formation
scolaire sans en mettre en cause les responsables ? Le motif profond n’apparaît
pas de prime abord à la lecture du Discours de la Méthode, mais il tient à la
réception et à la diff usion de ce que Descartes appelle sa « philosophie », c’est-
à-dire sa physique déjà élaborée, entre 1629 et 1632, dans Le Monde ou Traité
de la lumière. Conscient, entre autres5, de la difficulté à convaincre un public
inféodé aux préjugés de l’École, et de la censure théologienne de la science
galiléenne dont Descartes s’est trouvé « si fort étonné, qu[’il s’est] quasi résolu
de brûler tous [ses] papiers6 », il cherchait, pour surmonter l’obstacle, à imposer
une alliance tactique à la Compagnie en l’obligeant presque à enseigner sa
physique : les Météores en formaient un échantillon suffisant, qu’il somma
littéralement la Compagnie de « réfuter » ou de « suivre », sans qu’ils aient pour
1. Il l’est moins, toutefois, que dans les Regulæ (Reg. II, AT X, 364, 3-21) ou l’incipit de la
Recherche de la Vérité (AT X, 496, 1-4) : « la connaissance de son premier âge n’étant appuyée
que sur la faiblesse des sens & sur l’autorité des précepteurs, il est presque impossible que
son imagination ne se trouve remplie d’une infinité de fausses pensées ».
2. DM I, AT VI, 5, 1.
3. Sur cette question, voir G. Rodis-Lewis, Descartes, Paris, Calmann Lévy, 1995, ch. 2,
p. 25-44. Cette rectification des dates remonte à J. Sirven, Les années d’apprentissage de
Descartes (1596-1628), Albi, 1928, p. 40-49. Voir Descartes à [É. Noël], AT I, 383, 5-15.
4. AT VI, 1, 3.
5. DM V, AT VI, 41, 21-23 : « Mais pource que j’ai tâché d’en expliquer les principales [lois
de la nature] dans un traité que quelques considérations m’empêchent de publier… » (nos
italiques).
6. À Mersenne, novembre 1633, AT I, 270, 17 – 271, 1. De telles menaces ne sont pas nouvelles :
cf. à Dinet, 18 juillet 1629, AT I, 17, 11-18.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 44 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 45
cela à prendre parti sur la question de la mobilité de la terre1. Bref, Descartes
a tendu la main aux Jésuites en leur signifiant qu’ils n’avaient pas le choix de
la refuser. Malgré tout le soin apporté à la réalisation de cette offensive à peine
masquée, le plan devait toutefois échouer, et le Discours n’obtenir des Jésuites,
comme cela se pouvait concevoir, qu’un accueil très frais.
En effet, si le philosophe expatrié convient de la valeur de cette formation
scolaire pour la formation de l’honnête homme, il passe quasi sous silence ce
qui aurait pourtant dû en être la clef de voûte :
« Je ne dirai rien de la philosophie, sinon que […] il ne s’y trouve encore
aucune chose dont on ne dispute, et par conséquent qui ne soit douteuse2 ».
Comme les Jésuites eux-mêmes ne s’en cachaient pas, l’enseignement
de la philosophie suivait scrupuleusement Aristote en philosophie (logique,
physique, métaphysique)3, et le Ratio Studiorum voudrait même qu’on enseigne
un aristotélisme pur, c’est-à-dire expurgé de toutes ses variantes hétérodoxes,
notamment des aberrations « averroïstes4 ». En réalité, l’unitarisme pédago-
gique des Jésuites (Thomas d’Aquin en théologie, Aristote en philosophie)
s’avère n’être qu’une façade, derrière laquelle la diversité doctrinale existe bel
et bien, et trouve à s’exprimer en dépit d’une censure interne dont la finalité
vise moins à l’interdiction aveugle de toute nouveauté, qu’au maintien d’une
nécessaire cohérence.
On sait que la figure de proue de l’enseignement scientifique de la Compagnie,
Christoph Clavius (1537-1612), aurait reconnu, peu avant sa mort, la nécessité
d’adopter un nouveau modèle cosmologique, dans le style du système semi-
copernicien inventé par Tycho Brahé5. Et même si l’on cite souvent Christoph
1. À Ét. Noël, octobre 1637, AT I, 455, 18-456, 9 : « Il n’y a personne qui me semble avoir
plus d’intérêt à examiner ce livre, que ceux de votre Compagnie, car je vois déjà que tant
de personnes se mettent à croire ce qu’il contient, que je ne sais pas […] de quelle façon
ils pourront dorénavant les enseigner […] s’ils ne réfutent ce que j’en ai écrit, ou s’ils ne le
suivent ».
2. DM I, AT VI, 8, 18-22.
3. Descartes l’a remarqué : Princ., L.-Préf., AT IX-B, 7, 26-27 : [les opinions d’Aristote]
« sont les seules qu’on enseigne dans les écoles ». Cette affirmation, un peu hyperbolique,
mériterait d’être nuancée, et même problématisée (Aristote, certes, mais lequel ?). Voir les
indications et la bibliographie données par J. Schmutz dans « Aristote au Vatican… », in
Der Aristotelismus in der frühen Neuzeit – Kontinuität oder Wiederaneignung ? G. Frank et
A. Speer (hrsgb.), Harrassowitz Verlag, Wiesbaden, 2007, p. 65-95 (sur l’enseignement
jésuite, p. 66-67).
4. Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Iesu (1586, 1591, 1599), éd. L. Lukács, Monumenta
Pædagogica Societatis Iesu, V, Rome, 1986, p. 397 ; voir l’édition française d’Adrien Demoutier
et Dominique Julia, Ratio Studiorum. Plan raisonné des études de la Compagnie de Jésus,
Paris, Belin, 1997. Le Commentateur (Averroès) peut être cité et suivi, mais ses erreurs
doivent être poursuivies avec acribie.
5. M.-P. Lerner, « L’entrée de Tycho Brahé chez les Jésuites ou le chant du cygne de Clavius »,
in Les Jésuites à la Renaissance : système éducatif et production du savoir, éd. par L. Giard,
Paris, PUF, 1995, p. 145-185.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 45 08/01/15 12:07
46 Descartes
Scheiner (1573-1650) pour son implication dans la condamnation de Galilée,
il faut rappeler qu’il produisit, en alternative à une doctrine des sphères solides
bien établie en milieu aristotélicien, une théorie du ciel entièrement fondée sur
le principe de la fluidité de la matière céleste, comme Descartes le fera, non
sans de notables aménagements, dans la physique, du Monde aux Principia1.
Les Jésuites n’étaient donc, à vrai dire, pas tant hostiles à la nouveauté et au
progrès scientifique qu’on le dit souvent, mais il leur fallait faire en sorte que
ces nouveautés ne déstabilisent pas un équilibre institutionnel et pédagogique
durement acquis et politiquement essentiel. Si Descartes a cherché leur appui,
c’est qu’il l’avait bien compris. S’il ne l’a pas trouvé, c’est que sa philosophie
était, décidément, trop nouvelle pour eux.
Beaucoup plus tard, Descartes se souviendra encore de quelques uns de ses
anciens manuels scolaires (Fonseca, Tolet, Rubius, Eustache de Saint-Paul)2,
et de fait il n’a presque jamais cessé d’y revenir, ne fût-ce que pour mieux
s’en démarquer. Dans les Regulæ la critique de la faiblesse des démonstrations
mathématiques, quand elles ne montrent pas « pourquoi il en est ainsi, et de
quelle manière on l’a découvert », rappelle sans doute une formation scolaire
en grande partie axée sur la question de la scientificité respective des mathéma-
tiques et de la philosophie3. Parfaitement instruit des dissensions doctrinales
au sein de la Compagnie, Descartes en joue avec cette habileté qui devait déjà
étonner au collège, utilisant tour à tour les arguments des uns et des autres,
ceux des mathématiciens comme Clavius ou Blancani (1566-1624), ou ceux des
philosophes comme Beneto Perera (1536-1610), pour montrer sur quelle faille
spéculative repose le système éducatif des Jésuites. Quoi qu’il en soit, la leçon
du Discours est sans ambiguïté et sans appel : à la Flèche, Descartes a étudié
1. Il faut considérer l’imposante somme de Scheiner : Rosa Ursina, sive Sol ex admirando
facularum et macularum suarum phœnomenon varius necnon circa centrum suum
et axem fixum ab occasu in ortum annua, circaque alium axem mobilem ab ortu
in occasum conversione quasi menstrua, super polos proprios libris quatuor mobilis
ostensus (Bracciani, 1630). Scheiner accumule les autorités scientifiques et théologiques,
notamment celle du Père Mersenne (1588-1648), et cite (p. 735 sq.) de larges extraits des
Quæstiones celeberrimæ in Genesim (Paris, 1623 [Question VII, art. 9, conclusion 1]). La
position de Mersenne, fort novatrice de ce point de vue, peut se laisser résumer par cette
citation, répercutée par Scheiner (tr.) : « Il n’y a aucun phénomène qui ne se laisse beaucoup
plus aisément concevoir, sauver et expliquer, en admettant (data) la ténuité ou liquidité des
cieux, que si nous supposons des orbes solides durs et adamantins ».
2. À Mersenne, 30 septembre 1640, AT III, 185, 11-18.
3. Reg. IV, AT X, 375, 1-22, qui fait sans doute allusion à la critique philosophique des
mathématiques dont le Jésuite B. Perera, professeur au Collegium Romanum, s’est fait le
chantre dans son commentaire de la Physique d’Aristote (De communibus rerum naturalium
principiis et aff ectionibus, Rome, 1576) qui a fait autorité dans l’École. Sur ce point, voir
É. Mehl, Descartes en Allemagne 1619-1620. Le contexte allemand de l’ élaboration de la
science cartésienne, Strasbourg, Presses Universitaires, 2001, p. 253-261.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 46 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 47
tout ce qu’il est nécessaire à l’honnête homme d’apprendre, sauf l’essentiel, la
vraie philosophie, dont l’« étude est plus nécessaire pour […] nous conduire
en cette vie, que n’est l’usage de nos yeux pour guider nos pas1 ».
La désillusion des années 1615 n’atteint pourtant pas ce que Descartes
dévoile comme le trait dominant et constant de sa complexion juvénile : l’ar-
deur de son désir2 . Rétrospectivement, l’étude des lettres s’avère incapable
de satisfaire un désir de savoir, lequel doit d’ailleurs moins s’entendre au sens
traditionnel évoqué par l’incipit de la Métaphysique d’Aristote, qu’au sens d’un
désir de savoir juger et découvrir par soi-même : croyant sur la foi de ses maîtres
pouvoir satisfaire par leur moyen son « extrême désir » de « marcher avec assu-
rance en cette vie », il s’y était livré sans réserve. Mais au bout de ses désillu-
sions, le désir, au lieu de s’épuiser, l’obnubile. Telle est la principale leçon d’un
court texte composé par Descartes à l’occasion de la soutenance de ses thèses
de droit (1616)3. À peine sorti de l’enfance, son désir l’oriente vers la poésie,
avant qu’il n’éprouve le désir assoiffé des « fleuves plus vastes de l’éloquence4 ».
Mais l’éloquence excitant la « soif de savoir » bien plus qu’elle ne le satisfait,
il lui faut se tourner vers « l’onde immense des sciences », non pour épuiser
ne fût-ce qu’une seule d’entre elles – folle ambition –, mais une fois l’excès de
la soif étanché par l’une ou l’autre, pour tâcher de les « distinguer toutes par
l’expérience » (cupiebam omnes experimento dignoscere).
Ainsi ce texte, dans sa rhétorique sophistiquée, ne dit pas autre chose que
l’ambition singulière d’une totalisation du savoir et des sciences (omnes…
dignoscere), que la première des Règles pour la direction de l’esprit justifie plei-
nement, en déclarant « beaucoup plus facile de les apprendre toutes ensemble
en même temps (cunctas simul), que d’en séparer une seule des autres5 ». Plus
qu’elle ne l’interdit ou ne l’en détourne, l’étude du droit doit permettre à
l’esprit, en tempérant l’excès de sa soif et la « violence de sa liberté », d’approcher
de ces « sources » dont coulent toutes les vertus et toutes les sciences, l’unité
indivise de la science et de la vertu constituant la « sagesse » dont la philosophie
est l’étude6. Même si ce texte part d’un habile jeu de mots sur le nom de son
protecteur et oncle maternel (des Fontaines), son souci d’accéder à la « source »
1. Princ., L.-Préf., AT IX-B, 3, 29-4, 1.
2. DM I, AT VI, 42, 4 = 542, 1 : incredibili desiderio […] flagrabam ; 10, 9-11 = 545, 15-17 :
summo studio quærebam.
3. Voir J.-R. Armogathe, V. Carraud, R. Feenstra : « La licence en droit de Descartes : un
placard inédit de 1616 », Nouvelles de la République des Lettres, Naples, 1988, 2, maintenant
repris dans l’édition des textes de jeunesse (cit. supra, n. 6, p. 15- 34).
4. Sur la « divine » éloquence, originairement comprise comme l’effet du « zèle pour la vérité »
avant qu’elle ne dégénère en sophistique, voir la Censura des Lettres de son ami Jean-Louis
Guez de Balzac, AT I, 9, 14-21.
5. Reg. I, AT X, 361, 13-14.
6. Studium, AT X, 191, 7 : « … la sagesse, c’est-à-dire la science avec la vertu ».
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 47 08/01/15 12:07
48 Descartes
( fons) des vertus et des sciences, ou de demeurer au plus près, est en tous
points semblable à celui d’accéder à leur fondement (fundamentum), comme
il prétendra, trois ans plus tard, y parvenir sans la médiation de quiconque.
Le promoteur des études
Les activités de Descartes durant les deux années qui suivent sont mal
connues. On le dit à Rennes, en famille, mais il est difficile d’admettre que
le bouillonnant jeune homme n’ait pas déjà renoncé à la carrière juridique, et
donc commencé à étudier le « grand livre du monde ». Toujours est-il qu’on
ne le retrouve que deux ans jour pour jour après la date de sa soutenance,
soit le 10 novembre 1618, où il fait la rencontre du médecin Isaac Beeckman
(1588-1637).
On ne saurait exagérer l’importance de cette rencontre, qui a tiré le
jeune homme de son « oisiveté », le conduisant à la rédaction de ses premiers
essais de « physico-mathématique1 », où l’« algèbre géométrique » sert déjà de
moyen démonstratif2, puis à la réalisation d’un petit ouvrage de synthèse, un
Compendium de musique, où l’étude des consonances, ramenée à la proportion
arithmétique, repose sur les principes d’une esthétique étonnamment élaborée,
et procède selon des moyens bientôt formalisés sous le nom de méthode : clarté,
brièveté, réduction de l’objet (la corde vibrante) à la pure et simple dimension
mesurable3.
Ce que Descartes doit à Beeckman n’est pas « rien », contrairement à ce
que lui-même en prétendra avec insolence, lors d’une brouille dont le prétexte
est précisément le soupçon plus ou moins fondé que Beeckman s’attribue la
paternité du Compendium Musicæ4. Ce lamentable épisode explique pourquoi
Descartes refusera à son ancien mentor et premier véritable instituteur5, l’hon-
neur posthume d’une citation dans le Discours de la Méthode. Mais derrière
l’indignation morale, que suscite à juste titre la conception marchande de
la propriété des idées et des textes, on perçoit sans mal l’enjeu théorique : si
la vérité d’une proposition quelconque ne tient qu’à la manière dont on la
1. Il s’agit de deux textes édités sous le titre de Physico-mathematica, AT X, 67-78. Sur cette
première tentative d’explication de la chute des corps, voir A. Koyré, Études galiléennes, Paris,
Hermann, 1966, p. 107 sq., puis A. Charrak et V. Jullien : Ce que dit Descartes touchant la
chute des graves. – De 1618 à 1646, étude d’un indicateur de la philosophie naturelle carté-
sienne, Lille, PU, 2002. Pour l’aspect plus proprement scientifique de la collaboration entre
Descartes et Beeckman, voir la contribution de D. Rabouin dans ce même volume.
2. AT X, 78, 23.
3. Voir l’introduction de F. de Buzon à son édition critique de ce texte, Paris, PUF, 1987,
p. 10-13, puis p. 17.
4. À Beeckman, 17 octobre 1630, AT I, 156-170.
5. Voir le jeu de mots de la lettre à Beeckman du 23 avril 1619, AT X, 162, 16-17 : teque ut
studiorum meorum promotorem & primum authorem amplectar (nous soulignons).
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 48 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 49
déduit des vrais principes1, qu’en est-il de la science beeckmanienne, de la
vérité de ses principes, et de la déduction qu’ils rendent possible ? Bien que
la méchante lettre de Descartes n’en souffle pas mot, on devine sans mal de
quel « faux » ou « vrai » principe il est ici question : de celui qu’on appellera le
« principe d’inertie », et dont la chronologie des textes pourrait laisser penser
que Descartes l’a appris de Beeckman, à la fin de l’année 1618.
En effet, le Journal où Beeckman consigne, dans un certain désordre, le
fruit de ses recherches, indique clairement que l’élaboration de sa sententia de
motu (« un corps en mouvement ne s’arrête jamais, sinon par l’empêchement des
autres corps ») est très antérieure à sa rencontre avec Descartes. Les premières
pages du Journal le montrent : comme le fait simultanément Kepler, Beeckman
critique les thèses défendues par un auteur scolaire, Scaliger2 . Celui-ci croyait
en effet pouvoir prouver le caractère volontaire du mouvement des astres par
la supposition que tout mouvement naturel a lieu en vue du repos (« quod
movetur, movetur ut quiescat »). Si les corps célestes ne tendent pas au repos
et sont partout comme en leur lieu, c’est que le principe de leur mouvement
n’est pas naturel, mais volontaire. Mais si, au contraire du principe « étrange »
et rigoureusement contre-nature que tous les mouvements tendent au repos,
donc à la destruction de soi-même3, on suppose que « toute chose, une fois en
mouvement, ne s’arrête jamais que par un empêchement extérieur », comme
Beeckman le fait à partir des années 1614, alors l’hypothèse d’un mouvement
volontaire au principe de la physique devient, en plus de son invérifiabilité,
totalement inutile. La volonté, l’appétit et le désir, données purement psycho-
logiques, n’expliquent rien à la physique, bien qu’au demeurant ils expliquent
tout à nos errances spéculatives.
Cela dit, l’énoncé dont Descartes va faire le fondement de sa physique n’a
pas le même sens ni exactement le même contenu, puisque Beeckman l’enten-
dait du mouvement circulaire, et Descartes du seul mouvement rectiligne, au
motif de sa plus grande simplicité4. Si le mouvement est conservé dans ce qu’il
1. AT I, 158, 24-30.
2. L’ouvrage de Jules-César Scaliger, les Exercitationes contre le De subtilitate de Cardan
(Exotericarum exercitationum liber XV de subtililate ad Hieronymum Cardanum)
– qui ne compte pas moins de vingt éditions entre 1557 (Paris, Morel) et 1634 –, comprend
une longue paraphrase du De Cælo aristotélicien, et jouissait d’un grand crédit dans l’ensei-
gnement scolaire de la seconde moitié du XVIe siècle. Sur la critique keplérienne de ce texte,
voir Le Secret du monde, tr. A. Segonds, Paris, Les Belles Lettres, 1984, p. 329-330.
3. Le Monde, AT XI, 40, 14-19 : « Enfin le mouvement dont ils parlent est d’une nature si
étrange, qu’au lieu que toutes les autres choses ont pour fin leur perfection, & ne tâchent
qu’à se conserver, il n’a point d’autre fin ni d’autre but que le repos ; et, contre toutes les
lois de la nature, il tâche soi-même à se détruire ».
4. Princ., II, art. 37, AT VIII, 62, 9-12 : Harum prima est, unamquamque rem, quatenus est
simplex et indivisa, manere, quantum in se est, in eodem semper statu, nec unquam mutari,
nisi a causis externis [soit, selon la « traduction » de Picot : « La première est que chaque
chose en particulier continue d’être en même état autant qu’il se peut, et que jamais elle
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 49 08/01/15 12:07
50 Descartes
a de simple, c’est que l’action qui le conserve est elle-même continue et simple :
« elle ne change point1 ». Ainsi la déduction complète du principe requiert-elle
celle de l’immutabilité divine, car
« […] Ces deux règles suivent manifestement de cela seul, que Dieu
est immuable, et qu’agissant toujours en même sorte, il produit toujours le
même eff et 2 ».
La permanence du mouvement se fonde dans l’essence de sa cause « effi-
ciente et totale », et donc la physique dans la métaphysique. Sans doute cette
avancée fait-elle signe vers la découverte enthousiaste, en novembre 1619, des
« fondements de la science admirable3 », incluant sans doute celle du fonde-
ment métaphysique du mouvement inertial. Mais six longs mois de voyages,
d’expériences et de réflexions le séparent encore de ce qui constituera le véritable
commencement de sa philosophie. Pour lors, Descartes quitte Beeckman pour
un voyage au tracé et aux aboutissants encore incertains, qui doit le mener aux
abords de son propre destin.
Nécessité de la méthode
Beeckman était un érudit, lisant le grec dans le texte, très au fait, dès 1618,
des avancées fondamentales de l’astronomie depuis Tycho Brahé et Kepler,
comme, pour le versant technique, de la construction de la lunette de Galilée4.
Le Journal, retrouvé en 1905, et le catalogue de sa bibliothèque5, donnent une
idée assez précise de l’étendue de ses connaissances, et de ce que Descartes
a pu apprendre « avec lui » plus que « de lui ». Il est probable que tel ou tel
ne le change que par la rencontre des autres », AT IX-B, 84]. Dès Le Monde, Descartes a
parfaitement justifié le fait que la conservation s’entende seulement du mouvement droit
en invoquant sa simplicité : AT XI, 44, 29-45, 2 : « Or est-il que, de tous les mouvements,
il n’y a que le droit qui soit entièrement simple, et dont toute la nature soit comprise en un
instant ».
1. Le Monde, AT XI, 37, 11 ; ; Princ., II, art. 39, AT VIII, 63, 26-29 : Causa hujus regulæ eadem
est quæ præcedentis, nempe immutabilitas et simplicitas operationis, per quam Deus motum in
materia conservat.
2. Le Monde, AT XI, 43, 11-14.
3. AT X, 179.
4. Journal tenu par Isaac Beeckman de 1604 à 1634 ; 4 vol, éd. Cornelis de Waard. La Haye :
M. Nijhoff, 1939-1953 ; août-septembre 1618, vol. I, p. 208-209. Sur Beeckman, voir
K. van Berkel : Isaac Beeckman (1588-1637) and the Mechanization of the World Picture.
Amsterdam, Rodopi, 1983, puis (id.) Isaac Beeckman on Matter and Motion : Mechanical
Philosophy in the Making, Philadelphia, Johns Hopkins U. P., 2013.
5. E. Canone, « Il catalogus librorum di Isaac Beeckman », Nouvelles de la République des
Lettres, Naples, 1991/1 (p. 131-159). Les première notes de Descartes portent la marque
de plusieurs lectures sans aucun doute postérieures à la scolarité à La Flèche, comme celle
du médecin Levin Lemnius, De occultis miraculis naturæ, que Beeckman possède dans sa
bibliothèque et discute dans son Journal.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 50 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 51
ouvrage, lu et apprécié de Beeckman, a pu inspirer les réflexions que Descartes,
désormais, consigne dans un cahier offert par son ami au mois de janvier de
l’année 16191.
Depuis ses premiers essais en compagnie de Beeckman, Descartes nourrit
le projet d’une réforme de la géométrie et de la mécanique. En matière de
géométrie, ayant aperçu « une espèce de lumière dans l’obscur chaos de cette
science », il entend produire une science « foncièrement nouvelle », susceptible
de résoudre toutes les questions dans tous les genres de la quantité (continue
ou discrète)2 . Beeckman, admiratif, pensait y voir les rudiments d’un « art
de résoudre toutes les questions » (ars quæsita ad omnes quæstiones solvendas).
L’habileté mathématique de Descartes semble l’avoir moins impressionné que
son ambition synthétique et son exigence d’universalité.
Mais les moyens d’un tel achèvement de la science géométrique exigent
réflexion. Comment cette mise en ordre systématique est-elle possible ? C’est
pour y répondre que Descartes recherche du côté de la logique, et notam-
ment d’une forme de logique assez obscure mais très en vogue au début du
XVIIe siècle : l’art de Lulle. Il ne tirera aucun profit de cette espèce de combi-
natoire logique, que la néo-scolastique allemande contemporaine tâche quant
à elle d’intégrer à sa refonte de la logique aristotélicienne (Alsted), si ce n’est
que les ambitions de ces lullistes, en qui il ne voulut jamais voir que de préten-
tieux bavards3, l’amèneront à concevoir l’idée d’une méthode concrètement
universelle (donc radicalement opposée à ce formalisme), dont dépende aussi
bien la possibilité d’une quelconque démonstration géométrique que celle de
l’existence de Dieu.
Même si, pour les lecteurs modernes, le concept de « méthode » renvoie
immédiatement et presque primitivement à Descartes, on ne peut toutefois
comprendre le cheminement propre de sa pensée qu’en imaginant le contraire,
à savoir qu’il finit par donner ce nom commun, et même totalement vulgarisé
à son époque4, à cette science universellement inventrice dont il aperçoit la
possibilité aux confins des mathématiques et de la logique, encore que l’état
historique de ces disciplines devenues parfois très obscures ne permette guère
d’en donner une idée exacte. De cette science il est, sans conteste, le seul
1. Sur les premières notes et l’organisation matérielle de ce registre, voir H. Gouhier, Les
premières pensées de Descartes. Contribution à l’ histoire de l’anti-Renaissance, Paris, Vrin,
1958, 1979² ; G. Rodis-Lewis, Le Développement de la pensée de Descartes, Paris, Vrin, 1997.
2. À Beeckman, 26 mars 1619, AT X, 156, 7-158, 2.
3. Voir à Beeckman, 29 avril 1619, AT X, 164, 15 – 165, 23. Puis DM II, AT VI, 17, 19-20,
où l’art de Lulle est dit ne servir qu’à « parler, sans jugement, de celles [sc. les choses] qu’on
ignore ».
4. Sur l’usage original que Descartes fait d’un concept dont l’histoire est déjà ancienne,
voir E. Lojacono, « Epistémologie, méthode et procédés méthodiques dans la pensée de
R. Descartes », Nouvelles de la République des Lettres, Naples, 1996, 1, p. 39-105.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 51 08/01/15 12:07
52 Descartes
et unique inventeur, en tant qu’il ne s’est pas contenté d’en soupçonner la possi-
bilité, comme tant d’autres le font1, mais qu’il a assumé jusqu’au bout les consé-
quences de cette découverte, dans l’ordre spéculatif et pratique : dans l’ordre
spéculatif car cette « méthode » renouvelle complètement la manière tradition-
nelle de comprendre la subordination des sciences théorétiques (métaphysique,
physique, mathématique) les unes aux autres ; et dans l’ordre personnel, parce
qu’elle exige – autant qu’elle la produit – une maturation progressive de l’esprit,
une résolution pratique, et, en un mot, un ethos spécifique. Bref, elle fait d’un
simple particulier, n’ayant pour lui que le bon sens, celui qui doit changer
le visage même des sciences, en leur ôtant ces masques qui les défigurent 2 .
Vocation dont Descartes, partagé entre son désir de tranquillité et l’obligation
morale de partager la vérité avec son prochain, a bien fait sentir, sans pathos
excessif, le poids et la difficulté.
La rareté de la lumière naturelle
La vocation philosophique de Descartes ne s’est donc décidée qu’au cours
de ses pérégrinations allemandes, entamées au printemps de l’année 1619,
voyage dont l’itinéraire et les lieux restent encore assez imprécis ou douteux.
L’indication la plus ferme est donnée par le Discours de la Méthode, par
lequel on apprend que le jeune militaire se trouve, vers la fin de l’été, aux
1. Un bon exemple serait ici celui de du philosophe et pédagogue Jan Amos Comenius (1592-
1670), dont l’anglais Samuel Hartlib publie les Conatuum Comenianorum præludia (Oxford,
1637) réédité sous le titre de Pansophiæ Prodromus (Londres, 1639). En dépit d’une évidente
communauté de vues sur la nécessité de la méthode pour parvenir gradatim à la totalisa-
tion du savoir à partir des choses les mieux connues (notissimis), toutes se tenant comme
les anneaux d’une chaîne (ut in catena annulus annulum excipit ac trahit), le jugement de
Descartes sur Comenius sera très sévère, considérant qu’il s’agit chez lui de déclarations
programmatiques sans effet ni contenu. À ce sujet, voir la lettre retrouvée et éditée par
E. J. Bos et J. van de Ven, « Se nihil daturum. Descartes’s Unpublished Judgement of
Comenius’s Pansophiæ Prodromus (1639) », British Journal for the history of philosophy 12 (3),
2004, p. 369-386. Descartes semble avoir eu, depuis quelques années déjà, des contacts avec
le groupe de Samuel Hartlib. G. H. Turnbull (Hartlib, Dury and Comenius from Hartlib’s
papers, London, 1947, p. 167), rapporte un témoignage précieux sur Descartes, à savoir
le rapport d’un entretien avec John Dury, qui eut lieu pendant l’hiver 1634-1635, et où il
fut notamment question d’une « General method of Gen. Et Analys. for the study of all
things ». Descartes aurait fait part, dans cet entretien, d’une méthode d’analyse et donné son
sentiment sur les limites de son application. Dury et Descartes semblent s’être entendus sur
les « principes à partir desquels peut être démontrée la certitude des choses » en philosophie
et en métaphysique. Mais, au reste, Descartes semble surtout avoir insisté sur les raisons
de douter de cette certitude (« He could find no certainties almost in any thing, though
he was able to discourse as largely of any thing as any other »). Source incomparable pour
la connaissance de cette période, les Hartlib Papers ont été tout récemment mis en ligne :
http://hridigital.shef.ac.uk/hartlib.
2. Cog. Priv., AT X, 215, 1-4 ; l’édition Carraud-Olivo réinsère ce fragment dans le Studium ,
op. cit. p. 139 : « À présent les sciences sont masquées ; les masques enlevés, elles apparaîtraient
dans toute leur beauté. À qui voit complètement la chaîne des sciences, il ne semblera pas
plus difficile de les retenir dans son esprit que de retenir la série des nombres ».
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 52 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 53
fêtes données à Francfort pour le couronnement de l’Empereur1. L’événement
politique, d’une importance majeure en ce temps de conflits européens, se
double d’une activité scientifique effervescente : la capitale européenne du livre
diff use, cette année là, de nombreuses publications témoignant des dernières
avancées de la science : l’Oculus seu Fundamentum Opticum de Scheiner, qui a
sans doute servi à l’élaboration de la partie physiologique de la Dioptrique ; mais
aussi les Harmonies du monde du mathématicien Johannes Kepler. Grandiose,
cet ouvrage dévoile ce qu’il présente lui-même comme le socle ou le fondement
de la science astronomique, et que la postérité retient sous le nom de « troi-
sième loi de Kepler » ; les Harmonies proposent aussi une réflexion de fond sur
l’essence et les limites du savoir géométrique à laquelle Descartes s’est, selon
toute vraisemblance, mesuré de manière fructueuse.
C’est à partir de cette période que les choses se sont décidées pour Descartes,
et qu’elles s’obscurcissent pour ses historiens qui, faute d’archives, doivent se
rabattre sur les témoignages parfois douteux de ses premiers biographes.
Le témoignage majeur concernant cette période est celui de Daniel Lipstorp2
qui attribue à Descartes une rencontre et une collaboration avec le mathéma-
ticien ulmien Johannes Faulhaber. À ce jour, aucun document ne permet de
l’attester formellement, et plusieurs incohérences du récit de Lipstorp, comme
son caractère stéréotypé, permettraient d’en critiquer aisément l’authenticité3.
Si la question mérite toutefois d’être discutée, c’est que les enjeux en sont
décisifs pour la compréhension du développement de la pensée de Descartes. Il
est avéré que Descartes et Faulhaber travaillent, en 1619-1620, avec les mêmes
outils mathématiques originaux sur des problèmes semblables, qui ont trait à
l’algèbre et à ce que la tradition allemande appelle alors les « nombres figurés ».
Mais cette communauté d’objet a ceci d’étonnant qu’elle procède par ailleurs
de deux styles fort différents, voire incompatibles : la manière dont Faulhaber
protège ses inventions sous le voile du « secret » et du « miracle4 » pourrait être
1. DM II, AT VI, 11, 3-7.
2. Témoignage reproduit par AT dans l’Appendice III aux Cogitationes Privatæ, AT X, 252-253.
3. I. Schneider, Johannes Faulhaber, 1580-1635, Rechenmeister in einer Welt des Umbruchs,
Vita Mathematica, 7, Birkhäuser, 1993, ch. 9, pp. 171-198.
4. La « règle » pour la solution des équations de quatrième degré est exposée dans l’ouvrage
intitulé Miracula Arithmetica : zu der Continuation seines arithmetischen Wegweisers gehörig
(Augsburg, Francken, 1622) où c’est très vraisemblablement Descartes qui est cité sous le
pseudonyme de « Carolus Zolindius (Polybius) » comme possédant lui aussi de tels « secrets ».
K. Hawlitschek, Johann Faulhaber, eine Blütezeit der mathematischen Wissenschaften in Ulm,
Ulm, 1995, et K. Manders, « Descartes et Faulhaber », Bulletin Cartésien XXIII (Liminaire),
n’hésitent pas à identifier Descartes sous ce pseudonyme, au contraire de I. Schneider
(voir note précédente), plus réticent. Il y a en tous les cas, à cet égard, une avancée par
rapport aux travaux de P. Costabel sur les Exercices pour les éléments des solides, Paris, PUF,
1987. Sur la question, voir également E. Penchèvre, « L’œuvre algébrique de Faulhaber »,
Oriens – Occidens, Cahiers du Centre d’Histoire des Sciences et des Philosophies Arabes
et Médiévales, n° 5, 2004, p. 187-222.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 53 08/01/15 12:07
54 Descartes
à l’origine de cette aversion constante du secret et de l’arcanum1, par laquelle
Descartes en vient à exclure des limites du savoir tout ce qui ne fait pas l’objet
d’une connaissance fondée sur l’évidence de l’intuitus mentis, à telle enseigne,
d’ailleurs, que la dimension spirituelle de la « profondeur » devient immédia-
tement suspecte d’obscurité et de confusion : qu’y a-t-il de plus profond que
les précipices, et de plus abyssal que la vanité2 ?
Mais la puissance de la lumière naturelle est telle qu’elle en illumine malgré
tout les ténèbres, comme elle « pénètre jusque dans les secrets des plus curieuses
sciences3 ». Ainsi cette lumière naturelle, « toute pure », donc inviolable et
incorruptible, qui détermine d’autant mieux les opinions humaines qu’elle
n’y est pas soumise, qui déniche l’imposture, où qu’elle se cache, et indique
le droit chemin à l’« honnête homme », n’est-elle pas l’avatar de cette Themis
à qui l’étudiant en droit de 1616 avait déclaré faire vœu de fidélité 4 ? Du
style mythologique, et de la prosopopée, Descartes est donc passé, mais sans
véritable solution de continuité, à celui plus sobre de la philosophie, appelant
désormais « sagesse universelle », ou « lumière naturelle » cette puissance qui
éclaire les esprits sans se résoudre en eux.
Mais il y a là une difficulté essentielle : pourquoi cette « sagesse » reçoit-
elle désormais le nom de « sagesse humaine5 », si la vérité et l’erreur qui sont
dans les pensées que les hommes forment sur les choses ne l’affectent pas ? Et
pourquoi identifier, comme le fait la Règle I, cette sagesse invariable au « bon
sens » ? Cette question rejoint, sans se confondre avec elle, celle qui provoquait
l’étonnement initial de Descartes : pourquoi, si le bon sens et la lumière natu-
relle sont universels, sont-ils si rares chez le hommes ?
C’est à peu de choses près la question consignée dans le Journal de Beeckman
en 1628 (Docti cur pauci [Pourquoi il y a si peu de savants])6, contemporaine d’une
probable reprise par Descartes des Regulæ ad directionem ingenii. Beeckman
incrimine pour sa part une espèce de précipitation chronique par laquelle les
esprits « désirent incontinent écrire » (statim scripturiunt), regardent à peine ce
qu’ils inventent, et se tournent toujours vers de nouvelles choses, « étouffant
son esprit (ingenium), pourtant apte à parfaitement découvrir de nombreuses
choses, sous une multitude de travaux inutiles ». L’abstinence de Descartes à
l’égard de l’écriture devient donc la clé de son succès :
1. Sur la question, voir la remarque de la lettre à Mersenne, 20 novembre 1629, AT I, 78, 8-10.
2. Reg. X, AT X, 405, 9-13 : … nonnisi confusam acquirunt scientiam, dum cupiunt profundam…
3. C’est le titre de La Recherche de la vérité par la lumière naturelle, AT X, 495, 7-8.
4. Sur la datation de la Recherche, et une présentation synthétique de cette œuvre, voir l’édition
de E. Lojacono, La Ricerca della verità mediante il lume naturale, Roma, Editori Riuniti,
2002 (trad. fr. : R. Descartes, La Recherche de la Vérité par la lumière naturelle, Paris, PUF
Quadrige, 2009).
5. AT X, 360, 8.
6. AT X, 331-332.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 54 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 55
« Lui n’a encore rien écrit, mais il semble que, en méditant jusqu’ à
l’ âge de trente trois ans, il ait découvert plus parfaitement que les autres
cette chose qu’ il cherchait1 ».
Quant à la version cartésienne, elle repose sur une analyse beaucoup plus
approfondie de la perversion intellectuelle : le désir de savoir, qui n’est pas une
maladie incurable2 mais l’expression même de la nature de l’homme, a fait
place à une « curiosité aveugle3 », c’est-à-dire ignorante à l’égard des objets
– ou plutôt des ombres – qu’elle embrasse compulsivement, et des moyens
de se satisfaire ; la curiosité n’est pas tant le fait des individus que du genre
humain tout entier4, elle fait des hommes des « mortels5 ». Dans cet extrême
affaiblissement de la nature humaine, devenue chroniquement sujette à l’erreur
(mais plus par accident que par essence) l’esprit continue de posséder cette
lumière naturelle instinctivement, sous la forme de l’intuitus mentis, mais il
entre en conflit avec une autre espèce d’instinct naturel, à savoir « une certaine
impulsion de la nature à la conservation de notre corps, [et] à la jouissance
des voluptés corporelles6 ». Il faut donc, pour rétablir le bon sens, ne dériver
la connaissance que de l’instinct qui ne trompe jamais, l’intuitus, et débouter
les prétentions du second, donc récuser le « témoignage fluctuant des sens »,
ou le « jugement faux de l’imagination7 ».
Il n’y a donc, en soi, aucune difficulté pour l’entendement à repérer les idées
claires et distinctes auxquelles il se porte spontanément, voire instinctivement,
mais ce qui rend pour nous cet exercice pénible et difficile, c’est que les mortels
ont aussi cette inclination sourde à l’obscurité qui entrave l’épanouissement
de leur vraie nature. La curiosité les pousse à dédaigner toujours la facilité
(propre à l’intuitus mentis) au profit de leurs « méditations obscures ». On ne
peut donc pas considérer que la lumière naturelle refuse ses dons, ou qu’elle est,
comme l’Artémis de la fable, et comme si sa pureté nous la devait rendre inac-
cessible, d’une telle nature que nul mortel ne peut l’embrasser du regard8. Le
fait est, si étonnant soit-il, que presque personne ne le veut, et que, détournant
1. Cette chose recherchée n’est probablement pas autre chose que la philosophie : DM IV,
AT VI, 32, 28 : « … la philosophie que je cherchais » (nous soulignons).
2. Cf. La Recherche de la Vérité [Epistemon] AT X, 499, 24-26.
3. Reg. IV, AT X, 371, 4.
4. Reg. II, AT X, 362 : communi quodam gentis humanæ vitio ; Reg. IX, AT X, 401, 11 : commune
vitium mortalibus.
5. AT X, 401, 11 ; 446, 12.
6. À Mersenne, 16 octobre 1639, AT II, 599, 6-12. C’est cette lettre (commentaire sur le De
Veritate de Herbert de Cherbury) que cite littéralement Husserl dans un inédit de jeunesse
sur Descartes édité par C. Majolino : « Un inedito del primo Husserl su Cartesio », Nouvelles
de la République des Lettres, 2003 I-II, p. 181-189 (sub fine).
7. Reg. III, AT X, 368, 13-17.
8. Rappelons qu’en grec artemès signifie « intact », « pur » (cf. Platon, Cratyle, 406b).
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 55 08/01/15 12:07
56 Descartes
leurs regards vers des objets futiles et obscurs, presque tous se dénaturent eux-
mêmes ; « perpétuellement travaillés d’une curiosité insatiable1 », ils sont voués
à être dévorés par leurs appétits, tel l’infelix Acteon dévoré par ses chiens.
L’isolement et le scepticisme
Le Studium bonæ mentis – pour autant que l’on puisse se fier aux indications
de Baillet, à qui l’on doit tout ce que l’on sait de ce texte perdu, probablement
entrepris au tout début des années 1620 – prescrit donc un travail de réadap-
tation à cette lumière naturelle que les mortels fuient plus souvent qu’ils ne
la suivent. Inutile de dire que, dans cette perspective initiale, la soupçonner
de fausseté ou de tromperie ne peut procéder que d’un esprit aveuglé qui en
ignore l’essence et en méconnaît les bienfaits. Tel le scepticisme, qui est fonda-
mentalement déraisonnable et inconsistant. Sur ce point, on peut penser que
l’entreprise du Studium bonæ mentis et des Regulæ ad directionem ingenii ne
se démarque pas encore significativement de la grande apologie des sciences,
et de leur « vérité », dont le Père Mersenne est un des principaux instigateurs.
C’est en effet dès la Vérité des sciences contre les septiques et les pyrrhoniens (1625)
que Mersenne énonçait l’argument dont procèdera le cogito cartésien – qu’on
ne peut douter qu’on doute. Il n’est que d’en lire la première phrase pour se
convaincre que l’offensive mersennienne contre le scepticisme détermine pour
partie l’entreprise du Discours de la Méthode :
« Il n’y a rien au monde qui ait tant de puissance sur nos esprits que
la vérité […], l’entendement n’ayant point de liberté pour rejeter la vérité
lorsqu’elle est évidente2 ».
Tant de naïveté peut faire sourire, mais ne risque pas de faire désarmer le
scepticisme, et l’on ne s’étonne pas que le sceptique F. de la Mothe le Vayer
puisse sereinement répliquer dans les Dialogues d’Orasius Tubero (1630), en
ironisant sur la définition de la philosophie comme science de la vérité (epis-
témè tès alètheias), que « cette science de vérité n’est pas le partage de notre
humanité », et qu’« il n’y a aucune chose qui soit si naturelle à l’homme que
de se tromper lui-même3 ».
1. Recherche [Eudoxe] AT X, 500, 14-15.
2. Marin Mersenne, La Vérité des sciences contre les septiques et les pyrrhoniens (Paris, Toussaint
du Bray, 1625, Préf., n. p.). Sur la réfutation mersennienne du scepticisme, et les « emprunts »
évidents que Mersenne fait à Campanella, voir G. Paganini, « Mersenne plagiaire ? Les
doutes de Campanella dans La Vérité des sciences », XVIIe siècle, 2005-4, p. 747-767. Puis,
sur le doute cartésien, id., Skepsis. Le débat des modernes sur le scepticisme, Paris, Vrin, 2008,
ch. V.
3. [François de la Mothe le Vayer] Cinq dialogues faits à l’ imitation des Anciens par Orasius
Tubero (tome II), De l’ ignorance louable, [sans lieu, sans date, 1630-1631], p. 64 et p. 74.
Il s’agit, selon toute vraisemblance, du « méchant livre » que Descartes projetait de réfuter
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 56 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 57
À la différence de Mersenne, Descartes jouera contre le scepticisme avec
beaucoup d’ironie, et avec – en un sens bien précis – une certaine perméa-
bilité aux arguments du scepticisme ; lequel, beaucoup plus qu’un adversaire
obligeant la philosophie à de vaines polémiques, devient chez lui un moment
nécessaire dans l’instauration de l’ego cogito en premier principe. Les lettres
de Descartes à Mersenne de l’année 1630 témoignent d’une certaine commu-
nauté de vue avec le scepticisme, au moins en ce qui concerne l’inconvenance
et l’impossibilité pour la philosophie et la théologie de se prêter mutuellement
secours, et de se « mesler » des affaires de l’autre1. Mais ce que Descartes, à
la différence de Mersenne, reproche aux « sceptiques et pyrrhoniens », c’est
plutôt leur dogmatisme implicite et leur défaut de radicalité que leur excès de
scepticisme. Le point aveugle du scepticisme, c’est son point commun avec le
dogmatisme : les soi-disant « esprits forts » croient non moins que les autres
à leur propre rationalité, et faute de voir qu’ils croient à la raison aussi naïve-
ment que tout homme croit avoir un corps, ils n’atteignent pas le sol de l’ego
cogito, ce sol d’évidence originaire sans référence auquel la prétendue « vérité
des sciences » n’aurait pas plus de valeur ni de légitimité que les chimères d’un
mélancolique2 . La « découverte métaphysique » de ce sol d’évidence ouvre à la
en 1630. Du moins est-ce l’hypothèse la plus fréquemment retenue depuis les travaux de
R. Pintard jusqu’à ceux de R. Popkin. Voir à ce sujet É. Mehl, « Le méchant livre de 1630 »,
dans Libertinage et philosophie au XVIIe siècle, 1, Saint-Étienne, Publications de l’université
de Saint-Étienne, 1996, pp. 53-67.
1. Comparer à Mersenne, 6 mai 1630, AT I, 150, 24 : « Je ne veux pas me mesler de la théologie,
j’ai peur même que vous ne jugiez que ma philosophie s’émancipe trop », et le Dialogue
De la Divinité (op. cit., vol. I, p. 413) : « […] Ce n’est pas sans sujet que… le philosophe
Euphrates donne lui-même conseil… de ne croire jamais la philosophie quand elle se mêle
de choses divines ». Plus encore, dans la lettre suivante (27 mai 1630, AT I, 153, 4-13) où
Descartes refuse de répondre à Mersenne à la question « convient-il à la bonté divine de
damner les hommes pour l’éternité ? », la justification avancée (« pour ce que je tiens que c’est
faire tort aux vérités qui dépendent de la foi […] que de les vouloir affermir par des raisons
humaines… ») prend résolument le parti du scepticisme, ici fidéiste, que Mersenne veut lui
faire combattre : cf. Le Vayer, de l’Ignorance Louable, op. cit., p. 104 : « pour ce que je tiens
que c’est faire tort au christianisme de l’autoriser, et avec lui l’immortalité de l’âme, sur des
opinions humaines prises de la philosophie ». Descartes ayant expressément demandé à
Mersenne de faire circuler ses Lettres de 1630, et le dialogue De l’Ignorance Louable n’ayant
été publié qu’en 1631, il n’est pas exclu que Descartes ne soit ici la source de Le Vayer, et
non l’inverse !
2. La célèbre interprétation foucaldienne du cogito (Histoire de la folie à l’ âge classique, 1972)
est prise au piège de son propre présupposé : qu’il y a une constante confusion, chez
Descartes, entre l’expérience de la pensée et l’usage de la raison. Mais peut-on comprendre
Descartes sous le signe un peu obscur, sinon mythologique, d’un « avènement de la ratio » ?
Cette détermination époquale est solidaire d’une conception de la « rationalité moderne »
comme déploiement d’une épistémè de l’ordre et de la mesure, elle-même référée à l’idée
de mathesis universalis (lecture de la modernité cartésienne dont le meilleur représentant
est incontestablement Léon Brunschvicg, cf. L. Brunschvicg, Ecrits Philosophiques, tome I :
L’ humanisme de l’Occident. Descartes, Spinoza , Pascal, Paris, PUF, 19512). Mais il faudrait
poser à Foucault (et à Brunschvicg, dont il dépend étroitement) une question qui excède,
certes, le cadre du présent travail : faut-il considérer que le tournant de la modernité se
traduit par le passage à une épistémè de l’ordre et de la mesure, au lieu de l’épistémè de la
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 57 08/01/15 12:07
58 Descartes
philosophie un horizon nouveau, que les différents protagonistes de la querelle
du libertinage1 ne pouvaient pas même soupçonner. On essaiera certes d’y
enrôler Descartes, mais au prix de multiples malentendus et contresens au sujet
d’une « métaphysique » qui, n’en déplaise aux uns (Mersenne), ne prouve pas
l’immortalité de l’âme, et, n’en déplaise cette fois au scepticisme phénoméniste
des autres, trouve dans l’évidence ultime de l’idée d’infini la mesure de toute
vérité, de toute réalité et de toute existence.
La crise de l’exemplarité
Que la « lumière naturelle » soit identifiée à la sagesse « humaine » et
« universelle » (Règle I) s’avère finalement beaucoup moins problématique
que la question de savoir où se trouvent réellement des « hommes purement
hommes2 », s’il est vrai qu’il ne s’en trouve quasi aucun qui sache faire bon
usage de « la seule chose qui nous rend hommes », à savoir la raison3. À cet
égard il faut souligner une sorte de radicalisation hyperbolique de ce « presque
personne4 ». Chacun ne pense qu’à se distinguer. Mais qui saurait être « pure-
ment homme », c’est-à-dire n’être rien de plus ni de moins que tout autre ?
Force est en effet de constater ici la persistance d’une question nouvelle qui, de
Montaigne à Nietzsche, ne cesse d’accuser une gravité croissante : la question
de savoir qui est capable d’assumer la tâche de la philosophie. Car à supposer
même que le sujet de la philosophie soit l’« homme purement homme », on
sait qu’ils sont rares, s’il s’en trouve même un seul.
Montaigne avait souligné cette difficulté, provoquant ce qu’on pourrait
appeler une crise de l’exemplarité : « il est fort peu d’exemples de vie pleins
et purs5 ». Cette rareté en fait d’ailleurs le prix. Mais ce sont les exemples
qui manquent, et cette carence des exemples n’est pas nécessairement celle
des originaux. La rareté des exemples adéquats s’explique assez bien : d’abord
l’exemple peut comporter quelque chose de défectueux, et la relation d’une
vie n’être pas si parfaite que son modèle. Eût-il les qualités d’un Plutarque,
similitude, supposée caractériser le savoir renaissant (Les Mots et les choses) ? Ou bien cette
épistémè de l’ordre et de la mesure, peut-être plus adéquatement représentée par Copernic que
par Descartes, n’est-elle pas reprise et réfléchie, par ce dernier, dans ce qu’il faudrait appeler
une epistémè de la réflexion, dont dépendraient aussi bien les Regulæ que les Meditationes ?
1. Où l’on voit intervenir bon nombre de familiers de Descartes, notamment Mersenne,
Silhon, Guez de Balzac. Sur ce contexte intellectuel, voir R. Pintard, Le libertinage érudit
dans la première moitié du XVIIe siècle, Paris, Boivin, 1943, Genève, Slatkine, 2000².
2. DM I, AT VI, 3, 22.
3. DM I, AT VI, 2, 27-29.
4. Reg. I, AT X, 360, 19.
5. Les Essais, III, 13, « De l’expérience », éd. Villey-Saulnier, rééd. Paris, PUF, 1999, p. 1110 C ;
il s’agit d’un ajout de la couche C dans une page fortement réécrite ; voir http://artflsrv02.
uchicago.edu/images/montaigne/0501v.jpg.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 58 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 59
aucun auteur ne saurait rendre l’exemple parfaitement conforme à un modèle
qu’il n’est pas lui-même. Il n’y aurait donc pas d’« exemple pur » en dehors de
l’autobiographie. Mais la difficulté se redouble puisqu’une vie pleine et pure
est par définition une vie occupée à se vivre et non à se raconter. De surcroît
la sagesse est aux actions les plus ordinaires, et « la forme de vie plus usitée et
commune est la plus belle » ; le paradoxe est inévitable : ou bien on donne en
exemple une vie qui se distingue de la vie « usitée et commune », auquel cas
il risque d’illustrer plutôt la folie et l’outrecuidance que la sagesse du modèle ;
ou bien on donne l’exemple d’une vie commune, « basse et sans lustre », mais
l’exemple perd alors toute signification, puisqu’il n’y a plus aucune raison à
citer celle-ci plutôt que celle-là. De deux choses l’une : ou l’exemple est extra-
ordinaire, donc mauvais, ou bien il est ordinaire, et nul.
La philosophie du Discours de la Méthode est elle aussi traversée, mais aussi
bien convoquée par cette crise de l’exemplarité, crise qui détermine autant
l’impossibilité de suivre un exemple (« je fus comme contraint de me conduire
seul ») que d’en constituer un pour les autres1. Si l’exemple conserve une fonc-
tion déterminante (quand bien même provisoire) dans la morale, où l’auteur
se détermine à suivre l’exemple des « mieux sensés » (première maxime), des
voyageurs égarés (seconde maxime) et des philosophes (troisième maxime), la
recherche de la vérité dans le domaine théorique exige qu’on emprunte la voie
de l’homme « purement homme », celle que précisément personne ne suit, car,
Montaigne l’avait encore dit « on va bien plus facilement par les bouts […]
que par la voie du milieu large et ouverte » (III, 13, ibid.). S’il faut se défaire
de toutes ses opinions, et les neutraliser, c’est parce qu’il faut devenir, comme
le singulier-universel Poliandre de la Recherche de la vérité, une « personne
neutre2 ». À cet égard l’anonymat du Discours de la Méthode est beaucoup plus
une nécessité d’ordre philosophique qu’une affaire de politique et de stratégie
éditoriale.
L’origine de la géométrie
Vrai « centre de gravité du dialogue » (E. Lojacono), Poliandre, l’homme
idéalement neutre, est un personnage théorique, une fiction heuristique, ou
plus exactement une supposition du discours. Il n’est pas sans évoquer un autre
personnage, tout aussi théorique, sous le nom duquel Descartes semble avoir
1. DM I, AT VI, 4 : « … ne proposant cet écrit que comme une histoire, ou, si vous l’aimez
mieux, comme une fable, en laquelle, parmi quelques exemples qu’on peut imiter, on en
trouvera peut-être aussi plusieurs autres qu’on aura raison de ne pas suivre… ». La neutrali-
sation de toutes les opinions n’est pas non plus un exemple recommandable (DM II, AT VI,
15, 12-15).
2. AT X, 502, 20.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 59 08/01/15 12:07
60 Descartes
envisagé la publication de ses premiers travaux mathématiques : « Polybe
Cosmopolite ». De ce projet ne subsiste qu’un titre dont le maniérisme a paru
très longtemps pasticher la littérature hermétique : « trésor mathématique de
Polybe Cosmopolite1… ».
Pourquoi l’invention de ce nouveau personnage, pourquoi cette fiction ? Il
ne s’agit selon toute vraisemblance que d’un masque, et d’un jeu, mais le jeu
bien mené mène parfois à l’intime vérité des choses2 . Et de fait la personnalité
de Polybe contient le trésor de la pensée cartésienne. Rien n’est plus mysté-
rieux, mais rien n’est en même temps plus évident que ce personnage. Ce nom
est en effet emprunté à un des textes les plus célèbres de la culture classique :
c’est dans l’Odyssée qu’apparaît ce personnage de second rang, simple figurant
d’une scène énigmatique à laquelle Descartes apporte ce faisant un éclairage
singulier. Selon le récit homérique3, Polybe est originaire de la Thèbes d’Égypte,
la ville qui « regorge de trésors » ; Polybe et son épouse Alkandre (couple dont
Poli-andre est donc l’exact diminutif) ont en effet tous deux offert les trésors
qu’on dispose devant Télémaque quand paraît à ses yeux éblouis son hôtesse,
Hélène, dans une apparition dont le poème suggère le caractère surnaturel en
la comparant à la déesse Artémis (« on eût dit Artémis à la quenouille d’or »).
L’intelligibilité de cette séquence est étroitement liée à la suite du récit : après
que Télémaque s’est dévoilé à ses hôtes comme le fils d’Ulysse, et que tous en
ont pleuré la disparition, Hélène verse à Télémaque le fameux « népenthès »,
ce pharmakon qui guérit comme magiquement toutes les blessures de l’âme4.
Or ce précieux pharmakon a la même provenance que les présents de Polybe :
c’est d’Égypte qu’il lui a été apporté, et Homère de louer ce peuple dont les
« médecins » sont les « les plus savants du monde ». À tel point qu’une tradition
ancienne s’est plu à forger la fable d’un Homère égyptien, et même précisément
thébain : Polybe pourrait donc se concevoir comme un avatar et un hétéronyme
d’Homère, cryptant dans cet épisode crucial de la Télémachie la fable de ses
propres origines 5. Quoi qu’il en soit, Plutarque puis Macrobe ont donné de
1. AT X, 214, 9-14, traduction.
2. Cf. Reg. X, AT X, 405, 15-16.
3. Homère, Odyssée, IV, 125 sq. Sur les textes que nous commentons ici, voir les analyses
historiquement éclairantes de C. Froidefond, Le mirage égyptien dans la littérature grecque
d’Homère à Aristote, Aix, Ophrys, 1971.
4. Homère, Odyssée, IV, 219 sq.
5. Jean de Sponde, dans ses Prolégomènes à sa grande édition d’Homère (1583, 1606), rappelle
que telle était en effet la thèse de l’écrivain Héliodore d’Emèse, auteur d’un passionnant
roman, les Ethiopiques, qui devint, entre autres, le livre de chevet de Jean Racine. Heliodori
Aethiopicorum libri X. Io. Bourdelotius emendavit supplevit, ac libros decem animadversionum
adiecit. Lutetiæ Parisiorum, L. Février, 1619 (lib. III, p. 149) : « Homerus ab aliis quidem
aliunde nominetur : et patria cordato sit urbs quævis viro. Erat autem revera nostras, Aegyptius :
et urbs illi Thebæ centiportes, ut ex ipso cognoscere licet », soit, selon la traduction de Jacques
Amyot rafraîchie en 1626 : « L’on renommera Homère d’où l’on voudra, & l’un le dira
estre d’une ville, l’autre d’une autre, l’on dira (si l’on veut) que toutes villes soient son païs :
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 60 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 61
cette scène une interprétation allégorique, identifiant l’ingénieux pharmakon
à l’art consommé de faire profiter à leur insu de la philosophie à ceux qui n’en
ont aucune idée, et qui n’ont peut-être que mépris pour elle1.
Comment l’idée d’interpréter allégoriquement les trésors de Polybe le
thébain comme le savoir mathématique2 a-t-elle pu venir à Descartes ? Une
connaissance même scolaire des classiques de la philosophie y suffit largement :
le mythe du Phèdre (274 sq.) qui traite de l’invention de la géométrie et de
l’écriture, attribue cette invention au dieu Thot, venu l’apporter à la « grande
cité » (tèn mégalèn polin), Thèbes, comme un « remède » (pharmakon) à l’ins-
cience et au défaut de mémoire3. Avec le mythe platonicien s’achève ce que déjà
une lecture attentive d’Homère pouvait suggérer : la mathesis, et l’écriture, qui,
en en conservant la mémoire libère ce faisant la nôtre4, ont bien, en tant que
telles, la vertu d’un pharmakon. Elle soigne l’esprit mieux que tout autre remède
des vices d’obscurité et de confusion, en accoutumant l’esprit à ne se sustenter
que de vérités évidentes, en tranchant les nœuds gordiens qui l’asphyxient,
bref, c’est cette mathesis qui, en rééduquant l’esprit à la lumière naturelle, lui
offre en même temps le seul moyen d’éprouver un plaisir (voluptas) qui est pur
(integra felicitas), non parce qu’il exclut les sens, mais parce qu’il exclut toute
douleur (nullis turbata doloribus5). Après la fiction discrète de ce berceau royal
mais à la verité il étoit de ceste region d’Egypte, natif de la cite de Thebes aux cens portes,
comme luy-mesme l’appelle ».
1. Plutarque, Moralia, 614 b tr. J. Amyot, 1572, II, 359-360 : « Car c’est cela que le poète
appelle Nepenthes, drogue qui garde sentir mal [sic] et qui charme la douleur, c’est à
savoir un parler discret qui sait bien accommoder aux affections, aux temps et aux affaires
qui se présentent, mais les hommes avisés et de bon jugement, encore que directement ils
parlent de Philosophie, conduisent leurs propos par voie douce et aimable de persuasion,
plutôt que par force et contrainte de démonstration » ; Plutarque en déduit directement
que « les questions faciles et légères exercent les esprits commodément et utilement, mais
il se faut abstenir et garder de disputes enveloppées et impliquées, qui étraignent comme
courroies… », ce qui constitue l’objet de la Règle X (AT X, 403-406).
2. Le Trésor de Polybe a été évoqué par un des plus célèbres alchimistes de l’époque : Leonard
Thurneysser zum Thun (1530-1596). Très célèbre et critiqué dans les années 1570 pour ses
fausses promesses et prétentions, Thurneysser fait de ce trésor et de ces richesses l’emblème
de son secret alchimique. Melô Kai Ekplerôsis Und Impletio, oder Erfüllung, der verheissung
Leonhardt Thurneissers zum Thurn…, Berlin, 1580, n. p. : « Uns will ich inen / wo sie also
die ware Tugend erwehlen / auss rechtem warhaftigem grund / wol so gewiss / als Tolemus
dem Cyclopi / dass ime sein Aug ausgestochen werden solt / weissagen / und sie gewiss
vertrösten / das Gott der Allmechtig / welcher ein wolgefallen / an auff richtigen erbarem
leben hat / ihnen solche gnad geben wirdt / damit sie bey solchen hohen Personen / nicht
allein ehrlich / lieb und werth gehalten / sünder dass sie auch mit keyserlicher / königli-
cher / auch Chur und Fürstlichen Begabungen beschenckt / und verehrt / und so reich
als Alcandra / die Thebanerin / welche eine Hausfrau Polibii war / werden sollen [Finis] ».
On ne saurait définir en termes mieux circonstanciés ce que pouvaient être « les promesses
d’un alchimiste » (DM I, AT VI, 9, 9-13) dont le philosophe a appris à se méfier.
3. Platon, Phèdre, 274 a.
4. Voir la fin de la Règle IV, AT X, 379, 10-13.
5. AT X, 361, 4-7.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 61 08/01/15 12:07
62 Descartes
de la géométrie, la rêverie de la royauté ne cessera de hanter Descartes, tirant
un contentement manifeste à la peinture de soi-même en « roi de quelque pays
à part1 ».
La vie tout entière du philosophe, comme son ami Pierre Chanut l’a bien
compris, gravite autour d’une décision : ne jamais s’écarter de la voie que trace
l’étude de la mathesis. Ce qui ne signifie aucunement, bien sûr, qu’il lui faille
consacrer sa vie à l’étude des mathématiques. Car ce n’est pas en tant que
voie vers la connaissance spéciale des disciplines mathématiques qu’elle a de
l’intérêt, mais c’est en tant que, voie médiane entre la physique et la métaphy-
sique, elle est aussi ce qui les médiatise, elle est donc le « chemin sûr » (tutus
iter, sicher Weg) qui mène à la connaissance de la philosophie comme totalité
achevée du savoir. Kant aurait donc tort d’imaginer que chaque science a son
chemin propre, et réussit plus ou moins bien à le parcourir2 : il n’y en a qu’un,
et c’est celui auquel Descartes a voulu consacrer sa vie.
Est & Non
Sachant que ce savoir ne sort pas de la tête d’un philosophe comme Minerve
de la tête de Jupiter3, et que l’achèvement d’un édifice dépend surtout de la
patience de l’ouvrier, Descartes n’a pu, dans un premier temps, qu’interroger
ses propres forces et anticiper cet achèvement. Les Olympica relatent un épisode
biographique assez signifiant pour faire l’objet d’une narration détaillée : il
s’agit d’une nuit (10 novembre 1619) où il eut trois songes qu’il pensa devoir
considérer comme prémonitoires.
Le premier de ces songes évoque figurativement l’instabilité vertigineuse du
doute, le second la résolution morale (syndérèse) qui procède d’un commande-
ment (interprété comme) divin, le troisième, plus détaillé et complexe, amène
le rêveur à interpréter le sens de deux poèmes dont l’un commence par une
question, Quod vitæ sectabor iter ? et l’autre par une affirmation, Est & Non. Il
s’agit effectivement de deux pièces du poète Ausone, situées au même endroit
d’un recueil scolaire des poètes latins dont il ne se sépare pas. Mais la seule
chose qui compte ici est le sens qu’il leur donne.
L’embarras quant au « genre de vie » (iter vitæ) préférable n’est sans doute
que pratique, si l’on admet que Descartes a déjà décidé de suivre le droit chemin
de la vérité par l’étude de la mathesis4. La question n’est pas de savoir s’il sera
soldat ou philosophe, mais de savoir quelle activité lui permettra de progresser
1. Recherche, AT X, 501, 8-12 : « … mon esprit… jouit du même repos que ferait le roi de
quelque pays à part ».
2. Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Einleitung, B VII sq.
3. Reg. V, AT X, 380, 14-16.
4. Reg. II, AT X, 366, 6-9.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 62 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 63
le plus sûrement dans son dessein. Dans l’ignorance des agissements extérieurs
de Descartes entre 1619 et 1629 il est difficile de préciser comment il aura
résolu cette question.
Le second poème l’a aussi marqué par son commencement : Est & Non.
Celui-ci est aussitôt signalé par Baillet comme le commencement d’une idylle
d’Ausone qui fait immédiatement suite, dans le recueil, au Quod vitæ sectabor
iter ? du même auteur :
« Par la pièce de vers Est & Non, qui est le Oui & le Non de Pythagore
[nai kai ou] il comprenait la Vérité et la fausseté dans les connaissances
humaines et les sciences profanes1 ».
Mais Baillet, qui a mal compris certains points d’un manuscrit qu’il jugeait
irrationnel, s’est arrêté trop tôt dans l’identification de la référence, qui recouvre
en fait plusieurs anomalies : Nai kai ou, titre manifestement inauthentique2, ne
traduit pas exactement le Est & Non du premier vers et ne fait que lui ressem-
bler ; Pythagore n’étant aucunement mentionné par l’idylle, on peut penser que
le titre lui-même est une glose d’éditeurs permettant de rassembler trois pièces
(XV-XVII, p. 655 dans l’édition de Descartes) d’un recueil au demeurant fort
disparate. Mieux, il semble que la mention de Pythagore dans ces titres ne soit
pas à prendre comme une indication thématique mais comme une indication
stylistique : ne faut-il pas comprendre qu’il s’agit de trois pièces imitées du grec,
dans le style gnomique qu’on dit avoir été celui des pythagoriciens ?
Seconde anomalie que Baillet ne relève pas : le contenu de l’idylle n’a aucun
rapport avec la question du vrai et du faux dans les connaissances humaines.
Risquons alors, contre Baillet, une autre hypothèse : Est & Non pourrait bien
renvoyer moins à Pythagore qu’au poème de Parménide, dans lequel Est &
non (estin te kai os ouk estin me einai) désigne la voie de la vérité, une voie
largement ouverte aux hommes mais que presque nul ne fréquente, une voie à
l’écart des sentiers battus par l’opinion, et même des chicaneries incessantes des
dialecticiens. Qui est amené par Thémis3 au seuil de cette voie devra apprendre
« toutes choses », de l’inébranlable vérité jusqu’aux opinions fausses dont il
faut savoir juger aussi bien que des vraies4. Qu’y aurait-il d’étonnant à ce que
le jeune Descartes ait vu dans le plus ancien monument de la « philosophie »
la figure du chemin qu’il aurait, lui-même, à parcourir ?
1. AT X, 184, 37-185, 2.
2. Sur les difficultés de lecture et d’interprétation de ces idylles, voir R. P. H. Green, The
Works of Ausonius, Oxford, Clarendon, 1991 (pour les textes concernés : p. 104-107).
3. Hermann Diels Parmenides ; Lehrgedicht (Berlin, Reimer, 1897), Sankt Augustin, Academia
Verlag, 20032 ; Parménide, Le Poème, traduction par Jean Beaufret, Épiméthée, PUF, Paris,
1955 (repris en Quadrige, PUF, Paris, 1996).
4. Dans le même sens, DM I, AT VI, 6, 13-16.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 63 08/01/15 12:07
64 Descartes
Qu’il faille comprendre, envers et contre Baillet, que Est & Non désigne la
voie sûre de la vérité, indiquée par la déesse du Proemium parménidien, nous
amène à formuler, à rebours d’Henri Gouhier, l’hypothèse que les « premières
pensées » de Descartes vont droit aux pensées les plus anciennes et les plus
fondamentales de la philosophie ; pour le dire avec Plotin, traduit en latin
par Marsile Ficin, Parmenides […] in idem ens intellectumque reduxit 1. Or
Descartes aura compris que pareille « réduction », loin d’appauvrir l’étant
réduit au concept, ou de sombrer dans l’abstraction idéaliste, ouvre la seule
voie praticable en la « recherche de la vérité2 ».
Pour l’heure, on peut avancer une réponse à la question en suspens : Quod
vitæ sectabor iter ? C’est le chemin ouvert de longue date, où le commun des
mortels toutefois ne s’avance guère, par crainte, qui sait, d’y sombrer en même
temps que leur curiosité. Descartes, quant à lui, ne se dérobera pas au destin
philosophique qui lui est ici comme annoncé. Mais ceci permet aussi d’entre-
voir que l’anonyme jouant sa philosophie – « la plus ancienne de toutes3 » – sur
un vers d’Homère, en même temps qu’il se rêve comme le sujet d’un poème
ressurgi de la mémoire humaine4, a bien une conception de l’histoire, qui, fût-
elle fabuleuse, mythique ou poétique, n’en demeure pas moins cette histoire
de la vérité dont les hommes sont tous tributaires, et les philosophes, plus que
tous, responsables.
En tenant, avec le Discours, et en avant-propos aux Essais (La Dioptrique, La
Géométrie et Les Météores), la promesse faite à Guez de Balzac d’écrire un jour
« l’histoire de son esprit », et d’y décrire « le chemin… tenu » et « le progrès…
dans la vérité des choses5 », Descartes n’a pas fondamentalement changé de
projet, ni cessé d’approfondir la méditation qui sous-tendait la plaisante fiction
de « Polybe le Cosmopolite ». L’anonymat de 1637 – aussi paradoxal que peu
efficace, si toutefois son but est d’éviter toute publicité à son auteur – témoigne
en effet d’une même stratégie d’écriture. Stratégie complexe, dans laquelle il
1. Plotin, Ennéades, V, 1, 8, tr. M. Ficin. Rappelons que la traduction par Marsile Ficin des
Ennéades (Florence, 1492) n’a été accompagnée du texte grec que beaucoup plus tardive-
ment (Bâle, 1580).
2. Sur le motif des « voies » de la recherche de la vérité, omniprésent dans les textes de
jeunesse, voir Reg. IV, AT X, 360, 24. On peut en outre comparer directement le motif,
chez Parménide, des « voies de recherche accessibles à l’intelligence » (Fr. 2), à Reg. VII,
AT X, 389, 4 : vias omnes, quæ… hominibus patent ; Reg. VIII, AT X, 396, 6 : vias omnes
quæ hominibus patent ad veritatem, et enfin DM II, AT VI, 10, 30 : « … les chemins que
je devais suivre ».
3. Epistola ad P. Dinet, AT VII, 596, 11-15. Princ., IV, art. 200.
4. Le Poème a été pour la première reconstitué et édité par Henri Estienne (Poesis Philosophica,
1573), une dizaine d’années après les Hypotyposes pyrrhoniennes de Sextus Empiricus, dont
Estienne avait offert une version accessible en latin (cf. G. Paganini, Skepsis…, op. cit.,
p. 38 sq.).
5. Guez de Balzac à Descartes, 30 mars 1628. Voir É. Gilson, Commentaire, p. 98, qui n’établit
pas particulièrement de rapport avec le motif du « larvatus prodeo ».
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 64 08/01/15 12:07
2. Les années de formation 65
s’agit toujours de plaire pour instruire (au lieu d’instruire pour plaire, comme
le font ceux des philosophes qui ne sont que des sophistes), et de divertir pour
convertir, en conviant les mortels à la recherche d’une vérité plus durable. Il n’y
a là ni ruse ni dissimulation libertine, pour cacher on ne sait quelle liberté de
penser – ou de ne rien penser –, mais bien l’expression d’une sagesse supérieure
(mêtis) qui dans l’écriture cartésienne s’avance, et quand bien même voilée se
révèle, car « la vérité se découvre toujours bien1 ».
1. À Ferrier, 8 octobre 1629, AT I, 37, 22. Voir également ci-après la contribution de F. Lelong.
9782340-003798_Descartes_mep1.indd 65 08/01/15 12:07
Vous aimerez peut-être aussi
- Discours de La MéthodeDocument77 pagesDiscours de La MéthodeBbaggi Bk100% (2)
- Discours de La Méthode. Descartes. 1637. - PhiloLog PDFDocument29 pagesDiscours de La Méthode. Descartes. 1637. - PhiloLog PDFBrice BricePas encore d'évaluation
- Etudes Textes + CoursDocument2 pagesEtudes Textes + CoursTeissia CasulliPas encore d'évaluation
- Qu' Est-Ce Que La PhiloDocument7 pagesQu' Est-Ce Que La Philohatim-ziad.erradiPas encore d'évaluation
- DESCARTES Discours MéthodeDocument3 pagesDESCARTES Discours MéthodeOlivier PamePas encore d'évaluation
- PHILOSOPHIE 2019-2020Document23 pagesPHILOSOPHIE 2019-2020Junior MASUDIPas encore d'évaluation
- DescartesDocument3 pagesDescartesManal El OualiPas encore d'évaluation
- Presses Universitaires de FranceDocument34 pagesPresses Universitaires de FranceNicolas BowerPas encore d'évaluation
- Descartes - Roger-Pol DroitDocument2 pagesDescartes - Roger-Pol DroitVinicius Ferreira da PaixãoPas encore d'évaluation
- 00 - Intro - La Philosophie Cheminement - RaisonDocument10 pages00 - Intro - La Philosophie Cheminement - Raisond9vpfhm5t8Pas encore d'évaluation
- COURS DE PHILO CHRIS 2Document63 pagesCOURS DE PHILO CHRIS 2Junior MASUDIPas encore d'évaluation
- France Examen Annale 3637Document4 pagesFrance Examen Annale 3637Anonymous PSO0vRfPas encore d'évaluation
- Untitled Document - Google DriveDocument15 pagesUntitled Document - Google Drivedestino ngassakiPas encore d'évaluation
- Fiche de Lecture Sur Discours de La MethodeDocument6 pagesFiche de Lecture Sur Discours de La MethodeJunior KouaoPas encore d'évaluation
- 20XX XX - Projet.livre ReneDocument4 pages20XX XX - Projet.livre ReneCheikh DahoPas encore d'évaluation
- Explication DM 01Document4 pagesExplication DM 01Selma AbbouPas encore d'évaluation
- Philosophie 1Document18 pagesPhilosophie 1Ana-Maria DimaPas encore d'évaluation
- Discours de La Methode de DescartesDocument3 pagesDiscours de La Methode de DescartesVincent Merle100% (1)
- Histoire de La Philosophie - DescartesDocument9 pagesHistoire de La Philosophie - DescartesJordan BachwaPas encore d'évaluation
- RA19 Lycee G 1-T HLP Exemple-Sujet-Commente Sujet-Zero3 1205359Document5 pagesRA19 Lycee G 1-T HLP Exemple-Sujet-Commente Sujet-Zero3 1205359Anonymous PSO0vRfPas encore d'évaluation
- Descartes À La Recherche de La Vérité. A-F BaillotDocument8 pagesDescartes À La Recherche de La Vérité. A-F BaillotCláudio ReichertPas encore d'évaluation
- Emile Brehier - La Création Des Vérités Éternelles Dans Le Système de Descartes PDFDocument16 pagesEmile Brehier - La Création Des Vérités Éternelles Dans Le Système de Descartes PDFCarlos PachecoPas encore d'évaluation
- Synthèse Philosophie ModerneDocument72 pagesSynthèse Philosophie Moderneyusuf gorkopPas encore d'évaluation
- (FR) L'Union Des Opposés - Mémoire (Philosophie, Ésotérisme, Héraclite, Hegel, Bible, Yi King, Zen... )Document89 pages(FR) L'Union Des Opposés - Mémoire (Philosophie, Ésotérisme, Héraclite, Hegel, Bible, Yi King, Zen... )ptitmaxounouPas encore d'évaluation
- L'être Chez Jean Duns ScotDocument36 pagesL'être Chez Jean Duns ScotThierrytradePas encore d'évaluation
- La Vérité TA Trace ÉcriteDocument8 pagesLa Vérité TA Trace ÉcriteThildemaPas encore d'évaluation
- Livre A Quoi SertDocument142 pagesLivre A Quoi SertMdmChghMhamdiDridi100% (1)
- Support écrit 1e PartieDocument68 pagesSupport écrit 1e Partienourkada040905Pas encore d'évaluation
- L'hypothèse du bonheur: La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaineD'EverandL'hypothèse du bonheur: La redécouverte de la sagesse ancienne dans la science contemporaineÉvaluation : 4 sur 5 étoiles4/5 (383)
- La Science Da L' OrdreDocument16 pagesLa Science Da L' Ordrevaldemar abrantesPas encore d'évaluation
- Fiche de LectureDocument5 pagesFiche de LectureHamada Bhih100% (2)
- Boudoir philosophique suivi de faire, pouvoir, savoirD'EverandBoudoir philosophique suivi de faire, pouvoir, savoirPas encore d'évaluation
- 6 Philosophie Et Esprit Critique-1-1Document2 pages6 Philosophie Et Esprit Critique-1-1Mouhamed BarroPas encore d'évaluation
- Méditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisD'EverandMéditations métaphysiques de René Descartes: Les Fiches de lecture d'UniversalisPas encore d'évaluation
- MessageDocument3 pagesMessageglasglaqaPas encore d'évaluation
- Theosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)D'EverandTheosophie - Une introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée de l'homme (traduit)Pas encore d'évaluation
- Discours de la méthode - Méditations métaphysiques: Deux ouvrages de René Descartes en un seul volumeD'EverandDiscours de la méthode - Méditations métaphysiques: Deux ouvrages de René Descartes en un seul volumePas encore d'évaluation
- 9782867400315Document52 pages9782867400315angemukun157Pas encore d'évaluation
- Méditations Métaphysiques René DescartesDocument59 pagesMéditations Métaphysiques René DescartesOuedraogoPas encore d'évaluation
- Formation Esprit 16 26Document11 pagesFormation Esprit 16 26Mohamed El alaouiPas encore d'évaluation
- La MethodeDocument16 pagesLa MethodeJuan Carlos Lozada S.Pas encore d'évaluation
- Problème de la connaissance scientifique: Dans "La formation de l'esprit scientifique" de Gaston BACHELARDD'EverandProblème de la connaissance scientifique: Dans "La formation de l'esprit scientifique" de Gaston BACHELARDPas encore d'évaluation
- Theosophie (Traduit): Introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée humaineD'EverandTheosophie (Traduit): Introduction à la connaissance suprasensible du monde et de la destinée humainePas encore d'évaluation
- 07 PneupratiqDocument33 pages07 PneupratiqCheick DoumbiaPas encore d'évaluation
- Fiche 2 RAISONDocument4 pagesFiche 2 RAISONHAlliyahHPas encore d'évaluation
- Arguments Philosophiques M. Ndour 2024Document3 pagesArguments Philosophiques M. Ndour 2024gracekone518Pas encore d'évaluation
- Chapitre 1Document39 pagesChapitre 1faredj rsPas encore d'évaluation
- Reseau Libre Savoir: Baccalaureat Edition 2021Document2 pagesReseau Libre Savoir: Baccalaureat Edition 2021NoraMatouPas encore d'évaluation
- La loi du Succès - Deuxième leçon (Traduit): Un objectif principal bien définiD'EverandLa loi du Succès - Deuxième leçon (Traduit): Un objectif principal bien définiPas encore d'évaluation
- Introduction À La Critique de La Raison Pure de KantDocument6 pagesIntroduction À La Critique de La Raison Pure de KantisabellePas encore d'évaluation
- Cogitatio PhilosophusDocument59 pagesCogitatio PhilosophusIsmael OuedraogoPas encore d'évaluation
- Le Discours de La MéthodeDocument4 pagesLe Discours de La MéthodeClaire COUVREURPas encore d'évaluation
- Gerald M. Edelman Biologie de La Conscience PDFDocument374 pagesGerald M. Edelman Biologie de La Conscience PDFJean Baptiste Des100% (3)
- NOTES Philo Moderne Chapitre 3 DESCARTESDocument11 pagesNOTES Philo Moderne Chapitre 3 DESCARTESProméthée Hiambe Olembo LiamPas encore d'évaluation
- Neuvaine ARRUPE 2017 11 02Document11 pagesNeuvaine ARRUPE 2017 11 02Cedric Cherel N'drinPas encore d'évaluation
- 411 PDF 1Document76 pages411 PDF 1Rita S. AL BOUSTANYPas encore d'évaluation
- Retraite Au RythmeDocument23 pagesRetraite Au RythmebadianePas encore d'évaluation
- Nous Sommes Dans La Phase 9 Du PLAN. Phase 10 - UNE CRISE ALIMENTAIRE - Les Moutons EnragésDocument37 pagesNous Sommes Dans La Phase 9 Du PLAN. Phase 10 - UNE CRISE ALIMENTAIRE - Les Moutons EnragésRaph LemonnPas encore d'évaluation
- Abraham Et Melchisédech (PDFDrive)Document16 pagesAbraham Et Melchisédech (PDFDrive)AnubsPas encore d'évaluation
- Deep State Infographic Final VersionDocument1 pageDeep State Infographic Final VersionAngélique LimonchePas encore d'évaluation
- Albert Wahu - Le Spiritisme Dans L'antiquité (1885)Document800 pagesAlbert Wahu - Le Spiritisme Dans L'antiquité (1885)digital_doll100% (1)
- Fra 11074Document586 pagesFra 11074Karolliny FrotaPas encore d'évaluation
- La Constitution Apostolique Sapientia ChristianaDocument14 pagesLa Constitution Apostolique Sapientia ChristianaSamuelPas encore d'évaluation
- Y A-T-Il Une Spiritualité Jésuite - Expertise Jésuite Dans Les Procès de Canonisation de Thérèse de l'Enfant-Jésus (1911-1916) - LARHRADocument32 pagesY A-T-Il Une Spiritualité Jésuite - Expertise Jésuite Dans Les Procès de Canonisation de Thérèse de l'Enfant-Jésus (1911-1916) - LARHRAwilliam99oooPas encore d'évaluation
- Conspi de L'antichristDocument32 pagesConspi de L'antichristA.ZertyPas encore d'évaluation
- Codina. Aux Sources de La Pédagogie de Jésuites Le Modus ParisiensisDocument387 pagesCodina. Aux Sources de La Pédagogie de Jésuites Le Modus ParisiensisArt RebolPas encore d'évaluation
- Livre Gratuit. Extermination Humaine Pour Remplacement Reptilien Derriere Les Pandemies Et La Troisieme Guerre MondialeDocument400 pagesLivre Gratuit. Extermination Humaine Pour Remplacement Reptilien Derriere Les Pandemies Et La Troisieme Guerre MondialeJOHNPas encore d'évaluation
- Saint Philippe NeriDocument21 pagesSaint Philippe NeriMarc VAN STEENKISTEPas encore d'évaluation
- Spiritualite: DictionnaireDocument548 pagesSpiritualite: DictionnaireLocus MariologicusPas encore d'évaluation
- Histoire Du Collège LibermannDocument1 pageHistoire Du Collège Libermannprovince camerounPas encore d'évaluation
- Descartes Les Annees de FormationDocument25 pagesDescartes Les Annees de FormationDomenico CollaccianiPas encore d'évaluation
- Alain Forest - Les Missionnaires Français Au Tonkin Et Au Siam XVII - XVIII Siècles. Analyse Comparée D'un Relatif Succès Et D'un Total ÉchecDocument8 pagesAlain Forest - Les Missionnaires Français Au Tonkin Et Au Siam XVII - XVIII Siècles. Analyse Comparée D'un Relatif Succès Et D'un Total Échecjayden.myhomePas encore d'évaluation
- Amour, Service Et Humilité (Pape François (François, Pape) )Document105 pagesAmour, Service Et Humilité (Pape François (François, Pape) )Sylvain KonanPas encore d'évaluation
- Jésuites Hors-Série 2013Document64 pagesJésuites Hors-Série 2013jmlb0123Pas encore d'évaluation
- Le Rouge Et Le Noir CoursDocument46 pagesLe Rouge Et Le Noir CoursagnesdavidePas encore d'évaluation
- Mathématiques Sciences Éducation Autour de 1789 en Bretagne: Gérard HAMONDocument83 pagesMathématiques Sciences Éducation Autour de 1789 en Bretagne: Gérard HAMONKilgrave100% (1)
- ch04 99 TextesDocument22 pagesch04 99 TextesRyZod StormPas encore d'évaluation
- Claude Roy-L'Art À La source-T2-JerichoDocument227 pagesClaude Roy-L'Art À La source-T2-JerichoKi WiPas encore d'évaluation
- Contra Ref Matem - ROMANODocument704 pagesContra Ref Matem - ROMANOHugo ZayasPas encore d'évaluation
- CHRONIQUES D'henry PléeDocument12 pagesCHRONIQUES D'henry PléeAERREAPas encore d'évaluation
- Retour Sur La Position D'isabelle La Catholique Au Sujet de L'expulsion Des Juifs D'espagne en 1492Document12 pagesRetour Sur La Position D'isabelle La Catholique Au Sujet de L'expulsion Des Juifs D'espagne en 1492fregoly515Pas encore d'évaluation