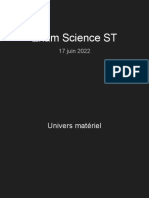Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Terpènes Semaine 1
Terpènes Semaine 1
Transféré par
agbodrepierretteCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Terpènes Semaine 1
Terpènes Semaine 1
Transféré par
agbodrepierretteDroits d'auteur :
Formats disponibles
SERIE TERPENIQUE
Les carbures terpéniques sont des molécules d’origine végétale, renfermant une ou plusieurs
doubles liaisons, le plus souvent de structure cyclique, dont la formule (C5H8)n révèle la
filiation avec l’isoprène C5H8.
L’isoprène ou le 2-méthyl buta-1,3 diène n’existe pas à l’état naturel, mais on connaît de
nombreuses substances résultant de sa polymérisation : caoutchoucs naturels, squalène des
huiles de poissons, carotènes et vitamine A, et plus généralement, série des terpènes.
Le lien se fait généralement tête à queue, mais les exceptions ne sont pas rares.
Il existe :
*les monoterpènes comportent 2 unités isopréniques (C10)
*les sesquiterpènes comportent 3 unités isopréniques (C15)
*les diterpènes comportent 4 unités isopréniques (C20)
* les triterpènes comportent 6 unités isopréniques (C30)
*et les polyterpènes sont des polymères naturels (M 300 000).
II-BIOSYNTHESE
Manière dont les êtres vivants synthétisent un produit. On fournit à un organisme un corps
supposé être le précurseur du terpène étudié. Pour suivre l’évolution, celui-ci est marqué
( isotopes du carbone ou de l’hydrogène principalement). Le produit final de la synthèse est
extrait et l’empilement des isotopes est repéré par différentes méthodes de dégradation.
Acide mévalonique MVA
Mevalolactone
1°) Acide mévalonique
Si l’isoprène est le précurseur formel des terpènes, leur biosynthèse est réalisée a partir de
l’acide mévalonique ou de son isomère la mévalolactone. Le schéma très simplifié qui suit :
L’acétylation au soufre de la coenzyme A (CoA-SH) combine les restes acétyle sous une
forme active CH3-CO-S-Co-A (acétylcoenzyme A ou acétate activé).
Deux molécules d’acétylcoenzyme A se combinent ensuite. Globalement, cette réaction
revient à l’attaque d’un carbanion (-CH3) voisin d’un carbonyle sur le carbonyle de la seconde
molécule et conduit à l’acétoacétylcoenzyme A (a) :
L’acétoacétylcoenzyme A (a) est alors attaquée par une autre molécule d’acétylelcoenzyme
A, selon un processus qui rappelle la réaction d’aldolisation. Le diacide-alcool formé ( acide-
3-méthyl-3-hydroxyglutarique) apparaît sous forme combinée avec deux molécules de
coenzyme A (b) ; il subit à la fois hydrolyse et réduction pour former l’acide mévalonique
AMV (c) qui est combiné à deux phosphoriques par action de l’ATP (acide adénosine
triphosphorique) ; le pyrophosphate de mévalonyle (d) formé est ensuite déshydraté et
décarboxylé en pyrophosphate d’isopentényle (e) ou isoprène activé qui intervient dans
l’édification des squelettes terpéniques.
Les étapes formelles de cette édification in vivo sont donc :
2°) Biogénèse du squalène
La combinaison de trois unités isoprénique conduit au farnésol qui peut, par couplage,
conduire au squalène.
Le couplage des unités isopréniques (a) commence par une isomérisation au niveau de la
double liaison (b) suivie du départ d’un ion pyrophosphate avec formation d’un
carbocation allylique (c).
L’attaque d’une unité (a) non isomérisée, par le cation (c) réalise l’enchaînement de deux
motifs et crée un nouveau carbocation (d). Celui-ci, par perte d’un proton, conduit à
l’éthylénique (e), qui par départ d’un anion pyrophosphate engendre le cation (f) :
L’attaque d’un nouvel élément (a) par (f) conduit, selon le mécanisme déjà vu, à l’ester
pyrophosphirique du farnésol (g).
Le couplage réducteur de deux molécules de pyrophosphate de farnésyle conduit au
squalène.
Le squalène est isolé de l’huile des foies de certains poissons. Par pyrolyse il redonne
l’isoprène.
3°) Squalène et biogénèse des stéroïdes
Le squalène est considéré actuellement comme un précurseur stéroïdes, auquels il
pourrait conduire par un processus oxydatif entraînant des fermétures de cycles
concernés.
On a en effet réalisé, in vitro, par catalyse acide, la synthèse du squelette du lanostérol à
partir d’un époxyde dérivé du squalène.
Vous aimerez peut-être aussi
- NF EN 13892-8 Essai de Resistance À L'arrachementDocument9 pagesNF EN 13892-8 Essai de Resistance À L'arrachementAnwar BrighliPas encore d'évaluation
- 1-Les TerpénesDocument28 pages1-Les TerpénesSARAH100% (1)
- CSN Cours 3 Les CoumarinesDocument9 pagesCSN Cours 3 Les Coumarinesze7015477Pas encore d'évaluation
- TP EsterificationDocument10 pagesTP EsterificationAnn Ouss100% (1)
- Travaux Dirigé L2 - 240125 - 201843Document4 pagesTravaux Dirigé L2 - 240125 - 201843hormandimenguiPas encore d'évaluation
- 1er Cours Petro 2019Document12 pages1er Cours Petro 2019slimane mohandPas encore d'évaluation
- Lip IdesDocument17 pagesLip IdesAhmed100% (2)
- 1983 1 s2.0 S0040403900940498 MainDocument4 pages1983 1 s2.0 S0040403900940498 MainLeyliPas encore d'évaluation
- 2eme Cours de Chimie OrganiqueDocument44 pages2eme Cours de Chimie OrganiqueAnfel BouchairPas encore d'évaluation
- Energie, Anabolisme D'énergie (Photosythèse)Document5 pagesEnergie, Anabolisme D'énergie (Photosythèse)Chawki MokademPas encore d'évaluation
- Pharmacognosie Spéciale IIDocument6 pagesPharmacognosie Spéciale IIsiheemmedPas encore d'évaluation
- c3 Les Acide Carboxyliques Et DerivesDocument12 pagesc3 Les Acide Carboxyliques Et DerivesComan SakoPas encore d'évaluation
- Energie, Anabolisme, CatabolismeDocument5 pagesEnergie, Anabolisme, CatabolismeMohemed MohamedPas encore d'évaluation
- Fiche de TD 1Document2 pagesFiche de TD 1oummoulkoulthoum174Pas encore d'évaluation
- Chapitre 5 Nomenclature SystematiqueDocument92 pagesChapitre 5 Nomenclature SystematiqueNatacha N'GUESSANPas encore d'évaluation
- Le Squelette Carboné Des Molécules OrganiquesDocument4 pagesLe Squelette Carboné Des Molécules OrganiquesSonia Sadek100% (1)
- Cours Chimie Organique BEP ProfDocument10 pagesCours Chimie Organique BEP ProfOtaku 4 LifePas encore d'évaluation
- Seq 7 ExercicesDocument4 pagesSeq 7 ExercicesMõ ÖnPas encore d'évaluation
- Metabolisme Des Acides AminesDocument9 pagesMetabolisme Des Acides AminesHea FPas encore d'évaluation
- c3 Acides CarboxyliqueDocument8 pagesc3 Acides Carboxylique68qrrhw4jtPas encore d'évaluation
- Chap 2a Les Hydrocarbures Saturés Et InsaturésDocument12 pagesChap 2a Les Hydrocarbures Saturés Et InsaturésYves Patrick AngoPas encore d'évaluation
- Molecules Organiques Et Squelettes Carbones Modification Du Squelette Carbone Cours 2 4Document5 pagesMolecules Organiques Et Squelettes Carbones Modification Du Squelette Carbone Cours 2 4Ossama SariaPas encore d'évaluation
- Chapitre 3-Réactions Diastéréosélectives (Substrats Chiraux)Document14 pagesChapitre 3-Réactions Diastéréosélectives (Substrats Chiraux)Mériem BradaiPas encore d'évaluation
- Rétrosynthèse, Énoncés Des ExercicesDocument13 pagesRétrosynthèse, Énoncés Des Exercicesfantamat974Pas encore d'évaluation
- TD2 CHM146 SVT Semaine7Document3 pagesTD2 CHM146 SVT Semaine7abalotouadjeiPas encore d'évaluation
- c8 Les AlcanesDocument6 pagesc8 Les AlcanestotoafifiPas encore d'évaluation
- Chimie Organique Cours Sur Les Acides Carboxyliques Et Leurs DérivésDocument24 pagesChimie Organique Cours Sur Les Acides Carboxyliques Et Leurs DérivésKone Kouwelton100% (1)
- Cours de Chimie Organique Sur Les Acides AminésDocument13 pagesCours de Chimie Organique Sur Les Acides AminésKone KouweltonPas encore d'évaluation
- Reactions Chimie OrgaDocument47 pagesReactions Chimie OrgafluiddynamicPas encore d'évaluation
- Métabolisme Des Acides AminésDocument7 pagesMétabolisme Des Acides AminésOussama FendaliPas encore d'évaluation
- 1S Chimie ChapDocument9 pages1S Chimie ChapHadia DjeltiPas encore d'évaluation
- Métabolisme Des Acides Aminés PDFDocument12 pagesMétabolisme Des Acides Aminés PDFHea FPas encore d'évaluation
- Séquençage Des Protéines - WikipédiaDocument31 pagesSéquençage Des Protéines - Wikipédiapierrenobang237Pas encore d'évaluation
- Correction Exam Svtu 2017 2021Document4 pagesCorrection Exam Svtu 2017 2021Achwak BelfadelPas encore d'évaluation
- SquelleteDocument6 pagesSquelletea houssPas encore d'évaluation
- SERIE 1+corrigéDocument7 pagesSERIE 1+corrigéSOUFYANE MUSTAPAPas encore d'évaluation
- Generalites Sur Le PetroleDocument27 pagesGeneralites Sur Le Petroleياسمين لقرافPas encore d'évaluation
- Questions de Cours en ChimieDocument17 pagesQuestions de Cours en ChimieJaynito EtinnePas encore d'évaluation
- Cours Les AlcanesDocument10 pagesCours Les Alcanesstefan100% (1)
- Cours de Chimie Organique Chapitre IIDocument15 pagesCours de Chimie Organique Chapitre IIzahramathlouthi127Pas encore d'évaluation
- Chap I Structures Des Molecules Organiques Med Iformed 2023Document23 pagesChap I Structures Des Molecules Organiques Med Iformed 2023Mame diarra bousso NdiayePas encore d'évaluation
- 1ère A - APC - Les AlcanesDocument5 pages1ère A - APC - Les AlcanesLAWSON NICOLASPas encore d'évaluation
- Ch4 Les EstersDocument6 pagesCh4 Les EstersrdprofpcPas encore d'évaluation
- Coures de Chimie Orgpharm.2Document82 pagesCoures de Chimie Orgpharm.2BADRXCKPas encore d'évaluation
- Cours SMP s3Document53 pagesCours SMP s3Anouar AlamiPas encore d'évaluation
- Série 2 + SolutionDocument9 pagesSérie 2 + Solutionمريم ياسمينPas encore d'évaluation
- chapitreII Les SteroidesDocument20 pageschapitreII Les SteroidesSARAH100% (1)
- Chapitre2 Chimie Organique L2Document13 pagesChapitre2 Chimie Organique L2Abdennour BelarbiPas encore d'évaluation
- Complements Notes de Cours Chim 306 Chim III Dco Fac SciencesDocument12 pagesComplements Notes de Cours Chim 306 Chim III Dco Fac SciencesTerence YepdjouPas encore d'évaluation
- TD - Reactivites - AaaDocument3 pagesTD - Reactivites - AaaOmega SigmaPas encore d'évaluation
- Ex Chap9 CorrectionDocument12 pagesEx Chap9 Correctionroot69707Pas encore d'évaluation
- Cours Chimie Organique FS Ben M'Sik 2012-2013Document47 pagesCours Chimie Organique FS Ben M'Sik 2012-2013Mahfoud ZakiPas encore d'évaluation
- Alcanes TDDocument4 pagesAlcanes TDFoufouna MariposaPas encore d'évaluation
- Terpènes Et Biosynthèse TerpéniqueDocument15 pagesTerpènes Et Biosynthèse TerpéniqueRẵmîRandyHassad100% (1)
- Olympiades 2012Document102 pagesOlympiades 2012Stephan Lampert100% (1)
- Acides nucléiques: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandAcides nucléiques: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- Cin PBDocument8 pagesCin PBYoussef FarjallahPas encore d'évaluation
- Casa Din CeruriDocument4 pagesCasa Din CeruriDaniela RussuPas encore d'évaluation
- Tp5 Univers MoléculesDocument2 pagesTp5 Univers MoléculesMonge TSPas encore d'évaluation
- Chimie en SolutionDocument166 pagesChimie en Solutionjawad izallalenPas encore d'évaluation
- Série 3 L'extraction 2023 2024Document2 pagesSérie 3 L'extraction 2023 2024bouaiedanissa61Pas encore d'évaluation
- Mémoire GOUTON Houénakpon Marc - CompressedDocument140 pagesMémoire GOUTON Houénakpon Marc - CompressedBabacar KanePas encore d'évaluation
- Epreuve Zero Tle Chimie Epreuve Theorique-1Document3 pagesEpreuve Zero Tle Chimie Epreuve Theorique-1Cedric yves NgnedjoPas encore d'évaluation
- Chap 6 Usinage Par Electrolyte.Document9 pagesChap 6 Usinage Par Electrolyte.Jean-Pierre EssimiPas encore d'évaluation
- Chimie Chapitre11 Groupes - CaracteristiquesDocument3 pagesChimie Chapitre11 Groupes - CaracteristiquesStevy AtaliPas encore d'évaluation
- Physique Chimie 2023 StudyramaDocument7 pagesPhysique Chimie 2023 StudyramaMerciaPas encore d'évaluation
- Ccgco FHDocument120 pagesCcgco FHIlham ChaidoumePas encore d'évaluation
- Les Transformations Effectuent 2 SensJKDocument3 pagesLes Transformations Effectuent 2 SensJKsouukainazaarPas encore d'évaluation
- Glucides PassDocument100 pagesGlucides PassHamza Hadouti100% (1)
- ch01 SolutionnaireDocument40 pagesch01 SolutionnaireWaqar BaigPas encore d'évaluation
- Exam Science STDocument62 pagesExam Science STfelixPas encore d'évaluation
- BAC Blanc M.cisseDocument3 pagesBAC Blanc M.cisseMoussa CISSEPas encore d'évaluation
- EP1070771A1Document22 pagesEP1070771A1Badr RbblPas encore d'évaluation
- 01 - Les Acides Et BasesDocument34 pages01 - Les Acides Et BasesBsissaSoltaniPas encore d'évaluation
- Cristallographie 3Document2 pagesCristallographie 3Thomas ShelbyPas encore d'évaluation
- Cine TiqueDocument68 pagesCine TiqueDamhrtPas encore d'évaluation
- Série D'exercices Suivie TemporelDocument12 pagesSérie D'exercices Suivie Temporelamribtzahra2Pas encore d'évaluation
- Memoire FinalDocument97 pagesMemoire Finaljean Martin EbanaPas encore d'évaluation
- QCM Cosmetologie 1Document2 pagesQCM Cosmetologie 1Mustapha TaniPas encore d'évaluation
- Examen 2019 - Catalyse EnzymatiqueDocument3 pagesExamen 2019 - Catalyse EnzymatiquePaulPas encore d'évaluation
- Memoire de Sana Abdelbaset Leffet de La Régénération Dun Polyéthylène Sur Les Propriétés PhysicoDocument98 pagesMemoire de Sana Abdelbaset Leffet de La Régénération Dun Polyéthylène Sur Les Propriétés PhysicoHaythem JemaiPas encore d'évaluation
- KAMLA Youcef These Doctorat en SciencesDocument150 pagesKAMLA Youcef These Doctorat en ScienceschahinePas encore d'évaluation
- Table of Thermodynamic ValuesDocument11 pagesTable of Thermodynamic ValuesJared TanPas encore d'évaluation
- TP Dureté EauDocument3 pagesTP Dureté EauAz AzPas encore d'évaluation
- VI..Etude Sommaire Des Mélanges: Johannes Broenstedt (1879 - 1947)Document31 pagesVI..Etude Sommaire Des Mélanges: Johannes Broenstedt (1879 - 1947)Bill644Pas encore d'évaluation