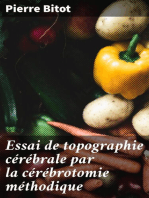Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Syndrome D'hypertension Intracranienne
Syndrome D'hypertension Intracranienne
Transféré par
ferdinandoyono948Titre original
Copyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Syndrome D'hypertension Intracranienne
Syndrome D'hypertension Intracranienne
Transféré par
ferdinandoyono948Droits d'auteur :
Formats disponibles
SYNDROME D’HYPERTENSION INTRACRANIENNE (HTIC)
Objectifs
1. Définir le syndrome d’hypertension intracrânienne (HTIC)
2. Décrire 3 signes du syndrome d’HTIC
3. Décrire l’engagement temporal et l’engagement des amygdales cérébelleuses
4. Citer 4 étiologies d’une HTIC
5. Énoncer les principes thérapeutiques de l’HTIC
Introduction
Définition
Le syndrome d’HTIC est l’ensemble des signes traduisant une augmentation de la
pression à l’intérieur de la boite crânienne, supérieure à 15 mm Hg.
Intérêt
- C’est une urgence médico – chirurgicale
- Epidémiologique : le syndrome d’HTIC est rencontré chez l’enfant ayant une
hydrocéphalie dans 50% des cas selon BROALET à Abidjan et KABRE à
Ouagadougou. Ce syndrome est retrouvé chez l’adulte dans 38% des cas, en
cas de tumeur cérébrale, d’après BEKETI, à Lomé.
- Diagnostique : il repose sur la clinique et la tomodensitométrie cérébrale.
Dans notre milieu, le diagnostic est souvent tardif car il y a une errance
diagnostique devant les vomissements qui orientent la plupart du temps vers
une affection digestive
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 1
- Thérapeutique : la prise en charge thérapeutique doit être précoce, une fois
le diagnostic posé.
- Pronostique : tout retard diagnostique et / ou thérapeutique expose au
risque de cécité irréversible, d’engagement et de décès.
1. Données fondamentales
1.1. Anatomie
Boîte crânienne :
o Contenant : os de la voûte et de la base du crâne,
o Contenu : parenchyme (88 %), liquide cérébro – spinal (9%) contenu
dans les ventricules, vaisseaux (3%). Schématiquement, ils définissent
trois secteurs dont le volume total est de 1400 ml. Ils sont contenus
dans la boite crânienne inextensible.Toute modification de l’un ou
l’autre va entrainer des perturbations que nous allons voir dans la
physiopathologie.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 2
1.2. Physiopathologie
Trois causes principales peuvent entrainer l’augmentation volumétrique de ces
secteurs :
Parenchymateux : processus tumoral
Vasculaire : hématome, turgescence
Liquidien : hydrocéphalie, œdème cérébral.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 3
La courbe pression / volume présente une allure exponentielle lors de la
décompensation. Ce qui se traduit par une augmentation rapide de la pression
intracrânienne qui survient pour une augmentation minime du volume (courbe de
LANGFITT). Cette augmentation de pression aura trois conséquences :
Sur l’encéphale : l’engagement
Cingulaire : engager du gyrus cingulaire sous la faux
Temporal : par hernie cingulaire de T5 dans l’incisure de la tente du
cervelet avec écrast du nerf III, du pédoncule cérébral (réticulée, voie
pyramidale, aqueduc cu mésencéphale)
L’encéphalique central, à travers l’orifice tentoriel
Cérébelleux à travers l’orifice tentoriel
Des tonsilles(amygdales) cérébelleuses dans le foramen magnum
entrainant une compression de bulbe, avec un risque permanent de
mort subite.
Le mécanisme d’engagement peut être déclenché ou aggravé par une PL. La
soustraction du LCS provoque un ‘‘ appel’’ des syndromes sus-jacentes vers l’aval.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 4
Sur l’œil : la compression des vaisseaux sur la rétine crée une stase veineuse,
un œdème papillaire avec risque d’atrophie optique.
Sur le crâne : disjonction des sutures chez l’enfant, impressions digitiformes,
agrandissement de la selle turcique.
La figure suivante résume la physiopathologie.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 5
2. Signes
2.1. TDD : syndrome d’HTIC non compliqué de l’adulte
Nous sommes amenés à examiner un patient chez qui l’interrogatoire précisera les
signes fonctionnels.
2.1.1. Signes fonctionnels
- Des céphalées : il s’agit d’une douleur à la tête souvent décrite par le patient
comme des maux de tête. C’est un symptôme fréquent. Lorsqu’elles sont
typiques, les céphalées surviennent surtout le matin ou au réveil ou vers la
deuxième moitié de la nuit, par crises. Elles sont de siège variable, diffuses ou
localisées, augmentant à l’effort (toux), résistantes aux antalgiques usuels.
Parfois elles sont sans spécificité, c’est – à dire banales, sans spécificité,
camées par des antalgiques.
Les céphalées sont accompagnées de vomissements.
- Des vomissements : il s’agit d’une expulsion forcée et violente du contenu
gastrique par la bouche. Ils surviennent en fusée ou en jet, soulageant les
céphalées
- Des troubles visuels : il peut s’agir de
Baisse de l’acuité visuelle
Diplopie (voir double un objet) par paralysie du VI
Impressions furtives de brouillards obscurcissant la vue
Œdème papillaire (infiltration de sérosité dans la papille) au FO : flou
des bords de la papille, dilatation veineuse.
- Des troubles de la vigilance ou de la conscience :
Baisse de l’attention, somnolence,
Obnubilation
Apathie
Torpeur, coma
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 6
L’interrogatoire précisera aussi le mode d’installation de ces signes fonctionnels. Il
recherchera une notion de prise médicamenteuse ou de toxique, un contexte
particulier d’immunodépression.
L’examen clinique appréciera les signes généraux.
2.1.2. Signes fonctionnels
L’état général est conservé. Le pouls, la température et la TA sont normaux e
2.1.3. Signes physiques
Ils sont mis en évidence à l’examen physique qui commence par l’examen
neurologique.
L’examen neurologique. Il apprécie :
- Etat mental : il s’agit d’un patient conscient avec un score de Glasgow à
15, bien orienté dans le temps et l’espace et qui n’a pas de trouble de
la mémoire
- Parole : pas d’aphasie, ni de dysarthrie, ni de trouble de la
compréhension
- Crâne : pas de douleurs ni de tuméfaction à la palpation, pas de bruits
intracrâniens à l’auscultation
- Rachis : pas de limitation douloureuse des mouvements du rachis
cervical (pas de raideur de la nuque, ni de contracture paravertébrale
cervicale).
- Organes de sens :
L’olfaction est normale
L’examen de la vision note une baisse de l’acuité visuelle
Le fond d’œil : met en évidence un œdème papillaire. Il s’agit
d’une infiltration séreuse de la papille, lui donnant un aspect flou
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 7
au niveau de ses bords. Cette infiltration est associée à une
dilatation des veines.
Audition : voix chuchotée perçue à 1m
- L’examen des autres paires crâniennes est normal
- L’examen du système moteur : attitude à l’inspection, à la palpation,
le tonus et la force, la coordination des mouvements, ROT
- Sensibilité (douleur, toucher, chaud, froid, vibration (diapason aux
chevilles et poignets), sens de position.
Les autres appareils seront examinés.
Au terme de l’examen clinique, des examens paracliniques sont demandés.
2.1.4. Examens paracliniques
- TDM (tomodensitométrie) cérébrale, encore appelée scanner
C’est un examen basé sur la topographie axiale assistée par ordinateur. Elle
permet d’obtenir des images en coupes et de mesurer la densité des tissus.
Elle sera réalisée sans et avec injection du produit de contraste. Elle mettra en
évidence la lésion (hydrocéphalie, processus expansif intracrânien,
hématome...)
- IRM (imagerie par résonnance magnétique) cérébrale
C’est un examen basé sur les propriétés magnétiques de l’atome d’hydrogène
ou proton, abondant dans l’organisme. Lorsque ces atomes sont mis en
présence d’un champ magnétique, ils sont stimulés et permettent de
reconstituer des images dans les 3 plans de l’espace. L’IRM pose dans notre
contexte, le problème de sa disponibilité géographique et de son coût élevé.
Lorsqu’elle est disponible, elle sera réalisée en séquences T1 sans et avec
injection de produit de contraste, T2 ... Elle montre l’étiologie de l’HTIC.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 8
- La radiographie standard du crâne (lorsqu’on ne dispose pas de scanner, ni
d’IRM) : on y recherchera un agrandissement de la selle turcique ou une
érosion des processus clinoïdes postérieurs ou du dorsum sellae.
- Mesure et enregistrement de la PIC à l’aide de capteurs logés à des différents
niveaux parenchymes, ventricule, espace sous dural, extra-dural
- Artériographie
- Doppler transcrânien : étudie l’hémodynamique intracrânienne, apprécie le
retentissement cérébral.
Non traitée, l’évolution se fera vers les complications :
- Cécité bilatérale définitive avec atrophie optique
- Engagement
- Décès
2.2. Formes cliniques
2.2.1. Formes compliquées
- Engagement temporal
o Mydriase homolatérale, atteinte du nerf III
o Trouble de la conscience
o Hypertonie de décérébration
o Syndrome de FORSTER KENNEDY (atrophie otique du côté de la
compression, stase papillaire de l’autre côté).
- Engagement des amygdales (tonsilles cérébelleuses)
o Stade début :
Cervicalgies, torticolis, attitude guindée du cou
Crise tonique postérieure
Geste de décompression en urgence, sinon
o
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 9
o Stade avancé :
Coma, rigidité de décérébration
Troubles neurovégétatifs : bradycardie, bradypnée
Décès
- Engagement sous falciforme
- Engagement central
- Engagement du culmen
- Engagement cérébelleux
2.2.2. Formes selon l’âge
- HTIC chez l’enfant à crâne ouvert
o Vomissements aux changements de position
o Macrocrânie, circulations collatérales sur le scalp
o Regard en coucher de soleil
o PC > 2 DS
o Bombement de la fontanelle antérieure
o Impressions digitiformes, aspect « peigné » des sutures à la
radiographie standard du crâne
- HTIC enfant à crâne fermé
o Céphalées
o Vomissements, signes pseudo – digestifs (fausse appendicite de
l’HTIC)
o Parfois réouverture des sutures
o Cervicalgies, torticolis, attitude guindée de la tête
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 10
2.2.3. Forme selon l’évolution
- Hydrocéphalie chronique de l’adulte
o Antécédents de méningite, hémorragie méningée, traumatisme crânien
o Triade de Adams et Hakim (trouble de la marche, troubles urinaires,
troubles de la mémoire)
o Imagerie montre la dilatation du système ventriculaire
2.2.2. Forme symptomatique
- HTIC bénigne
o Céphalées, troubles visuels
o Obésité
o Troubles endocriniens
o IRM des nerfs optiques montre dilatation des gaines par LCS,
ventricules cérébraux de taille normale
Les signes que nous venons de voir nous permettent de poser le diagnostic de
l’HTIC.
3. Diagnostic
3.1. Positif
- Signes fonctionnels : céphalées, vomissements, troubles visuels, troubles
de la conscience
- Signes généraux : hyperthermie, bradycardie, TA instable,
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 11
- Signes physiques : œdème papillaire au FO, atteinte des nerfs III et VI,
raideur de la nuque
- Examens complémentaires : TDM, IRM cérébrale lésion, engagement
mesure et enregistrement de la PIC
3.2. Différentiel
3.2.1. Devant les céphalées
- Migraine
- sinusite
3.2.2. Devant les anomalies du fond d’œil
- Neuro papillite
unilatérale, diminution de l’acuité visuelle angiographie à la fluoroscéine
3.2.3. Devant les céphalées et les troubles digestifs
- Affection digestive
3.2.4. Devant céphalées, la fièvre et la raideur de la nuque
- Méningite (TDM ou FO avant PL !!!), PL : germe
3.3. Etiologique
Le diagnostic étiologique est basé sur
3.3.1. L’interrogatoire
- Installation brutale ou progressive des troubles
- Age
- ATCD
- Prise médicamenteuses ou toxiques
- Contextes particuliers : immunodéprimés, SIDA
3.3.2. L’examen clinique
- Existence ou non de signes neurologiques de localisation
- Paralysie oculo-motrice autre qu’une VI isolé
- Dignes d’atteinte de la fosse post
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 12
3.3.3. Les examens paracliniques
- La TDM cérébrale (mécanisme en cause et importance de l’HTIC)
- L’IRM cérébrale
3.3.4. Principales étiologies :
Compartiment parenchymateux (processus focalisé)
abcès et tumeurs hémisphériques
hématomes intra parenchymateux
ischémie
lésions post traumatiques, contusions, hématome sous dural,
hématome extra dural
TDM/ IRM lésion
Compartiment vasculaire (œdème diffus)
suites immédiates d’un TCE
encéphalites et méningo – encéphalites
maladies inflammatoires (Behçet)
œdème diffus toxique
œdème diffus vasculaire (thrombophlébite du sinus longitudinal
supérieur)
œdème métabolique
Compartiment liquidien (hydrocéphalies)
hydrocéphalie localisée (tumeurs des VL ou du V3)
hydrocéphalie diffuse (processus de la fosse cérébrale postérieure,
hémorragies méningées, hydrocéphalies congénitales)
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 13
4. TRAITEMENT
4.1. But
Soulager le patient
Diminuer la pression intracrânienne
Traiter l’étiologie
Préserver le pronostic vital
4.2. Moyens – Méthodes
4.2.1. Médicaux
Médicamenteux
o Antalgiques
Paracétamol 15 mg / kg / 6h (palier 1)
Néfopam 20mg / 6h ; morphine 0,3 mg / kg / j (palier 3)
o Mannitol 20 % 1g / kg / 3h en IV, risque effet rebond
o Corticoïdes :
Tétracosactide (SYNACTHENE*) 1 à 2 mg / 24h
Méthylprednisone (SOLUMEDROL*) 80 à 140 mg / 24h, IV
Non médicamenteux
o Mesures de réanimation
o Position demi-assise (30°), tête droite
o Liberté des voies aériennes
o Oxygénothérapie
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 14
o Restriction hydrosodée
4.3. Chirurgicaux
Exérèse tumorale par abord direct
Fenestration des gaines des nerfs optiques
Évacuations d’hématome
Craniectomie décompressive
Dérivations du liquide cérébro-spinal
Dérivation ventriculaire externe (DVE)
Dérivation ventriculo-péritonéale (DVP)
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 15
Ventriculocisternostomie
4.4. Indications
4.4.1. Critères d’indication
Âge
Étiologie
Plateau technique
École
4.4.2. Dans tous les cas
Malade demi-assis (30°), tête droite, liberté des voies aériennes
Calmer la douleur : antalgiques palier 1, 2 ou 3
4.4.3. Œdème cérébral
Corticoïdes 1 à 3 mg/j en IV
Mannitol 20 % à 1g/kg/3 heures (exérèse tumorale)
4.4.4. Hydrocéphalie aiguë (hémorragies méningées, AVCH avec
inondation ventriculaire tumeurs de la fosse postérieure),
hydrocéphalie et syndrome infectieux
DVE
4.4.5. Hydrocéphalies obstructives (sténose de l’aqueduc de
Sylvius) Ventriculocisternostomie
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 16
Hydrocéphalie non hémorragique, ni infectieuse DVP
AVC ischémiques compressifs, traumatismes crâniens (HSDA)
Craniectomie décompressive
Processus intracrânien Exérèse tumorale
Conclusion
L’HTIC est une augmentation de la pression dans la boîte crânienne. Elle
peut intéresser le LCS, les vaisseaux et / ou le parenchyme cérébral.
Le risque majeur est l’engagement qui peut conduire rapidement au
décès.
L’examen clinique et la TDM cérébrale permettent de poser le diagnostic.
Toute PL lors d’une suspicion d’HTIC doit être exclue.
La prise en charge est urgente.
MCA DOLEAGBENOU A. K. Cours_NCH FSS_UL 17
Vous aimerez peut-être aussi
- Conduites À Tenir Face À Une Anomalie Surrénalienne:: Un Guide InteractifDocument109 pagesConduites À Tenir Face À Une Anomalie Surrénalienne:: Un Guide InteractifKhaled JaziriPas encore d'évaluation
- Minimodule CéphaléesDocument13 pagesMinimodule CéphaléesTarek NemsiPas encore d'évaluation
- 1 - Hypertension Intra CranienneDocument23 pages1 - Hypertension Intra CranienneFatimaPas encore d'évaluation
- Tumeurs - Processus Expansifs IntracraniensDocument9 pagesTumeurs - Processus Expansifs Intracraniensdiarrabg34Pas encore d'évaluation
- 2 - Syndrome D HICDocument3 pages2 - Syndrome D HICcamelia khaledPas encore d'évaluation
- HticDocument23 pagesHticBogeraine ESSAMIPas encore d'évaluation
- Maccabe de Neuro-1-1-1Document18 pagesMaccabe de Neuro-1-1-1banduflemingPas encore d'évaluation
- Main de Singe Ou Aran DuchenneDocument2 pagesMain de Singe Ou Aran DuchenneAsmae OuissadenPas encore d'évaluation
- Cas Clinique 3Document48 pagesCas Clinique 3m.aPas encore d'évaluation
- Soins Au Bloc 3Document19 pagesSoins Au Bloc 3Enthoine ArambaPas encore d'évaluation
- Comas Non Traumatiques SocapedDocument37 pagesComas Non Traumatiques SocapedIdiAmadouPas encore d'évaluation
- Syndrome D'hypertension IntracranialeDocument10 pagesSyndrome D'hypertension Intracranialemtourad09Pas encore d'évaluation
- 03 Syndrome MeningeeDocument4 pages03 Syndrome MeningeeMehdiPas encore d'évaluation
- Achalasie de L'oesophageDocument8 pagesAchalasie de L'oesophageIbrahima Gws SowPas encore d'évaluation
- Fichier Produit 3451Document29 pagesFichier Produit 3451melaliledossouPas encore d'évaluation
- 13 - PRNs AiguësDocument5 pages13 - PRNs AiguësNoureddine BoulaouedPas encore d'évaluation
- Correction Maq'uss SEDA-ACADEMIEDocument135 pagesCorrection Maq'uss SEDA-ACADEMIEraoul simaPas encore d'évaluation
- 16 CephaleesDocument22 pages16 CephaleesMarouane bouhabsPas encore d'évaluation
- 16 Cephalees 01Document22 pages16 Cephalees 01trigui amirPas encore d'évaluation
- Questionnaire NeurochirurgieDocument20 pagesQuestionnaire NeurochirurgieManassé Misenge100% (1)
- Comas Non TraumatiquesDocument8 pagesComas Non TraumatiquesSafa DocPas encore d'évaluation
- Syndrome MéningéDocument7 pagesSyndrome MéningéEbe100% (1)
- MédulloblastomeDocument39 pagesMédulloblastomeSoukaina DriouichPas encore d'évaluation
- Syndrome Dhypertension IntracrânienneDocument5 pagesSyndrome Dhypertension IntracrânienneBases pour l'étudiant en MédecinePas encore d'évaluation
- Cours de Neurologie FinDocument130 pagesCours de Neurologie FinWillson Peter Dungu businessPas encore d'évaluation
- Traumatismes Cranio-EncéphaliqueDocument114 pagesTraumatismes Cranio-EncéphaliqueChristian PheniPas encore d'évaluation
- Atrophie MultisystematiseeDocument27 pagesAtrophie MultisystematiseeNTAKIRUTIMANA EZECHIELPas encore d'évaluation
- CéphaléesDocument22 pagesCéphaléesMarMar TsiePas encore d'évaluation
- Coma Non Traumatique de L Adulte Et L EnfantDocument13 pagesComa Non Traumatique de L Adulte Et L EnfantDjamaleddine FahPas encore d'évaluation
- 13-Convulsion de L'enfantDocument6 pages13-Convulsion de L'enfantAhmed HoussemPas encore d'évaluation
- Hypertention IntracranienneDocument4 pagesHypertention IntracranienneSouheil MansouriPas encore d'évaluation
- Neuro4an Prna2019djemameDocument9 pagesNeuro4an Prna2019djemamedtahina22zPas encore d'évaluation
- Tcem 17Document24 pagesTcem 17Haytham MahdhaouiPas encore d'évaluation
- Affections Du Systeme NerveuxDocument8 pagesAffections Du Systeme NerveuxEl ÎmànePas encore d'évaluation
- Mal de PottDocument11 pagesMal de Potteugeria86Pas encore d'évaluation
- 14 CephaléeDocument6 pages14 CephaléeKhaled SghaierPas encore d'évaluation
- Adamsbaum Trousseau2012-1Document7 pagesAdamsbaum Trousseau2012-1alex mondomobePas encore d'évaluation
- FC1-Sémiologie de La Sensibilité Et de La Douleur (Provisoire)Document9 pagesFC1-Sémiologie de La Sensibilité Et de La Douleur (Provisoire)Maël ErmanPas encore d'évaluation
- ÉpilepsieDocument6 pagesÉpilepsieSouheil MansouriPas encore d'évaluation
- Les Comas-Cours M1 Avril 2023Document77 pagesLes Comas-Cours M1 Avril 2023Frédéric DjoumessiPas encore d'évaluation
- Cardio LogieDocument84 pagesCardio LogieBõuŤhęyÑãPas encore d'évaluation
- Les GlaucomesDocument6 pagesLes Glaucomesmila mimaPas encore d'évaluation
- Adenomes HypophysairesDocument12 pagesAdenomes HypophysairesPhilip McNelsonPas encore d'évaluation
- ConvulsionsDocument20 pagesConvulsionsBouhannache MeryemPas encore d'évaluation
- Tcem 16Document22 pagesTcem 16Haytham MahdhaouiPas encore d'évaluation
- Paralysie Flasque AigueDocument4 pagesParalysie Flasque AiguekennyPas encore d'évaluation
- Approche Diagnostique Et Thérapeutique D - Un ComaDocument6 pagesApproche Diagnostique Et Thérapeutique D - Un Comakheira SaketPas encore d'évaluation
- Cours 1 IMC PHYSIO 2017Document18 pagesCours 1 IMC PHYSIO 2017sawssenPas encore d'évaluation
- Cat Devant ComaDocument33 pagesCat Devant ComaBA MBENEPas encore d'évaluation
- Paraplegie Tetraplegie TD DR Blel MPRDocument57 pagesParaplegie Tetraplegie TD DR Blel MPRZL Fatima ZohraPas encore d'évaluation
- Tumeurs Intracrâniennes - HippocrateDocument11 pagesTumeurs Intracrâniennes - HippocrateHabib DarouichePas encore d'évaluation
- ComaDocument24 pagesComaGabin MbaiPas encore d'évaluation
- Hydrocéphalie Neuro FRDocument2 pagesHydrocéphalie Neuro FRAmand BenaPas encore d'évaluation
- Hydrocéphalie ConvertiDocument9 pagesHydrocéphalie ConvertielasbihaniyounessPas encore d'évaluation
- 8) Les MéningitesDocument41 pages8) Les Méningitesmeriem lalouPas encore d'évaluation
- HydrocephalieDocument26 pagesHydrocephaliearmainnomenjanaharyPas encore d'évaluation
- Coma en PediatrieuehDocument36 pagesComa en PediatrieuehPetit-Paul WedlyPas encore d'évaluation
- Essai de topographie cérébrale par la cérébrotomie méthodique: Conservation des pièces normales et pathologiques par un procédé particulierD'EverandEssai de topographie cérébrale par la cérébrotomie méthodique: Conservation des pièces normales et pathologiques par un procédé particulierPas encore d'évaluation
- Œil humain: Les Grands Articles d'UniversalisD'EverandŒil humain: Les Grands Articles d'UniversalisPas encore d'évaluation
- PDF 24Document24 pagesPDF 24ZA ERPas encore d'évaluation
- TransfoDocument20 pagesTransfoBregon10Pas encore d'évaluation
- Toolkit EditionDocument164 pagesToolkit EditionFeth-allah SebbaghPas encore d'évaluation
- Facture EdfDocument8 pagesFacture EdfamaurichepoudaPas encore d'évaluation
- Cer, - Ger, - GuerDocument5 pagesCer, - Ger, - Guerleila BKPas encore d'évaluation
- Chap1 PapierDocument25 pagesChap1 Papiermalika01Pas encore d'évaluation
- PAGAN Catalogue Web 06 2022Document28 pagesPAGAN Catalogue Web 06 2022ali1129ahmedPas encore d'évaluation
- Cours 5 ProthèseDocument4 pagesCours 5 ProthèseDDan2005Pas encore d'évaluation
- Cours SurfaceDocument31 pagesCours SurfacepipoughazelPas encore d'évaluation
- CD PDF L3 18Document34 pagesCD PDF L3 18pfePas encore d'évaluation
- Le Support Du Cours - Urgences NéphrologiquesDocument110 pagesLe Support Du Cours - Urgences NéphrologiquesMarouan DhnPas encore d'évaluation
- Analyse Ch1Document12 pagesAnalyse Ch1farahidiahmedPas encore d'évaluation
- Serie Tableau AvancementDocument5 pagesSerie Tableau AvancementkkkkPas encore d'évaluation
- OPP ERA Approvisionnement Gestion Des Stocks Manuel de ProceduresDocument11 pagesOPP ERA Approvisionnement Gestion Des Stocks Manuel de ProceduresDelondon AlasckoPas encore d'évaluation
- Seconde Equations Droites ExDocument7 pagesSeconde Equations Droites ExDIOUFPas encore d'évaluation
- Poly2M271 2015Document74 pagesPoly2M271 2015Kurros LANPas encore d'évaluation
- Cours Math - Chapitre 12 Généralités Sur Les Fonctions - 2ème Sciences MR HamadaDocument4 pagesCours Math - Chapitre 12 Généralités Sur Les Fonctions - 2ème Sciences MR Hamadajihed25100% (2)
- Le Livre Du Serpent NoirDocument6 pagesLe Livre Du Serpent Noiredmonddantes02-1Pas encore d'évaluation
- 6-Outillage ManuelDocument16 pages6-Outillage ManuelYannick NDO'O NDOUMOUPas encore d'évaluation
- IS0102A01MMDocument2 pagesIS0102A01MMdadaPas encore d'évaluation
- BDD Entreprises - Maroc TIC OffshoringDocument1 pageBDD Entreprises - Maroc TIC Offshoringali MPas encore d'évaluation
- TP Zoologie La ParamecieDocument7 pagesTP Zoologie La ParamecieIkram GouasmiPas encore d'évaluation
- Portrait Pierrette GengouxDocument10 pagesPortrait Pierrette GengouxphilodeschampsPas encore d'évaluation
- Manuel de Montage M1911Document13 pagesManuel de Montage M1911minmagPas encore d'évaluation
- Fiche Soutien Sanitaire Sdis 78Document6 pagesFiche Soutien Sanitaire Sdis 78Sébastien LachaumePas encore d'évaluation
- AYEL Jean - Lubrifiants Pour Moteurs Thermiques - Normes GeneralesDocument16 pagesAYEL Jean - Lubrifiants Pour Moteurs Thermiques - Normes GeneralesYodaScribdPas encore d'évaluation
- CV MwabanwaDocument1 pageCV Mwabanwanaasson kapelPas encore d'évaluation
- Cours Chapitre 11Document6 pagesCours Chapitre 11MouRad Es-salmanyPas encore d'évaluation
- DroPix V2Document33 pagesDroPix V2Charly de TaïPas encore d'évaluation
- Plantes Et Microbiote N 3 PDFDocument27 pagesPlantes Et Microbiote N 3 PDFeuqehtbPas encore d'évaluation