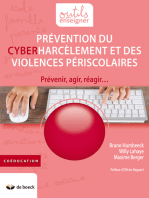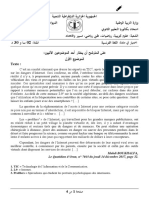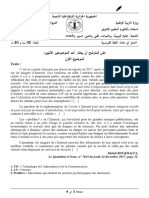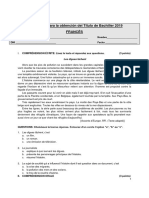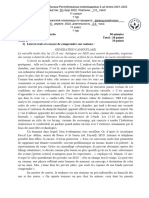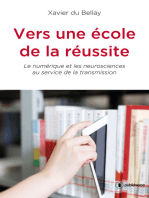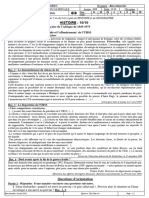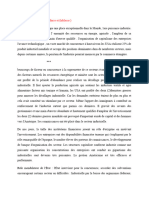Académique Documents
Professionnel Documents
Culture Documents
Suj CorrFrançais Bac2018 Tirés
Suj CorrFrançais Bac2018 Tirés
Transféré par
msambihafilsCopyright
Formats disponibles
Partager ce document
Partager ou intégrer le document
Avez-vous trouvé ce document utile ?
Ce contenu est-il inapproprié ?
Signaler ce documentDroits d'auteur :
Formats disponibles
Suj CorrFrançais Bac2018 Tirés
Suj CorrFrançais Bac2018 Tirés
Transféré par
msambihafilsDroits d'auteur :
Formats disponibles
UNION DES COMORES Examen : Baccalauréat
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Session : 2018
Série : A1 A2 A4 C D G Stc Sti
Epreuve : Français
Coeff. : 4 5 3 3 3 3 3
Nbr pages : 2 Durée : 4 4 4 4 4 4 4
Traitez au choix l’un des trois sujets types suivants
Sujet de type I : Texte argumentatif
A peine sortis de l’école, ils continuent à parler, ont du mal à se quitter au coin de la rue.
Avant, ils faisaient le trajet ensemble. Maintenant, ils s’appellent.
Beaucoup de parents d’adolescents connaissent les mêmes scénarii, éprouvent le même agacement devant ce
temps qu’ils passent, enfermés dans leur chambre, « à parler de tout et de rien » avec leurs copains. Le portable
est pour l’adolescent un moyen d’échapper encore plus à ses parents. Quand il est à la maison et que le
téléphone vibre dans sa poche ou sonne dans sa chambre à minuit, on ne sait qui l’appelle. On peut alors tout
imaginer (« Qui peut donc l’appeler à cette heure-là ?») et les parents anxieux imaginent des choses terribles.
Les parents ont peur aussi que le jeune, à cause du téléphone, ne se concentre plus sur ses devoirs. De toute
façon, ils ne peuvent pas l’obliger à se concentrer, l’empêcher d’avoir des rêveries amoureuses. Le téléphone
lui permet de s’autonomiser par la pensée, de sortir de la maison. Les parents connaissent les mêmes disputes
autour de ces lignes indéfiniment occupées et de ces factures qui explosent à la fin du mois.
Que les parents se rassurent : qu’un adolescent soit pris de « téléphonite » aiguë est en effet tout à fait «normal
». C’est même... le signe qu’il est devenu un adolescent, si onen croit le psychiatre et psychanalyste Didier
LAURU. « Le téléphone fait un peu office de rite de passage. Quand votre enfant vous réclame un mobile et
surtout l’utilise, prévient-il, c’est qu’il entre dans l’adolescence !».
Depuis que cet outil existe, il a rencontré un gros succès auprès des adolescents, en particulier des jeunes filles.
Mais, l’époque où les adolescents se contentaient de «squatter» l’appareil familial au milieu du salon, la famille
profitant largement de leurs conversations est dépassée. Avec le développement des mobiles et autres « sans fil
», leur permettant de couper le cordon avec leurs parents, le téléphone est devenu un objet personnel, intime.
Les opérateurs l’ont compris, et ont « attrapé subtilement le marché » comme le fait remarquer le sociologue
Michel CHAUVIERE, « en envahissant l’espace adolescent... qui s’est laissé aisément capter ».
Si le téléphone rencontre un tel succès auprès des adolescents, c’est d’abord parce qu’il est à l’image de cet âge
intermédiaire où on expérimente l’indépendance, où on veut prendre ses distances par rapport à ses parents tout
en restant proches d’eux. Il s’agit d’un outil transitionnel qui permet de prendre une relative indépendance par
rapport à ses parents, tout en maintenant un minimum de liens avec eux.
Tout comme ils ont besoin de se rencontrer entre eux. « Quand on devient adolescent, explique Didier LAURU,
on a envie de parler de soi, on commence à vouloir parler avec d’autres et on a besoin de le faire. On en parle
plus facilement par téléphone parce qu’on est à l’abri du regard de l’autre et qu’on peut se dire des choses plus
intimes quand le corps n’est pas là. Et cette communication entre adolescents même si elle paraît banale,
anodine, est essentielle pour eux ».
Que le contenu de ces conversations échappe pour l’essentiel aux parents est souvent ce qui les dérange.
Certains fantasment sur ces conversations interminables, ou à répétition. Plus généralement, ils ont l’impression
(souvent justifiée, cette fois-ci) qu’ils se disent entre eux des choses qu’ils ne veulent que leurs parents
entendent. « Il est toujours un peu douloureux de sentir que leurs enfants leur échappent », souligne Didier
LAURU. Il est important que les parents fixent un cadre et des limites. Car le téléphone ne doit pas couper la
communication entre parents et enfants : il peut même l’enrichir. A condition de fixer un minimum de règle :
on ne répond pas, par exemple, au téléphone quand on discute ensemble ou pendant le repas. Les parents
peuvent eux-mêmes s’en servir pour parler davantage avec leurs enfants. Mais, ils doivent leur laisser leur
espace intime, leur jardin secret, et quand ils téléphonent dans la pénombre de leur chambre, se retirer
pudiquement, sur la pointe des pieds.
Christine LEGRAND, dans le journal « La Croix », 18 décembre 2002.
Questions. (10 points)
1. Le pronom « on » est plusieurs fois employé aux sixième et septième paragraphes. A-t-il la même
valeur ? A qui renvoie-t-il ? (2 points)
2. La peur des parents vis-à-vis du téléphone portable de leurs enfants, vous semble-t-elle justifiée ?
Expliquez. (2 points)
Baccalauréat, session 2017. Epreuve : Français Page : 1/2
3. Quelle est la thèse défendue dans ce texte ? (2 points)
4. Est-ce que les propos tenus par Didier LAURU et Michel CHAUVIERE constituent une critique ou
un réconfort pour les parents ? Expliquez. (2 points)
5. De quel type d’argument pouvez-vous qualifier les propos du sociologue Michel CHAUVIERE :
Les opérateurs l’ont compris, et ont « attrapé subtilement le marché en envahissant l’espace
adolescent... qui s’est laissé aisément capter ». (2 points)
Travail d’écriture (10 points)
Étayez l’idée selon laquelle « le portable donne une très large liberté aux adolescents. »
Vous fonderez votre travail sur l’expérience que vous avez de la téléphonie mobile, des réseaux sociaux
et du comportement des adolescents.
Sujet de type II : Commentaire composé
Ce jour-là, ils dinèrent au sommet des buttes, dans un restaurant dont les fenêtres s’ouvraient sur Paris, sur
cet océan de maisons aux toits bleuâtres, pareilles à des flots pressés emplissant l’immense horizon. Leur
table était placée devant une des fenêtres. Ce spectacle des toits de Paris égaya Saccard. Au dessert, il fit
apporter une bouteille de bourgogne. Il souriait à l’espace, il était d’une galanterie inusitée. Et ses regards,
amoureusement, redescendaient toujours sur cette mer vivante et pullulante, d’où sortait la voix profonde
des foules. On était à l’automne ; la ville, sous le grand ciel pâle, s’alanguissait, d’un gris doux et tendre,
piqué çà et là de verdures sombres, qui ressemblaient à de larges feuilles de nénuphars nageant sur un lac ;
le soleil se couchait dans un nuage rouge, et, tandis que les fonds s’emplissaient de brume légère, une
poussière d’or, une rosée d’or tombait sur la rive droite de la ville, du côté de la Madeleine et des Tuileries.
C’était comme le coin enchanté d’une cité des Mille et Une Nuits, aux arbres d’émeraude, aux toits de
saphir, aux girouettes de rubis. Il vint un moment où le rayon qui glissait entre deux nuages fut si
resplendissant, que les maisons semblèrent flamber et se fondre comme un lingot d’or dans un creuset.
- Oh ! vois, dit Saccard avec un rire d’enfant, il pleut des pièces de vingt francs dans Paris !
Emile Zola, La Curée, (Date de publication originale : 1871).
Questions. (5 points)
1. A quel type de texte appartient cet extrait ? Justifiez votre réponse. (1 point)
2. Quelle est la focalisation dominante dans le texte ? (1 point)
3. A partir des réseaux lexicaux de l’image et des couleurs, définissez l’état d’esprit du personnage de
Saccard. (2 points)
4. Quel effet produit la description de la cité merveilleuse des Mille et Une Nuits ? (1point)
Commentaire (15 points)
Faites le commentaire composé de ce texte.
Les questions posées ci-dessus constituent une orientation pour l’organisation de vos axes de lecture. Mais
vous pouvez élaborer le travail de recherche selon vos propres choix des centres d’intérêt.
Sujet de type III : Dissertation
Le candidat traitera au choix l’un des deux sujets (I. ou II.).
I. A partir de votre lecture des Justes et de votre connaissance des attentats terroristes qui secouent le
monde actuellement, exprimez votre opinion sur les motifs des actions entreprises par les lanceurs de
bombes.
II. Etant atteint du Xala, El Hadji peut-il s’affirmer en tant qu’homme ? A-t-il une valeur quelconque à
ses yeux propres ?
Vous construirez votre devoir en vous rapportant sur l’évolution du caractère du personnage à travers
l’œuvre.
Baccalauréat, session 2018. Epreuve : Français Page : 2/2
Examen : Baccalauréat
Session : 2018
Corrigé : Français Série : A1 A2 A4 C D G Stc Sti
Coeff. : 4 5 3 3 3 3 3
Nbr pages : 2 Durée : 4 4 4 4 4 4 4
Ces pistes sont présentées au jury à titre indicatif ; mais le jury seul a latitude de décision sur l’évaluation du
travail fourni par les candidats.
Sujet de type I : Texte argumentatif
Questions (10 points)
1. Le pronom « on » : aux sixième et septième paragraphes, « on » se substitue aux enfants. Il a donc la
valeur de « ils ».(2 points)
2. La peur desparents est justifiée car ils ne savent pas qui est en contact avec leurs enfants : bonne ou
mauvaise fréquentation. Chaque parent voudrait être au fait de tout ce que font ses enfants. Ce qui est une
attitude normale.(2 points)
3.La thèse : Le téléphone portable permet aux adolescents de s’échapper encore plus du contrôle des
parents.(2points)
4.Il s’agit en quelque sorte d’une plaidoirie pour le portable, où le locuteur met en avant les propos
rassurantsd’autorités scientifiques pour réconforter les parents sur le désir d’indépendance des enfants.(2
points)
5.C’est un argument d’autorité en cela qu’il est rapporté d’un spécialiste du domaine psychologique.(2
points)
Travail d’écriture (10 points)
Le type et le domaine de réflexion sont évidents. La téléphonie mobile est un thème important à l’endroit de
tout le monde, et plus particulièrement les adolescents. Les jeunes étant en quasi-permanence connectés aux
réseaux sociaux, il sera aisé au candidat de disserter sur des faits vécus. C’est-à-dire de trouver des arguments
en faveur de l’opinion proposée.
Le correcteur aura, de ce fait à tenir compte de la conformation du candidat à la méthodologie usitée en telle
circonstance (respect de la consigne et des instructions), et évaluera la pertinence des idées exposées par le
candidat.
Sujet de type II : Commentaire
Questions (5 points)
1. Le texte est narratif du fait qu’un narrateur présente les faits et gestes des deux personnages, du début à
la fin du texte (l’emploi du passé simple et de verbes d’action comme : « dinèrent », ainsi que des
indices spatiotemporels) ; quoique certains passages font une description de la ville de Paris.(1 point)
2. La première question oriente implicitement le candidat à la réponse qu’il s’agit de la focalisation
interne. L’ensemble des événements se découvre par la voie du narrateur dans l’emploide la troisième
personne.(1 point)
3. Les réseaux lexicaux de l’image et des couleurs :
mer, verdures, feuilles de nénuphars,
émeraude, Mille et une nuits, saphir, rubis,
toits bleuâtres, ciel pâle, gris doux, nuage rouge,
poussière d’or, rosée d’or, lingot d’or.
La combinaison des deux réseaux présente le personnage de Saccard comme un visionnaire, au sens
mélioratif du terme.(2 points)
4. Le passage de la description de la ville à celle de la cité féerique constitue un rêve éveillé de Saccard.
C’est l’évasion par le merveilleux ; un dépassement qui entraine le lecteur dans la rêverie. (1 point)
Baccalauréat, session 2018. Corrigé : Français Page : 1/2
Commentaire (15 points)
Le correcteur l’aura remarqué, les questions posées sont de facture classique. Elles ont pour objectif de
passer le texte en revue dans sa forme et son fond sans les dissocier.
Il n’est pas inutile de rappeler iciaussi, avant toute chose, que l’auteur est le chef de file du Naturalisme
qui considère que le milieu influence les hommes.
A titre d’exemple, il pourrait être proposé comme centres d’intérêt les deux points suivants :
A. Le rapprochement.
Ce texte qui fait alterner le narratif et le descriptif, décrit assez longuement le décor extérieur avec
un rapprochement des mots dans leur dénotation et leurs connotations (exemple : enchanté + Mille
et une nuits + émeraude + saphir + rubis = image de la fortune).
B. La magie des couleurs.
Les couleurs de plus en plus claires et lumineuses dans la description (par la focalisation interne)
évoquent la gaîté de Saccard qui va grandissant.
Sujet de type III : Dissertation
I. Les Justes
Il y a à peu près un demi-siècle, Albert Camus s’inquiétait de la portée et des effets du nihilisme dans la
révolution (représenté dans la pièce par le personnage de Stépan). L’auteur en fait le témoignage en
s’inspirant de faits réels.
Il est demandé au candidat d’apporter un jugement sur les actes terroristes et la violence aveugle d’hier
et d’aujourd’hui.
Le correcteur devra, par conséquent, être attentif à la solidité de l’argumentation exposée par le
candidat, ainsi que du respect de la démarche suivie : comparer deux séries d’événements, et en tirer
une opinion personnelle.
II. Xala
La consigne attend du candidat qu’il fasse une étude du protagoniste au fil de l’œuvre. Celui-ci ne peut
manquer de constater l’attitude et le comportement d’El Hadji qui vont decrescendo. D’exubérant au
début du texte, il devient à la fin une loque. Tout son faste s’effrite à partir de ce moment : « (…) en
sortant de la douche, j’étais raide. Mais dès que je me suis approché [de N’Goné]. Rien. Zéro. » (P. 52). A
partir de là , il ne s’identifie que par le xala. Tout son monde décline. Son incapacité virile conduit à la
perte de son être-même. Il ne peut plus s’affirmer : il a un sexe amorphe, il devient lui-même amorphe.
Il n’a plus aucune valeur, même aux yeux des mendiants qu’il terrorisait.
Baccalauréat, session 2018. Corrigé : Français Page : 2/2
Vous aimerez peut-être aussi
- 101 Conversations in Intermediate French: 101 Conversations | French EditionD'Everand101 Conversations in Intermediate French: 101 Conversations | French EditionÉvaluation : 3 sur 5 étoiles3/5 (2)
- DNB Blanc /: Français Grammaire Et Compétences Linguistiques Compréhension Et Compétences D'interprétationDocument20 pagesDNB Blanc /: Français Grammaire Et Compétences Linguistiques Compréhension Et Compétences D'interprétationFleur Flur60% (5)
- Largot Sans Frontieres Des Jeunes Europeens QuestionsDocument3 pagesLargot Sans Frontieres Des Jeunes Europeens QuestionsMadhur Chopra67% (3)
- 19GENFRQGCG11Document5 pages19GENFRQGCG11LETUDIANT96% (23)
- CO Tanguy ActivitesDocument8 pagesCO Tanguy ActivitesAn LinhPas encore d'évaluation
- Prévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires: Prévenir, agir, réagirD'EverandPrévention du cyberharcèlement et des violences périscolaires: Prévenir, agir, réagirPas encore d'évaluation
- Cours AntidepresseursDocument91 pagesCours AntidepresseursWilfried FahPas encore d'évaluation
- A Level French FP - Tanguy - ActivitiesDocument8 pagesA Level French FP - Tanguy - ActivitiesĐạt Ngô ThànhPas encore d'évaluation
- (Lớp 11) Ninh Bình 2013-2014 (Có đáp án) -đã chuyển đổiDocument15 pages(Lớp 11) Ninh Bình 2013-2014 (Có đáp án) -đã chuyển đổiTừ Nguyễn Bảo MyPas encore d'évaluation
- Français - 1ère A4&DDocument3 pagesFrançais - 1ère A4&DwullemargePas encore d'évaluation
- 05FRANCES B2 C ComprehensionDocument7 pages05FRANCES B2 C ComprehensionEstrella Maria CasadoPas encore d'évaluation
- DELF B1 JuniorDocument20 pagesDELF B1 JuniorspopiiPas encore d'évaluation
- (123doc) Tai Lieu de Thi Delf b1 So 5Document20 pages(123doc) Tai Lieu de Thi Delf b1 So 5Ngốc XinhPas encore d'évaluation
- 2021 Dalf c1 写作课前练习【2】Document7 pages2021 Dalf c1 写作课前练习【2】Yufeng JiangPas encore d'évaluation
- La Construction D'un Texte ArgumentatifDocument10 pagesLa Construction D'un Texte ArgumentatifFryatte HefiedPas encore d'évaluation
- Piont Delf b1Document24 pagesPiont Delf b1Keyla JacintoPas encore d'évaluation
- Mines Ponts Langues 2014Document13 pagesMines Ponts Langues 2014Jack RefatoPas encore d'évaluation
- 4eme Mensuelle HonorDocument10 pages4eme Mensuelle HonorPaul MboulePas encore d'évaluation
- BAC 2018 Français اختبار في مادة اللغة الفرنسيةDocument4 pagesBAC 2018 Français اختبار في مادة اللغة الفرنسيةKhaled YazidPas encore d'évaluation
- Salim 2020Document9 pagesSalim 2020oceaniquemen sanjijilioPas encore d'évaluation
- Exemple 2Document6 pagesExemple 2Rami ElAliPas encore d'évaluation
- TIGps TA EB2 Avril2022Document38 pagesTIGps TA EB2 Avril2022interactif tchatcheuPas encore d'évaluation
- Delf Junior b2Document18 pagesDelf Junior b2Gabriela Yanti Bakara100% (2)
- Prueba Frances 19Document2 pagesPrueba Frances 19kevinsallereusPas encore d'évaluation
- HB 15Document12 pagesHB 15Ngan GiangPas encore d'évaluation
- 2022 06 S6L2 FRA ExamDocument5 pages2022 06 S6L2 FRA ExamAnna WangPas encore d'évaluation
- FRS SDocument5 pagesFRS SIsabelle RasoarimalalaPas encore d'évaluation
- Frengjisht - b1 Model Testi 2022Document8 pagesFrengjisht - b1 Model Testi 2022Diamanta SericaPas encore d'évaluation
- Examen Blanc Corom 2020-2Document20 pagesExamen Blanc Corom 2020-2raoul yankamPas encore d'évaluation
- Grade 8 FrenchDocument6 pagesGrade 8 FrenchJoe mamaPas encore d'évaluation
- 11 класс француз яз 1 тур 2022Document7 pages11 класс француз яз 1 тур 2022Bunny LerkaPas encore d'évaluation
- CTCANGL06560A Dystopian StoriesDocument5 pagesCTCANGL06560A Dystopian Storieswilldavidtchiakpe01stPas encore d'évaluation
- 7AR22TEPA0023 - Devoir 03Document4 pages7AR22TEPA0023 - Devoir 03Elham NeyshabooriPas encore d'évaluation
- Corrigé PDFDocument7 pagesCorrigé PDFAbanoub RamsisPas encore d'évaluation
- Prova CO EB Jacson1Document3 pagesProva CO EB Jacson1Cris PinheiroPas encore d'évaluation
- b1 SJ Exemple1 CandidatDocument11 pagesb1 SJ Exemple1 Candidatemna51Pas encore d'évaluation
- b2 Exemple3 ExaminateursDocument7 pagesb2 Exemple3 Examinateurs11松老 雲閑Pas encore d'évaluation
- Exemple Sujet Delf A2 ScolaireDocument19 pagesExemple Sujet Delf A2 ScolaireMiguel Angel Contreras RuizPas encore d'évaluation
- De - Chon - DT - 2014 Nghe TinhDocument11 pagesDe - Chon - DT - 2014 Nghe TinhNguyễn Ngân HàPas encore d'évaluation
- Bordeaux UniversitéDocument11 pagesBordeaux UniversitéNhu QuynhPas encore d'évaluation
- Colegiul Agricol Poarta AlbaJeudiDocument6 pagesColegiul Agricol Poarta AlbaJeudiVasilica CiuraruPas encore d'évaluation
- E3c Langues Vivantes Anglais Terminale Specimen 3 Sujet Officiel ADocument6 pagesE3c Langues Vivantes Anglais Terminale Specimen 3 Sujet Officiel AsadekPas encore d'évaluation
- Français A1: Exemple D'ExamenDocument10 pagesFrançais A1: Exemple D'Examenសុខ សៀនPas encore d'évaluation
- Français - Bac .S-Abcd - Coll .TchekeDocument220 pagesFrançais - Bac .S-Abcd - Coll .TchekeClémence BASSALEPas encore d'évaluation
- Examen Francés de Murcia (Ordinaria de 2018) (WWW - Examenesdepau.com)Document6 pagesExamen Francés de Murcia (Ordinaria de 2018) (WWW - Examenesdepau.com)FelipemeloPas encore d'évaluation
- Epreuve Sujet Bac 2021 Technique D'expression Et de Communication 1er Groupe T1 T2 G F6 SenegalDocument2 pagesEpreuve Sujet Bac 2021 Technique D'expression Et de Communication 1er Groupe T1 T2 G F6 SenegalMaguette SeckPas encore d'évaluation
- Ecm Francais Sujet GGM Oct19Document5 pagesEcm Francais Sujet GGM Oct19Amandine CarreauPas encore d'évaluation
- 11 Bilingv Judet 2022Document5 pages11 Bilingv Judet 2022Emma TatarPas encore d'évaluation
- AFANOYOASEQ2Document4 pagesAFANOYOASEQ2yvanbackedeckPas encore d'évaluation
- Vers une école de la réussite: Le numérique et les neurosciences au service de la transmissionD'EverandVers une école de la réussite: Le numérique et les neurosciences au service de la transmissionPas encore d'évaluation
- Au-delà du traducteur averti: Pour préserver le génie de la langueD'EverandAu-delà du traducteur averti: Pour préserver le génie de la languePas encore d'évaluation
- Préparer Mon TCF Canada: Se préparer au TCF Canada, #20731D'EverandPréparer Mon TCF Canada: Se préparer au TCF Canada, #20731Pas encore d'évaluation
- Climate Change in Simple French: Topics that Matter: French EditionD'EverandClimate Change in Simple French: Topics that Matter: French EditionÉvaluation : 2 sur 5 étoiles2/5 (2)
- Enseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?D'EverandEnseigner les langues étrangères: Quels sont nos objectifs et nos priorités ?Pas encore d'évaluation
- 100 jeux de langue à l'école et ailleurs: Guide pratiqueD'Everand100 jeux de langue à l'école et ailleurs: Guide pratiqueÉvaluation : 5 sur 5 étoiles5/5 (1)
- SujetMathsG Bac2018 - TirésDocument1 pageSujetMathsG Bac2018 - TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj CorrHistGéoA4 Bac2018 TirésDocument5 pagesSuj CorrHistGéoA4 Bac2018 TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Mon Cours TerminalDocument88 pagesMon Cours TerminalmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2017 Comores Sujet A4 Histoire-Geographie Bac 2017Document2 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2017 Comores Sujet A4 Histoire-Geographie Bac 2017msambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2018 Comores Sujet A4 Histoire-Geographie Bac 2018Document3 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2018 Comores Sujet A4 Histoire-Geographie Bac 2018msambihafilsPas encore d'évaluation
- Cartes Et Documents en Histoire-Géographie: SecondeDocument24 pagesCartes Et Documents en Histoire-Géographie: SecondemsambihafilsPas encore d'évaluation
- Cours T13Document3 pagesCours T13msambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj CorrMaths T Bac2018 TirésDocument7 pagesSuj CorrMaths T Bac2018 TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- SujetMathsC Bac2018 - TirésDocument3 pagesSujetMathsC Bac2018 - TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Corr 2013 Comores Corr A4 Histoire-Geographie Bac 2013Document4 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Corr 2013 Comores Corr A4 Histoire-Geographie Bac 2013msambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj CorrHistGéoA4 Bac2018 TirésDocument5 pagesSuj CorrHistGéoA4 Bac2018 TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- DjavetDocument3 pagesDjavetmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj - CorrEconom G Bac2018 - TirésDocument4 pagesSuj - CorrEconom G Bac2018 - TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Cahier D Exercice TerminaleDocument102 pagesCahier D Exercice TerminalemsambihafilsPas encore d'évaluation
- Mouna GDocument2 pagesMouna GmsambihafilsPas encore d'évaluation
- CorrectionDocument1 pageCorrectionmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj CorrDroitsG Bac2018 TirésDocument2 pagesSuj CorrDroitsG Bac2018 TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Suj CorrEducReligA2Bac2018 TirésDocument4 pagesSuj CorrEducReligA2Bac2018 TirésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2016 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2016Document4 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2016 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2016msambihafilsPas encore d'évaluation
- Fascicule de Corrigées IèreDocument6 pagesFascicule de Corrigées IèremsambihafilsPas encore d'évaluation
- Grille de Correction Bac Octobre 2020Document12 pagesGrille de Correction Bac Octobre 2020msambihafilsPas encore d'évaluation
- Devoir Maison N°2 CUBA Non Corrigé Décembre 2019Document2 pagesDevoir Maison N°2 CUBA Non Corrigé Décembre 2019msambihafilsPas encore d'évaluation
- Mouna 1Document2 pagesMouna 1msambihafilsPas encore d'évaluation
- Sujets CorrigésDocument10 pagesSujets CorrigésmsambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2013 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2013Document3 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2013 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2013msambihafilsPas encore d'évaluation
- Stock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2017 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2017Document3 pagesStock LesPdf Examens BAC Comores Sujet 2017 Comores Sujet C Histoire-Geographie Bac 2017msambihafilsPas encore d'évaluation
- Leçon Complet TerminaleDocument57 pagesLeçon Complet TerminalemsambihafilsPas encore d'évaluation
- Histoire Faits Economiques Chap 5 Cours v2Document40 pagesHistoire Faits Economiques Chap 5 Cours v2msambihafilsPas encore d'évaluation
- PP Entretien La Recherche Nov.06Document6 pagesPP Entretien La Recherche Nov.06msambihafilsPas encore d'évaluation
- Tirer Le Meilleur Parti de TwitterDocument127 pagesTirer Le Meilleur Parti de Twittercaptainjob93% (15)
- Les Mots InvariablesDocument3 pagesLes Mots Invariablesulrich ngnalaPas encore d'évaluation
- Joyce McDougallDocument2 pagesJoyce McDougallbarjot100% (1)
- La Fonction Muette Du Langage - Jacques CoursilDocument4 pagesLa Fonction Muette Du Langage - Jacques CoursilLeonorOrtizPas encore d'évaluation
- Lettres de Motivation CpgeDocument4 pagesLettres de Motivation CpgeMehdi El KarnePas encore d'évaluation
- Epreuve de Physiologie Session Janvier 2002 Portez Les Réponses Sur Les Feuilles Réservées À Cet EffetDocument5 pagesEpreuve de Physiologie Session Janvier 2002 Portez Les Réponses Sur Les Feuilles Réservées À Cet Effetyaya camaraPas encore d'évaluation
- Bary Et Prod Scal 1S1Document4 pagesBary Et Prod Scal 1S1ousseynou mbayePas encore d'évaluation
- Sansoni Caterina 2016 ED520 PDFDocument339 pagesSansoni Caterina 2016 ED520 PDFGuilherme Malvicini Ponteiro Das CruzesPas encore d'évaluation
- Fiches 1acsDocument31 pagesFiches 1acsHamid TahaPas encore d'évaluation
- TP L1 LMD 2022-2023Document5 pagesTP L1 LMD 2022-2023jo100% (1)
- Hafida Aferyad - Blurring The Boundaries - Une Poétique D'altérité Dans L'écriture D'angela CarterDocument9 pagesHafida Aferyad - Blurring The Boundaries - Une Poétique D'altérité Dans L'écriture D'angela Carterdanutza123Pas encore d'évaluation
- Livre II RèglesDocument40 pagesLivre II RèglesEscargotPas encore d'évaluation
- Pedicule HepatiqueDocument5 pagesPedicule HepatiqueTanguy Doumbia100% (1)
- Marchal Elric Mémoire M1 2022-2023Document49 pagesMarchal Elric Mémoire M1 2022-2023oledrastanPas encore d'évaluation
- Igot You BabeDocument2 pagesIgot You BabeŽeljko ČeganjacPas encore d'évaluation
- Le Langage PDFDocument22 pagesLe Langage PDFSeda Kabil100% (2)
- Guide FUFDocument31 pagesGuide FUFrayaneaggoune2004Pas encore d'évaluation
- Relation Hote - BactérieDocument2 pagesRelation Hote - BactérieRamzi Rz100% (1)
- Rapport FinalDocument38 pagesRapport FinalYosra HouliPas encore d'évaluation
- Gonalgie, Quand Prescrire Une Imagerie Et LaquelleDocument7 pagesGonalgie, Quand Prescrire Une Imagerie Et LaquelleBa abkPas encore d'évaluation
- Dictionnaire Des Calembours Et Des Jeux de Mots Lazzis Coqs À L'âne Quolibets Quiproquos Amphigouris Etc.Document270 pagesDictionnaire Des Calembours Et Des Jeux de Mots Lazzis Coqs À L'âne Quolibets Quiproquos Amphigouris Etc.Rosie100% (1)
- TD - DR YIMKO - CISMED-SANTE 2023-2024Document39 pagesTD - DR YIMKO - CISMED-SANTE 2023-2024Aimé Le MarioPas encore d'évaluation
- QE Radiologie Par Khadija Belcadi KBADocument30 pagesQE Radiologie Par Khadija Belcadi KBAkhaoulaelkasri0Pas encore d'évaluation
- Une Volumineuse Tumeur Hepatique - 243Document8 pagesUne Volumineuse Tumeur Hepatique - 243Nadjette BouregbaPas encore d'évaluation
- Cours DerivabiliteDocument20 pagesCours Derivabilitestephane flandrinPas encore d'évaluation
- Exos SuitesDocument13 pagesExos Suitesjeanpatrickkouame5Pas encore d'évaluation
- Guide D Entretien MémoireDocument1 pageGuide D Entretien Mémoiremathildeneige.sanchezPas encore d'évaluation
- LCDD 102 0010Document12 pagesLCDD 102 0010Martial TchapdaPas encore d'évaluation
- BAC Sciences Physiques Et Chimiques 2010 ST2SDocument9 pagesBAC Sciences Physiques Et Chimiques 2010 ST2SLetudiant.frPas encore d'évaluation